L’essor de la police scientifique a définitivement implanté l’expertise au cœur de la procédure judiciaire. Pourtant, les prérequis d’une expertise scientifique ne sont pas toujours bien encadrés.
Par Damien Charabidze, 17.02.2020
"Chercheur de profession, je suis spécialiste des insectes nécrophages (ceux qui colonisent les cadavres), un domaine maîtrisé par une poignée de personnes en Europe. Je suis donc régulièrement mandaté par la justice pour analyser des prélèvements d’insectes et dater la mort (entomologie médico-légale).
Un cas récent concernait une affaire de meurtre : le cadavre de la victime, aspergé de produits chimiques, avait été découvert caché sous des branchages dans un dépôt d’ordures. Ces circonstances particulières soulevaient de nombreuses questions techniques qui pouvaient influencer la datation du décès. En effet, la présence antérieure de larves sur les déchets était probable, et certains pesticides ou toxiques sont connus pour modifier l’arrivée des mouches et le développement de leurs larves. J’intégrais donc au mieux les connaissances scientifiques actuelles dans mes analyses tout en soulignant les limites de ce cas particulier.
Après avoir présenté – avec une certaine appréhension – mes conclusions lors du procès aux Assises, je n’eu droit qu’à une seule question, plutôt inattendue :
« Monsieur l’Expert, vous parlez d’asticots et de mouches, pouvez-vous nous préciser la différence entre les deux ? »
Après une brève hésitation :
« Comme je l’ai indiqué, les mouches sont attirées par le cadavre pour y pondre leurs œufs, qui se transforment ensuite en asticots. Les asticots sont donc les larves des mouches. »
« Ah d’accord… Merci. »
Il n’y eut pas d’autre question : ma déposition était terminée, et mes conclusions implicitement entérinées. Cet exemple m’a amené à réfléchir sur la fonction de l’expert.
L’expertise scientifique
L’expert peut être défini comme un technicien, c’est-à-dire un spécialiste d’une ou plusieurs techniques mettant en application une science donnée. Dans un contexte judiciaire, son expertise a pour but d’éclairer une question de nature technique ou scientifique utile à la manifestation de la vérité, selon la formule consacrée. Mais la loi ne définit pas explicitement la notion d’expertise, et la profession d’expert judiciaire n’existe pas en tant que telle.
Le Code de procédure pénale précise simplement que :
« Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties ordonner une expertise » (Art. 156).
Dans la même idée, le Code de procédure civile prévoit que le juge peut « commettre toute personne de son choix pour l’éclairer […] sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. » (Art. 232)
Le terme d’« expert judiciaire » unifie donc sous une pratique commune des acteurs hétéroclites, venant de diverses spécialités et ayant des parcours très différents.
Pour figurer sur la liste des experts, il faut justifier « d’une aptitude professionnelle (qualification suffisante) dont l’établissement dépend de chaque spécialité ». En d’autres termes, il est demandé à l’expert de fournir les preuves de sa compétence, preuves qui résident le plus souvent en un diplôme, une expérience antérieure ou une reconnaissance par les pairs. L’évaluation des compétences est ainsi déléguée à des institutions extérieures (Universités, Sociétés savantes, organismes d’accréditation, etc.), sans contrôle direct du législateur.
Alors même que ses conclusions se révèlent souvent déterminantes, la nomination de l’expert au pénal est donc paradoxalement peu encadrée. Cette question est pourtant cruciale, car si ses compétences peuvent être débattues lors des audiences, elles sont implicitement validées par sa simple nomination. Tandis que la procédure civile (par exemple un litige sur la réalisation de travaux) prévoit une phase de concertation avant le rendu final des conclusions d’expertises (procédure contradictoire), une telle disposition n’existe pas dans les affaires criminelles (procédure pénale)."
(...)



 Your new post is loading...
Your new post is loading...

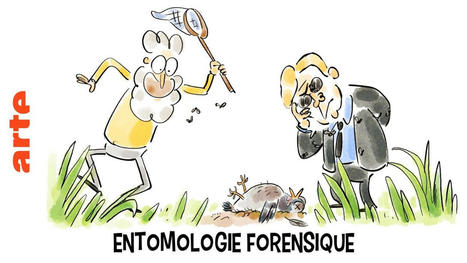





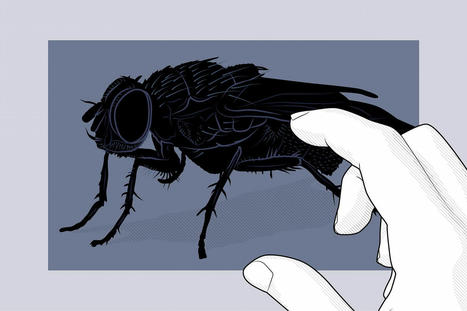








Sur le même sujet :
Mon fils de 4 ans a dit à la maîtresse que plus tard, il voulait être entomologiste forensique - De tumourrasmoinsbete.blogspot.fr - 11 décembre 2013, 23:50