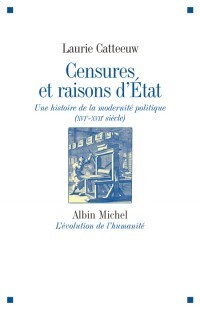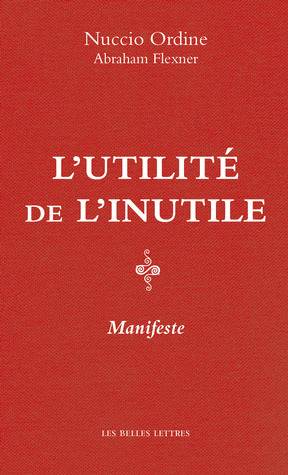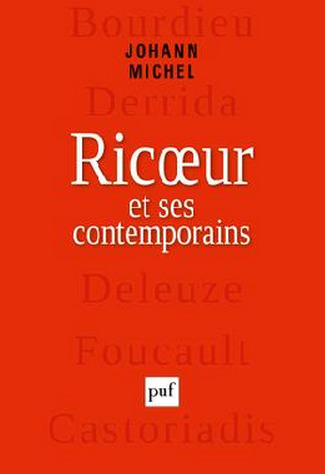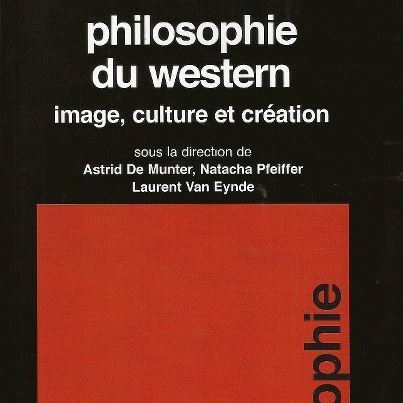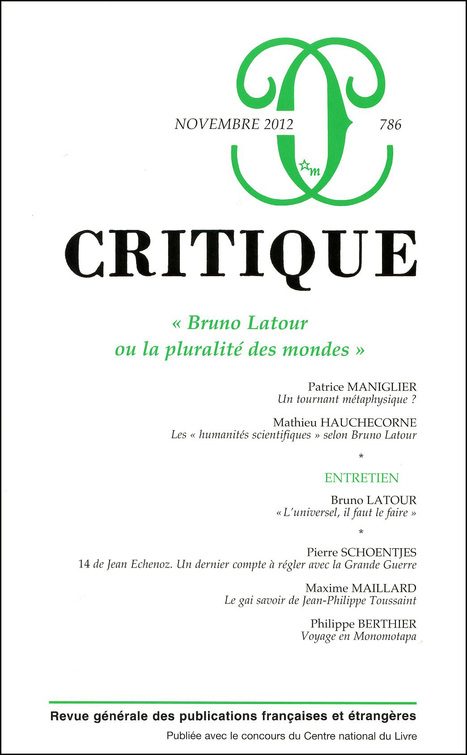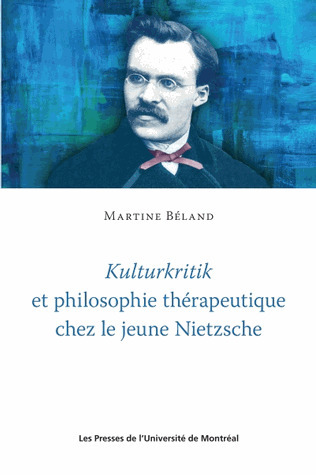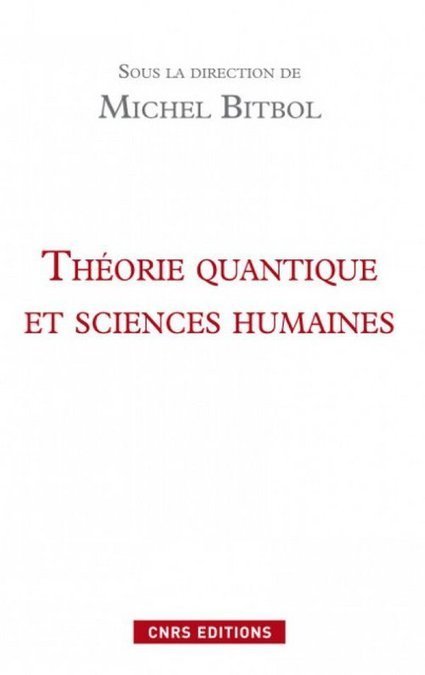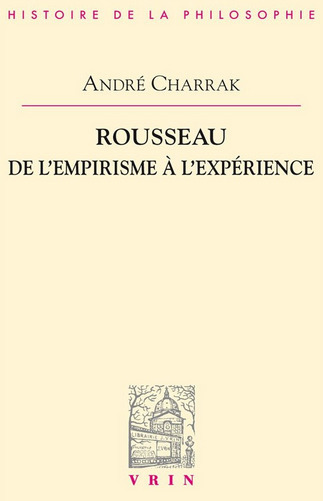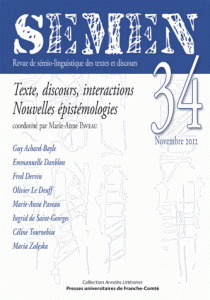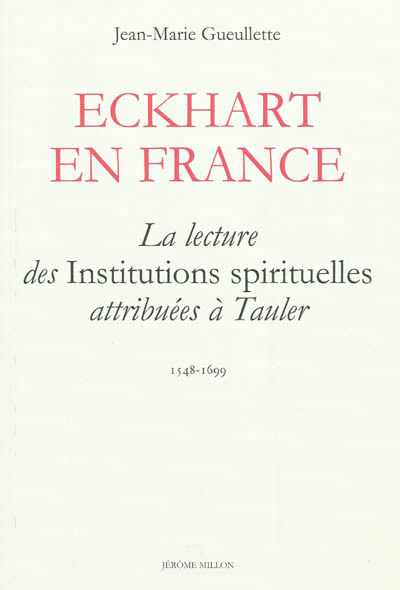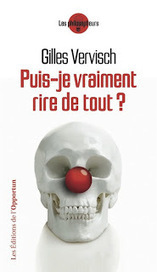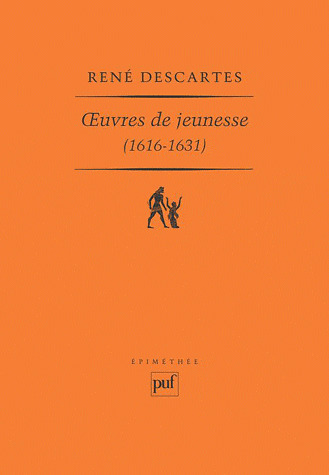Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
dm
February 18, 2013 6:00 AM
|
Magali Besson : Sans distinction de race ? Une analyse critique du concept de race et de ses effets pratiques
Vrin, « Philosophie concrète », 2013. Le concept de race – et ses déclinaisons catégorielles – a été historiquement enrôlé pour justifier de multiples formes d’injustice : discrimination, exploitation, oppression, voire annihilation de groupes entiers de l’humanité. Pour lutter contre le racisme, il a donc pu sembler cohérent de vouloir définitivement disqualifier le concept qui en constituerait le fondement. Ce livre défend pourtant la thèse adverse : entreprendre de réduire les inégalités raciales exige un usage analytique et critique du concept de race. Socialement construites, les catégories raciales sont aujourd’hui à l’œuvre, de manière plus ou moins masquée, dans de nombreuses pratiques administratives, juridiques et politiques. Ne pas les nommer, c’est s’interdire d’en débusquer les effets discriminatoires. Une philosophie politique soucieuse de penser l’injustice sociale sous toutes ses formes, mettant sa compétence propre de clarification conceptuelle au service d’un engagement politique, se doit d’affronter la question raciale. Magali Bessone est maître de conférences en philosophie politique à l’Université de Rennes 1 et membre de l’Institut Universitaire de France.

|
Scooped by
dm
February 17, 2013 3:13 AM
|
Johannes Angermuller : Le champ de la théorie. Essor et déclin du structuralisme en France
Johannes Angermuller
Le champ de la théorie
Essor et déclin du structuralisme en France
Hermann
2013
Présentation de l'éditeur Pendant les années 1960 et 1970, le champ intellectuel français donne lieu à une conjoncture dont on n’a pas fini de mesurer les effets. Avec le boom des sciences humaines, la scène intellectuelle de l’époque connaît une effervescence théorique sans pareille. En cette période où les modes s’enchaînent d’une année à l’autre émerge une somme considérable de mouvements avant-gardistes autour du structuralisme… Le présent ouvrage porte un regard nouveau sur une période si productive en théories et en concepts : celui d’un sociologue qui examine le monde derrière les idées : les cercles, circuits et groupes, les formations, carrières et trajectoires, les institutions éducatives et les maisons d’édition. Johannes Angermuller est Professeur du Discours à l'Université de Warwick, Royaume-Uni, et directeur du groupe de recherche DISCONEX à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris. Après avoir fait des études en Allemagne et aux États-Unis, il a obtenu un doctorat en sociologie et en analyse du discours en 2003 à l'Université de Paris Est (Créteil) et à l'Université de Magdebourg, Allemagne. Ses travaux portent notamment sur les discours académiques et politiques.

|
Scooped by
dm
February 17, 2013 2:02 AM
|
Page 5 à 7 : Alexander Schnell - L'image de l'infini. Sources spéculatives de l'idéalisme allemand | Page 9 à 34 : Romain Dufêtre - Proximités des théories de l'image chez Maître Eckhart et Fichte | Page 35 à 59 : Jean-Christophe Lemaitre - Figures de l'unité. Schelling et Nicolas de Cues | Page 61 à 79 : Frédéric Vengeon - Infini et logique spéculative. Deux philosophies de l'absolu : Nicolas de Cues et Hegel | Page 81 à 102 : Charles Théret - Deux métaphysiques de la mobilité. Giordano Bruno ou Schelling | Page 103 à 124 : Gerhard Schmezer - Wittgenstein, lecteur de la Bible | Page 125 à 146 : - Comptes rendus | Page 147 à 192 : - Bulletin cartésien XLII.

|
Scooped by
dm
February 4, 2013 3:49 PM
|
"Censures et raisons d’Etat” par Laurie Catteeuw
Expression d’un pouvoir absolu et de son arbitraire, symbole du sacrifice des individus à l’intérêt commun, la raison d’État semble toujours assignée au secret et à l’obscurité des cabinets princiers. Mis à l’Index dès la fin du XVIe siècle, de nombreux écrits lui sont pourtant consacrés, projetant la notion sur la place publique qui devient, en retour, l’un des lieux décisifs de son élaboration.
Mais que peut bien apporter à l’État, et à la société moderne, la publication massive de secrets politiques ?
Née de sa rivalité avec la raison d’Église, entre guerres de Religion et primat du politique, la raison d’État a des visages multiples et contradictoires. Cet ouvrage les déchiffre à travers les diverses pratiques de censure en usage aux XVIe et XVIe siècles. Clair-obscur de la modernité politique, les rapports entre censures et raisons d’État ne se réduisent pas à la part d’ombre du pouvoir absolu : ils appartiennent aussi à l’histoire de l’acquisition des libertés individuelles, à la formation de l’opinion publique et à la construction des sociétés modernes. À l’encontre des idées reçues, l’enquête de Laurie Catteeuw montre que la raison d’État ne fut pas seulement l’instrument de l’absolutisme, l’enfant du Léviathan, mais que, à sa genèse, participèrent aussi les opposants à ses pouvoirs, libertins et auteurs de libelles diffamatoires.
L’histoire contée dans ce livre se passa voici quatre siècles. Elle est pourtant essentielle à l’intelligence de notre temps.

|
Scooped by
dm
January 30, 2013 10:00 AM
|
Abraham Flexner (1866 - 1959), Nuccio Ordin : L'Utilité de l'inutile. Manifeste
Il n'est pas vrai – pas même en temps de crise – que seul ce qui est source de profit soit utile. Il existe dans les démocraties marchandes des savoirs réputés « inutiles » qui se révèlent en réalité d’une extraordinaire utilité. Dans cet ardent pamphlet, Nuccio Ordine attire notre attention sur l’utilité de l’inutile et sur l’inutilité de l’utile. À travers les réflexions de grands philosophes (Platon, Aristote, Tchouang-tseu, Pic de la Mirandole, Montaigne, Bruno, Kant, Tocqueville, Newman,Heidegger) et de grands écrivains (Ovide, Dante, Pétrarque, Boccace, L’Arioste, Cervantès, Lessing, Dickens, Okatura Kakuzô, García Márquez, Ionesco, Calvino), Nuccio Ordine montre comment l’obsession de posséder et le culte de l’utilité finissent par dessécher l’esprit, en mettant en péril les écoles et les universités, l’art et la créativité, ainsi que certaines valeurs fondamentales telle que la dignitas hominis, l’amour et la vérité. Dans son remarquable essai traduit pour la première fois en français, Abraham Flexner souligne que les sciences, elles aussi, nous enseignent l’utilité de l’inutile. Ainsi, s’il élimine la gratuité et l’inutile, s’il supprime les luxes jugés superflus, l’homo sapiens aura bien du mal à rendre l’humanité plus humaine. Les belles Lettres - 2012
L’ambition de cette nouvelle livraison de Tracés est autant de contribuer activement à réévaluer la portée conceptuelle du terme « diaspora », que de présenter un état des lieux critique des recherches sur le sujet.
Via carol s. (caravan café)

|
Scooped by
dm
January 16, 2013 5:29 PM
|
Page 1 : Dominique Lecourt - Avant-propos | Page 3 à 17 : Claude Olivier Doron - Introduction | Page 19 à 34 : Pascal Nouvel - Eero Mäntyranta. Un champion génétiquement (et naturellement) modifié | Page 35 à 83 : Jean-Noël Missa - Dopage, médecine d'amélioration et avenir du sport | Page 85 à 106 : Gérard Dine - Champions de demain : prédisposition naturelle optimisée ou amélioration structurelle programmée ? | Page 107 à 123 : Bengt Kayser - La politique antidopage : un dilemme éthique | Page 125 à 139 : Alexandre Mauron - Le dopage et (est ?) l'esprit du sport | Page 141 à 158 : Christophe Brissoneau - Éthique médicale et imposition des normes sportives (1985-2009) | Page 159 à 177 : Patrick Laure - La prévention du dopage et des conduites dopantes : le rocher de Sisyphe | Page 179 à 194 : Jean-Paul Thomas - La performance médicale ou le médecin dopé | Page 195 à 215 : Isabelle Queval - « Nature » et « surnature » du corps sportif | Page 217 à 234 : Denis Haw - « Commande » et « autonomie » dans la compréhension de l'activité des sportifs de haut niveau : quels savoirs pour l'éthique du dopage ?.

|
Scooped by
dm
January 16, 2013 12:37 AM
|
Johann Michel - Ricoeur et ses contemporains : Bourdieu, Derrida, Deleuze, Fourcault, Castoriadis
Si l’on connaît aujourd’hui le dialogue fructueux que Paul Ricœur a noué avec les penseurs structuralistes, on ignore largement son positionnement face à la mouvance poststructuraliste. Faut-il opposer la philosophie de Ricœur au poststructuralisme à la française ou au contraire doit-on montrer qu’elle en est une variante singulière ?
C’est la seconde option qui est ici défendue. Certes, le poststructuralisme ne doit pas être considéré comme une école de pensée mais comme une reconstruction qui relève de l’histoire de la philosophie. Dans la mesure où les horizons de dépassement du structuralisme ont été posés de manière chaque fois particulière, il est préférable de parler de poststructuralismes au pluriel. C’est la raison pour laquelle l'auteurl propose des confrontations dyadiques entre Ricœur et certains de ses contemporains (Deleuze, Derrida, Foucault, Bourdieu…) que l’on regroupe habituellement dans cette mouvance. - Paru le 16/01/2013 - PUF - 19 €

|
Scooped by
dm
January 9, 2013 12:07 PM
|
Philosophie du western. Image, culture et création
Le cinéma naît alors que l’épopée de l’Ouest touche à sa fin. En 1895, on déclare la fin de la Frontière et le cinéma prend la relève du mouvement de conquête. Les fondateurs de Hollywood ne manqueront pas de faire eux-mêmes le parallèle. Dès qu’il y eut cinéma aux États-Unis, il y eut western… Ce rapport de proximité entre l’époque et l’invention d’un nouveau mode de création nourrit une intimité sur laquelle fait fond le western classique américain. Au fil des contributions ici rassemblées, les angles d’approches se multiplient : esthétique, anthropologie philosophique, philosophie sociale et politique, philosophie de l’histoire, histoire de l’art et études cinématographiques. En mobilisant essentiellement des compétences et des références philosophiques, mais aussi les vertus de l’interdisciplinarité, ce collectif se propose de poser les jalons d’une étude approfondie de l’image westernienne en traitant les enjeux des limites et frontières, de la justice sans cesse réinterrogée, de l’étranger, du lointain, du vivre ensemble, de la persécution, de l’imaginaire culturel et social et de l’invention historique... Sous la direction de : Astrid De munter, Natacha Pfeiffer et Laurent Van Eynde, avec la collaboration de : Daniel Agacinski, Augustin Dumont, Franck Kausch, Florence Gravas, Laurent Jullier, Jean-Marc Leveratto, Philippe Sabot, Jean-Jacques Melloul et William Bourton
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, Belgique

|
Scooped by
dm
December 30, 2012 4:42 PM
|
Critique n° 786 : Bruno Latour ou la pluralité des mondes
Bruno Latour est infatigable. De la fabrique des faits scientifiques ou des objets techniques à l'ethnopsychiatrie, en passant par la religion, le droit, la politique ou les récentes controverses sur le changement climatique, aucun domaine du savoir et des pratiques ne lui est étranger. Depuis plus d"un quart de siècle, son ambitieux programme d’une anthropologie des « Modernes » lui fait parcourir dans toute son extension le « plurivers » où l’humanité invente son destin - monde bigarré, plein de hiatus, de malentendus et de controverses. En « diplomate » attentif à la pluralité réelle des intérêts, des valeurs, mais aussi des modes d’existence, il ne se contente pas de décrire les points de tension ; il entend les traiter en convoquant à la table des négociations le savant et le schizophrène, l’économiste et le militant écologiste, et pourquoi pas les non-humains avec les humains. C’est du moins ce qu’annonce sa vaste Enquête sur les modes d’existence, tout récemment parue. Le dossier que nous lui consacrons en cerne les enjeux aux confins de l’anthropologie et de la métaphysique, avec des articles de Mathieu Hauchecorne et de Patrice Maniglier, complétés par un entretien inédit avec Bruno Latour.

|
Scooped by
dm
December 30, 2012 4:15 PM
|
Kulturkritik et philosophie thérapeutique chez le jeune Nietzsche, par Martine BÉLAN
Dans la Grèce ancienne, on considérait la philosophie comme un remède aux maux de l'âme, comme une thérapeutique permettant à l'individu d'atteindre l'indépendance et la tranquillité d'esprit par la connaissance de soi. Il n'est pas étonnant de retrouver des échos de cette pensée sous la plume du jeune philologue Friedrich Nietzsche. Dans ses premiers écrits, Nietzsche, alors professeur à l'Université de Bâle, donne à cette préoccupation thérapeutique la forme de la Kulturkritik : le philosophe est un médecin qui lutte contre la maladie de la civilisation, en s'en prenant à la fois aux causes et aux manifestations du mal. Cette entreprise l'amène à critiquer les postures caractéristiques du moderne : l'optimisme théorique, l'esprit scientifique, le relativisme historique, l'esthétique de l'imitation, la dignité accordée au travail. /// Les presses de l'université de Montréal - octobre 2012

|
Scooped by
dm
December 24, 2012 2:06 AM
|
Pour Orwell, « le concept de vérité objective est celui de quelque chose qui existe en dehors de nous, quelque chose qui est à découvrir et non qu’on peut fabriquer selon les besoins du moment ». Le plus effrayant dans le totalitarisme n’est pas qu’il commette des « atrocités » mais qu’il s’attaque à ce concept. Pourtant, cette perspective d’un monde d’où l’idée de vérité objective aurait disparu n’effraie guère la plupart des intellectuels de gauche. Qu’ils se réclament de Rorty le « libéral » ou de Foucault le « subversif », ils y travaillent activement en proclamant que ces idées sont dépassées, dogmatiques et finalement réactionnaires.
Cet essai montre que « préservation de la liberté et préservation de la vérité représentent une seule et indivisible tâche, commune à la littérature et à la politique ». Celle-ci ne présuppose aucun postulat métaphysique mais seulement la reconnaissance du rôle fondamental que joue dans nos vies le concept commun et ordinaire de « vérité ».
De tels débats ne sont pas « purement philosophiques ». O’Brien, le dirigeant politique qui torture méthodiquement le héros de 1984, n’est pas un colonel parachutiste mais un philosophe cultivé, ironiste et courtois, professant qu’il n’y a pas de réalité objective et que « tout est construit ».Click here to edit the title
Théorie quantique et sciences humaines est un recueil de huit articles réalisé sous la direction de Michel Bitbol. D’emblée, signalons qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage traitant des conséquences philosophiques de certains résultats de la physique quantique comme par exemple les extrapolations d’ordre psychologique de Wigner à propos de la réduction du paquet d’ondes [1], mais l’intention de ce livre est plutôt de suggérer une identité de méthode entre la mécanique quantique et les sciences humaines et plus particulièrement les théories de la décision.
Via Plasticities Sciences Arts
|

|
Scooped by
dm
February 18, 2013 5:55 AM
|
André Charrak : Rousseau, De l’empirisme à l’expérience
Vrin, « Bibliothèque d’Histoire de la Philosophie », 2013. L’un des traits constants de la pensée de Rousseau réside dans la méditation qu’il poursuit jusqu’à la fin de sa vie sur l’amour de soi – sur l’affection essentielle de l’être sensible et intelligent. Mais les ressources mobilisées dans cette entreprise ne demeurent pas les mêmes tout au long de l’œuvre et elles se forgent avant tout dans un effort d’appropriation puis de mise à distance de la philosophie de son temps. C’est cet effort méthodologique qui est analysé dans le présent ouvrage. Du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité à l’Émile, Rousseau perfectionne un empirisme qui confère son caractère systématique à la « théorie de l’homme » mais qui, à terme, révèle ses limites dans l’examen des idées sublimes (l’ordre du monde voulu par Dieu, l’existence de l’âme) que l’homme moderne doit prendre en vue. Aussi importe-t-il de comprendre de quelle façon Rousseau abandonne cette perspective au long des recherches qui, en 1778, aboutissent à l’œuvre ultime achevée au seuil de la mort : Les Rêveries du promeneur solitaire. Le cheminement que l’on peut retracer en suivant la voie royale de la méthode découvre une dernière philosophie de Rousseau, où la clarification d’expériences décisives (l’accident, la rêverie) se substitue au style philosophique de l’époque pour découvrir les conditions d’un bonheur effectif. Membre de l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (UMR 5037), André Charrak enseigne à l’Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne.

|
Scooped by
dm
February 17, 2013 2:04 AM
|
Page 4 à 182 : Clarisse Hahn, Florence Lazar - Icônes | Page 13 à 17 : Ariel Kyrou - « Alea ACTA est » | Page 22 à 26 : Olivier Razac - L'hydre pénale à trois têtes | Page 36 à 42 : Lucia Sagradini - Exp(l)oser le temps | Page 56 à 64 : Yves Citton, Frédéric Neyrat, Dominique Quessada - Envoûtements médiatiques | Page 65 à 73 : Franco Berardi, Frédéric Neyrat - Média-activisme revisité | Page 74 à 85 : Erich Hörl, Guillaume Plas - Le nouveau paradigme écologique | Page 86 à 90 : Steven Shaviro, Frédéric Neyrat - Comment traduire une forme de vie ? | Page 91 à 98 : Daniel Bougnoux - Onde ou corpuscule ? | Page 99 à 110 : Eugene Thacker, Yves Citton - Antimédiation | Page 111 à 119 : Barbara Karatsioli - Les drones : nouveau médium de guerre ? | Page 120 à 126 : Jean-Paul Galibert - Hypertravail et chronophagie | Page 127 à 136 : Pierangelo Di Vittorio - Comme des poissons dans l'eau | Page 137 à 141 : Harleen Quinzel - Métaphysique du Joker | Page 142 à 149 : Thierry Bardini - En marchant avec une multitude de spectres prismatiques | Page 163 à 171 : Jérémie Zimmermann , Ariel Kyrou, Victor Secretan - Internet : 1 – ACTA : 0 | Page 184 à 186 : Frédéric Bisson, Frédéric Bisson, Pascal Houba - Musiques mineures, musiques pensantes | Page 187 à 193 : Dominique Dupart - Pour une musique de résistance | Page 194 à 200 : Pierre Deruisseau - Le Pharaon contre-attaque | Page 201 à 207 : Alexandre Pierrepont - Anthony Braxton, méta-réaliste | Page 208 à 211 : Catherine Guesde - L'éthique du hardcore | Page 212 à 218 : Frédéric Claisse - « We come in peace ».

|
Scooped by
dm
February 7, 2013 3:18 PM
|
L'autorité et l'autoritarisme font l'objet d'une réflexion constante, bien que souvent inaperçue, dans ce qu'on a appelé "l'école de Francfort". Des années 1930 aux années 1940, elle est présente dans les écrits de l'ensemble des penseurs de la première génération : Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse, Pollock, Löwenthal, ou encore Benjamin, Neumann, Kirchheimer. En analysant les phénomènes de servitude volontaire, de soumission à un chef, d'autorité dans la famille et dans la culture de masse, tels qu'ils se manifestent sous leurs yeux, les théoriciens critiques s'intéressent en fait aux différentes formes que peut prendre l'intériorisation de la domination sociale. Leur critique de l'autorité fait apparaître les facteurs psychiques, sociaux et politiques qui assurent la reproduction d'un ordre social irrationnel et barrent la voie à l'émancipation. Prenant les écrits de Horkheimer comme point d'entrée dans le problème de l'autorité, l'ouvrage de Katia Genel étudie l'ensemble des débats menés par les théoriciens de l'Institut de recherche sociale. A travers le thème de l'autorité, traité tout au long de ces années de manière interdisciplianire, se dessine ainsi un visage de "l'école de Francfort" différent de celui que l'on a coutume de présenter. Ces analyses éclairent la thèse d'une connivence entre raison et domination présente dans la Dialectique de la raison ; elles constituent en un sens le laboratoire de la théorie de la domination qui s'y trouve développée, et en montrent toute la complexité. Comment penser la transformation de la société quand la psychanalyse nous dévoile des êtres pulsionnels attachés à l'irrationalité de l'ordre existant ? Quels sont les facteurs politiques et juridiques qui entravent ou au contraire favorisent l'autonomie psychique des individus ? Et quelle est la possibilité même de la critique lorsque l'autoritarisme affecte la pensée et que la théorie elle-même perd toute autorité ? C'est à partir de cette triple perspective qu'il convient de repenser les conditions de l'émancipation. Éditions Payot et Rivages 6 février 2013

|
Scooped by
dm
February 4, 2013 3:38 PM
|
Cette livraison propose une réflexion sur les nouvelles manières d’aborder les textes, discours et interactions par rapport aux modifications épistémologiques repérables ces vingt dernières années, en particulier celles impliquées par le dépassement des grands binarismes du type esprit/corps ou langue/monde. Les auteurs proposent une critique constructive des théories et méthodologiesmainstream en linguistique et présentent des approches moins disciplinarisées dans la perspective d’une épistémologie critique. Les articles font travailler l’interdisciplinarité sur le plan des théories, des méthodes et des pratiques scientifiques, dans une perspective ouverte et soutenue par une interrogation constante sur leurs évolutions et modifications. Les auteurs questionnent les disciplines du texte et du discours par rapport à la longue durée des disciplines (Emmanuelle Danblon, Maria Zaleska) ou à l’élaboration d’un nouveau paradigme pour l’étude des productions verbales au-delà des contraintes de la linguistique issue du CLG (Ingrid de Saint-Georges). Ils font aussi des propositions théoriques et méthodologiques visant à intégrer à l’objet même de l’analyse linguistique les réalités du monde naturelles et culturelles (Guy Achard-Bayle, Fred Dervin & Céline Tournebise), ainsi que les matérialités techniques, en particulier dans les univers numériques (Marie-Anne Paveau et Olivier Le Deuff).

|
Scooped by
dm
January 24, 2013 5:59 PM
|
Eckhart en France, par J.-M. Gueullette
Jérôme Millon Editeur, 2012 Eckhart en France - La lecture des Institutions spirituelles attribuées à Tauler 1548-1699. Ce livre présente pour la première fois la façon dont un texte majeur d'Eckhart a été accessible en français dès la fin du XVIe siècle et décrit la manière dont il a été lu par les auteurs spirituels du XVIIe.
Il vient donc renouveler radicalement l'idée communément admise d'une suspension de la lecture et de l'influence d'Eckhart entre le XIVe et le milieu du XXe. Peu de temps après la mort d'Eckhart, ses Entretiens .spirituels sont utilisés par un disciple de Ruusbroeck qui le traduit en néerlandais et en intègre une grande partie dans son Traité des doute vertus. Il y mêle le texte eckhartien à des considérations de son cru, nettement marquées par le propos pénitentiel et ascétique de la devotio moderna. Ce traité connaîtra une certaine diffusion, en particulier parce qu'il est très vite considéré comme une oeuvre authentique de Ruusbroeck. Au début du XVIe siècle, il est lu dans un milieu spirituel qui associe des béguines du Brabant, et les chartreux de Cologne ; les uns et les autres l'intègrent à leur tour dans des ensembles plus vastes qui peu à peu vont former le texte des Institutions spirituelles. Celles-ci seront placées par Pierre Canisius dans son édition des oeuvres de Tauler en allemand, publiée en 1543, avant son entrée chez les jésuites. Cette première édition sera traduite en latin par son ami le chartreux Laurent Surius en 1548. A cette date, la mystique rhénane, dans des textes majeurs que sont les Entretiens d'Eckhart et les sermons de Tauler devient pour la première fois accessible à des lecteurs non germanophones. Très vite cette édition latine des Opera Tauleri sera connue dans toute l'Europe et donnera lieu à des traductions. C'est ainsi que les Institutions spirituelles sont lisibles en français dès 1587. Elles seront l'un des textes spirituels qui sera le plus souvent édité au XVIIe siècle, dans trois traductions différentes. C'est l'histoire mouvementée de ce texte, de ses lectures, de ses traductions et des interprétations diverses dont il a fait l'objet qui est racontée ici.
La traduction française des Institutions par le P. Noël est reproduite en annexe, accompagné de notes qui permettent d'identifier l'origine de la plupart des textes qui constitue cette compilation de la mystique rhéno-flamande.

|
Scooped by
dm
January 16, 2013 5:37 PM
|
Page 451 à 471 : Patrick Thierry - Des poires et un ruban. Petites généalogies du mal (Augustin et Rousseau) | Page 473 à 493 : Claudia Serban - Conscience impressionnelle et conscience réflexive : Husserl, Fink et les critiques phénomenologiques | Page 495 à 514 : Éric Pommier - La responsabilité en discussion : Apel/Jonas | Page 515 à 534 : Axel Cherniavsky - Les sources bergsonienne et kantienne de la theorie du concept de Gilles Deleuze | Page 535 à 549 : Denis Forest - Le cerveau, une réputation bien surfaite ? La conception standard et ses ennemis | Page 551 à 606 : - Analyses et comptes rendus | Page 607 à 611 : - Revue des revues (suite).

|
Scooped by
dm
January 16, 2013 5:28 PM
|
Page 5 à 9 : Frédéric Dupin - Éditorial | Page 11 à 41 : Jean-Claude Poizat - Entretien avec Marc Jimenez | Page 43 à 76 : Bernard Esmein - Beauté et Différenciation | Page 77 à 93 : Vincent Citot - Illusions et exigences du jugement esthétique | Page 95 à 105 : Christophe Giolito - Ondoyante beauté | Page 107 à 117 : Claude Obadia - Le mystère de l'expérience du beau | Page 119 à 130 : Camille Froidevaux-Metterie - La beauté féminine, un projet de coïncidence à soi | Page 131 à 153 : Sylvie Paillat - Esthétique du rire | Page 155 à 165 : Goulven Le Brech - Jules Lequier, le spectre du beau | Page 167 à 176 : Jules Lequier - Fragments sur le beau | Page 177 à 180 : Vincent Citot - Jules Lequier : le possible, le nécessaire et la beauté (à propos des Cahiers Jules Lequier n˚ 3) | Page 181 à 185 : Baptiste Jacomino - Singularité et actualité d'Henri Marion | Page 187 à 190 : Charles Boyer - L'École de Francfort, de Jean-Marc Durand-Gasselin | Page 191 à 194 : Baptiste Jacomino - L'expérience de l'incomplétude de Thierry Magnin | Page 195 à 205 : - Notices sur quelques publications récentes | Page 207 à 228 : Jean-Jacques Sarfati - Des limites de l'idée du droit flexible | Page 229 à 249 : Charles Boyer - Du « freudo-marxisme » au « freudo-libéralisme » ? | Page 251 à 272 : Gabriel Meyer-Bisch - Maritain, penseur de la démocratie : lecteur fidèle de Thomas d'Aquin ?.

|
Scooped by
dm
January 13, 2013 10:53 AM
|
« Peut-on rire de tout ? La question revient souvent dès que les humoristes ou caricaturistes s’attaquent à des sujets dits “sensibles”, comme la religion, la maladie, etc. Les uns considèrent qu’il faudrait imposer des limites à l’humour au nom de la morale et même, au nom de la loi. Les autres mettent en avant la sacro-sainte liberté d’expression. Et pour trancher, on a l’habitude de citer Desproges : “On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.” C’est sans doute qu’on considère toujours que le rire consiste à se moquer. Mais ne rit-on que des choses ridicules ? Le rire n’est-il pas sérieux ? Au fond, quels sentiments s’expriment dans le rire ? Pour savoir si on peut rire de tout, il faudrait donc commencer par se demander : qu’est-ce que le rire ? »

|
Scooped by
dm
January 6, 2013 6:12 PM
|
Anne Creissels et Giovanna Zapperi (dir.), Subjectivités, Pouvoir, Image. L’histoire de l’art travaillée par les rapports coloniaux et les différences sexuelles, Editions EuroPhilosophie 2012, ChampsArts&contreChamps - Ce livre rassemble des contributions issues du séminaire de recherche Acegami (Analyse culturelle et études de genre : art, mythes, images) du Centre d’Histoire et Théorie des Arts de l’EHESS. Les contributions proposent une approche critique de la production de sens et d’idéologie inhérente au champ artistique et envisagent l’histoire de l’art comme un domaine traversé par des rapports de force mais aussi par des subjectivités multiples.

|
Scooped by
dm
December 30, 2012 4:28 PM
|
René DESCARTES : Etude du bon sens - La recherche de la vérité et autres récits de jeunesse (1616-1631)
Il s’agit d’une édition de fragments (titres et extraits de traités entrepris ou simplement projetés) et de commencements d’œuvres de Descartes qui nous sont parvenus par des sources variées mais parfaitement fiables, et dont Descartes lui-même a fait mention à un moment ou à un autre dans sa Correspondance ou dans le Discours de la méthode, mais qui n’ont jamais été pris en considération pour eux-mêmes.
Nous avons réuni ces textes, nous les avons traduits quand ils étaient en latin ou en néerlandais – tout en plaçant les originaux en regard –, présentés, datés et annotés historiquement et philosophiquement. Nous insistons sur la Licence en droit (placard découvert en 1987), l’Étude du bon sens, dont nous restituons l’objet et l’ensemble des fragments non identifiés jusqu’ici, et La recherche de la vérité, pour la première fois traduite en français à partir de sa version néerlandaise et datée de façon sûre.
Ces textes ainsi réunis et datés présentent pour la première fois un Descartes inédit, travaillant en philosophe, et non seulement en savant, dans les deux décennies qui précèdent le Discours de la méthode. - PUF - Janvier 2012

|
Scooped by
dm
December 27, 2012 2:01 AM
|
Heidegger et les finisseurs - Raouf Sedghi
Les bruits de l'être (Heidegger, Derrida, Severino)
Alfonso Berardinelli
Derrida : l'arbitraire de la déconstruction - Roberto Giacomelli
Seul un dieu peut-il encore nous sauver ?
Javier Rodriguez Hidalgo
Un si petit monde : Heidegger et le milieu philosophico-littéraire français - Séverine Denieul

|
Scooped by
dm
December 24, 2012 2:00 AM
|
On connaît la problématique du cercle herméneutique : le tout n’est compréhensible qu’à partir du détail qui n’est compréhensible qu’à partir du tout. André Stanguennec cherche à tenir les deux exigences sans céder en rien sur la rigueur du détail ni sur le mouvement dialectique de la totalisation, à partir du sujet de l’action. Son oeuvre vise à se comprendre et à comprendre notre époque à travers ses totalisations éthiques, juridiques, politiques, esthétiques, scientifiques – et bien évidemment philosophiques. Or l’activité critique possède l’ambition de comprendre le discours tout d’abord aussi bien, puis mieux que son auteur. Ce livre cherche donc à présenter cette philosophie herméneutique et dialectique qui se veut totalement compréhensive ; et à la comprendre avec et contre son auteur. Il provient d’une journée d’étude, organisée en 2010 par J-M. Lardic et P. Billouet à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, sous la présidence de Bernard Bourgeois, Professeur émérite, (Paris I), Membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), en hommage à A. Stanguennec, Professeur émérite à l’Université de Nantes.
|
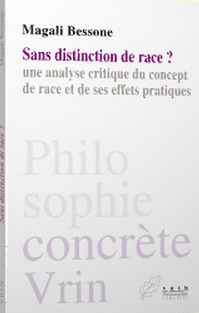



 Your new post is loading...
Your new post is loading...