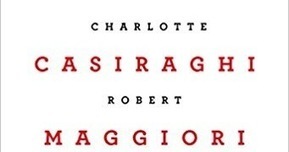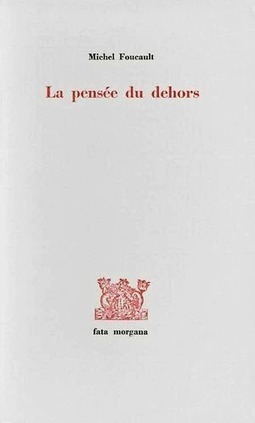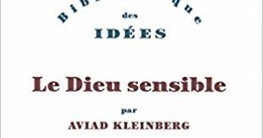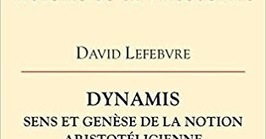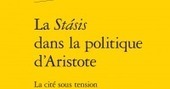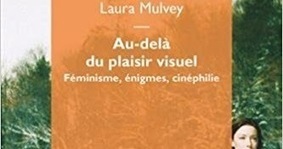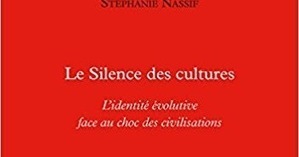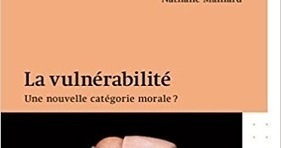Follow, research and publish the best content
Get Started for FREE
Sign up with Facebook Sign up with X
I don't have a Facebook or a X account
Already have an account: Login
Actualités des livres et revues philosophiques de langue française
Curated by
dm
 Your new post is loading... Your new post is loading...
 Your new post is loading... Your new post is loading...
|
|