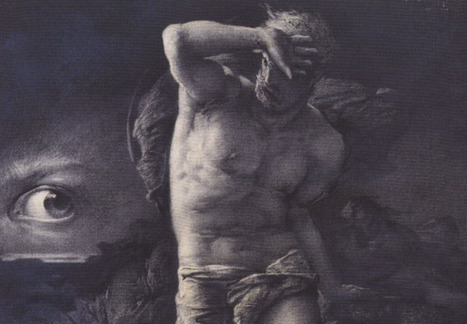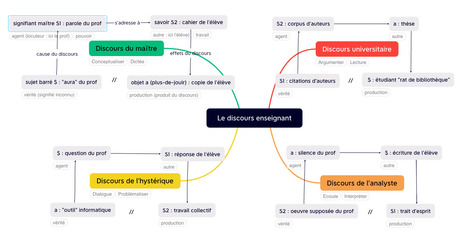Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
dm
January 10, 8:08 AM
|
« Nous nous cherchions avant de nous estres veus, et par des rapports que nous oyïons l’un de l’autre, qui faisoient en nostre affection plus d’effort que ne porte la raison des rapports, je croy par quelque ordonnance du ciel : nous nous embrassions par noz noms » (Montaigne). Le nom a ce pouvoir de faire naître l’amitié, en quelque sorte avant l’amitié, comme il la fait perdurer bien après. La renommée de La Boétie est à l’origine du désir de Montaigne de le rencontrer, ce dernier ayant grandement contribué, réciproquement, à la renommée de La Boétie. Mais l’amitié au présent se donne également un nom, ici celui de « frère » : pour nos auteurs c’est le signe d’une reconnaissance, ou mieux, le symbole d’une alliance. D’ailleurs dans le nom de frère, ou le nom du frère, Derrida (Politiques de l’amitié, 1994) voit une médiation entre le Montaigne grec, finitiste, et le Montaigne chrétien, infinitiste. En effet à quoi engage le nom ? Par la nomination j’existe par l’autre, tandis que par l’interpellation j’existe pour l’autre. Si par le nom en général je peux répondre de moi, c’est pour avoir répondu d’abord à celui qui me l’a donné, une première fois unilatéralement, et pour continuer à lui répondre lorsqu’il m’appelle ou m’interpelle. Le premier aspect (nomination) nous renvoie au modèle filial, perpétué par mot "frère", et serait voué à une certaine « spectralité » selon Derrida. Le second (interpellation) dévoile une altérité en même temps qu’une singularité plus grandes, celles de l’ami à qui je parle, et d’abord celui à qui je dois répondre. "Frère" redevient un "nom" comme un autre. Ainsi la question « qui est l’ami ? » (au lieu de « qu’est-ce que l’amitié ? »), épure le concept d’amitié de toute détermination d’essence et de toute relation d’appartenance. Simplement celui qui est appelé ainsi devient comme responsable de l’amitié qu’on lui voue (quel que soit le concept qu’on lui applique) et dont il doit, dès lors, témoigner dans l'échange. dm

|
Scooped by
dm
January 8, 4:36 AM
|
Le Catholicisme est-il une construction philosophique ?
La question paraîtra pour le moins abrupte et provocatrice : que pourrait-il arriver de pire à une religion - catholique ou autre - que de subir pareille réduction ?... Commençons par nous demander ce que pourrait bien être une lecture "catholique" de la Bible et quels seraient ses principes ? Un premier élément est constitué par l'affirmation essentielle, reprise à la tradition juive, selon laquelle Dieu se manifeste en parlant : l'existence, la création et la parole divines s'équivalent essentiellement. Ce fait s'avère déterminant pour l'homme qui emprunte son essence "langagière" à Dieu, tout en se positionnant en "second" par rapport à la parole, précisément du côté de l'écriture. Car si, de la Parole divine, nous conservons les "Ecritures", c'est bien pour que l'homme s'en serve, mais aussi parce qu'il en est l'auteur. Si Dieu est le Créateur et si, par sa Parole, il est la source sacrée et indéniable des Ecritures (support de la Révélation) il n'en est pas directement l'auteur. Inversement, l'homme qui n'est pas créateur, n'est pas davantage le scribe de Dieu : les auteurs de la Bible ont écrit ce que Dieu voulait, mais enfin ils l'ont écrit eux-mêmes. La doctrine chrétienne du Verbe "fait homme" résout cette contradiction d'une Parole vraiment humaine et divine, d'une Parole devenue Ecriture puis devenue chair... L'homme n'est donc pas identifiable par la seule écriture, même si elle lui est plus précisément destinée ; sous la "lettre" qui "tue" (quand elle est conservée seule) il y a l'Esprit qui "vivifie" (saint Paul) comme l'écho - et plus seulement la trace - de la Parole divine. Le second élément est le Livre lui-même, la Bible chrétienne, dans sa structure irrémédiablement bipartite - l'Ancien et le Nouveau Testament -, plus l'évènement qui l'informe dans sa totalité : l'existence, la mort, et la résurrection de Jésus-Christ. Cet évènement lui-même irréductible à l'écrit (ni d'ailleurs à la parole : Jésus-Christ n'écrit rien mais il ne se contente pas de discourir, comme Socrate) marque la clôture des deux parties du Livre, soit ce qui a été écrit avant et ce qui a été écrit d'après (pas plus de deux ou trois générations de disciples). Cette clôture canonique indique qu'avec le Livre dans son entier, nous avons affaire à un discours unifié et à un processus de signification achevé, donc désormais interprétable. Cela nous amène au troisième élément, le fait que le Nouveau Testament accomplit et permet d'interpréter l'Ancien, transformant du même coup la religion nationale des juifs en religion prosélyte universelle. Notons d'abord que le texte du second Testament interprète le premier sans modifier la lettre de celui-ci, ensuite qu'il ne reprend pas à son tour le statut de "lettre". En effet celle-ci se définit de ce qu'elle manque et de ce qu'elle annonce en même temps, soit le Réel corporel nommé Jésus-Christ, qui seul réalise pleinement l'Ecriture ("C'est de moi que les Ecritures rendent témoignage", Evangile de Jean 5, 39). Cette notion d'interprétation du premier Livre par le second, ce principe d'accomplissement par passage de la lettre à l'Esprit - dont la condition étonnante est le Corps - constitue le quatrième élément notable de la lecture catholique. Il s'agit plus précisément de relever les effets signifiants qui ponctuent un parcours allant des figures au corps. La figure qui représente une réalité mondaine est naturellement en attente de sens ; or, comme on l'a déjà signalé, le sens n'est pas délivré sans que ne se lève un corps, ce corps du Christ auquel l'Eglise s'est elle-même identifiée historiquement. En fait cette identification s'avère très mystérieuse, abyssale, puisque le lecteur interprète des Ecritures et leur référent final, après accomplissement, sont une seule et même "Chose" : l'Eglise. L'on serait tenté de prendre ce terme de "Chose" en un sens quasi-lacanien, comme étant le sans-nom ou le non-symbolisable depuis toujours forclos de l'Ordre symbolique. Cette divinité christique de l'Eglise, en tant qu'elle est corps et qu'elle fait corps, revient à exclure tout arrière-monde immédiatement et individuellement accessible. Elle se fait elle-même sujet d'un infini désir et objet d'une totale jouissance ; elle représente d'une part l'humanité entière reliée au corps du Christ, elle est ce lien invisible lui-même, mais d'autre part ne veut-elle pas incarner cette "Chose" dont on peut seulement jouir, c'est-à-dire Dieu lui-même en bonne doctrine augustinienne ? Comment ne pas relever la perversion que cette position de l'Eglise - celle de toute église - autorise implicitement ? La Bible chrétienne oriente son sujet lecteur vers la jouissance et ainsi bouleverse la Loi de Moïse : à ce stade, elle ne ferait que remplacer une perversion par une autre, la dictature d'un Père par la tyrannie d'une Mère... Mais heureusement, ce n'est pas seulement de cela qu'il s'agit, soit le pur exercice du Pouvoir. On ne peut pas omettre, ou faire semblant d'omettre l'intervention et le rôle directement interprétatif de la Philosophie parallèlement à celui de l'Eglise, et plus sûrement encore à l'intérieur de l'Eglise. Qu'elle soit "révélée" ou "naturelle", la théologie (et donc l'onto-théologie) a bien contribué à l'élaboration du Canon de l'Eglise chrétienne, et l'on ne peut ignorer que là où il y a mystère la dialectique n'est pas en reste... Foncièrement, la thèse augustinienne sur la jouissance est aristotélicienne : la jouissance reste jouissance de l'Etre, ou de l'Autre comme Etre. La jouissance de l'Autre comme tel, l'Autre jouissance (féminine dira Lacan) n'a pu être approchée que par des voies autrement mystiques. Donc l'accomplissement des Ecritures dans et par l'Eglise auto-proclamée "Corps-du-Christ" n'est aucunement surprenante : elle résulte de l'association hégémonique de deux volontés séculaires, celle - directement religieuse, c'est-à-dire politique - de faire corps ou communauté instituée, d'une part, et celle - rationnelle et philosophique - d'imposer une pratique discursive auto-justificatrice, d'autre part, de sorte que leur association fait la règle. Le Canon de l'église chrétienne, et donc l'interprétation catholique de la Bible, est bien une construction philosophique (onto-théologique) destinée à pérenniser un évènement (Jésus-Christ), à lui donner sens en fonction d'une tradition (juive), et à justifier un Ordre politique naissant (l'Eglise, puis la Chrétienté). En bref, le "catholicisme" et ses mystères ne nous paraissent absolument pas pensables sans cette liaison historique - et logique - avec la rationalité philosophique. Le religieux est généralement plus philosophe qu'il ne (le) croit… et réciproquement. dm (Crédit photo : fr.depositphotos.com)

|
Scooped by
dm
January 6, 4:19 AM
|
Nietzsche misogyne et féministe
Quand il s’agit des femmes Nietzsche se veut particulièrement provocateur, voire inamical, puisqu’il va jusqu’à les comparer à des animaux (nommément « chattes », « oiseaux », ou « vaches ») tour à tour séduisants, craintifs ou indolents ! D’après lui la femme veut une amitié toute nue, en quelque sorte avouée, sans mystère et sans polémique, et n’aspire qu’à la facilité. Elle n’est pas capable de mener la guerre à ses amis, et surtout d’honorer ses ennemis, ce qui prouve bien qu’elle confond amour et amitié. Car la suprême amitié consiste à provoquer, à réveiller l’ennemi en son ami, et à aimer l’inimitié de celui-ci pour la liberté que cet acte suppose. En ne pouvant aimer, par nature ou par excès d’humanité, son ennemi, la femme ne peut également accéder au véritable universalisme, celui qui commande d’aimer son ennemi « lointain » (ou l’Etranger) davantage que son ami proche. Que la misogynie de Nietzsche soit sincère ou simplement de façade, ou mieux provocatrice, soutenons qu’elle nous donne peut-être la clef d’une certaine idéologie politique et historique de l’amitié. S’il est vrai, comme le rappelle Derrida, que la fraternité naturelle et sa nostalgie ont depuis toujours lesté la pensée philosophique de l’amitié, l’autre face de ce problème est bien l’exclusion constante du féminin. Or Nietzsche, malgré les apparences, ne renchérit pas sur cette exclusion, car en déclarant les femmes incapables en la matière, il s’adresse en réalité aux femmes et leur lance un défi… Rien moins qu’une déclaration de guerre ! Voudrait-on s’attirer l’inimitié des femmes qu’on ne s’exprimerait pas autrement ! Mais cette provocation considérable est déjà une considération, elle va beaucoup plus loin que le respect de façade affiché par les mâles envers leurs sœurs dans le giron d’une humanité fraternelle et charitable. Faisons donc des femmes nos ennemies, nous leur devons bien ce respect, car entre les hommes et les femmes aucune paix ne doit régner. La psychanalyse abonderait peut-être dans ce sens, tout en logicisant ce non-rapport. Ici c’est plus métaphorique : si l'on couple ces poussées misogynes avec certaines déclarations de Nietzsche sur la nécessité de célébrer ses ennemis ("L'homme qui cherche la connaissance ne doit pas seulement savoir aimer ses ennemis, mais aussi haïr ses amis", Ainsi parlait Z.), on en déduit qu'il s’agirait de défier d’abord, puis de célébrer, une femme donc une ennemie, en chaque être humain dont nous prétendons être l’ami ! Ainsi le rejet nietzschéen du féminin peut être interprété lui-même comme une preuve d’amitié. Après tout ne se trouve lésé qu’un certain concept, phallocentriste à n’en plus pouvoir, de la « féminité ». Pour ce qui est « des femmes », c’est tout à fait autre chose. D’ailleurs il s’agirait plutôt de voir le féminin dans l’humain, plutôt que seulement défendre l’humain dans le féminin. N’oublions pas qu’avec Nietzsche ces valeurs, ces repères subissent une profonde transvaluation. L’on ne part pas de la différence sexuelle homme/femme ou même de l’opposition amitié/inimitié. A vrai dire la hiérarchie nietzschéenne homme/surhomme peut elle-même être remisée. L’opposition réelle – ce n’est donc plus une opposition mais une apposition – passe entre l’ami.e et l’amitié abstraite, entre les femmes et la féminité supposée. dm

|
Scooped by
dm
January 4, 5:31 AM
|
Savons-nous bien ce que nous désirons ? (problématique)
A l’inverse du mot « conscience », spontanément le mot « désir » n’évoque rien de très « philosophique », si l’on entend par-là (toujours spontanément) quelque chose d’« élevé ». Le désir évoque plutôt l’empire du corps, du "matériel" et du charnel : on pense immédiatement à envie, convoitise, pulsion, plaisir ou passion... Voyons plutôt ce que dit l’étymologie. Le verbe “désirer” vient du latin « desiderare ». « Sidus », « sideris » : constellation. « Considerare », c’est contempler l’astre. « Desiderare » c’est regretter son absence. L’étymologie présuppose ainsi deux éléments : 1° l’objet du désir possède une grande valeur (merveilleux, brillant comme un astre) 2° il est absent, de sorte que le désir serait manque. Lalande, dans son Dictionnaire, définit le désir comme une “tendance spontanée et consciente vers une fin connue ou imaginée”. La fin ou le but est ici l’« objet » du désir. Désirer, c’est tendre vers quelque chose. Mais la « tendance » est souvent assimilée à la pulsion spontanée, c’est pourquoi Lalande ajoute l’adjectif « consciente ». Spontanée : car le désir ne se décrète pas, il n’est pas un choix ou une décision issue d’une délibération ou d’une réflexion. Consciente : car le désir est « subjectif », il mobilise notre personne entière et tout notre être. Cependant, depuis Freud, l’on parle aussi de « désir inconscient ». De même qu’il ne faut pas confondre la pulsion (locale) et le désir (global), il ne faut pas confondre la volonté (toujours consciente) et le désir (parfois inconscient). La volonté est toujours consciente et précède l’action. Tandis que désir est un pur ressenti, qui peut être inconscient. La volonté est consciente : normalement, je sais ce que je veux ! Même si quelqu'un me fait remarquer avec un air légèrement exaspéré : "tu ne sais pas ce que tu veux !", cette phrase vise plutôt mon désir car elle a précisément pour signification : "ce que tu désires (réellement) n'est pas ce que tu veux (apparemment)", donc "tu ne sais pas ce que tu désires" ! Tâchons de clarifier : ce qui est conscient dans le désir c’est le fait même de désirer (je désire quelque chose… ou pas) ; ce qui a priori est inconscient c'est pourquoi l’on désire (quelle est l’origine de ce manque ?) ; enfin ce qui est plus ou moins conscient, c'est l'objet même du désir (est-ce vraiment ceci… ou plutôt cela ?). D’où la suite ambiguë de la définition de Lalande : « connue ou imaginée ». Une fin imaginée, cela peut aussi bien être un objet rêvé au sens d’idéal qu’un objet rêvé au sens d’illusoire, inexistant… En tout cas cet aspect imaginaire de l’objet du désir introduit un doute : savons-nous vraiment ce que nous désirons ? Au-delà des objets immédiats que l'on "croit" désirer, le motif véritable qui relance sans cesse notre désir n'est-il pas par définition toujours "autre" et mystérieux ? Car il semble évident que si le désir implique un manque, il faut bien qu’il ne soit jamais satisfait entièrement pour continuer d’exister, donc il faut que l’objet demeure de quelque façon insaisissable. A ce sujet l'on peut distinguer trois grandes positions, trois thèses qui nous mènent vers un mystère toujours croissant… – La 1ère thèse ne fait aucun mystère, bien au contraire, c'est celle connue sous le nom d'eudémonisme qui est majoritairement celle des philosophes antiques : le désir serait un phénomène "naturel" se donnant des buts eux-mêmes naturels, comme se nourrir convenablement, s'accorder des satisfactions physiques et intellectuelles, et tout ceci finalement dans le but supérieur d'accéder à l'harmonie de l'être et au bonheur… Mais l'homme désire-t-il "simplement" comme un être naturel, c'est-à-dire essentiellement autocentré ? Peut-il se contenter d'un bonheur "simple" et d'ailleurs est-il fait pour le bonheur ? – La 2ème thèse considère au contraire que le désir est un phénomène spécifiquement humain et même social, dont l'objet serait la reconnaissance. Si le désir est propre aux sujets conscients (pour le distinguer des instincts et des simples tendances), il faut bien qu'il se montre en quelque sorte à la "hauteur" de la conscience. C’est la conscience elle-même qui désire, et que désire-t-elle sinon la reconnaissance de soi ? D’où le fait que le désir soit intrinsèquement social, c’est-à-dire mimétique. D’où ces formes de désir que nous rencontrons typiquement au sein de la société, comme le désir de domination ou le désir de pouvoir. Or cette influence d’autrui sur notre propre désir, en sommes-nous conscients ? – La 3ème thèse pousse plus loin la précédente, jusqu'à assimiler l'essence du désir (et le comble de la reconnaissance), avec le désir amoureux, dont l’objet est l’Autre en tant que tel. Le vrai désir humain n’est-il pas en effet le désir d’aimer un autre humain et d'être aimé par lui ? Qu'est-ce que le désir amoureux sinon le désir de posséder l’Autre et/ou d’être possédé par lui, en passant le plus souvent par la possession charnelle ? N’est-ce pas alors un paradoxe étonnant, puisqu’il est évidemment impossible de posséder l’Autre physiquement, et que la sexualité ne fait que nous en donner l’illusion ? Serions-nous assez fous pour désirer l’impossible ? Or, c’est bien sous cet aspect - passionnel et sexuel - que le désir humain échappe en grande partie à la conscience étant donné les soubassements pulsionnels et fantasmatiques, essentiellement inconscients, dudit désir. dm

|
Scooped by
dm
January 2, 12:55 PM
|
Les critiques classiques du freudisme
Nous appelons “critiques classiques du freudisme” les objections les plus courantes qui se sont manifestées dans le courant du XXè siècle à l'encontre de la psychanalyse, qu’elles proviennent des milieux philosophiques ou scientifiques, mais nous n’abordons pas ici les discussions - notamment épistémologiques - les plus contemporaines. Il s’agira ici seulement d’un rappel. Nous exposons rapidement ces critiques et apportons en suivant des contre-objections, du point de vue de la psychanalyse et en faveur du concept de “sujet de l’inconscient”. 1-Les critiques philosophiques La critique rationaliste : par exemple, Alain "Les choses du sexe échappent évidemment à la volonté et à la prévision; ce sont des crimes de soi, auxquels on assiste. On devine par-là que ce genre d'instinct offrait une riche interprétation. L'homme est obscur à lui-même ; cela est à savoir. Seulement il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d'inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que l'inconscient est un autre Moi ; un Moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses ; une sorte de mauvais ange, diabolique conseiller. Contre quoi il faut comprendre qu'il n'y a point de pensées en nous sinon par l'unique sujet, Je ; cette remarque est d'ordre moral. [...] En somme, il n'y a pas d'inconvénient à employer couramment le terme d'inconscient; c'est un abrégé du mécanisme. Mais, si on le grossit, alors commence l'erreur; et, bien pis, c'est une faute." (Alain, Eléments de philosophie) Cette critique est essentiellement morale : pour le philosophe dit Alain (Emile Chartier), la théorie de Freud est dangereuse parce qu'elle accorde trop d'importance aux désirs et aux affects. Pour Alain il n'y a aucun intérêt à réveiller la "bête" qui sommeille en nous. Surtout, il n'accepte pas le principe selon lequel "le moi n'est pas maître dans sa propre maison" ! Alain s'en tient à la conception de Descartes selon laquelle l'inconscient, c'est le corps. Il ne saurait y avoir de pensée inconsciente et encore moins de "moi" inconscient". Il y voit un abus de langage, et même une faute morale. Que répondre ? En réalité, Alain confond l'instinct et les pulsions. Il n'y a strictement aucune "animalité" au niveau de l'inconscient, ni même d'ailleurs au niveau des pulsions, celles-ci étant strictement subjectives et faisant partie de l'histoire du sujet. Dans ce passage, Alain se fait même plus cartésien que Descartes: l'inconscient corporel serait pur mécanisme ! Comment naissent et se développent les pulsions ? C'est Lacan qui vend la mèche : les pulsions obéissent à une causalité d'abord psychique, et même symbolique (via le langage) en ce sens qu’elles se construisent en interaction avec autrui. En effet, contrairement au besoin organique, la pulsion (ou l'"envie") est générée par une demande à l'Autre et donc par un lien symbolique. Par exemple c'est parce que la mère propose le sein, parce qu'il y a demande de part et d'autre, que la pulsion orale existe. La pulsion est le substrat même d'un sujet de l'inconscient, non parce qu'elle serait "physique", mais parce qu'elle est déjà au contraire ciselée par le symbolique (le langage). La critique existentialiste : par exemple, Sartre Jean-Paul Sartre critique le freudisme non plus au nom de la raison, mais au nom de l’« existence » et de la liberté. D'une certaine façon cette critique est également morale : évoquer l'inconscient pour expliquer tel ou tel comportement serait une forme de déterminisme, cela reviendrait à nier la liberté et donc la responsabilité. Rappelons que pour Sartre, qui assimile pour ainsi dire la conscience à l'existence humaine, la conscience occupe toute la vie psychique (perceptive, imaginative, intellectuelle…). Ce que Freud appelle l'inconscient, selon Sartre, c'est ce que la conscience ne veut pas se représenter (bien qu'elle se le représente quand même, sinon comment pourrait-elle le refouler ?) : c'est donc typiquement de la mauvaise foi, le mensonge à soi-même, comme à chaque fois qu'on refuse de se tenir pour responsable de ce que l'on est… Réponse ? - Sur cette question de la responsabilité, Jacques Lacan a répondu implicitement à Sartre en rappelant que "l'inconscient dit toujours la vérité", la vérité du sujet. A partir du Freud de la première topique, il définit clairement l'inconscient comme un langage : "l'inconscient est structuré comme un langage". A chaque fois que l'inconscient se manifeste, par exemple lors d'un lapsus, un acte manqué, un rêve, etc., c'est bien le sujet qui s'exprime et qui trahit la vérité au détriment du "moi" conscient, lequel aurait plutôt tendance à la dissimuler (tant sa tâche de conciliateur l'amène à dissimuler, stratégiquement, la vérité). La tromperie, l'illusion, l'imaginaire sont du côté de la conscience, tandis que la vérité et le réel sont du côté de l'inconscient. L'inconscient dit toujours la vérité, c'est pourquoi il est toujours moral ! 2-Les critiques "scientifiques" La critique “épistémologique” : par exemple, Karl Popper L'épistémologue allemand Karl Popper reproche à la psychanalyse de se présenter comme une science, alors qu'elle n'en serait pas une. Une vraie théorie scientifique doit obéir au principe de falsifiabilité, autrement dit elle doit admettre qu'une hypothèse n'est pas toujours vérifiée par l'expérience. Il y a toujours des expériences négatives qui confirment finalement le sérieux de l'hypothèse et de la théorie, puisqu'une théorie scientifique, par définition, ne peut pas tout expliquer. Or l'inconscient et la plupart des concepts freudiens, selon Popper, ont plutôt le statut de mythes capables de tout expliquer. Il en va ainsi du complexe d'Œdipe par exemple : pour lui c'est une explication systématique et forcée. A cela il faut répondre que la psychanalyse freudienne ne prétend pas expliquer, mais seulement interpréter, dans les conditions précises – intersubjectives – de la cure. La psychanalyse fait donc partie des sciences humaines, voire des disciplines « herméneutiques » (sciences de l’interprétation, comme la poétique par exemple) et certes aucune de ces sciences ne saurait être dite « exacte ». Evidemment, si l'on s'obstine à séparer la théorie de l'inconscient de la pratique psychanalytique, comme expérience à la fois scientifique et humaine, on ne peut guère prendre au sérieux le freudisme. Or dans la pratique, le psychanalyste ne prétend pas savoir, c'est le patient qui sait, c'est lui qui détient la vérité. Le psychanalyste fournit quelques clefs, il se prête personnellement presque physiquement au transfert, par sa présence, mais c'est au patient d'interpréter la signification de ses symptômes. La critique psychiatrique Certains psychiatres (médecins de formation, parfois neurologues), ceux dont la formation relève purement de la médecine et non en même temps de la psychopathologie, reprochent à la psychanalyse son manque d'efficacité thérapeutique, ou bien le fait qu’elle ne saurait prouver celle-ci. Ce serait une perte de temps et une perte d'argent ; seule la longueur exagérément longue des cures expliquerait les cas de "guérison", quand ne n'est pas la conversion fréquente du malade au métier de psychanalyste… D'autre part, il existe d'autres méthodes psycho-thérapeutiques, rivales de la psychanalyse, comme la psychologie comportementaliste, voire hypnotique : dans ce dernier cas les résultats positifs semblent plus rapides (mais pas forcément plus durables ni plus réels que ceux des psychanalystes). Commençons par rappeler, à l'adresse de la psychiatrie, que pendant très longtemps cette science n'a pas su qualifier les malades mentaux autrement que comme des "dégénérés", ou bien des "simulateurs" (pour les hystériques)... D'autre part, depuis quand la psychiatrie médicale elle-même soigne-t-elle les malades dits “mentaux” ? Les traitements médicamenteux ne font qu'apaiser, calmer les crises d'angoisse, rééquilibrer le comportement, mais en occasionnant une accoutumance à vie et en aucun cas ils ne remplacent une psychothérapie qui seule prendra en charge la dimension psychique du problème. Il suffira donc de rappeler que, si la psychanalyse ne guérit pas davantage les « maladies mentales », au moins elle tente de soigner les patients en les traitant comme des sujets. Enfin il faut rappeler que la plupart des méthodes thérapeutiques rivales de la psychanalyse, quand elles se présentent réellement comme psycho-thérapeutiques, sont redevables au freudisme de cette révolution qui a consisté à prendre au sérieux la parole du patient. dm

|
Scooped by
dm
December 31, 2024 6:57 AM
|
La revanche du semblable. Pour une érotique de l’amitié
“Je recule à aimer mon prochain comme moi-même, pour autant qu’à cet horizon il y a quelque chose qui participe de je ne sais quelle intolérable cruauté.” (Jacques Lacan) “L’Autre n’est pas qu’un autre — s’il l’était, il serait aussi bien rien, ou encore indifféremment autre que lui-même, autre manière de dire : rien. L’Autre n’est ni même ni autre. Cela paraît invraisemblable ? Et pourtant oui, cet invraisemblable qu’est l’Autre ne l’est que si potentiellement il est aussi un vrai semblable…” (Patrice Desmons, psychanalyste) En général l’analogie n’est pas prise au sérieux au regard du réel ; on la cantonne bien souvent à l’imaginaire de la ressemblance, en-deça de la différence essentiellement symbolique du « prochain » qui est le cheval de bataille des éthiques modernes — psychanalyse comprise. Patrice Desmons a raison de souligner que le dénigrement systématique de l’analogie, de la ressemblance, de la sympathie et de l’amour du même, finit par rendre in-vrai-semblable l’éthique actuelle fondée sur l'altérité et la différence radicales, à cause précisément de l’indifférence qu’elle engendre ou qu'elle cautionne implicitement. La ressemblance ne posait guère de problème aux Anciens qui y voyaient le principe même d’une éthique de l’amitié. En effet, celle-ci était censée dériver de l’amour de soi ; le bien voulu à autrui ne pouvait qu’être analogue, et proportionnel, au bien voulu à soi-même. Cependant, pour un philosophe grec, le rapport à soi-même se définit essentiellement comme rapport d’autorité et de maîtrise : s’aimer soi-même, se vouloir du bien, signifie avant tout bien se diriger, se discipliner, serait-ce dans une perspective hédoniste. Aussi peut-on dire : mon ami, mon maître. Le miroir de l’amitié qui se veut formateur, voire correcteur, est donc également déformant. Puisqu’il me représente un au-delà de moi-même, comment la volonté de cet autre ne me serait-elle pas étrangère ? Pourquoi ne serait-elle pas également hostile ? Bref, la réponse éthique traditionnelle est insuffisante parce qu’elle ne voit pas l’au-delà du semblable et du miroir, ou plutôt elle méconnaît le miroir comme étant cet au-delà. Un jour l’image s’effondre parce qu’on se rend compte que le semblable ne me veut pas toujours du bien. Tout semblable qu’il est, il a la liberté de me vouloir du mal, de s’en prendre à mon être par pure méchanceté. La solution — promue par Kant — est de s’en remettre à un grand Autre, c’est-à-dire à la Loi ; non plus au semblable mais au prochain ; ou si l’on veut à l’autre en tant qu’il incarne, non plus ma propre image idéalisée, mais une idée de l’Humanité. Du registre de l’imaginaire, on passe à celui du symbolique ; la ressemblance fait place à l’identification ; le passage s’effectue moins par analogie que par métaphore — choses fort différentes. La première suppose la présence illusoire des deux termes, reliés par un «comme» unificateur. La seconde consiste dans la substitution d’un terme à un autre, par la guise d’une pure différence signifiante. Le respect du prochain, au sens moral, se définit bien avant tout comme respect de l’Autre, voire dans sa formulation contemporaine comme respect de la différence. C’est bien pourquoi l’analogie sous-entendue dans la formule « aimer son prochain comme soi-même » pose problème. Ce problème s’appelle Freud. Celui-ci oppose qu’il n’y a rien au fond du cœur humain qui évoque le « bien-être » naturel des éthiques anciennes, encore moins qui puisse présentifier l’humain comme tel sous l’espèce d’une conscience ou d’une raison. Il n’est même pas sûr, malgré le narcissisme, où à cause de lui, qu’on puisse parler d’« amour de soi ». On dit : « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ; l’ennui c’est qu’on ne s’aime pas soi-même. Au cœur de l’être humain — c’est la leçon de Freud — il n’y a pas le plaisir, le bien, l’amour, le besoin, il y a la jouissance — mais une jouissance impossible et par-là même maligne. On ne jouit pas pleinement de soi, comme si une part de nous-mêmes était depuis le début déjà manquante, comme si l’Autre avait déjà prélevé sa part. La quête éperdue de cette partie perdue, pour tout être parlant, est ce que Freud appelle la pulsion de mort. C’est ce que développe Lacan dans son séminaire VII L’Ethique de la psychanalyse. Il y a en mon cœur une Chose absente, un vide ; et je n’ai aucune raison de vouloir aimer mon prochain si celui-ci (le plus «proche») est d’abord représenté par cette Chose immonde. Il s’agirait plutôt d’aimer mon « lointain » (cf. Nietzsche) ! Cela ne veut pas dire qu’il faille s’éloigner de ce vide central de la Chose, qu’il faille fuir ce point d’horreur. Au contraire il ne faut pas le perdre de vue, mais le contourner, mais l’approcher, et savoir que toute relation avec autrui est marquée en creux par cette jouissance, par la jouissance. L’autre ne cherche pas à me connaître, comme on le répète à satiété, mais il cherche inévitablement à jouir de moi. L’ami ne cherche pas à me connaître, à connaître ce qui est bien pour moi ou à connaître mon être, mais à jouir de moi. Inversement, cette Chose que représente aussi l’autre pour moi, sous son aspect inconnu et impénétrable, est bien ce que je désire fondamentalement. Or ce désir et cette jouissance ne sont rien d’autre que sexuels, car ce qui «reste» effectivement de la Chose, ce sont des objets partiels, ou objets de la pulsion. Le désir emprunte obligatoirement cette voie. Au départ de la relation au prochain, qui est désir, il y a les pulsions. Et il faut faire avec ces pulsions qui peuvent être créatrices dans la mesure où elles substituent à la Chose tel ou tel objet partiel par un processus de sublimation. Historiquement, deux objets privilégiés ont été élevés par élaboration à la dimension de la Chose : Dieu (dans la mystique) et la Dame (dans l’amour courtois). Etrangement, ce n’est pas le cas de l’Ami en tant que tel, c’est-à-dire quand il n’est pas confondu avec Dieu ou avec la Dame en tant qu’asexués. Il n'y a pas de "mystique" de l'amitié ! Précisément parce que l’amitié, contrairement à toutes les idées reçues, n’est nullement asexuée si elle est fondée comme je le soutiens sur la jouissance et la pulsion, et si elle procède, elle aussi, d’une confrontation avec la jouissance du prochain ou de la Chose. Même la parole, même l’écriture, qui sont les médiums privilégiés dans les relations amicales, constituent des éléments de la pulsion — la parole en particulier à travers l’objet vocal. La pulsionalité de la parole, Lacan l’admet explicitement lorsqu’il ramène finalement toute son éthique à une érotique du « bien-dire ». Il le démontre à nouveau lorsqu’il dénonce dans l’impératif catégorique le sadisme (jouissance perverse) d’un surmoi n’ayant d’autre autorité, finalement, que celle de la « grosse voix ». Ainsi l’amitié pourrait participer d’une érotique de la parole capable d’élever, dans le langage, un objet particulier (l’ami) à la dignité de la Chose, afin justement d’éviter la jouissance folle de celle-ci. Mais sans pour autant ignorer les objets pulsionnels qui s'y rattachent (sans quoi l'on retombe dans la passion ou l'amour platonique). On pourrait sans doute y ajouter d’autres objets de la pulsion, comme le regard ou le toucher. Tant que l’objet est élevé au rang de l’Autre absolu, la Chose, il ne devient pas objet sexuel, c’est-à-dire pris dans le jeu phallique de la sexualité proprement dite. Il y aura toujours cette limite. Mais le champ érotique, pulsionnel, de l’amitié, lui, doit être considéré comme ouvert... J'ai beau les adorer et les vénérer comme des Autres radicaux ("parce que c'était lui parce que c'était moi"), mes amis je ne peux m'empêcher de "boire" leurs paroles et de les "dévorer" du regard… La relation amicale est bien une relation charnelle avant tout, érotique, quoique non-sexuelle a priori… Voilà comment, par le biais de l’érotisme pulsionnel, il est sans doute possible de rester au plus près de la Chose, en son voisinage, de préserver la part de la jouissance tout en évitant la cruauté du surmoi ou le déchaînement psychotique. L’homme rencontre (aime) donc son prochain s’il se tient assez proche de sa propre inhumanité, l’apprivoisant, par ce déplacement continu qu’autorise la pulsion. Ici se repose enfin le problème de l’analogie. On a dit que l’accès au symbolique via la Loi rompait avec l’analogie du semblable : la Loi qui dicte d’aimer son prochain comme soi-même situe en effet le prochain au niveau symbolique d’une référence absente, qui est celle du Dieu mort. Ainsi la relation métaphorique ne conserve qu’un terme dans le réel. Je puis aimer mon prochain, solitaire, du haut de ma tour d’ivoire, dans mes livres. Il n’en va pas de même au niveau pulsionnel : l’érotisme (de l’amitié, en l’occurrence) suppose irréductiblement du deux, c’est incontournable. Quant à la pulsion, on sait qu’elle procède plutôt par glissement (métonymique) que par substitution (métaphorique). C’est précisément par cette bande que l’analogie fait retour, non pas comme identification mais comme approche continue du ...semblable. Il s’agit ici du « vrai » semblable et non du semblable imaginaire. Car, pour ce qui est de cerner le vide de la Chose, il faut bien que l’autre, dans le réel de l’amitié, fasse de même. C’est d’ailleurs cette intimité respective avec notre prochain qui nous rapproche. Ainsi aimer son prochain (et surtout pas en jouir comme d’une idole : c’est la jouissance du Diable) ne nous dispense pas de jouir (amicalement) de notre semblable. dm

|
Scooped by
dm
December 29, 2024 9:09 AM
|
Peut-on parler d'un "sujet de l'inconscient" ? (problématique)
De l'adjectif au substantif On sait ce que signifie "être inconscient" ou "être un inconscient" : dans le premier cas, mentalement, c'est le fait de demeurer sans connaissance (évanoui), dans le second cas, moralement, cela désigne quelqu'un d'irresponsable. Plus simplement, on est inconscient de quelque chose lorsqu'on ne maîtrise pas tout ce que se passe en soi ou autour de soi… Or, en passant de la forme adjective (qui prévaut dans ces exemples) à la forme substantive, le terme a acquis non seulement le statut de notion philosophique mais encore celui de concept psychologique, notamment avec Freud. Il cesse alors de signifier quelque chose de négatif, le "contraire de la conscience", pour désigner une fonction dynamique et déterminante du psychisme. L’hypothèse freudienne d’un inconscient psychique et les raisons de s’en « préoccuper » L’on se doutait bien, avant Freud, qu’une partie importante de notre psychisme demeurait inconsciente, latente, méconnue, voire un peu suspecte ; mais l’on n’avait pas compris à quel point elle pouvait être déterminante sur l’ensemble notre personnalité, au point de conditionner nos désirs, nos rêves, nos fantasmes ou nos angoisses, voire certains troubles plus profonds comme névroses, phobies, obsessions, délires, etc. Avant Freud, l’on se préoccupait certes de ces phénomènes, mais sans les rapporter à une réalité psychique particulière, nommée par Freud « Inconscient », dans un premier temps au titre de simple hypothèse explicative. Finalement le concept freudien s’est imposé, au point de se répandre en profondeur dans la culture du 20è siècle (philosophie, art, cinéma, littérature…), non certes sans être régulièrement remis en question ou critiqué. Mis à part la question (toujours débattue) de l’existence même d’un inconscient psychique, se pose la question de savoir s’il faut s’en préoccuper ou pas, autrement dit s’il est nécessaire de « connaître » cet inconscient, de le rendre conscient (si c’est possible), par quels moyens et dans quelles proportions. Faut-il prendre conscience de notre inconscient pour se connaître soi-même ? Ou bien n’aurions-nous pas intérêt à laisser tranquille cette part de nous-mêmes qui, par définition, s’oppose à la conscience et, par-là même à l’autonomie recherchée ? A la suite d’une longue lignée de savants et de philosophes, comme Spinoza, et comme Marx en matière sociale et politique, Freud considère qu’il est indispensable de prendre conscience de ce qui nous détermine psychologiquement, et qu’on ne peut qu’y gagner en autonomie. Par ailleurs Freud avait acquis la certitude qu’à l’aide de son invention, la « méthode psychanalytique », il pouvait guérir nombre de maladies mentales : donc pourquoi ne pas essayer ? Peut-on parler d’un « sujet de l’inconscient » ? Et si l’inconscient était un sous-bassement déterminant de notre personnalité ? Et si ce n’était pas la conscience, mais l’inconscient qui constituait la part la plus secrète, mais aussi la plus authentique, de notre identité ? D’où l'expression "sujet de l'inconscient", forgée par Jacques Lacan (1901-1981), psychanalyste français. Elle est des plus surprenantes et des plus paradoxales si l'on se souvient que le concept de sujet fut employé par les philosophes modernes pour désigner la conscience, ou la personne en tant que consciente, et auparavant par les philosophes antiques dans le sens de substrat. Comment un sujet inconscient pourrait-il "subsister" à côté et surtout en plus du sujet conscient ? Peut-être alors devrons-nous former l'hypothèse d'un sujet essentiellement inconscient, quitte à laisser à la conscience une fonction seulement périphérique, sinon mineure, comme l'avait déjà laissé entendre Nietzsche. L'expression "sujet de l'inconscient" offre un double intérêt. 1) D'abord elle suggère que l'inconscient, au sens psychologique, s'applique toujours à un sujet (au sens moderne du mot sujet), toujours individuel et particulier : l'inconscient est subjectif, il n'est pas neutre, objectif, commun à tous. 2) Ensuite elle sous-entend que, à la base du psychisme, subsiste (au sens ancien du mot sujet d'abord, subjectum), "quelque chose" comme une structure inconsciente, ayant une fonction déterminante pour l'individu. Bien sûr la référence au subjectum ancien n'a de valeur que propédeutique : il est hors de question de revenir à l'idée de "substance", surtout si un tel sujet s'avère être un effet du langage, il pourrait au contraire se caractériser par une certaine volatilité ! Par ailleurs, étant donné l'origine sociale du langage, il faudra sans doute accepter de dissocier, au moins partiellement, le sujet inconscient de l'individu (Lacan ne proclame-t-il pas "l'inconscient est le discours de l'Autre" ?).

|
Scooped by
dm
December 26, 2024 5:52 PM
|
La belle âme et l'amitié. (D'un idéalisme congénital dans les conceptions philosophiques de l'amitié)
Aristote, déjà, se conformait à une vieille tradition en définissant l’ami comme une âme unique siégeant en deux corps. Pareil « nouage » assure aux deux âmes une parfaite connaissance mutuelle, leur promettant toujours plus de pureté et de spiritualité. Cependant, l’unité idéale des âmes ne laisse-t-elle pas cruellement impensée la dualité réelle des corps ? On constate qu'une ségrégation s'opère directement à partir des corps au nom de la différence sexuelle. Pour la tradition, une amitié véritable ne saurait exister entre deux femmes ou entre un homme et une femme, mais seulement entre deux hommes. En d'autres termes, l'âme n'est rien moins que sexuée, malgré ce qu'on en dit : bien qu’elle s’accorde au féminin, elle recouvre (spécialement dans l'amitié) une réalité masculine, marquée d’un évident narcissisme. Lacan disait, à propos de cette identification des âmes : « l'âme âme l'âme » (Encore). Aimer d'amitié, au sens où l'on veut du bien à l'ami, c'est toujours réduire autrui au semblable en le prenant pour son âme. C'est aussi un rapport de « compréhension » dès lors qu’il inclut fondamentalement la vertu en partage et un discours de la maîtrise : l'âme est ici le maître présent en chacun. Or, dans l’âme une de l’amitié, il ne saurait y avoir deux maîtres. Faut-il supposer un tiers, un maître-philosophe qui serait comme le père implicite de cette amitié ? A moins qu'un nouveau rapport, de type inégalitaire, ne soit déjà instauré. Dans la phrase citée en exergue, Montaigne évoque - comme malgré lui, comme dépassé par la fulgurance de sa formule - une sorte de relation qui détruit le mythe d'une symétrie ou d'une égalité parfaite entre les âmes amies (condition supposée de leur identification ou de leur union). On connait les célèbres formules de Montaigne : « je connoissoy la sienne comme la mienne » et « je me fusse plus volontiers fié à luy de moy qu'à moy ». Ainsi est marquée la rupture entre la connaissance, égalitaire par essence, et l'amour foncièrement dissymétrique puisqu'il me conduit à préférer à mon propre jugement celui d’autrui. Montaigne se situe à un carrefour entre 1° la position éthique traditionnelle fondée sur la vertu, 2° l’expérience passionnelle et individuelle, ineffable et lyrique, de l’amitié «moderne», et 3° la version chrétienne et déjà morale, elle aussi traditionnelle, d’une amitié pure et indicible des âmes considérées dans leur beauté extra-mondaine. L’ambivalence de ce dernier point de vue n’est rien d’autre que celle de la «belle âme», remarquablement analysée par Hegel. Pour le dire en un mot, Hegel désigne par «belle âme» l’état de la bonne conscience morale lorsqu’elle campe sur la seule pureté de ses intentions. Elle se heurte évidemment à la réalité effective des choses, dans laquelle et contre laquelle elle ne saurait même agir, ce qui ne l’empêche pas de prétendre réformer un monde jugé hypocrite et corrompu. Quel rapport avec l’amitié ? A l’évidence, nombre de comportements amicaux se parent des vertus de la belle âme pour faire, ou ne faire, il faut bien le dire, qu’illusion. On peut noter le caractère idéaliste, irréaliste, de la plupart des doctrines classiques de l’amitié qui n’ont pas peu contribué, par l’hypocrisie qu’elles engendrent, à la désaffection progressive dans nos sociétés du sentiment philanthrope. Un psychanalyste peut même soutenir qu’aujourd’hui « le désir d’amitié est devenu névrotique » (Patrice Desmons). Ce qui fait actuellement symptôme — à savoir que le cœur n’est plus à l’amitié — pourrait bien être étendu à l’ensemble de la culture philosophique qui, selon moi, ignore l’Ami de la même manière qu’elle ignore l’Homme (je veux dire “l’homme ordinaire”, cf. Laruelle). Parce qu’elle voit d’abord dans l’ami une âme, et que l’âme, comme vecteur d’illusions, est toujours finalement la «belle âme». Ce qui tend à justifier mes allégations, un peu plus haut, sur le "sexe des âmes". Car derrière l’identification exclusive des âmes, leur fusion ou leur confusion amicale (dans une sorte de virilité magnifiée, voire universelle), subsiste la réalité — symptomatique en tant que telle — des corps pluriels. L’unicité de l’âme ne va pas sans la dualité insistance - et têtue, si j'ose dire - des corps. Les doctrines classiques n’en ont cure, certes, mais ce faisant relèvent du point de vue de la belle âme. Malgré leur égoïsme plus ou moins vertueux, Montaigne et ses prédécesseurs n’échappent pas à une forme d’idéalisme dans leur célébration de l’Ame amie en tant qu’unique ou fusionnelle. «Il faudrait» une telle amitié, mais, au bout du compte, «il n’y a nul amy» (Aristote)... Chez Kant la passion du semblable cède la place au respect du prochain, cette mise à distance, et l’amitié parfaite n’est désormais qu’une pure idée. Naturellement, c’est bien une amitié pour l’âme, et même pour la belle âme, en l’occasion. Mais la loi du cœur n’est probablement pas loin : c’est l’envers de la médaille. Les bons sentiments, la bonne volonté ou le respect du devoir cachent aussi des intérêts privés et des désirs personnels. "L’âme ame l’âme" (Lacan) et pendant ce temps le corps dit «encore !» (sous des formes compulsionnelles et symptomatiques diverses). On pourrait évoquer maintes figures de ce qu’il faut bien appeler une « ontologie de l’amitié », puisqu’il est question de saisir à chaque fois l’« être » de l’autre, l’ami dans son existence pure et rien d’autre — notamment à travers une phénoménologie du regard et de la parole. On montrerait en quoi cela relève furieusement de la position de la belle âme en tant qu’elle n’a de cesse de se retirer dans l’être de son âme, c’est-à-dire son être en tant qu’être — soutenu pourtant bel et bien par un objet de désir et de jouissance. On pourrait d’ailleurs rappeler que cette ontologie de l’amitié, qui est aussi une ontologie de l’âme, se trouve déjà pour partie chez Aristote, et occupe bien sûr tout le terrain de la philosophie chrétienne. L’amitié vraie, l’amitié toute nue, si l’on peut dire, exige de toucher également à une nudité de l’âme. Les grecs appréciaient la nudité des beaux corps, mais le philosophe Socrate leur préfère encore la nudité des âmes. Socrate a d’ailleurs une technique avérée pour dénuder les âmes : il les fait parler. Parler dénude et permet de voir l’invisible. On verrait alors que si l’âme n’est rien d’autre que la parole, et l’amitié une prise de parole et une écoute de la parole, la nudité de l’âme ne saurait être rien d’autre que la voix. Dans l’amitié nous ne pouvons donner assurément que notre parole, et la voix seule rend effectif, voire érotise, ce don. Gratuité du don, amitié de l’âme, nudité de la voix : on sent bien qu’il faut prendre tout cela à la lettre c’est-à-dire au physique. La tradition philosophique, elle, l’a pris d’abord au figuré, c’est-à-dire à l’être, au méta-physique. Peut-être finalement n’a-t-elle pu concevoir l’amitié qu’à partir de l’absence de l’ami, sa négation charnelle... tout cela sur fond d’une mise à mort de l’Ami-Philosophe, j’ai nommé Socrate. C’est pourquoi il faudrait maintenant fonder à nouveaux frais une "érotique de l’amitié" pour s’affranchir de cette érotologie traditionnelle qu'est finalement l'ontologie. Qu'on le veuille ou non, au départ de la relation au prochain, qui est désir, il y a les pulsions. J’en parle ailleurs. En résumé le philosophe ne peut pas s’empêcher de voir dans l’ami, avant tout, une âme en tant que distincte du corps ; il assume une certaine identité, ou plutôt une identification tendant vers l’uni(ci)té des âmes, mais il délaisse par-là même la différence individuée des corps. D’où un réel en réserve, en souffrance, que la psychanalyse parvient à nommer pertinemment. Encore plus fondamentalement, il se trouve que le « philein » (amour-désir) de l’amitié et du philosopher sont le même : la philosophie s'est toujours pensée comme une pratique supérieure de l'amitié, et elle pense l'amitié réalisée comme une forme de sagesse. Ignoré en tant que réel ou “ordinaire”, l'ami doit assumer - à son corps défendant ! - une double fonction de représentation : non seulement tout ami représente une (belle) âme pour un autre ami potentiel, mais aussi toute âme représente un (bon) ami pour une autre âme. Ils n’existent que sous la condition de cette différence identificatrice : l’âme comme bon ami (« elle » reste masculine) et l’ami comme belle âme. Le philosophe — de toute son âme, en toute amitié — semble admettre que c’est « bien » ainsi ! dm

|
Scooped by
dm
December 22, 2024 8:51 AM
|
La "conscience morale" ou la reconnaissance d'autrui (au-delà de la "mauvaise conscience")
La "mauvaise conscience" : le remords est la face obscure de la conscience qui s'accuse elle-même. Le fait d'éprouver du remords, parce que l'on a fait du tort à autrui, réellement ou imaginairement, prouve au moins la présence d'une conscience. Mais de même que la "conscience malheureuse", au plan psychologique, doit être dépassée sur le chemin de la reconnaissance, la "mauvaise conscience" ne possède pas en elle-même le remède à sa propre souffrance. Celui qui s'accuse lui-même n'est guère plus avancé que celui qui ne s'accuse jamais, celui qui a "bonne conscience", comme on dit. Ce sont deux attitudes également "autistiques", deux rapports à soi (détestation de soi ou amour de soi) qui ignorent ou feignent d'ignorer que le principe de la vraie conscience morale réside dans le rapport à l'Autre et la reconnaissance d’autrui. Qu'est-ce alors que la "conscience morale" ? C'est la connaissance de ce que l'on nomme en raccourci le "bien" et le "mal", plus précisément la conscience de ce l'on doit faire ou ne pas faire, en fonction de principes qui placent le respect de la personne humaine au-dessus des seuls intérêts personnels. Il s'agit d'une conscience pratique et non seulement théorique ; ce n'est pas seulement un savoir, mais surtout une volonté. Cette volonté est par définition personnelle, autonome (personne ne peut me "forcer" à vouloir), mais elle est quand même placée sous l'autorité d'un devoir qui, lui, implique une forme d'universalité. Il existe une sorte de "cogito" moral qui pourrait se décliner ainsi : je veux (faire ceci ou cela) parce que je le dois, et je le dois parce que l’Autre (l’Humain en général, l’intérêt commun) me l’ordonne. A la notion de conscience morale est associée la notion essentielle de responsabilité. La responsabilité est ce qui fait de moi, sur le plan moral, un sujet. Cela consiste à être conscient de ses actes, à "savoir ce que l'on fait" : d'abord se reconnaître soi-même comme l'auteur de l'acte (d’où l’expression « répondre de ses actes », verbe latin respondere), et ensuite reconnaître que nos actes peuvent nuire à autrui. Le contraire de cette reconnaissance (de soi, de ses actes) est la mauvaise foi ; la non-reconnaissance d’autrui est l’égocentrisme. L’action suppose : une intention + une réalisation. A première vue, c’est l’élément intentionnel (la pensée) de l'acte qui s'avère être le siège de la conscience morale. Il convient de distinguer ici responsabilité morale et responsabilité pénale (juridique). Rappelons que la loi morale n’est pas écrite, à la différence de la règle de droit. L’intention de mal agir est condamnable par elle-même, moralement ; mais si elle n’est suivie d’aucune réalisation, elle n’est pas condamnable juridiquement (aux yeux de la loi). Par exemple, l'intention de tuer n'est pas constitutive d’un meurtre ni même d’une tentative de meurtre – sauf bien sûr si un début de réalisation est manifeste (menacer avec une arme, par ex.). Inversement, la réalisation privée d'intention ne constitue pas non plus un acte également qualifié : le fait de donner la mort sans avoir l'intention de la donner ne constitue pas un meurtre, mais un homicide involontaire, c’est bien différent. Mais si une intention pure ne constitue pas un acte, qu’est-ce qui doit être qualifié comme « bon » ou « mauvais » finalement : l’intention ou l’acte dans son ensemble ? Ce n’est pas toujours très clair. Il faut sans doute distinguer plus finement la simple « mauvaise pensée » (« j’ai envie de tuer untel » !) et l’intention qui, d’une certaine façon, dispose à agir, rend possible l’action (« je vais le tuer » !) en tant qu'elle mobilise la volonté, soit un certain effort de la pensée… Quoi qu’il en soit, si l'acte est un composé d'intention et de réalisation, il convient de ne pas attribuer à la pensée voire à l'intention seules le caractère moral de l'acte : ce serait trop facile ! Si une mauvaise intention en soi suffisait à constituer une faute, cela voudrait dire qu’une bonne intention seule suffirait à rendre un sujet vertueux… Or ne dit-on pas que "l'enfer est pavé de bonnes intentions" ? Nous retrouverions ici la figure décrite par Hegel de la « belle âme » : celle ou celui qui se pose en défenseur du Bien et de la morale, celui qui critique les mauvaises actions des autres sans agir le moins du monde lui-même… L'âme est "belle" parce qu'elle défend de beaux principes, et elle n'est pas souillée par l'action ; mais elle ne réalise pas que le fait de ne rien faire… constitue un acte à part entière, le plus souvent condamnable : laisser faire, c'est faire ! Posons maintenant la question de l'origine, de la genèse de la conscience morale. Serait-elle innée ? Comment se forme-t-elle ? Si l'on a reconnu l'autonomie (venant de soi) de la volonté morale, on a indiqué également que sa source, son origine (en rapport d'ailleurs avec sa finalité) devait être l'Autre, ou Autrui, donc l’hétéronomie. Il faut bien que, d'une manière ou d'une autre, l'on m'ait intimé l'ordre : "fais ceci, car c'est bien", pour que j'en sois venu à me l'ordonner moi-même. Quelle est donc l'origine de la conscience morale ? Pourquoi certains individus semblent totalement dépourvus de conscience morale ? Est-elle d'origine naturelle ou sociale ? Résumons trois thèses en la matière, pour faire vite. 1) Jean-Jacques Rousseau prétend trouver les principes de la moralité (c’est-à-dire la conscience morale) “au fond de mon cœur, écrits en caractères ineffaçables” ; c’est une “voix intérieure” qui est un “principe inné de justice et de vertu”. Elle dérive de la faculté propre à l'être humain de s'identifier à son semblable et donc de compatir à ses malheurs : parce que je peux m'imaginer à sa place, et parce que j'ai une sensibilité, je ne veux pas naturellement de mal à autrui. Pour Rousseau, la conscience est à la fois la voix de Dieu et celle de la nature, et c’est parfois (paradoxalement) la société qui nous empêche de l’entendre. « Conscience ! conscience ! instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre ; juge infaillible du bien et du mal, qui rends l'homme semblable à Dieu, c'est toi qui fais l'excellence de sa nature et la moralité de ses actions ; sans toi je ne sens rien en moi qui m'élève au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs à l'aide d'un entendement sans règle et d'une raison sans principe. Grâce au ciel, nous voilà délivrés de tout cet effrayant appareil de philosophie : nous pouvons être hommes sans être savants ; dispensés de consumer notre vie à l'étude de la morale, nous avons à moindres frais un guide plus assuré dans ce dédale immense des opinions humaines. Mais ce n'est pas assez que ce guide existe, il faut savoir le reconnaître et le suivre. S'il parle à tous les cœurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent ? Eh ! c'est qu'il nous parle la langue de la nature, que tout nous a fait oublier. La conscience est timide, elle aime la retraite et la paix ; le monde et le bruit l'épouvantent : les préjuges dont on la fait naître sont ses plus cruels ennemis ; elle fuit ou se tait devant eux : leur voix bruyante étouffe la sienne et l'empêche de se faire entendre ; le fanatisme ose la contrefaire, et dicter le crime en son nom. Elle se rebute enfin à force d'être éconduite ; elle ne nous parle plus, elle ne nous répond plus, et, après de si longs mépris pour elle, il en coûte autant de la rappeler qu'il en coûta de la bannir. » (Rousseau, Emile ou de l'éducation) Pour Emmanuel Kant également, la conscience morale a un caractère inné ; mais elle ne résulte pas de la sensibilité et de la pitié, seulement de la Raison présente en chaque homme, qui lui indique par définition même le caractère universel des valeurs morales. Mais naturellement, se servir convenablement de sa raison, cela s’apprend. Tous les auteurs soulignent l'importance de l'éducation dans la genèse du sens moral chez l'individu. Qu’elle soit logée dans le « cœur » ou dans la raison, ou même qu’elle résulte purement et simplement des conventions sociales, seule l’éducation peut faire apparaître au grand jour, progressivement, cette faculté de distinguer le bien du mal. Seulement, comment expliquer que certains individus apparemment "raisonnables" et bien éduqués se transforment en délinquants ou en criminels ? D'où une troisième explication qui va ajouter à ces arguments une dimension affective profonde. Freud a assimilé la conscience morale à un aspect très particulier du psychisme qu'il a nommé "le surmoi". Il le définit comme "l'intériorisation des interdits parentaux". Se pose alors la question de savoir comment cette intériorisation a pu s'effectuer. Freud situe ce processus à un niveau inconscient où l’affectif prime sur le rationnel. Pour l’enfant, il ne s’agit pas tant de « comprendre » ce que lui demande ou lui commande l’adulte, mais plutôt de le croire. Or à partir de quand l’adulte est-il crédible ? Freud n’articule pas clairement son concept de Surmoi avec l’éducation, il en souligne plutôt le caractère sévère et oppressant. Mais il nous oriente vers le fait que, au niveau de l’inconscient, intégrer des idéaux et des règles morales passe par un mécanisme d’identification (de l’enfant à l’adulte) qui nécessite lui-même l’amour et un contexte familial favorable. Avec ce nouveau schéma explicatif, il devient plus facile de comprendre la cause d'une absence de conscience morale, par exemple chez ceux que la voix populaire nomme des "monstres". Des monstres immoraux, sans doute, mais qui ne l'ont pas toujours été - donc ne le sont point "par essence" -, mais probablement des enfants qui ont été privés d'affection et d'amour. dm

|
Scooped by
dm
December 20, 2024 3:46 PM
|
Theoria ou les fondements du philosophico-religieux
Telle qu'elle est définie par Platon au livre VI de La République, la Theoria ne désigne pas seulement la connaissance intellectuelle des choses au moyen du discours et de la raison, mais une vision globale de la réalité qui s'assimile plutôt au Logos lui-même, en tant que présence incarnée dans l'esprit humain. A ce titre, elle procure bien plus qu'un simple savoir et excède même le statut de science : il s'agit plutôt d'une « prescience ». Dans la patristique chrétienne, le Logos est incarné par le Christ et la Theoria s'identifie donc avec la sagesse christique, le fait de voir les choses avec les yeux du Christ. En chaque homme, le Logos est présent comme un principe vivifiant, introduisant l'humain à la vie éternelle. Dans ce contexte, voir réclame également d'écouter (la Parole divine), qui réclame à son tour de lire (les Ecritures), car la Theoria n'est pas séparable de l'interprétation. Dans la doctrine chrétienne orthodoxe, que nous allons privilégier ici, Théoria se déploie selon trois dimensions explicites, à savoir l'histoire, l'allégorie, et l'antinomie. D’abord l'investigation historique est une composante à part entière de l'interprétation. Elle permet non seulement d'établir la réalité des faits mentionnés dans les Evangiles, mais aussi de les situer et de les comprendre dans leur contexte culturel et linguistique. La Trinité confère une signification unitaire à l'histoire de chaque homme et à celle de l'Humanité, au sens où elle permet d'envisager la vie terrestre dans la perspective de la vie éternelle. La sociohistoire est donc rehaussée d'une hiérohistoire. Ensuite, l'approche historique se double d'une approche allégorique ou tropologique. Les Ecritures ne se contentent pas de narrer des faits, elles donnent à entendre des symboles. Le propre des symboles étant de nouer des liens, leur compréhension n'est autre que l'intelligence des relations complexes entre les êtres, à condition d'envisager ces relations en profondeur, en fouillant l'au-delà des apparences. La condition d'une telle conduite herméneutique réside dans la liberté, car chaque individu engage sa propre vie à travers la lecture, et le bénéfice en est la créativité et la fécondité ; en effet découvrir des significations ouvre l'existence à de nouveaux possibles. Un trop grand attachement à la démarche allégorique pourrait cependant s'avérer nuisible, car l'inflation de l'interprétation et l'excès de significations qui en résulte amènerait à confondre les plans du langage et du réel. De là certaines dérives théosophiques ou autres, qui font perdre le sens sacré des Ecritures et de la religion. C'est pourquoi l'herméneutique orthodoxe est inséparable d'une ascèse, soit une assise de l'interprétation dans l'existence elle-même. D'une part l'incarnation reste finalement la référence absolue et incontournable de toute Theoria orthodoxe, d'autre part l'Eglise (définie justement comme le Corps du Christ) garantit le fait que l'interprétation intéresse l'humanité toute entière, excluant tout point de vue individualiste : la dissémination équivaudrait à une déperdition de sens. Enfin le style antinomique de l'interprétation orthodoxe s'explique par la nature même de l'intelligence vécue, spécifiée comme retournement : il s'agit toujours de remettre à l'endroit, de retourner un texte ou une parole jusqu'à ce qu'il parvienne à une sorte d'auto-révélation ou d'auto-interprétation. On interprète et on lit dans le « bon sens », dans la bonne orientation, lorsque on lit avec son âme ; lorsque l'âme apparaît à la fois comme lectrice authentique et comme la chose lue elle-même. La question de l'herméneutique est inséparable de celle de la vie, car l'enjeu pratique reste toujours le même : vivre du pain de la vie éternelle, vivre vraiment, vivre de la vie... C'est cela la Theoria, cette vision ou interprétation de la vie qui est en même temps une vision vécue, concrètement interprétée. La dimension du langage est évidemment essentielle, l'interprétation s'effectuant au sein même du langage ; mais il s'agit toujours d'entendre une autre parole en l'attribuant au divin. En ce sens, seul le Christ peut réellement interpréter, lui qui est la Parole vivante, le Verbe incarné. Le Christ et la Theoria ne font qu'un. Bien sûr le paradigme rassemblant en une seule essence la vie et la théorie, la vie et la vision, et finalement la théorie et la pratique, s’avère un fait de culture non exclusif de la tradition orientale du christianisme. Cette tradition et surtout ce paradigme unitaire (théorie et pratique) définissent ce que nous appelons le phénomène philosophico-religieux dans son ensemble, oriental et occidental. dm

|
Scooped by
dm
December 20, 2024 4:15 AM
|
De la conscience à la connaissance de soi. Moi empirique et moi transcendantal
Commençons, avec Kant, par rappeler le principe à la fois psychologique et moral de la conscience : elle donne à l’homme une identité, elle fait de l’homme une personne (la distinction radicale d’avec l’animal, faite ci-dessous, devrait sans doute être amendée aujourd’hui !) : « Le fait que l'homme puisse avoir le Je dans sa représentation, l'élève infiniment au-dessus de tous les autres êtres vivants sur la terre. Par-là, il est une personne et, grâce à l'unité de la conscience dans tous les changements qui peuvent lui arriver, il est une seule et même personne, c'est-à-dire un être entièrement différent, par le rang et la dignité, de choses telles que les animaux sans raison, dont on peut disposer à sa guise; et ceci, même lorsqu'il ne peut pas encore dire le Je, car il l'a cependant dans sa pensée; ainsi toutes les langues, lorsqu'elles parlent à la première personne, doivent penser le Je, même si elles n'expriment pas cette relation au Moi par un mot particulier. Car cette faculté (de penser) est l'entendement. » (Anthropologie du point de vue pragmatique) Même lorsqu'il ne peut pas encore dire le Je » : Kant ici fait allusion au petit enfant qui, même s’il n’est pas totalement conscient de son individualité, n’en est pas moins une personne et un être humain à part entière. Mais surtout grâce à Kant nous allons pouvoir préciser : 1) ce qui peut être appelé « conscience », 2) comment celle-ci peut « connaître » quelque chose en général, 3) et du coup comment je peux connaître quelque chose de « moi-même ». En effet, pour connaître il ne suffit pas de « se représenter » les choses, il faut pouvoir y parvenir de manière objective, c’est-à-dire qu’il faut d’un côté un sujet, et d’un autre côté, il faut se donner un objet précis à connaître : or comment la conscience peut-elle se trouver en position d’« objet » pour elle-même ? Justement en distinguant deux formes de conscience ou de « moi ». a) Le moi transcendantal. – « Transcendantal » désigne chez Kant ce qui fournit « les conditions a priori d’une connaissance en général », ce qui permet d’unifier et de connaître les données de l’expérience. Donc ce que Kant appelle le « moi transcendantal » est une fonction supérieure de l’esprit humain qui nous permet de synthétiser nos représentations (et par-là de les comprendre). “Le ‘Je pense’, écrit Kant, doit pouvoir accompagner toutes mes représentations” : ce “je pense” unificateur est une fonction permanente de la conscience, présente en chaque pensée et unifiant toutes mes pensées. Remarque. - Cette fonction « transcendantale », unifiante et connaissante, de l’esprit humain n’a pas d’équivalent dans le monde des machines ou dans l’I.A. : aucun ordinateur, disposant de données et d’informations, aussi calculateur et puissant soit-il, ne peut les synthétiser de façon consciente, donc nous ne pouvons pas dire d’un ordinateur qu’il « connait » quelque chose. b) Le moi empirique (ou psychologique). - Est « empirique », en règle générale, ce qui existe et ce que l’on éprouve à travers l’expérience. Nos états de conscience s’enrichissent de sensations, d’expériences, de vécus, de relations diverses, etc. Si le « moi transcendantal » est la face sujet (connaissant), le « moi empirique » est la face objet (à connaître) de ma personne. Il s’agit de la conscience en tant que réalité multiple, évolutive et changeante. Finalement qu’est-ce que « je » peux connaître de « moi » ? Tout ce qui est « empiriquement » observable par moi-même et en moi-même, mais cela reste limité puisque ce vécu change tout le temps ! Même nos « traits de caractères » peuvent varier. Celui qui prétend se connaître absolument est un imposteur. Il faudrait pour cela que l’âme soit figée éternellement, alors que précisément le moi (empirique), soumis au temps, change sans cesse. On ne se connait donc jamais intégralement. Par quel miracle pourrait-on se connaître soi-même intégralement, « tel qu’on est », puisque nul n’a accès à cet « être » qui n’est jamais « objet » dans sa totalité ? Certes il y a bien un « fil conducteur », fil invisible qui relie l’ensemble de ma personnalité et qui la mémorise. Mais ce fil est précisément le « Je » sujet, or l’on doit exclure par principe que « je » puisse connaître « je » : tout simplement parce que, sous ce rapport, il n’y a rien à connaître du tout ! « Je » - la conscience - est une fonction de synthèse, pas un objet ou un contenu. Conclusion. - « Être conscient » signifie bien dans un premier temps « être conscient de soi ». Il y a bien un sujet conscient qui unifie et qui rend possible (c’est le sens de transcendantal) la diversité de nos expériences vécues (au niveau du moi empirique). Mais il faut bien reconnaître que cette connaissance reste très subjective, peu objective, donc possiblement peu fiable. Tout seul, dans le pur rapport de Je à moi-même, je peux demeurer dans l’illusion la plus totale ! Pour devenir réelle, cette connaissance de soi devra s'effectuer dans le monde, se "frotter à la réalité" comme on dit, et prendre la forme d’une reconnaissance. C'est Hegel qui notamment développera cette notion de reconnaissance. Pour se connaître vraiment, il ne faut pas seulement penser, il faut sortir de soi, il faut agir et rencontrer l’autre, car c'est seulement à travers ce que l'on fait que l'on peut reconnaître ce que l'on est – voire qui on est. dm

|
Scooped by
dm
December 18, 2024 4:21 AM
|
Je et Moi : de l'identification symbolique à l'individualité assumée
Partons de cette observation d'Emmanuel Kant : "Mais il est remarquable que l'enfant, qui sait déjà parler assez correctement, ne commence pourtant qu'assez tard (peut-être bien un an après) à dire Je ; jusque-là, il parlait de lui à la troisième personne (Karl veut manger, marcher, etc.); et il semble que pour lui ce soit comme une lumière qui vient de se lever, quand il commence à dire Je; à partir de ce jour, il ne revient jamais à l'autre manière de parler. - Auparavant il ne faisait que se sentir, maintenant il se pense". (Anthropologie du point de vue pragmatique) Si l'on parle d'identité personnelle, de conscience, etc., il faut supposer un processus d'identification intervenant dans le temps et impliquant nécessairement autrui. Le phénomène décrit par Kant ci-dessus correspond, après l'identification par l'image (cf. le stade du miroir), à une identification par le langage ; après l'identification imaginaire (entre 4 et 6 mois), place à l'identification symbolique (vers 3 ans). Elle intervient donc beaucoup plus tard avec l’acquisition du langage, et surtout avec la maîtrise des formes pronominales. Kant remarque que l’enfant jusque vers trois ans parle souvent de lui à la troisième personne, qu’il éprouve les pires difficultés à aligner d’un seul jet le pronom personnel sujet « je » et sa forme complément d’objet « me » ou « moi » : ainsi au lieu de « dire « je me suis fait mal », toto va dire « toto s’est fait mal ». Cette maîtrise une fois acquise n’est pas seulement formelle, logique et grammaticale, elle est sociale et existentielle. L’enfant devient conscient de lui-même et de son existence parmi d’autres : de même que “Je” doit s’articuler correctement dans la phrase avec les autres mots, “Je” doit tenir une place dans la société et tenir compte des autres (c’est l’époque de la scolarisation). Notons que cette identification que l'on peut qualifier de "symbolique", par opposition à imaginaire, est surtout explicitement "logique" et "linguistique" ; elle reste secondaire par rapport à une première identification proprement symbolique (par le "trait unaire" comme le dit Lacan à la suite de Freud) intervenant au niveau de l'inconscient dès les premiers âges de la vie, dès que l'enfant entend qu'il est assujetti à la parole d'autrui, "parlé" avant même d'être parlant, et notamment appelé par son prénom. Qu’est-ce que cela signifie, le fait que l’enfant maîtrise l’usage combiné du « je » et du « moi », sinon que son individualité jusque-là confuse au niveau linguistique (Je et moi confondus) mais égocentrée à l’extrême psychologiquement, surprotégée socialement au sein du giron familial, désormais s’inscrit distinctement dans une chaîne bien ordonnée et différenciée qui est celle de la vie sociale, où le « moi » est sans cesse en butte aux autres moi, où les individus peuvent être des garçons… ou des filles (et la société nous le fait bien comprendre), où la joie le dispute à la tristesse, où la mort succède à la vie… Un jour un autre moi peut même apparaître au sein de la famille, un frère ou une sœur, une nouvelle existence que rien ne permettait d’anticiper. Un jour, l’enfant comprend même ce que veut dire « plus jamais » : un grand-père, une grand-mère peut mourir... A la suite de Kant, amusons-nous de l’erreur commise par ce petit enfant décrivant ainsi sa fratrie : « J’ai trois frères, Paul, Victor, et moi »... i En réalité cet enfant a deux frères et non trois, bien sûr ! L’enfant devrait dire “Nous sommes trois frères” (ou bien « je suis l’un des trois frères »), mais il énonce “J’ai trois frères”, substituant le “Je” au “Nous” et le verbe "avoir" au verbe "être". Il ne parvient pas à se positionner correctement avec le verbe être, comme s’il n’était pas encore clairement conscient de son existence individuelle, à côté de celle des autres. En utilisant le verbe avoir, il devrait dire « j’ai deux frères », mais il dit « j’ai trois frères » : le caractère illogique (et amusant, pour nous) de cette réponse provient du fait que l’enfant se compte deux fois, donc de façon très égocentrique : une première fois en tant que sujet de cette phrase (“Je”), une seconde fois en tant que l’un de des trois objets de cette phrase, l’un des trois frères de cette famille (désigné par “moi”). Le “je” et le “moi” ne sont pas coordonnés logiquement. L’enfant ne distingue pas, ni dans sa phrase ni par conséquent dans son esprit, le “je” qui pense et qui parle ici (en position de sujet), en train de compter ses frères, et le “moi” (en position d’objet) qu’il est également, en tant que frère lui-même… Il s’agit bien d’une confusion logique. Mais qu’est-ce que cela révèle de la psychologie de l’enfant ? L’utilisation du verbe avoir, et le fait de se compter deux fois, montre que l’enfant éprouve des difficultés pour l’instant à se compter à égalité parmi ses frères, à partager avec eux sa place dans la famille et sans doute auprès des parents, et qu’il voit les choses encore de façon trop égocentrique comme s’il était le “centre du monde”, comme un enfant qui n’a pas encore acquis la maturité pour assumer une existence sociale partagée. dm

|
Scooped by
dm
December 15, 2024 5:31 AM
|
La conscience, de l'intériorité à la subjectivité (Analyse conceptuelle)
L'âme ou l'intériorité La conscience peut d’abord être définie par l’intériorité, et l’intériorité est définie par l’ensemble de notre vie psychique : pensées, sentiments, émotions, sensations, états d’âme, etc. Cela suppose un “extérieur”, c’est-à-dire le monde des choses par opposition au monde de la conscience. N’oublions tout de même pas que l’adjectif « intérieur » n’est qu’une métaphore, une transposition au plan psychologique d’une réalité physique, le caractère de ce qui est cerné et clos par quelque limite (de ce point de vue, à l'"intérieur" de nous, il n'y a que des organes !). « Intériorité » du sujet qui s’applique au caractère privé, caché, invisible, non localisable et apparemment immatériel de la conscience – toujours par opposition au monde physique extérieur, dont fait évidemment partie le corps. D’où cette opposition classique entre l’âme - qui n’est nulle part dans l’espace, donc littéralement pas plus à l’intérieur qu’à l’extérieur - et le corps, qui occupe l’espace. En tout cas, même si ce terme d’intériorité est contestable, nous possédons tous une « vie intérieure », qui le niera ? - Notons quand même que le corps (supposé visible) est aussi bien le lieu par excellence de l’intimité, et l’objet de la pudeur (ce qui doit rester caché) ; par opposition « la conscience (supposée cachée) est bien ce qui nous sert à communiquer… Paradoxe, donc ! Ce n’est pas aussi simple... L’« âme » est un terme ancien (psyché en grec, anima en latin) qui désigne originellement le principe vivant d’une chose, ce qui anime une chose. Bien souvent on emploie indifféremment « âme » ou « esprit », mais son assimilation avec l’« esprit » au sens intellectuel ou même psychologique du terme est un phénomène tardif, dû aux premiers philosophes chrétiens. Hormis Platon, les philosophes grecs ne cherchaient pas à séparer l’âme et le corps, l’âme sous ses différents aspects n’étant au fond que l’ensemble des fonctionnalités du corps. Le propre de l’homme selon Aristote est de posséder, outre une âme végétative (alimentation et reproduction) et une âme sensitive comme tous les animaux, une âme intellectuelle ou rationnelle (faculté “dianoétique”). Il est donc absurde d’affirmer que les « animaux » (terme tout droit dérivé du latin anima) n’ont pas d’âme ni de psychisme sous quelque forme que ce soit. En revanche le règne minéral ne possède pas d’âme. Moi et identité, conscience et subjectivité Comment passe-t-on de la simple intériorité (d’abord sensitive et affective : plaisir, joie…) à la subjectivité consciente, de la simple sensation de soi à la conscience de soi ? En faisant intervenir une faculté de représentation qu’on appelle généralement la pensée, qui implique aussi réflexion (voire division) et distanciation… Représentation : moi. - Il y a deux vérités immédiates et incontournables que tout être humain sait de lui-même: "Je suis" (personne ne peut dire "je ne suis pas") et "je suis moi" (personne ne peut dire, sauf trouble grave, “je ne suis pas moi-même”). L’identité, c’est donc le fait de rapporter à un moi unique la perception de son existence, à la fois mentale et corporelle (car le corps est aussi un élément essentiel de notre identité). La conscience est une faculté de re-présentation mentale. Je rassemble dans un même vécu “subjectif” la totalité disponible de mes pensées, de mes sentiments, et de tout ce que je ressens, y compris physiquement. Cela vaut pour le présent comme pour le passé, pour autant que la mémoire ne me fait pas défaut (notion d’identité mémorielle). Cette faculté constante de rapporter les choses à soi, puis de se représenter, de se considérer soi-même, intentionnellement ou pas, bref d’avoir une subjectivité, ce n’est rien d’autre à proprement parler que la pensée. Réflexion et division : je et moi. - Cette différence notable entre la simple intériorité (sentir quelque chose en soi : par ex. plaisir, joie…) et la subjectivité (sentir quelque chose comme appartenant à soi, et se sentir soi-même : par ex. fierté, honte…) implique donc la faculté de se représenter soi-même, et même de se réfléchir soi-même. La conscience est une sorte de réflexion ou de rapport à soi, qui divise l'être en un pôle sujet et un pôle objet. Penser consciemment c’est être capable de dire « je me », et d'agir en conséquence : je me morfonds ou je m'éclate, je me fais du mal ou du bien, je pense à moi, je m'aime, etc. Le sujet grammatical, ou pronom, est double : il y a "je" (dit "sujet" du verbe) et "moi" (dit "complément d'objet" du verbe). La réflexion, la division ou la duplication de soi pour mieux se saisir soi-même "en entier", c'est donc le propre de la conscience. Distanciation : moi et les autres. - La conscience implique un pouvoir de distanciation entre soi et soi d’une part (réflexion), et entre soi et le monde d’autre part, un certain parcours qui sépare justement le simple fait d’avoir un moi (identité immédiate quasi-instinctive) et le fait d’être un sujet (personnalité consciente et mature). Le sujet conscient a la faculté de se poser soi-même face au monde, face aux autres. Cela revient à faire l’épreuve d’une certaine solitude existentielle : « je suis moi, je ne suis pas toi, et je ne le serai jamais » ! Tout être humain sait cela… Solitude assez vertigineuse, quand on y pense : “pourquoi moi ?”, “pourquoi suis-je moi ?”. Pourquoi suis-je enfermé dans la coquille de ce moi ridicule, étroite fenêtre par laquelle j’entrevois le monde ? La vérité c'est que le moi n’est pas seulement un être comme les autres dans ce monde (ce qui en ferait seulement un objet), mais aussi et surtout un point de vue singulier sur le monde et les choses (ce qui fait de lui un sujet). Un moi parmi d’autres mois qui ne sont jamais que d’autres points de vue… Heureusement que ces points de vue se rejoignent : c’est la vie sociale, l’intersubjectivité, le rapport à Autrui. dm
|

|
Scooped by
dm
January 9, 4:08 AM
|
La subjectivité du désir. Du désir de puissance au désir de reconnaissance
1) Le désir comme puissance d’être : la théorie du « conatus » (Spinoza) a) Le désir de vivre. – La tradition eudémoniste ne cesse de parler "des" désirs (au pluriel) et surtout de leurs objets, mais nous devrions plutôt nous concentrer sur le désir (au singulier), comme force, moteur, production. Rappelons d'abord que le désir, en un sens, est l'essence de la vie. Vivre, c’est désirer vivre. Tout est désir, y compris l’aversion qui n’est que le désir de s’éloigner d’une chose qui ne nous plaît pas. Tout ce qu’on fait, on le fait parce qu’on le désire. Dans la philosophie de Spinoza, le désir se nomme premièrement “conatus”, d’un terme qui veut dire “effort”. Il écrit : “Chaque chose, autant qu’il est en elle [autant que possible], s’efforce de persévérer dans son être” (“Ethique III, prop. 6). Autrement dit le conatus, c’est ce qui manifeste la force d’exister d’un être, sa puissance d’être et l’affirmation de son individualité en fonction de sa nature propre. Il faut comprendre que, dans le système de Spinoza, chaque chose singulière est un « mode » de la « substance » unique assimilée à Dieu, ce qui revient à dire que chaque chose est Dieu d'un point de vue déterminé (panthéisme). Comme Dieu est puissance infinie d'exister, chaque chose est donc puissance d'exister d'un point de vue déterminé. « Puissance d'exister » est alors à comprendre autant comme effort de conservation de son essence (sa nature propre) que comme augmentation, extension indéfinie de cette essence. Enfin le concept de conatus est lié, chez Spinoza, au couple constitué de deux affects : joie et tristesse. Tout « facteur » qui vient augmenter notre puissance d'exister, et donc favoriser notre conatus, provoque inévitablement en nous un affect de joie ; inversement, tout facteur réduisant notre puissance d'exister provoque immanquablement de la tristesse. L’éthique, pour tout homme, consiste à rechercher des situations nous faisant éprouver un maximum de joie, car cette affection « active » nous permet non seulement de conserver notre puissance d’être mais encore de l’accroître (ce qui se produit spécifiquement lorsque, grâce à ses facultés intellectuelles, l’homme parvient à la contemplation de la nature divine). La particularité de l’homme, c’est qu’il a conscience de cet effort, de cette puissance. Et aussi l'homme est un être dont la complexité lui permet de s'étendre beaucoup plus que tous les autres organismes connus, d’abord intellectuellement. b) Le désir est l’essence de l’homme. — Donc le désir est le moteur même de nos actions, l’expression de notre puissance d’exister, l’affirmation de notre individualité.. C’est pourquoi Spinoza affirme « le désir est l’essence de l’homme ». L’essence de l’homme, c’est ce qui fait qu’un homme est un homme et le demeure. D’abord précisément à cause du conatus, du désir d’exister comme essence de tout être vivant. Mais si le désir est l’essence de l’homme, cela veut dire aussi qu’il est propre à l’homme. Car le désir n'est justement rien d'autre que le fameux "conatus" en tant que conscient : « le désir se rapporte aux hommes, en tant qu’ils ont conscience de leurs appétits et peut, pour cette raison, se définir ainsi : le désir est l’Appétit [tendance, pulsion, etc.] avec conscience de lui-même ». Les autres êtres vivants ont des tendances, des « appétits », ils subissent la loi du « conatus », mais ils ne connaissent pas le « désir ». c) La subjectivité du désir. - Désir et conscience sont donc intimement liés. C’est pourquoi on peut parler d’une « subjectivité » du désir, au sens d’abord où l’homme est conscient de ses désirs selon Spinoza. De ce fait, tous ses désirs deviennent "son" désir propre. Le désir n'est pas seulement l'essence de l'homme, en général, il est propre à chaque homme. Chaque homme désire à sa manière. Effet de la conscience, le désir est personnel. Mais le désir peut être dit « subjectif » dans un autre sens encore. En effet le désir est souverain, au sens de maître de soi ; il est “sujet” dans un sens parce qu’il « décide » lui-même de ce qui désirable et de ce qui ne l’est pas. Il ne se laisse pas commander par le jugement ou la raison. Contrairement à ce que prétendait Aristote, nous ne désirons pas une chose parce que nous la jugeons bonne (ce qui suppose que le jugement est premier), mais nous la jugeons telle parce que nous nous efforçons vers elle, parce que nous la désirons (cela suppose la primauté du désir). Spinoza : « Ce n’est pas parce qu’une chose est bonne que nous la désirons, c’est parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne ». C’est le désir qui crée la valeur, qui donne de la valeur aux choses, non l’inverse. Par exemple, ce n’est pas parce qu’une chose « est » belle (selon quel critère ?) que nous la désirons, c’est parce que nous la désirons que nous la voyons ou même que nous la rendons belle. Le désir est une puissance créatrice de valeurs. Tout semble indifférent lorsque l’on évacue toute référence a priori aux valeurs, aux vérités préétablies qui viendraient d’”en haut”. Mais justement, non, c’est le désir qui fait toute la différence. Dès qu’il y a désir, il y a comme une pente, une tendance, une force qui va nécessairement d’un bas (d’où pousse le désir) vers un haut, un haut qui est toujours “bien” parce qu’il est désiré. De ce fait, il n’y a plus de « bons » et de « mauvais » désirs a priori. Ce n’est plus le choix de tel ou tel « objet » de désir (réaliser un projet, acquérir un bien, devenir savant, aimer quelqu’un, etc.) qui fait la valeur du désir, c’est la force du désir et son authenticité, le fait que ce soit bien notre désir (subjectif). Le désir étant fondamentalement désir d’être, d’exister (en fonction de sa nature propre, comme dirait Spinoza), l’"objet" du désir n’est autre que la Vie. Il est toujours bon de désirer, quand on désire de tout notre être, tandis que ne pas bien désirer (poussivement, passivement…) est un mal, une pitié, une perte de temps ! On ne désire pas quand on est sujet à la passivité, voire à la passion. Spinoza opposait assez nettement le désir et la passion, ce dernier terme prenant alors un sens négatif (car synonyme de "passivité"). Nietzsche reprendra cette conception du désir en termes d'"intensité" : le désir intense valorise et sublime tout sur son passage ; à l'inverse quand il se fige, lorsqu'il perd son dynamisme, son intensité, il devient négatif, "réactif", et ne mérite plus le nom de désir (il devient "mauvais", "coupable", il devient conscience !). Cependant il nous faut examiner plus scrupuleusement les rapports du désir et de la conscience. C’est une chose de considérer la conscience comme une propriété majeure du désir (Spinoza), c’en est un autre de définir la conscience tout entière comme « désirante »… C’est ce que va développer Hegel : désirer et être conscient ne sont pas seulement « associés », il faut dire que c’est la même chose. C’est parce qu’elle est elle-même désirante, tournée à la fois vers elle-même et vers une « autre » en quête de reconnaissance, que la conscience est dynamique et peut évoluer. 2) Le désir comme processus conscient et quête de la reconnaissance (Hegel) a) Le « désir de soi » et le désir de reconnaissance - Nous devons tenir pour acquis que le désir est l’essence de l’homme. Et que sa finalité n’est pas un « avoir » à posséder mais un « être » à exprimer et à développer. Nous devons montrer maintenant que le désir est l’expression même de la subjectivité humaine, comment il se trouve au cœur de la vie consciente. Dans sa Phénoménologie de l’esprit, Friedrich Hegel rappelle bien que l’homme désire avant tout être lui-même, et pour cela être reconnu. Cela signifie que la conscience désire avant tout être consciente d’elle-même : pas cette conscience de soi « théorique » ou immédiate qu’elle possède de toute façon, mais cette conscience de soi qui est connaissance de soi et qui passe par la reconnaissance de soi et des autres à travers les actions, les œuvres… Selon Hegel toute conscience est animée par un désir d’unité. Elle fait l’épreuve douloureuse du manque (cf. la « conscience malheureuse »), et cherche à restaurer la plénitude. Jean Hyppolite (20è) écrit à propos du désir chez Hegel : " L'objet individuel du désir, ce fruit que je vais cueillir, n'est pas un objet posé dans son indépendance, on peut aussi bien dire qu'en tant qu'objet du désir, il est et il n'est pas ; il est, mais bientôt il ne sera plus ; sa vérité est d'être consommé, nié, pour que la conscience de soi à travers cette négation de l'autre se rassemble avec elle-même. (…) Le terme du désir n'est donc pas, comme on pourrait le croire superficiellement, l'objet sensible - il n'est qu'un moyen - mais l'unité du Moi avec lui-même. La conscience de soi est désir ; mais ce qu'elle désire, sans le savoir encore explicitement, c'est elle-même, c'est son propre désir et c'est bien pourquoi elle ne pourra s'atteindre elle-même qu'en trouvant un autre désir, une autre conscience de soi. (…) Le désir porte sur les objets du monde, puis sur un objet déjà plus proche de lui-même, la Vie, enfin sur une autre conscience de soi, c'est le désir qui se cherche lui-même dans l'autre, le désir de la reconnaissance de l'homme par l'homme ... " b) Le « désir de soi » et le désir de pouvoir - Nous comprenons que le désir vise premièrement des objets divers et variés, qui disparaissent aussitôt, car le vrai objet est la plénitude avec soi-même, mais cela nous contraint à passer par l’intermédiaire d’autrui. L’aspect négatif de ce « désir de reconnaissance » réside dans sa face égocentrique qui se manifeste comme narcissisme, orgueil, ambition, et donc désir de pouvoir ; en bref le désir d’exalter sa personnalité en éprouvant le besoin de dominer les autres. Car exercer un pouvoir sur les autres est le passage obligé, dans un premier temps, pour valoriser son « moi ». Or le vice inhérent au désir de pouvoir, c’est qu’il est sans fin, car ainsi que l’explique Hobbes le but n’est pas tant d’accroître sa domination sur les autres que de la conforter dans le temps, ce qui oblige à la surenchère, par peur de perdre un jour ce pouvoir : Thomas Hobbes (17è), Le Léviathan, chap. II – « Je mets au premier rang, à titre d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir, désir qui ne cesse qu'à la mort. La cause n'en est pas toujours qu'on espère un plaisir plus intense que celui qu'on a déjà réussi à atteindre, ou qu'on ne peut pas se contenter d'un pouvoir modéré : mais plutôt qu'on ne peut pas rendre sûrs, sinon en en acquérant davantage, le pouvoir et les moyens dont dépend le bien-être qu'on possède présentement. De là vient que les rois, dont le pouvoir est le plus grand de tous, tournent leurs efforts vers le soin de le rendre sûr, à l'intérieur du pays par des lois, à l'extérieur par des guerres. Et quand cela est fait, un nouveau désir vient prendre la place : désir, chez quelques-uns, de la gloire de conquêtes nouvelles ; chez d'autres, de commodités et de plaisirs sensuels ; lez d'autres enfin, d'être admirés ou loués par des flatteurs, pour leur maîtrise en quelque art, ou pour quelque autre talent de l'esprit. » Le désir est donc ordinairement narcissique, auto-centré, pure ambition… Mais ce n’est pas une solution durable, car les autres nous le font payer cher ; en effet eux aussi sont susceptibles de chercher le pouvoir et la domination ! Le désir de reconnaissance nous met en concurrence avec autrui… c) Le désir de l’autre et le désir mimétique – Comment passe-t-on du « désir de soi » (qui est narcissisme, puis ambition) au vrai « désir de l’autre » (qui est altruisme, puis amour) ? Cette expression « désir de l’autre » peut s’entendre de plusieurs façons. 1) Désirer « autre chose » en général : cela résulte de notre point de départ, à savoir que le désir s'origine dans le manque, il vise toujours quelque chose d'autre (que l'on n'a pas). 2) Surtout, désirer « ce que l’autre désire » : en effet le désir est fondamentalement social et mimétique selon le philosophe René Girard (20è). Qu’est-ce qui rend un objet désirable, qu’est-ce qui lui confère de la valeur à nos yeux ? Bien évidemment le fait que d’autres le désirent et le convoitent aussi ! Cela signifie qu’entre l’objet de mon désir et moi-même, se tient un « médiateur » (autrui, la société, un tiers quelconque) qui valorise l’objet dans son « être », ce qui explique ma volonté de le posséder à mon tour, de l’« avoir ». Cela vaut pour toute sorte d’objets, des plus ordinaires aux plus sophistiqués. Qu’est-ce qui rendrait désirable une superbe voiture de sport Ferrari si cet objet n’était pas regardé admirativement par …les autres ? Qu’est-ce qui rendrait cette femme désirable à mes yeux si je ne pensais pas qu’elle pourrait être aussi bien désirée par d’autres hommes ? Etc. Et bien sûr ce processus est inconscient. « En observant les hommes autour de nous, on s'aperçoit vite que le désir mimétique, ou imitation désirante, domine aussi bien nos gestes les plus infimes que l'essentiel de nos vies, le choix d'une épouse, celui d'une carrière, le sens que nous donnons à l'existence. Ce qu'on nomme désir ou passion n'est pas mimétique, imitatif accidentellement ou de temps à autre, mais tout le temps. Loin d'être ce qu'il y a de plus nôtre, notre désir vient d'autrui. Il est éminemment social... L'imitation joue un rôle important chez les mammifères supérieurs, notamment chez nos plus proches parents, les grands singes ; elle se fait plus puissante encore chez les hommes et c'est la raison principale pour laquelle nous sommes plus intelligents et aussi plus combatifs, plus violents que tous les mammifères. L'imitation, c'est l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de plus dynamique ; c'est ce qui dépasse l'animalité, donc, mais c'est ce qui nous fait perdre l'équilibre animal et peut nous faire tomber très au-dessous de ceux qu'on appelait naguère « nos frères inférieurs ». Dès que nous désirons ce que désire un modèle assez proche de nous dans le temps et dans l'espace, pour que l'objet convoité par lui passe à notre portée, nous nous efforçons de lui enlever cet objet et la rivalité entre lui et nous est inévitable. C'est la rivalité mimétique. Elle peut atteindre un niveau d'intensité extraordinaire. Elle est responsable de la fréquence et de l'intensité des conflits humains, mais chose étrange, personne ne parle jamais d'elle. Elle fait tout pour se dissimuler, même aux yeux des principaux intéressés, et généralement elle réussit ». (René Girard, Celui par qui le scandale arrive, 2001) “Personne ne parle jamais d’elle”…. il ne faut pas entendre l’existence de quelque “complot” en la matière, mais plutôt l’indication du caractère inconscient de ce processus à la fois mimétique et narcissique, que la psychanalyse met d’ailleurs parfaitement à jour. S’il est la source de tous les progrès humains, c’est également ce mimétisme - ce passage de mon désir par le désir de l’autre - qui nourrit le désir de possession, de même que l’ambition, et explique la violence entre les hommes. Sméagol (dans le « Seigneur des anneaux ») désirerait-il plus que tout le « précieux » anneau si cet objet n’était pas initialement convoité par son cousin ? Qu’est-ce qui confère à cet objet symbolique un tel attrait - outre son pouvoir légendaire - si ce n’est certes sa rareté mais aussi le fait qu’il soit ardemment recherché par toutes sortes de « personnes » ? On voit bien à travers cet exemple que le désir de possession et la soif de pouvoir peuvent mener jusqu’à la folie et l’autodestruction… Le désir de l’homme est donc désir de reconnaissance comme l’affirme Friedrich Hegel, et le désir de dominer autrui, de régner, le désir de pouvoir et de gloire en font partie. Au-delà de ces aspects négatifs, en quoi consiste la vraie reconnaissance ? Ce n’est certes pas en écrasant les autres que nous serons reconnus par eux comme quelqu’un de bien et de valeureux, mais c’est en les aidant, en leur permettant d’être à leur tour d’être des « sujets du désir » autonomes… Au-delà de l’altruisme moral, on comprend bien que le prolongement de cette problématique de la « reconnaissance » n’est autre que celle de l’amour, le désir amoureux comme la vraie et la « grande affaire » du désir humain… dm

|
Scooped by
dm
January 7, 3:53 PM
|
L'eudémonisme et le désir du bonheur
L'eudémonisme (eudon, bonheur) est la doctrine selon laquelle la finalité essentielle, et naturelle, de la vie humaine serait d'atteindre le bonheur ; lequel serait en même temps l'objet ultime, également naturel, du désir. Mais les théories eudémonistes, qui dominent dans l'Antiquité, ne s'accordent pas toujours sur la nature du bonheur, même si elles l'associent toujours au respect de la raison et donc à l'accomplissement d'une certaine sagesse. On retrouve d'abord l'opposition classique entre épicurisme et stoïcisme. L’hédonisme et la recherche des plaisirs (épicurisme) L’« hédonisme » (de hedon, plaisir) est la doctrine selon laquelle la recherche des plaisirs naturels est aussi la voie du bonheur. Pour le philosophe grec Epicure (IVè av. JC) il n’existe aucun autre but dans la vie que de trouver la satisfaction et d’éviter le manque – et ceci vaut pour tous les êtres. Pour autant ne confondons point le désir et la nécessité, ou la tendance et le besoin. La plante a besoin d’eau, c’est entendu ; mais trouver l’eau n’est point le but, la finalité de la plante. Le but de la vie, ce n’est pas seulement la survie, mais la croissance, la reproduction, l'épanouissement… Que désire l’homme ? Parvenir à ce que les épicuriens nomment l’« ataraxie », soit l’absence de trouble, ou tranquillité de l’âme. C’est leur définition du bonheur. Mais pour un être pourvu de raison et de jugement tel que l’homme, le bonheur est synonyme de sagesse, et c’est la philosophie qui peut y conduire car elle permet de trier les bons et les mauvais désirs – les premiers se caractérisant comme « naturels ». Il est donc important de procéder à une hiérarchie fine des désirs et donc des plaisirs, que voici : I. Désirs naturels a. Désirs naturels et nécessaires i. pour le bonheur : paix avec soi et philia avec autrui ; ex. « convier des amis » ii. pour le bien-être du corps ; ex. « bien manger… mais pas trop » iii. pour la vie elle-même ; ex. « se nourrir suffisamment » b. Désirs naturels et non nécessaires ; ex. désir sexuel, désir esthétique… II. Désirs vains (« vides » : sans objet réel, inutiles et nuisibles) : ce sont tous les désirs excessifs ; dès qu’ils vont au-delà des limites prescrites par la nature, ils comportent l’illimité (et donc l’insatisfaction pathologique) ; ex. désir de possessions matérielles et de richesse, désir de pouvoir, désir de gloire… Se fixer sur des choses extérieures à soi et superflues n’est pas naturel : comme la richesse, ou même la gloire, autant de désirs inutiles qui divisent les hommes et mènent à la guerre. Pour Epicure, comme pour son commentateur latin Lucrèce (1er s. av. J.-C.), le progrès matériel est suffisant au stade où il en est. Progresser dans l’abondance des biens matériels ne contribuerait en rien au bonheur. « Alors, c'étaient donc les peaux de bêtes, aujourd'hui c'est l'or et la pourpre qui préoccupent les hommes et les fait se battre entre eux : ah ! c'est bien sur nous, je le pense, que retombe la faute. Car le froid torturait ces hommes nus, ces enfants de la terre, quand les peaux leur manquaient : mais pour nous, quelle souffrance est-ce donc de n'avoir pas un vêtement de pourpre et d'or rehaussé de riches broderies ? Une étoffe plébéienne ne suffit-elle pas à nous protéger ? Ainsi donc le genre humain se donne de la peine sans profit et toujours consume ses jours en vains soucis. Faut-il s'en étonner ? il ne connaît pas la borne légitime du désir, il ne sait les limites où s'arrête le véritable plaisir. Voilà ce qui peu à peu a jeté la vie humaine en pleine mer et déchaîné les pires orages de la guerre. » (Lucrère, De Natura, Livre V) Le sage doit donc juger ce qui peut lui apporter la santé du corps et la tranquillité de l’âme (ataraxie)… Au fond cette sagesse n’est que trop évidente. Qui voudrait la contester ? Mais d’un autre côté, qui voudrait s’en satisfaire ? Si le sage épicurien rencontre le bonheur et donc la sagesse, qu’a-t-il d’autre à désirer ? L’homme ne cherche-t-il pas, constitutivement, à dépasser sa condition, à se transcender ? Antithèse : désir et vertu (stoïcisme) La thèse stoïcienne (une autre grande Ecole philosophique grecque), c’est que le bonheur s'obtient en pratiquant la vertu et non en réalisant tous ses désirs, fussent-ils naturels. Les stoïciens, comme les chrétiens plus tard, n’ont pas une vision égalitaire de la vie du corps et de la vie de l’esprit : l’esprit est supérieur, l'esprit gouverne, à lui revient la dignité… C’est pourquoi il convient de se méfier des désirs ne visant que les plaisirs physiques et immédiats. Qu’est-ce que la vertu ? Pour le stoïcien, c’est avant tout la maîtrise de soi, l’autonomie de la volonté, la capacité de résister à nos désirs justement, et le fait de n’accorder d’importance qu’à ce qui dépend de soi. Certes nos désirs dépendent de nous, comme nos pensées, mais ils ont une cause extérieure puisqu’ils « tendent » (par définition) vers un objet manquant : on désire toujours ce que l’on n’a pas. Il ne faut donc pas se laisser troubler par eux. A la limite, plutôt que de chercher à distinguer les bons et les mauvais désirs, comme les épicuriens, il vaut mieux les rejeter en bloc si l’on ne peut les maîtriser… Mieux vaut ne pas se laisser envahir. En théorie, le désir n’est pas condamnable en lui-même… mais il faut lui préférer cette sorte de « désir de l’intellect » qu’est la volonté, guidée par une raison plus sûre. Cette thèse selon laquelle nous pouvons et devons contrôler, voire réduire, nos désirs (le fameux "tu peux si tu veux"), se retrouvera chez Descartes. « Mieux vaut changer ses désirs plutôt que l’ordre du monde » écrit celui-ci. Comme il est plus aisé de se connaître soi-même que de connaître le monde, selon Descartes, il est plus facile et plus raisonnable de régler ses désirs en fonction du possible, plutôt que de prétendre changer à soi seul le monde, et surtout les lois de ce monde. Autrement dit mieux vaut ne pas désirer l'impossible, car Descartes a bien vu que justement nous tendons à désirer l'impossible, et nous nous égarons ! Mais ce point de vue en tous points raisonnable, la « maîtrise de soi », le « contrôle de la volonté » suffisent-ils pour définir la sagesse ? L’homme est mu par un désir spécifique, en rapport avec sa nature d’être raisonnable : c’est le désir de savoir. D’ailleurs, ce désir apparaît comme étant encore naturel… Le désir de savoir (Aristote) “Tous les hommes désirent naturellement savoir” écrit Aristote. Ceci est conforme à notre nature d’êtres essentiellement raisonnables. Aristote distingue trois grands types de vie : productive, active et contemplative, et donc corollairement trois grands types de biens convoitables : les biens matériels, les honneurs, et la sagesse. Tous trois sont naturels, mais hiérarchisés. Les biens matériels et les plaisirs immédiats ne sont nullement condamnables, car ils font partie de l’existence humaine ; Aristote ne partage pas le rigorisme intransigeant des stoïciens, leur mépris du plaisir. Cependant la vie intellectuelle doit être privilégiée, puisqu’elle correspond à l’essence de l’homme (la raison). C’est la raison qui fixe les normes du désir, qui oriente le désir vers le savoir et non vers les choses futiles. Le savoir est désirable car il est le bien le plus durable ; inversement il n’est pas raisonnable de vouer sa vie au plaisir charnel parce que cela ne dure pas. Quant à la gloire, que recherche le soldat ou l’homme politique, elle apparaît elle-même bien superficielle. Résumons : pour Aristote, le désir est cette activité-tendance naturelle qui permet à l’homme d’atteindre son but également « naturel » (essentiel) : la connaissance. La raison nous présente les biens les plus durables (intellectuels, spirituels) comme étant les plus désirables. Lorsque nous jugeons qu’une chose est bonne pour nous, logiquement nous la désirons. Au fond, le point de vue ici (mais cela vaut pour l’ensemble des théorie eudémonistes) repose sur l’idée que le désir humain peut être naturellement assouvi, voire comblé, à partir du moment où l’on ne se trompe pas d’objet (le savoir, plutôt que les plaisirs fugitifs ou les biens matériels). Il s’agirait de ne pas vivre dans l’insatisfaction. Mais est-ce bien si évident ? Platon et l'image du tonneau percé Platon, qui n'était pas spécialement eudémoniste, avait lui aussi dénoncé le caractère superficiel des plaisirs immédiats, en opposant deux styles de vie : la « vie ordonnée » (par la raison et le savoir) et « la vie déréglée » (par la recherche frénétique des plaisirs et des biens matériels). C’est ce qui ressort de la célèbre image du tonneau percé » : « Socrate — Bien. Allons donc, je vais te proposer une autre image […]. En effet, regarde bien si ce que tu veux dire, quand tu parles de ces deux genres de vie, une vie d’ordre et une vie de dérèglement, ne ressemble pas à la situation suivante. Suppose qu’il y ait deux hommes qui possèdent, chacun, un grand nombre de tonneaux. Les tonneaux de l’un sont sains, remplis de vin, de miel, de lait, et cet homme a encore bien d’autres tonneaux, remplis de toutes sortes de choses. Chaque tonneau est donc plein de ces denrées liquides qui sont rares, difficiles à recueillir et qu’on n’obtient qu’au terme de maints travaux pénibles. Mais, au moins, une fois que cet homme a rempli ses tonneaux, il n’a plus à y reverser quoi que ce soit ni à s’occuper d’eux ; au contraire, quand il pense à ses tonneaux, il est tranquille. L’autre homme, quant à lui, serait aussi capable de se procurer ce genre de denrées, même si elles sont difficiles à recueillir, mais comme ses récipients sont percés et fêlés, il serait forcé de les remplir sans cesse, jour et nuit, en s’infligeant les plus pénibles peines. Alors, regarde bien, si ces deux hommes représentent chacun une manière de vivre, de laquelle des deux dis-tu qu’elle est la plus heureuse ? Est-ce la vie de l’homme déréglé ou celle de l’homme tempérant ? En te racontant cela, est-ce que je te convaincs d’admettre que la vie tempérante vaut mieux que la vie déréglée ? Est-ce que je ne te convaincs pas ? » (Platon, Gorgias, 493d-494a) On voit bien que l’un des hommes vit heureux à partir du moment où, son tonneau étant rempli, il évite de gaspiller son contenu : il n’a donc plus rien à désirer. Tandis que le second désire constamment remplir ses tonneaux puisqu’ils sont percés (image de l’intempérance et de la vie déréglée) : il vit dans l’insatisfaction permanente. Que vaut-il mieux : avoir comblé ses désirs une fois pour toute et ne plus rien désirer (quel ennui !), ou bien dépenser tout ce que l’on gagne (quelle folie !) et toujours désirer ? Nos deux personnages ne sont-ils pas victimes d’une même illusion, à savoir le fait qu’il serait possible de combler ses désirs ? Et cela parce que l’objet du désir serait assimilé à un « avoir », à une possession ? C'est justement ce que conteste Platon qui a une vision beaucoup moins naturaliste du bonheur et du désir ; pour lui le désir vise "autre chose", qui est beaucoup plus de l'ordre de l'amour ou même de la création (il le développe notamment dans son dialogue Le Banquet - nous en parlons ailleurs). Critique de l'eudémonisme Plus généralement, une critique de l'eudémonisme s'impose. Est-ce bien raisonnable de penser que le désir peut être aussi facilement comblé, fût-ce par le savoir ? Ou bien de prétendre qu’il pourrait être aussi aisément contrôlé, guidé par la raison et la volonté ? Comme si la raison seule définissait ce qui a de la valeur, et donc ce qui est désirable, pour l’homme ? N’est-ce pas sous-estimer le désir comme tendance et activité profonde – intrinsèquement insatiable – de l’homme, non seulement en tant qu’être vivant mais aussi en tant qu’être social ? On ne peut pas se contenter d'analyser le désir comme un mouvement naturel destiné à combler un manque lui-même naturel (et cela culmine dans le « désir de savoir »), donc comme un désir d’avoir. Le désir ne serait-il pas plutôt un désir d’être, enveloppant l’ensemble de l’être, dont l’objet serait de ce fait bien moins défini et la possession beaucoup plus problématique ? Déjà il est clair que le désir concerne l’ensemble de la personne, le « sujet » lui-même. Le désir est profondément subjectif. Au-delà, dans le monde social, qui est celui de « l’intersubjectivité », le désir d’avoir n’est-il pas enveloppé par le désir d’être reconnu ? dm

|
Scooped by
dm
January 5, 8:54 AM
|
Dans Les origines de l'amour et de la haine (1935), le psychiatre Suttie relevait un véritable et indubitable « tabou de la tendresse ». Chacun peut voir en effet qu'on n'accepte les manifestations de la tendresse qu'entre parents et enfants ou bien entre amoureux. En tout autre occasion, le geste tendre paraît plus inconcevable et déplacé que bien des manifestations grivoises ou obscènes. Pourquoi prendre la main, effleurer la joue de l'autre sont-ils des actes si difficiles et quasiment impossibles à assumer spontanément ? Mis à part certains contacts autorisés et coutumiers (comme la poignée de mains ou la tape « amicale », sans oublier l’inévitable « bise » - double, triple, quadruple…), et malgré l’essor d’un nouveau souci de soi corporel - inséparable du souci de l'autre, en tant que "vulnérable" -, l’on ne se touche guère dans nos sociétés occidentales. Faut-il s’en plaindre, au regard des risques indéniables de sexualisation, voire de brutalisation inhérents aux échanges corporels entre animaux-humains ? Ne faut-il pas, sinon condamner, du moins limiter les effusions tendres au nom de la "pudeur" ? On le voit, le sujet est délicat... Dans ce contexte, oser la tendresse physique s’avère être une gageure non seulement entre personnes étrangères mais également entre amis. Généralement, les douceurs du regard et les accents tendres de la parole suffisent ; il n'empêche que, même sous ces formes relevées et déjà spiritualisées, la tendresse paraît difficilement soutenable au long cours. Elle est davantage l'exception que la règle. Y aurait-il donc un tabou de la tendresse plus coriace, plus originel encore que celui de la sexualité ? Freud considérait la tendresse comme un élément de la vie sexuelle en général, l'un des deux courants — le plus stable et le plus durable — de la « psychosexualité », à côté du courant proprement sexuel ou génital. Le comportement amoureux normal ou idéal réunit justement les deux aspects, à l'adolescence lors du choix d'objet amoureux, ou plus tard dans le mariage qui consolide ce lien et ce choix dans le temps (Freud insiste sur le fait, non négligeable, que cette fusion parfaite des deux courants est rarissime : ce couple, donc le couple en général, fonctionne mal). Concernant la genèse du courant tendre, les textes freudiens sont loin d'être univoques même si une explication générale s'en dégage : la tendresse serait l'expression d'un désir désexualisé, dévié de ses buts sexuels, notamment après le refoulement situé lors de la période de latence. Il reste que si ce mouvement est bien un résidu des motions sexuelles primitives, toujours lisibles et sous-jacentes à l'affection, inversement le courant le plus ancien de l'histoire individuelle, comme le reconnaît Freud lui-même, n'en est pas moins la tendresse : les attouchements de la mère sur l'enfant lors des premiers soins, l'inscription de la « lettre » (Leclaire) du désir et de la jouissance sur le corps du sujet, les « mamours » et les câlins, etc.. Allons plus loin, risquons une hypothèse somme toute assez peu freudienne : si la tendresse n'est pas seulement une conséquence du refoulement, et pour finir une forme de ces pulsions sociales comme l'affection ou l'amitié ; si elle existe également dès les premiers rapports, s'affichant jusque dans la pulsion et le narcissisme ; pourquoi ne pas admettre l'existence d'une tendresse "primordiale", comme une “passibilité” ou une “tactilité” originelle dont même le narcissisme primaire serait issu ? On comprendrait mieux, dès lors, l'enjeu psychique et surtout social du tabou dont elle continue de faire l'objet. Ce n'est pas la sexualité que refoule la tendresse en la déviant et en l'édulcorant, c'est cette tendresse primordiale que la sexualité tente de refouler aussi bien par l'interdit que par l'injonction perverse de jouir. Mais c'est aussi cette tendresse - assez peu "sentimentale" - que la vie sexuelle - par bonheur - permet de retrouver en de rares occasions. dm

|
Scooped by
dm
January 3, 11:21 AM
|
Sagesse philosophique et Vie chrétienne (Exemple d’une structure philosophico-religieuse)
Comment le christianisme a-t-il pu assimiler, sans doute sporadiquement mais régulièrement, la Vie chrétienne avec l'idéal de Sagesse prôné par les philosophes grecs, en reprenant à son compte l'opposition typiquement philosophique de la théorie et de la pratique ? Opposition bien mal assurée, néanmoins, car si certains religieux ont vu dans le Christ l'incarnation même de la Philosophie dans sa vocation premièrement éthique, sinon pratique, à l'inverse celle-ci était cantonnée par d'intransigeants théologiens au rôle d'une simple propédeutique, une théorie ne pouvant que participer de loin à la vraie Sagesse religieuse. Un peu d’histoire… La philosophie pratique des Pères de l’Eglise Les Pères de l’Eglise avaient fortement contribué à l’émiettement de la conception antique de la philosophie. Le message du Nouveau Testament n’avait que peu de connivences avec celle-ci dans la mesure où le monde terrestre (auquel se consacre la philosophie, théoriquement et pratiquement) n’est que l’anti-chambre du royaume céleste. Saint Paul oppose fortement la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu, qui culmine dans le mystère (c’est l’atopia religieuse) de la croix. Mais depuis la seconde moitié du deuxième siècle après J.-C., les penseurs chrétiens tentent de comprendre et de récupérer certains aspects de la philosophie, et finissent même par qualifier le christianisme de « philosophie », en adoptant une tripartition déjà largement éprouvée. Sont considérés comme « exploitables » philosophiquement : 1° les vérités révélées par Dieu sur sa propre personne divine, sur l’homme et sur le monde, 2° les préceptes moraux qui en découlent, et 3° la réalisation de ces vérités et de ces préceptes dans la vie des saints, bibliques ou post-bibliques. Ce dernier aspect s’avère le plus important. Car si les Pères admettaient que les philosophes païens avaient découvert certaines vérités partielles, conformes à la Révélation, et avaient en outre formulé des règles de vie proches des exhortations de l’Evangile, ils doutaient fortement de la capacité du Philosophe d’incarner cette sagesse. La philosophie religieuse des Pères de l’Eglise ne faisait qu’exacerber le culte de la pratique et de l’exemplarité, déjà vivace chez les philosophes grecs. Basile de Césarée précise ainsi sa Manière de tirer profit des lettres helléniques (Les Belles lettres, 2012, p. 52) : « Car celui qui, à la philosophie qui s’arrête aux mots chez les autres, donne l’appui des actes, seul est sensé, les autres ne sont que des ombres voltigeantes » et ce disant, ne fait que reprendre à son compte la recommandation d’Epictète (Manuel) : « ne montre pas aux gens les principes de la philosophie, mais digère-les et montre les œuvres qu’ils produisent ». Mais une grande différence subsiste, car chez le chrétien l’homme livré à lui-même, confié à ses propres forces, se montre incapable d’appliquer correctement ses connaissances et ses principes moraux. Le rôle du divin se concentre en ce point essentiel du passage à la pratique, passage au réel… Paradoxalement le christianisme se pose comme la vraie philosophie et la vie du Christ devient l’unique modèle de toute sagesse. La philosophie du côté des arts libéraux. Début du Moyen-âge Les arts libéraux étaient reconnus par les philosophes antiques comme une propédeutique possible à l’exercice de la philosophie. Or les penseurs chrétiens n’ont pas tardé d’assigner le même rôle à la philosophie. Origène propose ainsi d’utiliser les branches de la philosophie grecque pour servir de base à une authentique formation religieuse. Le Moyen-Age chrétien va réduire la philosophie à une science à la fois théorique et propédeutique. Toutefois, en tant que propédeutique, la dimension morale de la philosophie n’est pas ignorée. Dans son De consolatione philosophia, Boèce renoue avec la conception grecque d’une philosophie « thérapeutique » et d’une approche typiquement philosophique de la mort. Cette démarche s’appuie sur la dualité de la philosophie et des arts libéraux, et sur la mise à l’écart de ces derniers. Alcuin, au VIIIè siècle, s’intéresse également beaucoup à la valeur morale de la philosophie, mais en se faisant l’artisan d’une identification de la philosophie avec les arts libéraux, tandis que la vraie consolation est attendue plutôt de la sagesse biblique. La philosophie est donc comparée aux « sept colonnes » des arts libéraux, qui constituent les « degrés » de l’apprentissage théorique : ce sont la grammaire, la rhétorique, la dialectique, l’arithmétique, la géométrie, la musique et l’astrologie. La philosophie est une connaissance utile, moralement profitable, mais la véritable sagesse n’appartient qu’à la « perfection évangélique » dans le cadre de la vie monastique, hors de portée du philosophe (on se rappelle pourtant que les premiers Pères de l’Eglise nommaient « philosophie » cette sagesse de reclus). Les représentants de l’école de Chartres au 12è siècle ajoutèrent la physique aux sept arts libéraux, complétés par l’éthique grâce à Abélard. En outre ce dernier fait de la dialectique une discipline pilote, identique à la philosophie, séparant donc à nouveau la philosophie des arts libéraux. Mais cela ne change pas grand-chose à la grande dualité subsistant entre d’une part les disciplines théoriques, essentiellement philosophiques, et d’autre part la pratique chrétienne comme seule sagesse authentique. C’est ainsi que dans les milieux monastiques cisterciens des XIè et XIIè siècles, et malgré la doctrine scolastique qui s'annonce, survit la conception patristique d'une philosophie « pratique » comme art de vivre. S'opposent alors deux philosophies également pratiques : la philosophie « mondaine » qui correspond à la manière laïque de vivre (comme celle des philosophes...), et la philosophie « céleste » ou spirituelle qui correspond à celle des moines réglés. Le Christ devient ainsi l'emblème de la « vie philosophique », non pas tant le « philosophe » que la Philosophie elle-même réalisée. La philosophie théorique des scolastiques Au 13è siècle, l'assimilation de la philosophie avec l'étude du corpus aristotélicien ne l'empêche pas d'être encore très liée, du moins institutionnellement, avec l'enseignement des arts libéraux. Elle en conserve l'aspect purement théorique et tend même à devenir une « science » essentiellement impersonnelle. Cette tendance s'affirme d'abord par la soumission à une autorité ancienne, que constituent les œuvres du Philosophe (Aristote), et ensuite par une interpénétration évidente entre les problèmes théologiques chrétiens et les questions traditionnelles de métaphysique. Mais les auteurs scolastiques séparent radicalement les problèmes que la raison se pose à propos des textes d'Aristote et les préceptes de sagesse prodigués par la foi selon les textes saints. Saint Thomas d'Aquin distingue donc deux sagesses, celle de la philosophie et celle de la religion. La sagesse reste bien la finalité ultime de la philosophie comprise comme connaissance des premiers principes, selon la définition d'Aristote, et elle se réalise proprement dans cette contemplation bienheureuse. Si cette contemplation se suffit à elle-même (au point d'être l'unique fin de la philosophie), elle n'est en rien une contemplation du divin (visio beatifica). « La sagesse est la connaissance des choses divines, mais nous la voyons autrement que les philosophes » écrit saint Thomas, qui avec l'ensemble de la communauté religieuse n'entend pas confondre « vie de philosophe » et « vie chrétienne ». Héritant d'une conception scolastique et théoricienne de la philosophie, Gilles de Rome (fin du 13è siècle) radicalise celle-ci comme « théorie de l'être ». Seule la spéculation pure atteint la vérité des êtres réels, ceux qui ont leur cause dans l'intellect divin. Il ne faut pas les confondre avec les êtres « intentionnels » dont la cause se situe dans l'intellect humain, ne servant précisément qu'à diriger et qualifier les conduites humaines. Gilles distingue plus précisément quatre degrés d'êtres : ceux qui sont la raison de notre savoir, les êtres intentionnels, les agibilia, et enfin les factibilia ; leur correspondent quatre arts principaux : les arts spéculatifs réels, les arts rationnels, les arts moraux, et les arts mécaniques. Seuls les arts spéculatifs visent la vérité en tant que but car ils portent sur les objets strictement autonomes de l'intellect. Par exemple, les facultés morales ne peuvent pas constituer une partie authentique de la philosophie, parce qu'elles visent une œuvre ou une action et non un savoir. En revanche les choses « réelles » peuvent être de nature aussi bien physique, mathématique, que théologique (au sens de la théologie naturelle d'Aristote). La Renaissance et le retour en grâce de l’”atopia” socratique Aux 14è et 15è siècles, les tendances non-scolastiques se renforcent sans parvenir totalement à réhabiliter la philosophie dans sa signification antique de sagesse globale, d'éthique réalisée. La valeur morale de la philosophie est reconnue sur la base d'une distinction stricte entre l'Esprit divin et la nature humaine, entre la création de Dieu et les actions des hommes. Mais il manque cet élément essentiel qui caractérise la personnalité et la vie du Philosophe, son atopia. Lorsqu'un Jean Gerson (Collectorium super Magnificat), se plaçant sur le terrain de l'éducation et de la didactique, compare la simplicité vertueuse d'un Socrate (adaptant toujours son discours aux capacités intellectuelles de son auditoire) et l'abnégation du Christ accueillant à Lui les enfants, on constate que l'Amour et la Grâce font irréductiblement défaut au philosophe, précisément parce que ces qualités plus-que-vertueuses ne dépendent pas de son seul esprit. De son côté Pétrarque se montre extrêmement féroce en attaquant l'éthique rationnelle d'Aristote et en lui opposant l'ignorance socratique. Selon lui, la définition aristotélicienne de la vertu ne nous rend pas meilleur, tandis que la description « scientifique » du vice engendre à la longue un penchant pour celui-ci. Partant du principe qu'« il est plus important de vouloir le bien que de connaître la vérité », il se tourne plutôt vers Sénèque ou même Cicéron pour l'exemplarité de leur conduite. De même l'auteur (présumé : Thomas a Kempis) du fameux De imitatio Christi fait l'éloge de l'ignorance assimilée à la vraie vertu, par opposition à l'érudition et à la science scolastique. Cependant, il ne s'éloigne pas beaucoup de la conclusion scolastique selon laquelle, justement, la simplicité de la vie chrétienne dépasse les préceptes philosophiques païens, que la science théologique intègre en revanche à ses spéculations morales. L'assimilation de l'éthique de vie chrétienne avec la sagesse philosophique, au sens antique, s'affirme chez les savants des 14è et 15è siècles qui, à l'image des doxographes comme Laërce, se sont penchés sur la personnalité des philosophes anciens et ont révélé leur « atopia », même si le mot n'est pas formellement cité. L'usage des exempla philosophorum se généralise dans l'humanisme chrétien d'un Anbrogio Traversari (traducteur de Laërce), d'un Léonard Bruni qui a su voir l'importance des Lettres de Platon pour la connaissance du personnage de Platon, ou d'un Marcile Ficin, autre figure incontournable de cet humanisme. Parfois est louée la vie solitaire des philosophes, parfois c'est leur engagement civique, ou d'autres fois encore c'est l'attitude du philosophe face à la mort qui sont interprétés comme des preuves de leur sagesse. Et toujours leur style expressif et persuasif rencontre la préférence sur la neutralité « suspecte » des doctes. Deux motifs sont maintenant assimilés : il s'agit des aspects moraux de la vie des philosophes et l'identification de leur vie à la Vie chrétienne. Cette tendance culmine et s'homogénise chez le grand humaniste et théologien du 16è siècle, Erasme de Rotterdam. Celui-ci attribue la même qualité « silénique » et « atopique » aux figure de Socrate, Diogène le Cynique, Epictète d'une part, et à celles des apôtres et du Christ d'autre part. L'assimilation de la sagesse philosophique avec la sagesse chrétienne était alors accomplie. Permanence de la structure philosophico-religieuse La controverse ne s'achève pas à la Renaissance, comme on s'en doute, bien que la référence croisée à l'imitatio Chriti et aux exempla philosophorum s'estompera dans les siècles ultérieurs. D'autres modes d'identification de la vie chrétienne et de la vertu, de la religion et de la philosophie verront le jour, tantôt plus mystiques et tantôt plus rationnels, davantage spéculatifs dans tous les cas. Il est douteux que la religion puisse se passer de toute morale philosophique, ne serait-ce que pour en signaler l'insuffisance ; mais comment pourrait-elle cacher sa propre indigence sans emprunter le discours rationnel des philosophes ? Comment dès lors ne pas partager avec eux la visée éthique essentielle qui justifie et résout l'opposition théorie-pratique ? Nous ne pouvons nous départir de l’idée que la vie religieuse court après la vie philosophique comme son Autre et réciproquement, mais partageant finalement un “même” point de vue unitaire. Nous serions fondés à identifier une structure philosophico-religieuse universelle, dont le couple historique sagesse philosophique / vie chrétienne, ici présenté, ne serait finalement qu’un exemple. Peut-être qu’éthique philosophique et éthique religieuse ne sont l'une pour l’autre que les symptômes d'une absence fondamentale d'éthique, c’est-à-dire de confiance radicale en l'homme, dont l’atopie essentielle serait systématiquement niée au profit d'une pseudo-atopie plus ou moins sociale (religieuse) ou individuelle (philosophique) ? Nous rejoindrions alors le point de vue d’un François Laruelle, au nom d’un tout autre “humanisme” il est vrai, non-philosophique autant que non-religieux, disons même hérétique. dm

|
Scooped by
dm
January 1, 10:54 AM
|
L'Inconscient selon Freud et l'invention de la psychanalyse
I / La découverte freudienne de l'Inconscient a. Trois humiliations historiques Pour Freud (Vienne 1856- Londres 1939), la conscience humaine a subi dans son histoire trois "humiliations" considérables, trois leçons de modestie qu'elle s'est en quelque sorte adressée à elle-même. Par trois fois elle a dû relativiser son importance cruciale, sa prétention à gouverner et à résumer l'humain. Le savoir humain a été trois fois décentré : la première fois quand Copernic montra que la Terre n’est pas le centre de l’univers (donc l'homme non plus), la seconde fois quand Darwin signala que l’homme ne possède pas une place privilégiée, en tout cas à part dans l’ordre biologique (théorie de l'évolution), la troisième fois (Freud lui-même) avec le décentrement opéré par l'Inconscient, résumé par ces deux formules : “le moi n’est pas maître dans sa propre maison”, et "l'inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité.” b. Une démarche clinicienne et scientifique Freud médecin, une méthode clinique. - Comme Nietzsche ou Marx, Freud n'est pas philosophe de formation, mais médecin neurologue. C'est dire que sa démarche n'est pas purement théorique ou spéculative, mais d'emblée pratique et clinique. Par-là, il ne s'intéresse pas à un être humain théorique, dans sa perfection essentielle, il l'étudie au contraire par le biais de ses manques, en tant que malade ou défaillant. Contrairement à toute une tradition qui méprise l'enfance, il étudie l'humain par le biais de l'enfance, en pariant sur l'impact déterminant de la petite enfance sur la vie adulte. Une démarche scientifique. - En outre, la démarche de Freud se veut résolument scientifique, même si le caractère scientifique de ses recherches a été régulièrement contesté. Mais de son point de vue tout au moins, la théorie de l'Inconscient satisfait à la méthode expérimentale au sens où Freud est amené à proposer un certain nombre d'hypothèses explicatives et à les vérifier au moyen d'une méthode thérapeutique expérimentale, inédite. c. Une hypothèse : l'Inconscient "On nous conteste de tous côtés le droit d'admettre un psychique inconscient et de travailler scientifiquement avec cette hypothèse. Nous pouvons répondre à cela que l'hypothèse de l'inconscient est nécessaire et légitime, et que nous possédons de multiples preuves de l'existence de l'inconscient. Elle est nécessaire, parce que les données de la conscience sont extrêmement lacunaires; aussi bien chez l'homme sain que chez le malade, il se produit fréquemment des actes psychiques qui, pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas du témoignage de la conscience. Ces actes ne sont pas seulement les actes manqués et les rêves, chez l'homme sain, et tout ce qu'on appelle symptômes psychiques et phénomènes compulsionnels chez le malade ; notre expérience quotidienne la plus personnelle nous met en présence d'idées qui nous viennent sans que nous en connaissions l'origine, et de résultats de pensée dont l'élaboration nous est demeurée cachée. Tous ces actes conscients demeurent incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons à prétendre qu'il faut bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait d'actes psychiques ; mais ils s'ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la cohérence, si nous interpolons les actes inconscients inférés." (Freud, Métapsychologie) Cette hypothèse, d'abord, n'est autre que l'Inconscient lui-même : il s'agit pour le médecin Freud de rendre compte de certains phénomènes psychiques n'ayant pas encore reçus d'explications, ni par la conscience spontanée, ni par la morale traditionnelle (qui juge et condamne mais n’explique rien), ni par les médecins, en particulier les troubles dits "névrotiques". Freud fut amené à étudier cette maladie lors d'un séjour à Paris alors qu'il était l'élève du célèbre médecin aliéniste Jean-Martin Charcot. Celui-ci avait déjà compris le caractère symbolique, significatif, et profondément subjectif de ces troubles, comme s'ils exprimaient la personnalité profonde du patient. Freud émis donc l'hypothèse d'une région occulte du psychisme, apte néanmoins à se manifester de diverses manières (les symptômes névrotiques donc, mais aussi les rêves, les lapsus et les actes manqués, etc.). d. Une expérience : la psychanalyse "Et s'il s'avère de plus que nous pouvons fonder sur l'hypothèse de l'inconscient une pratique couronnée de succès, par laquelle nous influençons, conformément à un but donné, le cours des processus conscients, nous aurons acquis, avec ce succès, une preuve incontestable de l'existence de ce dont nous avons fait l'hypothèse." (Freud, op. cit.) Parallèlement, Freud élabora la méthode psychanalytique, en guise de traitement et surtout comme lieu de mise à l'épreuve de la théorie, autrement dit comme expérience. La méthode psychanalytique n'est rien d'autre que la vérification expérimentale de l'existence de l'inconscient. Mais l'expérience psychanalytique innove de manière considérable puisque, pour une fois, l'expérience n'est pas basée sur l'observation (visuelle, cf. Charcot), mais sur l'écoute du patient, sur la prise en compte de sa parole. Le patient sujet, pour Freud, ne peut accéder à son inconscient que via la parole et en présence de ce tiers qu'est le médecin : celui-ci l'engage (au moins dans un premier temps) à dire "tout ce qui lui passe par la tête", seule chance pour que la couche inconsciente parvienne à faire son apparition, mais toujours dans et par le langage. e. Un « scandale » : la libido Cependant Freud n'a pas inventé le mot "inconscient" et l’on a vu que certains philosophes avant Freud avaient émis des théories dans ce sens. Sa théorie ne serait rien sans une deuxième hypothèse qui donne tout son sens et son poids à la première : le concept de libido, soit une "énergie" définie par Freud "comme la manifestation dynamique dans la vie psychique de la pulsion sexuelle." Freud cette fois se place sur le terrain du désir et des pulsions, non plus sur celui de la conscience : la libido est pour Freud une énergie psychique irrigant les canaux inconscients, investissant les représentations inconscientes. C'est pourquoi non seulement Freud a inventé une nouvelle théorie/pratique, mais il a choqué ses contemporains en insistant sur le rôle primordial de la sexualité, y compris au stade infantile, dans la formation de la personnalité psychique. II / Description du psychisme selon Freud Les différentes "topiques" : il s'agit, au cours de l’évolution de la théorie freudienne, de représentations en quelque sorte spatiales (topos, lieu) du psychisme, dont la valeur est purement métaphorique, non neurologique. Freud, médecin, nourrissait l’espoir que la neurologie pourrait rapidement éclaircir les mystères du psychisme. Mais l’évolution de cette science étant insuffisante à son époque, il a dû se replier sur ce qu’il appelle lui-même une « métapsychologie », en somme une nouvelle discipline à côté de la psychologie classique. On distingue deux topiques, qui divisent chacune la personnalité psychique en trois "lieux" ou trois "instances" : conscience, préconscient, inconscient pour la première ; et ça, moi, surmoi pour la seconde. Les deux topiques ne se contredisent pas, elles correspondent à deux états successifs de la théorie de Freud. En réalité il faut distinguer plutôt trois étapes. La première correspond à l'élaboration du concept d'"appareil psychique". a. L'"appareil psychique" : perception-conscience (pc-cs) et préconscient-inconscient (pcs-ics) Le concept de "psychisme". - Il s’agit de la première phase de la psychologie théorique (dite “métapsychologie”) de Freud, complétée puis dépassée, mais jetant quand même des bases et définissant les premiers concepts. Le mot "appareil" rompt déjà de façon spectaculaire avec toute espèce de psychologie réflexive ou purement rationnelle. Freud opère en "physicien" voire en "mécanicien" du psychisme ! Tout d’abord, rappelons que Freud affirme l’existence du psychisme en tant que tel, non réductible à la conscience ; voire même assimile inconscient (ics) et psychisme : “L’inconscient est le psychique lui-même et son essentielle réalité.” Deux "systèmes" opposés. - Une fois que l’on a distingué psychisme et conscience, disposons les différents éléments de l’appareil. On trouve une opposition entre deux systèmes : le système Perception-Conscience (pc-cs) et le système Préconscient-Inconscient (ics-pcs). Le premier se situe à la périphérie de l’appareil psychique, recevant à la fois les informations du monde extérieur et celles provenant de l’intérieur. Le système Pc-Cs perçoit des qualités : "Ce serait comme si l’Ics, par le moyen du système Pc-Cs, étendait vers le monde extérieur des antennes, qui sont rapidement retirées après en avoir comme dégusté les excitations" ; à son tour, le système Ics-Pcs inscrit celles-ci comme des souvenirs ou des traces mnésiques durables et quantitativement modulables. b. La première topique : Inconscient (ics) et préconscient-conscient (pcs-cs) Cette “1ère topique” (c’est-à-dire la première théorie achevée de Freud) complète et modifie légèrement la conception initiale de l’appareil psychique. Elle consiste essentiellement à distinguer deux systèmes: l’inconscient d’un côté, l’ensemble préconscient/conscient de l’autre (ics/pcs-cs). Entre les deux, sévit un gardien, une « censure » qui filtre les représentations « autorisées » à devenir conscientes. La question est de savoir pourquoi ! "La représentation la plus simple de ce système est pour nous la plus commode: c’est la représentation spatiale. Nous assimilons donc le système de l’inconscient à une grande antichambre, dans laquelle les tendances psychiques se pressent, telles des êtres vivants. A cette antichambre est attenante une autre pièce, plus étroite, une sorte de salon, dans lequel séjourne la conscience. Mais à l’entrée de l’antichambre, dans le salon veille un gardien qui inspecte chaque tendance psychique, lui impose la censure et l’empêche d’entrer au salon si elle lui déplaît. Que le gardien renvoie une tendance donnée dès le seuil ou qu’il lui fasse repasser le seuil après qu’elle ait pénétré dans le salon, la différence n’est pas bien grande et le résultat est à peu près le même. Tout dépend du degré de sa vigilance et de sa perspicacité. Cette image a pour nous cet avantage qu’elle nous permet de développer notre nomenclature. Les tendances qui se trouvent dans l’antichambre réservée à l’inconscient échappent au regard du conscient qui séjourne dans la pièce voisine. Elles sont donc tout d’abord inconscientes. Lorsque, après avoir pénétré jusqu’au seuil, elles sont renvoyées par le gardien, c’est qu’elles sont incapables de devenir conscientes : nous disons alors qu’elles sont refoulées. Mais les tendances auxquelles le gardien a permis de franchir le seuil ne sont pas devenues pour cela nécessairement conscientes ; elles peuvent le devenir si elles réussissent à attirer sur elles le regard de la conscience. Nous appellerons donc cette deuxième pièce : système de la pré-conscience. " (Freud, Introduction à la Psychanalyse) - L’inconscient - Il est comparé à une antichambre où s’amasseraient des représentations refoulées par le système Pcs-Cs, celui-ci étant comparé à un salon protégé par un gardien, la “censure”. En tant qu’il est habité par les pulsions et la libido, l’inconscient n’obéit qu’à un seul principe : le principe de plaisir. En d’autres termes, rechercher la satisfaction la plus directe en retrouvant la trace des excitations ayant déjà engendré du plaisir. L'ics obéit à une logique différente de celle du pcs et du cs : les pensées s'y enchaînent de façon illogique, sur un mode plutôt poétique ou métaphorique, par pure association. Freud nomme cela « processus primaire » de la pensée. (D'où la nécessité de les retrouver par la "libre association", méthode que Freud préconise pour ses patients.) - La conscience - Associée à la perception, la conscience se situe à la périphérie de l’appareil psychique, recevant à la fois les informations du monde extérieur et celles provenant de l’intérieur. Elle est globalement affectée aux "relations extérieures" et à la communication (Freud reprend à cet égard les idées de Nietzsche). Contrairement à l’inconscient régi par le principe de plaisir, la conscience obéit au « principe de réalité ». Son exigence principale est la stabilité et la sociabilité. C'est pourquoi la conscience refuse certaines représentations. - Le préconscient - Le "préconscient" paraît assez proche du “subconscient” de Bergson. Il désigne selon Freud “les faits psychiques latents, mais susceptibles de devenir conscients”, c’est-à-dire oubliés momentanément mais non refoulés, non interdits. Freud : “le pcs joue le rôle d’un écran entre l’Inconscient et la conscience.” Dans le préconscient règne le « processus secondaire » de la pensée. Alors que pour Freud, les représentations Ics se limitent à des représentations de choses (images), dans le Pcs et la Cs se trouvent des représentations de choses associées aux représentations de mots correspondantes (langage). Le pcs exerce aussi une fonction de censure (le "gardien") pour déterminer les pensées susceptibles de devenir conscientes, et refouler les autres. Cependant, certaines pensées inconscientes passent par "ruse" dans le pcs, et arrivent même jusqu'à la conscience, notamment à travers le rêve, car le propre du rêve est le travestissement des pensées inconscientes. - Le refoulement, lien dynamique entre les systèmes cs-pcs et ics - “Un désir violent a été ressenti qui s‘est trouvé en complète opposition avec les autres désirs de l’individu, inconciliable avec les aspirations morales et esthétiques de sa personnalité. Un bref conflit s’en est suivi ; à l’issue de ce combat intérieur, le désir inconciliable est devenu l’objet du refoulement, il a été chassé hors de la conscience et oublié. J’ai appelé refoulement ce processus supposé par moi, et je l’ai considéré comme prouvé par l’existence indéniable de la résistance [pendant la cure psychanalytique, l’ics résiste, « refuse » de se livrer]." (Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse) Laplanche et Pontalis (Vocabulaire de Psychanalyse) : “Au sens propre : [le refoulement est l’] opération par laquelle le sujet cherche à repousser ou à maintenir dans l’Inconscient des représentations (pensées, images, souvenirs) liées à une pulsion. Il se produit dans les cas où la satisfaction d’une pulsion risquerait de provoquer du déplaisir à l’égard d’autres exigences.“ L’effet dynamique principal de cette opposition entre les systèmes Cs-Pcs/Ics est le phénomène du refoulement. Ce qui est nouveau chez Freud, c’est que, au-delà de la simple vision statique selon laquelle il y a plus d’inconscient que de conscient dans la vie psychique (c'est l'image de l'iceberg, avec sa masse immergée bien plus grande que sa partie émergée, qui amène à confondre fatalement inconscient et subconscient), il définit l’Ics à partir du refoulement, et le refoulement à partir de la censure (au service de la conscience) qui oblige à refouler. D’où la présence d’un conflit psychique. Mais ce conflit est à chaque fois singulier, propre à chacun. L’Ics freudien est constitué, de façon subjective et contingente — ce n’est pas un vécu indifférencié. L'Ics a une dimension historique et personnelle irréductible. Un refoulement a pu se produire chez un sujet et pas chez un autre, il a pu générer un conflit chez l’un et pas chez l’autre... C’est pourquoi l’inconscient freudien n’a rien à voir avec « l’animal qui serait en nous » ou bien avec l’« instinct » (indifférencié par définition au niveau des individus). Mais qu’est-ce qui est refoulé au juste ? et pourquoi ce refoulement ? Il s’agit d’un représentant d’une pulsion, par exemple d’un désir d’origine sexuelle — mais c’est bien la représentation, et non la pulsion elle-même, qui est ainsi refoulée dans l’Inconscient. C’est pourquoi il sera possible, malgré tout, d’en « prendre conscience » via la verbalisation… (cf. plus loin la cure psychanalytique). - Le "refoulement infantile" et le complexe d’Œdipe - Ce sont plus particulièrement des désirs primitifs de l’enfance qui connaissent une fixation dans l’Ics à travers leurs représentations. “Fixation” indique qu’au lieu de disparaître ils opposeront une certaine résistance par la suite, qu’inlassablement ils feront “parler d’eux”... C’est donc par l’action du “refoulement infantile” que s’opère le premier clivage entre Ics et Cs. Notamment dans la période dite de “latence”, période qui va du déclin du complexe d’Œdipe jusqu’au début de la puberté. Apparition de sentiments comme la pudeur et le dégoût, et d‘aspirations morales et esthétiques, refoulant les premières pulsions infantiles. Qu'en est-il, alors du fameux complexe d'Œdipe ? L’expression désigne pour Freud cette période de l'enfance (de 3/4 ans jusqu’à 6/7 ans) où l'enfant, en plein processus d'identification et de construction personnelle (y compris genrée : garçon/fille), éprouve une série de sentiments ambigus à l'égard de ses parents. Par exemple, le garçon s'identifiant naturellement au père pour « devenir un homme », se tourne « amoureusement » vers la mère (à la manière d’un enfant certes, non comme un adulte le ferait !), cherchant à s’attirer ses faveurs, pendant qu'il éprouve envers le père un sentiment mêlé de jalousie, d'amour et de culpabilité. Mais lorsque le processus d'identification vient à terme, l'enfant venant à se socialiser (école, etc.), ces sentiments contradictoires s’estompent. La manière dont l'enfant "traverse" cette période détermine, selon Freud, son caractère plus ou moins "névrosé" à l'âge adulte : ses relations avec le sexe opposé seront la réplique des relations œdipiennes, et dommage si les conflits et les contradictions accompagnant ces dernières n'ont jamais été résolus ! Or la « traversée » de ce complexe d’Œdipe n’est pas forcément facile : toutes sortes de circonstances comme des conflits familiaux (mésentente entre les parents par ex.), ou un comportement problématique de l’un des parents (infidélité, alcoolisme, violence…) peuvent nuire au processus d’identification. Ainsi à l’âge adulte, au lieu d'exprimer son désir librement, le névrosé reste attaché à un sentiment de culpabilité non résorbé, ainsi qu'à l'image sublimée d’un parent trop aimé. Les premiers symptômes d’une névrose (qui peuvent être aussi bien : angoisse, phobie, dépression, décrochage scolaire, délinquance, addiction, etc.) apparaîtront, comme par hasard, à la fin de l’adolescence lorsque à nouveau la question du désir (sexuel) se posera explicitement au sujet. Toute sa vie, la fille restera en conflit (rivalité) avec sa propre mère et inversement sera excessivement dévouée à son père ; toute sa vie, le garçon restera « proche » de sa mère (et sera en conflit avec ses compagnes, jamais… « assez bien » au regard de l’image idéalisée et inconsciente de la mère), tandis qu’il éprouvera agressivité et mépris envers son père. Or il est évident que le rapport avec le complexe d’Œdipe initial demeure inconscient pour le sujet concerné. c. La deuxième topique : ça, moi, surmoi - Pourquoi le passage à une 2ème topique (1920) ? - Pour le dire vite, il semble de plus en plus évident pour Freud que l’inconscient est plus vaste qu’il ne le supposait au départ, qu’il n’est pas seulement une partie du psychisme, mais son « essentielle réalité » comme il dit lui-même. Il va donc réorganiser sa théorie. 1° Freud s'aperçoit qu'il existe des forces pulsionnelles inconscientes primitives non-refoulées (le "ça"). 2° Il s'aperçoit (dans les cures de ses patients) que les processus de refoulement et de censure sont les plus souvent inconscients et pas seulement préconscients. Il constate aussi que l'ensemble formé par le système cs-pcs qui forme (apparemment) le cœur de la personnalité (le "moi") comprend lui-même des aspects inconscients : témoin le narcissisme. 3° Enfin il remarque que, à côté de l'amour de soi, le psychisme comporte une large part d'auto-agressivité, qu’il appelle « pulsion de mort ». Il fait un rapprochement avec la "conscience morale" et nomme ceci le "surmoi". De ce fait, dans le cadre de la 2ème topique, le terme "inconscient" est surtout employé sous sa forme adjective: en effet l’ics n’est plus le propre d’une instance particulière puisqu’il qualifie le “ça” et pour une part le “moi” et le “surmoi”. L’ics étant partout, on passe d’une dualité ics/cs-pcs à une vraie tripartition. - Le Ça - Cette instance de la personnalité se présente comme le réservoir premier de l’énergie psychique, où circule librement la libido. A la différence du premier Ics (1ère topique), il comporte des éléments non refoulés, toujours inconscients, mais particulièrement archaïques et “primaires”. Donc ses contenus, expressions psychiques des pulsions, sont ics, pour une part héréditaires et innés, pour l’autre refoulés et acquis. “C’est la partie la plus obscure, impénétrable de notre personnalité. (...) nous l’appelons : chaos, marmite pleine d’émotions bouillonnantes. (...) Il s‘emplit d’énergie, à partir des pulsions, mais sans témoigner d’aucune organisation, d’aucune volonté générale ; il tend seulement à satisfaire les besoins pulsionnels, en se conformant au principe de plaisir. Les processus qui se déroulent dans le ça n’obéissent pas aux lois logiques de la pensée ; pour eux, le principe de la contradiction est nul. Des émotions contradictoires y subsistent sans se contrarier, sans se soustraire les unes aux autres.” (Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse) “Expression psychique des pulsions”, le ça n’est donc pas assimilable à un ensemble brut de pulsions. Et pourtant il est incontestablement plus réel, plus résistant, plus “primaire” que l’Ics de la première topique. Qu’est-ce qu’une “pulsion” ? Répétons ce propos de Freud : "Le concept de pulsion nous apparaît comme un concept-limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations issues de l’intérieur du corps” (cf. plus haut). Il s’agit bien sûr essentiellement de la pulsion sexuelle, mais sous ses formes les plus diverses, liées à des objets "partiels" (sein, fèces, etc). Freud découvre un monde pulsions primitives liées à la petite enfance, bien avant le complexe d'Œdipe, complètement inconscientes (et souvent très violentes). Il ouvre ainsi la voie au traitement de maladies plus graves, plus profondément enracinées que la névrose, telles les psychoses et les perversions. - Le Moi - Son statut est ambigu. En principe le Moi est le centre de la personnalité et doit préserver l'unité de celle-ci. Il est essentiellement une représentation consciente et préconscience de soi (le siège de l’ « identité »), mais il comporte aussi des aspects inconscients, comme le narcissisme. L’aspect narcissique du Moi est ce que Freud appelle le « Moi idéal », le Moi en tant qu’il s’admire et cherche à se faire reluire. Celui-ci se présente comme un idéal de toute-puissance narcissique forgé sur le modèle du narcissisme infantile : en somme une belle image de soi. Au pire, c’est ce Moi-idéal fantasmé comme irrésistible et tout puissant – faible et malade en réalité ! – qui peut donner lieu à ces personnalités dangereuses pour autrui que l’on nomme aujourd’hui « pervers narcissiques ». A propos du Moi Freud dit que sa "vie n'est pas facile". Le Moi est dans une relation de dépendance tant à l’endroit des revendications du Ça (qu’il doit surveiller) que des impératifs du Surmoi (qui le tyrannise) et des exigences de la réalité… "Les pulsions du « ça » aspirent à des satisfactions immédiates, brutales, et n'obtiennent ainsi rien, ou bien même se causent un dommage sensible. Il échoit maintenant pour tâche au « moi » de parer à ces échecs, d'agir comme intermédiaire entre les prétentions du « ça » et les oppositions que celui-ci rencontre de la part du monde réel extérieur. Le « moi » déploie son activité dans deux directions. D'une part, il observe, grâce aux organes des sens, du système de la conscience, le monde extérieur, afin de saisir l'occasion propice à une satisfaction exempte de périls ; d'autre part, il agit sur le « ça », tient en bride les passions de celui-ci, incite les instincts à ajourner leur satisfaction ; même, quand cela est nécessaire, il leur fait modifier les buts auxquels ils tendent ou les abandonner contre des dédommagements. En imposant ce joug aux élans du « ça », le « moi » remplace le principe de plaisir, primitivement seul en vigueur, par le principe dit de réalité, qui certes poursuit le même but final, mais en tenant compte des conditions imposées par le monde extérieur." (Freud, Ma vie et la psychanalyse) Le Moi apparaît comme un objet privilégié d’investissement libidinal. Pour Freud c'est le désir, bien plus que la conscience, qui le caractérise. Et c’est la concurrence entre deux types de pulsions — pulsions du moi (narcissiques et donc libidinales dans un sens, mais dirigées quand même vers le principe de réalité) et pulsions partielles (incompatibles dans leur état brut avec la réalité sociale) — qui va faire naître le conflit et donc le refoulement, lequel s’explique mieux par là-même. On comprend mieux en outre le passage du conflit à la pathologie, c’est-à-dire à la maladie, car selon Freud : “Ce sont les mêmes organes et les mêmes systèmes d’organes qui sont à la disposition des pulsions sexuelles et des pulsions du moi. (...) Ce principe conduit forcément à des conséquences pathologiques si les deux pulsions fondamentales se sont désunies, si de la part du moi un refoulement est entretenu contre la pulsion sexuelle partielle qui est concernée. (...) Le moi a perdu sa domination sur l’organe qui maintenant se met entièrement à la disposition de la pulsion sexuelle refoulée.” - Le Surmoi - Il dérive de l’influence exercée par toute autorité, toute tradition et se définit comme l’intériorisation des exigences et des interdits parentaux. Freud : “la conscience [morale] est une fonction que nous lui attribuons parmi d’autres, et qui consiste à surveiller et juger les actes et intentions du Moi et à exercer une activité de censure”. Mais il comprend aussi une part inconsciente, qui est justement la plus révélatrice. Il faut notamment expliquer pourquoi cette censure peut se transformer en répression violente, voire sadique. Ce Surmoi est de nature essentiellement imaginaire, ce qui veut dire aussi libidinale (ce qui prouve qu’il est aussi en contact avec le “ça”). Il est le résultat d’une projection et aussi d’une inversion, d’un retournement de nos tendances les plus agressives, les plus narcissiques, contre nous-mêmes. Alors le Surmoi engendre l’angoisse et même un besoin masochiste de punition chez le Moi. Ancré sur le sentiment de culpabilité, on comprend mieux dès lors pourquoi le Surmoi est l’héritier de la dépendance infantile et du complexe d’Œdipe. III / Le « retour du refoulé » et les « formations de compromis » Examinons les conséquences, pour un sujet, du phénomène dynamique du refoulement. En effet ce qui fut refoulé a tendance à faire retour — mais pas par la voie consciente, ni en général d'une façon agréable. Toutes les manifestations de ce « retour » auront un aspect ambigu, dans le sens où 1° elles expriment d’un côté la censure, l’interdiction, 2° mais aussi la satisfaction de la pulsion ou du désir refoulé (puisqu’il s’agit d’un retour). En d’autres termes, il s’agit d’un compromis. On parle alors de “formations de compromis”. a. Le symptôme névrotique Le mot « névroses » désigne des troubles psychiques divers et variés, dont les manifestations peuvent être comportementales (comme les fameux troubles obsessionnels compulsifs, « tocs »), psychosomatiques (agitation, paralysie soudaine, neurasthénie, irruptions cutanées, etc.), ou purement mentales (anxiété). Le symptôme névrotique se produit de façon répétée et énigmatique, et il est supposé ne pas avoir été solutionné (ou guéri) par la médecine du corps. Un symptôme psychosomatique peut être dit névrotique, donc intéresse le psychologue (et pas seulement le médecin) à partir du moment où l’on peut supposer qu’il est directement lié à l’état mental du sujet, plus précisément à son inconscient : donc lié à la représentation d’un désir refoulé, ou bien à un traumatisme infantile lui-même refoulé, voire au complexe d’Œdipe. (cf. Exemple de certaines formes d’alopécie féminine.). Le mot « psychoses » désigne d’autres troubles mentaux réputés plus sévères que les névroses. Pour comprendre comment Freud explique la formation des symptômes névrotiques, demandons-nous à nouveau : que se passet-il lors refoulement ? Il faut bien se souvenir que ce sont des représentations mentales (un mot, une image, un souvenir – mais pas les pulsions elles-mêmes) qui sont refoulées, lorsqu’elles sont incompatibles avec la conscience. Or Freud associe à chaque représentation un affect (une émotion) qui lui est lié. Que devient cet affect dans le refoulement ? Il est converti en énergie somatique ou corporelle (c’est le symptôme, dit « symptôme de conversion »), tandis que c’est la représentation à proprement parler qui est refoulée dans l’Ics. Energétiquement, cette conversion est un phénomène compensatoire. Un symptôme névrotique, conversion physique et maladive de l’affect en l’absence de la représentation refoulée, sera donc à la fois le prétexte à un interdit (telle affection physique entraînant l’impossibilité d’une certaine action, par exemple sexuelle) et l’occasion de sa transgression (le malade, dit Freud, en tire un bénéfice); donc à la fois le lieu d’une jouissance et d’une souffrance. Formation de compromis donc. En bref, le symptôme névrotique (en tout cas psychosomatique), c’est le retour du refoulé à même le corps. Même si ce n’est pas du tout le même référentiel (fantastique vs psychologie), c’est un peu le principe de l’exorcisme : parvenir à nommer le démon pour le faire partir et que cessent les souffrances du possédé ! b. Le rêve “Le rêve est la réalisation inconsciente d’un désir."“Si le rêve est obscur, c’est par nécessité et pour ne pas trahir certaines idées latentes que ma conscience désapprouve. Ainsi s’explique le travail de déformation qui est, pour le rêve, un véritable déguisement.” (Freud, L'interprétation des rêves) Mais il existe d’autres formations de compromis, non pathologiques, qui traduisent aussi le retour du refoulé ; cette fois au niveau du préconscient. On connaît les actes manqués et les lapsus (voir Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne, 1901), qui sont des actes (faussement involontaires) et surtout significatifs, mais aussi et surtout le rêve, "vois royale de l'inconscient" selon Freud. En effet le rêve comprend un contenu manifeste (dont nous avons conscience) et un contenu latent (son sens caché, un désir ics). D'où la nécessité de décoder, d'interpréter les rêves. Comme toute formation du système pcs-ics, il utilise les procédés de la condensation (métaphore) et du déplacement (métonymie) qui sont les principaux outils de maquillage de la censure. Là encore règne l’ambiguïté puisque 1° la censure est censée censurer, interdire, mais 2° c’est quand même elle qui laisse passer l’expression du désir (c’est-à-dire que le gardien s’est un peu endormi !). c. La sublimation Selon Freud, les pulsions qui par elles-mêmes sont synonymes de vie et de potentialités, ne doivent pas être niées ou détruites, elles doivent être sublimées : c'est-à-dire qu'elles doivent être déviées de leur but initial (corporel ou sexuel) et utilisées à des fins sociales, personnelles, créatives… Freud définit la sublimation comme un processus de transformation de l’énergie sexuelle (libido) en la faisant dériver vers d’autres domaines, comme la création artistique ou autres activités socialement valorisées. Car, s’il n’est pas bon de les refouler jusqu’à la frustration, il n’est pas question non plus de satisfaire ses pulsions librement ! Freud, plutôt pessimiste sur ce plan, considère que l’homme est resté un animal égocentrique, agressif et avide de possession. S’il ne condamne pas la morale sociale (en bon bourgeois qu’il reste), il sait ce qu’il en coûte (en bon thérapeute qu’il est aussi) de simplement nier ou de réprimer ses désirs inconscients. Freud considère à juste titre que la voie royale pour exprimer ses pulsions tout en s’élevant spirituellement est la sublimation. A condition de savoir y faire entendre l’inconscient, ce qui est particulièrement le cas dans l’art (Freud ici est proche de Nietzsche, comme d’André Breton, le fondateur du surréalisme). A défaut, les pulsions inconscientes se manifesteront autrement, le retour du refoulé s’effectuera pathologiquement (névroses, psychoses, perversions…), ou bien thérapeutiquement pour tâcher d’y remédier, et c’est justement l’objet de la méthode inventée par Freud, la cure psychanalytique. d. La cure psychanalytique En résumé, Freud présente le psychisme comme une organisation dynamique, conflictuelle, dont les ressorts échappent parfaitement à la conscience. Or la conscience n'a pas la possibilité de rendre conscient ce n'a pas pour vocation de l'être : l'inconscient lui-même. Et pourtant, Freud écrit aussi : "là où c'était, je dois advenir", où "je" signifie non pas le moi (qui fait partie intégrante du psychisme, comme on l'a vu), mais le "sujet" (si l'on veut bien se souvenir que cette distinction est légitime), en l’occurrence le sujet de la parole. Il faut surtout se souvenir que l’inconscient contient des représentations, des images et des mots. Donc là où le « ça » muet fait sa loi, dans le cas où cette influence est pathogène, le sujet (« je ») a la possibilité de prendre la parole pour dénouer au niveau de l'inconscient ce qui peut l'être, et ainsi vivre mieux. C'est le principe de la cure psychanalytique. Le moyen de guérir ou de soulager les symptômes : il s’agira bien sûr de refaire surgir la représentation refoulée. Ce qu’on peut appeler à la rigueur une prise de conscience, mais qui est plutôt une prise de parole puisque ladite représentation est faite de langage. Dans le cadre de la « cure psychanalytique » le patient est amené, par la voie des associations dites libres (Freud : « Dites tout ce qui vous passe par l’esprit »), et l’anamnèse (souvenir, réminiscence), à faire ressurgir le refoulé dans la parole. Le rôle du psychanalyste est d’aider le patient (« analysant ») dans ce travail, en proposant des « interprétations », c’est-à-dire en soulignant ce qui est important (« signifiant ») dans les dires du patient. La cure analytique se différencie aussi de l’introspection psychologique pour deux raisons essentielles : 1° elle n’est pas rationnelle, logique, mais s’appuie sur une approche plutôt “ordinaire” voire “poétique” du langage (les “associations”), 2° elle dépend entièrement d’un Autre (le psychanalyste) qui empêche, par sa seule présence, que le discours du patient ne devienne un monologue stérile ...sans être pour autant un dialogue (différence avec la “psychothérapie” classique). Car, comme le dit Lacan, il faut que “Ça parle” ! Notons pour finir une dernière spécificité de la cure psychanalytique : celle-ci s'appuie sur un phénomène troublant mais nécessaire qui porte le nom de « transfert ». Le transfert est la relation affective profonde qui unit le patient et le médecin, conséquence inévitable du fait que le patient projette sur la personne du médecin à qui il s’adresse en apparence, les figures de personnages ayant compté affectivement pour lui (ses parents notamment), ce qui revient un peu à « revenir en enfance » le temps d’une séance… qui comporte donc son lot de pulsions, de désirs, d'émotions refoulées. Du reste, sans ce lien affectif, qui reste par ailleurs artificiel et tout à fait provisoire, provoqué par la cure et limité à celle-ci, le patient ne serait pas porté à dévoiler quelques bribes de son inconscient... Conclusion L'inconscient est une découverte qui oblige à relativiser les pouvoirs de la conscience et qui donne au moi une leçon de modestie. Cette théorie nous rappelle la finitude humaine et le fait que l'homme est un être historique marqué par le poids du passé. Pour autant, existe-t-il un inconscient psychique ? Il est vrai que le terme « psychique » lui-même a un peu vieilli. Il peut prêter à confusion s’il renvoie à une intériorité psychologique qui ne serait rien que l’envers de la conscience. Or le freudisme désigne l’humain comme marqué également par ses relations primitives avec l'Autre. "L'inconscient est le discours de l'Autre" (= le discours de l’Autre gravé en moi, déterminant, sans que je le sache) disait Lacan, donc l'inconscient pas plus que le conscient n'est "intérieur"… Et surtout la théorie de Freud et de ses disciples ne sacrifie pas la notion de Sujet ; au contraire elle lui donne une extension remarquable, jusqu’à proposer le concept d’un "sujet de l’inconscient" (Lacan). L'inconscient apparaît alors comme le cœur même, le ressort intime de notre être. Difficile, dans ces conditions, de ne pas s’en préoccuper… surtout si nous sommes préoccupés, personnellement, par quelque dilemme existentiel, où notre désir est en jeu, voire notre désir de vivre. Cette recherche, cette connaissance soi, il est évident qu’elle ne s’impose pas, au niveau de l’inconscient, comme la recherche de la Vérité au sens philosophique et socratique, au niveau de la conscience intellectuelle. Cette recherche ne s’impose qu’à ceux qui en éprouve le besoin, à cause des épreuves douloureuses de la vie. Ou par exemple lorsqu’une personne souhaite comprendre pourquoi elle accumule les échecs amoureux, dès qu’elle admet que ce n’est pas toujours « la faute des autres » ni forcément dû au hasard. Personne ne va faire une cure psychanalytique pour le plaisir ! Il est bien vrai aussi que l’inconscient ne devient pas réellement conscient : il parle, il s’exprime, et se volatilise en quelque sorte au moment même où il s’exprime… C’est un sujet éminemment volatile ! Cela reste un savoir, un savoir inconscient, qu’il s'agit de reconnaître en tant que tel. dm

|
Scooped by
dm
December 30, 2024 3:21 AM
|
La notion philosophique d'Inconscience et ses limites (l'Inconscient avant Freud)
De nombreux penseurs, avant Freud, ont utilisé une notion philosophique d'Inconscient, le plus souvent implicitement, de façon variable et parfois contradictoire, pour caractériser en un sens très large le contraire du connaissable et de l’intelligible, ou pour désigner ce qui n’est pas encore conscient. Soit plutôt l’inconscience que l’inconscient. Pour tracer cette généalogie de l'inconscient, l'inconscient pré-freudien, il est possible de distinguer trois grands points de vue, c'est-à-dire trois aspects du problème correspondant plus ou moins à des "courants" philosophiques : un point de vue métaphysique et occultiste, postulant l'existence d'une réalité non-manifestée et invisible ; puis un double point de vue physiciste et vitaliste, l'un affirmant que le corps est l'inconscient même, dépourvu de pensée, et l'autre que le corps pense inconsciemment ; enfin un point de vue psychologiste, qui nous mène vers l'idée d'un inconscient psychique, sans en posséder encore le concept précis, avec notamment le "subconscient". 1) Aspects métaphysiques : une réalité inconsciente ? Existe-t-il une réalité non-manifestée et invisible, donc inconsciente et inconnaissable ? C'est ce que postule, sous certains aspects, ce vaste continent de la pensée philosophique qu'on nomme métaphysique, voire pré-philosophique sous le nom d'"ésotérisme" ou d'"occultisme". Classiquement la "métaphysique" est cet partie essentielle de la philosophie qui traite de la "réalité en soi" et de l’essence des choses. Bien des philosophes ont soutenu le caractère positif et bien réel de ce qui reste invisible et non-manifesté, inconnaissable, voire irrationnel. Ces penseurs ne nomment pas encore ceci l'Inconscient, mais ils en font progresser l'idée. La puissance et le non-manifesté (Aristote) Commençons par un authentique savant et métaphysicien, que l'on ne saurait suspecter d'aucun irrationalisme, Aristote lui-même. Celui-ci distingue deux modes d’existence : « être en puissance » (= virtuellement) et « être en acte » (= effectivement). L’opposition se fait bien entre le virtuel et l’actuel, et non entre le virtuel et le réel : quelque chose peut bien être virtuel (virtus, en capacité de) donc non actuel, sans pour autant être irréel. Par exemple « je suis un artiste en puissance » (= pas encore, et inconsciemment) mais non en acte (maintenant, et consciemment). Ce qui signifie : je peux (ou je vais peut-être) devenir un artiste, mais ce n’est pas encore manifeste, et à vrai dire pour l’instant je n’en sais rien. L’existence en acte possède une forme déterminée ; tant que celle-ci n’est pas réalisée, on peut dire qu’elle reste latente, non-manifesté, invisible. D’une façon générale, c’est le mouvement (le devenir) qui assure le passage de la puissance à l’acte. « Quelque chose peut donc avoir la puissance d'être, et cependant n'être pas, avoir la puissance de n'être pas, et être. De même pour toutes les autres catégories : un être peut avoir la puissance de marcher, et ne pas marcher ; avoir la puissance de ne pas marcher, et marcher. » (Aristote, Métaphysique) Bref, ce n’est pas parce qu’une chose ou un phénomène n’est pas encore manifesté, non perceptible ou non connaissable, qu’il n’existe pas. Mais nous sommes encore très loin de l’idée d’inconscient ! Le mystère et l’invisible (l’occultisme) En marge de la tradition philosophique, ou parfois mêlés à elle, de nombreux penseurs « occultistes » (occulte : caché) mettent en avant l’aspect mystérieux des choses et des êtres, leurs potentialités cachées, donc inconscientes. Ce point de vue est compatible avec les religions et leurs théologies : celles-ci supposent toujours une origine mystérieuse (inexplicable) et invisible (divine) aux choses naturellement perceptibles. Ainsi Jacob Boehme (16è) : “Les choses visibles et sensibles sont un être de l’Invisible ; de l’Invisible, de l’Insaisissable proviennent le Visible et le Saisissable." En un sens la phrase ci-dessus ne fait que reprendre la distinction aristotélicienne de la puissance et de l’acte, mais en la teintant de mystère. Ces doctrines « ésotéristes » ou « occultistes », pensées symbolistes davantage que conceptuelles, aux relents de mysticisme et parfois de magie, tenant que l’invisible et l’inconnu sont généralement plus importants que le visible et le connu, paraissent trop souvent irrationnelles et pour le moins confuses. Elles se mêlent volontiers aux pensées anciennes et orientales, sont souvent nostalgiques et réactionnaires et sont même parfois compatibles avec ce que l’on appelle aujourd’hui le « complotisme » : l’idée selon laquelle des puissances invisibles et avides nous manipulent à notre insu. Seule une minorité de résistants éveillés, voire d’initiés détenant les clefs de l’invisible, seraient conscients de cela… 2. L'inconscient physique : le corps est-il inconscient ? L'instinct, ou les animaux inconscients. Le corps ne pense pas selon Descartes "Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, mais je ne m'en étonne pas car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement et par ressorts, ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure qu'il est, que notre jugement ne nous l'enseigne. Et sans doute que, lorsque les hirondelles viennent au printemps, elles agissent en cela comme des horloges. Tout ce que font les mouches à miel est de même nature, et l'ordre que tiennent les grues en volant et celui qu'observent les singes en se battant, s'il est vrai qu'ils en observent quelqu'un, et enfin l'instinct d'ensevelir leurs morts, n'est pas plus étrange que celui des chiens et des chats, qui grattent la terre pour ensevelir leurs excréments, bien qu'ils ne les ensevelissent presque jamais: ce qui montre qu'ils ne le font que par instinct et sans y penser." (Descartes, Discours de la méthode) Sur la question de l’instinct, l’on ne peut que donner raison à Descartes : par définition l’instinct est une disposition naturelle, héréditaire et inconsciente. Si les hommes possédaient encore des instincts (ce qui n’est pas évident), ceux-ci seraient également inconscients. De là à affirmer que les animaux n’ont pas d’âme, ne pensent pas, et que leur comportement est tout entier instinctif voire mécanique, comparable à celui des machines… il y a une marge que Descartes franchit allègrement. En clair, pour Descartes, l'âme seule pense, le corps ne pense pas ; or comme la conscience et la pensée sont le même, il est clair que le corps est inconscient. Lorsque que le corps souffre, certes cela vient à notre conscience, mais par lui-même le corps n’est pas conscient. Pour Descartes le corps est animé par des automatismes ou par des instincts, comme chez l'animal. Pourtant, la thèse cartésienne d'un corps sans pensée paraît contestable. Il est bien vrai que nous n'avons pas conscience de notre corps et que le "silence des organes", comme on dit, est synonyme de santé (si nous "sentons" notre foie, c'est qu'il est malade !), mais dans la vie du corps il faut inclure les affections de plaisir et de douleur qui, à travers les émotions qu’elles engendrent, participent de la conscience. Descartes lui-même envisage une sorte de pensée "selon le corps" (une 3è substance, intermédiaire entre l’âme et le corps), subissant les assauts des désirs, des émotions et des affections diverses du corps. Mais Descartes refuse de lui attribuer un caractère conscient, car pour lui la conscience suppose une pensée réfléchie. Cependant ne suis-je pas en droit d'affirmer, par exemple, que la souffrance est la conscience de la douleur (je dis « une dent me fait mal », mais au bout d’un certain temps je dis simplement « je souffre », m’identifiant tout entier à cette souffrance) ? De la même façon ne puis-je pas affirmer que la jouissance est la conscience du plaisir, un plaisir globalisé et rapporté à moi ? Une conscience de la douleur, ou une conscience du plaisir, certes toujours physique et corporelle… Ce qui tend à prouver que le corps possède bien une sorte de conscience de soi, ou participe en tout cas de la conscience de soi. Et pourtant… paradoxalement, dans la souffrance extrême comme dans le plaisir extatique, l’on pourrait bien voir à l’inverse une sorte de « perte » ou d’« absence » de soi-même, donc tout simplement une perte de conscience… ! Suis-je encore « sujet » dans l’épreuve de la souffrance ou de la jouissance ? Pas au sens actif et conscient du terme « sujet » en tout cas. Il semble bien au contraire que mon corps subisse (sujet au sens passif), pour mon plus grand malheur ou bonheur, l’interaction avec un corps étranger… Une pensée corporelle et inconsciente : la « volonté de puissance » selon Nietzsche Peu avant Freud, et contre la tradition cartésienne, Friedrich Nietzsche a émis la thèse d'une pensée inconsciente, une pensée plutôt corporelle antérieure à la conscience, plus profonde et plus authentique, non tournée vers la communication mais vers l’affirmation et la "création de soi", à l’écoute des pulsions de la vie. Citons d’abord cet extrait du Gai savoir : « Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus médiocre et la plus superficielle ; car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication par quoi l'origine même de la conscience se révèle. » Nietzsche appelle cette pensée la "volonté de puissance", une célébration de la vie et des forces dionysiaques (pourtant cette "volonté de puissance" n'est pas la Nature ou la Vie en général, mais la potentialité créatrice de chaque individu en tant qu'il affirme sa liberté, sans but conscient ni prédéfini). "Voilà mon monde dionysiaque qui se crée et se détruit éternellement lui-même, ce monde mystérieux des voluptés doubles, voilà mon par-delà bien et mal, sans but (…). Ce monde, c’est le monde de la volonté de puissance et rien d'autre ! Et vous-même, vous êtes aussi cette volonté de puissance – et rien d’autre!" (Fragments posthumes) Bilan ? D’un côté avec Descartes, il semble que le corps ne pense pas, et pourtant nous avons vu qu’il faut reconnaître au corps une certaine conscience (le « rapport à soi »). D’un autre côté, avec Nietzsche, il semble bien que le corps pense et « veut » sans passer par la conscience, de ce fait il y aurait bien une forme de pensée inconsciente, mais corporelle ! A partir de maintenant, nous allons commencer à envisager la possibilité d’une pensée inconsciente au plan psychique. 3) Vers l’inconscient psychique : les « petites perceptions » et le « subconscient » « Des petites perceptions » Déjà Leibniz (Gottfried Wilhelm Leibniz, 17è) soutient contre Descartes que toutes nos perceptions ne sont pas conscientes, plus précisément que le processus de perception, extrêmement complexe, inclut des phases inconscientes. Il y a tout simplement des petites perceptions et même des pensées dont on ne s’aperçoit pas. “Il ne s’ensuit pas de ce qu’on ne s’aperçoit pas de la pensée qu’elle cesse pour cela” (Leibniz). Pensées et perceptions sont des phénomènes continus, pas toujours réflexifs, de sorte que la conscience ne les saisit pas toujours. Au fond, Leibniz applique à l'esprit un principe bien connu qu’il énonce lui-même : "la nature ne fait jamais de sauts"… Lorsque le réveil sonne, il semble que nous nous réveillons subitement mais en réalité la perception de la sonnerie est progressive, de sorte que plusieurs phases de notre éveil sont inconscientes. "D'ailleurs on ne dort jamais si profondément qu'on ait quelque sentiment faible et confus ; et on ne serait jamais éveillé par le plus grand bruit du monde, si on n'avait quelque perception de son commencement, qui est petit ; comme on ne romprait jamais une corde par le plus grand effort du monde, si elle n'était tendue et allongée un peu par de moindres efforts, quoique cette petite extension qu'ils font ne paraisse jamais." (Leibniz, Nouveaux essais sur l’entendement humain, 1704) Le « subconscient » : dans les profondeurs de la mémoire… Le concept de subconscient est le vrai ancêtre de l’inconscient psychique au sens de Freud. Il a été élaboré au début du 20è siècle par des auteurs tels que Janet (psychologue), Bergson (philosophe), Freud lui-même… Henri Bergson (20è) relie le subconscient, comme le préfixe du mot l'indique, à des états de conscience enfouis dans la mémoire. En général, nous n'utilisons notre mémoire que pour les besoins de l'action courante. On utilise des souvenirs et on en écarte d'autres pour que notre acte ou même notre action du moment soit efficace. Mais cela ne veut pas dire que nos états de conscience passés disparaissent : cette réalité "subconsciente", Bergson l'appelle l'esprit, par opposition au cerveau (qui gère les aspects pratiques). On part donc du principe qu'il existe des états de conscience inconscients, mais susceptibles de devenir conscients. Car selon Bergson il est possible d'accéder à ces pensées subconscientes. Il suffit de se désintéresser de l'action présente. Pourtant ce n'est pas si simple, il faut mettre en œuvre une logique spéciale. L'écrivain Marcel Proust a bien décrit le mécanisme de cette mémoire en quelque sorte involontaire, qui procède par associations métaphoriques. Une odeur, une saveur, par exemple, peuvent faire ressurgir tout un état de conscience passé, tout un vécu existentiel et pas seulement une image isolée (c'est le fameux passage de la "madeleine" dans A la recherche du temps perdu). "Derrière les souvenirs qui viennent se poser ainsi sur notre occupation présente et se révéler au moyen d'elle, il y en a d'autres, des milliers et des milliers d'autres, en bas, au-dessous de la scène illuminée par la conscience. Oui, je crois que notre vie passée est là, et que tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu depuis le premier éveil de notre conscience, persiste indéfiniment. Mais les souvenirs que ma mémoire conserve ainsi dans ses plus obscures profondeurs y sont à l'état de fantômes invisibles. Ils aspirent peut-être à la lumière : ils n'essaient pourtant pas d'y remonter ; ils savent que c'est impossible, et que moi, être vivant et agissant, j'ai autre chose à faire que de m'occuper d'eux. Mais supposez qu'à un moment donné je me désintéresse de la situation présente, de l'action pressante. Supposez, en d'autres termes, que je m'endorme. Alors ces souvenirs immobiles, sentant que je viens d'écarter l'obstacle, de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience, se mettent en mouvement. Ils se lèvent, ils s'agitent, ils exécutent, dans la nuit de l'inconscient, une immense danse macabre. Et, tous ensemble, ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir." (Bergson, L'énergie spirituelle) Freud lui-même a longtemps utilisé ce terme de subconscient, avant de distinguer deux concepts différents – l'inconscient et le pré-conscient – et de rapporter le subconscient au second. En effet, ce dont il s'agit avec l'Inconscient proprement dit n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qui vient d'être décrit. Au niveau du subconscient, il n'y a pas encore de place pour un sujet différent de la conscience, ou même pour une réalité psychique distincte, puisque le subconscient n'est au fond que la réalité profonde de la conscience, sa partie immergée (image classique de l’iceberg), et la plus volumineuse. Mais Freud a inventé une théorie nouvelle pour rendre compte d'une découverte : une autre réalité psychique, insoupçonnée, en marge de la conscience… dm

|
Scooped by
dm
December 28, 2024 9:20 AM
|
Vous avez dit "Philosophie générale" ?
Les philosophes de l’Antiquité – des pré-socratiques jusqu’aux premiers stoïciens – prétendaient hardiment traiter de toutes les questions possibles, par exemple de morale, de logique, et de cosmologie – surtout de cosmologie. Ce qui se comprend bien puisqu’une cosmologie, c’est-à-dire un « système du monde » qui est aussi d’ailleurs une « histoire du monde » (cosmogonie), cela contient forcément l’histoire et la science de toutes choses… De son côté Platon avait mis sur pied un système philosophique qui lui permettait, jusqu’à un certain point, de répondre de la totalité du réel : il distinguait en effet trois Idées essentielles : le Vrai, le Beau, le Bien et en confiait l’étude à la dialectique. Ce n’est déjà plus la classification adoptée par Aristote, qui procède plus en « savant » qu’en « politicien » de l’ordre. L’on peut tirer une classification implicite à partir de sa vaste bibliographie. L’on trouve d’abord des ouvrages de physique et de biologie, puis des ouvrages de politique et de morale, des ouvrages de logique (mais aussi une poétique), et enfin l’ouvrage central de La Métaphysique. La Métaphysique est la partie à la fois la plus haute et la plus spécifique de la philosophie, puisqu’elle est censée traiter de « l’être en tant qu’être », mais le terme lui-même serait purement circonstanciel puisqu’il désignerait simplement les œuvres d’Aristote composées après la physique, et aurait été attribué par des compilateurs. C’est pourquoi on peut lui préférer le terme consacré d’Ontologie qui signifie littéralement la science de l’Etre. Cette classification plaçant l’Ontologie (autre nom de la métaphysique) au somment de la connaissance philosophique ne sera pratiquement jamais contestée. Sur quoi repose-t-elle ? Non plus sur la primauté de la Valeur, comme chez Platon, mais sur la primauté de l’Etre. Qu’est-ce que c’est, « l’être en tant qu’être » ou « l’être-même des choses » ? En réalité, les « choses comme elles sont », chez Aristote, ce sont les choses « comme on les connaît », comme on les objectivise. De quoi tomber sous le coup de la critique Kantienne adressée la Métaphysique, justement, c’est-à-dire pour Kant toutes les questions et toutes les vérités qui demeurent au-delà de nos capacités de connaissance. C’est pourquoi les termes d’Ontologie ou de Métaphysique furent peu à peu remplacés, dès le milieu du 19è siècle, par l’expression plus neutre de « Philosophie générale ». Or le « spécialiste » de Philosophie générale reprend ni plus ni moins le flambeau du métaphysicien ! Son rôle, son métier : faire en sorte que les problèmes restent des problèmes, que les questions restent des questions, en conservant surtout la plus grande généralité. A la limite, « Philosophie générale » désigne moins un « domaine » se superposant à d’autres qu’une « manière générale » d’aborder les problèmes philosophiques. La philosophie se voit contrainte de généraliser, paradoxalement, pour mieux définir ses objets ; et les définir, pour elle aujourd’hui, revient essentiellement à les défendre et à les préserver contre la concurrence des sciences humaines. Face à l’afflux de ces nouvelles sciences, le champ du savoir philosophique tend à fondre comme neige au soleil. C’est pourquoi il ne reste plus que deux solutions. 1) Soit accepter la limitation du champ réduisant la « quête de la sagesse » à une épistémologie, à une science de la philosophie, ou à une analyse du langage – mais l’on ne parle plus de Philosophie générale. 2) Soit au contraire, foncer dans la voie d’une généralisation de la philosophie générale elle-même – faisant de la « philo » une « pensée » indépendante, une pensée en liberté qui n’aurait ni domaine ni méthode propres : par exemple une sorte de « poésie » (Heidegger), ou bien une « écriture » (Derrida), une “pop-philosophie” (Deleuze) et pourquoi pas un retour à l’esprit socratique de la philosophie-discussion (les tendances en vogue de la “pratique philosophique”)… Mais comment (et surtout pourquoi) préserver seulement le nom de Philosophie dans ces conditions ? D’aucun soutiennent que l’on peut légitimement philosopher à propos de tout et de n’importe quoi, puisque cette discipline qui n’en est pas vraiment une aurait pour seul domaine le « général », à ne pas confondre bien entendu avec les « généralités » vulgaires. C’est ce que l’on pourrait appeler la « philosophie du génitif » ou la philosophie du « de ». Cohabitent ainsi, dans un certain respect des anciennes catégories tout d’abord, puis de moins en moins, une philosophie des Sciences et une philosophie des Mœurs, une philosophie de l’Art, de l’Histoire, mais aussi une philosophie du Sport, de la Mode, ou du Carburateur, donc une philosophie dirigée vers des objets toujours plus singuliers voire improbables, sans doute, tout en continuant à généraliser son approche quoi qu’il en soit, et tout en recyclant, inventant ou bricolant des concepts, sinon ce n’est plus de la philosophie. Et ainsi de suite jusqu’au jour où quelqu’un proposera – pourquoi pas, inévitablement – une philosophie de l’amibe, pour peu que celle-ci possède la dignité de nous interroger sinon de penser par elle-même (quoique). Nous en sommes là… Allons plus loin, tel autre penseur pourrait développer - si ce n’est déjà fait - une authentique philosophie de la frite… Il est vrai qu’une histoire ou une « sociologie de la frite » serait des plus éclairantes, par exemple pour dévoiler les habitus d’une région comme le Nord de la France… Mais justement, qu’aurait à nous apporter de spécifique ou de suffisamment profond une philosophie de la frite que ne saurait atteindre l’approche sociologique ? En réalité, bien qu’il soit tentant de prendre cette hypothèse au sérieux, les raisons de considérer comme douteuse une telle initiative peuvent parfaitement être dégagées. C’est que, pour lui conserver un minimum d’apparence philosophique, il faudra hisser cette étude jusqu’à un certain niveau d’abstraction et de généralité. Cette « philosophie de la frite » devra donc accéder au rang d’une théorie, mais une théorie réflexive et même spéculative très différente de l’étude sociologique précédemment envisagée, laquelle préserverait une distance scientifique entre sa pensée et son objet. Au contraire l’on peut parier que l’élément théorie, dans la pseudo-théorie philosophique, ne tardera pas à prendre autant d’importance, puis davantage d’importance que l’élément frite qui constituait à l’origine le véritable objet. La théorie va insensiblement prendre toute la place, elle va en quelque sorte manger la frite… Bref notre philosophie de la frite se tardera pas à devenir une philosophie de la philosophie – une de plus. Ainsi se manifeste, au besoin jusqu’à l’absurde, ce que nous appelons l’auto-référentialité et l’auto-suffisance de la philosophie. dm

|
Scooped by
dm
December 23, 2024 3:56 AM
|
Conscience, langage et société
La phénoménologie et l'existentialisme ont défini la conscience comme un faisceau intentionnel, voire comme un réseau de relations avec le monde et avec autrui. Comment ne pas évoquer alors la question du langage, grâce auquel nous communiquons ? A minima il s'agit de mettre en évidence le rapport étroit entre la conscience et le langage, avec la "fonction symbolique" en général. Serions-nous conscients si nous ne pouvions nous parler à nous-mêmes "intérieurement" ? Que signifie "se représenter quelque chose" si ce n'est à l'aide des mots ? Ce qu'on appelle conscience ne serait-il pas finalement un mode intériorisé de la fonction du langage ? Et si la conscience se définit plutôt comme une extériorisation, un "hors-de-soi" à l'enseigne de l'existentialisme, comment ne serait-elle pas encore une fois langage, communication, interpellation, dialogue, etc ? Pire encore : n'allons-nous pas découvrir des formes quasiment « objectives » de la conscience, sociales et collectives, qui déterminent au moins partiellement la conscience individuelle ? Bien des philosophes ont souligné ce lien entre conscience et langage, mais c'était souvent pour faire du langage une simple conséquence de la pensée. La question de savoir "comment penser sans les mots" était simplement évacuée ! D'autres, comme Hegel, ont clairement établi qu'il n'était pas question de concevoir des idées sans être capable de les exprimer clairement : une idée qu'on ne sait pas ou qu'on ne peut pas exprimer n'est tout simplement pas une idée. Nietzsche : la conscience n'est qu'un réseau de communication Nietzsche, le premier, a littéralement jeté un pavé dans la mare ! En effet il a développé une théorie beaucoup plus radicale, qui a pour conséquence de remettre en question le statut privilégié de la conscience – ouvrant par conséquent la voie aux conceptions de Freud sur l'Inconscient. "La conscience n'est en somme qu'un réseau de communications d'homme à homme, ce n'est que comme telle qu'elle a été forcée de se développer : l'homme solitaire et bête de proie aurait pu s'en passer. Le fait que nos actes, nos pensées, nos sentiments, nos mouvements parviennent à notre conscience du moins en partie est la conséquence d'une terrible nécessité qui a longtemps dominé l'homme : étant l'animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d'aide et de protection, il avait besoin de ses semblables, il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible et pour tout cela il lui fallait d'abord la « conscience », pour « savoir » lui-même ce qui lui manquait, « savoir » quelle était sa disposition d'esprit, « savoir » ce qu'il pensait. Car, je le répète, l'homme comme tout être vivant pense sans cesse, mais ne le sait pas ; la pensée qui devient consciente n'en est que la plus petite partie, disons : la partie la plus médiocre et la plus superficielle ; car c'est cette pensée consciente seulement qui s'effectue en paroles, c'est-à-dire en signes de communication par quoi l'origine même de la conscience se révèle. (…) Mon idée est, on le voit, que la conscience ne fait pas proprement partie de l'existence individuelle de l'homme, mais plutôt de ce qui appartient chez lui à la nature de la communauté et du troupeau ; que, par conséquent, la conscience n'est développée d'une façon subtile que par rapport à son utilité pour la communauté et le troupeau, donc que chacun de nous, malgré son désir de se comprendre soi-même aussi individuellement que possible, malgré son désir « de se connaître soi-même », ne prendra toujours conscience que de ce qu'il y a de non-individuel chez lui, de ce qui est « moyen » en lui, que notre pensée elle-même est sans cesse en quelque sorte écrasée par le caractère propre de la conscience, par le « génie de l'espèce » qui la commande et retraduite dans la perspective du troupeau. Tous nos actes sont au fond incomparablement personnels, uniques, immensément individuels, il n'y a là aucun doute ; mais dès que nous les transcrivons dans la conscience, il ne parait plus qu'il en soit ainsi..." (Nietzsche, Le gai savoir) Nietzsche affirme que la conscience n'a pu se développer chez l'homme qu'avec le besoin de communiquer, donc avec le langage. A l'origine, l'homme a dû compenser la perte de ses instincts et une relative faiblesse physique par un accroissement démesuré de la fonction du langage : la pensée existe aussi sous une forme inconsciente en quelque sorte corporelle, pulsionnelle, mais pour communiquer il faut que la pensée devienne consciente, commune, simplifiée, assagie, "arrangeante" et un peu menteuse… D'abord il nous faut nous persuader nous-mêmes que "nous" existons en-dehors de nos actes, que nous sommes des "sujets" séparés et auteurs de nos actes. Mais nous ne sommes sujets que lorsque nous créons, lorsque nous assumons ce que Nietzsche appelle notre "volonté de puissance". Au fond celui-ci remet en cause la notion même de sujet. Il ne faut pas dire "je pense" mais "ça pense". Et il remet en cause le primat de la conscience, celle-ci étant tout simplement une ennemie de la Vie. Lorsque la conscience émerge, lorsque la communication remplace l'action, la pensée faiblit, devient veule et hypocrite. La conscience a quelque chose d'artificiel, de négatif, de "réactif" : c’est au fond un réflexe de défense, un repli sur soi, qui profite à l'espèce (le "troupeau") beaucoup plus qu'à l'individu. Car pendant que nous communiquons, l'individu en nous ne s'exprime pas. La philosophie contemporaine et les sciences sociales ont repris cette hypothèse. N'y a-t-il pas en effet une sorte de conscience "collective" faite de langage qui aurait finalement plus d'impact sur moi-même que ma propre conscience, que mes propres pensées personnelles ? Ce que j'appelle "ma" conscience n'est-il pas avant tout un phénomène social, ou au moins d'origine sociale ? C'est bien ce qu'a voulu démontrer Karl Marx... Marx et la "conscience de classe" "Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience." (Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique) Marx, avec Nietzsche et Freud (que nous abordons ailleurs), est le troisième penseur à avoir sérieusement mis en doute le statut central de la conscience chez l'homme. Pour Marx c'est la société qui fabrique et détermine jusqu'à notre propre conscience personnelle, et c'est l'économie réelle, base de toute « exploitation de l’homme par l’homme » (surtout sous son mode capitaliste) qui impose de facto certaines idées comme « allant de soi » – rien d’autre que des illusions - littéralement une idéologie. Par exemple le respect du « supérieur » hiérarchique (qui en fait nous exploite), la supposée valeur de l’effort (quand son produit nous est extorqué), l’évidence de la propriété privée (qui en fait prive l’autre), etc. On avait cru jusqu'à présent que la conscience, en tant qu'individuelle, était notre propriété, à l'abri de toutes les influences extérieures. Or pour Marx non seulement notre conscience est déterminée par notre existence sociale, mais encore elle est le reflet (pour une part au moins) de la classe sociale à laquelle on appartient. Par exemple, le fait de penser que notre conscience individuelle est notre propriété sacrée constitue typiquement une illusion bourgeoise ! Comme Nietzsche et Freud, Marx est frappé par la formidable impuissance de la conscience lorsqu'il s'agit de changer effectivement la réalité. On ne change la réalité (Marx veut changer la réalité sociale de son temps, la domination politique et sociale de la bourgeoisie) qu'en s'en donnant les moyens matériels (il faut confisquer les biens matériels des bourgeois) et en agissant réellement sans s'embarrasser de scrupules moraux (il faut faire la Révolution). Bref ce qu'on appelle la "conscience", y compris la "conscience morale", n'est finalement qu'un symptôme déterminé d'une réalité sociale et historique complexe. Mais pour Marx, et en général pour tous ceux qui s’impliquent dans les luttes sociales, il est important de prendre conscience de ces déterminations réelles, justement pour changer la réalité (sociale et politique) et parvenir à une existence libre. C’est ainsi que l’expression « conscience de classe » prend une tournure positive et dynamique, expressément révolutionnaire. Emile Durkheim et la "conscience collective" “La conscience collective est l’ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d’une société” écrit le sociologue Emile Durkheim, fondateur de la sociologie scientifique. L’expression de "conscience collective" a donc été forgée par lui. Elle traduit aussi la prise en compte de l'élément social, mais elle est dépourvue de signification politique militante. Elle s’applique aux micro- comme aux macro-sociétés, aux groupes sociaux-professionnels comme aux peuples. Il y a (peut-être) une conscience collective européenne, des consciences collectives nationales, professionnelles, socio-culturelles, ethniques, etc. En tant que telle la conscience collective est un phénomène objectif, c'est-à-dire observable et quantifiable. On se persuadera du bien-fondé de cette notion si l'on s'avise que, de nos jours, toute activité commerciale, prospective, publicitaire repose sur une analyse scrupuleuse et en temps réel de telles consciences collectives (pratique des "sondages"). Nous savons que les médias nous influencent (certains disent nous "manipulent") ; nous savons bien par exemple que, faute d'étudier une question d'actualité à fond, nous n'avons pas vraiment d'opinion personnelle, nous ne sommes qu'une caisse de résonance de l'opinion générale fabriquée par les médias. Notre vie privée, intime ? Est-elle épargnée ? Nous le savons bien également, nos conduites les plus privées (familiales, alimentaires, sexuelles, etc.) sont également conditionnées par un ensemble de discours communs, de programmes TV, de séries, de fantasmes collectifs… Le phénomène s’est accentué avec le développement d’internet et des réseaux sociaux qui semble brouiller la notion même d’identité personnelle. A travers les réseaux l’individu ne cesse de cultiver sa supposée « singularité », soit pour promouvoir ses activités soit pour en tirer une simple satisfaction narcissique. Seulement il est devenu quasiment impossible – autant pour le sujet lui-même que pour ses « followers » – de cerner une quelconque identité réelle (il faudrait démêler le vrai du faux, trier le réel de l’imaginaire) à travers ces « profils » plus ou moins trafiqués – consciemment ou inconsciemment – que nous proposons de nous-mêmes… Le sujet s’offrant à travers une myriade d’images – éphémères – de lui-même possède-t-il encore une identité, une conscience de soi ? Ce jeu sans fin avec les apparences apporte-t-il une quelconque certitude sur soi-même, donne-t-il un quelconque sens à son existence ? Fantasme imaginaire... diraient Freud et la psychanalyse. Avec la théorie de Freud, la conscience va se trouver encore plus décentrée, minimisée par rapport à cette instance bien plus vaste et déterminante qu'est l'inconscient : rien qu'un moi largement imaginaire et narcissique, qui perd les principales fonctions de synthèse que la philosophie classique lui avait reconnu, qui n'est même plus "maître dans sa propre maison" ! dm

|
Scooped by
dm
December 21, 2024 8:31 AM
|
La conscience "pour-soi" et la reconnaissance de soi (au-delà de la "conscience malheureuse")
"Les choses de la nature n'existent qu'immédiatement et d'une seule façon, tandis que l'homme, parce qu'il est esprit, a une double existence ; il existe d'une part au même titre que les choses de la nature, mais d'autre part il existe aussi pour soi, il se contemple, se représente à lui-même, se pense et n'est esprit que par cette activité qui constitue un être pour soi. Cette conscience de soi, l'homme l'acquiert de deux manières : Primo, théoriquement, parce qu'il doit se pencher sur lui-même pour prendre conscience de tous les mouvements, replis et penchants du cœur humain et d'une façon générale se contempler, se représenter ce que la pensée peut lui assigner comme essence (…). Deuxièmement, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique (…). Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu'il marque du sceau de son intériorité et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. L'homme agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger et pour ne jouir des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité. La première pulsion de l'enfant porte déjà en elle cette transformation pratique des choses extérieures ; le petit garçon qui jette des cailloux dans la rivière et regarde les ronds formés à la surface de l'eau admire en eux une œuvre, qui lui donne à voir ce qui est sien." (Friedrich Hegel, Esthétique) "Pour-soi" s'oppose à "en-soi" : les choses de la nature existent en soi seulement, mais l'homme existe aussi pour soi car, grâce à sa conscience, il a une existence automne et il est pour lui-même son propre but. "Pour" exprime la finalité. L'arbre existe pour la forêt ou pour l'insecte qu'il abrite ; l'homme existe pour lui-même, mais cela prend la forme d'un trajet, d'une aventure, c'est pourquoi il ne peut rester en lui-même ni rester le même."L'homme pour soi est l'être qui existe consciemment pour lui-même, théoriquement et pratiquement" (Hegel). Pratique vient du grec praxis qui signifie l'action. Entre le théorique et le pratique, il y a tout l'écart entre le possible et le réel, entre ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire effectivement. Une conscience vivante telle que l'être humain a besoin de se reconnaître à travers une œuvre, un travail, une action ou un projet. Comme l'artiste vérifie son talent dans l'œuvre réalisée, ou comme l'éducateur vérifie sa science dans le savoir de l'élève. D'une façon générale, l'être humain ne peut s'empêcher d'utiliser le monde et les choses comme un matériau pour imprimer, comme dit Hegel, "le sceau de son intériorité", voire comme un gigantesque miroir où il finit par se contempler lui-même. Parallèlement, une conscience a besoin d'être reconnue par les autres consciences pour ce qu'elle est. Par exemple être-poète ne se manifeste pas simplement par un « état d’esprit » de poète, une vague « vision poétique » des choses, mais surtout par un travail d’écriture. Mais encore cela ne se vérifie pas seulement à travers l’écriture des poèmes, mais également dans le fait de les publier et de les donner à lire. Ce qui représente toujours un risque… Ce sont les lecteurs finalement qui consacrent le poète, pas le poète lui-même ! La "conscience malheureuse", maintenant : cette expression est employée par Hegel dans son ouvrage Phénoménologie de l'Esprit pour désigner le sentiment de frustration et d'impuissance qu'éprouve une conscience (un être humain) lorsqu'elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est (ou ce qu’elle croit être) ; ou pour mieux dire, lorsqu'elle ne parvient pas à faire coïncider l'idée abstraite et théorique qu'elle a d'elle-même et son efficacité réelle dans le monde. Hegel vise par-là aussi les âmes que l’on dit « belles », qui refusent d’agir de peur de se souiller : « La conscience vit dans l’angoisse de souiller la splendeur de son intériorité par l’action et l’être-là, et pour préserver la pureté de son cœur elle fuit le contact de l’effectivité et persiste dans l’impuissance entêtée, impuissante à renoncer à son Soi affiné jusqu’au suprême degré d’abstraction… ». Pour exister vraiment, la conscience doit se tourner vers les autres et vers le monde, auprès desquels elle cherche et parfois trouve la confirmation de ce qu'elle pense être. Le problème, c'est que cela conduit parfois à affronter les autres consciences : il y a une lutte pour la reconnaissance. Il faut forcer l'autre à nous reconnaître, il faut s'imposer à lui. Que l'on songe par exemple au "monde du travail", terrain de jeu favori des consciences en quête de reconnaissance et pas seulement avides de gains financiers… La reconnaissance n'est jamais donnée d'avance car, même si le but final est de recevoir la reconnaissance d'autrui dans le cadre d’un échange mutuel, après lui avoir accordé notre propre reconnaissance, on ne peut être reconnu comme "méritant" que si notre action a été efficace ; or pour être efficace, il ne faut pas toujours s'encombrer de scrupules. On veut être reconnu comme sujet par d'autres sujets, mais entre-temps il aura fallu dominer l'autre souvent perçu comme un concurrent, il aura fallu traiter l'autre comme un objet (au moins provisoirement). Bref, une conscience est toujours confrontée aux autres parce qu'elle vise toujours un au-delà d'elle-même. Or au-delà de la conscience individuelle, il y a ce que Hegel appelle l'Esprit, l'Esprit universel : l'Humanité, l'Histoire, la Culture, le Savoir… La reconnaissance totale ne s'effectuera qu'au sein de l'Esprit, mais, paradoxalement, il faut renoncer à son individualité… Conséquence : en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'individuelle, et accrochée à son individualité, la conscience est toujours malheureuse ! Quand elle sera reconnue vraiment elle sera devenue Esprit, elle fera partie de la Culture, mais elle ne sera plus individuellement : disons-le plus trivialement, pour être reconnu pleinement, il faut être mort ! Mais ceci est un processus nécessaire, il faut accepter l'idée que l'universel est supérieur à l'individuel, et qu'il y a "quelque chose de plus important" que sa propre individualité. Avoir autrui dans sa pensée (et pas seulement le Je, comme dit Kant), penser à autrui, tenir compte de l'autre, et le reconnaitre comme un sujet, c'est exactement ce qu'on appelle la "conscience morale". Il faut exister "pour-autrui" et pas seulement "pour-soi". Mais c'est encore un autre question... dm

|
Scooped by
dm
December 20, 2024 7:23 AM
|
Réflexion sur le "discours de l'enseignant" à partir de la théorie des discours de Lacan
L'intuition première de cette réflexion serait d’assigner à la parole enseignante – notamment celle du professeur de philosophie, mais son cas n’est pas si spécifique - une certaine forme d’« atopie », tout en reconnaissant son inclusion dans une structure relativement contraignante qui est celle des discours. Notre hypothèse est que la parole enseignante n’appartient pas à un seul modèle de discours auquel elle serait rivée définitivement, mais qu’elle participe au contraire d'une pluralité de discours qui, pour être antinomiques n’en sont pas moins articulés structurellement, du moins si l’on se réfère à la théorie des discours de Lacan. Le caractère propre de la posture enseignante serait donc à chercher, paradoxalement, dans son inassignabilité - voire une certaine équivocité - et surtout dans sa mobilité essentielle. C'est bien cette qualité qui permettrait à l'enseignant de s'adapter à la diversité des situations, à l’hétérogénéité grandissante des publics, bref de parer aux difficultés nombreuses de sa tâche. Tout ce que nous aurons à formuler sur l’enseignement et le discours enseignant en général vaudra évidemment pour l’enseignement de la philosophie, d’autant plus que cette discipline s'est volontiers auto-érigée, depuis ses origines, en discours princeps et universel. Commençons par rappeler les grandes lignes de cette fameuse "théorie des discours" que Lacan a développée notamment dans son séminaire de l'année 1969-70, "L’envers de la psychanalyse", avant de tenter de les appliquer à la situation enseignante. La théorie des discours de Lacan part de la situation énonciative la plus commune où un agent locuteur (destinateur) s'adresse à un autre locuteur (destinataire), ce qui correspond à la forme nucléaire d’un lien social tissé par le langage. Tout message basé sur un code linguistique (S1 > S2, c'est la chaîne signifiante saussurienne) est censé transmettre un signifié ayant valeur de vérité et produire un effet dans le réel. Ces deux derniers éléments appartiennent à l’énonciation, ils sont respectivement moteur et conséquence réelle de la parole, ils n’apparaissent donc pas au niveau conscient de l’énoncé. Ainsi les places sont fixes (agent, autre, vérité, production) et constitutives de tout discours, mais elles se trouvent investies différemment par les sujets en fonction des types de discours, eux-mêmes résultant de situations sociales différentes et de mises en place du désir contradictoires. Ces éléments tournants sont représentatifs de toute subjectivité parlante, ou si l'on veut de toute intersubjectivité pour utiliser un terme que n'affectionnait pas Lacan. Une première parole signifiante (S1) - donc il faut prendre signifiant au sens large d'énoncé, et non de "mot" - est émise en vue (la flèche) d'une réponse potentielle elle-même signifiante (S2). S2 est le second signifiant au sens d'abord où un locuteur s'adresse à une totalité théorique de signifiants, ce réseau de savoir qui constitue l'inconscient où réponse doit pouvoir lui être faite. Le signifié du signifiant premier n'est autre que le sujet parlant lui-même qui s'y représente, donc le sujet en tant que divisé ($) par le manque, le désir, le besoin de parler. D'où la célèbre définition du signifiant par Lacan (il n’y en a pas d’autre qui tienne) : "le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant". Reste le 4è terme, qui logiquement devrait être le "signifié" propre du S2, sauf que celui-ci n'est plus un énoncé simplement articulé au S1, mais, ainsi qu'on l'a dit, un savoir incluant l'interaction entre les signifiants. Or un savoir n'a pas de signifié comme c'est le cas d'un énoncé S1, nommant lui le sujet, car il faudrait que le savoir rende compte pleinement du réel (de la "Chose") ; mais c'est impossible puisque ce rapport S2/a dépend du premier rapport S1/$. Donc ce qu'il en résulte n'est pas le signifié d'une complétude absolue pour le sujet, une jouissance mythique, mais proprement un reste, la jouissance chue et séparée du sujet que Lacan appelle l'"objet a" ou "plus-de-jouir" pour reprendre l'idée de plus-value de Marx, soit le produit du travail en tant que marchandise chez Marx, et donc produit du discours chez Lacan. Ce n'est pas le moindre des paradoxes que cet objet-effet soit aussi objet-cause dans l'économie du sujet, objet réel cause du désir et donc de l'acte énonciatif. C'est pourquoi les linguistes ignorent ce concept d'objet réel – la linguistique comme discours scientifique ne s'attache qu'aux déterminations et ignore toute autre "cause" - préférant plutôt mettre en avant le contexte ou la situation qui n'engagent pas le sujet dans sa division propre. Il est pourtant essentiel de se rappeler que tout du sujet n’est pas symbolisable, qu’il y a un reste réel – nommé dans la structure bien qu’il lui échappe – résistant à la symbolisation. Notamment il ne peut pas exister de correspondance entre la vérité et la production, car si le sujet pouvait se lire ainsi dans l’objet produit, on se demande bien quel besoin il y aurait de parler. Si la structure n’était pas fermée par cette butée réelle, la structure serait en quelque sorte complète, absolue, parfaitement circulaire c’est-à-dire qu’elle n’aurait littéralement plus aucun sens. Il faut bien que la structure ait une direction pour que l’on puisse soit s’y tenir quelque part, soit y circuler à bon escient, changer de place. C’est pourquoi d’une part le nombre théorique des discours est fixe, il ne saurait y en avoir que quatre (rappelons qu’« une structure quadripartite est depuis l'inconscient toujours exigible dans la construction d'une ordonnance subjective » comme l’a écrit Lacan dans le texte Kant avec Sade, 1963) ; c’est un fait que notre « discours de l’enseignant », s’il existe, ne pourra être que « supplémentaire » et n’aura peut-être même d’autre justification que de répondre ou de résister à une autre excroissance discursive apparue sur le tard, nous parlerons alors plus bas du « discours capitaliste »… D’autre part qu’il y ait de l’impossible dans la structuration de tout discours demeure un fait primordial, car à vouloir le nier, le forcer ou passer outre, l’on se condamnerait à une impuissance qui réduirait pour le coup le champ des possibles comme une peau de chagrin. Voilà bien l’impasse de fait où se trouvent réduits nombre d’enseignants abusés par un surmoi institutionnel qui veut tout et son contraire, exigeant tantôt le respect de normes moralement obsolètes tantôt l’obtention de « résultats » chiffrés dépourvus de toute signification. Ce n’est pas pour rien que l’éducation était déjà qualifiée de tâche « impossible » par Freud lui-même, y reconnaissant un dénominateur commun avec la psychanalyse. Comme un maître Le discours "standard" - le plus simple et aussi le plus illusoire de tous - est celui qui correspond à la définition princeps du signifiant comme "représentant le sujet pour un autre signifiant". Il s'agit du Discours du maître auquel on pourrait certes trouver de nombreux référents historiques, spécialement dans l'éducation, mais il faudrait commencer par indiquer qu'il s'affirme avec la position même du discours comme vecteur et garant de la vérité, révolution opérée par les philosophes grecs. Fondamentalement ce discours du maître a donc à voir avec la philosophie, c'est le discours du philosophe en tant que maître du discours essentiellement. Mais c’est aussi pourquoi, d’un autre point de vue, cette assignation première du philosophe à une position de maîtrise est discutable. Car avec le philosophe il s’agit exclusivement de la maîtrise du discours, et non de la maîtrise en tant que lien social traditionnel, auquel on est en droit de rapporter le schéma de Lacan. Vu de cette manière, le discours philosophique relèverait plutôt de l’Université et en tout cas de l’École, où la maîtrise du discours est requise en même temps qu’une certaine capitalisation du savoir. Le maître « à l’ancienne » ne pourrait être qu’un maître de la Parole uniquement, donc plutôt un initiateur, un magicien du verbe où il y va essentiellement du pouvoir (et de la jouissance) de nommer. Or on sait ce qu’il en fut de Platon qui, tout en feignant de critiquer l’écriture comme accessoire et simulacre (cf. le mythe de Theuth dans le Phèdre), rédigea pourtant l’œuvre philosophique écrite la plus considérable de son temps. Il y a bien le « cas » Socrate, mais son ambiguïté se situe au niveau d’une autre articulation, entre Socrate maître et Socrate hystérique (celui qui affirme ne rien savoir, etc.), mais dans l'ensemble même le non-savoir de Socrate relève de la maîtrise - du discours, proprement. Structurellement le discours du maître reflète la position subjective qui consiste à placer en situation première et donc dominante sa propre parole de maître, laquelle est censée représenter le sujet "lui-même" qui s'ignore donc en tant que divisé et castré, aliéné à l'Autre du fait même qu'il parle et séparé de sa jouissance ; au contraire il se fantasme comme héros proférant une parole "pleine" - alors qu'elle n'est qu'emphatique -, entouré de cette "aura" mythique qui longtemps aura été l'apanage illusoire du "prof de philo". Mais à qui s'adresse-t-il le maître quand il parle, à qui parle-t-il quand il fait mine ainsi de s'adresser à l'élève ? Le maître s'adresse à un disciple théorique supposé pouvoir savoir, c’est-à-dire au fond rien d'autre que lui-même dans sa forme savante réalisée : son propre cours dicté et consigné mécaniquement dans le cahier de l’élève. Comme S2 figurant théoriquement le trésor des signifiants, le cours du professeur représente cette totalité d'informations et de réponses possibles. Mais elles restent évidemment illusoires et de toute façon inaccessibles, sous cette forme, aux élèves. Ce discours prétend donc transmettre et forcer la constitution d'un savoir chez l'élève, dont la propre parole n'est qu'accessoire puisque le but en effet est de produire la sacro-sainte "copie", laquelle se voit endosser la fonction d'objet précieux. D'autant plus précieux que si le maître fait travailler l'élève comme un forcené, voire un esclave, c'est aussi dans le but de s'en nourrir lui-même, avant d'être finalement dépassé par l'élève selon la plus parfaite dialectique du maître et de l'esclave. Ce discours – du moins s'il est érigé en modèle - annonce évidemment un ratage intégral dont les effets peuvent s'avérer extrêmement pervers, même s'il peut faire illusion pendant un certain temps (les premières semaines, en situation enseignante, le "prof de philo" peut espérer méduser ses jeunes auditeurs). D'un côté le signifiant maître revêt un caractère arbitraire exacerbé tandis que le sujet s'exhibe comme non castré, maître du discours, de l'autre l'élève ne peut produire que le plus mauvais discours, la mauvaise copie singeant précisément la "voix de son maître" ! L'éducateur, et singulièrement le prof de philo, n'a eu que trop tendance par le passé à endosser ce rôle et à produire ce discours de maîtrise. Pourtant il est clair aussi que, à certains moments, il faut bien assumer cette position, il faut "jouer au maître" à condition de ne pas s'identifier réellement au maître, donc en ménageant une distance ironique propre à désamorcer la haine de l'élève. L'une des attentes des élèves et de prendre un cours, de recevoir littéralement une leçon, éventuellement sous la dictée. Toute l'intelligence du professeur consiste alors à ne pas se prendre trop au sérieux à ce petit jeu, qui pourrait se révéler "a very bad game". Comme un livre Deuxièmement le Discours universitaire place en position dominante, non plus l'énoncé singulier maître mais directement le savoir, soit ici le corpus des "grands auteurs". Ce type de savoir ne s'adresse pas directement à des sujets parlants mais à leur réalisation potentielle, cet objet académiquement survalorisé qu'est la Thèse, la consécration des études ! Sauf que pendant ce temps c'est le sujet lui-même qui fait office de produit, qui se voit ravalé au rang d'objet-déchet, mal nourri, malade, fauché et mélancolique, l'être-étudiant dans toute sa déréliction – au mieux, un parfait rat-de-bibliothèque. Rien d'autre qu'un esclave, là encore, esclave non pas directement du maître (c’est bien plutôt le savant lui-même qui occupe ce rôle, car le maître n’a pas disparu !) mais d'un savoir aliénant. En position de vérité, l'on trouve cette fois le signifiant maître bien illustré par la citation, que rien ni personne ne saurait remettre en question. Historiquement ce discours peut correspondre à une certaine idée de la science (pré-galiléenne), voire à une certaine philosophie, dans tous les cas y perdure le fantasme d'un savoir absolu. Le discours savant de l'universitaire fait indéniablement partie des « casquettes » du professeur, du moins s'il prend au sérieux son rôle de transmetteur du savoir. C'est bien ce que lui demande avant tout l'institution, son vrai maître. Mais l'on sait bien qu'une démarche pédagogique authentique ne saurait se contenter de bourrer des crânes, et c'est bien la faiblesse du discours universitaire : de la pédagogie il n'en a cure. De ce fait il laisse sur la touche le plus grand nombre et ne convainc que ceux possédant déjà les bases du savoir, les plus cultivés, les « héritiers ». Mais la philosophie se trouve aussi dans les textes et il est évident que son apprentissage passe inévitablement par leur étude, surtout si la dissertation continue de s'imposer comme l'épreuve de référence à l'examen. De toute façon, lire des textes en classe et les expliquer rapidement ne peut pas faire de mal, surtout quand on prend soin de les sélectionner dans l'optique de susciter la comparaison, la controverse et le débat. Le pédagogiste hystérique : tous « apprenants » ! Le discours de l'hystérique est aussi le discours de la science (moderne), dont le sujet n'est pas le savant mais le chercheur, aux prises avec son désir. L'enseignant s'y présente en tant que sujet divisé cherchant le savoir auprès de la classe tout entière, à qui il donne la parole. Le discours de l'hystérique est celui de l'enseignant questionneur. Son obsession est de « faire participer » les élèves. Il y a à l'évidence une dimension socratique dans cette démarche, étant donné la position de non-savoir tenue ici par le maître, qui cependant l'assume moins qu'il ne la joue, voire la sur-joue. En effet, faisant mine de ne rien savoir, il va questionner l’élève sur ce qui lui tient lieu de signifiants maîtres – rien d’autre que la doxa, ce qui ne va jamais bien loin – pour l’amener à y réfléchir et les critiquer dans un second temps. Démarche assez classique du prof de philo, qui plaira à certains élèves mais qui pourra en rebuter d’autres. C'est aussi le discours pédagogiste type - tant honni des petits maîtres ou des héritiers conservateurs - qui tente de mettre en position d'agent la classe tout entière et qui se prononce en toute occasion favorable au travail "en équipe ». Le pédagogiste est un infatigable organisateur (d’activités diverses), un animateur hors pair, sévèrement atteint de réunionnite… Pour cela il y met du sien, il se donne (aussi bien physiquement) sans compter ! Le pédagogiste met en garde contre le discours du maître, refuse la sacralisation de la parole comme celle de l'écrit, préconise les méthodes et les « apprentissages » plutôt que les savoirs, se tourne volontiers vers les « nouvelles technologies » au point de fétichiser parfois l'« outil » pédagogique sous toutes ses formes comme source de vérité ; quand la technologie devient pour ainsi dire son symptôme, métaphore de ce qui ne « marche pas » chez lui… Heureusement en face, faisant office de savoir, se tient le dialogue lui-même, l'échange, l'interaction : toute parole vraie doit être dialogue dans l'idée que le dialogue tricote à son tour le savoir, produit au niveau du groupe (cf. les fameux « TPE ») voire de la classe tout entière. C'est du moins l'utopie de ce discours, sa volonté acharnée de produire dans le réel un savoir au moyen du travail collaboratif. Démarche progressiste composant un curieux mélange d’idéalisme (croire que ça va marcher) et d’empirisme (le courage d’essayer), à la fois relativement efficace et profondément vaine tant il est vrai qu’aucun sujet ne peut y retrouver vraiment son désir et encore moins y trouver sa voie (sauf à s'en détacher). Comme un analyste Que vient faire le discours de l'analyse dans un dispositif enseignant ? Inversant radicalement le discours du maître, ce discours met en position d'agent cet objet très précieux qu'est le silence de l'analyste (ici le professeur), incarnation de la pulsion, dans la mesure où seul il rend possible la parole de l'autre, l'émergence d'un signifiant maître de la part du patient (ou de l'élève) après des années de cure. Si au mieux l’analysant peut s’approprier ses propres signifiants maîtres et apprendre à s’en arranger autrement pour changer le cours de sa vie, l’on attend de l’élève qu’il pose enfin ses propres questions, celles qui lui tiennent à cœur, et non plus les questions/réponses téléguidées du maître hystérisant qui lui tient lieu de prof... Au mieux, que lui vienne le trait d'esprit libérateur, l'énoncé (S1) propre à relancer son désir de savoir. Tel est le véritable objectif, la promotion attendue, le véritable objet de jouissance. Pour y parvenir l’enseignant « comme un analyste » aura donné à l'autre la possibilité d'une élaboration subjective qui soit réellement écriture. Le silence initial présuppose évidemment le savoir supposé (voire l'oeuvre) de l'enseignant. Le silence est le meilleur auxiliaire de l'enseignant, toujours sous-estimé, sous-employé, le plus difficile à manier également. Mais c'est dans le silence que la pensée a lieu – le silence partagé, pas uniquement celui des élèves, dont « rare » en un sens – et c’est dans la coupure interprétante que la signification émerge. Il faut bien que le maître se taise aussi pour que l'élève écrive : d'où l'importance concrètement que celui-ci puisse griffonner librement pendant le cours. L’écriture collective est une option à privilégier car il ne faudrait pas confondre subjectivité et individualisme. Ce discours de l'analyste n'a pas vocation à devenir un « modèle » pour l'enseignant, puisque la tâche de ce dernier n'est plus privée mais bien sociale et même publique. Un professeur qui ne miserait que sur les vertus du silence, ou bien qui confondrait l'activité de l'autre (élèves) avec une participation orale désordonnée ou « libre » (comme le sont les associations verbales en cure), ne transmettrait pas grand-chose, de fait, et ne permettrait guère à l’élève de produire du consistant. Ce discours est salutaire, profondément subversif par rapport aux trois autres, mais il ne résout rien au plan pédagogique et n'apporte aucun savoir objectif. Mais il est bon que l'enseignant se souvienne qu'il doit se taire de temps en temps pour qu'un désir d'échange puisse naître ! Ecartèlement et mobilité L'enseignant n'est lié à aucun discours particulier, même si par tradition ou préjugé l'on voudrait lui coller celui de la maîtrise, et surtout celui de l’université. Sa place théorique se tient donc au croisement des quatre principaux discours, tout en sachant que cette « place » logiquement et structurellement n’existe pas, et surtout ne fait pas centre (malgré son placement au centre, sur notre schéma, illusion de l'espace-plan). Plus précisément l'enseignant est amené à circuler d'un discours à l'autre en fonction des circonstances, des objectifs, et de la déontologie qui lui commande de mener un travail à la fois le plus consistant et le plus équitable. Il est possible d’utiliser les quatre discours sans adhérer à aucun, par ailleurs sans y être pris de tournis dès lors que l’enseignant acquiert justement une pratique suffisante (mais sans-maîtrise) des discours pour pouvoir en jouer. Ce qui ne fait pas de lui un être cynique et sans éthique ; c’est tout le contraire dès lors qu’il est capable de distinguer l’ordre imaginaire du discours et l’ordre du réel. Une fois ce « dispositif de mobilité » (dirons-nous) installé et intégré, sa marge de manœuvre, sa liberté pédagogique et son efficacité s’en trouvent alors décuplées. Exemple du professeur de philosophie (voir le détail de notre schéma). Nous attendons tout à la fois de l'élève qu'il ECOUTE (le maître), qu'il LISE les textes d'auteurs, qu'il prenne la PAROLE pour répondre aux questions du prof, enfin qu'il ECRIVE ses propres textes philosophiques ; selon que nous mettons l'accent plutôt sur telle ou telle tâche, nous nous définissons en tant que professeur comme adepte de tel ou tel discours. Sauf, comme il est requis; si nous considèrons que les 4 activités sont également nécessaires et complémentaires, dans ce cas c'est au professeur de changer de posture et donc de discours opportunément, en fonction du type de public auquel il s'adresse ou tout simplement en fonction des taches assignées (TD, cours, etc.), en bref il aura besoin de faire preuve d'agilité et de mobilité. Il est encore possible d'établir des correspondances entre ces quatre discours et les quatre capacités (ou compétences) requises pour l'acte de philosopher (à condition d'y ajouter une 4è comme on va le voir) : CONCEPTUALISER et ultimement théoriser sera prioritairement le fait du discours du maître (fétichisant l'Idée), ARGUMENTER ou raisonner sera le propre de l'universitaire enchainant les références aux thèses d'auteurs, PROBLEMATISER ou questionner restera le propre du discours de l'hystérique, fétichisant la question, tandis que INTERPRETER à l'aide de métaphores créatrices de sens sera le privilège du discours de l'analyste (cette compétence est requise dès lors qu'une touche de subjectivité et d'originalité est recherchée dans le discours, évidemment non sans risques, surtout de la part d'un étudiant). S'agissant de conduire une leçon où il faut analyser finement des concepts, formuler avec rigueur une problématique, le discours du maître conserve quelques avantages. On peut aussi considérer qu'il n'est pas le plus prometteur ni le plus efficace sur le long terme. Quand il s'agit de confronter les élèves à la difficile lecture des textes, rien ne vaut une certaine érudition et l'ostentatoire obligeance du professeur lui-même à l'égard des textes qu'il s'agit de mettre en valeur. Reconnaissons toutefois que ce n'est pas la finalité de l'enseignement secondaire. Lorsqu'il s'agit de mettre les élèves au travail autour d'exercices et de travaux dirigés, c'est bien le discours de l'hystérique, le discours pédagogiste qui tirera le mieux son épingle du jeu. Enfin il ne faudrait pas oublier que la finalité de l'enseignement est l'enseigné lui-même, non directement comme le « sujet » (la relation enseignante n’est pas à ce point prétentieuse et folle) mais comme faculté d'énoncé du sens et d'en jouir, à l'occasion (jouis-sens). De ce point de vue c'est bien le discours de l'analyste qui est le plus à même de guider l'enseignant dans sa pédagogie, ce qui pour autant ne fait pas de ce dernier un substitut du « psy » ! Résistance au capitalisme et enseignement Allons plus loin. Selon nous, le discours mais aussi bien le savoir-faire enseignants ont à voir avec un certain esprit « ludique » (même si le métier est sérieux et la tâche essentielle) fait de souplesse et d’inventivité, incluant évidemment un rapport décomplexé et créatif à l’égard des nouvelles technologies et du numérique. C’est la conséquence de la mobilité même et du décentrement de ce discours enseignant tel que nous l’avons analysé. Nous convergerions vers une nouvelle formulation plus précise et surtout moins ambiguë, moins synonyme de libre arbitre ou de « n’importe quoi », de cette fameuse « liberté pédagogique » que les enseignants (surtout en philosophie) ont toujours plus ou moins revendiquée par principe. Le fait d’en clarifier le concept pourrait justement ouvrir à des possibilités concrètes de réalisation. Pourtant le contexte idéologique, les conditions politiques et les cadres institutionnels d’une telle mise en œuvre demeurent pour le moins d’une grande opacité. D’où qu’elles viennent, qu’elles soient « pédagogistes » ou « réactionnaires », les « nouvelles » dispositions en matière d’enseignement semblent toujours commanditées par le discours de la science et revêtent au moins une grande cohérence politique. Ne sont-elles pas perfidement imposées par une époque et un « système » qui a bouleversé, voire perverti, jusqu’à l’ordre même des discours ? Dans cette dernière hypothèse, comment faire pour que les vertus de créativité, d’adaptabilité, de mobilité etc. – rien d’autre que « libérales » au fond, et d’ailleurs vantées par nos gouvernements successifs - ne se réduisent pas à une pure soumission des enseignants au discours politique dominant (néolibéral) mais au contraire puissent être porteuses d’indépendance sinon même être en mesure de lui résister ? L’enjeu est d’importance, car il ne suffit pas de déboulonner l’enseignant d’un statut de maître devenu mythique (voire celui de respectable fonctionnaire, comme on y pousse à droite) si c’est pour le livrer à la fluctuation et à l’insécurité constitutives des marchés, à la folie du discours publicitaire, soit à terme une nouvelle forme d’esclavage. Rappelons encore qu’il n’y a pas de « discours enseignant » à proprement parler qui formerait un 5ème discours spécifique et indépendant ; de par sa mission l’enseignant a plutôt à composer avec l’ensemble des discours existants, puisqu’il ne se reconnait dans aucun d’entre eux. Surtout, il n’a plus guère le choix depuis que le discours capitaliste a quelque peu brouillé les cartes. Le discours capitaliste professant que tout est possible, que rien n’est impossible (il y a toujours une application et un produit pour ceci ou pour cela), a désarrimé l’ordre du discours de tout réel, où par contre il y a de l’impossible. Par incidence, il a rendu les professeurs impuissants et rendu leur tâche concrètement de moins en moins possible. Qu’est-ce alors que ce « discours capitaliste », ajouté par Lacan sur le tard contre toute attente ? Lacan avait dû repérer la dé-légitimisation progressive des autres discours sous l’effet de la mondialisation et la généralisation du capitalisme, l’installation d’un type de discours hégémonique où prévaut l’imaginaire du sans-limite (à l’opposé mais complémentaire de l’imaginaire du tout-sphérique de l’antiquité). Le sans-limite de la jouissance. Comme on le voit sur le schéma, ce discours inverse le premier rapport S1/Sujet du discours du maître, de sorte que la circulation peut désormais s’opérer dans tous les sens, y compris entre la vérité et l’objet produit, rendant possible la réalisation du fantasme dans le monde (puisqu’il n’y a plus de frontière repérable entre le symbolique, l’imaginaire et le réel), légitimant la fétichisation de la marchandise, etc., pendant que le Capital régnant en Maître ne se nomme même plus comme tel, se retire dans l’anonymat du sans-Autre, se normalise… Ce qui est produit, c’est donc une généralisation du semblant, et à titre de symptôme social une mobilité littéralement affolante des pseudo-sujets à travers ce qui reste des discours constitués. L’enseignement, dans ce contexte, persiste et signe, mais il n’échappe pas à au mouvement. L’enseignant conserve toutefois cet avantage d’en connaître un bout en matière de discours, au moins autant que les nouveaux rhéteurs publicistes. L’enseignement reste le symptôme social d’une certaine impuissance, ce qui est quand même signe de vie. Qu’est-ce qui est encore possible ? A l’heure du capitalisme post-moderne, l’enseignement ne peut que s’installer dans le semblant des discours, en opérant sur et avec le semblant, seule façon de ne pas en être dupe. En réajustant par exemple le ludique vers le pédagogique… mais ce n’est qu’une piste possible. Le « discours de l’enseignant » est le seul à pouvoir tenir tête au semblant généralisé du discours capitaliste, et à espérer l’infléchir, un peu. Personne ne peut prétendre le renverser, mais lui reprendre l’essentiel - se désaliéner de son idéologie - reste envisageable. Si les enseignants ne mènent pas ce combat auprès des jeunes et avec eux, ce travail de résistance, qui le fera ? Certainement pas les psychanalystes qui n’ont affaire qu’à des sujets individuels. Ce n’est pas la vocation du discours analytique (qui n’est de toute façon qu’un discours à deux/trois) que d’affronter le capitalisme, même si l’invention de la psychanalyse est contemporaine de l’émergence du discours capitaliste, ou plutôt de sa généralisation. Cependant il faut reconnaître qu’il est le seul à en fournir les moyens théoriques (paradoxalement induits de sa pratique), c’est-à-dire nommément le seul à faire cas du sujet. Didier Moulinier

|
Scooped by
dm
December 19, 2024 4:03 AM
|
« Je pense donc je suis »
À juste titre, l’on ramène souvent la conscience au phénomène de la pensée prise au sens le plus large. Descartes (qui n’emploie pas directement le mot « conscience », mais « ego » et « cogito ») assimile clairement pensée et connaissance. “Par le nom de pensée j’entends ce qui est tellement en nous que nous en avons immédiatement connaissance” (Principes de la philosophie). La pensée est dite « réfléchie » ou « réflexive » car, contrairement à la simple perception externe (nous ne pouvons pas nous voir en train de voir), dès que nous pensons à quelque chose, immédiatement, nous savons que nous le pensons… Locke : “Lorsque nous voyons, que nous entendons, que nous flairons, que nous goûtons, que nous sentons, que nous méditons, ou que nous voulons quelque chose, nous le connaissons à mesure que nous le faisons” et Spinoza : “Dès qu’on sait quelque chose, on sait par-là même qu’on le sait, et en même temps on sait qu’on sait qu’on sait et ainsi à l’infini.” Pour Descartes également, toute pensée est consciente, et toute conscience n’est faite que de pensée. Mais Descartes va plus loin, non content de montrer que la pensée suffit à se saisir elle-même, il montre que le sujet, dans l’acte de penser, se saisit lui-même dans son existence et dans son essence (sa nature propre) : "Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser" (Discours de la méthode). Autrement dit il se « connaît ». Il sait qu’il est avant tout un être pensant, une âme. C’est évident car seule cette vérité, “je pense”, peut résister au doute « méthodique » (= progressif) que Descartes met en place dans son Discours de la méthode (et différemment dans les Méditations métaphysiques) : même si je m’imagine que le monde matériel n’est qu’une vaste illusion, y compris mon propre corps, même si les notions le plus simples de la science sont des fictions, je peux tout nier sauf finalement le fait que j’existe …puisque je pense et que je doute. L'existence de ma pensée dubitative est la preuve de mon existence comme être pensant : "Je pense donc je suis." Descartes expose de manière raisonnée et philosophique ce que nous avons exposé dans un premier temps comme un savoir intuitif : je sais que j'existe et je sais que je suis moi. D'abord, une certitude. – « Je pense donc je suis » n’est qu’une apparente déduction (malgré le « donc »), c’est plutôt une intuition immédiate - et pour chacun, une certitude. C’est pourquoi on ne saurait dire de la même manière et dans le même sens «j e marche donc je suis » : certes, pour marcher, il faut être, c’est logique, et pour penser il faut être aussi, c’est encore logique. Mais le fait de marcher n’est pas une activité personnelle comme le fait de penser ; et surtout ce n'est pas une certitude aussi évidente : je puis avoir l’illusion de marcher ou bien marcher artificiellement, ou bien ne pas marcher du tout. En revanche, comment avoir l’illusion de penser, d'une part, et de penser moi-même d'autre part ? Si je pense, je sais que c’est bien moi qui pense, car personne ne peut penser à ma place ! Et puis ce n’est pas le fait de marcher (ou de respirer, ou autre) qui me renseigne sur moi-même, sur mon identité, sur ma nature profonde… mais c’est bien plutôt le fait de penser. Qu’est-ce que je suis, donc ? - Je suis un homme, un être pensant. Rappelons que Descartes distingue deux « substances » chez l’homme : l’âme et le corps, plus une troisième combinant les deux, l’union de l’âme et du corps, qui serait le siège des passions et des émotions. L’homme est l’union d’une âme et d’un corps, mais le pôle essentiel de cette nature humaine est bien l’âme, c’est-dire la pensée. Cette notion de « substance », rappelons-nous qu’elle renvoie à l’ancienne définition du « sujet » (subjectum latin, hupokeimenon grec). J'existe, donc Dieu existe ! Cela peut paraître étrange mais c’est l’une des conséquences majeures du cogito selon Descartes. Considérant que la pensée est immatérielle, et n’imaginant nullement qu’elle puisse être produite par des processus physico-chimiques (comment l’aurait-on su, au 17è siècle ?), Descartes rejoint logiquement la thèse chrétienne selon laquelle l’âme, cette « chose pensante », doit être immortelle et de nature divine. Donc si la première vérité est que j’existe, la seconde doit être que Dieu existe. Enfin, ce n’est pas pour s’« amuser » que Descartes s’est livré à cette petite « expérience de pensée » qu’est le cogito. Les enjeux sont considérables au 17è siècle, à la fois sur le plan épistémologique (la connaissance, les sciences) et sur le plan moral, d’affirmer la puissance et l’autonomie de la pensée humaine (à part le fait que Dieu est son créateur et source de toute vérité). Il faut montrer à de nombreux sceptiques et autant de conservateurs religieux que la pensée humaine peut découvrir les lois (physiques) de ce monde. Il faut montrer aussi que la vraie et la seule morale découle de la pensée consciente, laquelle n’est pas différente de la raison. Penser et surtout bien penser, c’est une question de morale, mieux, une affaire de dignité comme le confirme Blaise Pascal dans ce texte célèbre : « Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai point d’avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends. La grandeur de l’homme est grande en ce qu’il se connaît misérable ; un arbre ne se connaît pas misérable. C’est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c’est être grand que de connaître qu’on est misérable. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser ; une vapeur, une goutte d'eau, suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. » (Pascal, 1670, Pensées) Bilan. Avec Descartes, pour la première fois dans le cadre d’une démarche philosophique assumée, la conscience réfléchit sur son existence et se pose elle-même comme sujet. Oui, de ce point de vue, indéniablement, la conscience parvient à la connaissance de soi. Mais, bien que fondamentale cette « connaissance de soi » (= je sais que j’existe et que je suis d’abord une âme) dont nous parle Descartes paraît pour l’instant bien abstraite et bien vide ! Pour valider une quelconque connaissance de soi, il faudrait paradoxalement la relativiser, et pour cela peut-être distinguer plusieurs formes de conscience… C'est à cette tâche que t'attèlera notamment un philosophe comme Emmanuel Kant. dm

|
Scooped by
dm
December 16, 2024 5:58 PM
|
L'identification imaginaire ou le stade du miroir
La conscience du moi individuel n’est nullement évidente ni surtout immédiate. Elle est le résultat d’un processus d’identification qui intervient dans l’enfance, que les psychologues connaissent bien et que nous pouvons scinder en deux phases successives : une identification imaginaire et une identification logique ou linguistique. Concentrons-nous aujourd'hui sur la première identification, baptisée « stade du miroir » par le psychologue suisse Henri Wallon ; elle concerne le processus par lequel le jeune enfant, dès l'âge de 6 mois (environ), parvient à la reconnaissance de sa propre image, de sa propre forme corporelle. En effet, aux premiers âges de la vie, l’enfant ne perçoit distinctement que des fragments de son corps, puisque à aucun moment il n’a pu se contempler dans un miroir. Il le peut évidemment grâce à un adulte qui le porte, cependant avant un certain degré de maturité psychologique et cognitive, une telle image sera vue mais elle ne sera pas perçue, c’est-à-dire reconnue : c’est ce qui se passe avec la plupart des animaux qui, placés devant un miroir, soit font mine de ne rien voir soit se comportent comme s’ils étaient face à des congénères, à des autres. Or un beau jour il advient que, porté par l’adulte qui s’avère être sa mère ou son père - lequel exhibe fièrement sa progéniture devant le miroir et lui témoigne ostensiblement le plus vif intérêt –l’enfant va sourire au miroir, ou plutôt en souriant au regard de l’adulte qui le porte va du même coup sourire à sa propre image et donc se reconnaître. Puissance de l’analogie : comment ne pourrait-ce pas être lui, ce petit être regardé à la fois par l’adulte depuis le miroir et par lui-même depuis le réel ? On comprend bien que sans la participation de l’autre, ici de l’adulte, sans l’attestation qu’il apporte, et à la condition expresse qu’il se montre bienveillant (sourire), qu’il lui fasse signe et/ou qu’il lui parle (on peut imaginer les conséquences psychiques graves, dans le cas contraire où c’est le « mauvais œil », ou le mutisme de l’autre, qui est rencontré !), aucune identification ne pourrait avoir lieu : l’enfant, tout seul face au miroir ne serait pas plus avancé qu'un animal, il ne pourrait pas se reconnaître. Paradoxalement, il faut donc être deux au départ pour que le Un de l’identification soit fonctionnel. Mieux : « je » me vois d’abord tel que je suis vu par l’autre, c’est-à-dire (espérons-le) « bien vu », valorisé, grandi. C’est ce qui explique cette jubilation et ces éclats de rire, de l’enfant face au miroir, qui ne cesseront plus… On lui dit qu’il est beau ! Il est ravi, littéralement conquis par sa propre image. Ce phénomène est à l’origine du narcissisme imaginaire, littéralement la fascination pour sa propre image. Voir le mythe de Narcisse. C’est le psychanalyste français Jacques Lacan qui a révélé toute cette dimension narcissique du « stade du miroir ». Mais il ajoute une dimension supplémentaire qui s'avère décisive : au-delà des deux protagonistes réels nouant ainsi un lien imaginaire, se tient une instance proprement symbolique, qui est celle du langage : car l'adulte parle dans ces moments-là, on l'a dit, et l'enfant babille ou rit. Ces parole sont signifiantes, valorisantes, et surtout elles s'adressent à lui de manière indubitable. Le “stade du miroir” nous apprend déjà trois vérités fondamentales concernant le Sujet ou la subjectivité, et même la conscience : 1) “Je” n’existerais pas sans autrui, autrement dit l’altérité est la condition de l’identité, 2) le “moi” qui se construit dès la petite enfance est en grande partie imaginaire et narcissique, c’est-à-dire (déjà !) rempli d’illusions sur lui-même, 3) la “conscience” elle-même doit composer d’emblée avec une bonne part d’inconscient, puisque cette incidence d’autrui ainsi que l’aspect narcissique-imaginaire de l’identification se font à l’insu du sujet, autant d’incidences dont il ne retrouvera jamais la mémoire. dm
|


 Your new post is loading...
Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Your new post is loading...