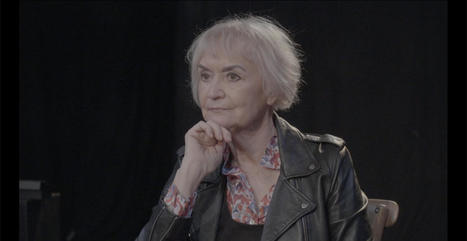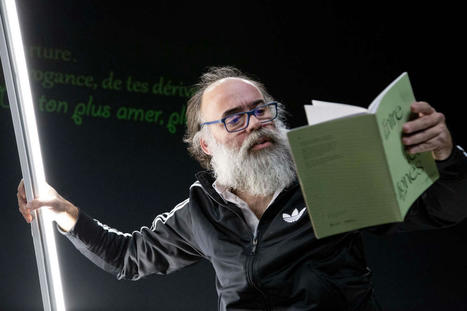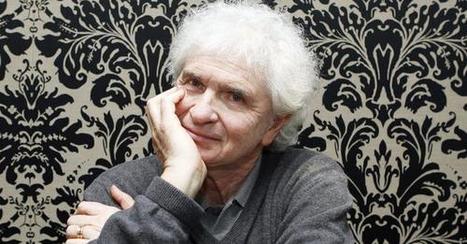Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 4, 2023 4:10 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 24 mars 2023 Dans la grande salle de La Scala Paris se joue «En attendant Godot », magnifique mise en scène par Alain Françon de la pièce phare de Beckett dans sa version ultime. Dans la petite salle, le maître Françon nous convie à un rendez-vous plus intime avec « Premier amour » (1946), œuvre de jeunesse du génie irlandais fortement autobiographique. Pour incarner le narrateur de cette nouvelle, aussi insolente que déroutante, il a joué d'audace en sollicitant une femme : une grande dame du théâtre, Dominique Valadié, son épouse.
La comédienne surdouée campe avec brio cet homme en bout de course, trouvant la paix dans les cimetières, qui se remémore le seul amour fugace de son existence, vécu à l'âge de 25 ans. Cheveux ramassés en chignon, vêtue d'un ensemble noir austère, l'actrice donne un supplément d'ironie et de diablerie à cet antihéros misogyne et misanthrope, qui fuit la compagnie des vivants. Chaque mot, prononcé avec une clarté gourmande, provoque le rire ou le trouble.
Les flèches du jeune Beckett piquent l'esprit sans discontinuer. Dominique Valadié incarne, au-delà du genre, l'homme universel, terrassé autant qu'amusé, voire enivré par l'absurdité du monde. Jamais évanescente, elle confère une dimension charnelle, concrète à ce monologue mêlant souvenirs - la mort du père, l'éviction de la maison familiale, la rencontre avec la jeune femme « tenace » sur un banc, son installation chez elle, puis sa fuite - et réflexions débridées, tour à tour prosaïques et philosophiques. Absence au monde Badine dans les séquences provocatrices, acides, morbides et scatologiques du texte, la comédienne nous cueille à froid quand elle exprime avec une fulgurante gravité l'absence au monde de son personnage. Semblant s'être échappée de toutes les passions, elle s'embrase, soudain rattrapée par l'émotion, quand elle évoque la splendeur de la montagne aperçue par la fenêtre ou qu'elle décrit la rupture déchirante avec la femme trop peu aimée, alors qu'elle vient d'accoucher de leur enfant. Silhouette élégante se détachant sur une discrète toile bleu gris, Dominique Valadié concilie tous les contraires d'un texte qui oscille entre désir de mort et chant de vie, burlesque et tragédie, soif et absence d'amour. Econome de ses gestes elle surfe sur le fil d'une insoutenable légèreté. Ce soir, à La Scala Paris, Beckett est une femme. PREMIER AMOUR de Samuel Beckett Réalisation de Dominique Valadié et Alain Françon La Scala Paris, lascala-paris.fr jusqu'au 19 avril durée : 1 h 15 Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Dominique Valadié se plongeant dans la lecture de « Premier amour » (@ Thomas O'Brien)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2023 11:48 AM
|
Par Samuel Gleyze-Esteban dans L'Œil d'Olivier - 15 mars 2023
Franck Manzoni commence dans le public, harangue quelques spectateurs attrapés au hasard. Son discours est indéchiffrable, labile. C’est le début d’une plongée dans les tréfonds d’un cerveau tourmenté. Écrit avec l’aide de Simon Delgrange à partir d’un matériau autobiographique, sa propre épreuve de père confronté à l’épilepsie aggravée de sa fille Garance, Et pourtant, il gardait sa tête parfaitement immobile se déploie comme un objet à entrées multiples.
L’acteur évolue comme à l’intérieur d’un espace mental, parmi des formes abstraites et massives sculptées dans le bois. Le personnage de quasi-fou perdu dans son monologue intérieur est l’un des quatre avatars du comédien aux côtés d’un détective, d’un médecin et d’un méditant. Le coauteur, metteur en scène et interprète approche son sujet à la manière d’un pointilliste, faisant converger quatre régimes de parole autour des ténèbres du cerveau révélées par la maladie de Garance. Sont mis dos à dos les paroles fatalement pragmatiques d’un neurologue mettant une famille face au dilemme de l’intervention chirurgicale, avec sa cruelle balance bénéfice-risque, et le témoignage d’un homme qui, face à ces angoisses, trouve l’apaisement dans la méditation, à l’instar de Manzoni lui-même.
Physique et terrien, le comédien de la bande de Catherine Marnas, saisit dès les premières minutes et tient la scène avec une puissance indéniable et presque autant d’humour. Solitaire, cette composition est néanmoins peuplée par la composition du jeune musicien Balthazar Monge, intégré au dispositif scénique, et les sculptures à caractère du plasticien spiritualiste Jean-Jacques Enjalbert. Et si l’on peut s’égarer dans les limbes de ce labyrinthe mental, où sont mis en regard le cerveau tourmenté d’un père et celui, souffrant, d’une fille, cette création, pensée pour le studio du TnBA, n’en offre pas moins un terreau fertile à de multiples interprétations.
Samuel Gleyze-Esteban – Envoyé spécial à Bordeaux Et pourtant, il gardait sa tête parfaitement immobile de Franck Manzoni
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine
Place Renaudel
33000 Bordeaux
Du 2 au 11 mars 2023
Durée 1h30
Direction d’acteur Faustine Tournan
Création sonore Balthazar Monge
Création lumière Anna Tubiana
Œuvres Jean-Jacques Enjalbert
Avec Franck Manzoni et Balthazar Monge, musicien
Crédit photos ©Pierre Planchenault

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 22, 2023 5:35 AM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 21 février 2023 Appels d’urgence, écriture Agnès Marietta, mIse en scène Heidi-Eva Clavier, création lumière Philippe Lagrue, interprète Coco Felgeirolles. Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03. Appels d’urgence est un projet né de l’envie de l’autrice Agnès Marietta d’écrire pour Coco Felgeirolles, travail en trio avec Heidi-Eva Clavier, depuis l’intime sur « l’obsolescence d’une mère par sa famille ». Interviews, échanges, à travers l’expérience de l’actrice, entre fiction et réalité. Mme Waller, professeure de latin dans les sixties surgit de la mémoire de la comédienne: brillante et intransigeante et d’une aura sûre pour les élèves – un texte en aller-retour sur les deux figures. La metteuse en scène dit « opérer ce tissage entre réalité et fiction et comme les couturières, retirer tous les faux-fils pour qu’à la fin, il soit impossible de distinguer l’actrice du personnage ». En exergue au spectacle de Heidi-Eva Clavier, Appels d’urgence, écrit par Agnès Marietta interprété par Coco Felgeirolles, une jolie phrase de La Voyageuse de nuit de Laure Adler, qui se penche sur la vieillesse : « Je ne veux pas me croire jeune, mais je ne veux pas que la société m’ôte, en raison de mon âge, ce sentiment de la continuité de soi qui nous permet d’exister » Le Seule en scène de Coco Felgeirolles aborde les contrées d’un âge de la vie qui avance, toute proportion gardée, car sur le plateau, l’interprète mordante a toujours son mot à dire – vivacité. Depuis le plateau, elle accueille le public, regrettant tout haut qu’il ne prenne suffisamment la peine de regarder les photos d’elle-même, à tous les âges, de l’enfance au présent, exposées un peu en vrac sur les murs de la salle ou collées sur le sol de l’avant-scène. Un peu bougonne, et comme sur le fil du rasoir, elle souligne avec humour et ironie le léger retard des derniers spectateurs. Ella a quelque chose à confier au public de la salle, ces autres « elle-même » – honnêteté et vérité. Cette femme libre remonte le fil de sa vie, au rythme de l’apparition désordonnée des nouvelles technologies – ordinateurs, écrans, internet, i-phones, messages sms, mails et réseaux sociaux. S’impose, inéluctable, l’ère du numérique qui a bousculé les vies, comme s’il n’y paraissait rien. « Je me souviens de l’arrivée du répondeur Certes ça prenait les messages quand on était absents Formidable Mais encore plus formidable Ça nous permettait de filtrer les appels Et de décrocher en fonction de qui appelait Ma mère râlait « Tu es là je sais que tu es là réponds » je répondais encore moins j’appelais le lendemain Maman j’étais au cinéma A dix heures du matin ? t’as été voir quoi Elle n’était pas dupe Je ne lui répondais pas parce que sinon j’en avais pour des heures. » Après les modifications successives des comportements, les petits arrangements quotidiens, s’ensuivent des petits heurts personnels, des difficultés d’adaptation, de réactualisation à des temps autres – leur terminologie nouvelle -, et de soutien quémandé auprès des plus jeunes, obtenu ou pas: « Les réseaux sociaux façonnent la vie en fonction de celui qui va la recevoir : l’ubiquité, être ici et ailleurs en même temps, être là et pas là pareillement ». Méthodes et stratégies de survie pour le moins avouables et défendables, nécessaires à soi : « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange » Le monde entier me dérange, répète celle qui se penche sur la qualité de toute existence intime. « On a tous fait ça Poser le téléphone et partir dans une autre pièce Moi en tout cas je l’ai fait Aujourd’hui c’est mon tour J’ai atteint l’âge d’être filtrée Mise en attente Posée là et parler toute seule dans le vide Je deviens une obligation Mais la réciproque est vraie C’est ça que j’ai envie de leur dire à mes enfants Et pas que à mes enfants, moi aussi le monde entier me dérange. » Constat d’une époque, retour sur une existence – réflexion et jeu – qui poursuit son cours bien vivant, l’interprète incisive répond avec facétie à une société oublieuse qui a tôt fait de séparer jeunes et vieux : elle prend sa télécommande et danse, l’accessoire à la main – ses bras levés dessinent une gestuelle expressive, loufoque et libératrice -, face une TV qui ne la soumettra pas. Elle refuse le mot de certains qui la caractériserait : « malaisante », comme si elle était coupable. Perfecto sur le dos, l’élégante et moqueuse Coco Felgeirolles ne s’en laisse pas conter, attentive aux jours qui passent, elle s’amuse de ces petits bouleversements imposés – puis surpassés – par la technologie et les repères nouveaux d’une société qui se métamorphose et qui met à mal le sentiment d’être, l’échange avec l’autre, la vraie présence, ce contre quoi elle œuvre via le théâtre. Véronique Hotte Du 19 février au 29 mars 2023, relâche exceptionnelle le 28 février, dimanche 20h, lundi, mardi, mercredi 21h, au Théâtre La Manufacture des Abbesses 7 Rue Véron, 75018 Paris. Tél : 01 42 33 42 03.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 30, 2022 7:29 PM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog - 27 nov. 2022 C’est en fond de cale d’une péniche amarrée sur le canal de l’Ourcq à Paris qu’Yves-Noël Genod enterre sa vie artistique débutée avec Claude Régy et achevée à la Pop. Prononçant lui-même une oraison funèbre qui emprunte autant à Marguerite Duras qu’à Sylvie Vartan, il fait de « TITANIC, hélas » un vibrant hommage à la scène, beau et triste à la fois, drôle et mélancolique, à son image. Drôle d’endroit pour un adieu. Une fois passé la porte de la péniche la Pop[1] amarrée sur le bassin de la Villette, le spectateur entre de plain-pied dans la salle de spectacle. À l’intérieur, Yves-Noël Genod joue les hôtes de maison, embrasse les amis, salut les inconnus, offre çà et là une coupe de champagne. Le spectacle va bientôt commencer, ou plutôt la mise en bière. Quoi de mieux qu’un fond de cale pour un enterrement ? En l’occurrence celui de la carrière artistique de l’une des figures les plus singulières de la scène française. La sonnerie d’un téléphone portable retentit, laissant entendre une mélodie dont seuls les plus de cinquante ans se souviennent, la chanson d’un amour qui s’achève interprétée en 1976 par une Américaine à Paris. Le jeune homme au téléphone murmure tout d’abord puis se lève pour mieux entonner la rupture, en ressentir la douleur, espérer la dernière étreinte : « Faisons l’amour avant de nous dire adieu ». Derrière lui, une femme âgée, déjà au seuil de sa vie, enfile une robe rouge sang qu’elle assortit de talons aiguilles de même couleur. Une apparition, un fantôme, l’incarnation de la vie dans ce qu’elle a de plus précaire : la brièveté des corps, et de plus beau : la fragilité. La beauté contemporaine est immuablement éphémère. Le prologue s’achève alors que ce couple improbable, sorte d’Harold et Maud du bassin de la Villette incarnant deux temps fondamentaux de la vie, la promesse et le souvenir, deux âges de l’être humain, quitte une scène accidentée par de petites saillies formant tranchées, des trappes qui, si elles ne sont pas laissées béantes sont néanmoins entrouvertes de façon à créer un parcours en relief, comme semé d’embuches, à la surface de ce fond de cale, telle une ligne de vie scarifiée par les affres qu’elle a traversée. « Avant de nous dire adieu » Assis parmi les spectateurs, Yves-Noël Genod esquisse un signe de croix, geste assurément culturel qui n’en est pas moins religieux pour autant, avant d’entamer la longue litanie des raisons qui le conduisent à mettre un terme à sa carrière. S’il se dit en pleine forme, il n’a « depuis quelque temps, plus assez de commandes et surtout pas assez de public pour continuer[2] ». Le temps est venu de la reconversion. « Après tout, j’avais formé des gens, j’avais eu — moi aussi — mon petit conservatoire de Mireille — où pas mal de monde était passé… » rappelle-t-il en introduction. Genod joue sur la figure archétypale du dépassement de l’artiste par de plus jeunes, avouant : « Je suis une grande actrice. Mais un peu d’une autre époque ». Comme toujours chez l’artiste, l’humour se mélange à la poésie et aux sanglots longs. Chacune de ses performances théâtrales est un manifeste. « TITANIC, hélas » n’échappe pas à la règle, interrogeant ici la signification de la création artistique dans un monde au bord du naufrage, un monde où les salles de spectacles ne font plus recette. Faire ses adieux à la scène sur la Seine (ou presque), il fallait oser. À la fois metteur en scène, chorégraphe, comédien, performeur et auteur sans doute le plus prolifique des arts vivants en France – il a plus d’une centaine de spectacles à son actif –, Yves-Noël Genod se forme à l’école d’Antoine Vitez à Chaillot et fut d’abord interprète de Claude Régy pour qui écrire était à la fois « parler et se taire[3] » – le maître aimait à travailler sur les contrastes –, et demandait « aux interprètes d’être au niveau, d’à la fois parler et s’taire, à la fois vivants et morts », et de François Tanguy au Théâtre du Radeau. La pratique du Contact improvisation[4](CI) le fait doucement dévier vers la danse. En juin 2003 lors du festival Let’s Dance au Lieu Unique à Nantes, répondant à l’invitation du chorégraphe Loïc Touzé, il signe son premier spectacle. Simplement intitulé « En attendant Genod », il prend pour modèle le Stand-Up anglo-saxon. Le succès de ce premier spectacle en appelle d’autres. Depuis cette date, il met en scène tous ses spectacles dont les formes hybrides dénotent une certaine résistance aux catégories. Yves-Noël Genod déborde des cases. « J’ai abusé du temps, et à présent le temps abuse de moi » La performance repose sur le texte, lui-même construit par collage de citations plus ou moins célèbres, plus ou moins déformées, évoquant le théâtre, la scène. « Ce spectacle est un jeu de ‘samples’ souvent non référencés » écrit Yves-Noël Genod dans la feuille de salle. Il cite ainsi pêlemêle Vladimir Jankélévitch et Barbara, Emmanuele Coccia et Stéphane Mallarmé, Marcel Proust et Florence Foresti, reprend la fascinante prédiction de fin du monde que Marguerite Duras nous adresse depuis 1986 : « Maintenant on pourrait presque enseigner aux enfants dans les écoles comment la planète va mourir, non pas comme une probabilité mais comme l'histoire du futur[5] ». Duras avait raison : « Le capitalisme a fait son choix : plutôt ça que de perdre son règne[6] ». Il prend soin cependant de rappeler que dans la fin du monde il y a aussi la fin de soi, et que si ce thème a été et est si populaire, c’est parce qu’il représente un pas supplémentaire vers notre propre mort. « Dieu merci, notre art ne dure pas » se rassure-t-il, empruntant la formule à Peter Brook. Il est plus proche cependant de la pensée de Madeleine Renaud pour qui le théâtre est du côté de la vie, pas de la mort. Il assume sa mélancolie, affirmant que « la mélancolie, c’est le bonheur d’être triste », mais peine à raconter des blagues belges, avouant lui-même son incapacité à en imiter l’accent. Côté avenir, il annonce, sans même y croire, sa reconversion dans le commerce de bouche, formulant le souhait d’ouvrir une boucherie dans les Cévennes, hésitant encore à la spécialiser : bio ou chevaline. « Sylvie Guillem, il paraît qu’elle élève des ânes. Ça, ça me plairait… » dit-il rêveur. Il s’adresse au public venu ce soir-là en nombre : « Pendant des années, vous m’avez permis de vivre ». Si le désir est intact, les commanditaires sont de moins en moins présents. Peut-être redeviendra-t-il interprète comme avant. Lui qui a été « conçu pour enchanter les foules trois cent soixante-cinq jours par an » préfère se retirer. « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce ! » Qu’on se rassure, chaque spectacle d’Yves-Noël Genod est unique et, par conséquent, le dernier, et les prochains n’échapperont pas à ce protocole sans protocole. Soyons sûrs que l’artiste fera ses adieux pendant bien des années encore. C’est bien là tout le mal qu’on lui souhaite. « Le passé ne m’intéresse pas, ne m’intéresse que le présent et un tout petit peu l’avenir ». dit-il, faisant siennes, à nouveau, des paroles de Madeleine Renaud. C’est bien à cet endroit que se situe la grâce, dans l’instant T, le moment présent, ce qui est en train de se faire et qui n’est déjà plus. Telle une épiphanie, « être déplacé par l’autre ». Yves-Noël Genod avait promis du rire et des larmes. La réapparition des fantômes qui avaient ouverts le bal des adieux annonce déjà la fin du spectacle. Que la fête commence. [1] Incubateur artistique et citoyen installé sur une péniche du bassin de la Villette, la Pop ouvre au public en 2016. Structure de production, lieu de résidence, de recherche et d’expérimentation, espace de création multidisciplinaires, elle interroge les rôles et fonctions que jouent la musique et les sons pour l’individu, les communautés, la société ou les écosystèmes. [2] Le texte TITANIC, hélas est disponible à la lecture dans son intégralité sur blog de l’artiste Le Dispariteur, http://ledispariteur.blogspot.com/2022/11/t-exte-de-titanic-helas.html?m=1 Consulté le 27 novembre 2022. [3] « Le maître soumet son auditoire à l'écoute, à la patience. Ponctuant de ses commentaires chaque fragment du poème de Vessas lu par les stagiaires, il instille, entre autres principes, que « le sens apparent n'est pas intéressant », que « seul compte le non-exprimé, le poétique », qu’« il faut faire entendre la multiplicité, les sens contraires ». Bref, qu’il ne faut pas lire, mais rêver en lisant et remplacer la passivité par l'activité » ou, en d'autres termes, « qu'il faut lire et écouter en même temps ». Dans ce contexte, se taire ou parler constitue un travail identique pour l'acteur : c'est ici la première leçon », Virginie Lachaise, « Claude Régy : une leçon de maître », Jeu, n°129, 2008, pp. 72–76. [4] Champ de recherche par le mouvement initié par le chorégraphe et danseur américain Steve Paxon à partir de 1972 qui en donne la définition suivante : « Ce n’était pas de la lutte, une forme d’étreinte, du sexe, de la danse sociale, pourtant c’était en partie un peu de tout cela. Il fallait trouver un nom (…). Contact Improvisation… ? », Steve Paxton, Nouvelles de danse N°38-39, 1999, p.113. [5] Marguerite Duras. « Tchernobyl, une mort géniale. Entretien avec Gilles Costaz », Le Matin, 4 juin 1986. [6] Ibid. TITANIC, hélas - Conception Yves-Noël Genod. Interprétation Aymen Bouchou, Mariella Mounnie et Yves-Noël Genod. Son Benoît Pelé. Scénographie et lumière Philippe Gladieu. Production Le Dispariteur. Coproduction La Pop Du 25 au 27 novembre 2022. La Pop
Face au 61, quai de la Seine, Bassin de la Villette
75 019 Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2022 11:38 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 20 nov. 2022 En une heure dense et dansante, le comédien Fitzgerald Berthon nous plonge dans une évocation profonde du destin de celui qui fut condamné à mort pour avoir tué un gardien de la paix et découvrit Dieu, le Christ et la Vierge Marie en prison. Il y a quelque chose d’impardonnable dans le comportement de Jacques Fesch, fils de famille indolent qui préféra fréquenter Saint-Germain-des-Prés plutôt que d’aller jusqu’au bac. Il y a quelque chose d’impardonnable et d’ailleurs la société de son temps ne lui pardonna rien puisqu’il fut condamné à mort, au temps de la guillotine, pour avoir, après une tentative de vol à main armée, abattu un policier, le 25 février 1954, dans le quartier de la Bourse, à Paris. Jacques Fesch trouva la foi en prison. Il eut des guides. A commencer par son avocat, homme qui avait dû renoncer à sa vérité de conscience et de désir, et qui savait ce qu’était la souffrance. Jacques Fesch affronta la vérité de son caractère et de sa fatale sortie de route, dans l’enfermement particulièrement cruel des prisons de son temps. Ce blouson doré solitaire, qui trouva tout de même un ami pour l’accompagner dans sa tentative de braquage -ce dernier tenta au dernier moment de trouver des aides pour convaincre la tête brûlée de renoncer à son projet- est devenu, au fil du temps, un modèle, un homme de foi qui éclaire l’Eglise à tel point que son procès en béatification a été ouvert. Ne racontons pas ici toute la vie de Jacques Fesch : le spectacle a ceci de puissant qu’il est assez clair pour que les personnes qui ne connaîtraient rien de cette vie, en saisissent assez. Pour ce moment intitulé Dans 5 heures, plus simple serait difficile : une table, une chaise, au sol un rectangle délimité par un trait blanc, des lumières, des voix off, du son, de la musique. On est à fleur de plateau dans le petit espace du Théâtre La Flèche, rue de Charonne, au fond d’une cour très séduisante. Le public, nombreux, semble acquis à la cause et du « héros » et du spectacle. Mais l’on n’est ni au catéchisme, ni dans une entreprise d’animation culturelle. Il s’agit bien de théâtre et de théâtre puissant. Lumières et son, signés Vincent Hoppe, voix off d’Eric Devillers et de Maxime d’Aboville, regard pour la danse, Jann Gallois, regard pour le théâtre, collaboration artistique, Vincent Joncquez. Toute une équipe pour que Fitzgerald Berthon puisse incarner, de toutes ses fibres et avec audace, rigueur, sincérité, ce parcours bouleversant. Il y a donc de la danse dans cette évocation. Une danse très expressive, une danse de combat en même temps. Et puis le récit, les pensées. C’est en puisant dans les écrits de prison de Jacques Fesch que Fitzgerald Berthon a mis au point le texte. Voix bien placée, regard proche puisque la salle est petite, se déplaçant, d’abord dans les limites du rectangle tracé au sol, puis suivant l’extérieur, comme s’il retrouvait la liberté avec la foi, il impose, par-delà sa personnalité athlétique, l’homme Fesch, mais d’abord ses questions, ses errements, sa découverte d’un sens à la vie, au destin. Un moment bref, d’une heure à peine, mais fort et d’une haute qualité d’intelligence et de sensibilité. Jacques Fesch était né le 6 avril 1930, à Saint-Germain-en-Laye. Il mourut le 25 février 1954. « Dans 5 heures », « Conversion d’un condamné », d’après les écrits de prison de Jacques Fesch, par Fitzgerald Berthon. Jusqu’en février. Les samedis à 19h00. Durée : 1h00. A La Flêche Théâtre, 77 rue de Charonne, 75011 Paris. Tél : 01 40 09 70 40. Les écrits de Jacques Fesch sont disponibles à l’issue des représentations. Armelle Héliot Légende photo : Dans la solitude de la cellule, un homme va être transfiguré. La Flèche. Photographie de Christophe Raynaud de Lage. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 27, 2022 9:37 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 21 octobre 2022 Frêle et pudique, il incarne le père imaginé par Antonio Tarantino dans Vêpres de la Vierge bienheureuse, dans une mise en scène sobre et sensible de Jean-Yves Ruf. C’est Olivier Cruveiller et Paul Minthe qui avaient fait connaître à Jean-Yves Ruf La Passion selon Jean d’Antonio Tarantino, texte traduit par Jean-Paul Manganaro et publié aux Solitaires Intempestifs. Ils créèrent le spectacle vers 2010. L’écrivain, d’abord connu comme plasticien, peintre, sculpteur, s’était mis tardivement à l’écriture dramatique. A plus de cinquante ans. Sa manière de transcrire, en d’étranges textes irrigués d’une culture chrétienne, mais puisant ses racines dans les vieux fonds mythologiques méditerranéens, sa passion pour les humbles, sa manière ferme d’affronter les réalités de la société, lui valurent une reconnaissance immédiate et de nombreux prix prestigieux. Les artistes et le public l’aimeront toujours. Né le 10 avril 1938, à Bolzano, dans le nord-est de l’Italie, Antonio Tarantino s’est éteint le 21 avril 2020. Partout célébré, traduit, il avait pourtant été rattrapé par la pauvreté, comme s’il avait rejoint ses « personnages » -mais il avait reçu une aide de l’Etat… Un être à part, une âme forte. Aujourd’hui, on peut donc découvrir Vêpres de la Vierge bienheureuse. Dans la petite salle du Rond-Point, salle Roland-Topor, dans une proximité émouvante avec l’unique interprète, l’interprète unique qu’est Paul Minthe. Un banc et une urne funéraire. On comprend que l’homme, avec son pantalon qui plisse sur ses talons, son chapeau vissé sur la tête, attend le bus qui le ramènera vers la gare. L’urne est celle des cendres de son fils. Il avait fui sa famille. A Milan, il a basculé : travesti, prostitué, malheureux. Il a fini par se suicider. Tardivement, son père se reprend. Il le comprend, il le célèbre. Dans le monologue de cet homme frêle comme un enfant, les voix de la mère, les voix des voisins, pointent parfois. Le texte est difficile parfois, à cause de ces ruptures peu marquées. Jean-Yves Ruf dirige avec tact, intelligence, tendresse, le comédien et donne à entendre ces étranges « vêpres ». Le père ne se justifie de rien. Il lui a fallu le temps de la séparation pour comprendre son enfant. A la fin, il lui donne des conseils. Surtout ne pas se séparer de sa belle robe rouge, ni de ses cothurnes : ainsi sera-t-il accepté dans l’au-delà. Celui des Grecs. Car c’est là qu’il a sa place, une fois traversé le Styx redoutable… La ferveur contenue, la voix tendre, la douceur et la grâce de Paul Minthe, sont magnifiques. Tout, ici, bouleverse. Mais sans démonstration aucune. Un art très fin préside à la représentation. Armelle Héliot Théâtre du Rond-Point, à 20h30 du mardi au samedi, dimanche à 15h30. Durée : 1h15. Jusqu’au 30 octobre. Tél : 01 44 95 98 21. Texte aux Solitaires Intempestifs. www.theatredurondpoint.fr Légende photo : Paul Minthe dans la mise en scène de Jean-Yves Ruf - Crédit Photo © Alban van Hassenhove Autre critique de Christine Friedel publiée dans Théâtre du blog : Un petit homme frêle porte sur son bras, très simplement, comme un bouquet de fleurs embarrassant ou un enfant tenu avec une certaine maladresse, l’urne contenant les cendres de son fils. C’est l’histoire d’un éloignement, d’une séparation, entre un pas-grand-chose de père et un fils inquiet, différent et qui se fera travesti à Milan. Il faudra son suicide par noyade pour que le père remonte le courant et, faute de le ramener à la maison, l’accompagne enfin. Il parle de sa propre vie, pas reluisante, faite de bagarres et traîneries de bistrot, avec des copains qui ne valent pas mieux que lui. Traversant son récit, la voix de la femme, de la mère, en colère contre ce propre à rien incapable d’apporter une lire à la maison, sinon fauchée en douce.
Et puis on entend celle du fils, douloureuse. Et c’est comme si ces voix transformaient l’homme. Elles font de lui le « psychopompe », le tendre accompagnateur de l’âme de son fils jusqu’au cœur de la mort. Ta robe de fille, tes talons hauts ? Oui, garde-les, glorieux, cela t’ouvrira une priorité chez les morts. Tu pourra te payer le passage du Styx. Et les anges battent des ailes, apaisants….
Antonio Tarantino, récemment disparu comme on dit, mais très présent par son théâtre, était aussi peintre et sculpteur. On est tenté de déchiffrer dans son écriture cette pratique d’artiste : il écrit comme on peint au couteau, avec de la matière, posée en gestes larges ou par petites touches. Cela donne une langue heurtée, bizarre, dérobée, avec des trous– rendons un hommage particulier au traducteur, Jean-Paul Manganaro- et pas commode à lire.
En compensation, cette langue donne beaucoup au théâtre, au personnage comme au comédien. Double effet : ce collage, ces accidents permettent aux différentes voix qui traversent ces Vêpres de se faire entendre, et au spectateur de suivre de mieux en mieux le chemin que fait dans sa tête ce père pas intéressant, à l’en croire.
On dira que c’est le principe même de l’écriture théâtrale, mais Tarantino en joue, dans ce flux interrompu, avec une force particulière.
Cette langue de théâtre unique permet de passer à l’état brut du social, au très intime, et du très intime, au spirituel. Tout en permettant au public de faire la synthèse des émotions ressenties. Grandissant son fils dans la mort, le père accède lui-même à une dignité et devient la « mater dolorosa » consolatrice « bienheureuse » de cette mort réconciliée. Passion selon Jean est le premier texte d’Antonio Tarantino que Paul Minthe a apporté à Jean-Yves Ruf, en 2008. Avec Olivier Cruveiller, il lui en avait fait entendre une lecture. Car il faut l’entendre, il faut l’effort des comédiens, leur présence physique pour que cette écriture prenne sens, avec sa force et sa musicalité. Jean-Yves Ruf est musicien, et, avec Paul Minthe, a réussi l’interprétation parfaite.
Une mise en scène très discrète : le père est debout devant un banc, finit par s’asseoir, avec ce poids lourd sur les bras, épuisé par le chemin parcouru dans sa conscience et ses émotions, mais l’air de rien, comme on attend l’autobus. En réalité, il se passe beaucoup de choses. Acteur et metteur en scène, ensemble creusent de plus en plus profond, sans relâche, dans la vérité du personnage.
Et la vaillance du comédien suit, sans faille, sans lâcher la simplicité de l’ «homme de rien». C’est tout et c’est essentiel. Et sans doute, ce qui produit certains soirs, un si beau silence avant les applaudissements. Le public, lui aussi, est entré dans une émotion et une pensée partagées.
Christine Friedel / Théâtre du blog Jusqu’au 30 octobre, Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin D. Roosevelt, Paris (VIII ème). T. : 01 44 95 98 00. Le texte de la pièce est publié aux Solitaires intempestifs.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 29, 2022 7:34 AM
|
Par Fabienne Darge (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) le 28 septembre 2022
La comédienne et le chorégraphe reprennent le solo d’une intensité exceptionnelle créé en 2008 par Patrice Chéreau sur un des textes les plus forts de l’écrivaine.
« Alors, comment ça va avec La Douleur ? » Dominique Blanc éclate de rire : on lui pose la question tous les jours. Et la réponse est simple : « Très bien ! » Dans la salle de répétition du TNP de Villeurbanne (Rhône), la comédienne rayonne et vibre d’émotion à l’idée de reprendre aujourd’hui ce spectacle créé en 2008 par Patrice Chéreau, avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Dominique Blanc avait tourné pendant quatre ans, de ville en ville et jusqu’au Vietnam et au Japon, ce solo d’une intensité exceptionnelle, créé à partir d’un des textes les plus forts de Marguerite Duras, paru en 1985. L’écrivaine y fait le récit de l’attente insupportable, au printemps 1945, de son mari Robert Antelme, déporté à Dachau, et dont elle ne sait s’il est vivant ou mort. « J’avais toujours rêvé de vivre et de vieillir avec ce spectacle », raconte la comédienne. Et puis Patrice Chéreau est mort, en 2013, Dominique Blanc est entrée dans la troupe de la Comédie-Française, et La Douleur a été mise en sommeil. Lire aussi (en 2011) : Une actrice, une auteure, seules et géniales Mais le désir était toujours là, de reprendre ce spectacle intemporel, de réactiver la rencontre, brûlante, entre la comédienne et le texte. Thierry Thieû Niang a eu envie de jouer le jeu lui aussi, et a rendu cette renaissance possible. C’est lui, grand lecteur de Duras, qui avait mis La Douleur entre les mains de Chéreau et de Dominique Blanc. A l’époque, ils cherchaient des textes pour des lectures en duo. « J’ai commencé à lire Duras très tôt, parce qu’elle me racontait un Vietnam que mon père ne me racontait pas », confie-t-il, avec son sourire lumineux. Lire aussi (en 2011) : Et Dominique Blanc fit capitale « La Douleur » Thierry Thieû Niang, qui avait composé toute la partition corporelle du spectacle, et Dominique Blanc sont donc allés fouiller dans leurs archives personnelles, pour trouver les éléments nécessaires à ce remontage. Il n’existe aucune captation de La Douleur : Chéreau l’avait voulu ainsi, qui estimait que le théâtre enregistré n’avait aucun sens. Mais l’un et l’autre avaient gardé des cahiers et des documents, notes scrupuleuses sur les mouvements du spectacle pour le premier, brochures annotées avec les indications d’interprétation de Chéreau pour la seconde. « Une mémoire du corps » Ni l’un ni l’autre ne se sont posé la question de changer la mise en scène établie par Chéreau. « C’est une forme suffisamment simple, sans âge, pour qu’on puisse la réinvestir et la faire vivre », constate Thierry Thieû Niang. Dominique Blanc a ressorti de ses armoires personnelles le costume qu’elle portait à la création, et qu’elle avait déjà, à l’époque, extrait de son propre vestiaire : un chemisier, une jupe et un manteau qui pourraient être des années 1940 comme d’aujourd’hui ou des années 2000. Quant à la scénographie, elle avait été conçue – de manière assez visionnaire aujourd’hui où l’on commence à réfléchir, pour des raisons écologiques, à la question du transport des décors – comme une base adaptable dans tous les lieux où serait joué La Douleur. Il a donc suffi d’aller chiner parmi les trésors des réserves du TNP pour trouver les chaises et la petite table de bois qui occupent le plateau nu, juste habillé par les lumières en clair-obscur, évocatrices de la guerre, de Gilles Bottacchi. Dominique Blanc, comédienne : « Je retraverse le texte avec ce que je suis aujourd’hui, et avec ce qu’est devenu le monde » L’enjeu, à partir de là, était de « remettre au présent » le texte, indique Dominique Blanc. « Je peux témoigner qu’il existe vraiment une mémoire du corps. Les gestes, les mouvements, tout est revenu, au fil des répétitions. Tout a pu renaître, mais différemment, bien sûr. Je retraverse le texte avec ce que je suis aujourd’hui, et avec ce qu’est devenu le monde. Les six ans que j’ai passés à la Comédie-Française, où l’on joue beaucoup, avec des metteurs en scène très différents, m’ont fait grandir en liberté, en présence. Le travail mené avec Lars Noren sur Poussière, notamment, a beaucoup compté, grâce à la capacité extraordinaire qu’avait cet auteur [disparu en 2021] à plonger dans les replis de l’humain. » Avant même le début des représentations, la comédienne prend conscience que le texte ne résonne pas tout à fait de la même façon de nos jours qu’à la création du spectacle. « La vibration ne peut être que différente. A l’époque, le ressenti était encore très lié à la seconde guerre mondiale, aux traces qu’elle a laissées dans nombre de familles, précise l’actrice. Aujourd’hui, la guerre est à nouveau à nos portes, avec ce qui se passe en Ukraine, et le texte s’est réinscrit dans un présent. On redécouvre Duras, qui a tout pour plaire aux jeunes gens d’aujourd’hui, dans sa manière d’aborder l’amour, la guerre, la solitude et l’attente d’une femme, mais aussi la résistance, la solidarité et le courage. Ce qui est toujours incroyable, chez elle, c’est sa puissance de vie et de désir. Dans La Douleur, elle ne parle que de cela : d’êtres qui ont cette capacité de renaître, de dépasser les atrocités qu’ils ont traversées par leurs forces de vie et d’amour. » La Douleur, de Marguerite Duras. Reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang. Théâtre national populaire de Villeurbanne, jusqu’au 9 octobre. Puis en tournée jusqu’en juin 2023, notamment à Paris, à L’Athénée-Théâtre Louis-Jouvet, du 23 novembre au 11 décembre. Fabienne Darge (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) Légende photo : Dominique Blanc dans « La Douleur », le 15 septembre 2022, au TNP de Villeurbanne (Rhône). SIMON GOSSELIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 8, 2022 7:25 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 8 juin 2022 Le comédien de 39 ans livre un récit d’émancipation intime et drôle, sans être impudique, au Théâtre de la Reine blanche, à Paris.
Comment s’affranchir du diktat de la virilité pour parvenir au bonheur d’être soi ? Résumer ainsi le spectacle de Mickaël Délis, c’est prendre le risque de faire fuir le lecteur (et potentiel spectateur) lassé des questions de genre qui agitent notre époque. Pourtant, ne fuyez pas ! Car Le Premier Sexe, bijou de seul-en-scène introspectif, n’est ni militant ni larmoyant, mais truculent, romanesque et formidablement écrit. Sur la forme, le récit de cette émancipation emprunte des codes archiconnus : sur un plateau sans décor, un seul comédien habillé de noir, avec un tabouret et une craie pour accessoires, interprète de multiples personnages jalonnant une histoire personnelle (parents, amis, enseignants, psy…). Mais, sur le fond, Mickaël Délis, mis en scène avec habileté par Vladimir Perrin, a le don de transformer son parcours de petit garçon, d’adolescent et d’homme en autant d’expériences intimes qui exaltent une quête identitaire universelle. Le résultat est à la fois drôle, touchant et extrêmement sincère, grâce à la capacité de ce comédien d’alterner personnages (dont l’inoubliable professeur d’université résumant à merveille l’essai XY, de l’identité masculine, d’Elisabeth Badinter – Gallimard, 1949 –, mais aussi la mère follement excentrique) et réflexions pour tous sur la manière de se construire et de penser par soi-même. Cette aventure théâtrale – sauvée de nombreuses annulations pour cause de pandémie de Covid-19 – arrive au bon moment pour son auteur. « Ce spectacle aurait été impossible il y a dix ans, car il est non pas une thérapie, mais le fruit d’une thérapie », résume-t-il. Rencontrer Mickaël Délis, c’est faire connaissance avec un homme au faux air de Vincent Dedienne, volubile, souriant et réellement « bien dans [ses] pompes ». A 39 ans, ce « chantre de l’analyse » a eu besoin de ce nécessaire « temps long ». Il lui a permis d’acquérir la confiance d’être, pour la première fois, seul en scène et de « dépasser la colère » des violences vécues par les injonction de la masculinité pour la remplacer par l’humour. « Dans un élan narcissique » La construction de ce spectacle a commencé en 2018. Mickaël Délis a, cette année-là, « carte blanche » au théâtre parisien de La Loge. « Je me suis alors souvenu du choc qu’avait suscité en moi la lecture du Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir. Pourquoi ne pas faire le pendant, Premier Sexe ? », Loin, très loin du pamphlet du même nom écrit par Eric Zemmour. Pour éviter l’écueil didactique et rendre le sujet plus accessible, Mickaël Délis choisit de retenir le déroulé du tome II de l’essai beauvoirien, soit l’expérience vécue, mais en version masculine. Cet ancien étudiant littéraire (hypokhâgne, khâgne, option anglais, troisième cycle de littérature anglo-saxonne) s’est nourri de multiples lectures, de Beauvoir à Despentes, de Welzer-Lang à Olivia Gazalé, etc., et a peaufiné son seul-en-scène sous le regard de son frère jumeau, David Délis, musicien et graphiste. Dans la famille Délis, établie du côté du bassin d’Arcachon, tout le monde est artiste. Père sculpteur et designer, mère céramiste et photographe. « Au départ, je les ai tellement vus galérer que je ne voulais surtout pas être comme eux. Alors j’ai fait des études avec l’idée de devenir enseignant-chercheur », se souvient-il. Mais une petite annonce collée sur un mur, « Devenez star, faites un book », le fait bifurquer, « dans un élan narcissique », dit-il en souriant, de la Sorbonne au conservatoire d’art dramatique du 20e arrondissement de Paris. Une réflexion salutaire, mais sans injonctions, sur la déconstruction des stéréotypes de genre Ses premiers textes sont sélectionnés par le Théâtre du Rond-Point dans le cadre du concours interconservatoires. Mais pas question pour lui d’être un saltimbanque « miséreux ». Artiste multicarte, il multiplie de rémunérateurs films institutionnels et scénarios de publicités qui le mettent à l’abri pour développer ses propres pièces (#Jesuisleprochain) et travailler avec plusieurs compagnies (Théâtre de la Lune, Philippe Person, L’Etoile bleue…). Jusqu’à cette expérience solitaire au théâtre La Loge, qui a convaincu ce fugace chroniqueur de l’émission « C à Vous » sur France 5 de se raconter, de raconter avec panache cet enfant né au milieu d’« hommes pas franchement admirables et de femmes pas souvent admirées », cet ado « toujours pris pour une fille », ce jeune homme qui sent « son corps libre et vivant » sur la musique de Britney Spears. Le Premier Sexe n’est pas un spectacle sur l’homosexualité, mais l’autobiographie d’un homme libéré dont l’histoire peut permettre à chacun de s’identifier dans ce chemin vers l’émancipation. Intelligemment réalisé (rarement une chemise blanche pour simple accessoire aura offert autant de possibilités), terriblement drôle sans être impudique, ce spectacle fait tout simplement du bien et permet une réflexion salutaire, mais sans injonctions, sur la déconstruction des stéréotypes de genre. A ceux que tous ces mots font peur, l’histoire de Mickaël Délis est une belle entrée en matière, généreuse et sans « prise de tête » avec, en prime, un joli geste théâtral. Le Premier Sexe, c’est l’histoire d’un homme qui a beaucoup réfléchi sur ce qu’être un homme veut dire. Le Premier Sexe, ou la grosse arnaque de la virilité, de et avec Mickaël Délis, mise en scène Mickaël Délis et Vladimir Perrin, jusqu’au 18 juin, au Théâtre de la Reine blanche, Paris 18e. Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 29, 2021 9:54 AM
|
par Fabienne Arvers dans Les Inrocks le 26 novembre 2021
“Tout va bien Mademoiselle“ de Marie Rémond - © Giovanni Cittadini
Transformer l’épreuve de la maladie en énergie de vivre, c’est le pari relevé par l’héroïne de ce spectacle adapté du podcast Superhéros/Hélène.
À quoi ça tient un destin, une ligne de vie, les contours d’un combat ? Pour Hélène, ça commence à cinq ans lorsqu’elle attrape un staphylocoque. Non décelé, non soigné. À 16 ans, ses reins ne fonctionnent plus. Commence alors son long parcours de combattante, entre dialyses et greffes de reins successives. L’ironie du sort ? C’est parce qu’Hélène n’a pas été soignée enfant qu’elle découvre adolescente que sa naissance cache un secret de famille jusque-là bien gardé. Mais ne dévoilons rien des révélations faites au cours d’un spectacle qui nous a mis KO debout d’admiration et d’émotions mêlées. Parce que même si l’on connaît Hélène, professionnellement et amicalement, même si l’on savait qu’elle avait réalisé le podcast Superhéros/Hélène avec le journaliste Julien Cernobori et que c’était déjà, pour elle, une façon de mettre des mots sur son expérience, le passage de relais effectué avec Marie Rémond sur un plateau de théâtre se révèle furieusement cathartique. Et cela, que l’on connaisse ou non Hélène, tant l’interprétation qu’en donne l’actrice culmine de fraîcheur, de candeur, d’endurance et d’une détermination sans faille, renvoyant au délicat échafaudage élaboré de l’enfance à l’âge adulte, au rapport singulier qu’on entretient avec la maladie, le deuil, l’amitié, l’amour. >> À lire aussi : Réserver : les spectacles à ne pas manquer en novembre 2021 ! (partie 4) Rien ne vaut la vie “À 17 ans, on m’a dit que j’avais une vie extraordinaire, plus exactement hors de l’ordinaire, indique Hélène Ducharne. Depuis j’ai tenté années après années, de composer le puzzle de cette existence fondée sur un secret de famille. Mes proches m’ont souvent conseillé d’écrire cette histoire. Après plusieurs tentatives, j’ai abandonné. Un jour, autour d’un café, j’ai discuté avec mon ami Julien Cernobori, journaliste à Radio France. Il avait comme projet de raconter, en podcast, des histoires de ‘Super héros du Quotidien’. Je serai le numéro zéro. J’avais trouvé mon vecteur…“ C’est le démarrage de ce podcast qu’on entend en ouverture de Tout va bien Mademoiselle !, le plateau éclairant un appartement chaleureux. Tout le contraire de l’atmosphère aseptisée des hôpitaux où se déroule pourtant une grande partie de son récit. La scénographie est comme le miroir de la personnalité d’Hélène : accueillant et lumineux. Assise à sa table et proposant café sur café à son interlocuteur invisible, Marie Rémond reprend la balle au bond avec une évidence et une légèreté qui va nous chavirer tout au long de la représentation. Une interprétation d’une justesse à couper le souffle qui tient aussi à la relation tissée entre l’actrice et son “personnage“ : “Je rencontre Hélène en 2012 lorsque nous jouons André au théâtre du Rond-Point. Son enthousiasme, son énergie, son implication en font l’une des meilleures attachées de presse que j’ai rencontrée. Nous sympathisons. (…) En juin 2020, après le confinement, Hélène m’appelle, nous nous voyons, elle me parle de l’idée de créer Superhéros sur scène et, pour choisir qui pourrait incarner ce texte, elle me dit qu’elle a pensé à moi, qu’elle y pense depuis longtemps mais n’osait pas m’en parler. On ne peut pas me faire de plus beau cadeau. (…) Sans jamais se départir de son humour et sa joie, elle nous raconte que la vie n’est pas un long fleuve tranquille mais que comme le chante Souchon rien ne vaut la vie…” Par quelle alchimie a–t-elle trouvé le ton juste et l’intonation précise ? Comment a-t-elle mis le doigt sur cette curiosité toujours en éveil, cette absence totale de jugement ou de ressentiment et cette empathie relevant chez Hélène d’une seconde nature ? Dans Le Coût de la vie, Deborah Levy écrit : “Le métier d’acteur est étrange parce qu’il revient à élire domicile à l’intérieur de quelqu’un.” On ne saurait mieux dire. Tout va bien Mademoiselle !, de Julien Cernobori et Hélène Ducharne, d’après Superhéros/Hélène, un podcast. Adaptation et mise en scène Christophe Garcia et Marie Rémond, avec Marie Rémond, jusqu’au 19 décembre au théâtre du Rond-Point.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 22, 2021 6:02 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 21 nov.2021 Jean-Philippe Toussaint a écrit pour le sociétaire de la Comédie-Française, un texte envoûtant, La Disparition du paysage. Aurélien Bory orchestre avec subtilité la représentation, espace et mise en scène, tandis que l’interprète déploie subtilement son grand art.
Dans la nuit de l’espace, on aperçoit quelque chose qui ressemble à un fauteuil roulant. Puis, furtivement, surgissant d’une porte côté jardin, le comédien, dans un trench-coat beige, se glisse jusqu’à ce siège. Comme une respiration, l’image, de lumière et de géométrie, va accompagner toute la représentation. Passant par des moments où l’on peut croire voir des nuages, la mer au loin sans doute, le ciel. Plus tard, le toit d’un bâtiment délabré et même des ouvriers en train de monter un étage supplémentaire en haut du vieux casino d’Ostende. Car nous ne sommes pas perdus, pas largués, pas égarés. L’homme qui s’adresse à nous le sait et nous le dit : il est à Ostende, en convalescence. Il parle même de l’aide-soignante, qui, matin et soir, s’occupe de lui. Mais il aurait oublié, beaucoup. Ici, la lumière d’Arno Veyrat, la musique de Joan Cambon, sont de véritables partenaires de ce livre de l’intranquillité, qui se feuillette pourtant dans une paix crissante comme neige. On suit, au soupir près, le récit de l’homme. La voix particulière, l’articulation précise et le timbre feutré de Denis Podalydès, sa magistrale capacité à donner de l’épaisseur aux écritures, à les rendre sensibles dans l’espace, font ici merveille. Aurélien Bory, artiste qui sait donner corps, fût-il évanescent, à ses intuitions, s’appuie toujours sur les textes, sur l’encre. Il se renouvelle chaque fois. Pas de recette qu’il appliquerait, fort d’un savoir-faire de virtuose. C’est pourquoi il magnifie les propos, leur donne, sans les surligner, une puissance encore plus prenante. On ne pouvait imaginer développement plus beau, plus intelligent. Jean-Philippe Toussaint est un écrivain remarquable. Marqué par l’actualité, la violence de la réalité, il la transmute en une fable mystérieuse et séduisante, un conte noir et cruel. L’homme assis à la fenêtre et qui voit disparaître le paysage, est un « personnage », mais c’est aussi l’écrivain, mais c’est aussi l’interprète, le metteur en scène et scénographe. Il est aussi, d’une certaine manière, l’homme occidental du XXIème siècle, en proie à des bouleversements qu’il tente de comprendre. C’est pourquoi, d’une situation unique, ce ciel d’Ostende, le cercle s’élargit à l’univers. L’interprétation de Denis Podalydès, jusqu’à ses regards que bientôt –car le « personnage » se déplace- on pourra saisir, les modulations de sa voix, les stridences muettes, jusqu’aux explosions finales, grondements sourds et lumières aveuglantes, tout subjugue. C’est un grand moment de haut théâtre, d’art, de littérature. Une heure , comme un souffle qui caresse et emporte loin. De l’autre côté du temps, de l’autre côté de la vie. Rare et magistral. Armelle Héliot Théâtre des Bouffes du Nord, à 20h30 et autres horaires à vérifier. Jusqu’au 27 novembre. Tél : 01 46 07 34 50. Légende photo : Est-ce un homme vaincu ? Un homme qui a traversé la paroi de nacre qui sépare la vie de la mort, la conscience du rêve ? Photographie Aglaé Bory. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 13, 2021 9:18 AM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 13 nov. 2021 La comédienne dit l’un des textes du recueil Feux, celui consacré à la figure de Marie-Madeleine. Pensées audacieuses, écriture puissante, comédienne magnifique. Pas même une heure. Juste le temps de donner corps, sensibilité, puissance à ce texte audacieux d’une Marguerite Yourcenar de 32 ans, se défendant d’une immense aventure d’amour non partagé. Feux, comme feux de l’amour chez Racine. Embrasement, carbonisation. Toutes les figures de Feux, des nouvelles aux allures de poèmes en prose, toutes les figures viennent de l’Antiquité : Phèdre ou Sappho, Antigone, Clytemnestre ou Achille, Patrocle, Phédon. Sauf Marie-Madeleine. « Dans Feux, où je croyais ne faire que glorifier un amour très concret, ou peut-être exorciser celui-ci, l’idôlatrie de l’être aimé s’associe très visiblement à des passions plus abstraites, mais non moins intenses, qui prévalent parfois sur l’obsession sentimentale et charnelle », analysait, des années après la parution du recueil en 1936, l’écrivain des Mémoires d’Hadrien et de L’Oeuvre au noir. Brigitte Catillon explique dans quelles circonstances elle a lu ce texte, alors qu’elle tournait un film, à Jérusalem, dans les années 80. Elle est frappée par cette découverte. Des années plus tard, en 2018, elle propose, au Petit Louvre, à Avignon, une version de Marie Madeleine. Au Poche-Montparnasse, sous le pinceau des lumières très délicates d’Orazio Trotta, avec, comme unique partenaire, la musique, très subtilement présente, de Nicolas Daussy, une musique vivante et vibrante comme les rumeurs de la vie même, Brigitte Catillon, interprète ultra-sensible, présence, beauté, voix très harmonieuse, intelligence de toutes les écritures –elle a tout joué, du plus classique au plus contemporain- donne vie à ce texte très étonnant. Une tunique légère, imprimée dans des tons beiges et dorés, un foulard qui dégage le visage, dans les mêmes couleurs, c’est tout. Un pantalon et des sandales. Tout sonne juste, vrai. La comédienne, remarquable depuis toujours, est ici au cœur de ce qu’elle a souhaité, conçu. Son interprétation est remarquable. Forte personnalité, beauté évidente, Brigitte Catillon laisse toute sa place à l’écriture même de Marguerite Yourcenar. Elle a de la grâce, elle bouge bien, comme une danseuse au port de reine. Marie-Madeleine ? Une jeune femme abandonnée par son jeune époux qui préfère suivre un homme à la parole fascinante, une jeune femme qui se vend, corps mais non pas âme, une jeune femme qui se retrouve auprès du Christ, pour qui elle a été jetée dans le désarroi. Trois voix, ici, en quelque sorte. Marie-Madeleine, le mari, le Christ…Marie-Madeleine répond à des questions que l’on n’entend pas. Il ne faut pas que nous en disions plus car, ici, la plupart des spectateurs –à commencer par nous-même- découvrent ce texte que l’on ne connaissait pas et que nous dévoile le travail plein de tact et de pudeur de Brigitte Catillon. Au Poche, on est dans la proximité. Les regards, les imperceptibles mouvements de l’être, tout impressionne et fait sens. On se dit, bêtement, qu’elle était gonflée, Marguerite Yourcenar ! Un moment de théâtre, de poésie, un texte taillé dans l’étrange pensée d’une jeune femme de 32 ans, amoureuse enflammée qui tente de juguler sa passion mais s’y abandonne. Théâtre de Poche-Montparnasse, salle du haut, chaque dimanche à 17h00 et le lundi à 19h00. Durée : 55 minutes. Tél : 01 45 44 50 21. Texte de Marguerite Yourcenar, Gallimard. Légende photo : Une comédienne dans la simplicité d’une interprétation profonde et bouleversante. Photographie de Laurencine Lot. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 14, 2020 7:05 AM
|
Sur la page de l'émission d'Olivia Gesbert La Grande Table sur France Culture -8/10/2020 La comédienne Valérie Dréville, celle qui a joué avec les plus grands metteurs en scène, se raconte et nous parle de "Danses pour une actrice", une pièce pensée pour elle par le chorégraphe Jérôme Bel pour le Festival d'Automne 2020.
Lien pour écouter l'émission (30 mn)
Depuis bientôt 40 ans, la comédienne Valérie Dréville déploie son art de la métamorphose aux côtés des plus grands metteurs en scène, d'Antoine Vitez à Sylvain Creuzevault, en passant par Claude Régy, disparu le 26 décembre 2019, Thomas Ostermeier, Alain Françon... De ces incarnations auprès de directeurs d'acteurs aussi singuliers que différents, elle retire une énergie vitale. Chacun de ces rôles l'accompagne et lui procure une grande richesse ainsi qu'une diversité d'approches du jeu de comédienne.
Valérie Dréville se considère comme une "éternelle élève". Il s'agit pour elle de faire table rase, de tout remettre en question, comme aux côtés de Claude Régy ou d'Anatoli Vassiliev pour "Médée-Matériau" d'Heiner Müller. De ce rite initiatique, elle tire un ouvrage : " Face à Médée: Journal de répétition" (Actes Sud, 2018).
Avec Claude Régy, il n'y avait pas de chemin tout tracé, c'était l'écoute avant le voir, il nous mettait à l'écoute du silence, à l'écoute des corps, le fait de quitter le corps quotidien. Avant de trouver une forme d'existence, il faut du temps.
(Valérie Dréville).
Fil rouge de son parcours, la quête du dépassement est au coeur de " Danse pour une actrice ", créé aux côtés du chorégraphe Jérôme Bel. Dans le cadre du Festival d'Automne, le spectacle sera présenté du 7 au 16 octobre à la MC93, du 19 au 26 novembre à La Commune, centre dramatique national Aubervilliers, puis en tournée à Valence, au Centre dramatique national Drôme – Ardèche, des 2 au 4 décembre et à Toulouse, au Théâtre Sorano, les 14 et 15 avril 2021. Cette rencontre avec la danse est l'occasion pour Valérie Dréville d'expérimenter un autre rapport au corps par un langage différent de celui du jeu théâtral.
Je pense que ce qui différencie une danseuse d'une actrice, c'est que l'actrice n'a pas de technique, mais qu'elle a une forme de technique qui a à voir avec l'arrivée des émotions, une sorte de connaissance intérieure du chemin qui mène à l'émotion. C'est une forme de mode de vie. Je crois que c'est ça qui intéresse Jérôme Bel : comment une actrice s'empare de la danse avec cette aptitude sur le territoire des émotions, des affects. Je m'en suis rendue compte que dès que je faisais un effort physique intense, la mémoire de mon corps s'activait. Il y a une limite au langage que le corps dépasse.
(Valérie Dréville)
Acquis au mouvement chorégraphique, le corps de la comédienne ne se plie pas pour autant à une abnégation au geste, à son exactitude formelle, telle que l'a incarné la danse classique. La danse est au contraire pour Valérie Dréville une voie de libération, s'inscrivant dans les pas de la danseuse et chorégraphe Isadora Duncan, qui n'a cessé de "danser sa vie".
Je crois que ce qui m'a intéressé avec le travail du corps, c'est le fait d'entrer en contact avec sa vie intérieure, avec son énergie propre. Et l'improvisation est une sorte de rencontre avec l'être profond. (...) Isadora Duncan parle du fait que toutes ces chorégraphies sont sa vie, elle danse sa vie. Alors peut-être que ce spectacle n'est rien d'autre que ma propre vie.
(Valérie Dréville)
À RÉÉCOUTER
33 min
La Grande table idées
Stop à la mégamachine : guide pratique pour éviter l’effondrement
Extraits sonores:
Jérôme Bel / Valérie Dréville "Danse pour une actrice"
Jérôme Bel, France Culture (Hors Champs, 2012)
Boris Charmatz, France Culture (sept. 2020)
Pina Bausch (Les nuits magnétiques, 1990)
Légende photo :Valérie Dréville - "Danse pour une actrice", de Jérome Bel MC93• Crédits : Véronique Ellena

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 9, 2019 5:27 AM
|
Charmeuse, enchanteresse, l’eau de la piscine attire le jeune homme. Telle une maîtresse exigeante, elle l’engloutit, lui pompe, à son corps défendant toute son énergie et le laisse exsangue à côté du bassin. Plongeant dans ses souvenirs d’enfance, le jeune et talentueux Maxime Taffanel conte l’histoire d’une passion et d’un désamour, le récit d’un succès, d’un échec qui par touches construit l’homme en devenir.
Dans la pénombre, une silhouette apparaît. Droite, carrée, elle vacille dans les flots projetés en arrière-plan. La passion est trop forte, dévorante. Les eaux bleues captivent le jeune homme, le font chavirer. Il plonge, se love au creux de cet amour d’adolescent. Rien d’autre ne compte que la natation, la compétition. Obnubilé, obsédé, il se voit déjà sur le podium, remportant la médaille d’or. Sa carrière est déjà toute tracée. Il sera un sportif de haut-niveau.
Athlétique, épaules larges, il est fait pour être nageur. S’entraînant sans relâche, ne comptant pas les heures, il s’épuise. Le succès est au rendez-vous contre toute attente, malgré les quolibets de ses camarades, il décroche la première place. Galvanisé par cette victoire, il se voit déjà comme le nouveau Michael Phelps, son modèle. La vie n’est malheureusement pas aussi simple. À force d’efforts, nageant après une chimère, la « niaque » l’abandonne. Devant son coach dépité par ses résultats de plus en plus médiocres, terriblement lucide, un choix s’offre à lui continuer ou renoncer ?
Avec beaucoup de justesse, Maxime Taffanel s’empare de ce sujet particulier et universel : les ambitions contrariées. Ancien athlète de haut niveau, sa musculature en témoigne, il connaît le sujet. Entre espoir et désillusion, entre joie et amertume, il signe un portrait touchant d’un adolescent qui se cherche, tente, tombe et se relève. Même si on aurait aimé qu’il creuse un peu plus les failles, les doutes de ce jeune homme à l’avenir à réinventer, le comédien captive par sa performance tout en délicatesse et énergie. Porté par la sobre mise en scène de Nelly Pulicani, il se donne à fond et évoque par quelques pas de danse frénétiques, acharnés les sensations de « glisse » qui l’ont toujours poussé à aller toujours plus loin en vain.
Véritable plongée dans le journal intime de cet ado de 16 ans, ses interrogations, ses questionnements, Cent mètres papillon séduit par la fraîcheur candide de son interprète.
par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Avignon
Durée 1h05
Mise en scène de Nelly Pulicani
Sur une idée originale de Maxime Taffanel
Adaptation de Nelly Pulicani
Avec Maxime Taffanel
Création musicale de Maxence Vandevelde
Création lumières de Pascal Noel Conseils
Costumes d’Elsa Bourdin
Production Collectif Colette
Co-production Comédie de Picardie, Amiens
Ce spectacle est accueilli en résidence à la Corpus Fabrique, au Clos Sauvage, au Théâtre de L’Opprimé et au Théâtre de Vanves.
Avec le soutien de la Spedidam Administration Léa Fort Diffusion Scène 2, Séverine André Liebaut
Crédit Photos © Ludo Leleu
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2023 9:32 AM
|
Par Catherine Robert dans La Terrasse - 13 mars 2023 Une femme, à bout de souffle mais jamais de courage, régénérée à chaque déception par le vent du large et l’espoir de l’amour retrouvé : Clémentine Célarié est lumineuse et magistrale en Jeanne. Clémentine Célarié interprète la vie de Jeanne : une vie qui aurait pu être sans histoire, n’était-ce l’amour, même déçu, le génie littéraire de celui qui la raconte et la sincérité de celle qui l’incarne sur scène. Jeanne est trahie par les hommes et trompée par sa naïveté et son inextinguible soif d’affection. Elle est sauvée par la force de la nature et Rosalie la simple, dont le bon sens vient à bout des méchantes sangsues qui ont vidé son cœur. Clémentine Célarié a adapté le texte de Maupassant et s’en empare à la première personne, transformant le récit en confession poignante. Sortie oie blanche du couvent, la jeune fille rencontre le vicomte Julien de Lamare, bellâtre volage, qui la trompe avec la bonne dès le début du mariage, et avec la voisine, Gilberte de Fourville, quand la bonne a été engrossée et renvoyée. L’amour, tué par la pusillanimité du mari, renaît avec la naissance de l’enfant. Mais Paul, dit Poulet, autre sybarite frivole, délaisse sa mère, la ruine et finit dans la débauche. À la fin cependant, paraît la petite fille de Poulet, pour laquelle Jeanne invente l’art d’être grand-mère. « Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ou si mauvais qu’on croit. » conclut Maupassant : c’est avec cette phrase que Clémentine Célarié achève sa fascinante exploration des arcanes d’une âme. Femme océan La scénographie d’Hermann Batz installe Jeanne au bord de la falaise, prête à laisser le désespoir la faire plonger dans la mer. Les lumières de Denis Koransky font apparaître le visage du mari inconstant, la silhouette du château natal adoré, le rougeoiement du couchant et les grilles du confessionnal où Jeanne confie sa peine. La musique de Carl Heibert et Abraham Diallo soutient l’interprétation théâtrale et dialogue avec elle. Avec un très grand talent, la comédienne interprète Jeanne en toutes les étapes de son calvaire, de l’innocence de l’âge tendre à la douleur de l’âge mûr. Elle joue aussi tous les autres rôles de cette passion en forme de chemin de croix avec un vigoureux talent, peuplant, par la voix et le geste, le plateau nu, sur lequel elle virevolte, se tort, irradie, s’abîme et renaît. On dirait l’amour dans Le Banquet : « tour à tour dans la même journée il est florissant, plein de vie, tant que tout abonde chez lui ; puis il s’en va mourant, puis il revit encore, (…) tout ce qu’il acquiert lui échappe sans cesse : de sorte que l’amour n’est jamais ni absolument opulent ni absolument misérable. » La comédienne excelle en jouvencelle et en mère, crinière au vent ou canne à la main, larmes aux yeux et sourire extatique aux lèvres. Elle parvient à transformer le texte de Maupassant remarquablement adapté en un thriller psychologique haletant. Blâme-t-on Jeanne ? La plaint-on ? Moque-t-on sa naïveté ? Peut-être : tout dépend de qui la regarde et qui la juge. Mais Clémentine Célarié réussit brillamment à faire qu’on l’aime. C’est là tout ce que Jeanne demande. Catherine Robert / La Terrasse Une vie
du jeudi 9 mars 2023 au dimanche 30 avril 2023
Théâtre du Petit Saint-Martin
17, rue René-Boulanger, 75010 Paris
Jeudi et vendredi à 19h ou 21h, samedi à 19h ou 16h et 21h, dimanche à 16h. Tél. : 01 42 08 00 32. Durée : 1h30.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2023 11:27 AM
|
par Laurent Schteiner dans le blog "Sur les planches | 22 Fév 2023
La Manufacture des Abbesses nous propose pour l’heure une évocation drôle et réaliste de nos mœurs dans une société envahie par les nouvelles technologies ces dernières années. Ce spectacle subtil traduit, par glissement progressif, l’obsolescence programmée d’une frange de la population en stigmatisant nos comportements inadaptés mais jugés normaux par une société qui se dédouane de ses propres excès. Notre société a subi des mutations sociétales sur la lancée des nouvelles technologies qui ont de facto mis hors champs nos anciens, les reléguant à sa périphérie. Dissonance ou velléité délibérée de marginaliser les anciens, le cadre même de cette société les cannibalise sur l’autel des technologies. Ces nouvelles communications, qui en brisant l’intimité et la sphère privée de chacun, n’ont jamais été aussi exclusives isolant les membres de la société dans une bulle ouatée. Coco Felgeirolles endosse ce vêtement qui sied aux personnes qui n’ont pas réussi à prendre le train de la modernité en marche ou qui se sont refusées à le faire. En déchirant le voile de cette drôle de société, elle incarne une génération qui tente d’adapter, contre toute superficialité dictée par les réseaux sociaux, une logique frappée au coin du bon sens. Mais que faire lorsque la raison et la logique conspirent contre soi. Maniant les paradoxes avec outrance, elle n’hésite pas à développer sa façon de voir son monde à coups de télécommande WII ou encore en manipulant la régie lumière. L’irruption de la technologie, briseuse d’harmonie familiale ou même privée, constitue une atteinte au bonheur. Cette société, qui vrille, dévient incompréhensible à ses yeux et l’enferme de surcroit dans un espace dédié à ceux qui ne peuvent vivre de cette façon. Les situations théâtralisés sont cocasses et expriment l’inanité de nos réflexes quotidiens qui sont mis en lumière et croqués sous la plume de ce trio de femmes. Il convient de saluer, outre la performance de Coco Felgeirolles, le délicat et sensible travail de cette figure qui réunit des souvenirs personnels, de la fiction et une intangible réalité. Saluons à cet effet, l’autrice, Agnès Marietta et la metteuse en scène Heidi-Eva Clavier qui ont uni leur talent à Coco Felgeirolles pour nous proposer un spectacle où la densité et la profondeur sont de tout premier ordre. Laurent Schteiner APPELS D’URGENCE d’Agnès MARIETTA, de Heidi-Eva CLAVIER et de Coco Felgeirolles Mise en scène de Heidi-Eva Clavier avec Coco Felgeirolles Création lumière : Philippe Lagrue Manufacture des Abbesses
7 rue Véron
75018 Paris
www.manufacturedesabbesses.com
Tel : 01 42 33 42 03 Jusqu’au 29 mars 2023 à 21h Tournées :
du 24 au 26 mars 2023 au Festival Les Grands Solistes à Etampes (78)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2022 6:35 PM
|
Par Brigitte Salino dans le Monde - 30 nov. 2022 Dans cette adaptation de la pièce créée en 2013, le nouveau directeur du Festival d’Avignon met en scène son acteur fétiche, Tonan Quito, dans un monologue entre création et réalité.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/30/theatre-entre-les-lignes-ou-les-poupees-russes-de-tiago-rodrigues-entre-present-et-passe_6152388_3246.html?im=259188
La plupart des théâtres à l’italienne de Paris sont dotés de deux salles, une grande, et une petite qui n’existait pas à l’origine. La plus belle est celle de l’Athénée-Louis Jouvet. Voulue par Pierre Bergé, directeur du théâtre de 1977 à 1981, elle a été édifiée avec un raffinement que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Une forme carrée douce, des murs peints en trompe-l’œil, 91 fauteuils : c’est un théâtre intime de rêve, où l’on se rappelle avoir découvert un très bel Aglavaine et Sélysette, de Maeterlinck, mis en scène par Françoise Merle, dans les années 1980. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Tiago Rodrigues : « Quand un artiste dirige le festival d’Avignon, il doit repenser sa façon de travailler » Depuis, on a peu à peu perdu l’habitude d’aller dans la salle Christian-Bérard, en partie parce que l’on n’y accède seulement par un escalier et qu’elle niche haut, sous les combles du théâtre. La nouvelle direction qui a succédé à Patrice Martinet en 2021 – le duo Olivier Poubelle et Olivier Mantei – offre l’occasion de remonter au septième ciel, avec une pièce de Tiago Rodrigues, Entre les lignes, jouée par Tonan Quito. Il est sur scène quand le public prend place. En jogging et baskets, avec une barbe grise bien fournie : l’allure d’un comédien dans une salle de répétition. Sur une table, il y a une machine à café dont il fait usage, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les spectateurs qu’il vient servir dans la salle. Ce n’est pas rien, le café, dans l’histoire de Tonan Quito, et on comprendra vite pourquoi. L’acteur de 46 ans est un compagnon de travail de longue date de Tiago Rodrigues, l’auteur, metteur en scène et nouveau directeur du Festival d’Avignon. Tous deux ont créé Entre les lignes en 2013, à Lisbonne, et l’ont adaptée pour sa présentation à l’Athénée. Plaisir du partage d’histoires La pièce s’articule comme des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Au départ, il y a le projet de l’auteur d’écrire un monologue pour son acteur, à partir d’Œdipe roi, de Sophocle. Mais, comme toujours, nous dit Tonan Quito, Tiago Rodrigues est en retard. Il annonce une date qu’il ne tient pas et ne livre le texte qu’au dernier moment. En attendant, tous deux discutent dans une salle de répétition, en buvant du café. Et voilà que, cette fois, Tiago Rodrigues disparaît. Il ne répond pas au téléphone ou donne des rendez-vous dans un café où il ne vient pas. Jusqu’au jour où il vient, les yeux rougis. Il a un problème de vision, les ophtalmologues essaient de le soigner mais il ne peut pas écrire. Il propose à Tonan Quito que chacun travaille de son côté. Le père de l’acteur possède une bibliothèque qu’il a achetée à un major, au Mozambique. Il n’était pas cultivé, il s’est mis à lire, avec passion. Quand son fils lui parle de ses déboires, son père lui conseille de prendre une version d’Œdipe roi dans sa bibliothèque. Le livre provient du centre pénitentiaire de Lisbonne. Entre les lignes, un détenu a écrit, à la main bien sûr, une lettre à sa mère. Il lui explique pourquoi il a tué son père, sous les mots mêmes d’Œdipe apprenant qu’il a tué son père. L’écriture de Tiago Rodrigues est portée par une simplicité telle que le brio s’efface devant le plaisir Ainsi se noue un dialogue entre hier et aujourd’hui, le geste et le jeu, la création et la réalité. Tiago Rodrigues est un as en la matière. Il sait enchâsser différents niveaux les uns dans les autres, au risque parfois d’en faire un procédé. Mais son écriture est portée par une simplicité telle que le brio s’efface devant le plaisir. Plaisir d’un esprit vif qui jamais ne traite de haut le spectateur et souvent se moque de soi. Plaisir du partage d’histoires sensibles, comme celle d’Entre les lignes, où l’auteur, d’une main alerte, nous guide entre le théâtre et la prison, la santé et la maladie, le meurtre et la vie. Tonan Quito est à son aise dans ce monologue. Joueur, séducteur, il met la salle dans sa poche. Son art d’acteur repose sur une virtuosité discrète, dont il semble lui-même se méfier. Il est là, seul sur scène, et il sert la pièce de Tiago Rodrigues comme il offre le café : naturellement, tel un cadeau à partager. A la fin, il distribue le texte d’Entre les lignes à tous les spectateurs. Entre les lignes, de et mis en scène par Tiago Rodrigues. Avec Tonan Quito. Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet, 2-4, square de l’Opéra-Louis-Jouvet, Paris 9e. Tél. : 01-53-05-19-19. De 22 € à 30 €. Du mardi au samedi, à 20 h 30. Durée : 1 h 20. Jusqu’au 17 décembre. www.athenee-theatre.com/ Brigitte Salino Légende photo : Tonan Quito dans « Entre les lignes », de Tiago Rodrigues, à l’Athénée-Théâtre Louis Jouvet, à Paris, le 22 novembre 2022. MARIANO BARRIENTOS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2022 4:57 PM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 28/11/2022 Icône des marges, génie de l’incongru, l’ancien acteur de Claude Régy et ami de Marguerite Duras tirait, ce week-end, sa révérence dans «Titanic, hélas», sublime stand-up donné sur une péniche dans l’adoration de son public et l’indifférence des «pros». Touché, vraiment coulé ? Il cite Françoise Sagan et les Grosses Têtes avec la même grâce. Pour un peu, il ferait passer du Patrick Timsit pour du Marguerite Duras. Il aime à la fois le chic et le toc. Quand il «reçoit» au théâtre comme d’autres tiennent salon, il sert toujours aux spectateurs du champagne dans des verres en plastoc. N’est-ce pas la moindre des choses quand on est la plus grande actrice de son époque ? Ce week-end, à contrecœur et presque en douce, Yves-Noël Genod faisait ses adieux à la scène, sur la Seine. Dans la cale d’une péniche parisienne, ses fans s’entassaient sous des manteaux, des plaids, et quelques gilets de sauvetage pour entendre son Titanic, hélas (c’est le titre), révérence tirée à une carrière qui prenait l’eau. Tandis que l’artiste disparaissait dans le noir, main dans la main avec une vieille dame au dos voûté, maquillée de fards colorés et gantée jusqu’aux coudes comme les chanteuses de music-hall, le froid et l’émotion faisaient naître de la buée sur les hublots. Que s’est-il donc passé, dans la société, pour qu’on doive se passer des dingueries d’Yves-Noël Genod ? A poil dans les vestiaires Inoubliable pour son petit public d’addicts, tout à fait inconnu pour les autres, l’acteur, metteur en scène, grand accoucheur d’acteurs (mémorables Marlène Saldana ou Jonathan Capdevielle), avance lui-même des hypothèses en ouverture de ce sublime stand-up de fin du monde. Fin d’un monde, en tout cas. Le spectacle prend la forme d’une adresse drôle et mélancolique d’une génération d’artistes à l’autre. Les temps, constate-t-il, ne sont plus «aux p’tits gars» comme lui. Sans amertume, il en prend son parti. Quand Yves-Noël Genod est monté sur Paris pour jouer dans les spectacles de Claude Régy – un metteur en scène mort aujourd’hui, et dit-il, déjà tombé dans l’oubli –, «tous les garçons étaient homos […] La tendance s’est renversée et c’est normal […] mais, moi, je ne suis pas une petite chanteuse lesbienne de vingt ans, bien entendu ; hélas». Nécessairement, aujourd’hui, face à tous ces jeunes «homos déconstruits», comment ne pas apparaître, poursuit-il avec son élégance de grande dame, comme un «vieux naturiste» quand il prend sa douche à poil dans les vestiaires du théâtre, sous les yeux gênés de ses comédiens qui, tous, bien sûr, ont gardé leur slip ? Dans sa bouche, les mots «vieux phoque» ou «grosse gouinasse» brillent du même raffinement qu’un vers de Charles Baudelaire. On ne peut pas dire ça ? Alors on ne peut plus rien dire ? Mais Yves-Noël Genod peut tout dire. D’abord parce qu’on n’est jamais sûr que ses mots soient bien les siens. Titanic est un grand jeu de sample, et n’avance que par citations, une polyphonie de voix où s’enlacent, sans que l’on sache vraiment à qui attribuer quoi, les mots de Florence Foresti et de Michel Houellebecq, de Paul Verlaine et d’Elie Semoun, de Vivienne Westwood et de Luc Plamondon. Jeanne Balibar flanquée d’un dindon Surtout, rôdent ici en fantômes les voix des plus mégalo des divas d’antan, grotesques dans leur besoin de briller, pathétiques dans leur peur panique d’être oubliées. Et Titanic devient alors une déclaration d’amour à leur verve, leur mauvaise foi, leur art de l’enfumage et du bobard, théâtrales névroses qui n’ont jamais été aussi bien servies qu’ici, avec cette silhouette oblongue qui n’appartient qu’à lui : la tronche d’Iggy Pop avec des yeux de Bambi, un charisme d’Aigle noir de Barbara surmonté du petit carré frangé jaune poussin de Mireille Darc, et cette façon de sembler, perpétuellement, étonné de sa propre incongruité. Une autre star des marges, un ami, le décrivait ainsi : «Un mélange de standing Yves Saint Laurent et de Royco minute soupe». Yves-Noël Genod, donc, n’arrive plus à se produire et ne remplit pas les salles. Il s’adapte, il ouvrira une «petite boucherie bio dans les Cévennes». Comprenons aussi les programmateurs, toujours face à un sacré merdier avec lui : l’acteur et metteur en scène n’a jamais voulu créer de structure stable, ne travaille que sur commande et livre des projets jamais normés, sans «action théâtrale» répertoriée, jamais «finis». Les spectacles d’Yves-Noël Genod ont parfois ressemblé à ça : un paysage contemplatif nimbé d’ennui, et soudain, surgissant de l’outrenoir du plateau, Jeanne Balibar dans la brume flanquée d’un dindon. C’était sans doute «invendable» et c’était inouï. Fut un temps pourtant, dans le monde du spectacle vivant, des producteurs irresponsables s’acharnaient à faire place pour pareille bizarrerie. Cette fois, pour la «der des der», Yves-Noël Genod leur facilite la tâche : Titanic dure 1h30 et se pose au parfait carrefour du Jamel Comedy Club et de Claude Régy. Un format parfait pour que ces adieux deviennent un come-back ! Il eut fallu peut-être que l’auteur contacte un peu plus de programmateurs. Au téléphone, Yves-Noël Genod admet qu’il manque peut-être de stratégie mais le pouvoir, dit-il, le «terrifie» : «Je ne sympathise avec les programmateurs qu’une fois qu’ils prennent leur retraite.» Est-il vraiment trop tard pour que les plus jeunes redressent la barre ? Eve Beauvallet / Libération Titanic, hélas d’Yves-Noël était donné à la Péniche POP du 25 au 27 novembre. Légende photo : Le spectacle prend la forme d’une adresse drôle et mélancolique d’une génération d’artistes à l’autre. (Sébastien Dolidon/photo © Sébastien Dolidon)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 17, 2022 9:21 AM
|
Propos recueillis par Guillemette Odicino pour Télérama
Publié le 02/09/22 mis à jour le 07/09/22 Pure tragédienne sur les planches, on l’a vue grave ou drôle au cinéma, chez Sautet, Blier, Bonello ou celui qui l’a fait naître au théâtre, Patrice Chéreau... Seule sur scène, la comédienne reprend avec bonheur “La Douleur”, adapté de Marguerite Duras, son monologue fétiche depuis vingt ans, dans la mise en scène originale de Chéreau. Elle a les yeux de Bette Davis. Et un rire perlé, qui éclate à tout bout de champ pendant l’interview. Qu’on se le dise, Dominique Blanc est une jeune fille de 66 ans rigolote, même si des rôles dramatiques, au cinéma, et surtout au théâtre, en ont fait l’une de nos plus grandes comédiennes, auréolée de quatre Césars et quatre Molières et désormais même au programme du bac 2023 ! Merveilleuse lesbienne libérée dans Milou en Mai, de Louis Malle (1991), gouailleuse môme caoutchouc dans Indochine, de Régis Wargnier (1992), elle reste inoubliable pour son interprétation d’une jalouse -obsessionnelle dans L’Autre, de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic (2008), qui lui valut la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise. Au théâtre, sa carrière est éblouissante, d’Une maison de poupée, d’Ibsen (1998), aux Liaisons dangereuses, jusqu’au récent Angels in America, mis en scène par Arnaud Desplechin à la Comédie-Française, qu’elle a intégrée sur le tard, et en majesté. Sur les planches, c’est avec Chéreau que tout commença, que tout devint d’une intensité sans égale, grâce à une Phèdre mémorable, et La Douleur, adapté de Marguerite Duras, un texte devenu comme une seconde peau, qu’elle reprend au TNP de Villeurbanne à partir du 28 septembre. Cette rentrée est la sienne puisqu’elle sera aussi à l’affiche de L’Origine du mal, le thriller familial et capiteux de Sébastien Marnier (5 octobre), et sur le petit écran dans une série glaçante adaptée d’un roman de Franck Thilliez, Syndrome E. Libre, émue, primesautière, la comédienne se souvient de tout, y compris de drôles de rendez-vous manqués. En fait, la tragédienne est un clown blanc. Vous reprenez La Douleur pour la cinquième fois. Pourquoi au TNP de Villeurbanne, cette fois ?
C’est là que j’ai connu Patrice Chéreau. La boucle est bouclée. Je voulais le faire en amont de 2023 et des dix ans de sa mort. Je serai dirigée par Thierry Thieû Niang, son ami chorégraphe, dans la mise en scène d’origine de Patrice. La Douleur est le texte de ma vie. Pour moi, c’est comme un motif de peinture qui évolue au fil du temps, de mon émotion, de ma technique, de mon parcours de femme, et sur lequel je dois revenir sans cesse. En quoi ce texte vous est-il essentiel ?
Avril 45, l’ouverture des camps de concentration, comment oublier ça ? Comment oublier la Shoah ? Je suis effarée de la façon dont on oublie l’histoire aujourd’hui. Et puis, il y a ce thème théâtral si intense : une femme, seule chez elle, qui attend, qui espère. Comment l’avez-vous découvert ?
En 2003, je joue Phèdre, mis en scène par Patrice. Le climat de répétition a été euphorique, mais jouer à l’Odéon pendant six mois, c’est trop, et j’en sors brisée. D’autant que j’enchaîne avec un rôle d’héroïnomane dans Un couple épatant - Cavale - Après la vie, la trilogie de Lucas Belvaux. Ensuite, je ressens un énorme vide, j’erre d’agent en agent, et je ne reçois aucune proposition. L’homme de ma vie me conseille d’appeler Patrice, qui, me voyant perdue, décide que nous allons nous envoyer des textes et essayer d’inventer quelque chose ensemble. C’est Thierry Thieû Niang qui trouve le texte de Duras. Dès que je le lis, je le sais : ce sera ça et rien d’autre. Je propose à Patrice de me mettre en scène dans un décor minimaliste : juste une femme qui attend, une table, une chaise. La première est prévue en Catalogne dans un tout petit théâtre. Nous partons avec Patrice et Thierry une semaine en avance : répétition tous les après-midi, et tous les soirs, au dîner, Patrice me parle de son enfance. Le samedi de la première arrive, et soudain je panique : je n’y arriverai jamais ! Et je décide de me tirer en douce ! Comme s’il avait deviné, Patrice ne cesse de m’appeler : « Qu’est-ce que tu fais ? Tu es dans ta loge ? Thierry va t’apporter à manger. Tu ne bouges pas, hein ? » Je suis restée, j’ai joué, c’était merveilleux. Ce soir-là, je suis née, à nouveau. Chéreau vous a sauvée ?
Il avait dû réaliser qu’il m’avait un peu abandonnée pendant les représentations de Phèdre. Les Américains lui avaient prêté une grande villa avec une grande piscine en Californie pour écrire un film. Il rêvait de son Napoléon avec Al Pacino. Il était parti et m’avait laissée dans une grande solitude avec Phèdre sur les bras. Avec La Douleur, c’est comme s’il avait réparé son absence. Comment l’avez-vous rencontré ?
Je faisais partie de la première année de Classe libre du cours Florent, avec deux professeurs, Francis Huster et Pierre Romans, un immense pédagogue dont nous étions tous amoureux, les garçons comme les filles. Avec Pierre, nous montons un spectacle sur Tchekhov pendant trois soirs à l’Espace Cardin, et, le premier soir, Chéreau est là. Au mois de septembre 1980, il laisse un message sur mon répondeur et je crois que c’est une blague ! Il me donne rendez-vous chez lui, où, quasiment aussi intimidé que moi, il me propose de jouer plein de petits rôles dans Peer Gynt, d’Ibsen, au TNP de Villeurbanne, avec Maria Casarès, Didier Sandre et Gérard Desarthe. Ce sera une année de rêve : j’ai 25 ans, je me sens plus à l’aise, nous rions beaucoup, et je crois que ça lui plaît, car, déjà, autour de lui, commence le ballet des courtisans. Je n’ai jamais fait partie de sa cour. “Ma professeure m’encourage à présenter le Conservatoire. Mon père décrète que, dans ce cas-là, je peux prendre la porte.” Ni de son école au sein de son théâtre à Nanterre…
Jamais. Pour une raison toute simple : d’après Pierre Romans, Patrice pense à moi pour Les Paravents, de Genet, mais il ne me prendra pas si je présente l’école. Et en effet il m’a appelée pour jouer une petite pute à la fin des Paravents. Puis, à Nanterre, j’enchaîne avec Terre étrangère, sous la direction de Luc Bondy, où je joue la maîtresse de Michel Piccoli. Lors de la première lecture, pour laquelle Luc avait demandé que nous sachions déjà nos textes, Michel tient sa brochure à la main : il n’a pas eu le temps de l’apprendre. Cela m’agace, je lui arrache les feuilles des mains et je les balance ! Michel a adoré mon culot. Dans les coulisses, il vient vers moi : « Dominique, si je fais quoi que ce soit qui vous dérange dans cette scène où nous sommes censés nous toucher, il faut me le dire, car je ne voudrais surtout pas être grossier ou intrusif. » Cet homme était une merveille. Il était l’élégance, l’éthique, l’engagement, l’utopie. Il était mon ami. Quelle petite fille étiez-vous ?
Née à Lyon, numéro quatre d’une famille de cinq enfants. Mon père était gynécologue-obstétricien mais il a fini par arrêter les accouchements car, travaillant jour et nuit à l’hôpital, au dispensaire et en cabinet privé, il allait y laisser sa peau. Un jour, j’ai osé dire que, d’une certaine manière, en tant qu’interprète, moi aussi je mettais au monde des êtres. Il n’a pas aimé cette comparaison ! À quel moment naît l’envie de jouer ?
Ma mère a un amour fou pour le cinéma italien, que nous regardons à la télévision. Les comédiennes italiennes sont à l’origine de ma passion : des tempéraments incroyables, et des physiques si différents, de Sophia Loren à Giulietta Masina, qui semblent dire que tout est possible. À l’adolescence, je suis mal dans ma peau, je me sens différente de mes frères et de ma sœur. Je convaincs ma mère de m’inscrire dans un cours d’art dramatique. “Lorsque vous nettoyez les chiottes à la turque, pour, ensuite monter sur scène dans le rôle d’une reine, ça glousse.” C’est le déclic ?
Rapidement, ma professeure m’encourage à présenter le Conservatoire de Lyon. Mon père décrète que, dans ce cas-là, je peux prendre la porte. C’était violent : une fenêtre de liberté que je n’imaginais même pas s’était entrouverte pour se refermer d’un coup. J’ai passé mon bac scientifique et commencé des études d’architecture. Cent étudiants dont seulement une dizaine de filles et deux Antillais dans une école aux locaux en préfabriqué. Et un prof de géométrie qui déclarait que sa matière était « trop difficile pour les filles et les Noirs ». En deuxième année, pour tenter d’améliorer l’ambiance et les locaux, nous décidons avec des copines de prendre en otage le directeur de l’école. Pardon ?
Absolument ! Mortes de peur, nous sommes entrées dans son bureau, avons fermé à clé, et lui avons signifié sa prise d’otage et nos revendications. Il avait un frigo avec une bouteille de champagne à l’intérieur. Après avoir bu son champagne, nous ne savions plus quoi faire et l’avons relâché assez vite ! Évidemment, nous n’avons obtenu aucune amélioration, et mon dossier pour continuer mes études à Paris n’est jamais arrivé à destination… Mais à Paris, vous tentez le cours Florent ?
Quand je m’y rends pour la première fois, je suis outrageusement maquillée, je porte une jupe à fleurs et de gros sabots et je me retrouve au milieu d’une jeunesse dorée qui passe des scènes pour rigoler. Pour être acceptée, je présente Dans ma maison, de Jacques Prévert, et je suis tellement engagée physiquement dans mon interprétation que les autres élèves sont atterrés ! Mais François Florent trouve ça intéressant. Pour que je me sente plus à l’aise, il me propose de venir aux cours du soir, avec des gens plus âgés. Et, pour pouvoir payer mes cours, je deviens la femme de ménage du Cours. Au bout de six mois, Florent me donne les clés : c’est moi qui ouvre les salles le matin et les ferme le soir. Quelle fierté ! Sauf que lorsque vous nettoyez les chiottes à la turque, pour, ensuite monter sur scène dans le rôle d’une reine, ça glousse… Seul Florent croyait en moi : « Passe les concours, tu ne les auras pas, mais au moins ils verront ta gueule. » En effet, je n’ai ni Conservatoire, ni Rue Blanche, mais j’ai rencontré Chéreau. Lire aussi : Dominique Blanc : “Le seul qui pouvait m’aider à m’en sortir était Patrice Chéreau”44 minutes à regarder À vos débuts, vous avez connu une drôle d’expérience avec Jean-Luc Godard…
Je suis engagée comme figurante dans deux tableaux de Passion [1982]. Pour « Le bain turc », je dois être assise au bord de la piscine et Godard me demande de soupeser mes seins en rythme avec le Requiem de Mozart ! Puis j’apprends que finalement je ne fais plus le tableau de « La jeune fille à l’ombrelle » car il a réalisé que je suis blonde. Je ne veux pas perdre mon cachet. J’ose contester, il finit par céder. J’aurais dû me méfier… Nous sommes le 31 décembre 1980 aux studios de Boulogne, c’est un énorme travelling, j’ai une perruque et un chihuahua dans les bras qui essaie de me mordre le sein. Le directeur de la photographie, Raoul Coutard, derrière la caméra, me crie dessus, et Godard s’y met aussi. Une journée de terreur à la fin de laquelle je dis ma façon de penser à Godard et combien c’est scandaleux de m’avoir maltraitée ainsi. Le lendemain, son assistant m’appelle pour me dire que le maître continue à travailler sur le scénario et qu’il veut que je vienne en Suisse car il écrit pour moi ! J’ai refusé, il ne faut pas exagérer. “La folie des êtres me fascine. L’humain, qu’il soit lumineux ou sombre, m’éblouit.” La 5 octobre, vous serez à l’affiche de L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, dans un rôle de matriarche étrange…
Cette femme a une part de folie, qui s’exprime par le syndrome de Diogène, la collectionnite aiguë. J’ai tenu à avoir des ongles comme des griffes, car, avec Jacques Weber, nous formons un couple de vieux fauves qui va être réveillé par le personnage qu’incarne Laure Calamy. Ils ont tous un grain dans cette famille. La folie des êtres me fascine. L’humain, qu’il soit lumineux ou sombre, m’éblouit. Vous serez aussi bientôt dans la série Syndrome E, sur TF1.
Le rôle est fantastique : cette chirurgienne est une méchante à 400 %. Encore plus folle que la mère de L’Origine du mal ! Comme il est réjouissant d’imaginer un passé, des traumatismes à ce genre de personnage… Pour mon premier jour de tournage, j’étais très concentrée sur le texte, mais la réalisatrice, Laure de Butler, m’a conseillé de prendre du plaisir avant tout, ce qui n’a pas été si courant dans mon parcours de comédienne. C’est-à-dire ?
Très vite, au cinéma, on m’a collé la couleur du tragique. Peut-être à cause de mon premier vrai rôle, l’alcoolique de La Femme de ma vie, de Régis Wargnier [1986]. Ensuite les cinéastes ne m’ont plus vue que comme une femme déprimée ou suicidaire ! Pourtant, juste après, quand je jouais Georgette dans Quelques Jours avec moi, de Claude Sautet [1988], j’étais très rigolote, n’est-ce pas ? Mais vous aimez la tragédie ?
Évidemment ! Je suis fascinée par les destins tragiques. Quand, au début de La Douleur, Marguerite Duras dit que « la douleur est l’une des choses les plus importantes de ma vie », je m’y retrouve. Sans doute parce que j’ai eu tant de mal à m’imposer. J’avais le sentiment qu’il n’y avait pas de place pour moi dans ce métier. À mes débuts, lors d’une audition, le metteur en scène Jacques Rosny m’avait conseillé de m’orienter vers… les arts martiaux ! Et toutes ces réflexions inouïes que j’entendais sur mon physique : on ne sait pas où vous ranger, vous avez un corps de femme sur un visage d’enfant… Et vous entrez à la Comédie-Française en 2016…
La revanche à 60 ans ! Et c’est grâce au Phèdre de Chéreau que j’avais joué treize ans plus tôt avec deux immenses comédiens de la Comédie-Française, Michel Duchaussoy et Éric Ruf, qui restera mon Hippolyte à jamais. Quand le merveilleux Éric est devenu l’administrateur général du Français, il m’a proposé d’intégrer la troupe dans l’Agrippine de Britannicus. Je n’en revenais pas ! Moi qui avais toujours été boudée par les instances officielles et avais tracé ma route toute seule, voilà qu’il m’offrait le collectif, et pas n’importe lequel. “J’espère mourir sur scène. Comme Molière. Ou au moins dans la salle. Mourir entre le réel et le fictif, quoi de plus fabuleux ?” Aviez-vous le trac ?
Je me retrouve dans l’arène avec soixante comédiens en pleine activité. Seule manière de se mettre dans le bain ? Travailler. Seul le travail vous apprend à connaître les gens. Pendant cinq ans, j’ai enchaîné les rôles. La tête dans le guidon. Au cinéma, je n’ai pu tourner que Réparer les vivants [2016], où je jouais un toubib, et Patients [2017], pour Grand Corps Malade, où je jouais… un toubib. Puis, en janvier 2021, vous êtes nommée sociétaire.
J’ai pleuré pendant la cérémonie… Toute la troupe au complet, masquée à cause du Covid, mais qui vous applaudit à tout rompre pendant dix minutes. Bouleversant. Vous sentez-vous sanctuarisée ?
Depuis mon entrée au Français, qui m’a donné une nouvelle visibilité, le cinéma et la télévision semblent me rêver autrement. Et puis, sans le Français, je n’aurais peut-être jamais travaillé avec Christophe Honoré. La vieille marquise de Villeparisis dans Le Côté de Guermantes est si comique ! Ni avec Arnaud Desplechin, que je chassais depuis mon coup de foudre pour son film La Sentinelle [1992]. J’avais traîné dans les restaurants qu’il fréquentait, mais je n’avais jamais osé l’aborder. Avez-vous peur de vieillir ?
J’ai mes premiers cheveux blancs, et mon projet est de les garder. Et personne ne touchera jamais à ma figure. Je suis trop curieuse de savoir quelle tête j’aurai à 80 balais. J’aimerais juste ne pas avoir un goitre à la Balladur ! Que faites-vous quand vous ne jouez pas ?
Je suis… pénible. Si je devais cesser de jouer, je voyagerais. Mais je ne pourrai jamais arrêter. La formule peut paraître pompeuse, mais je ne suis jamais autant moi-même que sur une scène. J’espère y mourir. Comme Molière. Et si ce n’est pas sur scène, au moins que ce soit dans la salle. Mourir entre le réel et le fictif, quoi de plus fabuleux ? De quoi rêvez-vous pour la suite ?
J’aimerais rire. Avec les années, j’ai envie de comique et de burlesque. Travailler avec Roberto Benigni, par exemple. Sortir le clown qui est en moi. Mais, en attendant, avec La Douleur, je ne souffre de rien. Propos recueillis par Guillemette Odicino / Télérama DOMINIQUE BLANC EN QUELQUES DATES
25 avril 1956 Naissance à Lyon.
1986 La Femme de ma vie, de Régis Wargnier, premier grand rôle au cinéma.
1995 L’Allée du roi, téléfilm de Nina Companéez.
1999 Troisième César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Ceux qui m’aiment prendont le train, de Patrice Chéreau.
2001 César de la meilleure actrice pour Stand-by, de Roch Stéphanik.
19 mars 2016 Entrée à la Comédie-Française.
A voir : La Douleur de arguerite Duras, à L'Athénée - Théâtre Louis-Jouvet du 23 novembre au 11 décembre
https://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/la-douleur.htm
Photo Yann Rabanier pour « Télérama »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 3, 2022 3:17 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 3 oct. 2022 Rencontre avec la rabbin et la comédienne Johanna Nizard, qui interprète le texte de la première sur scène, pour un spectacle excessif et iconoclaste qui a permis à son autrice de se détacher de sa fonction religieuse. Et si on inventait qu’Emile Ajar, auteur bien connu de la Vie devant soi et double de Romain Gary, avait eu un fils ? Et si on disait que ce fils, Abraham Ajar, était resté reclus dans une cave ? Et s’il se mettait à nous parler ? Et s’il disait parfois des horreurs tout en interprétant des histoires juives ? C’est avec ce genre d’hypothèse que Delphine Horvilleur a écrit Il n’y a pas de Ajar, d’abord en imaginant que ce serait un homme qui le jouerait, puis en l’offrant à une comédienne, Johanna Nizard. C’est un spectacle excessif qu’on pense détester et qu’on se surprend à aimer, à moins que ce soit l’inverse. Et comme on ne sait plus ce qui l’emporte dans cette météo des sentiments affolés, on va le revoir. Un spectacle «too much» comme dit son instigatrice la rabbin du judaïsme en mouvement et directrice de la rédaction de Tenou’a, Delphine Horvilleur, aussi bien dans sa forme, la tessiture du son un peu trop forte, les lumières qui éblouissent, le propos parfois trop direct autour de la Shoah et le traumatisme qui se lègue chez les humains comme il s’expérimente sur les souris. Mais en permanence, la comédienne Johanna Nizard, qui ne cesse de se métamorphoser à vue, tel un caméléon cher à Romain Gary, stupéfie. Non seulement elle porte le texte, mais elle donne le sentiment qu’on ne l’a jamais ouvert même si on vient de le lire. On a rendu visite à Delphine Horvilleur, Johanna Nizard était là, présence forte, qu’on ne reconnaît pas puisqu’elle est totalement autre sur scène. On est toutes les deux malades, si bien que c’est Delphine Horvilleur qui parle et soigne les divers maux. Avez-vous d’emblée conçu ce texte pour la scène ? Delphine Horvilleur : Oui, je l’ai écrit pour qu’il soit joué, car la question qui m’obsède depuis des décennies est celle de l’interprétation. Bien entendu, elle est le cœur de mon métier de rabbin, qui est d’interpréter les textes sacrés. Mais je n’avais jamais fait l’expérience de l’interprétation théâtrale. Grâce à Johanna Nizard, qui cosigne la mise en scène avec Arnaud Aldigé et incarne ce personnage d’Abraham Ajar, je découvre que le texte interprété a des résonances beaucoup plus vastes que mon intention d’autrice. Si bien que la première fois que j’ai vu le spectacle, j’étais interloquée : «Ce n’est pas moi qui ai écrit ça ! Qu’est-ce qui m’a pris ? Qu’est-ce j’ai fumé ?» Alors que je l’ai tout de même relu, ce manuscrit ! Je l’ai confié à Grasset. Mais sur scène, il prenait une dimension de culot, qu’on appelle en hébreu la chutzpah, que je n’avais pas perçu pendant l’écriture. C’était un choc. Johanna, est-ce que tout texte peut avoir une destinée théâtrale ? Auriez-vous pu prendre un autre écrit de Delphine Horvilleur ? Johanna Nizard : Tout texte peut passer la barre du plateau à partir du moment où on en éprouve la nécessité. On appréhende déjà à la lecture comment on va pouvoir le faire vivre, quelle visée on lui prête. Ce qui m’attire dans l’écriture de Delphine Horvilleur, c’est sa manière d’être charnelle y compris dans ses essais. Dans En tenue d’Eve, elle parle de suc, de trou, de liquide. On n’attend pas forcément cela d’un rabbin. Pour autant, c’est notre rencontre qui a été déterminante. D.H. : C’est la première fois que j’écris un texte dont je ne suis pas la narratrice. Abraham n’est pas tout à fait moi, il outrepasse mes pensées. S’il s’était agi d’adapter au théâtre En tenue d’Eve ou pourquoi pas un sermon, je pourrais donner une conférence ! Le personnage Abraham est dans une colère dans laquelle je ne suis pas, il exagère. Y a-t-il une vertu de l’exagération ? D.H. : Je viens de témoigner en appel au procès de Charlie Hebdo sur la fonction de la caricature, la différence entre le blasphème et la profanation. Je pense qu’on ne grandit que dans la transgression, dans la bordure, dans le too much. Jamais dans la mesure. J.N. : Avec Arnaud Aldigé, on était très vigilants à ce que ce passage des limites ait lieu l’air de rien. D.H. : L’écriture de cette pièce, c’est un geste de rébellion, lié à ma fonction rabbinique, son caractère pesant et parfois liberticide. Je l’ai écrit en réaction au succès de Vivre avec nos morts. J’ai une reconnaissance immense à l’égard des lecteurs qui m’ont expliqué combien ce livre les avait aidés. C’était bouleversant. Ce grand placard dans mon salon est rempli de cartons de courriers, des lettres de trente pages, avec des photos des morts de ceux qui m’écrivent, des récits dont je suis parfois la seule dépositaire. Vivre avec nos morts a permis à beaucoup de parler de leurs morts et leurs deuils. Mais, avec Il n’y a pas de Ajar, j’ai éprouvé le besoin de hurler : je ne suis pas que cette grande prêtresse de l’au-delà. Je suis aussi une adolescente, une sale gosse. Je ne suis pas coincée dans ma fonction rabbinique, cléricale, sacerdotale et je peux aussi écrire d’énormes bêtises. Il fallait que j’écrive quelque chose d’iconoclaste, comme mon personnage Abraham. Evidemment il va trop loin lorsqu’il dit : «On doit tant… à l’Allemagne.» Mais je connais des anciens déportés amis de mes grands-parents qui pourraient faire des blagues de très mauvais goût comme lui. L’un des propos du texte est cependant une critique en règle des dérives engendrées par le concept d’appropriation culturelle… Doit-on être juif pour tenir le monologue d’Abraham Ajar ? D.H. : L’humour juif est évidemment partagé par les non-juifs. C’est un humour de la désespérance. Il n’y a pas besoin d’être juif ni de montrer son pedigree de descendant de la Shoah pour dire ce texte. Le concept d’appropriation culturelle qui consiste à ne pas kidnapper la voix de ceux dont on n’a jamais écouté les récits est tel l’enfer pavé de bons sentiments. Je reste encore traumatisée par Tom Hanks qui a dit cet été «regretter» d’avoir accepté le rôle principal dans Philadelphia du fait qu’il n’est pas homosexuel. Mon amie Tania de Montaigne m’a dit que son roman graphique Noire ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis parce que la dessinatrice est blanche ! Lorsque mon livre Réflexions sur la question antisémite a été traduit en anglais, mon traducteur m’a appelée pour me dire qu’il ne pouvait pas traduire la première phrase, tirée d’une blague, «Pourquoi on n’aime pas les juifs ?», trop offensante. Certains passages d’Il n’y a pas de Ajar ne sont audibles que parce qu’ils sont signés par vous. S’ils étaient dits par Dieudonné, par exemple, ils ne passeraient pas… D.H. : Oui, bien sûr, certains éléments ne tiennent que parce qu’ils sont portés par moi. Quand quelqu’un dit : «Merde à toute croyance», ça a plus d’intérêt s’il est rabbin que journaliste de Charlie Hebdo. La lutte contre les identités assignées consiste toujours à casser ce qu’on attend de vous.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 19, 2022 6:51 PM
|
Par Corinne Denailles dans Webthéâtre - 19 septembre 2022 Entre la vie et la mort Une jeune femme vient d’accoucher. Son bébé, dont les poumons sont insuffisamment développés, est entre la vie et la mort. Une attente insupportable durant laquelle la mère parle dans un flot continu à son enfant, comme pour lui insuffler le désir de vivre, l’aider à déployer les alvéoles pulmonaires pour accueillir l’air et la vie. Cette adresse à sa petite fille l’aide à tromper l’angoisse. Les mots arrivent vite, les idées déboulent, elle n’a pas le temps de trier. Dans l’urgence de la situation elle dresse un portrait du monde qui attend son enfant, dans toutes ses contradictions, ses horreurs et ses beautés, l’absurdité de la société des hommes sans avenir qu’elle devra affronter, mais aussi la chance extraordinaire d’être en vie. L’évocation de désastres planétaires laisse place à la joie des mille premières fois à venir qu’elle égrène dans l’oreille de son petit écureuil (ou suricate, ou castor, etc., c’est selon), comme un hymne à la joie, à la vie. Imaginer les premiers pas, les premiers mots, la première chute, le premier baiser, le premier voyage, etc., c’est projeter l’enfant dans sa future existence et si elle n’entend rien à ce qu’on lui raconte, un jour, elle vivra une de ses premières fois avec une impression de déjà vu, une réminiscence indéfinie. Ainsi de l’ange qui à la naissance efface tout le savoir détenu par le nouveau-né en déposant un baiser au-dessus de sa lèvre supérieure dont cette petite fossette qui nous reste est le témoin.
Romane Bohringer porte le texte tendre, terrible et drôle de Sophie Maurer avec beaucoup d’émotion et de tenue. Dommage que Panchika Vélez n’ait pas fait complètement confiance à l’auteur et à la comédienne qu’elle encombre d’une scénographie malvenue et d’une musique superflue, ce qui ne met nullement en cause le talent du musicien. Etait-il nécessaire de s’adresser à une pseudo-couveuse absente qu’on tente de faire exister au milieu d’un matériel vaguement hospitalier, surligné par la projection d’images de couloir d’hôpital (travaillées avec talent par Mélina Vernant) ? Romane Bohringer a suffisamment de présence et de talent pour se passer de ces artifices. Le spectacle et la métaphore qu’il suggère de l’incertitude d’un monde entre la vie et la mort gagneraient en intensité.
Respire de Sophie Maurer, mise en scène Panchika Velez, avec Romane Borhinger et Bruno Ralle. Scénographie et lumières, Lucas Jimenez. Musique, Baloo Productions. Paris, La Piccola Scala, du jeudi au samedi à 19h30 du 15 septembre au 8 octobre 2022 et du 3 février au 1er avril 2023. Tel : 01 40 03 44 13.
www.lascala-paris.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 10, 2022 3:52 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 10 mai 2022 L’autrice-actrice de «Je suis une fille sans histoire», qu’elle joue à Paris, évoque son passage du livre à la scène et les obstacles rencontrés sur son parcours. Elle est une fille pleine d’histoires et nous fait partager leurs genèses, leurs constructions, ses doutes d’écrivain. Grâce à cette pièce qu’elle a déjà jouée une trentaine de fois, Alice Zeniter s’expose comme actrice pour la première fois. Sur scène, elle nous parle de son plaisir de lectrice, questionne les affects que portent les récits et le chagrin étonnamment vif qu’on éprouve à la mort de certains personnages. Elle nous explique pourquoi les récits des chasseurs de mammouth ont écrasé ceux des cueilleuses d’airelles – car oui, de tout temps, on a prétendu que la cueillette était féminine. Une conférence féministe sur la littérature qui a pris les oripeaux d’un enthousiasmant one-woman-show ? Pas vraiment, bien que la réflexion de l’autrice de l’Art de perdre soit comme toute conférence authentique nourrie de références saillantes et avenantes. Tandis qu’on écoute Alice Zeniter nous répondre au téléphone, le vent souffle dans son jardin en Bretagne. On est à Paris, et il est possible qu’elle entende de son côté un jeu de ballon dehors rythmant nos questions. Notre conversation est-elle le début d’un récit ? C’est précisément son sujet. Sur scène, quel est le moment le plus difficile pour vous ? Je ne sais toujours pas quoi faire pendant les saluts. Je n’ai pas de feuille de route. Je me sens entre deux, démasquée, sortie de mon rôle mais pas encore retournée dans mon état habituel. Quand j’étais assistante à la mise en scène, on calait toujours un moment pour répéter les saluts. Etre seule change tout, on ne peut pas s’appuyer sur l’énergie, les regards, les sourires des autres comédiens. C’est une pièce qui s’adresse très ouvertement à un public qu’on suppose jeune. Change-t-elle en fonction des lieux et des spectateurs ? Je suis une fille sans histoire a été créée juste avant la fermeture des lieux pouvant accueillir du public. J’ai commencé les représentations devant des visages masqués, dont je devinais les expressions, et j’ai été bouleversée de découvrir enfin les réactions des spectateurs sur des visages entiers. Je ne m’attendais pas à ce choc. J’aime beaucoup lorsqu’il y a dans la salle des scolaires. Les ados ont une manière propre de s’emparer à toute vitesse de ce qu’on leur propose, y compris d’un sujet aussi âpre que la narratologie. Dans le hall, après le spectacle, j’entends parfois des petits groupes qui discutent pour savoir s’ils ont déjà lu ou vu une œuvre sans résolution. Ça m’est très agréable de surprendre ces conversations. On dit parfois qu’un texte (de théâtre) ne doit pas être pédagogique. Vous faites l’inverse et vous nous embarquez. N’avez-vous pas craint d’être trop didactique ? Je ne suis pas dans la même situation que si, écrivant un roman, j’avais décidé qu’un personnage devait véhiculer mes idées. La pièce est conçue comme un moment où je partage à la fois mon amour des histoires et mes doutes à l’égard des formes qui se répètent, en produisant des hiérarchies et des valeurs dont il me semble très difficile de se dégager. Des femmes de ma génération m’ont fait remarquer le désespoir infini qu’il y a à considérer que je suis marquée au plus profond de moi-même par des récits où l’homme est tout-puissant et la femme enfermée dans la sphère domestique. Il n’existe pas de groupe témoin qui ne serait pas déformé par le récit du chasseur de mammouths ! Je suis constituée à mon insu et de manière irrattrapable par ces histoires. Je ne serai jamais libérée de leurs effets. Des personnes plus jeunes peut-être peuvent l’être. Pourriez-vous transmettre Je suis une fille sans histoire à une comédienne ? Quand on m’en a fait la proposition, j’ai été très surprise. Pourtant, cette femme que j’interprète est aussi une fiction. C’est une version améliorée de moi-même qui réussit constamment à s’exprimer. Est-ce qu’il faudrait que je réécrive les parties autobiographiques en fonction de la comédienne qui choisirait de le jouer ? Est-ce que j’accepterais de le faire ? Je ne suis pas tout à fait au clair… Philippe Caubère a continué à jouer Philippe Caubère sans transmettre son personnage… La pièce qui me paraît la plus proche de ce que je propose est Un faible degré d’originalité d’Antoine Defoort. Elle présente énormément d’informations tout en maniant des affects puissants. Elle traite des droits d’auteur dont on peut supposer qu’ils sont une notion froide et abstraite. Mais la question le brûle et lui importe au point qu’il lui est impossible de ne pas en parler. Je comprends tout à fait cet état ! Avez-vous grandi dans une famille féministe ? Pas ouvertement. J’ai été élevée par des parents qui pensaient que les femmes étaient absolument les égales des hommes et que tous ceux qui empêcheraient les filles d’avoir les mêmes chances que les garçons devaient être combattus. Mais je n’ai pas été outillée pour faire face aux obstacles que les jeunes filles peuvent rencontrer, ne serait-ce que par des discussions où ils auraient été nommés. Ou encore en me donnant accès aux textes qui les désignent. Ancienne élève à l’Ecole normale supérieure, romancière… votre parcours semble sans accroc. Avez-vous rencontré ces obstacles ? Je suis à la fois femme et fille d’immigrés. Ce que j’ai éprouvé assez banalement, c’est la peur panique d’être en situation d’imposture. J’ai ou j’avais une difficulté immense à prendre la parole dans un groupe de manière construite et forte. Tout, dans la manière dont j’avais été socialisée, me disait que je n’en avais pas le droit. Lors de mes premiers entretiens, j’étais par exemple incapable de refuser une question à côté de la plaque. Je mettais un temps fou à bricoler une réponse aimable, positive, alors que tout en moi hurlait. J’avais l’impression que j’avais déjà bien de la chance d’être publiée, de travailler comme dramaturge. Qu’il ne fallait pas, qu’en plus, je sois contrariante. Je suis une fille sans histoire de et avec Alice Zeniter, au Théâtre du Rond-Point du 11 au 29 mai.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 23, 2021 5:21 PM
|
Par Anthony Palou, dans le Figaro - 15/11/2021
PORTRAIT - En cette saison théâtrale, il est à l’affiche avec Marivaux et Rainald Goetz. Portrait d’un homme qui trouve le rythme d’une pièce à travers le texte.
Au début, un peu hésitant, puis, se chauffant au fil de la conversation, le verbe d’Alain Françon, lorsqu’il tourne à plein régime, est enchanteur. Disons-le tout net: cet homme ne baliverne pas. On ne présente plus ce metteur en scène discret qui jouit d’une belle réputation, bien méritée. Plusieurs fois moliérisé, maintes fois récompensé. Un sacré pedigree: il fond le collectif le Théâtre éclaté à Annecy au début des années 1970 ; fin 1980, il dirige le Centre dramatique national de Lyon ; entre 1992 et 1996, il mène un autre Centre dramatique, celui de Savoie ; est directeur de 1996 à 2010 du Théâtre de la Colline, puis crée sa propre affaire en 2010: le Théâtre des Nuages de neige. Il a mis en scène Racine, Goldoni, Tchekhov, Feydeau, Ibsen. Aussi des contemporains: Michel Vinaver, Peter Handke, Edward Bond, etc. Avec lui, nous avons l’embarras du choix. Ces jours-ci, à Paris, nous pouvons voir deux pièces qui pourraient résumer l’étendue colorée de sa palette. D’un côté La Seconde Surprise de l’amour, de Marivaux, de l’autre Kolik, de Rainald Goetz. Marivaux? Une vieille histoire. Il y a une quarantaine d’années, Alain Françon avait monté La Double Inconstance avec François Cluzet en Arlequin. De cette expérience, il semble être resté sur sa faim: «Ce n’est pas un très grand souvenir. Le spectacle avait été créé à Annecy. En tournée, à chaque fois que j’allais le voir, je me disais que je n’avais rien compris à cette écriture. En fait, j’avais fait du remplissage, des images pour éviter de me pencher vraiment sur le texte. Il y a trois ou quatre ans, j’ai monté Un mois à la campagne, de Tourgueniev. Certaines personnes - des professionnels ou des spectateurs - me répétaient: “Pourquoi ne faites-vous pas Marivaux?, car il y a quelques ressemblances…” Je n’y avais pas pensé. Et je me suis dit: pourquoi pas!» Alors, Françon a relu tout Marivaux. Le sens dans le son Quand il s’intéresse à un auteur, il lit tout ce qui le concerne, s’imprègne du rythme, de l’agencement des phrases… Il a hésité entre Les Fausses Confidences et La Seconde Surprise de l’amour. Et a opté pour cette dernière, la préférant aussi à la première Surprise, à ses yeux trop italienne. «La Seconde est plus mathématique, dit-il. Comme un graphique, d’une évidence totale.» Françon sait l’importance de la fabrique des mots. Le rythme, voilà la chose importante. Sûrement pour cela que ses mises en scène raffinées ne souffrent jamais de boursoufflures. Selon lui, Marivaux est tel le volcan. D’un coup, il y a une éruption de lave et, «si on a été fort avec le texte, il rejaillit forcément, il devient contemporain». On pourrait résumer son travail ainsi: le sens dans le son. «Le texte est avant tout un matériau sonore», répète son ami et dramaturge Michel Vinaver. Surtout, ne pas transformer idéologiquement le texte, lui laisser son sens strict, la bonne heure. Chez Marivaux,le spectateur n’est pas le tiers exclu, il est le tiers inclus, le témoin de ce qui arrive Alain Françon Ses décors et ses costumes ne sombrent jamais dans l’ostentation. Ils sont «peu bavards», pourrait-on dire. Ils semblent tromper le temps, comme si la postérité regardait les années 1720 ou que celles-ci se contemplaient encore. Finement accompagné de Jacques Gabel, son scénographe, et de Marie La Rocca, sa costumière, il aime employer le mot «intermédiaire» pour définir ce sobre entre-deux qui illumine son travail. Françon ne quitte jamais des yeux le spectateur, qui serait le sujet du spectacle. «Chez Marivaux, précise-t-il, le spectateur n’est pas le tiers exclu, il est le tiers inclus, le témoin de ce qui arrive.» Du côté de chez Françon, il n’est pas de spectacle autiste, même lorsqu’il met en scène Kolik, de Rainald Goetz, un de ses auteurs fétiches. Kolik est une pièce interprétée, habitée plutôt, par un impressionnant Antoine Mathieu. On en sort essoré, car, chez Goetz, «il y a toujours quelque chose de torrentiel». Sorte de coulée de boue, flux et reflux de mots à la frontière de la psychiatrie: un homme, comme enfermé dans un corps-prison, cherche l’humain en des volutes, proche de la dyspepsie. Un théâtre de la décomposition dont le référent serait peut-être Beckett. Agression au couteau en mars dernier Ah, Beckett! Souvenez-vous: l’écrivain irlandais s’était fait poignarder par un déséquilibré en 1937, rive gauche, à Paris. En mars dernier, Alain Françon reçut, lui aussi, un coup de couteau dans une rue de Montpellier. Une agression par-derrière qui lui valut une cicatrice de 15 cm au cou. Un égorgement. De sa voix toujours posée, presque modianesque, Françon raconte l’impensable: «Les quinze premiers jours, j’ai repassé toute ma vie en détail pour savoir ce que j’avais fait pour mériter ça. Puis, lorsqu’on m’a dit que cette agression n’avait rien à voir avec moi, je me suis dit…, j’ai pensé que j’étais tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment. J’étais un peu plus soulagé. Je sais que l’agresseur a demandé sa liberté provisoire. Elle a été refusée. Mon agresseur a carrément déclaré que, son idéal, c’était d’être terroriste et de tuer le maximum de petits Français.» Après un court silence, sa voix sourit: «Mais, ça va. Marivaux m’a bien soigné.» Rien ne fera obstacle à Marivaux. Son agenda? Bien rempli. En janvier, à la Porte Saint-Martin, il remet en scène Thomas Bernhard, Avant la retraite. La direction de l’Opéra de Paris lui a demandé de se pencher sur Le Couronnement de Poppée, de Monteverdi, puis, il montera, pour le Festival de Fourvière, En attendant Godot. Beckett, le mur porteur. «Kolik», au Théâtre 14 (Paris 14e). Tél.: 01 45 45 49 77. Légende photo : Alain Françon, un metteur en scène discret, plusieurs fois moliérisé, maintes fois récompensé. SANDRINE ROUDEIX/Le Figaro Magazine

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 15, 2021 6:41 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde le 10/11/2021 Dans « La Métamorphose des cigognes », le comédien raconte avec humour et délicatesse ses tourments et questionnements face au parcours de procréation médicalement assistée vécu par son couple.
Quand des spectateurs souhaitent lui parler à l’issue de son spectacle, Marc Arnaud a parfois l’impression de se transformer en « docteur tendresse ». Il y a ce couple qui entame une quatrième fécondation in vitro (FIV), cette femme qui lui décrit son parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou cette autre qui se confie sur sa stérilité. « Je ne pensais pas que j’ouvrirais ces portes-là, cette intimité-là », s’étonne le comédien. Pour nous qui avons découvert son premier seul en scène, La Métamorphose des cigognes, en juillet lors du Festival « off » d’Avignon, ce besoin d’échanger ne nous surprend pas. Car quoi de plus intime que de raconter un désir d’enfant bousculé par la froideur des protocoles médicaux ? Après son succès avignonnais, ce bijou de solo, à la fois drôle et émouvant, est à découvrir au Théâtre La Scala à Paris. Le comédien convoque, dans une remarquable interprétation, tous les personnages croisés au fil de cette aventure, tour à tour, grave et joyeuse Tout est né lorsque Marc Arnaud s’est retrouvé un jour, un gobelet à la main, dans la solitude d’une salle de recueil de sperme. Le comédien se met alors à écrire, à tenir un journal de bord de cette expérience à la fois presque banale mais si peu racontée par les hommes. « Avec ma compagne, nous essayions de faire un enfant. Au départ, cela pouvait paraître étrange d’écrire pendant que nous traversions ce parcours de FIV. L’idée n’était pas de raconter notre vie mais la manière dont on se construit en tant qu’homme, explique Marc Arnaud. Dans une FIV, c’est la femme qui endure. L’homme, lui, n’a quasiment rien à faire ; il n’est pas du tout héroïque et a le temps de s’interroger sur lui-même. » La force de son spectacle tient à l’humour et à la délicatesse employés pour raconter la fragilité d’un homme. Un homme face à son gobelet, invité régulièrement par l’infirmière à « lancer le protocole » pendant que sa femme est au bloc opératoire pour la ponction ovarienne. « Pourquoi ça nous arrive à nous, à moi ? Pourquoi je veux un enfant ? A quoi je peux penser ? », s’interroge-t-il. De ce moment si prosaïque qui consiste à devoir éjaculer pour tenter de faire un bébé par FIV, Marc Arnaud en tire un abîme de questionnements. Le comédien se penche sur son rapport aux femmes, sur sa sexualité, ses désirs et convoque, dans une remarquable interprétation, tous les personnages (notamment les médecins) croisés au fil de cette aventure, tour à tour, grave et joyeuse. Jamais scabreux, toujours sensible On passe du tragique au comique, on est ému, on rit et on écoute avec attention cet homme qui a tant envie de nous parler de ses tourments. La Métamorphose des cigognes, c’est l’histoire d’un homme qui lève le voile avec panache. Pour le spectateur, ce parcours où se mêlent passé, présent et futur, prend l’allure d’un thriller. Ce regard masculin posé sur la FIV, jamais scabreux, toujours sensible, se révèle captivant. Formé au cours Florent puis au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris et à l’Académie de musique et d’art dramatique de Londres, ce comédien de 38 ans a « toujours eu l’envie d’être seul sur scène. Cela remonte au désir même de faire ce métier », dit-il en citant en référence Muriel Robin et Philippe Caubère. Ce Vendéen a grandi dans une famille qui chérissait le théâtre amateur et a vécu ses premières expériences de jeu au Puy-du-Fou. « Faire à 16 ans le bouffon dans un spectacle médiéval devant quatre mille personnes, c’était une émotion assez dingue », se souvient-il. Plus tard, il jouera dans l’étonnant Masques et Nez, mis en scène par Igor Mendjisky, mais aussi dans Tartuffe, adapté par Brigitte Jaques-Wajeman au château de Grignan (Drôme) ou encore dans les pièces de Jean-François Sivadier (Portrait de famille, Don Juan). En parallèle, il réalise nombre de doublages, de Tony Kebbell dans Les Quatre Fantastiques au personnage de Duke Caboom dans Toy Story 4. Désormais il se « concentre » sur cet « ovni théâtral », à mi-chemin entre le stand-up et le seul en scène, qu’est La Métamorphose des cigognes. Et a même renoncé à jouer dans Sentinelles la prochaine création de Jean-François Sivadier. Avec Benjamin Guillard comme metteur en scène et Benjamin Bellecour comme producteur (ACME production compte à son catalogue les pièces d’Alexis Michalik), Marc Arnaud est entre de bonnes mains. Il a commencé à écrire Le Gobelet – premier titre envisagé avant d’opter pour le plus poétique et plus à-propos Métamorphose des cigognes – en mai 2017. Puis il en a présenté une forme courte en 2019 au festival Mises en capsules qui, chaque année au Théâtre Lepic à Paris, donne une chance à de jeunes auteurs et acteurs. La crise du Covid-19 l’a stoppé dans son élan, mais le comédien a rebondi en juillet 2020 au « off » d’Avignon. Entre-temps, il est devenu le papa de deux filles et a dévoilé à son aînée l’histoire de sa conception. La Métamorphose des cigognes, de et avec Marc Arnaud, mise en scène par Benjamin Guillard, jusqu’au 29 décembre au Théâtre La Scala à Paris. Sandrine Blanchard Légende photo : Marc Arnaud dans « La métamorphose des cigognes », au Théâtre La Scala, à Paris. ALEJANDRO GUERRERO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 4, 2021 7:44 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 4 nov. 2021 Dans son nouveau seul-en-scène intitulé « Un soir de gala », le comédien et humoriste interprète un tourbillon de personnages illustrant l’époque actuelle.
Qu’écririons-nous si l’on devait envoyer une carte postale à l’adolescent qu’on a été ? C’est par cet exercice formidablement nostalgique que débute le nouveau spectacle de Vincent Dedienne. La scène plongée dans le noir, le public se concentre sur la voix douce du comédien et humoriste et, déjà, le charme opère. Grâce à ses histoires désopilantes et à sa faculté de susciter une mélancolie joyeuse, Vincent Dedienne capte son auditoire dès les premières minutes de son Soir de gala. Un joli titre pour un one-man-show enchanteur. Quand les projecteurs s’allument, on le découvre, costume noir et chemise blanche, assis devant un piano à queue. « Je ne sais pas jouer de piano. Enfant, je rêvais parfois d’être chanteur, mais en regardant mon visage dans la glace, lucidement, j’ai bifurqué vers l’humour. » Ce sera donc une sorte de piano-voix sans musique, juste avec le pouvoir des mots. Tourbillon de personnages Contrairement à son premier seul-en-scène, S’il se passe quelque chose (2014) – autoportrait drôle et émouvant qui lui valut le Molière de l’humour en 2017 –, Un soir de gala nous emmène dans un tourbillon de personnages dont le narcissisme, l’égoïsme ou la bêtise reflètent une époque à tendance schizoïde. Pour Vincent Dedienne, l’heure n’est plus aux confessions, mais davantage au regard décalé sur le monde. Vincent Dedienne a le goût des mots, il en a même inventé un, « la chagreur », pour mesurer le degré de chagrin de s’éloigner de l’enfance C’est un régal de le voir incarner un journaliste d’une chaîne d’info en continu, speed et cynique, un comédien minaudier mélangeant sans scrupule interview et placements de produits, une agente de voyage persuadée d’avoir affaire au recherché Dupont de Ligonnès, une petite fille à haut potentiel désespérée par le remariage de son père, ou encore une bourgeoise snob et prétentieuse s’épanchant auprès de sa femme de ménage (« Je m’emmerde tellement que je suis à deux doigts de vous aider. ») Le piano, au gré des personnages, sert de pupitre, de table ou d’assise et, entre certains sketchs, l’humoriste glisse quelques états d’âme sur le temps qui passe et cette nostalgie qu’il a chevillée au corps. Vincent Dedienne a le goût des mots, il en a même inventé un, « la chagreur », pour mesurer le degré de chagrin de s’éloigner de l’enfance. C’est son « pays natal », et il reste « inconsolable d’y être exilé ». « Ce n’était pas mieux avant, mais c’était plus lent », résume joliment ce comédien attachant. Tendre, poétique et absurde On dit souvent que le deuxième spectacle, surtout quand le premier fut un succès, est le plus difficile. En quelques années, Vincent Dedienne, formé à l’Ecole nationale supérieure d’art dramatique de La Comédie de Saint-Etienne, a acquis une belle notoriété, tour à tour chroniqueur singulier à la radio et à la télévision, comédien de talent au théâtre (Le Jeu de l’amour et du hasard, de Marivaux, mis en scène par Catherine Hiegel), au cinéma (L’Etreinte, de Ludovic Bergery, en 2021) et dans la série télévisée humoristique La Flamme. En renouant avec son rêve de jeunesse, faire rire sur scène, l’artiste séduit à nouveau, sans se copier, mais en gardant sa patte, celle d’un humour à la fois tendre, poétique et absurde, qui n’est pas fait de punchlines mais de situations, de réflexions et de dérision. Quel humoriste peut, dans un même spectacle, faire entendre la voix enveloppante d’André Dussollier, évoquer les noms de Micheline Dax, Sim ou Laurent Terzieff, inventer un personnage de « redresseur de chansons françaises » et s’avouer, à 34 ans, « vieux depuis qu’[il est] jeune ». Il n’a jamais eu les goûts de son âge, et c’est ce qui le rend à la fois irrésistible et émouvant. Sur l’affiche de ce Soir de gala, Vincent Dedienne, au sommet d’un plongeoir, regarde en bas, la veste à moitié retirée, prêt à sauter. « Pourquoi on saute ou pas ? », s’interroge-t-il sur scène. « A 20 ans, on saute parce qu’on a envie de vivre, à 50 ans, on hésite parce qu’on a peur de mourir. » Lui est entre les deux, et sent bien que plus les étés passent, plus il met du temps avant de plonger d’un rocher. Les spectateurs, eux, plongent avec plaisir dans son univers et rient de ses personnages tantôt monstrueux, tantôt pathétiques. Ce Soir de gala est une réjouissance, un remède à la mélancolie et à une époque pas jolie-jolie. Un soir de gala, écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et Anaïs Harté. Mise en scène par Juliette Chaigneau, avec Vincent Dedienne. En tournée : les 6 et 7 novembre à Grasse (Alpes-Maritimes), le 13 à Dunkerque (Nord), le 14 à Bruxelles, le 20 à Martigues (Bouches-du-Rhône), le 21 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), le 27 à Angers (Maine-et-Loire), etc. Du 22 décembre au 29 janvier au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris. Sandrine Blanchard Légende photo : Vincent Dedienne dans « Un soir de gala », le 1er octobre 2021, à Colombes (Hauts-de-Seine). CHRISTOPHE MARTIN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 21, 2019 7:44 PM
|
Par Olivier Frégaville -Gratian d'Amore dans L'Oeil d'Olivier 21/11/2019 A l’occasion du Festival Art & Déchirure du CDN de Rouen-Normandie, Nicolas Petisoff raconte sa jeunesse rock’n roll, les aléas de son existence d’enfant adopté, la découverte de son homosexualité dans un spectacle intime et percutant. Dépassant les clichés, réparant ses fêlures, il se livre avec générosité et touche juste.
Casquette vissée sur la tête, Nicolas Petisoff déambule sur scène. Son regard dans le vague s’arrête parfois sur une silhouette, celle d’un homme, d’une femme qui s’installe. Jamais, il ne s’attarde. Toujours en mouvement, il ne sait pas rester en place. Derrière lui défilent les images d’un petit garçon filmé en super 8. Une voix off les commente. Attendri, ému, Nicolas Petisoff, s’assoit sur un tabouret, racle sa gorge et de sa voix douce entame son récit.
Enfant turbulent, il a grandi dans la banlieue de Limoges, élevé par une mère un brin neurasthénique et un père alcoolique. Très tôt, il se sent différent comme s’il ne faisait pas partie du tableau initial, comme s’il avait été adopté. Conforté par des bribes d’information entendu çà-et-là, il s’invente d’autres parents. Pourquoi ne serait-il pas l’enfant caché d’un tsar russe ? La vérité est tout autre, moins fantastique, plus banale, plus trivial.
Entre les crises du paternel, sa violence, le petit Nicolas pousse. Il devient un adolescent rebelle. Il découvre son amour pour les garçons dans les pages lingerie pour hommes de La Redoute. Il boit, fume, se drogue. Il s’éloigne mais revient toujours. Quelles que soient ses origines, il est le fils de la famille. Il soutient sa mère, aide son père à se sevrer. Tout semble s’arranger, même l’adoption, secret de polichinelle, trop longtemps tue, n’est plus un problème. L’homosexualité passe mal, mais après tout on l’a voulu. L’amoureux est gentil, on l’accepte.
Avec une belle émotion, Nicolas Petisoff se met à nu. Il ne cache rien de ses dérives, de ses blessures. De Limoges à Rennes, en passant par Toulouse, il se construit, s’assume, se libère de ses fantômes. L’écriture est simple, le style sobre, vivant. Avec sa bouille ronde, ses yeux séducteurs, il attrape le public, l’entraîne avec lui sur le chemin de la résilience, de l’acceptation de soi.
Accompagné sur scène par le musicien Guillaume Bertrand, qui signe la bande son, juché sur une estrade rappelant les parpaings, avec lesquels il construit son identité, le carrelage du pavillon de banlieue où il fait ses premiers pas, Nicolas Petisoff croque la vie à pleines dents et fait vibrer intensément cette confession intime, cet hymne à la tolérance.
Guidé par le regard amical et tendre d’Emmanuelle Hiron, la complicité de Denis Malard, le comédien s’affranchit de son texte et révèle avec émotion sa part d’humanité, de générosité. Chapeau l’artiste pour cette attendrissant leçon d’amour.
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Rouen
Parpaing de Nicolas Petisoff
Festival Art & Déchirure
CDN de Rouen-Normandie
Espace Marc Sangnier
1 Rue Nicolas Poussin
76130 Mont-Saint-Aignan
Jusqu’au 21 novembre 2019
Durée 1h00 environ
Tournée
Le 31 mars 2020 au DSN Dieppe – Scène nationale
Les 1er & 2 avril 2020 au Festival Mythos, Rennes
Juillet 2020 au Festival Off, Avignon
Mise en scène de Nicolas Petisoff
avec Nicolas Petisoff
collaboration artistique, régie son, régie lumière de Denis Malard
Musique de Guillaume Bertrand
direction d’acteur d’Emmanuelle Hiron
construction scénographie de François Aubry
conseil en écriture de Ronan Chéneau
Crédit photos © Pierre Bellec
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...