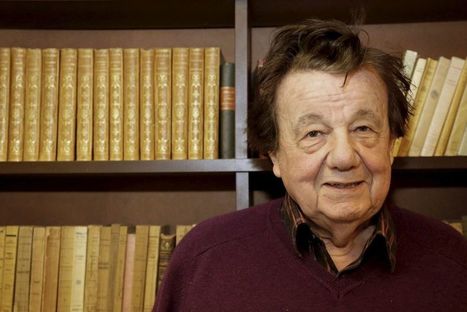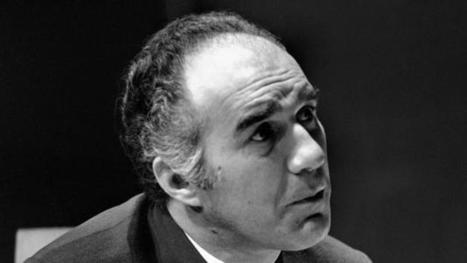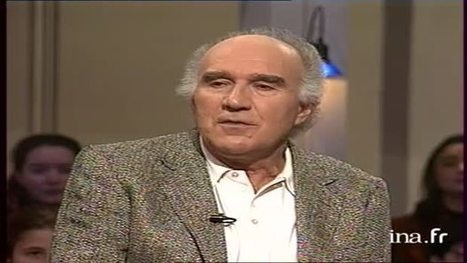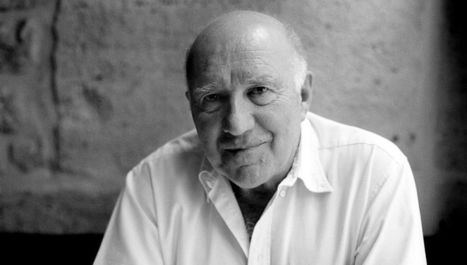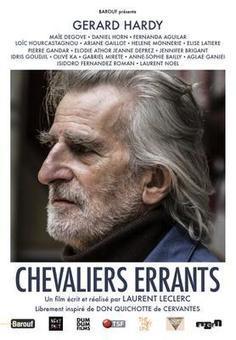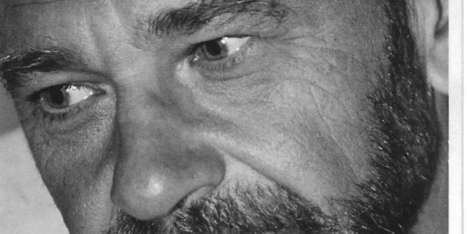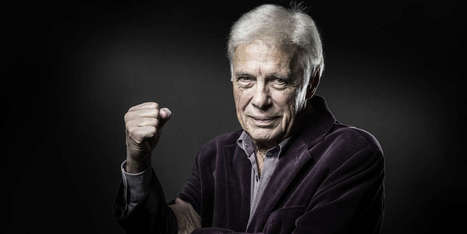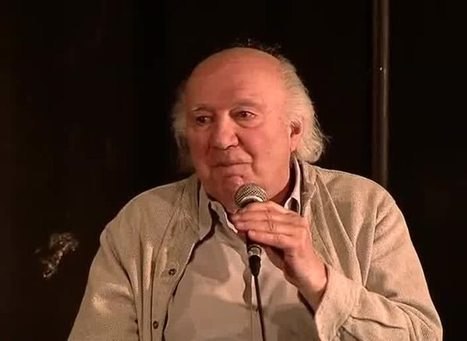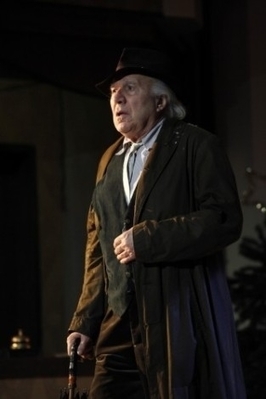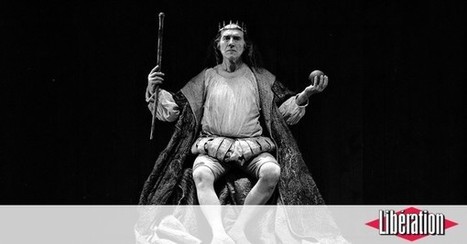Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 7:22 PM
|
Par Mathieu Macheret dans Le Monde le 21 septembre 2020 Le comédien, qui a brillé aussi bien au théâtre qu’au cinéma, notamment chez Buñuel, Duras, Welles, Costa-Gavras ou Beauvois, est mort lundi à l’âge de 89 ans.
Comédien excentrique et sophistiqué dont le maintien britannique lui permettait tous les dérapages possibles, Michael Lonsdale, mort le 21 septembre à Paris, à l’âge de 89 ans, a offert au cinéma français de ces cinquante dernières années l’une de ses présences les plus fascinantes et insaisissables. On se souvient de sa haute silhouette légèrement voûtée, plantée comme un point d’interrogation, de son visage aux bajoues plongeantes, mais surtout, peut-être, de sa voix sinueuse et grésillante, infiniment souple et capable de voler en éclats tonitruants. Cette labilité corporelle et émotionnelle est précisément ce qui l’autorisait à passer d’un rôle à l’autre en restant exactement lui-même, comme tous les grands acteurs. Habitué à ces seconds rôles marquants qui volent la vedette aux premiers par leur force drolatique dans les films de Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Marguerite Duras, François Truffaut ou Orson Welles, il fut surtout un homme de théâtre chevronné et assidu, ayant joué sous la direction de Claude Régy, Peter Brook ou Jean-Marie Serreau. Il est né le 24 mai 1931, dans le 16e arrondissement de Paris, d’une passion intempestive de sa mère, une Française d’ascendance bourgeoise, pour un officier de l’armée britannique, ami de son mari. L’enfant, qui tirera son bilinguisme de sa double nationalité, grandit sur l’île de Jersey, où ses parents tiennent un hôtel, puis quelques années à Londres, avant d’arriver, en 1939, au Maroc, où son père prend un emploi de représentant en engrais chimiques. Ce dernier, soupçonné de traîtrise, est fait prisonnier par les autorités vichystes, après la destruction de la flotte française par les Britanniques lors de l’attaque de Mers el-Kébir, en Algérie, du 3 au 6 juillet 1940. Il ne sera libéré que deux ans plus tard, en novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord : revenu à la maison, il n’est plus que l’ombre de lui-même. L’acteur confiera s’être inspiré de son apathie pour incarner le personnage du vice-consul, dans India Song, de Marguerite Duras. Choc avec Strindberg C’est dans le sillage de cette libération que, à Casablanca, le jeune Michael Lonsdale découvre le cinéma, grâce aux films américains projetés dans les casernes pour les GI’s. Il voit les films de Howard Hawks, John Ford, George Cukor, qui lui font éprouver pour la première fois le désir de devenir comédien. En 1947, il revient en France seul avec sa mère, désormais séparée de son second mari. Ils s’installent d’abord à Meudon, dans une maison où l’adolescent s’initie à la musique et à la littérature, à travers les ouvrages de Sacha Guitry, Mark Twain et Gustave Flaubert. Ils reçoivent régulièrement la visite d’un oncle, l’écrivain Marcel Arland, pilier de la NRF et Prix Goncourt (1929), qui présente son jeune neveu à tout le petit milieu de la littérature. Lui et sa mère emménagent définitivement à Paris, dans un grand appartement que leur laisse son grand-père. Le jeune Lonsdale tourne alors autour des écoles de théâtre, mais n’ose en franchir le seuil. C’est en voyant La Sonate des spectres, d’August Strindberg, mis en scène par Roger Blin, qu’il reçoit un choc et décide de se lancer. Au début des années 1950, il intègre le cours de Tania Balachova, au Studio des Champs-Elysées, « professeure de génie » dont il dira qu’elle était « capable de révéler à ses élèves une dimension d’eux-mêmes totalement insoupçonnée », mais aussi qu’elle « travaillait les comédiens comme un matador, jusqu’à ce qu’ils succombent. » Double orientation Il reçoit une seconde révélation en 1955, celle du théâtre de Bertold Brecht, devant Le Cercle de craie caucasien joué au Théâtre des Nations par le Berliner Ensemble. Il passe alors une audition auprès de Raymond Rouleau, metteur en scène de boulevard, en même temps qu’il rejoint la troupe de Laurent Terzieff, portée vers des aventures théâtrales novatrices. Il joue Chers zoiseaux, de Jean Anouilh, avec le premier, et L’Echange, de Paul Claudel, avec le second. On reconnaît ici la double orientation qui présidera à toute la carrière de Michael Lonsdale : complice irréductible des avant-gardes et des auteurs contemporains, il semble s’être fait connaître du grand public par ricochets – notamment pour son apparition dans Hibernatus (1969), au côté de Louis de Funès, et son rôle de méchant, Sir Hugo Drax, dans le volet Moonraker (1979) de la saga James Bond. Au théâtre, il devient le compagnon de route du metteur en scène Claude Régy, maître du silence et de la suspension, sous la direction duquel il jouera 18 pièces, interprétant les textes de Marguerite Duras, Peter Handke ou Luigi Pirandello. Avec un autre dramaturge, Jean-Marie Serreau, il travaille au défrichage scénique des textes d’Eugène Ionesco et de Samuel Beckett, encore fraîchement accueillis en ce mitan des années 1960. Sa rencontre avec Beckett est déterminante : en 1966, l’écrivain supervise en personne une mise en scène de Comédie, où Lonsdale se retrouve aux côtés de Delphine Seyrig et Eléonore Hirt. Il restera fidèle à Beckett tout au long de sa carrière, portant lui-même sur scène certaines de ses pièces, telles que Dis Joe, L’Impromptu d’Ohio, Berceuse et Catastrophe. Autre rencontre déterminante, celle de Marguerite Duras qui assiste aux répétitions de L’Amante anglaise, mise en scène par Claude Régy en 1968. Duras se souviendra du comédien et l’invitera à jouer dans trois de ses films : Détruire, dit-elle (1969), son tout premier long-métrage, où l’acteur joue Stein, personnage récurrent de son œuvre, Jaune le soleil (1971) et, surtout, l’inoubliable India Song (1975). Michael Lonsdale y incarne un vice-consul languissant, dont la silhouette fantomatique se traîne dolemment à travers les salons et courts de tennis d’une propriété abandonnée. Sur la bande-son, audacieusement désynchronisée de l’image, il pousse de terribles hurlements d’amour et de désespoir (précédemment enregistrés lors d’une représentation radiophonique du texte en 1974). Dérision magistrale Son premier grand rôle au cinéma avait eu lieu quelques années auparavant, dans Snobs (1961), de Jean-Pierre Mocky, où il jouait déjà avec une dérision magistrale de cette affectation guindée qui lui semblait si naturelle. Mais le film fut interdit pendant deux ans pour outrage à l’armée et à l’Eglise. La suite de la carrière cinématographique de Michael Lonsdale est majoritairement faite de seconds rôles et d’apparitions ponctuelles, à chaque fois si puissamment drolatiques ou étranges, qu’ils en viennent souvent à voler la vedette. « J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage », déclarait Michael Lonsdale Dans Le Procès (1962), d’Orson Welles, d’après Kafka, il pousse une harangue inquiétante, dans un anglais parfait, sous la défroque d’un prêtre. Dans Baisers volés (1968), de François Truffaut, il interprète un marchand de chaussures comme un petit commerçant étriqué et hautain. Dans Le Fantôme de la liberté (1974), de Luis Buñuel, il incarne un chapelier sadomaso, qui se fait fouetter les fesses devant une assemblée outragée. Il faut évidemment ajouter à tout cela sa participation à des expériences de cinéma hors du commun, comme les douze heures du ciné feuilleton Out 1 (1970) de Jacques Rivette, où il se livre à de longues séances d’improvisation théâtrale en roue libre, ou encore au magnifique cycle des « Quatre Saisons », de Marcel Hanoun, où il incarne le double du cinéaste à l’écran. Le jeu de Michael Lonsdale se caractérise à chaque fois par une forme de distance envers le personnage, dans laquelle peuvent aussi bien se loger l’ironie que la réflexivité. L’acteur est capable de passer de l’onctuosité la plus suintante à une forme de dureté brute, voire à d’impressionnants coups de colère. Il sera également voyeur des toilettes publiques chez Jean Eustache (Une sale histoire, 1977), érotomane patenté chez Alain Robbe-Grillet (Glissements progressifs du plaisir, 1973) et collaborateur vichyste chez Costa-Gavras (Section spéciale, 1975). L’un des rares films où il occupe le premier rôle est une merveille méconnue tournée pour la télévision : Bartleby (1976) de Maurice Ronet, d’après Herman Melville, où il joue un notaire troublé par l’un de ses employés qui se refuse à tout. Dans les dernières années de sa carrière, on l’avait retrouvé en sublime patriarche prostré, dans Gebo et l’ombre (2012), du Portugais Manoel de Oliveira, ou en double de fiction du cinéaste Eric Rohmer, dans Maestro (2014), de Léa Fazer. La foi chrétienne Une part plus secrète de sa filmographie concerne les rôles ecclésiastiques qu’il a ponctuellement interprétés au fil des années, fondés sur son aisance à incarner l’obséquiosité, le dédain, la dissimulation ou plus simplement l’aménité. Michael Lonsdale a joué un abbé bibliophile dans Le Nom de la rose (1986), de Jean-Jacques Annaud, d’après Umberto Eco, le cardinal Barberini, dans Galileo (1974), de Joseph Losey, et surtout le frère Luc Dochier, dans Des hommes et des dieux (2010), de Xavier Beauvois, sur l’assassinat des moines de Tibéhirine. Un rôle qui lui vaudra la reconnaissance ainsi que le César du meilleur acteur de second rôle. Il raconte toutefois avoir refusé de jouer un évêque de Rome dans Amen. (2002), de Costa-Gavras, pour son parti pris « anti-papiste ». Derrière ces choix et ces refus pouvait se lire en filigrane l’adhésion de Michael Lonsdale à une foi chrétienne dont il ne s’est jamais caché, et qui ne l’a surtout jamais empêché d’accepter des rôles transgressifs ou anticléricaux. Il confiait à ce sujet : « Certaines personnes, dans le métier, se sont détournées de moi parce que le seul mot de “religion” leur donne des boutons… La peur d’être rejeté, de ne plus travailler, en a muselé plus d’un, et loin de moi l’idée de les juger ! » Cette foi assumée fut peut-être moins une marque d’anachronisme que d’anticonformisme suprême, de la part d’un artiste qui est toujours resté « à part » et ne s’est jamais vraiment fondu dans le milieu artistique. Situation d’isolement qu’il évoquait lui-même en ces termes : « Ah, cette grande famille des acteurs… Je m’y sens parfois si décalé, n’ayant pas du tout l’esprit blagueur, pas le moindre goût pour la grosse farce, au point de me sentir parfois très mal à l’aise. J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage. » Michael Lonsdale restera pour toujours ce comédien extraterrestre, cet acteur venu d’ailleurs qui semblait incarner une certaine condition humaine tout en posant un regard extérieur sur elle, comme s’il ne lui appartenait pas vraiment. Et sans doute faut-il voir là le véritable secret de son génie. Michael Lonsdale en dates 24 mai 1931 Naissance à Paris 1966 Interprète de la pièce « Comédie » de Samuel Beckett 1968 Interprète de la pièce « L’Amante anglaise » de Marguerite Duras 1975 Acteur dans le film « India Song » de Marguerite Duras 1979 « Moonraker » de Lewis Gilbert 1986 « Le Nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud 2010 « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois 2012 « Gebo et l’ombre » de Manoel de Oliveira 21 septembre 2020 Mort à Paris Mathieu Macheret Légende photo : L’acteur Michael Lonsdale, en 2008 à Paris. OLIVIER ROLLER / DIVERGENCE --------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Christophe Henning dans La Croix Publié le 21/09/2020 Mort de Michael Lonsdale, comédien à l’inépuisable générosité Michael Lonsdale est mort lundi 21 septembre à l’âge de 89 ans. Acteur aux 130 films et comédien à la longue carrière, il a toujours témoigné d’une foi profonde. Michael Lonsdale, photographié le 20 octobre 2011 à Paris. ERIC GARAULT/PASCO Monstre sacré du cinéma, il était devenu une icône. Après une longue carrière, il reste la figure d’un sage ou d’un grand-père, à qui on peut se confier, tout comme il apparaît dans le film Des hommes et des dieux, quand une jeune Algérienne demande à Frère Luc ce qu’est aimer. Michael Lonsdale est né à Paris de la rencontre de sa mère avec un officier britannique. Il a vécu une partie de son enfance au Maroc, pendant la guerre, avant de s’installer avec sa mère dans un appartement familial, face aux Invalides, où il vécut jusqu’à sa mort, ce lundi 21 septembre. François Truffaut y a tourné en son temps une scène de Baisers volés (1968). Entré en théâtre comme en religion, Lonsdale a joué des rôles d’une incroyable diversité. Après-guerre, le monde des arts est en ébullition : Lonsdale le timide fréquente Beckett, Marguerite Duras, Madeleine Renaud… En suivant les cours de Tania Balachova, ce vrai timide dans un corps trop grand apprend le métier : « J’ai mis du temps, mais j’ai fini par libérer toute mon énergie jusqu’à casser une chaise ! J’en étais effrayé moi-même. » Dirigé au cinéma par les plus grands, on le retrouve aussi bien avec François Truffaut qu’avec Jean-Pierre Mocky, dans James Bond ou Le Mystère de la chambre jaune. Une voix à nulle autre pareille Les années passant, sa silhouette s’impose, le pas lent, la barbe fournie et les sourcils broussailleux, les cheveux balayés en arrière… Un regard, et une voix, à nulle autre pareille, grave et douce, jouant aussi bien des intonations que du silence. Plus de cent trente rôles au cinéma et une profonde vie intérieure, intime. Le théâtre est sa maison, l’Église, là où est son cœur. Baptisé à 22 ans, il n’a jamais caché sa foi, qui devient contagieuse à force de lectures et de méditations. « Vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne d’autre », lui avait dit, très jeune, un père dominicain, qui avait perçu cette singularité du comédien. Sainte Thérèse de Lisieux et tant d’autres bouleversent l’artiste courtisé par le Tout-Paris. Dans les années 1980, frappé par une série de décès, il plonge dans la dépression. C’est lors d’une célébration de la communauté de l’Emmanuel, dans sa paroisse Saint François-Xavier à Paris, qu’il reprend pied : « Cela m’est apparu très clairement : ce qui allait me sortir de mon chagrin, ce qui me rendrait le goût de vivre, était là. La vie fraternelle, la prière et la louange : Jésus venait à ma rencontre. J’étais fou de joie. » L’émotion de Frère Luc « Le métier de comédien est un travail de passeur : je dois m’efforcer de transmettre la beauté, je fais entendre les mots d’un autre », confiait-il encore. Au soir de sa vie, interpréter Frère Luc de Tibhirine dans le film de Xavier Beauvois fut une grande émotion. « Mais ni le film, ni l’existence édifiante de frère Luc ne doivent nous faire oublier que c’est le Christ le premier qui a donné sa vie pour nous. Jésus s’est laissé humilier, bafouer. Nous ne sommes que ses disciples. » Témoin du Christ et artiste à part entière, il a déclamé de grands textes, écrit nombre de livres de prière et de méditation, sans oublier une carrière de plasticien, peu connue, et qui lui tenait particulièrement à cœur : « La beauté est un des noms de Dieu », soufflait-il. Si c’est un grand comédien qui s’en va, c’est aussi un accompagnateur, un accoucheur, qui ne savait pas refuser les multiples sollicitations qui engorgeaient son répondeur téléphonique, souvent saturé. Il inscrivait à l’occasion plusieurs rendez-vous sur une même page, au risque de faire faux bond, preuve d’une inépuisable générosité, qui se manifestait par une écoute bienveillante accordée aux plus grands comme aux passants de la rue. De santé fragile, ce roc a tenu, jusqu’au bout. Lonsdale est mort à 89 ans. Et connaît aujourd’hui l’envers du décor : « J’aimerais partir en paix. Je voudrais mourir en Dieu. Ce qui fonde ma confiance face à la mort, c’est Jésus : mon ami m’a dit que la mort était vaincue, qu’elle n’avait pas le dernier mot. Pourquoi se soucier de ce qui est entre les mains de Dieu ? » ______________________________________________ Repères 1931 : naissance à Paris, d’une mère française et d’un père britannique 1946 : rencontre le metteur en scène Roger Blin et décide de faire du théâtre. Il s’inscrit à l’école de Tania Balachova. 1955 : premier rôle au théâtre avec Raymond Rouleau dans Pour le meilleur et pour le pire. 1956 : début au cinéma dans C’est arrivé à Aden de Michel Boisrond 1961 : Snobs ! de Jean-Pierre Mocky. Ensemble, jusqu’au Renard Jaune en 2013, ils tourneront sept longs-métrages. 1962 : Le procès d’Orson Welles 1967 : La mariée était en noir, de François Truffaut ; Baisers Volés l’année suivante. 1968 : L’amante anglaise de Marguerite Duras, au théâtre, sous la direction de Claude Régy. 1974 : Le Fantôme de la liberté de Luis Bunuel 1975 : India Song, de Marguerite Duras 1986 : Le nom de la Rose, de Jean-Jacques Annaud 1993 : Les vestiges du jour, de James Ivory. 2010 : Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois. César du meilleur acteur dans un second rôle. 2020 : Mort à Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 10:56 AM
|
Par Philippe du Vignal dans Théâtre du blog - 21 juillet 2020 L'hommage de Philippe du Vignal : Elle avait cinquante neuf ans. Cette metteuse en scène française de théâtre, était aussi scénariste et professeur d’art dramatique. Diplômée du Conservatoire National et de l’Université Hébraïque de Jérusalem, elle avait aussi suivi en Angleterre une formation au théâtre shakespearien. Elle joua dans Jamais plus Jamais, un James Bond avec Sean Connery et ensuite mit en scène Le Marchand de Venise de Shakespeare au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis puis en 84, Docteur X Hero ou le dernier client du Ritz de Mériba de Cades au festival d’Avignon et en 87 Bastien et Bastienne de Mozart.
En 1988, elle vécut en Nouvelle-Calédonie où elle travailla à la préparation du Festival des arts du Pacifique. Elle mit en scène au studio des Champs-Élysées, Le Banc d’Alexander Gelman et travailla ensuite avec Patrick Grandperret à un scénario sur l’Afrique contemporaine, puis avec Xavier Castano à l’écriture de Veraz dont le rôle principal est interprété par Kirk Douglas. Saskia Cohen-Tanugi fut ensuite chargée d’une étude sur la programmation du Théâtre 13 à Paris. Elle travailla ensuite à l’élaboration du Vieil Homme et le Molosse pour Greg Germain, l’actuel directeur de la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon.
Puis elle enseigna quelques années à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot. En 1999, elle adapte Mademoiselle Else d’Arthur Schnitzler au théâtre, une pièce récompensée par plusieurs Molière. En 2000, elle dirige un atelier de théâtre à l’Université hébraïque de Jérusalem et écrira plusieurs œuvres sur le Proche-Orient : Caleb et Yoshua, Judith Epstein, La Vieille Femme du 55 rue Gabirol, Les Deux Jeunes Filles de Netanya, Avant qu’Ophélie ne…, Lettres d’intifada…
Personnalité attachante, d’une grande culture théâtrale et artistique, elle avait choisi depuis une vingtaine d’années de vivre et enseigner en Israël.
Philippe du Vignal ------------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Patrick Sommier : Elle s’appelait Saskia Cohen Tanugi. Elle vient de mourir, en Orient, en Israël. Elle avait mis en scène au conservatoire, avec ses amis, au début des Années 1980, un époustouflant Roméo et Juliette rempli de fureur et de bruit. Un oratorio punk qui célébrait la jeunesse, la beauté et le théâtre. Le théâtre pour lui-même, comme une charge de centaures, l’explosion joyeuse d’une cartoucherie, une délivrance. C’est Rémy Kolpa qui m’avait alerté parce que c’était autant du théâtre que de la musique. René Gonzales lui a ouvert la scène du TGP à Saint-Denis où elle créa le Marchand de Venise, un autre Shakespeare au cordeau, au stylet, à coups de surin, violent, follement sensuel comme un tableau orientaliste. Elle continua, à Avignon où l’attendaient les garçon- bouchers de l’art théâtral ; Elle était follement belle, ça les rendait agressifs. Elle continua mais comme elle avait tout balancé dans son Zeppelin, elle erra longtemps dans les régions froides où l’oxygène se fait rare. Il lui aurait fallu plusieurs vies. Elle avait quelque chose de Rimbaud qui avait tout donné puis s’était perdu dans les sables. C’était un météore, un arc en ciel de nuit. Dans le ciel et la nuit où elle est retournée. Là ou ailleurs. (publié sur sa page Facebook)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2020 6:08 PM
|
Publié sur le site de France3 PACA - Marseille le 12 juin 2020 Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est décédé à l'âge de 83 ans. Macha Makaïeff, directrice de La Criée, Théâtre national de Marseille, dont il fut le fondateur, se souvient d'un homme de troupe, un ogre de théâtre, désormais hanté par son "bon fantôme". "Mon père est mort cette nuit chez lui à Paris des suites d'une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans", a indiqué son fils Mathias, également comédien. Metteur en scène, comédien et écrivain, Marcel Maréchal était né en 1937. Fondateur du théâtre du Cothurne à Lyon, il avait fait débuter de nombreux artistes dont Pierre et Catherine Arditi, Maurice Bénichou ou encore Bernard Ballet. Après Lyon, où il avait dirigé le Théâtre du Huitième, il se rend à Marseille où il est nommé à la tête du Théâtre du Gymnase. En 1981, avec François Bourgeat, il fonde La Criée, Théâtre national de Marseille. Quatorze ans après, toujours avec François Bourgeat, il devient le directeur du Théâtre du Rond-Point, jusqu'en 2001 avant de prendre la tête des Tréteaux de France (jusqu'en 2011). Auteur, Marcel Maréchal a notamment écrit "Une anémone pour Guignol" (1975), "Conversation avec Marcel Maréchal" (1983), "Rhum-Limonade" (1995) et "Saltimbanque" (2004). Il s'était également livré à des adaptations de grands classiques comme "Les Trois Mousquetaires" d'Alexandre Dumas ou "Capitaine Fracasse" de Théophile Gautier. En tant que metteur en scène, Marcel Maréchal n'a eu de cesse d'alterner création de textes classiques et contemporains. Il a ainsi monté "Cavalier seul" et "Opéra du monde" de Jacques Audiberti, "Badadesques" de Jean Vauthier, "Cripure" de Louis Guilloux ou les grands textes de Musset et Molière. Un homme extrêmement chaleureux, puissant et charismatique. A la Criée, l’homme de théâtre a laissé une trace indélébile derrière lui. Macha Makeïeff, l’actuelle directrice, affirme que le théâtre est désormais hanté par son "bon fantôme". "Tous les acteurs ou régisseurs qui ont travaillé avec lui m’en parlent souvent. Ils évoquent un homme extrêmement chaleureux, puissant et charismatique". Actuellement à Lyon, où elle prépare des ateliers au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, l’auteure raconte : "Même ici, quand je dis que je viens de La Criée, les régisseurs viennent me dire ‘Moi j’ai connu Marcel Maréchal’. En plus de l’œuvre qu’il a laissé, il y a cette trace de chaleur, de proximité, d’entraînement". Admirative, elle ajoute : "C'était un homme de troupe, qui savait fédérer. Il a laissé des traces d'effervescence et de bienveillance, presque charnelle". Il était flamboyant et surdimensionné, mais aussi extrêmement délicat. La metteuse en scène garde "une haute estime" pour cet homme qui vivait par et pour le théâtre. "Quand on voit le nombre de pièces et de projets qu'il a monté, c'était presque un ogre ! Il était dans un appétit immense de théâtre, de troupe et de scène." Marcel Maréchal laisse derrière lui le souvenir d'une personnalité puissante, mais non sans finesse. Macha Makeïeff se rappelle une anecdote touchante sur le metteur en scène. "J'étais à la Criée depuis quelques mois. On traversait une période difficile, avec des travaux et des problèmes d'amiante. Il est venu m'apporter une lettre d’une extrême bienveillance. Elle se terminait par ces mots : 'Vous savez Macha, les initiales M.M ça porte bonheur'. Il était flamboyant et surdimensionné, mais aussi extrêmement délicat". Le théâtre marseillais songe déjà à lui rendre hommage. "On va prendre le temps de bien le faire. Ça ne se fera pas avec des salles fermées. Il faut attendre de retrouver les usages normaux du théâtre". Légende photo : Marcel Maréchal, comédien et metteur en scène, à la librairie des Arcenaux, à Marseille, en mars 2015. • © Valérie Vrel / MaxPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 6:25 PM
|
Marcel Maréchal, biographie et hommages publics
Marcel Maréchal - Biographie concise Né le 25 décembre 1937 LYON (1958-1975) : 1958 - Fondation de la Compagnie des Comédiens du Cothurne. 1960 - La troupe s’installe rue des Marronniers. Elle passera huit ans dans le petit théâtre où avait débuté Roger Planchon. Elle y créera notamment Badadesques et Capitaine Bada de Jean Vauthier et Cripure de Louis Guilloux. 1968 - Ouverture du Théâtre du Huitième avec la création de La Poupée de Jacques Audiberti. L’année suivante, Marcel Maréchal joue Sganarelle dans le Dom Juan de Molière mis en scène par Patrice Chéreau, puis il monte Le Sang de Jean Vauthier. Il commence alors à constituer son répertoire. FESTIVAL D’AVIGNON (1973-1974) : Dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, en 1973 avec Cavalier seul d’Audiberti et en 1974, avec Holderlin de Peter Weiss, La Poupée de Jacques Audiberti et Fracasse. COMÉDIE FRANÇAISE (1975) : En 1975, sous la direction de Pierre Dux, Marcel Maréchal met en scène La Célestine avec Denis Gence dans le rôle-titre. MARSEILLE (1975-1994) : En 1975, Marcel Maréchal et sa compagnie quittent Lyon pour Marseille. Ils s’installent au Théâtre du Gymnase en attendant que s’ouvre, en 1981, sur le Vieux-Port, dans l’ancienne Criée aux poissons, le nouveau grand théâtre dont ils ont rêvé. La compagnie porte désormais le nom de son créateur et acquiert le statut de Théâtre National de Région. À Marseille, il y aura Molière, Brecht (La Vie de Galilée), Beaumarchais, Tchekhov, ainsi que les grandes fresques populaires comme Les Trois mousquetaires, Fracasse ou le Graal-Théâtre. Mais il y aura surtout, et en nombre, ces auteurs d’aujourd’hui que Marcel Maréchal s’attache à faire connaître : Valère Novarina, Jean Genet, (Les Paravents) David Mamet, Sam Shepard, Nella Bielsky, John Berger, Jean-François Josselin, Marcel Jouhandeau, Pierre Laville et bien sûr Jean Vauthier. Avec Pierre Arditi, Don Juan de Molière et Puntila et son valet Matti de Brecht. PARIS (1995-2000) : En janvier 1995, Marcel Maréchal prend la direction du Théâtre du Rond-Point. Il transforme totalement la grande salle, multiplie les activités et présente en cinq saisons plus de 50 spectacles, pour la plupart des créations contemporaines. Il met lui-même en scène Paul Claudel, Jacques Prévert, David Mamet, François Billetdoux, Jean Vauthier, Jacques Audiberti et joue En attendant Godot de Samuel Beckett, Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg avec Pierre Arditi. Il offre une saison entière à Harold Pinter et fait rencontrer au public, avec France Culture, une trentaine de poètes d’aujourd’hui. LES TRÉTEAUX DE FRANCE (2001- 2010) : En janvier 2001, Marcel Maréchal succède à Jean Danet à la direction des Tréteaux de France, Centre Dramatique National. Il fonde une nouvelle troupe, monte et interprète successivement L’école des femmes de Molière, Ruy Blas de Victor Hugo, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, George Dandin de Molière, Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Lettres d’une mère à son fils de Marcel Jouhandeau, La Maison du peuple de Louis Guilloux, Audiberti & fils, Le Bourgeois gentilhomme de Molière repris au Théâtre 14 à Paris en janvier 2012. Dans le cadre des Tréteaux de France, il a créé et dirigé le Festival Théâtral de Figeac de 2001 à 2010. OEUVRES : La Mise en théâtre (1974), Une anémone pour Guignol (1975), L’Arbre de mai (1984), Fracasse, Un colossal enfant, Rhum-Limonade, Cripure, d’après Louis Guilloux, opéra, musique de François Fayt (création prochaine) DISTINCTIONS : Prix de la Critique dramatique 1969 et 1983 ; par trois fois, Molière de la Décentralisation ; nomination au Molière du meilleur acteur pour le rôle de Puntila… TOURNÉES À L’ÉTRANGER : Russie (Moscou, Saint-Petersbourg), Ukraine, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Allemagne de l’Ouest, Allemagne de l’Est, Amérique du sud (Brésil, Argentine, Urugay, Chili), USA, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Togo, Niger, Nigeria, Japon, Chine… Décès le 11 juin 2020 Biographie détaillée : http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html ------------------------------------------------------------ HOMMAGES DANS LA PRESSE ET SUR LES RESAUX SOCIAUX Dans la presse : Hommage de Fabienne Pascaud / Télérama : Mort de Marcel Maréchal, acteur tonitruant et directeur de théâtre contrarié Hommage d'Armelle Héliot / Le Figaro : Marcel Maréchal, poète des tréteaux Hommage de Brigitte Salino / Le Monde : Marcel Maréchal, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, est mort Hommage sur le site France TV INFO https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/marcel-marechal-comedien-metteur-en-scene-et-fondateur-de-la-criee-a-marseille-est-mort_4005953.html Hommage de Jacques Nerson dans l'Obs : Jusqu’au revoir, Monsieur Marcel Maréchal Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est mort, ce jeudi 11 juin, d’une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans. C’est l’une des figures majeures de la décentralisation culturelle d’après-guerre qui disparaît. Marcel Maréchal (1937-2020), ici en 2012 dans « Cher menteur », de Jean Cocteau, au Théâtre La Bruyère, dans une mise en scène de Régis Santon. (DELALANDE RAYMOND/SIPA / SIPA) Dans les années 1960-1970, le petit milieu du théâtre lyonnais avait deux pôles. D’un côté les fidèles de Roger (Planchon), de l’autre les partisans de Marcel (Maréchal). Le premier exerçait ses talents au Théâtre de la Cité de Villeurbanne qui allait reprendre le sigle TNP en 1972, le second, de six ans son cadet, dirigeait le Théâtre du Cothurne, puis à partir de 1968 le Théâtre du 8ème à Lyon. Rares étaient les acteurs à faire la navette entre les deux troupes. Au-delà d’une rivalité anecdotique de chefs de bandes, il y avait entre Planchon et Maréchal de profondes divergences. Divergences politiques : l’un et l’autre étaient de gauche, mais Planchon était marxiste, et Maréchal, chrétien de gauche. Divergences esthétiques surtout : Maréchal n’avait pas la rigueur de Planchon. Disons qu’il était plus dionysiaque qu’apollinien. Autrement dit, plus dans la lignée de Jean-Louis Barrault que dans celle de Jean Vilar. De fait ses spectacles n’atteignait jamais la perfection formelle de ceux de Planchon ou, moins encore, ceux de Chéreau ou Strehler. En revanche, grand découvreur de textes, il avait un goût très sûr pour les poètes baroques comme Jacques Audiberti (« le Cavalier seul », 1963, « la Poupée », 1968, « Opéra parlé », 1980) et Jean Vauthier (« Badadesques », 1965, et « Capitaine Bada », 1966, « le Sang », 1970, « Ton nom dans les nuées, Elisabeth », 1976, « les Prodiges », 1997), ou encore pour Louis Guilloux (avec « Cripure », 1967, adapté de son grand roman « le Sang noir », puis « la Maison du peuple », 2002). Un comédien chimiquement pur En réalité Maréchal était, comme Barrault, plus animateur que metteur en scène. Et comédien avant tout. Un comédien chimiquement pur. Nul n’a oublié ses envolées lyriques dans le rôle de Cripure. Courtaud, affligé d’un physique ingrat à la Charles Laughton, il était doté d’un charme irrésistible. Son sourire jovial, ses yeux plissés par la ruse, ce mélange unique de trivialité et de poésie, en faisaient un Falstaff natif. Ajoutez à cela son accent de gone de la Croix-Rousse, jamais tout à fait perdu, même quand il a quitté Lyon pour Marseille où il a fondé et dirigé La Criée (de 1981 à 1994), puis laissé Marseille pour Paris où il a repris le Rond-Point (1995-2000), et enfin pris la tête des Tréteaux de France (2001-2011) dont la mission itinérante s’accordait bien avec le talent baladeur de ce fils de chauffeur routier. J’ai dit qu’aucun de ses spectacles n’était parfait et ne m’en dédis pas. Mais il faut ajouter que ce saltimbanque avait un tel sens de la scène, un tel amour du public, qu’il n’ennuyait jamais. C’est grâce à vous, Marcel, et à Roger aussi, ne vous en déplaise, que m’est venue la passion du théâtre. Mes parents vous ont maudit mais moi, je vous rends grâce. Par Jacques Nerson Publié dans l’Obs le 12 juin 2020 -------------------------------------------------------------------------------- Hommage de Michaël Mélinard / L' Humanité : Marcel Maréchal, L'homme théâtre Metteur en scène et comédien, auteur et adaptateur, directeur, Marcel Maréchal est mort le 11 juin. Il a tout fait sur les planches au fil d’une carrière débutée à Lyon et poursuivi à Marseille, Paris et sur les routes de France. Il a beaucoup travaillé à la reconnaissance d’auteurs contemporains en revenant régulièrement aux classiques. Marcel Maréchal, metteur en scène, acteur, auteur, adaptateur et directeur de compagnie et de théâtre, est mort le 11 juin. « Si, pari stupide, je devais choisir entre toutes mes casquettes, c’est sûr que je choisirais d’être comédien. Parce que jouer est aussi aventureux que les exploits de Bombard ou de Thor Heyerdal » révélait-il dans « un colossal enfant », un livre d’entretiens. Avec lui, disparaît l’un des grands chantres de la décentralisation du théâtre opéré après guerre et un défenseur acharné du théâtre public. Pourtant, ses relations avec le ministère de tutelle n’ont pas toujours été au beau fixe. Né en 1937 à Lyon, il y fonde et dirige le théâtre du Cothurne en 1958. Il met en scène Beckett, Goldoni, Anouilh, Audiberti, Ionesco, Marlowe ou Louis Guilloux. Une ancienne halle aux poissons C’est là que débutent Pierre et Catherine Arditi, Marcel Bozonnet ou Maurice Benichou. En mai 1968, il inaugure le théâtre du Huitième, toujours dans la capitale des Gaules. Avec sa troupe de la compagnie du Cothurne, il revisite Shakespeare, Nazim Hikmet, Georg Buchner ou Kateb Yacine, continuant un travail axé sur les auteurs contemporains, sans délaisser le théâtre classique. L’aventure théâtrale se poursuit à Marseille, d’abord au théâtre du Gymnase à partir de 1975. Mais son grand œuvre reste la fondation du théâtre de la Criée, une ancienne halle aux poissons, située sur le vieux port. Inauguré en 1981, il offre à la cité phocéenne un espace à la hauteur de ses ambitions culturelles. Il y demeure près de 15 ans. Shakespeare, Molière, Beaumarchais, Dumas ou Théophile Gautier y côtoient Sam Shepard, David Mamet, Jean Genet ou Valère Novarina. Lieu itinérant En 1995, il est nommé à la tête du théâtre du Rond-Point à Paris. L’exercice n’est pas de tout repos entre les critiques pas toujours tendres avec lui et les cafouillages de Catherine Trautmann, la ministre de la culture, au moment de sa succession. Il a tout de même contribué à rénover ce lieu, situé à côté des Champs-Elysées et devenu aujourd’hui l’une des salles parisiennes les plus courues. En 2000, à l’issue de son mandat parisien, Maréchal espère faire son retour à Lyon au théâtre des Célestins. Il hérite finalement en 2001 du théâtre des Tréteaux, lieu itinérant comme un pied de nez à son histoire familiale. « L’aventure sous chapiteau me fait rêver depuis longtemps. J’ai deux souvenirs magiques de théâtre rattachés à cette forme de présentation, La Bonne Âme de Se-Tchouan, montée par Jean Dasté, et Richard III, avec Vittorio Gassmann, qui a mené une expérience de théâtre populaire en Italie. J’avais très envie de jouer sous chapiteau. Mon père, qui possédait une petite entreprise de camionnage, aurait bien ri de ma promotion » confie-t-il alors au Figaro alors que son aventure mobile commence. L’histoire se poursuit jusqu’au début des années 2010 où le Bourgeois gentilhomme conclut son parcours aux Tréteaux. S’il a beaucoup joué dans ses mises en scène, il a aussi été dirigé par d’autres : Chéreau dans Don Juam en 1969, Vitez à Avignon, dans la cour des comédiens de Lavaudant en 1996 ou encore dans une adaptation d’Israël Horovitz, Opus Cœur, mise en scène par Caroline Damay en 2015. Affaibli depuis quelques années, il s’est éteint à l’âge de 82 ans. ------------------------------------- Hommage de Stéphane Capron / Sceneweb Un grand nom de la décentralisation théâtrale française vient de mourir, le metteur en scène Marcel Maréchal. Il est décédé à l’âge de 83 ans. Il a dirigé des théâtres prestigieux comme la Criée à Marseille ou les Tréteaux de France. Avec la disparition de Marcel Maréchal, c’est l’un des derniers pionniers de la décentralisation qui s’éteint. Il débute sa carrière à Lyon à la fin des années 50 et fonde le Théâtre du Cothurne qu’il dirige pendant 17 ans. C’est dans cette troupe que Pierre Arditi fait ses premiers pas d’acteur. Lorsqu’il inaugure en 1968, le Théâtre du 8ème toujours à Lyon, il ouvre la programmation à la musique. Il est le premier à accueillir en France Mick Jagger, les Who ou les Pink Floyd… On est alors très loin du théâtre de Jacques Audiberti dont il présente deux pièces dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon en 73 et 74. Dans les années 80, avec le développement de la décentralisation, Marcel Maréchal fonde La Criée, le Théâtre national de Marseille. Il y joue pendant 13 ans, les plus grandes pièces du répertoire. Puis on lui confie en 95 le théâtre du Rond-Point dont il fait moderniser la grande salle qui prend alors le nom de Renaud-Barrault.
En 2001, à 64 ans, il devient le directeur des Tréteaux de France, le seul centre dramatique de France itinérant. Marcel Maréchal peut ainsi continuer de sillonner pendant 10 ans la France en interprétant ses pièces fétiches de Molière, Dandin ou Le bourgeois gentilhomme.
Stéphane Capron ---------------------------------------- Sur les réseaux sociaux : Jack Lang, sur Facebook : Marcel Marechal, celui pour qui Molière et tant d’autres grands dramaturges n’avaient pas de secrets ne rugira plus sur les planches. Quelle tristesse pour le théâtre français. Tout au long de sa vie, il s’est engagé pour celui-ci. Grand militant de la décentralisation culturelle, de Lyon, à Marseille, à Paris, il aura tant oeuvré pour faire vivre les tréteaux de France ! Acteur, metteur en scène, écrivain, j’aimais sa poésie, immense et généreuse, et sa vigueur contagieuse. C’était un prince intrépide et expressif des mots. Comme le mistral qui souffle à Marseille, Il avait la voix forte, orageuse et la faconde si belle, si méditerranéenne. Combien de talents nous a fait découvrir Marcel Maréchal ? Des acteurs, comme Pierre Arditi ou Maurice Bénichou, mais aussi des auteurs, comme Jean Vauthier ou Louis Guilloux. Optimiste déterminé, il avait le goût de la vie et de la joie. Il aura été un artiste total, un homme-orchestre entièrement dédié aux arts et à la culture. Il me manquera beaucoup. Toutes mes pensées vont aujourd’hui à sa famille et à son fils Mathias. ------------------------------------------------------ Le metteur en scène Renaud-Marie Leblanc J'étais encore un jeune adolescent très mal dégrossi, gauche et inculte lorsque dans les années 80, je pénétrais pour la première fois une salle de théâtre. C'était Le Théâtre La Criée à Marseille, dans cette grande salle aux allures de paquebot. On y jouait Capitaine Bada de Jean Vauthier. Je ne connaissais rien du théâtre. Je n'y étais jamais allé. Sur scène, #marcelmaréchal, acteur, metteur en scène et directeur du théâtre. Je me souviens encore de lui comme si c'était hier, virevoltant, incandescent, libre! oui libre. c'est le souvenir que je veux emporter de Marcel, et qui a bouleversé ma vie ce jour-là. Plus tard, il m'aura croisé sur un travail d'atelier où je travaillais Capitaine Bada, justement. C'était très mauvais. il avait été d'une bienveillance extrême, de celle qui n'existe presque plus aujourd'hui. Plus tard, encore, je participerai à l’aventure. Cripure, Tartuffe, Le Malade Imaginaire, La Paix, Les Paravents, Falstafe. Tout cela de mes 21 à mes 25 ans. Marcel enthousiaste, Marcel qui m'appelait Monsieur l'évêque à cause de ce Marie dans mon prénom, Marcel qui me dit un jour à une lecture de note " c'est très bien, je n'ai rien à te dire", Marcel colérique et il fallait déguerpir vite, Marcel te faisant une blague juste avant que tu rentres sur le plateau avec lui, Marcel n'arrivant pas à retenir son texte du monologue du Malade Imaginaire, Marcel farceur, Marcel joyeux, Marcel en apesanteur, un soir, sur scène, réinventant tout... Marcel, chef de troupe : toutes ces rencontres, tous ces gens, toutes ces humanités partagées, ces fêtes aussi, chez lui, dans sa famille; Marcel et sa famille si accueillante, si fragile aussi. Cet homme aura bouleversé ma vie, il m'aura fait aimé le théâtre comme personne. je me souviens aussi de la fascination qu'il avait pour les auteurs, pour la langue. Je crois qu'il restait toujours impressionné par les mots, par la poésie, comme un enfant qui découvre les pouvoirs du langage. Audiberti, Vauthier, Novarina ( oui , on oublie qu'il a été l'un des premiers à faire découvrir l'écriture de Novarina). Plus tard, comme metteur en scène, j'ai monté le Malade Imaginaire de Molière. je me suis souvenu de ce qu'il disait : c'est la pièce la plus Shakespearienne de Molière. Quelque part, Molière , c'était lui, dans ses excès, sa générosité, son élan solaire. Un soleil, oui c'est ça. Marcel, c'était un soleil qui aimait les gens. Simplement. Marcel était autodidacte, il ne faisait rien comme personne. C'était sa force. La liberté. Je t'ai aimé Marcel, comme un autre père, même si tu ne l'as jamais su. et je crois que mon père, le vrai, t'as aimé aussi de m'aimer quelque part un peu. Aujourd'hui Marcel Maréchal s'en est allé. Pas pour moi. Pas pour nous, tous ceux qui ont vibré un jour dans une de tes aventures théâtrales. Tu resteras une étoile incandescente dans la constellation du théâtre. J'ai une pensée émue et profonde pour ses proches et ses enfants, Mathias Maréchal et Laurence. Au revoir Marcel Renaud-Marie Leblanc ----------------------------------------------------------- Marcel Maréchal est mort. S’il y a une origine, c’est celle-ci : 1983 ? 1984 ? Un soir, mes parents nous emmènent, mon frère et moi, voir une représentation des « Trois Mousquetaires » à la Maison des Arts de Créteil. Je crois que c’est le premier spectacle que je vais voir, qui n’est pas spécifiquement destiné aux enfants. Ce que je vois me bouleverse ; tout est merveilleux et magique. Ça y est, je veux être acteur, ou mousquetaire, je veux être là, sur scène, avec eux, courir, combattre, aimer, sous le faux soleil du théâtre, ovationné par huit cents personnes. Cette soirée va, littéralement, changer ma vie. Mes parents vont m’inscrire à l’atelier théâtral d’Ivry ; moi, petit garçon introverti, enfermé en lui-même, je vais découvrir que je peux parler. Surmonter ma peur, la transformer - aller sur scène et parler ! Être regardé, écouté. Jouer avec les autres. Dire les mots des autres. Être plus heureux, plus fort, sur scène - avec eux. Merci maman, merci papa. Et merci, Monsieur Maréchal. Adrien Michaux --------------------------------------------------- Page des Tréteaux de France Si cher Marcel... De grand et de tout coeur avec nos si grands si beaux moments de notre jeunesse... dix-huit ans de partage, côte à côte... le meilleur du théâtre. Mes plus chaleureuses pensées à Luce, Mathias, Laurence. Pierre LavilleNous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de Marcel Maréchal ce 12 juin 2020.
Il aura été un grand comédien, auteur, metteur en scène passionné et un découvreur de talents. Depuis sa compagnie du Cothurne créée à Lyon en 1958, jusqu’aux Tréteaux de France qu'il dirigea de 2001 à 2011, en passant par le Théâtre de la Criée à Marseille et le Théâtre du Rond-Point à Paris, il laissera le souvenir de nombreuses mises en scène foisonnantes et débridées. On se souviendra de ses adaptations des Trois Mousquetaires et de Capitaine Fracasse, de son grand amour pour Alexandre Dumas et Théophile Gautier mais aussi de sa passion pour Audiberti, Louis Guilloux, Kateb Yacine… Toute l'équipe des Tréteaux de France - Centre dramatique national adresse à sa famille et à ses proches leurs pensées de soutien et de réconfort les plus affectueuses. Robin Renucci Comédien, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France CDN ----------------------------------------------------- Merci Marcel ! Marcel Maréchal a quitté la scène du monde.
Avec lui, part un pan de l'histoire d'un théâtre de création populaire de haute tenue.
Avec lui, part un pan de l'histoire de Marseille, de ce Théâtre du Gymnase à cette Criée qu'il a rêvée, inaugurée et dont il a encré définitivement la nature profonde sur les quais du port...
Il y a impulsé et créé, joué et dirigé avec une énergie belle et des envols de poésie touchant, les publics les plus variés si bien qu'il a « fabriqué » durablement le public marseillais.
Incroyable « bête de scène », son sens du plateau l'amenait immanquablement à faire mouche à chaque mot ou regard…
En tant que « patron » et meneur d'équipes, s'il pouvait paraître parfois ailleurs – main sur les babines, brouillant ses traits, regard perdu, cheveux en bataille, au fond, il était là, aux côtés de chacun dans sa singularité et sa capacité à se mettre au service du projet artistique qu'il portait... et partageait d'abord avec ses équipes, ensuite avec le public. Au-delà de son côté un peu ours timide, homme du monde, il savait s'ouvrir et accueillir l'Autre.
C'est comme çà que je l'ai connu alors que, jeune étudiante en Arts plastiques, j'avais demandé à son décorateur de l'époque, Alain Batifoulier, quel chemin prendre, quelle formation effectuer, pour devenir décoratrice de théâtre comme on disait à l'époque... Deux semaines plutard, j'étais assistante de décoration pour les trois créations du Graal théâtre. C'est là qu'entre Marcel, Alain, Bernard Ballet et Gaston Serre, j'ai appris un métier d'humanité, de solidarités et de créativité. Homme de fidélités, il m'a intégrée pour cinq années décisives pour mon parcours personnel à ses équipes dans lesquelles j'alternais entre l'assistanat de décoration et la réalisation des archives du TNM sous la direction du regretté Jean Rouvet, un être hors du commun s'il en fut. Homme de la main tendue, il a accueilli le Théâtre de la mer et les créations d'Akel Akian dans ses programmations, lui ouvrant large les portes de sa « Petite salle ». Nous sommes encore quelques uns à nous souvenir des youyous des mamans des Quartiers Nord à La Criée, que ce soit lors de la conférence de presse de « Baisers d'hirondelles » ou dans la salle au milieu des applaudissements en fin des représentations. Je me rappelle aussi... C'est la dernière fois que je l'ai vu... c'était à la Librairie des Arcenaulx, lors d'une de ses lectures... Il commence à lire, lève les yeux, son regard tombe sur moi... Il s'interrompt... et lance un vibrant hommage à Akel Akian... Sans aucun doute, ces deux anciens lyonnais, l'un des traboules, l'autre émigré des oueds et terres rouges du Maroc, se sont reconnus, rencontrés, à Lyon, à Marseille, sur les scènes et dans ces mondes de poésies où ils respiraient ensemble. Avec Marcel Maréchal une part du théâtre du XXéme siècle s'est refermée. Gageons que chaque parcelle de théâtralité qu'il a semée sur sa trajectoire inspirée germe et germera encore.
Avec lui, s'est écrite une part de mon histoire professionnelle, la plus fondatrice.
A toi, Marcel, reconnaissante !
Que les scènes de l'imaginaire te fassent une place de choix où continuer à jouer, à l'infini...
Frédérique Fuzibet, metteuse en scène, scénographe ------------------------------------------------------------ Mon Merlin l’enchanteur C’était en 1977, j’avais 11 ans. Avec ma classe de 6e, pour la première fois, j’allais au théâtre, voir Merlin l’enchanteur. Au Théâtre du Gymnase. On était tout en haut, dans la promenade, debout tout du long, émus ensemble, transportés.
Depuis ce jour l’amour du théâtre ne m’a pas quittée, ce bonheur quand les lumières s’éteignent et que les acteurs apparaissent, ce plaisir de leur présence véritable dans un espace qui, pourtant, n’est pas tout à fait réel…
Marcel Maréchal m’a conduite au théâtre. Avec la magie de Merlin, puis avec les Trois Mousquetaires, le capitaine Fracasse, cette culture populaire qu’il revisitait comme un enfant. Puis il m’a fait aimer Vauthier, Audiberti surtout, Louis Guilloux. Et il a aiguisé mon sens critique parce qu’il ne connaissait pas ses textes, bafouillait, ouvrait les bras et partait en funambule sur des sommets improvisés. Parce qu’il ne comprenait pas Genet, ne s’intéressait pas aux pièces de femmes, montait Beaumarchais comme un Labiche, Brecht, Shakespeare et Tchekhov comme un Beaumarchais… et Novarina comme il aurait dû monter Shakespeare !
Mais justement c’est à La Criée, dans ce théâtre qu’il avait fondé, que je suis venue au monde. A ce second monde que j’aime tant hanter aujourd’hui encore, même lorsque j’y suis déçue, parce qu’il suscite la parole, la relation, l’ouverture. Le débat, la critique, l’écriture. La vie, le plaisir, la pensée, la joie. Marcel Maréchal nous a quittés alors que nous sommes encore privés de spectacle. Que nos corps réclament de se retrouver, côte à côte, le regard tourné vers le même horizon, la même fable, la même illusion incarnée. Plus que jamais nous avons besoin de théâtre. Ancien, nouveau, exigeant, populaire, et toujours d’aujourd’hui. Agnès Freschel, journaliste, directrice du magazine Zibeline -------------------------------------------------------------- La chose que je voudrais ajouter concernant Marcel Maréchal, c'est qu'il était le plus fidèle à Jean Vilar au regard des nombreux metteurs en scène de sa génération qui lui avaient tourné le dos voire qui le dénigraient. Bruno Boussagol, metteur en scène -------------------------------------------------------------- Serge Pauthe, comédien MARCEL MARÉCHAL NOUS A QUITTÉS Sa vie s’est envolée cette nuit et tous les souvenirs qui me rattachent à lui à l'instant me reviennent. Afflux d'émotions reliées autant à la vie tout(e) court(e) qu’au théâtre partagé quelques années ensemble à Lyon, puis à Marseille. Ce fut mon patron pendant 8 ans. A Lyon, au Théâtre du Huitième. Puis à Marseille au Théâtre de la Criée. D’abord, j’étais l’un de ses spectateurs au petit théâtre de la rue des Marronniers à Lyon. J’ai vu son « Capitaine BADA » de Jean Vauthier. En compagnie de Luce Mélite, il interprétait ce personnage, déchiré par la souffrance d’un amour absolu. Porté par une voix intérieure semblable à un murmure, parfaitement timbrée et teintée d'un lyrisme qui sera toujours reconnaissable dans ses rôles futurs. Je ne le cache pas. J’étais un fana de ce nouveau comédien et je ne manquais aucune de ses créations. Particulièrement au Festival de Couzan, un petit village du Haut-Forez à quelques encâblures de Saint-Etienne. Là-haut, dans les ruines d’un château médiéval, il joua LA MOSCHETA de l’auteur Ruzante, ce noble Vénitien qui montrait comment vivent les pauvres à toutes les Seigneuries, Doges en tête, dans la Venise du XVème Siècle. Nous n’étions pas loin de 1968 et Maréchal, avec Bernard Ballet, Jean-Jacques Lagarde et Jacques Angéniol, décorateur et acteur, avaient assemblé, au milieu des murailles moyenâgeuses éparpillées sur le sol, tout un fatras de matériaux que les pauvres du monde entier récupèrent dans les poubelles pour se construire une maison, dans les bidonvilles des banlieues de Paris ou de Mexico. Le cri de Ruzzante se propageait ailleurs qu’à Venise et vous emplissait de fureur et d’émotion. Voilà l’artiste tout neuf dont je fis connaissance en ce temps-là. Il vint jouer en 1972 son « FRACASSE » à la Comédie de Saint-Etienne. Heureux de nous revoir, il me demanda si je voulais le rejoindre à Lyon au Théâtre du Huitième. J’acceptais à condition qu’il me permette de monter un spectacle poétique à partir de l’œuvre de Nâzim HIKMET, ce poète turc que je chérissais comme un frère. Promesse tenue. Geste fraternel d'un comédien hors-pair envers un poète universel. Cela restera gravé en moi et j'aurai toujours pour Marcel une reconnaissance éternelle. Marcel Maréchal, c'est un artiste né à Lyon, le soir de la Noël. Il s’appelait parfois Marcel-Noël Maréchal, c’est joli, non ? Il admirait Laurent Mourguet, le créateur du Guignol Lyonnais au temps de la Révolution. Son coté râleur et bon vivant l'inspirera au point qu’il écrivit une pièce pour raconter sa vie. Mais Marcel était fait de chair, d’os, de rires et de larmes. Il porta sur la scène les plus grands textes devant un public immense qui savait l'apprécier. Il était populaire au meilleur sens du terme. Il bannissait les méchantes critiques par un surcroît de travail. Toujours inspiré par la lecture permanente de ses poètes et auteurs favoris. Je cite au hasard Rimbaud, Audiberti, Molière, Guilloux et son Cripure.. Ah! Cripure! Surnom donné par les élèves du lycée de Saint-Brieuc au Professeur Merlin, objet de moqueries. Ce prof’ adorait enseigner Kant et sa « Critique de la Raison Pure » et les chenapans l’avait donc surnommé « Cripure »…Donc, Maréchal interpréta magistralement ce personnage. Y a t'il dans la vie d'un acteur une telle fusion avec un personnage né dans l’imagination d’un auteur ? Peut-être entre Knock et Jouvet? Ou Luchini avec…Luchini ? Au temps où Maréchal vivait à Lyon, la vie théâtrale ne manquait ni d’émulation, ni de confrontation. En 1968, le Ministère nomma Maréchal à la tête du Centre Dramatique de Lyon. Mais à Villeurbanne, Roger Planchon et son Théâtre de la Cité avait « pignon sur rue » depuis les années 50. Maréchal était son cadet et il lui fallait exister à coté de son génial voisin. On disait parfois que Brecht était à Villeurbanne et Aristophane dans le 8ème Arrondissement de Lyon. C’était parfois comme deux navires au large de Saint-Malo qui se tiraient la bourre pour arriver bon premier. Mais heureusement, l’ami Jean-Jacques Lerrant, fin critique au « Progrès de Lyon », les aimait bien tous les deux. Et le public ne désertait aucune des salles. Il ne choisissait pas selon l’humeur du moment. C’était encore le beau temps du Théâtre Populaire. Maréchal créait une pièce de Kateb et invitait Gatti. Planchon « Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale » de Brecht avec Jean Bouise dans le rôle titre… J’ai vécu toutes ces années au cœur de ce creuset théâtral et je le dois tout de même à Marcel qui donna tout son talent pour que vive une intense activité théâtrale. Qui donna lieu à l’éclosion de nouveaux artistes. Toutes mes pensées émues vont ce matin vers son fils Mathias, sa sœur et sa maman. Et à tous ses compagnons qui sont restés si proches de lui. Et à tous mes ami..e…s Lyonnais qui ont vécu ces années-là et que j’embrasse affectueusement. Serge PAUTHE ------------------------------------------ Marcel Maréchal, un grand homme de théâtre qui a fait vibrer plein de belles nuits du Théâtre de la Mer à Sète. Il a enchanté nos jeunes années d'élèves de ce métier. Je me souviens du "Fracasse", et de toutes ses géniales mises en scènes, comme "La moscheta" de Ruzzante, "Godot,"Les prodiges" de Vauthier"... où nous apprenions tant. Énergie, invention, audace, sens du plaisir. Un de nos maîtres. Moni Grégo, comédienne -------------------------- Documents audio et vidéo, liens : Archive INA-France Culture 5 entretiens radiophoniques de 28 minutes : https://entretiens.ina.fr/en-scenes/Marechal/marcel-marechal Archive Ina : La Puce à l’oreille par la Comédie-Française, 1985 : https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00377/la-puce-a-l-oreille-de-georges-feydeau-mise-en-scene-par-marcel-marechal.html Archive vidéo « Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg, avec Marcel Maréchal et Pierre Arditi : https://www.youtube.com/watch?v=iRVkieN8p9U Rencontre avec Marcel Maréchal, masterclass en février 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=96zJdlVQ4N8 Présentation de « En attendant Godot » de Beckett, avec Pierre Arditi, Robert Hirsch, Jean-Michel Dupuis, Marcel maréchal, mise en scène Patrice Kerbrat au Théâtre du Rond-Point (1997) : https://www.ina.fr/video/I00013833 En 2009, dans l'émission de France 3 "Les Mots de minuit", il évoque Jacques Audiberti :
"Audiberti avait une sorte de fils spirituel : Marcel Maréchal, un saltimbanque coloré, joyeux et angoissé. Celui-ci a lui-même un fils, spirituel et biologique cette fois, un jeune homme gracieux. Tout cela, c’est la même famille poétique, venue de la Méditerranée. Audiberti et fils. Ils sont tous réunis sur la scène, corps et âme. Et dans une adaptation ingénieuse et une mise en scène délicate, signées François Bourgeat, ils chantent la chanson de la filiation, la chanson de l’humanité, de l’origine à l’éternité, la chanson du mystère de l’homme et de sa reproduction. Le père apprend la vraie vie à son fils qui rêve la vie.”
Philippe Tesson. Le Figaro, 15 octobre 2007. En lien une vidéo extraite des "Mots de minuit" en 2007, où Marcel Maréchal évoque son rapport à l'oeuvre et la personne d'Audiberti. http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 1:30 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama 12/06/2020
Fort en langue et en gueule, généreux, il était doté d’une extraordinaire palette qui lui a permis d’évoluer dans de nombreux registres. Le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, créateur de La Criée, à Marseille, vient de disparaître à l’âge de 83 ans.
L’œil gourmand et le sourire goguenard, la tignasse bouclée enfantine et la bouille réjouie – qui savait aussi se faire colérique et terrible, voir son interprétation du roi Lear… –, Marcel Maréchal fut un tonitruant et généreux acteur. De la veine des bateleurs, de la grande tradition des tréteaux. Mais avec une palette de toutes les couleurs, de toutes les matières, de toutes les fureurs. De Scapin au Malade imaginaire, d’Arnolphe à Sganarelle, de Fracasse à Falstaff, de maître Puntila à Cripure, cet amoureux de Molière comme des contemporains forts en langue et en gueule – de Jean Vauthier à Louis Guilloux, sans oublier Jacques Audiberti – fut un admirable serviteur des textes et de leurs musiques scéniques. Il les laisse orphelins. Il vient de disparaître à 83 ans.
Un amoureux des mots en effet. Cet autodidacte lyonnais né en 1937 sut les faire rayonner comme des soleils ou des plats raffinés de sa ville. C’est l’amour même de cette parole, de ce dialogue à faire naître avec le public qu’il aimait tant, qui le poussa, dès 21 ans, à diriger des théâtres. Et le meilleur, le plus savoureux de son parcours artistique rabelaisien se niche dans ces années 1950 où s’invente la décentralisation imaginée après guerre.
C’est à Lyon, au Théâtre du Cothurne qu’il fonde en 1958 – dans la lignée de son aîné Roger Planchon, autre fameux homme de théâtre lyonnais – que commence l’odyssée théâtrale populaire du prodigieux cabot. Sa passion des poètes lui fait programmer d’emblée contemporains et classiques dans des mises en scène qui n’ont pour ambition que de faire sonner le texte et réjouir les spectateurs.
Spectacles hauts en couleur
À La Criée, qu’il ouvre sur le Vieux-Port de Marseille en 1981 – après avoir dirigé, à Lyon toujours, le Théâtre du Huitième, puis le Gymnase à Marseille –, il saura cultiver les mêmes bonheurs de jeu et de spectacles hauts en couleur et pêchus, ouvertement hérités d’un théâtre populaire à la Jean Vilar, où flamboient uniquement jeu de l’acteur et respect de l’auteur. D’Alexandre Dumas à Bertolt Brecht, de Shakespeare à Jean Vauthier, de Beckett à Jean Genet, de Novarina à Tchekhov, ses programmations étaient toujours ambitieuses et pleines de drames et de joies.
Hélas, Marcel Maréchal rêva un jour de quitter les territoires pour monter à la capitale. L’aventure ne lui réussit pas. Il n’en possédait pas les codes. Nommé au Théâtre du Rond-Point en 1995, il ne sut guère réveiller le palais endormi que lui avaient laissé les Renaud-Barrault et y accumula les spectacles médiocres, dépourvus de cet esprit flambant qu’il avait eu autrefois. L’air de Paris allait mal au tribun des planches. La critique l’abandonna, le public aussi.
Galère parisienne
La qualité exceptionnelle de son parcours passé lui valut quand même de diriger, à partir de 2001, les Tréteaux de France. Jusqu’à 2011, il n’y fit pas non plus merveille, reprenant de vieilles recettes, aigri peut-être de n’avoir jamais eu la reconnaissance méritée…
Mais après des parcours lyonnais et marseillais fondateurs et exemplaires, que diable Marcel Maréchal allait-il faire dans la galère parisienne ? Elle broya ses gourmandises, ses générosités, ses ambitions.
Reste un homme de scène qui jamais ne lâcha le plateau, un acteur metteur en scène qui eut jusqu’au bout la passion de jouer les spectacles qu’il montait, souvent autour de lui. Narcissisme ? L’homme avait trop à cœur d’embarquer son public dans l’aventure du verbe. Plutôt feu sacré. Et il est essentiel qu’il continue partout d’en brûler.
Légende photo : Cripure de Louis Guilloux. Mise en scène de Marcel Maréchal. Paris, Petit T.N.P., avril 1967. © Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 2, 2020 3:29 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 2 juin 2020
Le grand public ne la connaissait pas. Mais le monde du théâtre, oui. Elle aura passé plus de cinquante années à mettre en lumière des talents et à faire vivre des lieux.
Elle était souriante. Très souriante. Petite de taille, grande de force d’âme. Rayonnante et volontiers rieuse. On ne peut la séparer de deux personnalités très belles, qui l’ont accompagnée : sa mère, la comédienne Jenny Bellay et son amie, la femme de sa vie, Dominique Darzacq, journaliste et défenseuse sans faille du beau, du bon théâtre et de celles et ceux qui le font vivre.
Longtemps on s’était inquiétés pour Dominique qui avait dû faire face à la maladie, il y a des années. Elle luttait. Toujours. Martine Spangaro, à son tour, dut affronter de graves problèmes et des maux en cascade. Elle tenait bon. Et puis, le 31 mai, elle s’est éteinte. Elle avait 74 ans. La date de ses obsèques n’a pas encore été fixée.
Rares étaient les soirs où l’on ne rencontrait pas Martine et Dominique. Il fallait que ses obligations la retiennent dans un lieu ou un autre, pour que Martine Spangaro n’assiste pas aux premières représentations des spectacles. Elle avait le regard, le cœur. La bienveillance. Mais devant les prétentieux et autres faux intellectuels, elle était drôle et caustique. Elle était de cette génération à qui on ne la fait pas, si l’on peut ainsi s’exprimer !
Elle était née le 28 mars 1946 et avait fait ses études à Paris et Evreux. Le club de théâtre lui plaît. Et l’exemple de sa mère, bien sûr, qui a fait une très belle carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision et qui, encore récemment, donnait le merveilleux spectacle qu’elle a consacré à Colette.
Martine Spangaro était très fière de sa mère, comédienne qui, il y a encore quelque temps, jouait Colette.
Martine Spangaro a à peine plus de 20 ans, lorsque, à partir de 1968, elle fait ses premiers pas professionnels et affermit son apprentissage au sein d’une association intitulée « Théâtre de la Région Parisienne ». La décentralisation n’est pas encore lancée à pleine vitesse…Mais elle s’esquisse à échelle de la couronne de la capitale, quand, dans la foulée, sera donné au Théâtre de la Commune sa pleine ampleur. Comme au théâtre de Saint-Denis.
En 1971, Martine Spangaro est à Besançon. Elle a le poste, essentiel, de secrétaire générale et participe à l’élaboration de la programmation et donne une impulsion vive aux décisions.
Mais c’est évidemment à Saint-Denis, au Théâtre Gérard-Philipe, auprès de René Gonzalez, qu’elle va s’épanouir, secondant un homme merveilleux qui aura été un découvreur, un bâtisseur, un soutien de la création, partout où il sera passé, après avoir été, quelques années durant, comédien. De Saint-Denis à la MC93, l’Opéra-Bastille et bien sûr Vidy-Lausanne, Martine Spangaro était demeurée très proche de René Gonzalez, mais avait suivi son propre parcours.
Secrétaire générale, chargée des relations publiques et des relations avec la presse, elle veille, découvrant de jeunes talents, participant à la mise en lumière d’auteurs, de metteurs en scène, de techniciens, de comédiens et comédiennes, jusqu’alors inconnus. Elle passe des années à Saint-Denis : de 1974 à 1986, douze années d’une fertilité exemplaire. Théâtre, mais aussi musique et chant, avec Michel Hermon et Giovanna Marini.
Alfredo Arias fait appel à sa personnalité sûre, en 1986, lorsqu’il accède à la direction du centre dramatique d’Aubervilliers, le Théâtre de la Commune. Avec la rigueur et la fantaisie de Martine Spangaro, il élabore une transformation enchantée du lieu et met en place une programmation à son image. Le théâtre renaît.
Enfin, et ce sera l’ultime étape de sa carrière dans le secteur public de la culture, Martine Spangaro rejoint Claude Sévenier à la direction du Théâtre de Sartrouville. Encore les brillantes années d’un théâtre « élitaire pour tous ». De 1989 à 2006, son imagination s’allie à merveille aux missions de cette institution. On retrouve là des artistes aimés de Gonzalez, de Sévenier et d’elle depuis longtemps : Joël Jouanneau qui met en scène ses propres textes et beaucoup d’autres, la chanteuse et comédienne Angélique Ionatos qui de sa voix sublime illumine les soirées de Sartrouville. Et elle met sur pied le festival qui dure encore, un festival de création pour le jeune public, qui essaime dans le département : Odyssées-en-Yvelines. Spectacles pour les jeunes mais d’une qualité telle, d’une originalité si profonde, que l’ensemble du public suit la manifestation. La douzième édition de cette biennale a eu lieu de janvier à mi-mars 2020. Enfin un festival qui a échappé au confinement. Juste à temps !
Le livre des riches heures de Martine Spangaro n’était pas encore refermé. C’est à Avignon, dans le « off » qu’on allait la retrouver. Directrice artistique du Petit Louvre, rue Saint-Agricol, un espace dont elle fit en quelque temps l’une des meilleures adresses d’Avignon. Avec Claude Sévenier, appelé par les propriétaires, Sylvie et Jean Gourdon. Dès le premier été, elle avait imprimé sa marque avec son patron et alter ego en fait, Claude Sévenier. Malheureusement, Claude s’était éteint en février 2016.
Martine Spangaro avait poursuivi sa mission. Elle déplorait de ne pouvoir accueillir les artistes dans de meilleures conditions, mais c’est la loi de la cité des Papes. Le public est là, on joue, mais parfois l’épreuve est sans confort. Tout le monde aimait rejoindre Martine, faire partie de l’équipe de Martine.
Les metteurs en scène lui faisaient une grande confiance et lui demandaient de les assister. Ainsi Alfredo Arias, ainsi Marc Paquien, et quelques autres. Elle se taisait sur la maladie. Elle était aussi pudique que courageuse. Nos pensées vont à sa famille, sa maman, Jenny, et à Dominique.
Martine Spangaro avait quelque chose d’une grande sœur un peu magicienne. Elle réchauffait les cœurs et les plateaux. Une âme de théâtre.
A lire : Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).
Légende photo : Martine Spangaro, souriante et solaire. DR ------------------------------------------------------------------- L'hommage de Gilles Costaz dans Webthéâtre : Une vie au service du théâtre Martine Spangaro nous a quittés le 31 mai. Elle était, dans le monde du théâtre, une femme de l’ombre qui rayonnait d’une grande lumière et ne cessa de participer à l’activité artistique française. Que d’étapes dans cette vie qui s’achève trop tôt, en raison d’une douloureuse maladie ! Dans les années 60, elle était déjà partie prenante au TRP (Théâtre de la région parisienne) qui préparait la décentralisation en banlieue en faisant circuler les spectacles de Pauline Carton, Gabriel Garran, Pierre Debauche, Georges Brassens… Ensuite, coup sur coup, elle collabore à la création de deux Centres dramatiques matinaux, à Limoges puis à Besançon. Elle est ensuite secrétaire générale, au côté de René Gonzalez, du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis : ce sont de grandes années, fécondes et chahuteuses, comme en témoigne le précieux livre de Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).
Ensuite, ce sera l’aventure centrale de sa carrière : la prise en main, avec Claude Sévenier, du Centre d’animation culturelle de Sartrouville, qui deviendra Centre dramatique national. Sévenier et elle, en tant que codirectrice, imaginent des formules nouvelles, comme celle de donner des moyens à des artistes invités (ce seront Angélique Ionatos et Joël Jouanneau) ou le fameux festival jeune public Odyssées-en-Yvelines.
Quand elle quitte Sartrouville, elle s’occupe, d’une manière inattendue, d’une salle du off d’Avignon, le Petit Louvre. D’abord avec Sévenier, puis seule, après la mort de celui-ci. Tous les familiers d’Avignon savent quel lieu important fut le Petit Louvre, avec ses deux salles rue Saint-Agricol, l’une en étage, l’autre dans l’ampleur d’une ancienne chapelle. Pendant dix ans, Martine Spangaro programme là ce qu’il y a de meilleur.
C’était une personnalité passionnée, très active, souriante, discrète. Elle aimait les artistes, elle savait les découvrir. Pour être près d’eux, elle a été assistante de certains metteurs en scène : Michel Vitold autrefois, Alfredo Arias et Marc Paquien plus récemment. Elle était l’une de ces personnalités qui font le théâtre, sans bruit, avec un talent particulier mais égal à celui de ceux qui sont en scène.
.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 28, 2020 5:27 PM
|
Publié dans Le Figaro, le 28 mai 2020 Bien sûr on oubliera jamais Paulette, la Drague et toutes les facéties drolatiques que Guy Bedos racontait avec un cynisme désopilant. Mais ce saltimbanque surdoué aura aussi marqué de la finesse de son jeu quelques-unes des comédies les plus douces-amères des années soixante et soixante-dix.
À lire aussi : «Il était beau, il était drôle, il était libre et courageux... » Mort de Guy Bedos à 85 ans
Son personnage de docteur séducteur et larmoyant dans Un éléphant ça trompe énormément et sa suite, Nous irons tous au Paradis était cultissime, - c'était mérité -, de son vivant. Et les dialogues des films d'Yves Robert étaient signés, et ce n'est pas un hasard, par son complice Jean-Loup Dabadie, qui deviendra le parrain de son fils, Nicolas, qu'il aura le temps de voir devenir un réalisateur accompli.
Ses jeunes années et son amitié avec Jean-Paul Belmondo appartiennent déjà à la légende du cinéma. On sait que les deux garnements revinrent d'une tournée dans toute la France en auto-stop. En 1963, Jacques Baratier eut la riche idée de rassembler à l'écran les deux inséparables d'autrefois. Le pitch du film avec le recul du temps ne manque pas de saveur. Guy Bedos incarnait un jeune homme de bonne famille qui rêvait de devenir acteur.... Quand la fiction rejoignait la réalité.
En 1965, le titre du film Les Copains lui donne l'occasion de se mesurer à l'œuvre de Jules Romains. Sous la direction d'Yves Robert, encore lui, déjà serait-on tenté d'écrire, avec une pléiade d'acteurs de talents (Philippe Noiret, Claude Rich, Michael Lonsdale) ils vont inventer des canulars à se tordre de rire. C'est en Auvergne, à Ambert, que sera déclamé dans la petite église du bourg un sermon... pas très catholique.
En 1970, dans Le Pistonné Claude Berri lui confie le rôle sur mesure d'un appelé du contingent très peu militariste, nommé Claude Langmann, le vrai nom à la ville du réalisateur. Cette critique à peine voilée de notre armée collera comme un gant à Guy Bedos qui ne cachait pas son dégoût et son mépris de l'esprit guerrier.
Enfin, évidemment, comment ne pas mentionner son rôle de bon copain Juif pied-noir aimant trop sa mère (Marthe Villalonga) dans Un éléphant ça trompe énormément et sa suite, aussi drôle, c'est assez rare pour le signaler, On Ira tous au Paradis. Encore une fois, il jouait un inséparable ami, tendre facétieux. Et il faut le dire, ce Simon Messina avait énormément de talent.
En hommage à Guy Bedos, Le Figaro présente, en vidéos, un florilège de sa carrière de Dragées au poivre à On ira tous au paradis en passant par Le Pistonné et Les Copains.
Dragées au poivre de Jacques Baratier en 1963, avec Jean-Paul Belmondo, Guy Bedos... (chanson du film en duo avec Sophie Daumier, paroles et musique de Serge Rezvani alias Cyrus Bassiak)
Les Copains d'Yves Robert en 1965, avec Philippe Noiret, Michael Lonsdale, Guy Bedos, Christian Marin...
Le Pistonné de Claude Berri en 1970, avec Guy Bedos, Rosy Varte, Coluche, Claude Piéplu, Jean-Pierre Marielle...
Un éléphant ça trompe énormément d'Yves Robert en 1976, avec Jean Rochefort, Victor Lanoux, Guy Bedos, Claude Brasseur...
Nous irons tous au paradis d'Yves Robert en 1977, avec Jean Rochefort, Victor Lanoux, Guy Bedos, Claude Brasseur...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 22, 2020 10:06 AM
|
Par Marie Baudet dans Lalibre.be le 21-05-2020
La nouvelle, jeudi, du décès d’Olindo Bolzan a plongé dans la stupeur et le chagrin le monde théâtral, qui salue un homme de cœur, un être d'une sensibilité rare, une âme généreuse pourfendeuse d’injustices, un camarade précieux, un regard précis.
Comédien hors normes, à la présence à la fois poétique et inquiétante, tendre et politique, Olindo Bolzan fit ses débuts sur scène aux côtés entre autres d’Anne-Marie Loop dans L’Annonce faite à Marie, de Claudel, par le Groupov.
Formé au conservatoire de Liège, il aura en près de trente ans de carrière visité tant le répertoire que la plus contemporaine des créations. Des Dario Fo ou du Thomas Bernhard de Françoise Bloch au puissant Décris-Ravage d’Adeline Rosenstein, en passant notamment par Tchekhov (La Mouette mise en scène par Jacques Delcuvellerie, La Cerisaie selon Thibaut Wenger) ou Shakespeare sous le regard de Martine Wijckaert ou d’Isabelle Pousseur.
Passé également devant la caméra de Chantal Akerman (Nuit et jour, 1991) ou des frères Dardenne (L’Enfant, 2005), Olindo Bolzan avait 58 ans.
Olindo Bolzan seul en scène, à la fois solaire et lunaire. © Lou Hérion ---------------------------------------------------------------------------------- Article publié dans Lesoir.be par Jean-Marie Wynants (22-05-2020) : En apprenant la mort du comédien Olindo Bolzan, à l’âge de 58 ans, son visage d’éternel gamin nous est instantanément apparu, à la fois malicieux et mélancolique. La première fois que nous l’avions découvert, c’était il y a 30 ans, dans « Les autres » de Jean-Claude Grumberg, mis en scène par Philippe Laurent. Déjà son regard, sa manière de bouger, de parler nous avait intrigué. On l’avait retrouvé ensuite, au fil des ans, dans les spectacles de Pietro Varrasso (Le Fou de Leïla, Le chemin du Serpent), Mathias Simons (Don Juan revient de guerre, Cœur de Pierre), Jean-Louis Colinet (Liliom), David Strosberg (L’enfant rêve), Jacques Delcuvellerie (La Mouette), Philippe Sireuil (La Forêt), Jean-François Noville (Under), Adeline Rosenstein (Décris-Ravage), Mélanie Laurent (Le dernier testament), Thibaut Wenger (La seconde surprise de l’amour)… (suite de l'article réservée aux abonnés) Jean-Marie Wynants Le Soir (Bruxelles)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 20, 2020 11:57 AM
|
Par Armelle Héliot dans Le Figaro - 19 mai 2020 Dès son adolescence, ce fils d'un violoniste et d'une pianiste, a aimé jouer. Malgré sa formidable carrière au cinéma, il n'a quasiment jamais quitté les planches
Un homme debout. Grand et droit. Avec un dos large. Des épaules à porter des tourments. Un front haut que dégagent les cheveux bruns et denses et que barrent deux sourcils noirs qui approfondissent le regard. Toujours été le même, Michel Piccoli qui s'est éteint à 94 ans. Les cheveux avaient grisonné, étaient devenus moussus sur les côtés. Mais il était tel qu'en 1945, lorsqu'il avait débuté. Un beau ténébreux tout enveloppé du charme de son ascendance italienne, mais surtout un très jeune homme de vingt ans, discret, timide, peu sûr de lui. Cependant porté par la certitude que le théâtre était sa patrie. Au collège d'Annel, à Compiègne, lors de la première apparition sur les planches du tout jeune adolescent de 10 ans – on est un enfant en 1935 - un adulte s'était écrié : « Mais il existe, ce petit ! » Jamais, pourtant, Michel Piccoli ne fit autre chose, au théâtre sa passion fondatrice, comme au cinéma, son allégresse enchantée, que de mettre à l'épreuve son talent, son métier, ses certitudes. Il avait une formule : « Que le jeu de l'acteur ne soit plus la peinture de nos hypocrisies, qu'il en soit le scalpel. » Elle était empruntée à l'un de ses maîtres. Il n'aurait pas imaginé ne pas aller vers ses aînés. Se plier à leurs disciplines. Au cours de Madame Bauer-Thérond qui se soucie d'articulation et de grands textes et que fréquentent Maria Casarès et Luis Mariano, histoire d'amender leurs accents, le jeune Piccoli rêve de Jacques Copeau, du Cartel. Jouvet, Baty, Pitoëff. Et Dullin, bien sûr, qu'il voit un jour sur un quai de métro, frêle et aigu. Une image qu'il gardera comme un talisman et dont il parlait souvent. En Georges Douking, comédien, metteur en scène, décorateur, homme de théâtre complet et personnalité hors normes, il va trouver l'idéal d'une relation de maître à élève et aller d'engagement en engagement dès 1945. Il travaille alors avec toute la jeune création de l'époque. Georges Vitaly, Michel de Ré, Jean-Pierre Grenier, Jacques Mauclair, Jean-Marie Serreau, Claude Régy, Jean-Louis Barrault, Raymond Gérôme, Jean Mercure, Jacques Deval. Évidemment, sa route croise celle de Jean Vilar. Des années plus tard, lorsqu'il évoquait cet épisode assez violent – mais oui, violent - on le sentait encore désarmer devant l'intransigeance du fondateur du Festival d'Avignon, malgré l'humour avec lequel il le racontait. C'est en 1957. Il a trente-deux ans. Un long parcours. Et au cinéma aussi. Le maître du TNP monte Phèdre : Maria Casarès, Alain Cuny dans Thésée. Vilar lui-même s'est réservé le rôle de Théramène et demande à Piccoli du jouer Hippolyte. Mais le metteur en scène ne semble pas passionné. Il réprime des bâillements sans ambiguïté…Quant au jeune Piccoli, il trouve son costume, une ample robe rouge, tout simplement ridicule. Casarès et Cuny : ce sont déjà des monstres sacrés, mais il espère, après la création à Strasbourg, rendre son rôle. Vilar refuse. Mais le jour de la générale, il le remplace. Il ne veut plus lui adresser la parole… Ils se retrouveront bien plus tard, au moment du Dossier Oppenheimer. Discuteront. Confronteront leurs points de vue. Mais pour un être aussi détaché, aussi généreux que Michel Piccoli, l'âpreté vilarienne était assez difficile à comprendre. Michel Piccoli est enfant de la balle. Les grands-parents, les grands oncles étaient qui officier, qui sénateur, qui gouverneur du Niger, qui industriel. La guerre de 14 a balayé les fortunes mais pas les sensibilités. Son père est violoniste. Un poème d'homme. Très petit, fragile d'apparence. Des années et des années plus tard, il fera des apparitions au cinéma, chez Jacques Tati et Marco Ferreri. Sa mère est pianiste et donne des leçons dans leur appartement du XIII ème arrondissement. Elle a souffert. Perdu un enfant, un petit garçon né avant Michel. Longtemps il n'en parla pas. Ce n'est que bien plus tard qu'il s'analysait parfois comme «un enfant de remplacement », lui à qui on avait donné comme prénom celui de cet aîné. Mais il fut Michel et non Jacques, et non Daniel. Et avec ce petit frère, ce petit blond diaphane, il dialoguait avec lui. Et cherchait dans la vraie vie, un frère, un autre frère. Sa voix douce, au timbre feutré, cette voix très tendre, presque féminine – il devance Depardieu - cette voix subtilement musicale –qui ne l'empêche pas de tonner, d'exploser : nul n'oublie les déjeuners des amis…- cette voix traduit l'essence même de ce grand caractère. Il n'a eu dans sa vie que des femmes belles et à la personnalité puissante, d'Éléonore Hirt (ils ont une fille, Anne-Cordelia), à Ludivine Clerc en passant par Juliette Gréco. Des amitiés fortes, des admirations. Romy Schneider, Bulle Ogier. Des années durant il a pris la route en compagnie de Dominique Blanc pour célébrer René Char. Souvent Paul Veyne se joignait à eux. Et Marie-Claude Char écoutait, inlassable, ce trio d'exception. Il serait prétentieux, tant il a tourné, joué, de prétendre ici résumer ce chemin formidable. Comédien, il était ultra-sensible, très imaginatif, très complexe. Il se réinventait sans cesse. Il a attendu d'avoir près de soixante-dix ans pour tourner ses premiers films. Il y a perdu beaucoup d'argent. Mais on les aime, ces films. Il avait été à l'école de Luis Bunuel avec qui il a beaucoup tourné. Ils étaient en dialogue ouvert, tous les deux. Michel Piccoli a également aimé travailler avec Manoël de Oliveira, et souvent on pense à l'enchanteur lusitanien lorsque l'on voit les films de Michel Piccoli : Train de nuit, Alors voilà, La Plage noire, C'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé. On pense au cinéma de l'Est, la Pologne de ses deux enfants les plus jeunes, et aussi à Raul Ruiz. Un grand homme et un homme simple. Un homme qui ne méprisait pas le monde, mais qui n'aurait jamais prétendu changer la face de la planète. Il était un esprit engagé. Il avait des convictions humaines, politiques. Mais il n'avait pas la manie de la pétition. On pense à lui qui n'a jamais fait défaut à un ami pour l'aider, coproduire des longs-métrages non assurés de sauter en haut du box-office. Il s'est ruiné, parfois. Avec Mastroiani. Il s'amusait, Piccoli, devant les journalistes : Marcello, une star, moi, un comédien. Mais il testait les teneurs de micros. Pour renflouer les caisses du producteur, il tournait des publicités. Les esprits forts ironisaient. Michel Piccoli les ignorait, ces juges, du haut de son mètre quatre-vingt-quatre. Il savoura ses heures de maturité. Avec Peter Brook qu'il avait retrouvé, en 81, pour une inoubliable Cerisaie ; avec Patrice Chéreau, avec qui il inaugura en 1983 le règne des Amandiers de Nanterre en jouant avec Philippe Léotard, Sidiki Bakaba, Myriam Boyer, Combat de Nègre et de chiens, avant, entre autres, Le Retour au désert ou l'entrée de Jacqueline Maillan dans le monde de Bernard-Marie Koltès. Auparavant, il avait été un merveilleux jongleur de sentiments dans La Fausse suivante de Marivaux. Il y côtoyait sa chère Jane Birkin, amie indéfectible, elle aussi. Avec Luc Bondy pour qui il joua Terre étrangère, d'Arthur Schnitzler et obtint le prix du syndicat de la critique comme meilleur acteur. Avec lui, il fut aussi le roi cruel et malheureux du Conte d'Hiver et l'impressionnant John Gabriel Borkman d'Ibsen. C'était en 1993. Le rideau se levait sur un homme immense, de dos, accroché à une échelle, devant une monumentale bibliothèque. Il était prêt pour un Robert Wilson épuré : La Maladie de la mort d'après Marguerite Duras, avec Lucinda Childs et pour s'aventurer, en toute confiance, comme un Petit poucet rêveur, en compagnie de Klaus Michael Grüber dans les mystères envoûtants de la magie et des Géants de la montagne de Luigi Pirandello. À Catane, où il avait joué alors qu'il recevait le prix Europa du Théâtre, il apparaissait entre les plis du rideau de velours si haut, si large, de l'opéra, visage illuminé, dominant son monde : une salle magnifique. À l'orée des années 2000, Bernard Murat l'avait conduit jusqu'à Sacha Guitry. Il s'amusait, il était heureux dans un monde un peu différent, et dans les répliques ciselées de La Jalousie. Son cher Peter Brook lui fit signe encore pour Ta main dans la mienne de Carol Rocamora, une manière de retrouver Tchekhov. Enfin deux personnages à sa mesure se présentèrent. Deux rôles-titres. Le Roi Lear qu'il interpréta sous la direction d'André Engel, aux Ateliers Berthier, en 2005 et 2006. Là encore, on le revoit de dos, immense, pris dans la tempête de la nature déchaînée et de la folie. Bouleversant. Et puis Minetti, à la Colline et en tournée. Encore la neige, encore la tempête, encore Lear. Mais version Thomas Bernhard. Une vie pour le théâtre. Une vie de théâtre. C'était le titre de la pièce de David Mamet traduite par Pierre Laville que Michel Piccoli mit en scène aux Mathurins en 1988. Après, il s'essaierait à la réalisation… On n'avait jamais oublié, et lui non plus, mais il s'en moquait ces dernières années, comment la critique arrogante l'avait accueilli, en 1971, lorsqu'il avait créé la pièce de Pierre Louki, Allo ! C'est toi Pierrot ? Un si méchant accueil qu'il s'arrêta dix ans durant. Un grand homme et un homme simple. Un homme qui ne méprisait pas le monde, mais qui n'aurait jamais prétendu changer la face de la planète. Il était un esprit engagé. Il avait des convictions humaines, politiques. Mais il n'avait pas la manie de la pétition. Il ne s'engagea qu'avec sincérité et puissance. Loyauté. Il était demeuré réservé comme lorsqu'il était jeune. Il ne jugeait pas les personnes sur leurs préférences. Il les écoutait. C'était l'un des hommes les moins sectaires qui soient. Avec Ludivine Clerc, il pénétra dans le monde des chevaux lui qui avait été l'inoubliable Dom Juan à cheval de Marcel Bluwal, ce film du Dom Juan de Molière, avec Claude Brasseur en Sganarelle. Il aimait les chevaux. Il aimait la discipline des cavaliers. Un jour, il prit un coup de tête et une méchante fracture du crâne s'en suivit. Un vrai grave accident. Il en parlait plus tard avec son cher Bartabas. Il n'aurait jamais raté un spectacle. Il admirait. Il riait. Il avait un grand rire d'enfant et d'ogre. Il avait de l'appétit pour la vie. Un homme grand. Armelle Héliot / Le Figaro À lire : « Dialogues égoïstes » de Michel Piccoli, Grand Document, Marabout.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 6:58 PM
|
Michel PICCOLI parle de son rôle de Jean GENET dans le film de Nico PAPATAKIS "Les équilibristes". Il donne les raisons qui lui font accepter des rôles provocateurs.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 6:22 PM
|
Par Vincent Josse sur le site de son émission sur France Inter 18 mai 2020 Michel Piccoli est monté sur scène pour la dernière fois en 2009 pour jouer Thomas Bernhard dans une mise en scène d'André Engel. Vincent Josse l'avait reçu alors pour parler de cette pièce, mais aussi de son travail au théâtre et au cinéma, devant et derrière la caméra. Ecouter l'intégralité de l'entretien :
Michel Piccoli avec Vincent Josse
Par France Inter (8 min)
Piccoli faisait peur, a priori. Dans le métier, on racontait ses colères, les caméras de TF1 qu'il pouvait envoyer paître durant un tournage, boutant Bouygues hors du plateau. Mais une fois devant lui, qu'il soit dans sa peau de réalisateur ou de comédien, toute crainte s'effaçait. L'homme était doux et souvent drôle.
Je me permets de livrer ici un extrait de l'interview qu'il m'avait accordée le 15 janvier 2009, il avait 83 ans. Il jouait Minetti de Thomas Bernhard dirigé par André Engel, son dernier rôle au théâtre. L'entretien fut diffusé dans Esprit Critique, sur France Inter.
J'ai fait deux métiers. Comédien au théâtre et comédien au cinéma. Faire deux métiers au lieu d'un, c'est plus amusant et plus rassurant.
"Deux métiers différents, oui. Au cinéma, les techniques, les rapports avec le réalisateur n'ont rien a voir avec le métier d'acteur au théâtre qui est présent du début à la fin des répétitions et devient le maître de tout, une fois qu'il joue. Mais avant cela, on répète un texte pendant un mois ou deux dirigé par un metteur en scène et sous l'oeil d'un partenaire. C'est très important, le partenaire (...)
Beaucoup d'acteurs n'ont pas eu la chance de tomber sur le bon metteur en scène et les bons partenaires. Alors, ils n'ont pas fait carrière.
Je n'ai jamais eu peur de monter sur scène. Je monte sur scène depuis l'âge de neuf ans. J'ai extrêmement peur pendant les répétitions. Dès qu'elles sont terminées, quand je suis soi-disant prêt à exécuter, tout va très bien. Le public m'amuse et ne m'angoisse pas.
C'est très amusant d'avoir le culot de se retrouver devant dix-sept ou mille spectateurs, oui, vraiment, ça m'amuse!
Etre là devant des gens muets et raconter à haute voix une histoire que je crois extraordinaire et les voir fascinés. C'est amusant aussi d'apercevoir ceux qui sortent de la salle pendant la représentation! Non, ça ne me vexe pas! De quel droit me vexerais je? Et par quel chemins me glorifierais-je d'être devant une salle pleine ou les gens se taisent, muets admiratifs et finissent par applaudir"?
Photo : Michel Piccoli © Getty / Christophe d'Yvoire

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 4:59 PM
|
Laure Adler s'entretient avec Michel Piccoli dans cinq "A voix nue", une série diffusée en 2006 sur France Culture Ecouter les entretiens (5 x 25 minutes) sur le site de France Culture Dans ces cinq entretiens de la série "A voix nue" diffusée en 2006, le comédien Michel Piccoli dit faire très attention aux textes, "on peut être le diseur, le haut-parleur" de textes "merveilleux" et "alors il n'y a plus besoin de jouer la comédie" affirme-t-il. Piccoli insiste sur cette "beauté du métier d'acteur" qui est " de ne pas révéler justement qui on est mais de révéler qui est celui que l'on invente, ou plutôt que l'auteur a inventé et que l'on invente avec l'auteur": Il faut essayer complètement d'oublier qu'on est acteur quand on est acteur. Michel Piccoli dit regretter que le théâtre soit "devenu, dans nos sociétés, un art destiné aux intelligents, et non pas aux populaires." On ne devrait pas s'habituer à vivre, on devrait être étonné tous les jours. [...] Mais moi je suis un peu étonné tous les jours quand même. Il y a tous les jours quelque chose qui m'étonne.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 3:20 PM
|
Par Brigitte Hernandez Publié dans Le Point.fr le 18/05/2020 Il fut l'immense Lear, le douloureux Léonid, joua sous la direction de Brook et Chéreau. « Le théâtre, j'y reviens toujours », disait le comédien, décédé le 12 mai.
En 2006, Michel Piccoli interprétait le roi Lear de Shakespeare, le rôle qui couronne la carrière de tout acteur, dans cette pièce étrange et vagabonde où le souverain n'est plus qu'un mendiant, chassé par ses filles qui se disputent son héritage. Piccoli, en vieil industriel des années 1930 dans la mise en scène d'André Engel au théâtre de l'Odéon, fut surprenant ; homme en colère, homme en rage. En 2006, Michel Piccoli interprétait le roi Lear de Shakespeare, le rôle qui couronne la carrière de tout acteur, dans cette pièce étrange et vagabonde où le souverain n'est plus qu'un mendiant, chassé par ses filles qui se disputent son héritage. Piccoli, en vieil industriel des années 1930 dans la mise en scène d'André Engel au théâtre de l'Odéon, fut surprenant ; homme en colère, homme en rage. Trois ans après, il retrouvait Lear, cette fois dans le rôle d'un acteur qui a consacré sa vie à Shakespeare et qui croit avoir rendez-vous avec un metteur en scène pour parler du rôle. Mais le pauvre homme, dans cette pièce signée du dramaturge autrichien Thomas Bernhard, divague. Il est encore plus égaré que Lear sur sa lande. Là aussi, Piccoli fut remarquable. Parce qu'il était un très grand acteur et que cette mise en abyme lui permettait d'interroger, à travers ce rôle de Lear, ce qu'est être un grand acteur. Les rôles extrêmes, Piccoli aimait s'y frotter, s'y confronter en « revenant au théâtre » comme on revient à la source. Depuis quelques années, les assurances refusaient qu'il se produise au théâtre. Le souvenir de lui sur scène – sa voix un peu sourde, son grand corps imposant – imprègne toute l'histoire du théâtre français. Piccoli, contre son gré, était une légende, un monstre sacré. Il n'aimait pas parler de lui mais acceptait les interviews par peur d'être présomptueux. « Le premier choc fut théâtral » De ses débuts à ses dernières années, il a joué : le théâtre était son alpha et son oméga. Il faisait tout pour y revenir lorsque le cinéma l'accaparait. « Petit garçon, je ne voyais pas de films. Le premier choc fut théâtral. » À 9 ans, en pension, « secret, muet, enfermé », il se retrouve sur scène lors d'une fête de fin d'année. « Ça s'est déclenché là. J'ai voulu devenir acteur. Je ne savais pas ce que c'était. Je suis allé dans les cours et ensuite j'ai eu la chance de tomber sur ceux que je devais rencontrer De Rey, Vitali, Vilar… » Sa première fois, en 1945, à 20 ans, sera Le Jugement dernier sous la direction de Georges Douking au théâtre Pigalle : il interprétait à la fois un vieillard et un jeune chômeur. Les Dullin, Jouvet, Pitoëff lui avaient montré la voie royale, mais ce chemin, peut-on dire, s'est construit au hasard des rencontres. Piccoli ne cherchait rien mais « tomba » tout au long sur « ceux qui comptaient ». En 1969, lorsqu'il travaille avec Marcel Bluwal au Misanthrope de Molière (en costume Mao), il a déjà joué plus de cinquante pièces en dix-huit ans et déclare à notre consœur Danièle Heymann, de L'Express, dans un long entretien : « S'il n'y avait pas eu ce Misanthrope, j'aurais arrêté le cinéma. Si j'ai pensé à changer de métier ? Je suis discret, méticuleux. Je cire très bien les chaussures. Je serais devenu valet de chambre. » Jamais l'acteur n'oublia le comédien. « Je ne veux pas qu'on oublie que je suis homme de théâtre ; disons que je joue ici pour me rafraîchir. Entre théâtre et cinéma, la vraie satisfaction sera toujours le théâtre ; on y est plus responsable, physiquement et moralement ; au cinéma, à la télévision, on doit s'incliner devant une machinerie. » Et encore : « Je ne peux pas rester des années sans remonter sur scène. Le théâtre, c'est mon premier métier. » Face à lui-même Ainsi, entre ses succès au cinéma, au fil des ans, il remonte sur les planches, ne craignant jamais de risquer son nom sur des pièces inconnues. Mais pas de boulevard « trop facile » ! Sortir de la facilité, se confronter aux visions de Peter Brook, Chéreau, Bondy, Engel… Dans La Cerisaie de Tchekhov, mise en scène par Brook en 1981, il joue Léonid, le maître de la Cerisaie, symbole de leur société qui meurt. Piccoli s'y révéla bouleversé et bouleversant. Ce frère un peu faiblard, bien conscient de sa faiblesse et qui s'en excuse avec ses blagues, il le portait à un niveau d'émotion tel que la salle frissonnait. « Un éternel enfant et un vieux garçon », disait-il de Léonid. Encore un homme acculé à lui-même, comme il en a interprété souvent au cinéma et sur scène. Bondy lui offrira Terre étrangère de Schnitzler, un choc dans le monde du théâtre. L'année précédente, il avait joué Koltès dans Combat de nègres et de chiens sous la direction de Chéreau. Ces années 1980 lui portent chance au théâtre. Chaque pièce révéla un autre lui, donnant le sentiment que son talent était un diamant aux facettes démultipliées. À la fin des années 1990, Bob Wilson le dirigea dans La Maladie de la mort de Marguerite Duras, aux côtés de la hiératique chorégraphe Lucinda Childs. Wilson le vêtit de noir comme un homme d'Église, ses mains et son visage se détachent, éclaboussés de lumière, comme dans un rêve. Quelque chose de sépulcral, de sacré se détachait de Michel Piccoli, acteur à jamais magistral. Légende photo : Le comédien français Michel Piccoli dans la pièce "Ta main dans la mienne" d'Anton Tchekhov, mise en scène par Peter Brook, en octobre 2003 à Paris. © MARTIN BUREAU / AFP
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 13, 2020 4:53 PM
|
Par Armelle Héliot, dans son blog - 4 septembre 2020 Il était l’un des co-fondateurs du Théâtre du Soleil. Forte personnalité de la troupe d’Ariane Mnouchkine, il a travaillé avec d’autres artistes, formé des comédiens et été un spectateur passionné que l’on ne cessait de rencontrer lorsqu’il ne jouait pas.
Un profil d’aigle écrit son ami Jean-Claude Berruti : « ton profil de gentil aigle » dit-il plus exactement dans un hommage publié sur Facebook et transmis par le Théâtre du Soleil. C’était frappant. Une forte personnalité physique, sensible, intellectuelle, Gérard Hardy.
Il avait 85 ans. On ne l’imaginait pas octogénaire car il se tenait très droit, comme un danseur, un athlète affectif aurait dit Antonin Artaud (né un 4 septembre…).
Gérard Hardy s’est éteint dans la nuit du 1er au 2 septembre.
Photo de Guido Mencari (que nous remercions). DR publiée par Olivia Corsini. Le dernier rôle de Gérard Hardy.
Il avait été élève de l’Ecole de théâtre de Chaillot alors que Jean Vilar était encore là et il avait, comme figurant, côtoyé la grande équipe du TNP.
Il avait aussitôt enchaîné avec le groupe réuni autour d’Ariane Mnouchkine, l’Association théâtrale des étudiants de Paris. Il est aux Arènes de Lutèce, en juin 1961. Ils jouent Gengis Khan d’Henry Bauchau.
Sur le site du Théâtre du Soleil, demeurent quelques photographies. Et sur celui de l’INA, on peut retrouver le reportage de Georges Paumier, ancien comédien, réalisateur phare du théâtre à la télévision. Il avait filmé la jeune troupe pour une émission d’Eliane Victor. Un très précieux et émouvant document.
Gérard Hardy est donc là. Si jeune ! Il sera là, quatre ans plus tard, pour fonder, avec Ariane Mnouchkine, Philippe Léotard, Roberto Moscoso, Jean-Claude Penchenat, Françoise Tournafond, le Théâtre du Soleil. Son chemin se confond dans les premières années avec la vie de la troupe qui présente ses spectacles au Cirque de Montmartre, entre autres lieux : en 64 Les Petits Bourgeois de Maxime Gorki en 64, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier en 1966, La Cuisine d’Arnold Wesker en 1967, Le Songe d’une nuit d’été en 1968, Les Clowns en 1969, puis, en 1970 et 1972, le cycle de la Révolution, 1789 et 1793.
Entretemps, évidemment, la troupe s’est installée à la Cartoucherie. Gérard Hardy sera aussi des aventures de Méphisto de Klaus Mann en 1979 et plus tard L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, grand texte d’Hélène Cixous.
Dès les années 70, Gérard Hardy commence à explorer d’autres univers, même s’il est de l’aventure du film Molière qui sort en 1978 et est tourné en grande partie sur le site même de la Cartoucherie, avec les décors double face de Guy Claude François.
La forte personnalité de Gérard Hardy, sa puissance, son regard ferme, son visage (« aigle gentil » donc, à la Béjart, un peu), son articulation classique, son aristocratie et son engagement sans faille, son attention aux autres, séduisent. Et lui, il a le goût de l’aventure et de la liberté. Mais il est consubstantiel au Soleil. C’est sa maison d’éternité.
Il travaille sous la direction du romanesque André Engel avec Baal de Brecht en 1976, enchaîne avec la Franziska de Wedekind montée par Agnès Laurent. Avec Jean-Marie Simon qui l’engage pour Intrigue et amour de Schiller, en 82 et Gilles Atlan qui le dirige dans Minetti de Thomas Bernhard, il est heureux. Il tourne dans le Danton d’Andrzej Wajda qui sort en 1982…et au théâtre, c’est l’intimidant (et très timide) Klaus Mikaël Grüber qui l’appelle à rejoindre le groupe magnifique de comédiens français qu’il réunit pour La Mort de Danton de Büchner. On est en 1989, année de célébration. Cela se crée à Nanterre-Amandiers. C’est inoubliable.
Et il va entamer un sacré long parcours avec Gilles Bouillon qui dit aujourd’hui, dans les colonnes de la République du centre, son chagrin et son bonheur d’avoir travaillé avec cet homme impressionnant qu’il avait rencontré alors qu’il avait vingt ans et était élève de l’école du TNS. Dès 83, il le dirige dans Le Marchand de Venise. Gérard Hardy est Shylock. C’est à Bourges. Mais ce sera surtout à Tours, alors qu’une profonde amitié les lie, que les deux artistes vont travailler ensemble. Gérard Hardy devient une figure très importante du Nouvel Olympia mais, de plus, comme il dirige des ateliers dans les établissements scolaires, il exerce un ascendant très fort sur plusieurs générations et insuffle le goût du théâtre et des beaux textes à de nombreux jeunes. Citons quelques-uns des spectacles, parmi la bonne douzaine élaborée ensemble : Marivaux, Brecht encore (Dans la jungle des villes) Molière, jusqu’à Dom Juan en 2013.
Gérard Hardy aimait partager. Avec Stuart Seide il plonge toute une année dans les textes de Samuel Beckett et se sent bien dans cet univers aussi musical que métaphysique avant de commencer un long chemin avec celle qui dirige aujourd’hui le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Claire Lasne-Darcueil. Elle écrit parfois, mais surtout explore Tchekhov sans délaisser Molière ou Shakespeare.
Le cinéma fait signe de temps en temps à Gérard Hardy (mais il est en scène, en tournée, ou dans les régions). On le voit dans Jean Galmot, aventurier d’Alain Maline dans Ridicule de Patrice Leconte en 1996. Et dans les années 2000, dans courts-métrages très remarqués : L’Infante, l’âne et l’architecte de Lorenzo Recio en 2001 et Chevaliers errants de Laurent Leclerc, avec un professeur faisant travailler ses élèves sur Don Quichotte, en 2015.
Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec cet esprit volontiers rebelle, aussi accueillant qu’il pouvait être sévère, le pleurent aujourd’hui. Le Soleil bien sûr et ses amis. Et ceux avec qui il n’a joué qu’occasionnellement Lorsqu’il ne jouait pas, Gérard Hardy allait à l’opéra, au concert, au théâtre. On le croisait partout, beau visage toujours, marqué de rides, regard aigu, enveloppé de grands manteaux…
Une de ses dernières apparitions, il y a un peu plus d’un an, était dans A Bergman affair, travail d’Olivia Corsini et Serge Nicolaï : deux enfants du Soleil, de la nouvelle génération… Ainsi boucla-t-il la boucle, du Soleil au Soleil…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2020 5:27 AM
|
Par Philippe-Jean Catinchi dans Le Monde - 20 juillet 2020 Professeur à Nanterre, où il a enseigné l’histoire et l’esthétique du théâtre, auteur de plusieurs livres sur la littérature du XVIIe siècle, il a publié en 2006 « Qu’est-ce que le théâtre », ouvrage devenu référence. Il est mort le 13 juillet, à l’âge de 68 ans. Spécialiste de la littérature du XVIIe siècle comme de l’histoire et de l’esthétique du théâtre, Christian Biet est mort des suites d’un accident de la route, à Poitiers, le 13 juillet, à l’âge de 68 ans. Né à Paris le 12 mai 1952, au sein d’une famille où l’école est centrale (une mère directrice, un père professeur en collège), Christian Biet perd son père à 14 ans, milite à la fin des années 1960 à Lutte ouvrière – l’ère du temps –, entre en hypokhâgne au lycée Condorcet et, auditeur libre à l’ENS Saint-Cloud, obtient l’agrégation de lettres en 1975. Il enseigne une dizaine d’années en banlieue parisienne, collège et lycée, tout en poursuivant un 3e cycle en littérature comparée, avant d’être chargé de cours à l’ENS, maître de conférences en 1986. D’emblée le jeune chercheur s’oppose à la doxa pédagogique, rêve d’autres voies d’apprentissage, d’un regard actualisé sur le savoir à transmettre. Avec des camarades de son âge, Jean-Paul Brighelli et Jean-Luc Rispail, il entreprend pour Magnard une série de manuels « Texte et Contextes », exigeants au risque que ne pas « sécuriser » le lycéen. Qu’importe ! Avec ses complices, que la nouvelle collection « Découvertes » chez Gallimard, enthousiasme, Biet prêche le savoir autrement. Il publie Les Miroirs du Soleil (1989), sur Louis XIV et « ses » artistes, plus tard un décapant et radical Don Juan (1998) et cosigne en bon camarade les titres consacrés à Dumas, Malraux et les surréalistes. Le partage est essentiel. Avec la sociologue Irène Théry, Christian Biet livre un collectif, La Famille, la loi, l’Etat. De la Révolution au code civil (1989), proche des préoccupations de l’universitaire, qui avait consacré sa thèse de 3e cycle à Œdipe en monarchie. Publiée chez Klincksieck en 1994, elle abordait la périlleuse réception de la tragédie de Sophocle sous l’absolutisme quand les dramaturges osent présenter un roi fautif, une reine incestueuse et des héritiers illégitimes, exorcisant les terreurs propres à la famille et à l’Etat. Energie et enthousiasme Sans doute Biet aurait-il pu être éditeur – il le fut un temps pour Larousse, créant une éphémère collection de biographies, « La Vie, la légende », qui astucieusement mettait en balance le factuel d’un parcours réel et sa reconstruction dans l’imaginaire collectif, où lui-même signa un Henri IV, tandis qu’il confiait à l’ami Brighelli un Sade recommandable (2000). Renouant avec son goût des monographies accessibles, Biet signe un ultime « Découvertes », Moi, Pierre Corneille (2006) peu avant d’intégrer comme membre senior l’Institut universitaire de France. Mais, si prenante soit-elle, l’activité éditoriale comme universitaire ne l’enferme pas. Et dès l’année suivante, Christian Biet entre au comité de rédaction de Théâtre/Public, revue créée en 1974 mais menacée, qu’il contribue par son énergie et son enthousiasme à relancer, assurant le soutien de l’équipe de recherche « Représentation » de l’université Paris-X-Nanterre qu’il dirige. Des trésors dramatiques oubliés aux aventures contemporaines extra-européennes (Inde, Japon, Chine récemment), Biet s’attache à ce qu’on ne voit pas. Ou pas assez. Ainsi ce mémorable Théâtre de la cruauté et récits sanglants en France XVIe-XVIIe siècle (Laffont, 2006), qui interroge la portée morale du spectacle de l’effroi, exhumation capitale d’un répertoire négligé qu’il poursuit chez Garnier en 2009 avec Marie-Madeleine Fragonard en codirigeant Tragédies et récits de martyre en France (fin XVIe-début XVIIe siècle). Une façon de pourfendre les lieux communs et de décaper la vision des enjeux scéniques, tant pour comprendre le passé que pour se confronter au contemporain. Interrogeant inlassablement l’hétérogénéité de ceux qui font le théâtre (auteurs, acteurs, metteurs en scène, régisseurs, mais aussi lecteurs et spectateurs), Christian Biet a défendu une perspective capable de mobiliser tous les enjeux (écriture, architecture, voix et gestuelle, esthétique et idéologie) du spectacle vivant. Largement traduit tant il est indispensable, Qu’est-ce que le théâtre ? (Gallimard, 2006), l’ouvrage capital qu’il cosignait avec Christophe Triau, reste une référence pour son propos comme pour l’audace de son regard qui voit la scène comme le lieu même de la vie. Consulté par d’exigeants metteurs en scène (Olivier Py, Stanislas Nordey), Christian Biet était un interlocuteur ouvert et stimulant. Nous reste son message. Philippe-Jean Catinchi
Christian Biet en quelques dates 12 mai 1952 Naissance à Paris 1989 « Les Miroirs du Soleil » 1994 « Œdipe en monarchie » 1995-2020 Enseigne l’histoire et l’esthétique du théâtre à Paris-X-Nanterre 2006 « Qu’est-ce que le théâtre ? » 13 juillet 2020 Mort à Poitiers Légende photo : Christian Biet Collection privée

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 16, 2020 8:59 AM
|
Par Agnès Freschel, journal Zibeline, le 13 juin 2020
Hommage à Marcel Maréchal
Mon Merlin l’enchanteur
C’était en 1977, j’avais 11 ans. Avec ma classe de 6e, pour la première fois, j’allais au théâtre, voir Merlin l’enchanteur. Au Théâtre du Gymnase. On était tout en haut, dans la promenade, debout tout du long, émus ensemble, transportés. Depuis ce jour l’amour du théâtre ne m’a pas quittée, ce bonheur quand les lumières s’éteignent et que les acteurs apparaissent, ce plaisir de leur présence véritable dans un espace qui, pourtant, n’est pas tout à fait réel…
Marcel Maréchal m’a conduite au théâtre. Avec la magie de Merlin, puis avec les Trois Mousquetaires, le capitaine Fracasse, cette culture populaire qu’il revisitait comme un enfant. Puis il m’a fait aimer Vauthier, Audiberti surtout, Louis Guilloux. Et il a aiguisé mon sens critique parce qu’il ne connaissait pas ses textes, bafouillait, ouvrait les bras et partait en funambule sur des sommets improvisés. Parce qu’il ne comprenait pas Genet, ne s’intéressait pas aux pièces de femmes, montait Beaumarchais comme un Labiche, Brecht, Shakespeare et Tchekhov comme un Beaumarchais… et Novarina comme il aurait dû monter Shakespeare !
Mais justement c’est à La Criée, dans ce théâtre qu’il avait fondé, que je suis venue au monde. À ce second monde que j’aime tant hanter aujourd’hui encore, même lorsque j’y suis déçue, parce qu’il suscite la parole, la relation, l’ouverture. Le débat, la critique, l’écriture. La vie, le plaisir, la pensée, la joie.
Marcel Maréchal nous a quittés alors que nous sommes encore privés de spectacle. Que nos corps réclament de se retrouver, côte à côte, le regard tourné vers le même horizon, la même fable, la même illusion incarnée. Plus que jamais nous avons besoin de théâtre. Ancien, nouveau, exigeant, populaire, et toujours d’aujourd’hui.
AGNÈS FRESCHEL
Juin 2020
--------------------------------
Par Dominique Bluzet, directeur des Théâtres (Gymnase et Bernardines à Marseille, Jeu de Paume et Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence) Salut patron, Ciao l’artiste… Tu t’en vas le jour où nous allons annoncer la construction d’un nouveau théâtre. Tu t’en vas, tu me laisses mais tu es toujours là. Ce que nous créons, ce que nous inventons, c’est une part de ce que tu m’as enseigné. Tu as incarné pour moi l’état tripale du théâtre : comment avoir ça dans le sang, comment le vivre avec ses tripes, comment ne pas pouvoir vivre sans, comment être dans le théâtre, comment vivre avec… Tu as été le héraut, le porte-voix du théâtre marseillais. J’ai essayé, à ma manière, de prendre ta suite. Tu as été l’artiste, le patron, l’ouvrier, le spectateur, la grande gueule de cet art dans notre ville. Aujourd’hui, alors que je me rends à une conférence de presse pour annoncer quelque chose qui t’aurait enthousiasmé, je me sens à la fois vide et plein de toi. Un théâtre populaire, une grande baraque en bois, du maquillage et des costumes, du cirque et du guignol… Je vais demander que la rue qui y mènera porte ton nom… Salut l’artiste, salut patron, salut à toi qui fut mon père du théâtre… Filialement. DOMINIQUE BLUZET
Directeur des Théâtres
Photo : Marcel Maréchal et Louis Guilloux © X-D.R.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 2:31 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde 13 juin 2020 Pionnier de la décentralisation théâtrale, il a marqué de nombreux rôles et mises en scène de sa truculence généreuse. Il est mort, jeudi 11 juin à l’âge de 82 ans.
C’était un homme qui aimait de gourmandise le théâtre et la vie. Il portait les cheveux en crinière, au vent, et il avait le goût des écritures ensoleillées qu’il a servies, comme comédien et metteur en scène, au long d’une carrière de cinquante ans qui lui a valu de diriger plusieurs institutions. Né un jour de fête, le 25 décembre 1937, à Lyon, Marcel Maréchal est mort un jour gris à Paris, jeudi 11 juin, à 82 ans, des suites d’une fibrose pulmonaire, a annoncé son fils Mathias Maréchal, lui-même acteur. Depuis quelques années, on ne le voyait plus guère sur les plateaux, comme s’il était effacé, dans un contexte qui ne ressemblait plus au théâtre qu’il avait connu et aimé, et qui aujourd’hui appartient définitivement au siècle dernier.
Par sa biographie, Marcel Maréchal est rattaché à la génération des pionniers de la décentralisation. Il a 10 ans quand Jean Dasté prend la direction de la Comédie de Saint-Etienne, l’un des tout premiers centres dramatiques nationaux. A 21 ans, il fonde la Compagnie des comédiens du Cothurne à Lyon, qui s’installe deux ans plus tard dans une toute petite salle où Roger Planchon a fait ses débuts, rue des Marronniers, à deux pas de la place Bellecour. C’est là que Marcel Maréchal crée en 1963 Le Cavalier seul, de Jacques Audiberti (1899-1965), dont la lecture lui a provoqué « un éblouissement ». Le jeune homme de théâtre lyonnais a trouvé son père spirituel : un auteur d’Antibes à la langue imprudente, qui manie l’excès en entrelaçant la tragique et la bouffonnerie. Le succès public et critique du Cavalier seul valent à Marcel Maréchal d’émerger. Désormais, il compte dans la galaxie du théâtre, et il reçoit ses premières subventions.
Bada, c’est lui
Jusqu’en 1969, il reste rue des Marronniers, où il crée les auteurs qui complètent sa trilogie d’élection et de cœur : Jean Vauthier (1910-1992) et Louis Guilloux (1899-1980). Comme il l’avait fait avec Le Cavalier seul, Marcel Maréchal s’empare du personnage de Bada, René Dupont dit « Badaboum », fou stellaire qui ne veut voir d’autre monde que celui qu’il s’invente, et auprès de qui sa femme (Martine Pascal) joue le jeu de l’imposture, à la vie, à la mort. Le lyrisme teinté d’angoisse de Jean Vauthier colle telle une peau à Marcel Maréchal : Bada, c’est lui, tant et si bien qu’il y reviendra, vingt ans plus tard. Et toujours émerveillera. Avec Cripure, adapté du roman Le Sang noir, de Louis Guilloux, c’est dans une autre peau, grotesque, déchirée et grandiose, qu’entre le comédien. Il a trouvé les rôles qui façonnent son style.
Marcel Maréchal cherchait sur le plateau à rendre l’intensité de « la vie portée au rouge », selon ses mots
Jean Vauthier ne cessera d’accompagner l’acteur-metteur en scène, pour qui il écrira plusieurs adaptations d’auteurs élisabéthains, en particulier Thomas Middleton (La Tragédie du vengeur), et Shakespeare (Romeo et Juliette, Le Roi Lear). Cela se fera au cours des années qui vont mener Marcel Maréchal à la direction du Théâtre du Huitième, à Lyon, de 1968 à 1975, puis à celle du Théâtre du Gymnase, à Marseille, qu’il quittera pour le Théâtre de la Criée, nouvellement construit, sur le Vieux-Port. L’inauguration, en 1981, a lieu avec un hommage à Scapin, un des personnages de Molière qui convient le mieux au style de l’acteur, avec celui de Sganarelle. Patrice Chéreau l’avait compris très tôt, en lui confiant dès 1968 le rôle qu’il reprend en 1988, dans sa propre mise en scène, et avec, dans le rôle de Dom Juan, Pierre Arditi qu’il dirigera également dans Maître Puntila et son valet Matti, de Bertolt Brecht.
Marcel Maréchal cherchait sur le plateau à rendre l’intensité de « la vie portée au rouge », selon ses mots. Il a particulièrement réussi avec Capitaine Fracasse et Les Trois Mousquetaires, galvanisés par la truculence généreuse qui a assuré ses plus grands succès. Quand il a quitté Marseille pour diriger le Théâtre du Rond-Point, à Paris, en 1994, Marcel Maréchal a eu du mal à retrouver ses marques. Question d’époque, d’esthétique, de répertoire. Une nouvelle génération occupait le devant de la scène, le vent avait tourné, qui a mené l’acteur metteur en scène à prendre en 2002 la direction des Tréteaux de France, où il a œuvré jusqu’en 2010. Et où il est revenu à Louis Guilloux, avec La Maison du peuple, en 2002.
Marcel Maréchal en quelques dates
25 décembre 1937 : Naissance, à Lyon
1963 : « Le Cavalier seul », d’Audiberti
1981 : Prend la direction du Théâtre de la Criée, à Marseille
1987 : « Capitaine Fracasse », d’après Théophile Gautier
11 juin 2020 : Mort, à Paris
Brigitte Salino
Légende photo :
Marcel Maréchal lors de la 14e Nuit des Molières, le 12 juin 2000 à l’Opéra-Comique de Paris. JEAN-PIERRE MULLER / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 12, 2020 9:42 AM
|
Par Armelle Héliot dans Le Figaro 12 juin 2020 DISPARITION - Le metteur en scène et comédien s’est éteint, à Paris, dans la nuit du 10 au 11 juin, à l’âge de 83 ans.
Son regard, son sourire le disaient: il y avait en Marcel Maréchal une alliance profonde de candeur et de savoir, d’intelligence et d’innocence. Un livre d’entretiens que lui avait consacré, il y a une vingtaine d’années, la regrettée Nita Rousseau, s’intitulait Un colossal enfant. Un rejeton de François Rabelais et de Jean Vauthier, Marcel Maréchal. L’une des plus fortes personnalités du théâtre européen, de 1958, ses débuts, jusqu’à ces derniers temps puisqu’il était sur la scène du Poche-Montparnasse, il y a un an, en 2019, lisant Mon père, récit de Jean Renoir sur son père peintre. Avec son fils, Mathias Maréchal, celui qui avait dirigé la Criée de Marseille et le Rond-Point à Paris figurait, six années plus tôt, dans la distribution du Mal court d’Audiberti, mise en scène de Stéphanie Tesson.
Jacques Audiberti, l’une des grandes passions de Marcel Maréchal qui, toute sa vie durant, aura défendu avec force des écrivains qu’il contribua à imposer. Jean Vauthier, Louis Guilloux, Florence Delay et Jacques Roubaud, Valère Novarina. D’autres encore, tels Pierre Laville, Jean-Louis Bourdon, Jean-François Josselin. Ce qui ne l’empêcha jamais de mettre en lumière le grand répertoire, et de le jouer: Molière comme Brecht, Shakespeare comme De Filippo, et les contemporains étrangers, Nella Bielski, Sam Shepard, David Mamet.
Comment circonscrire un tel chemin? Marcel Maréchal était né à Lyon le 25 décembre 1937. Son père, Georges, est chauffeur routier. Une famille modeste et très aimante. L’enfant est très bon élève, l’adolescent apprend le grec et le latin dans un collège catholique. Il découvre alors Paul Claudel comme Arthur Rimbaud et le théâtre! Il réussit le concours d’entrée à l’Idhec (cinéma), mais il doit rester à Lyon et s’engage dans le droit. Une troupe de théâtre universitaire lui demande de mettre en scène Robinson de Jules Supervielle. Ils obtiennent un prix. Marcel Maréchal a trouvé sa voie.
Il fonde et dirige le Théâtre du Cothurne. On est donc en 1958. Il monte Anouilh comme Arrabal et, en 1963, Le Cavalier seul de Jacques Audiberti. Puis Obaldia, Beckett, Limbour, Vauthier. Le public est vite au rendez-vous.
Il irradie. Il partage. Il écrit
Marcel Maréchal aime les poètes de la scène, mais aussi ses camarades interprètes et aime faire débuter les jeunes talents. Parmi eux, Catherine Arditi et son frère, Pierre Arditi. Une indéfectible amitié les lie et, dans les années 1990, alors que Marcel Maréchal a pris, neuf ans plus tôt, la direction d’un théâtre flambant neuf, le centre dramatique La Criée de Marseille, il monte Dom Juan de Molière: Arditi rôle-titre et lui, Sganarelle, et Maître Puntila et son valet Matti, dans une relation inversée.
Entre-temps, après Le Cothurne, il a dirigé avec grand succès, à partir de 1968, le Théâtre du Huitième, toujours à Lyon. Il y accueille des rockers qui deviendront des stars, Mick Jagger, notamment! Puis en 1975, on lui offre le Gymnase, à Marseille. Marcel Maréchal travaille sans cesse. Il met en scène des dizaines de spectacles. Il joue, toujours impressionnant. Il émane de toute sa personne une bonté. Il irradie. Il partage. Il écrit. Des pièces, des souvenirs qu’il livre à de fidèles observateurs, tel Michel Pruner.
En 1995, il est nommé à Paris, à la tête du Rond-Point. Il propose une programmation ambitieuse mais le théâtre a perdu une partie de son public en devenant, juste avant, après le départ des Renaud-Barrault, la Maison des cultures du monde. Malgré la qualité des propositions, le lieu ne retrouve pas sa dynamique. Le 1er juin 2000, ce baladin magnifique est nommé à la direction des Tréteaux de France. Un centre dramatique itinérant, avec son grand chapiteau, ses gradins de cirque, sa scène de commedia dell’arte. Il retrouve une fougue de jeune homme. Il est heureux. Onze années durant.
Dans les dernières années de sa vie, il voit grandir avec bonheur l’aura de son fils Mathias, excellent comédien qui a, comme son père, le sens de la troupe. Il joue un peu, notamment au privé. Mais la maladie le surprend, hélas. Il s’est éteint dans la nuit du 10 au 11 juin, à l’âge de 83 ans, chez lui, à Paris, entouré de sa famille. Dans la paix, notre Capitaine Bada, notre comédien si sensible, désarmant de fraîcheur enfantine jusqu’à son dernier souffle.
Légende photo : Marcel Maréchal en 2011. Hannah Assouline/©Hannah Assouline/Opale/Leemage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 28, 2020 6:31 PM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde, 28 mai 2020 Comique, polémiste, le comédien qui a reçu le Molière du meilleur « one-man-show » en 1990 est mort à l’âge de 85 ans.
Il sera, selon son souhait, enterré dans le cimetière de Lumio en Corse, cette île qu’il aimait tant. Il la surnommait « mon Algérie de rechange » à cause « des odeurs de maquis » qui lui rappelaient son enfance. Guy Bedos est mort jeudi 28 mai à l’âge de 85 ans, a annoncé son fils, Nicolas. Le comédien, humoriste et auteur se définissait comme « un pur résilient ». Tout son parcours d’artiste engagé, d’anar de gauche, de pamphlétaire énervé, d’éternel révolté, puise ses racines dans son enfance algéroise entre un beau-père raciste et antisémite et une mère pétainiste : « Le premier gouvernement que j’ai eu à subir, c’est ma mère et mon beau-père. Ma constance dans la rébellion vient de là .»
Le 23 décembre 2013 à l’Olympia, Guy Bedos avait mis un terme à près de quarante ans de carrière seul sur la scène qui avait fait sa renommée. Devant une salle comble, il livrait sa « der des der », du nom de son spectacle, avouant : « Je vais avoir un mal fou à vous quitter ; il n’y a que sur scène que je suis bien. » A près de 80 ans, il n’avait rien perdu de son franc-parler qui lui avait valu autant d’amis que d’ennemis. Il l’assumait complètement : « Comment ça, je manque de nuance ? Absolument, je manque de nuance. Il y a une phrase de ce vieux réac de Sacha Guitry que je m’approprie bien volontiers : “Depuis que j’ai compris quels étaient les gens que j’exaspérais, j’avoue que j’ai tout fait pour les exaspérer”. »
Fidèle à ce qui avait fait sa marque de fabrique, Guy Bedos ressortait, pour sa dernière représentation ses fiches en bristol pour une ultime revue de presse. Gambadant sur scène, il réglait ses comptes avec « les fachos », confiait sa peur de la montée du Front national, rendait hommage à Nelson Mandela, saluait le « courage » de son « amie » Christiane Taubira. Il se demandait ce que Manuel Valls faisait à gauche, et avouait, taquin, à propos de François Hollande : « Je n’arrive pas à me concentrer sur lui. » Mais, ajoutait-il : « Je n’en suis pas à regretter mon vote car, comme le disait Françoise Giroud : “En politique, il faut choisir entre deux inconvénients”. » C’était l’une de ses phrases fétiches.
Le « vieux clown à succès »
Un mouchoir blanc à la main, Guy Bedos disait au revoir à son public fidèle en rappelant, comme à son habitude, que « la vie est une comédie italienne : tu ris, tu pleures, tu vis, tu meurs (…) En piste les artistes, c’est notre rôle d’être drôles ». Le « vieux clown à succès » eut droit à une standing ovation. Un peu plus tard dans les loges, plusieurs générations d’artistes venaient le saluer, parmi lesquels Jean Dujardin, Jean-Pierre Marielle, Charles Aznavour, Matthieu Chedid, Claude Rich, Jacques Higelin, Michel Boujenah.
Il en avait fini avec le one-man-show et la satire politique, mais pas avec les planches. Quelques mois plus tard, on le retrouvait sur la scène du Théâtre Hébertot à Paris, dans Moins 2, de Samuel Benchetrit. En pyjama, sur un lit d’hôpital, il partait, aux côtés de Philippe Magnan, dans une dernière évasion sentimentale pour se rire de la mort avant que le cancer les emporte.
Car, si le seul en scène a été la grande histoire de sa vie d’artiste et lui a permis de faire partie, des décennies durant, des plus grands humoristes français (aux côtés de Pierre Desproges et de Coluche), il est apparu plus d’une fois, et avec talent, au théâtre (notamment en 1993 dans La Résistible ascension d’Arturo Ui, mis en scène par Jérôme Savary), ainsi qu’au cinéma (il avait adoré jouer, en 2012, un vieux militant gueulard dans Et si on vivait tous ensemble, de Stéphane Robelin).
Entre deux spectacles en solo, Guy Bedos s’échappait régulièrement sur des tournages
Devenir comédien a toujours été son rêve d’adolescent malmené qui aspirait à se « réfugier dans la fiction pour supporter l’insupportable du réel ». Alors, entre deux spectacles en solo, Guy Bedos s’échappait régulièrement sur les planches (notamment dans deux pièces écrites par son fils Nicolas) ou sur des tournages. Son personnage de Simon, médecin étouffé par sa mère juive pied-noir très possessive, dans Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis, d’Yves Robert, lui vaut une belle reconnaissance.
Mais ce n’est pas le grand écran qui lui apportera une notoriété. « Je n’ai pas la moindre amertume envers un cinéma qui m’aurait négligé, seulement un regret et aussi de la lucidité », avouait-il.
La violence familiale
Guy Bedos est né le 15 juin 1934, à Alger. De ses seize premières années en Algérie, qu’il quittera en 1949, il garde un souvenir douloureux de misère affective. Il a 5 ans quand ses parents se séparent : « Un jour je n’ai plus vu mon père, c’est un autre homme qui dormait avec ma mère. » Envoyé pendant deux ans en pension à la campagne, il y vit le « passage préféré » de son enfance grâce à Finouche, la fille de la ferme. Cette institutrice – « ma vraie maman », écrira-t-il dans Mémoire d’outre-mère (Stock) en 2005 – lui apprend à lire, écrire, compter, mais aussi « à penser : liberté, égalité, fraternité, droits de l’homme au-delà des clivages qui divisaient l’Algérie ».
De retour dans sa famille, il retrouve la violence familiale, entre un beau-père qui lui fait comprendre qu’il est de trop et une mère à la main leste qui lui gâche son enfance. Maintes fois, il a envie de fuir cet environnement, et même de mourir. « Je n’ai été guéri de ce cancer mental, de ce penchant suicidaire qu’à la naissance de mes enfants », dit-il dans le très beau documentaire Guy Bedos, un rire de résistance, réalisé par Dominique Gros en 2009.
« J’ai fait du théâtre sur ordonnance médicale »
Après son arrivée en France avec sa mère et ses deux demi-sœurs jumelles, âgées de quelques mois, il décide très vite de quitter la maison familiale inhospitalière de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour éviter de « glisser dans une momification d’ennui mortel ». Il rêve de théâtre et s’inscrit à l’école de la rue Blanche. « J’ai fait du théâtre sur ordonnance médicale », aimait-il raconter. « Ma chance fut qu’un médecin attentif ait compris que j’étais en perdition. Profondément dépressif. Il a recommandé à ma mère de me laisser suivre une vocation artistique, sinon cela finirait mal », expliquait-il au Monde, en 2009.
Rue Blanche, il rencontre Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Marielle, Michel Aumont, met en scène et joue le rôle principal d’Arlequin poli par l’amour, de Marivaux, et « guérit » de ses tourments. C’est le hasard qui va le mener au music-hall. Jacques Chazot lui écrit son premier sketch qu’il joue à la Fontaine des Quatre-Saisons, dirigé par Pierre Prévert, le frère de Jacques. C’est Jacques Prévert, mais aussi Boris Vian et François Billetdoux qui l’encouragent à griffonner dans ses cahiers. Il commence à se produire dans des cabarets, seul ou avec Jean-Pierre Marielle. Dans les années 1960, il se retrouve, en covedette, au côté de Barbara à Bobino, puis en tournée avec Jacques Brel. L’humour devient son domaine de prédilection.
Pendant dix ans, avec la comédienne Sophie Daumier (morte le 1er janvier 2004), Guy Bedos fait rimer humour et amour. Couple à la ville, ce tandem comique – qui s’était rencontré sur le tournage du film Dragées au poivre, de Jacques Baratier – interprète de nombreux sketches écrits notamment par Jean-Loup Dabadie. Certains d’entre eux (le raciste de Vacances à Marrakech, le tombeur lourdingue de La Drague, le miséreux sexuel de Toutes des salopes) rencontrent un très grand succès populaire. En 1974, le duo se sépare, et, en cette année où Giscard « l’aristo » s’installe à l’Elysée, Guy Bedos passe au « je » et se fait polémiste politique dans des spectacles où il glisse des parenthèses sur l’actualité.
« Faire du drôle avec du triste »
Avec lui, la revue de presse parlée devient un exercice de style. Drogué aux infos, il dévore la lecture des journaux. « Je les lis comme un citoyen ordinaire, et ensuite je cherche comment tourner tout cela en dérision. » Ses tropismes sont constants : le pape et plus largement toutes les religions, les présidents, les ministres importants, les faits de société. Homme de pulsions, dès que quelque chose le révolte, il vitupère sur scène, se soulage par le rire de la bêtise humaine. Sa devise : « Faire du drôle avec du triste. » « Giscard à l’Elysée, ça me contrarie. Fortement. Je le dis et je l’écris », reconnaît-il.
Lire aussi Guy Bedos : « L’antiracisme reste l’engagement majeur de ma vie »
Ce stand-upeur avant l’heure livre ses colères au public et s’en donne à cœur joie, actualisant soir après soir sa revue de presse. Applaudi par la gauche, dénigré par la droite, le pamphlétaire remplit les salles et est interdit dans certaines émissions de télévision et de radio. Aux côtés de Gisèle Halimi (marraine laïque de son fils Nicolas) et de Simone Signoret, il est toujours prompt à pétitionner ou à manifester pour défendre les droits de l’homme, soutenir l’association Droit au logement.
Alors le 10 mai 1981, l’antigiscardien exulte à l’élection de François Mitterrand. Ce soir-là à Bobino, c’est la fête. Mais comme d’autres, Guy Bedos déchante. En 1989, au Théâtre du Gymnase, il profère : « Ça devient difficile d’être de gauche. Surtout, quand on n’est pas de droite. » Poil à gratter du pouvoir, il éreinte la droite, et n’est pas tendre avec la gauche dès qu’elle s’éloigne de ses idéaux et de ses valeurs. Néanmoins, il gardera des liens amicaux avec François Mitterrand, qui ne ratait aucun de ses spectacles. Le président avait beau lui dire : « Vous y allez fort, quand même ! », il conviait régulièrement le trublion à déjeuner ou à dîner à l’Elysée et l’invita même une fois, en août 1993, à Latche, dans les Landes, où l’ancien président possédait une maison.
Haut-parleur politico-satirique
Dans sa carrière de haut-parleur politico-satirique, certaines de ses invectives lui vaudront parfois procès. Que ce soit Marine Le Pen ou Nadine Morano, toutes deux ont perdu face à cet humoriste engagé qui revendiquait haut et fort un « rire de résistance ». L’antiracisme fut l’engagement majeur de sa vie. Dans son enfance algérienne, il avait entendu sa mère catholique dire : « Les juifs et les Arabes, qu’ils s’entretuent, ça fera toujours ça de moins. » Cette phrase l’a marqué à jamais. « Ma Torah, mon Coran, ma Bible à moi, c’est la Déclaration universelle des droits de l’homme », écrivait ce converti à l’athéisme dans Je me souviendrai de tout (Fayard, 2015). « Ma carrière d’humoriste est un succès, ma vie de citoyen utopiste, un échec », constatait-il face à la montée de l’extrême droite.
Guy Bedos était un « mélancomique », qui ne cachait pas ses larmes
Tel un éternel ado, râleur et curieux, il n’hésitait pas à dire : « On m’a trop fait chier dans ma jeunesse pour que je me laisse emmerder dans ma vieillesse. » Il a inspiré plusieurs humoristes, au premier rang desquels Christophe Alévêque ou Stéphane Guillon qui font leur miel de l’actualité politique. Lui aimait Pierre Desproges, Fellag et Muriel Robin, avec qui il interpréta un duo en 1992.
Guy Bedos était un « mélancomique » qui ne cachait pas ses larmes. Sans fard, il disait à quel point il ne s’habituerait jamais à la disparition de ceux qu’il aimait (Sophie Daumier, Pierre Desproges, Simone Signoret, James Baldwin…). Il est parti les rejoindre. Adhérent à l’Association pour le droit de mourir dans la dignité, il avait prévenu qu’on ne lui retirerait pas cette ultime liberté : « En cas d’urgence, je choisirai le suicide assisté. Avec ou sans la permission du président de la République. »
----------------------------
Guy Bedos en quelques dates
15 juin 1934 Naissance à Alger
1964-1974 Duo avec Sophie Daumier
1976-1977 Joue le rôle de Simon dans Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis
1990 Reçoit le Molière du Meilleur « one man show »
2005 Publie Mémoire d’outre-mère
28 mai 2020 Mort à 85 ans
Une sélection de vidéos : - Guy Bedos avec Sophie Daumier à Bobino (1978) archive INA https://www.youtube.com/watch?v=lYbDi-ydmS4 - Sketch en duo avec Sophie Daumier "La drague" ORTF 28/10/1972 archive INA : https://youtu.be/ogV0gc9JQuI - Sketch : Pauv'gosse https://www.youtube.com/watch?v=CdH-4ENA_uU - Chanson du film "Dragées au poivre" chantée avec Sophie Daumier, paroles et musique de Serge Rezvani, alias Cyrus Bassial (1963) "Je te plum'ploterai":
https://www.youtube.com/watch?v=r94tnz9yk5w - Sketch "Chagrin fiscal", pour la TV (1983) : https://www.youtube.com/watch?v=EkXlWTdWsug - En duo avec Muriel Robin à l'Olympia, archive INA (1993) https://www.ina.fr/video/CAC93032763 Légende photo :
Guy Bedos, fidèle à sa réputation d’éternel rebelle, pose à Boulogne-Billancourt, le 5 décembre 2016. JOËL SAGET / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 25, 2020 2:32 PM
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 20, 2020 4:56 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan janvier 2009
« Portrait de l’artiste en vieil homme ». C’est le sous-titre que Thomas Bernhard donne à sa pièce « Minetti », nom d’un célèbre acteur allemand du XXe siècle. Et c’est ainsi que la joue Michel Piccoli qui, né en 1925, a, comme on dit, l’âge du rôle.
Un vieil hôtel d’Ostende
Thomas Bernhard n’était pas un proche de l’acteur allemand Bernhard Minetti, il ne le rencontra que brièvement (« trois heures en tout »). Il l’admirait comme acteur. C’est lui qui avait créé sa pièce « La Force de l’Habitude ». Alors il lui avait offert cet écrin baptisé de son nom « Minetti », pièce créée par Minetti lui-même en 1977 (dans une mise en scène de Claus Peymann) avant que Klaus Gruber ne le dirige dans un mémorable « Faust ». La pièce « Minetti » n’est pas plus fidèle à l’acteur Minetti que ne l’est le texte qu’a consacré Valère Novarina à Louis de Funès.
Le Minetti de Bernhard entre dans le hall d’un vieil hôtel d’Ostende, le jour de la Saint-Sylvestre. Il a rendez vous avec de directeur du théâtre de Flensburg pour jouer le roi Lear. Cela fait trente ans qu’il n’a pas joué le rôle titre de la pièce de Shakespeare, trente ans qu’il n’est pas monté sur une scène. Il le dit à une femme ivre et seule (Evelyne Didi), il le redira à une jeune fille sage (Julie-Marie Parmentier) qui écoute son transistor en attendant son fiancé.
Minetti soliloque mieux à deux. Il ressasse sa vie, ses rancoeœurs, ses remords, une page sombre de sa vie et surtout ce rôle de Lear qu’il joua dès l’âge de 18 ans et qui le poursuit de ses répliques (en langue originale).
Du roi Lear au vieux Minetti
Michel Piccoli a, lui aussi, joué Lear, en janvier 2006 au théâtre de l’Odéon, dans une mise en scène d’André Engel. Ce dernier lui avait proposé le rôle quinze ans plus tôt. Piccoli, trop pris par le cinéma sans doute, avait différé l’offre. Il a fini par jouer le vieux Lear, un peu tard peut-être, avec un grand succès (le spectacle a été repris deux saisons de suite). La tentation était trop forte. Engel qui a déjà monté plusieurs pièces de Thomas Bernhard (à commencer par un « Réformateur » avec Serge Merlin) a proposé à Piccoli cette pièce où il est tant question de Lear. Le rôle est moins écrasant que celui du vieux roi, mais Minetti, une fois qu’il est entré en scène, n’en sort quasiment plus. Pour l’essentiel, le spectacle repose sur ses épaules.
Le coffre et les épaules
Celles de Piccoli sont légèrement voûtées. Michel Piccoli -« l’immense Michel Piccoli“- en vieil acteur âgé qu’il est, entre en scène avec tous les rôles de sa vie, synchrone avec ce ‘portrait de l’artiste en vieil homme’ qu’est ‘Minetti’. On le regarde murmurer ces mots d’un personnage de théâtre qui se trouve être un acteur, et c’est comme un léger crépitement familier, une voix amie, un feu de cheminée qui nous réchauffe. On est content d’être là, de suivre les pas de sa haute silhouette qui n’ont plus la vivacité de naguère, mais tout de même. C’est un vieil acteur magnifique.
Et puis, osons le dire même s’il nous en coûte, cela se gâte. Le débit se ralentit, perd de son relief malgré quelques coups de reins salutaires, cela se grippe. C’est presque imperceptible, mais cela va de mal en pis La mémoire -ce muscle et ce démon qui obsède l’acteur et plus encore l’acteur vieillissant-, n’est pas pleinement au rendez vous.
La voix du souffleur
La fatigue ? L’hiver ? L’usure du temps ? Qu’importe. La mémoire, cette traîtresse, fait des siennes. Alors l’acteur, qui a trois quarts de siècle de métier dans son grand coffre, se lève, s’approche d’un rideau, d’une fenêtre et l’air de rien (‘tiens, il ne neige plus’) écoute la voix du souffleur. Et ça repart avant de se gripper derechef. Et le souffleur de remettre ça. La peur, on le devine, habite cette voix qui ouvre sur des gouffres.
Piccoli, l’autre soir, en fit même l’aveu en ajoutant une phrase au texte de Thomas Bernhard : ‘L’art se dégrade facilement mon enfant/ quand l’artiste faiblit/ se laisse détourner/ faiblit ne fût-ce qu’un instant’, dit Minetti, et Piccoli d’ajouter : ‘et ne sait pas son texte’. Il est à lui-même son fantôme.
Dans la salle, comme l’histoire de l’acteur Minetti et celle de l’acteur Piccoli ne sont pas sans points communs (l’âge, Lear, l’aura), beaucoup spectateurs n’y voient que du feu et c’est tant mieux. D’autres souffrent avec lui de le voir chercher son texte et cela fait mal. On voudrait tellement écrire combien ‘l’immense Piccoli’ est magnifique. Il l’est. Mais il est tout autant pathétique.
Le masque d’Ensor
Le coût de production du spectacle est important et une fois la machine à produire lancée, difficile de l’arrêter. Il y a les cinq acteurs et encore plus de figurants qui entourent Piccoli. Il y a l’imposant décor de Nicki Riéti (décorateur attitré d’Engel) d’un académisme accablant qui, même s’il se veut ironique, ajoute à la pesanteur (un tel décor aurait fait se tordre de rire -ou de honte- le même Rieti il y a trente ans).
Il y a encore bon nombre d’autres collaborateurs dont le fidèle ‘dramaturge’ Dominique Müller qui co-signe la version scénique avec Engel. Les deux compères ont supprimé l’épilogue quasi muet où Bernhard, entre Lear et Godot, entraîne son personnage au bord de la mer. Là, guidé par un infirme, ayant revêtu le masque de Lear fait par l’artiste Ensor –natif d’Ostende- dont Minetti parle tout au long de la pièce, il reste immobile jusqu’à ce que la neige le recouvre.
Dans la version d’Engel-Müller, le masque du personnage n’apparaît pas. Les spectateurs peuvent penser que le masque d’Ensor est imaginaire. L’acteur Piccoli s’avance nu, son visage est son propre masque. A la fin, Minetti-Piccoli demeure seul, de dos, dans le hall de l’hôtel, près de sa valise où il a rassemblé les coupures de presse de sa vie. Et l’on entend la voix rayée de nuit de Tom Waits, chantant un air qui, lui, fait écho à un ancien spectacle d’Engel, comme un vieux 33 tours.
Une table, un texte, un acteur
Longtemps l’immense Alain Cuny resta sans remonter sur une scène. Ce n’est pas qu’il ne le souhaitait pas jouer, mais sa mémoire ne suivait pas. Et puis un jour Cuny eut l’idée lumineuse de s’asseoir à une table dressée sur une scène et de lire des textes aimés comme ceux d’Antonin Artaud. C’était impressionnant, magistral
En sortant du Théâtre de la Colline, c’est à cela que l’on rêvait. Que l’on foute en l’air ce décor, tout ce cirque autour du vieil acteur, qu’il soit seul assis à une table, le texte devant lui, qu’il lise magnifiquement ‘Minetti’ avec une voix débarrassée de la peur du par cœur, que l’on retrouve, tel qu’en lui-même, ‘l’immense Michel Piccoli’.
Minetti Théâtre de la Colline - jusqu’au 6 février 2009 - mar 19h30, mer, jeu, ven, sam 20h30, dim 15h30 - 13 à 27€ - Tél. : 01 44 62 52 52 - puis tournée jusqu’en mai : Reims, Genève, Berlin, Villeurbanne, Grenoble, Lille, Lausanne, Toulouse.
Photo : Michel Piccoli dans ’Minetti’ (Richard Schroeder).
Jean-Pierre Thibaudat

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 19, 2020 5:32 PM
|
Par Jean-Pierre Léonardini dans L'Humanité - Mardi19 Mai 2020
SA PASSION POUR LE THÉÂTRE NE S’EST JAMAIS ÉTEINTE
Après avoir écumé toutes les scènes parisiennes dans une multitude de rôles, Michel Piccoli, dans sa maturité heureuse, a séduit de grands metteurs en scène de la fin du XXe siècle, de Patrice Chéreau à Robert Wilson en passant par Peter Brook. Il a triomphé en interprétant les plus grands textes.
Au théâtre, Michel Piccoli a tout fait. Sa brillante carrière au cinéma ne l’en a jamais éloigné. Il commence, comme à peu près tout le monde à l’époque, par le cours Simon, après avoir appris les rudiments du métier auprès de Georges Douking, ancien de la troupe de Gaston Baty. Dès les années 1950, Michel Piccoli est choisi par des metteurs en scène de renom dans le théâtre privé : Michel de Ré, Jean-Pierre Grenier, Jacques Mauclair, Georges Vitaly, Jean-Marie Serreau, Raymond Gérôme, Jean-Louis Barrault, André Barsacq, Roland Monod… Il joue aussi bien dans Penthésilée, de Kleist, sous l’œil vigilant de Claude Régy (1954), que dans Phèdre, mise en scène de Jean Vilar (1957). Il a été de l’aventure du Vicaire, pièce de l’Allemand Rolf Hochhuth, sous la direction de François Darbon, à l’Athénée, qui fit scandale jusqu’à Paris, dans la mesure où y était mise en cause, avec force, l’attitude du pape Pie XII face aux nazis et à la déportation des juifs.
Durant un demi-siècle, il couvre l’éventail des possibles
De Courteline à Audiberti, de Jacques Deval à Georges Schehadé et Anouilh, de Strindberg à Pirandello et Claudel (dans Protée) en passant par Ugo Betti, Louis Calaferte ou Primo Levi, Michel Piccoli a donc couvert durant un demi-siècle l’éventail des possibles proposé par les scènes parisiennes. On doit inclure sans hésiter, dans ce palmarès hâtif, bien qu’il s’agisse de télévision, son rôle-titre dans Dom Juan ou le Festin de pierre, de Molière, tourné de main de maître par Marcel Bluwal en 1965 : un classique de l’intelligence lorsqu’elle avait encore droit de cité dans ce qui était alors l’ORTF. Quatre ans plus tard, Bluwal et Piccoli étaient à nouveau réunis dans le Misanthrope, au Théâtre de la Ville.
Un retour sur les planches dans les années 1980
Après la grande parenthèse cinématographique, qui l’intronise sans coup férir dans l’histoire du cinéma, Michel Piccoli revient au théâtre - dans les années 1980 – par la grande porte ouverte dans le théâtre public par des artistes d’envergure, tenants de la mise en scène comme art supérieur. En 1983, c’est à Nanterre-Amandiers, dont Patrice Chéreau assume la direction, le coup d’éclat mémorable de Combat de nègre et de chiens de Koltès. Piccoli y joue Horn, contremaître perdu-éperdu sur un chantier en Afrique. Plus tard, en 1988, toujours avec Chéreau, ce sera le Retour au désert, où Michel Piccoli, en bourgeois aux pieds nus, affronte sa sœur pétardière de retour d’Algérie (Jacqueline Maillan).
Il y eut aussi, avec Chéreau encore, la Fausse Suivante. Avec Luc Bondy, ce fut Terre étrangère, de Schnitzler, le Conte d’hiver, de Shakespeare, et John Gabriel Borkman, d’Ibsen. Peter Brook confie à Piccoli le rôle de Gaïev, propriétaire terrien bon enfant au bord de la ruine (la Cerisaie, de Tchekhov). Souvenir impérissable. Dans la Maladie de la mort (1997), de Duras, Robert Wilson a pu changer Michel Piccoli en statue dansant à point nommé… Avec André Engel, ce sera le Roi Lear (2006) puis Minetti, de Thomas Bernhard.
Jean-Pierre Léonardini
Légende photo : Sur les planches avec Julie Parmentier, dans le Roi Lear, mis en scène par André Engel. © Marc Vanappelgheim

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 6:46 PM
|
Michel PICCOLI sur le métier d'acteur : une possibilité de s'évader, surtout quand on a la possibilité de choisir avec qui on veut travailler. Il faut que l'acteur soit un peu auteur. (TV 1973)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 5:24 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération — 18 mai 2020
Chéreau, Brook, Bondy, Vilar… Piccoli aura accompagné tous ceux qui ont forgé l’art théâtral au XXe siècle.
Tous les acteurs le disent : partager le plateau avec Michel Piccoli était enthousiasmant. Nul autre que lui ne savait rendre son partenaire meilleur, le sauver en cas de défaillance, lui prêter secours, mais surtout lui donner des ailes. Cependant, lorsqu’il évoquait sa «carrière» au théâtre, mot qu’il n’employait d’ailleurs pas, il se contentait de dire qu’il avait eu de «la chance». La chance de travailler avec «des êtres d’exception», c’est ainsi qu’il qualifiait Peter Brook, Patrice Chéreau, Luc Bondy, Klaus Michael Gruber, Bob Wilson, et bien sûr André Engel, sans compter celle d’avoir débuté avec Jacques Audiberti, Jean Vilar, Jean-Marie Serreau, c’est-à-dire tous ceux qui ont forgé en France l’art théâtral du XXe siècle. Lorsqu’il égrenait ces noms, ce qui frappait, c’est que ces rencontres avaient créé, le plus souvent possible, un compagnonnage qui donnait lieu à de nombreuses explorations, plusieurs mises en scène et surtout une amitié. Michel Piccoli était à la recherche de maisons-théâtres, de lieux dont la fonction excédait celle de la seule représentation, ce qu’il trouva aux Bouffes du Nord où il joua une Cerisaie montée par Peter Brook qui fit date en 1981, ou encore au théâtre de Nanterre-Amandiers, refondé et dirigé par Patrice Chéreau et Catherine Tasca dans les années 80, sa «maison» avait-il confié à Libération. Où, sous la direction de Patrice Chéreau, il créa aussi bien Combat de nègre et de chiens, de Bernard-Marie Koltès, que la Fausse suivante de Marivaux, avec une Jane Birkin débutante sur les planches, ou encore Terre étrangère d’Arthur Schnitzler, alors rarement monté et mis en scène par un jeune metteur en scène quasi inconnu en France, et révélé par ce spectacle : Luc Bondy.
Muet.
Il n’aimait pas les «cabots», mais il disait qu’il pouvait l’être, et le dire suffisait à lui interdire de tomber dans ce travers. Il pouvait tout jouer et il s’en amusait. Et sa polyvalence était tout sauf une évidence. Enfant, avait-il confié dans J’ai vécu dans mes rêves, un livre sous forme de lettres coécrit avec Gilles Jacob, il était muet. Cet enfant muet découvrit le théâtre dans un pensionnat près de Compiègne, classiquement grâce à des représentations de fin d’année, où il joua l’un des tailleurs des Habits neufs de l’empereur du conte d’Andersen. «Tout d’un coup, je me suis senti comme un poisson dans l’eau. Je racontais des histoires devant des gens qui m’écoutaient en se taisant.»
S’il n’a pas de doute sur sa vocation, il attend d’avoir 18 ans avant d’en faire part à ses parents, bourgeois artistes et musiciens, mais pas bohèmes du tout. On imagine une enfance triste, aussi triste qu’il devint un homme joyeux, grâce à la scène, disait-il. Il débute dans l’immédiat après-guerre alors que de nouvelles salles ouvrent et que le théâtre met toute son énergie à devenir un art populaire, aussi nécessaire «que le gaz et l’électricité» disait Jean Vilar. Sous la direction de Jean Vilar, justement, il joue Phèdre. Se brouille avec lui, car il n’hésite pas à se produire également dans un théâtre privé. Les deux hommes se réconcilieront plus tard.
Adieux.
Un sentiment d’euphorie et une énergie sans limite poussent parfois Michel Piccoli à jouer six pièces la même année. Si on ne doit garder qu’un seul nom de ces années 50, ce serait celui de Jean-Marie Serreau, le fondateur du Babylone, qui ouvre son théâtre avec deux pièces de Pirandello interprétées par Piccoli et Eléonore Hirt, avec qui l’acteur se mariera. Mais dans les années 60, c’est la France entière qui découvre que Dom Juan a ses traits mis en scène et filmé par Marcel Bluwal. De fait, chaque décennie, de nouvelles générations de spectateurs découvrent Michel Piccoli comme un acteur absolument contemporain, né aujourd’hui à l’art de la scène, même lorsqu’il jouait le Roi Lear, l’un de ses derniers rôles, dans une mise en scène d’André Engel, qui fut un succès considérable. Il avait pourtant résisté, affirmant que rien n’était plus pathétique qu’un vieil acteur faisant ses adieux ainsi. Son dernier rôle fut celui de Minetti dans la pièce du même nom de Thomas Bernhard, qui raconte justement l’histoire d’un acteur qui refuse absolument d’interpréter des classiques, même et surtout Lear.
Anne Diatkine
Légende photo : Le Conte d’hiver, aux Amandiers, en 1988. Photo J. Ber. CHRISTOPHEL

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 18, 2020 3:28 PM
|
Par Colette David dans Ouest-France le 28 octobre 2015
Ce duo lettré et farceur s'échange des lettres. Intimité et distance : Jacob s'autorise à questionner frontalement l'ami, l'immense artiste qui craint de paraître prétentieux.
« Joyeux et coquin »
Piccoli a été à l'affût des meilleurs rôles offerts par les metteurs en scène les plus inventifs. Au théâtre : Brook, Chéreau, Bondy, Wilson… Au cinéma : Buñuel, Sautet, Ferreri… « Vous vous trompez, cher Gilles, quand vous dites qu'un film repose sur l'art du comédien. L'art du cinéma, c'est celui du réalisateur. C'est lui qui donne la partition de jeu. »
Qu'est-ce qui distingue le grand acteur d'un bon interprète ? Pour Piccoli, il faut travailler beaucoup, puis se lâcher « avec une énergie brute qui ne sente pas le labeur ». Et parvenir, « le plus difficile, à écouter son partenaire sans le dévorer ». Surtout, il faut rester « joyeux et coquin ». Lui s'est « régalé ». Il a pris le contre-pied de ses parents, un violoniste et une pianiste « qui jouaient bien, mais sans plaisir ». Enfant né « par compensation », après la mort du premier fils, il a déniché lui-même des complices pour partager ses enthousiasmes.
Il évoque les femmes aimées, l'argent, la ruine en tant que producteur, les hontes tenaces, les rendez-vous manqués. Avec Vilar, puis les Renaud-Barrault et leurs « sourires éternels qui cachaient un autoritarisme excessif, une grande suffisance ». Il salue « Mastroianni, modèle absolu », et les comédiens italiens d'alors pour « leur manière exemplaire de s'admirer ».
Piccoli, si élégant, trop lucide. Il a 89 ans, la mémoire qui flanche, et cette fatigue désormais… Médecins et assurances rechignent à le voir jouer à nouveau : « Certains de mes films vont rester, mais je ne reste plus. Je voudrais ne pas mourir. »
J'ai vécu dans mes rêves, Grasset, 160 pages.
Dom Juan, 1965
Le 6 novembre, l'ORTF diffuse une splendeur de Marcel Bluwal. Piccoli dans le rôle-titre et Claude Brasseur évoluent dans des décors naturels : les austères salines d'Arc-et-Senans, une plage déserte d'Hardelot… Ni perruque, ni rubans, un dépouillement qui sied à cette confrontation entre un homme et Dieu. « Douze millions de personnes l'ont vu ce soir-là. Le chef-d’œuvre de Molière a été vu par plus de spectateurs qu'il ne l'avait été depuis sa création. »
Le Mépris, 1963
« Ce film m'a donné parmi les plus beaux moments que j'aie pu vivre. Jean-Luc Godard était le patron, avec une grande autorité. Nous travaillions dans la joie, dans une concentration et une sévérité exceptionnelles. Godard pouvait être dur mais il était très émotionnel, il avait une grande tendresse pour les acteurs et les techniciens. Dans la scène de nu (« Et mes seins, tu les aimes ? »), il avait mis un livre sur les fesses de Bardot. J'ai osé lui dire que là, il exagérait. Il a dû penser que oui, c'était une image vulgaire. Il a retiré le livre. Bardot, la star qui faisait fantasmer le monde entier, avait une énergie formidable, toujours de bonne humeur. Fascinée par cette œuvre remarquable et cet épouvantable Godard qu'elle admirait, qui donne quelque fois aux acteurs le sentiment qu'ils doivent se débrouiller seuls. Elle m'épatait. »
Une étrange affaire, 1981
Dans ce film de Pierre Granier-Deferre, Piccoli campe un chef d'entreprise qui prend possession d'un subalterne. Il charme sa proie, l'abrutit de travail, s'immisce dans sa vie privée. Piccoli tout en finesse en pervers effrayant. « J'ai beaucoup joué les bizarres, pas les voyous. Je n'avais qu'une idée : ne jamais faire la même chose. Je cherchais à découvrir. Très important, soigner l'apparence : les vêtements, la démarche ; faire entendre les voix du personnage… » Légende photo : Dans J'ai vécu dans mes rêves, que publient les éditions Grasset, Michel Piccoli poursuit la conversation débutée à l'hiver 1968 avec Gilles Jacob (ex-président du Festival de Cannes).
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...