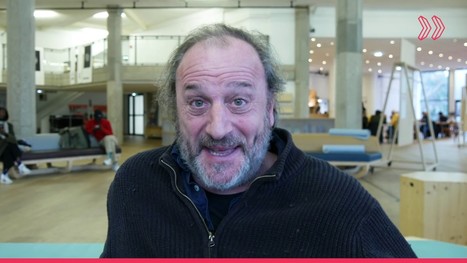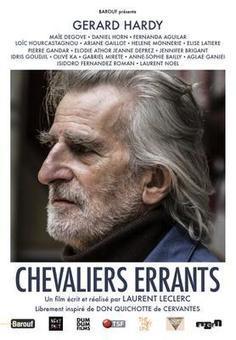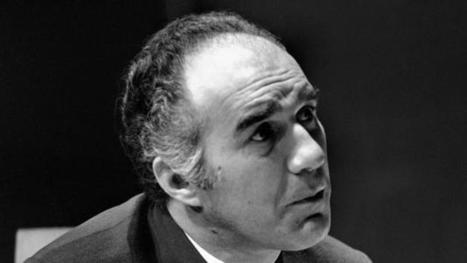Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 7:24 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 24 septembre 2020 Seul en scène, accompagné tout du long, d’une création vidéo, il incarne le narrateur d’un texte de Mohamed Rouabhi, mis en scène par Sylvie Orcier.
Ne mentons pas : on serait bien en peine de circonscrire exactement le propos et l’action du texte de Mohamed Rouabhi adapté par Sylvie Orcier qui signe la mise en scène et par Patrick Pineau qui joue.
Un homme seul. Un isolé. Un paumé qui s’adresse à un chien que l’on ne verra vraiment qu’à la fin, en image.
Un type qui souffre, tel Job. Mais pas d’imprécations contre un Dieu cruel, ici. Juste un homme qui condenserait tout ce que la noire littérature du XXème siècle nous a donné à comprendre.
On est seul, on est embarqué. Mais comme Rouabhi est un conteur, il nous a concocté une fable : un avion s’est écrasé non loin du refuge de celui qui nous parle. Un président et tout son staff. Tous morts. L’homme récupère sa valise. Il y a dedans un téléphone. Il va pouvoir, depuis le lieu reculé de sa solitude extrême, s’adresser au monde.
N’en disons pas plus. Saluons l’art éblouissant du comédien. Patrick Pineau est impressionnant et bouleversant.
La direction, le déploiement de vidéo par Ludovic Lang, de son par François Terradot, de lumière par Christian Pineau, de musique par Jean-Philippe François, l’orchestration de tout cela par Sylvie Orcier, tout concourt à donner à ce moment bref d’une heure dix/quinze, une puissance profonde.
A voir vite. A Bobigny puis en tournée.
Moi, Jean-Noël Moulin, président sans fin, de Mohamed Rouabhi
MC93, Nouvelle salle, jusqu’au 3 octobre. Tél : 01 41 60 72 72.
reservation@mc93.com
Site : www.mc93.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 20, 2020 3:59 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 19 septembre 2020
Après « Un démocrate », consacré à celui qui pensa la propagande, l’auteure, metteuse en scène et comédienne s’intéresse, avec « Bananas (and kings) », à la fortune que la culture du fruit en Amérique Latine offrit à quelques cyniques, dévastant populations indiennes et paysages.
Elle possède de l’audace et une maîtrise de l’art du théâtre qui sont bien réconfortantes en une période où la faiblesse des propositions est frappante. Julie Timmerman est une artiste remarquable. Elle a été comédienne en herbe, elle est devenue une femme de tête qui n’a jamais abdiqué une sensibilité extrême. Après Un démocrate –un livre complété d’un dossier très intéressant vient de paraître- Julie Timmerman poursuit son questionnement, par le théâtre même, d’épopées qui se sont dessinées grâce aux injonctions d’un monde capitalistique et sans états d’âme. Avec Bananas (and kings) , elle réussit, dans le même style, une plongée hallucinante dans le monde qu’elle évoquait rapidement dans Un démocrate. Elle y évoquait des faits qui sont la conclusion de Bananas, son dénouement, presque. Guatemala 1954 : un coup d’Etat est ourdi par la CIA et la très puissante United Fruit Company. Ce qui est très aigu dans le travail de Julie Timmerman, c’est qu’elle nous apprend, sans leçon rigide, comment les multinationales ont pu commencer à grignoter le pouvoir des Etats, dans l’unique pensée de leur profit financier. On ne vous résumera pas ici les faits et moins encore la manière dont l’auteure et metteuse en scène conduit son récit. Elle le développe avec intelligence et efficacité, sans jamais amoindrir le charme consubstantiel au théâtre. Avec quatre comédiens –elle évidemment et aussi Anne Cressent, Mathieu Desfemmes, Jean-Baptiste Verquin, en s’appuyant sur une équipe artistique et technique de premier plan (décor, lumière, son, vidéo, musique, costumes), elle nous captive. Quatre pour quarante-trois personnages. Du XIXème siècle aux années soixante, on voit grandir une société tentaculaire et toxique, la United Fruit Company. On la vit détruire les Indiens, les réduire, les ruiner, les exploiter, les déposséder, pour pratiquer l’ultra culture de la banane et agir sur tous les rouages des pays utiles à ce déploiement arasant. Des pouvoirs de la communication, de la propagande, dans Un démocrate, à celui des atroces connivences dans Bananas, Julie Timmerman, mine de rien, écrit des pièces fortes, puissantes. Disons-le, en cette très morose rentrée qui offre une cascade de gentils essais d’un intérêt plus que faible, Bananas est un véritable morceau de théâtre, palpitant et enthousiasmant. Pas le temps aujourd’hui d’analyser les passages d’un mouvement à l’autre, d’un personnage à l’autre –Julie aime les personnages de garçons !- , pas le temps de louer dramaturge et collaborateur artistique. On y reviendra, Un seul mot : allez-y ! Du théâtre exigeant, élitaire pour tous, comme on le dit, reprenant Antoine Vitez. Allez-y et nous y reviendrons… Théâtre de la Reine Blanche, du mercredi au samedi à 21h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h50 sans entracte. Jusqu’au 1er novembre. Tél : 01 40 05 06 96. Lisez l’ouvrage consacré à la pièce précédente « Un démocrate », ou le parcours d’Edward Bernays, « petit prince de la propagande ». C&F éditions –Caen master édition. 18€. reservation@scenesblanches.com https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/bananas-and-kings Légende photo : Les Indiens, tous les Indiens en un personnage, femme-fantôme qui témoigne des faits. DR Photo de Pascal Gély.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 5, 2020 6:22 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 5 septembre 2020 On est saisi d’entrée par cette « disputatio » réglée comme une pièce musicale par Marcel Bozonnet qui joue la mort, face à Logann Antuofermo, dans « Le Laboureur de Bohème ». Une joute métaphysique.
Il est plié de douleur, de chagrin, au pied du mur du fond. Lové comme un enfant. Dans un costume couleur sable, qui évoque le Moyen-Âge, mais aussi un bébé au maillot…Car c’est bien cela. Un homme va se lever. Interpeller la mort comme Job interpelle Dieu. Le Laboureur est nu et sans défense, malgré la puissance de sa pensée, son audace, son sens du raisonnement et de la réplique. On devine obscurément qui gagnera, à la fin… C’est Philippe Tesson qui a voulu que ce dialogue très puissant soit joué dans le Théâtre de Poche, que dirige sa fille Stéphanie et qui l’a proposé à Marcel Bozonnet. Le comédien et metteur en scène, ancien Administrateur général de la Comédie-Française, avait monté, l’hiver dernier, une évocation poétique et musicale, construite avec Olivier Beaumont, de l’Eloge funèbre par Bossuet, d’Henriette d’Angleterre. « Madame cependant a passé du matin au soir, ainsi que l’herbe des champs. Le matin, elle fleurissait ; avec quelles grâces, vous le savez : le soir, nous la vîmes séchée… » Le Laboureur de Bohème n’est pas une œuvre inconnue. Florence Bayard, l’a traduite. Dans la présentation par le Théâtre de Poche, on nous dit que « cette partition a été redécouverte au XIXème siècle » et qu’elle « connut un destin théâtral dès le XXème siècle. » On n’a pas oublié la version qui pour nous, a remis en lumière ce texte très étonnant, la mise en scène de Christian Schiaretti qui dirigeait alors Didier Sandre, le Laboureur et Serge Maggiani, la Mort. Avec également Fabien Joubert, apparition d’un ange. Il n’y a pas d’ange visible dans cette version. Dans la traduction de Dieter Welke et Christian Schiaretti, l’adaptation mettait la Mort au féminin. Pas dans cette version, adaptation de Judith Ertel et mise en scène de Marcel Bozonnet et Pauline Devinat, d’après la traduction de Florence Bayard. Ils la mettent, cette Mort, bizarrement, au masculin. Etrange, tout de même, et c’est le tout début : « Terrible destructeur de toute contrée, nuisible proscripteur de tout être, cruel meurtrier de toute personne, vous, Mort, soyez maudit ! ». Dans un espace imaginé par le grand artiste qui a fait vivre les spectacles –et costumes en particulier- de la Comédie-Française, Renato Bianchi, très graphique mais sans froideur abstraite, on écoute donc deux interprètes. L’un, de longue route, dans les superbes enveloppements de costumes, avec la présence de quelques masques superbes de Werner Strub, et des lumières très fines de François Loiseau, impose la Mort. Marcel Bozonnet possède un timbre très personnel. On le reconnaît à la première syllabe. Il est musical. Il s’offre quelques moments de danse. Il a pensé à des moments de danses macabres. Il les situe dans un texte : elles sont tibétaines, guinéennes, espagnoles. Avouons que nous avons vu un danseur japonais. Tel Kazuo Ohno dans l’art spirituel du butô. Bozonnet est inquiétant avec son maquillage pâle et les yeux féroces de la Mort. Face à cet artiste de grande expérience, le jeune, le tout jeune Logann Antuofermo que l’on a pu voir cet été dans le film de Philippe Garrel, Le Sel des larmes, impose loin de toute démonstration, la voix –la sienne est très bien placée- du Laboureur. Job et un enfant désarmé, désarmant. L’auteur, Johannes Von Tepl, est un érudit. Un savant. Un très grand esprit. « La plume est ma charrue ». Il est recteur de l’université de Saaz, en Bohème. Il est également administrateur de la ville. Il a déjà beaucoup écrit lorsqu’il compose Le Laboureur de Bohème. Le texte daterait de 1401. Il nous touche directement. Sincérité, colère, éloquence, puissance : le savant auteur (qui a plus d’une demi-douzaine de noms) vient justement de perdre sa femme. La véhémence le porte. Logann Antuofermo lui, endosse cette partition avec une sincérité, une lumière radieuse et douce. Il est remarquable. Regard ferme et doux, quelque chose de tendrement farouche, courageux personnage, interprète très fin et d’une belle maturité. Il y a aussi de la musique. D’autres voix et notamment, Anne Alvaro. Des instants que l’on ne saisit pas clairement mais qu’importe. Détail. Ici, il s’agit ici d’un théâtre très humain, très haut et accessible. Du théâtre de plaisir et de partage. Théâtre de Poche-Montparnasse, du mardi au samedi à 21h00, le dimanche à 17h00. Durée : 1h25. Texte de l’adaptation publié dans la collection « Quatre vents » (10€). Traduction de Florence Bayard, éditée par la Sorbonne, collection Traditions et Croyances. Réservations au 01 45 44 50 21 www.theatredepoche-montparnasse.com Dans un entretien donné au « Monde », la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, admet que la distanciation est à manier avec délicatesse dans les théâtres tels que le Poche. Pas de règle unique et écrasante, souligne-t-elle. Ecrabouillés que nous sommes, les uns sur les autres, dans les métros, les bus, au théâtre, sage, chacun dans son fauteuil, on peut demeurer, une heure, une heure et quelque, sans risquer plus que dans la vie quotidienne. Légende photo : Avec vue de l’espace imaginé par Renato Bianchi. .La Mort ou le Diable ? Marcel Bozonnet, maquillages de Catherine Saint-Sever, costume de Renato Bianchi. Photographie de Pascal Gély. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 2, 2020 3:29 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 2 juin 2020
Le grand public ne la connaissait pas. Mais le monde du théâtre, oui. Elle aura passé plus de cinquante années à mettre en lumière des talents et à faire vivre des lieux.
Elle était souriante. Très souriante. Petite de taille, grande de force d’âme. Rayonnante et volontiers rieuse. On ne peut la séparer de deux personnalités très belles, qui l’ont accompagnée : sa mère, la comédienne Jenny Bellay et son amie, la femme de sa vie, Dominique Darzacq, journaliste et défenseuse sans faille du beau, du bon théâtre et de celles et ceux qui le font vivre.
Longtemps on s’était inquiétés pour Dominique qui avait dû faire face à la maladie, il y a des années. Elle luttait. Toujours. Martine Spangaro, à son tour, dut affronter de graves problèmes et des maux en cascade. Elle tenait bon. Et puis, le 31 mai, elle s’est éteinte. Elle avait 74 ans. La date de ses obsèques n’a pas encore été fixée.
Rares étaient les soirs où l’on ne rencontrait pas Martine et Dominique. Il fallait que ses obligations la retiennent dans un lieu ou un autre, pour que Martine Spangaro n’assiste pas aux premières représentations des spectacles. Elle avait le regard, le cœur. La bienveillance. Mais devant les prétentieux et autres faux intellectuels, elle était drôle et caustique. Elle était de cette génération à qui on ne la fait pas, si l’on peut ainsi s’exprimer !
Elle était née le 28 mars 1946 et avait fait ses études à Paris et Evreux. Le club de théâtre lui plaît. Et l’exemple de sa mère, bien sûr, qui a fait une très belle carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision et qui, encore récemment, donnait le merveilleux spectacle qu’elle a consacré à Colette.
Martine Spangaro était très fière de sa mère, comédienne qui, il y a encore quelque temps, jouait Colette.
Martine Spangaro a à peine plus de 20 ans, lorsque, à partir de 1968, elle fait ses premiers pas professionnels et affermit son apprentissage au sein d’une association intitulée « Théâtre de la Région Parisienne ». La décentralisation n’est pas encore lancée à pleine vitesse…Mais elle s’esquisse à échelle de la couronne de la capitale, quand, dans la foulée, sera donné au Théâtre de la Commune sa pleine ampleur. Comme au théâtre de Saint-Denis.
En 1971, Martine Spangaro est à Besançon. Elle a le poste, essentiel, de secrétaire générale et participe à l’élaboration de la programmation et donne une impulsion vive aux décisions.
Mais c’est évidemment à Saint-Denis, au Théâtre Gérard-Philipe, auprès de René Gonzalez, qu’elle va s’épanouir, secondant un homme merveilleux qui aura été un découvreur, un bâtisseur, un soutien de la création, partout où il sera passé, après avoir été, quelques années durant, comédien. De Saint-Denis à la MC93, l’Opéra-Bastille et bien sûr Vidy-Lausanne, Martine Spangaro était demeurée très proche de René Gonzalez, mais avait suivi son propre parcours.
Secrétaire générale, chargée des relations publiques et des relations avec la presse, elle veille, découvrant de jeunes talents, participant à la mise en lumière d’auteurs, de metteurs en scène, de techniciens, de comédiens et comédiennes, jusqu’alors inconnus. Elle passe des années à Saint-Denis : de 1974 à 1986, douze années d’une fertilité exemplaire. Théâtre, mais aussi musique et chant, avec Michel Hermon et Giovanna Marini.
Alfredo Arias fait appel à sa personnalité sûre, en 1986, lorsqu’il accède à la direction du centre dramatique d’Aubervilliers, le Théâtre de la Commune. Avec la rigueur et la fantaisie de Martine Spangaro, il élabore une transformation enchantée du lieu et met en place une programmation à son image. Le théâtre renaît.
Enfin, et ce sera l’ultime étape de sa carrière dans le secteur public de la culture, Martine Spangaro rejoint Claude Sévenier à la direction du Théâtre de Sartrouville. Encore les brillantes années d’un théâtre « élitaire pour tous ». De 1989 à 2006, son imagination s’allie à merveille aux missions de cette institution. On retrouve là des artistes aimés de Gonzalez, de Sévenier et d’elle depuis longtemps : Joël Jouanneau qui met en scène ses propres textes et beaucoup d’autres, la chanteuse et comédienne Angélique Ionatos qui de sa voix sublime illumine les soirées de Sartrouville. Et elle met sur pied le festival qui dure encore, un festival de création pour le jeune public, qui essaime dans le département : Odyssées-en-Yvelines. Spectacles pour les jeunes mais d’une qualité telle, d’une originalité si profonde, que l’ensemble du public suit la manifestation. La douzième édition de cette biennale a eu lieu de janvier à mi-mars 2020. Enfin un festival qui a échappé au confinement. Juste à temps !
Le livre des riches heures de Martine Spangaro n’était pas encore refermé. C’est à Avignon, dans le « off » qu’on allait la retrouver. Directrice artistique du Petit Louvre, rue Saint-Agricol, un espace dont elle fit en quelque temps l’une des meilleures adresses d’Avignon. Avec Claude Sévenier, appelé par les propriétaires, Sylvie et Jean Gourdon. Dès le premier été, elle avait imprimé sa marque avec son patron et alter ego en fait, Claude Sévenier. Malheureusement, Claude s’était éteint en février 2016.
Martine Spangaro avait poursuivi sa mission. Elle déplorait de ne pouvoir accueillir les artistes dans de meilleures conditions, mais c’est la loi de la cité des Papes. Le public est là, on joue, mais parfois l’épreuve est sans confort. Tout le monde aimait rejoindre Martine, faire partie de l’équipe de Martine.
Les metteurs en scène lui faisaient une grande confiance et lui demandaient de les assister. Ainsi Alfredo Arias, ainsi Marc Paquien, et quelques autres. Elle se taisait sur la maladie. Elle était aussi pudique que courageuse. Nos pensées vont à sa famille, sa maman, Jenny, et à Dominique.
Martine Spangaro avait quelque chose d’une grande sœur un peu magicienne. Elle réchauffait les cœurs et les plateaux. Une âme de théâtre.
A lire : Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).
Légende photo : Martine Spangaro, souriante et solaire. DR ------------------------------------------------------------------- L'hommage de Gilles Costaz dans Webthéâtre : Une vie au service du théâtre Martine Spangaro nous a quittés le 31 mai. Elle était, dans le monde du théâtre, une femme de l’ombre qui rayonnait d’une grande lumière et ne cessa de participer à l’activité artistique française. Que d’étapes dans cette vie qui s’achève trop tôt, en raison d’une douloureuse maladie ! Dans les années 60, elle était déjà partie prenante au TRP (Théâtre de la région parisienne) qui préparait la décentralisation en banlieue en faisant circuler les spectacles de Pauline Carton, Gabriel Garran, Pierre Debauche, Georges Brassens… Ensuite, coup sur coup, elle collabore à la création de deux Centres dramatiques matinaux, à Limoges puis à Besançon. Elle est ensuite secrétaire générale, au côté de René Gonzalez, du théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis : ce sont de grandes années, fécondes et chahuteuses, comme en témoigne le précieux livre de Dominique Darzacq, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (Solin, 1985).
Ensuite, ce sera l’aventure centrale de sa carrière : la prise en main, avec Claude Sévenier, du Centre d’animation culturelle de Sartrouville, qui deviendra Centre dramatique national. Sévenier et elle, en tant que codirectrice, imaginent des formules nouvelles, comme celle de donner des moyens à des artistes invités (ce seront Angélique Ionatos et Joël Jouanneau) ou le fameux festival jeune public Odyssées-en-Yvelines.
Quand elle quitte Sartrouville, elle s’occupe, d’une manière inattendue, d’une salle du off d’Avignon, le Petit Louvre. D’abord avec Sévenier, puis seule, après la mort de celui-ci. Tous les familiers d’Avignon savent quel lieu important fut le Petit Louvre, avec ses deux salles rue Saint-Agricol, l’une en étage, l’autre dans l’ampleur d’une ancienne chapelle. Pendant dix ans, Martine Spangaro programme là ce qu’il y a de meilleur.
C’était une personnalité passionnée, très active, souriante, discrète. Elle aimait les artistes, elle savait les découvrir. Pour être près d’eux, elle a été assistante de certains metteurs en scène : Michel Vitold autrefois, Alfredo Arias et Marc Paquien plus récemment. Elle était l’une de ces personnalités qui font le théâtre, sans bruit, avec un talent particulier mais égal à celui de ceux qui sont en scène.
.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 22, 2020 4:57 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, 16 mars 2020
Il s’était fait connaître d’une manière éclatante, il y a quarante ans, avec « Essayez donc nos pédalos », fantaisie audacieuse sur l’homosexualité. Comédien, compositeur, metteur en scène sensible d’ouvrages lyriques comme de pièces de théâtre, il était à part. Il s’est éteint le 9 mars, à Rio de Janeiro.
C’est son cœur qui a lâché. Son cœur grand et tendre d’artiste très doué, hyper sensible, fidèle en amitié, son cœur d’éternel gamin imaginatif, doué, rieur, très cultivé, et audacieux. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas en lui un fond de mélancolie tenace.
Alain Marcel s’est éteint le 9 mars dernier, d’une crise cardiaque, à Rio de Janeiro, au Brésil, un pays qu’il aimait particulièrement. C’est son ami Jean-Marie Besset, qui l’avait engagé dans plusieurs de ses spectacles, qui nous l’a aussitôt annoncé. On a attendu car on ne sait pas, en ces cas-là, si les familles sont prévenues, si des amis plus proches ne vont pas être bouleversés d’apprendre ainsi, par un article, la disparition d’un camarade.
Alain Marcel était né en 1952 dans une petite ville du sud-est d’Alger, à la lisière de la Kabylie, non loin de Sétif. Il avait gardé au cœur son pays de naissance et avait d’ailleurs écrit en 2009, Algérie chérie.
Mais sa patrie d’élection, c’était le spectacle vivant. Il aimait les planches. Il avait un vrai talent d’inventeur qu’il soit simple interprète, ou qu’il écrive, compose, mette en scène des opéras très sérieux ou des fantaisies comme il savait si bien en concocter.
Il est rentré d’Algérie avec sa famille et a suivi ses premiers cours d’art dramatique à Tours, avant Paris et le conservatoire où il va suivre la classe d’Antoine Vitez signer son premier spectacle, Scènes de chasse en Bavière de Martin Sperr dont le thème est la violence adressée à un jeune homosexuel.
Il connaît ses premiers engagements de comédien : il est à l’affiche du Sexe faible d’Edouard Bourdet mis en scène par Jean-Laurent Cochet dès 74 et de Les Papas naissent dans les armoires pièce à personnages nombreux, adaptée de l’Italien, portée par une troupe brillante avec Robert Hirsch, Rosy Varte, Michel Robin, plein de monde et aussi Jean-Paul Muel, tous dirigés par Gérard Vergez. Ce fut à la Michodière, en 78-79, un vrai succès !
Mais ce qui va le projeter au-devant de la scène, justement avec Jean-Paul Muel et un autre artiste aux dons multiples, Michel Dussarrat, c’est Essayez donc nos pédalos au Théâtre Fontaine ! Ils sont auteurs et acteurs. On n’a pas idée de cette comédie musicale de proportions raisonnables mais portée par une réjouissante folie et un désir d’en finir avec les hypocrisies lénifiantes sur l’homosexualité alors et pour plusieurs années encore, un délit ! On ne disait pas encore « gay » couramment, sauf si on traversait souvent l’Atlantique ! Mais c’était très gai ! Et à la sortie des spectacles, les trois comédiens, en tutus, vendaient un disque inoubliable. Triste de se souvenir que c’est la jeune Tonie Marshall, qui s’est éteinte le jeudi 12 mars, vaincue par un cancer, qui signait la chorégraphie pour ses amis.
Seul, Alain Marcel écrit le texte et les chansons d’une autre comédie musicale de poche et la met en scène : Rayon femmes fortes, vers 1983. Il y a les trois compères de la compagnie « Coulisse et piston » et des demoiselles de talent : Elisabeth Catroux, Catherine Davenier, Bernadette Rollin !
Ensuite, au théâtre, comme au cinéma ou à la télévision, où il était rare, on le perd de vue car il signe des mises en scène lyriques en France, en Suisse, en Belgique. Rossini, Donizetti, Mozart, Offenbach, Verdi, notamment. Le fantaisiste est un musicien exigeant et il a le sens des œuvres, connaît très bien les chanteurs, et aime la gravité.
A New York il va monter une version bilingue des Mariés de la tour Eiffel de Jean Cocteau.
Mais c’est aussi avec de grands spectacles musicaux, adaptés ou écrits par lui, qu’il va marquer les scènes. La Petite boutique des horreurs, qu’il crée en français au Dejazet, Peter Pan, Kiss me Kate, My Fair Lady, et même La Cage aux folles version « musical » de Broadway, en 1999, à Mogador.
Ces dernières années, d’une part il avait renoué avec des formes plus légères, sur des textes et musiques souvent composés par lui : Le Paris d’Aziz et Mamadou et surtout L’Opéra de Sarah, magnifique évocation d’une femme, Sarah Bernhard, bien sûr, qu’il admirait et dont il connaissait la vie, les travaux et les jours avec une passion érudite et émerveillée.
Les ultimes fois qu’on a applaudi cet être si généreux, c’est dans des textes de Jean-Marie Besset. Perthus en 2008, Rue de Babylone en 2012, Le Banquet d’Auteuil en 2014. Entretemps, Alain Marcel avait présenté Encore un tour de pédalos au Rond-Point, il y a dix ans !
Légende photo : Ils sont jeunes, beaux, drôles, ils sont courageux ! Pochette du disque que nos trois amis vendaient eux-même à la sortie des spectacles. DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 8, 2020 1:40 PM
|
I Il a souvent joué dans des pièces de Yasmina Reza. Il a rêvé de jouer une femme. Elle a écrit pour lui le monologue « Anne-Marie la Beauté ». C’est lui. C’est bien lui. Un léger maquillage, un semblant de perruque, le tout imaginé à la perfection par Cécile Kretschmar. Il est assis sur une méridienne, plantée sur le plateau de la petite salle de la Colline. Il recoud sa jupe. Il porte un corsage imprimé sur une combinaison. Il enfilera devant nous cette jupe et glissera ses pieds dans de jolies mules rouges, achetées à Venise. Un peu plus tard, Anne-Marie videra son sac : que contient-il ? Des pochettes, des petites bourses, des trucs rangés, protégés. Et puis elle se hissera sur des chaussures à haut talon après avoir pris soin de mettre ses boucles d’oreille. Elle s’adresse à nous, ce qui explique sans doute qu’après « mademoiselle » (« J’articulais parce que j’aimais dire les mots mademoiselle »), il y aura « monsieur » (« Vous savez mon rêve monsieur ? »), etc : nous les spectateurs. Elle remercie que l’on soit venu l’interviewer, mais elle triche : c’est elle qui décide de tout… Yasmina Reza a écrit pour André Marcon et signe la mise en scène. Elle s’est très bien entourée : Emmanuel Clolus, pour la scénographie, Orjan Wikström pour les peintures, Dominique Bruguière pour la lumière. Un espace simple magnifié par les projections des silhouettes, des tableaux, et l’éclairage qui ne cesse d’évoluer, tout comme la musique qui marque les articulations. Laurent Durupt d’après Bach, Brahms. Tout cela est très élégant, très délicat. L’écrivain donne la parole à une comédienne qui n’a jamais connu la gloire. Elle doit avoir 70 ans, pas plus. Elle a admiré beaucoup une de ses camarades, Giselle Fayolle. Elle a été jolie, Anne-Marie. Elle a été un bon élément dans des productions professionnelles. Elle a vécu sa vie. N’en disons pas plus car l’intérêt est de découvrir les pensées et les rêves de cette femme. Une femme venue de province, une femme éloignée du monde de la culture, dans sa jeunesse. « Toujours eu le spectre de la roue qui tourne Tu commences petites gens et tu finis petites gens » Pas de ponctuation, pas de logique dans les fluctuations des pensées. Cela doit être rudement difficile à apprendre, d’ailleurs. André Marcon est Anne-Marie. Sans composer. Il est doux, extrêmement doux. Il puise au plus profond de lui-même le féminin. La tristesse, la mélancolie d’Anne-Marie. On est ici aux antipodes du travestissement : André Marcon, la virilité même, dans d’autres pièces de Yasmina Reza ou le Général Petypon dans La Dame de chez Maxim, que l’on vient d’applaudir au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et bien sûr les textes exceptionnellement difficiles de Valère Novarina. Ajoutons, et sourions, qu’au cinéma, André Marcon souvent, ces derniers temps, endossé des figures fortes : Philippe Rondot, Louis Pasteur, Charles Pasqua, Jacques Foccart et jusqu’à François Mitterrand ! Quel charme dans ce moment ! Quelle évidence dans l’accord de l’interprète avec le personnage et avec l’encre même de l’auteure. Brève rencontre, grand théâtre. La Colline, petite théâtre, mardi à 19h00, mercredi au samedi à 20h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h15. Tél : 01 44 62 52 52. Jusqu’au 5 avril. Texte publié par Flammarion (12€). Légende photo : Devant les pochettes qui protègent ses menus trésors, Anne-Marie ou André Marcon, tel qu’en lui-même. Une photographie de Simon Gosselin / La Colline. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 15, 2020 8:25 AM
|
par Armelle HÉLIOT dans son blog 8 février 2020
Aux Abbesses/Théâtre de la Ville, l’adaptation d’ «Histoire de la violence» constitue un spectacle remarquable, extrêmement bien conçu et interprété.
Adaptant un livre très bouleversant du jeune Edouard Louis, Thomas Ostermeier réussit à conserver et l’originalité et la puissance de l’écriture de l’écrivain.
Il faut dire qu’il a composé cette adaptation avec Edouard Louis lui-même et avec son dramaturge, Florian Borchmeyer.
Le résultat est remarquable, qui soutient un spectacle exceptionnellement réglé, d’une invention de tous les instants et audacieux. Le spectacle se donne en langue allemande, puisqu’il s’agit d’une production de la Schaubühne Berlin. Très lisibles sont les surtitres, placés dans le champ de vision des spectateurs : on ne lâche pas un instant les comédiens.
Un musicien, à cour, accompagne discrètement la représentation qui se déploie sur deux heures très vite envolées, car les rythmes et la construction complexe sont efficaces et soutiennent sans faiblesse l’attention du spectateur, qu’il ait ou non lu le livre d’Edouard Louis.
Derrière sa batterie, attentif, impliqué, délicat, Thomas Witte.
Au fond, un écran sur lequel sont diffusées des images, pour la plupart captées, avec une maestria époustouflante, par les interprètes eux-mêmes avec leurs téléphones portables.
Une manière supplémentaire, pour Thomas Ostermeier, de nous plonger dans le monde, ici et maintenant.
Il ose ici, même des instants de danse, qui s’intègrent parfaitement. Il y a ici, intelligence et joie mêlées, maîtrise sans raideur de la représentation.
Quatre comédiens seulement, sur le plateau. Deux d’entre eux incarnent les protagonistes du drame : le blond, mince, d’une jeunesse lumineuse, Laurenz Laufenberg, Edouard, et le brun, barbu, sans doute un peu plus mûr, Renato Schuch, Reda, le garçon d’origine kabyle qui transforme une rencontre de hasard en épisode très traumatisant…
On le sait, c’est un épisode réel de sa vie que raconte Edouard Louis. Un soir de Noël, après un réveillon, les livres qu’on lui a offerts pour tout bagage, il se laisse tenter par un jeune homme très beau…
Les premières images sont l’irruption des enquêteurs qui, dans leurs combinaisons blanches, recherchent les traces de l’agression…Ils sont trois. Renato Schuch lui-même, et les deux autres comédiens, Alina Stiegler, Clara, la sœur d’Edouard, et une femme médecin, une infirmière, une policière et Christoph Gawenda, le mari de Clara, Alain, mais aussi, la mère d’Edouard et Clara, et encore un policier, un infirmier, un médecin.
Dans cet éventail d’apparitions, l’ironie des regards s’impose et, notamment lorsque surgit la mère, le souvenir de la mère… Humour qui libère, qui permet des respirations par-delà les tensions. Et trajets que l’on admire, car ils sont en ruptures vives, précision du jeu, sur des scènes denses et éloquentes. Alina Stiegler et Christophe Gawenda sont formidables et rigoureux jusque dans les moments presque farcesques…
Edouard est donc incarné par quelqu’un qui n’est pas sans lui ressembler, physiquement. Il y a Laurenz Laufenberg, tendre, timide, hésitant puis s’abandonnant, et sa voix intérieure que l’on entend parfois ; face à lui, séduisant autant qu’inquiétant, Renato Schuch, joue sur les arêtes de l’ambivalence du personnage.
Ce que raconte Histoire de la violence, ce n’est pas un fait divers, une nuit de cauchemar ; non, c’est la société d’aujourd’hui et ses préventions, ses peurs, ses grilles de lecture teintées de racisme obtus. Au-delà des faits, cette analyse est magistralement lisible.
Théâtre de la Ville aux Abbesses, à 20h00 du mardi au samedi, dimanche à 15h00. Durée : 2h00. Tél : 01 42 74 22 77. En langue allemande avec de très lisibles surtitrages. Jusqu’au 15 février.
theatredelaville-paris.com
L’adaptation est publiée par les éditions du Seuil sous le titre « Au cœur de la violence » (14€).
Copyright ©2019, Armelle Héliot, Tout droits réservés.
Légende photo : Laurenz Laufenberg, Renato Schuch, Alina Stiegler. Photo d’Arno Declair. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 14, 2019 7:45 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 14/11/2019 Traduite par Myriam Tanant et Jean-Claude Penchenat qui l’avait montée, « Une des dernières soirées de Carnaval » est mise en scène avec finesse par Clément Hervieu-Léger et jouée par une quinzaine de comédiens, jeunes et très doués.
Un décor simple permettant la circulation (et la longue tournée) : de grands panneaux de bois comme de hautes parois mobiles qui protègent le son. Quelques meubles : des sièges, dont de simples chaises d’école en bois clair et tubulures de métal, des tables sur tréteaux, quelques fauteuils qui semblent confortables et plus dans l’esprit de l’époque traduite par des costumes superbes mais sans ostentation. Quelque chose sonne vrai, ici. Aurélie Maestre signe la scénographie, Caroline de Vivaise les costumes, David Carvalho Nunes les perruques et maquillages. Bertrand Couderc éclaire l’ensemble avec délicatesse. Ajoutons de la musique, discrètement, avec Erwin Aros comme conseiller et Jean-Luc Ristord, pour la réalisation sonore. Et des voix, de superbes voix telle celle d’Erwin Aros, justement, qui intervient régulièrement et apporte sa grâce et sa poésie comme le font les deux musiciens, M’hamed El Menjra et Clémence Prioux qui marquent les articulations des actes et s’imposent à la fin alors que, dévoilons-le, tout le monde entre dans la danse, selon des chorégraphies de Bruno Bouché, et se déploie dans le chant.
Quinze interprètes, dont les deux musiciens et le chanteur, intégrés au jeu, servent avec une alacrité enjouée et une intelligence idéale, l’intrigue sentimentale et touchante, mais qui nous fait plonger dans le monde de Venise qu’Anzoletto (Louis Berthélémy) célèbre à la fin de la comédie, tandis qu’il se prépare à un grand voyage pour Moscou.
C’est la Venise de Goldoni, entreprenante et gourmande de vie et de joie. On est dans le monde des tisserands, des brodeurs, des dessinateurs. Tous ces artisans, ces commerçants qui louent les qualités des productions françaises, vivent leurs amours, leurs couples, leurs rêves avec plus ou moins de bonheur.
C’est la Venise du départ, pour le grand écrivain qui, vaincu un moment par l’hostilité puissante de son rival, Carlo Gozzi, doit se rendre à Paris. Nous sommes en 1762. Cette comédie est comédie d’adieux.
Zamaria (Daniel San Pedro), tisserand prospère, a invité ses amis pour la fin du carnaval. Un des jeunes gens, Anzoletto (Louis Berthélémy, on l’a dit), dessinateur remarquable, est invité à Moscou. La fille de Zamaria, Domenica (Juliette Léger) est amoureuse du beau blond. Pourra-t-elle l’épouser ? Et même partir, elle aussi, pour Moscou ?
Il y a beaucoup de couples dans la pièce. Des heureux et équilibrés, des névrosés, des frivoles. Il y a une malade (imaginaire) et rageuse, Alba, Aymeline Alix, impayable emmerdeuse, et son mari d’une infinie patience, Jean-Noël Brouté, il y a la belle et autoritaire et libre Maria, Clémence Boué, il y a une française, déjà trois fois mariée, très mal vue de cette petite société. Elle aussi doit se rendre à Moscou et se dit amoureuse d’Anzoletto, avec qui elle s’apprête à voyager. Marie Druc est cette Madame Gatteau qui va trouver encore un nouveau mari… Il y a bien sûr aussi le boute-en-train, Momolo, calendreur et joueur, Stéphane Facco, idéal.
Citons-les tous : Adeline Chagneau, Charlotte Dumartheray, Jérémy Levin, Guillaume Ravoire, le filleul, sa femme à haute perruque poudrée, la jeune fille qui fait rêver Momolo.
Toute la troupe est parfaite. La traduction de la regrettée Myriam Tanant est fluide et savoureuse, comme il se doit. Elle l’avait composée avec Jean-Claude Penchenat qui avait monté cette pièce lumineuse et mélancolique il y a des années.
On est très heureux de retrouver cette soirée de carnaval, la vie active et enfiévrée de Venise et tous ces personnages si bien incarnés. Goldoni les aime tous et leur donne une épaisseur humaine immédiate. L’excellent et sensible Clément Hervieu-Léger signe un spectacle accompli. Une perfection dans la distribution, la direction d’acteurs, les mouvements, la vision.
Sans doute le meilleur des spectacles dont on puisse rêver : après les Bouffes du Nord, il sera longtemps en tournée.
Théâtres des Bouffes du Nord, du mardi au samedi à 20h30, samedis à 15h30, dimanche 24 novembre à 16h00. Jusqu’au 29 novembre. Durée : 2h10. Tél : 01 46 07 34 50. Puis en tournée.
www.bouffesdunord.com
Crédit : Une photographie de Brigitte Enguerand. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 27, 2019 10:48 AM
|
Disparition de Jacques Nichet : Hommage des journalistes
Armelle Héliot dans son blog : Jacques Nichet, la discrétion et l’audace Metteur en scène, directeur de grandes institutions, il s’est éteint des suites d’une longue maladie. Il avait 77 ans. Il laisse une très forte empreinte. Il aimait la même histoire que celle que Jean-Louis Trintignant adore raconter dans ses spectacles. Jacques Nichet, lui, en avait fait la chute de sa leçon inaugurale au Collège de France (chaire de création artistique, 2009-2010). Il aimait dire, divertir. Il aimait les ellipses : « Un jour, un homme vint trouver le directeur d’un cirque et lui demanda si par hasard il n’avait pas besoin d’un imitateur d’oiseau. « Non », répondit le directeur du cirque. Alors l’homme s’envola à tire d’aile par la fenêtre. » Jacques Nichet s’est envolé. Il s’est éteint le 29 juillet, vaincu par une longue maladie qu’il avait traitée avec distance, sinon indifférence. Il s’y était abandonné, comme las, hanté d’un insondable chagrin. De nos jours, 77 ans, cela sonne jeune, surtout pour un artiste toujours curieux de lectures et de découvertes. Les circonstances font que l’on a connu le tout jeune agrégé de Lettres Classiques qui, à peine sorti de l’Ecole Normale supérieure, avait choisi d’enseigner au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes, cette fac née en plein bois, quelques mois après mai 1968. On disait que seuls des professeurs qui n’avaient plus rien à prouver s’aventuraient dans … l’expérience…Michel Deguy, Michel Foucault, Lucette Finas, la très jeune et très brillante Hélène Cixous –une thèse remarquée sur James Joyce et un roman prix Médicis, Dedans. Il y avait aussi le jeune Nichet, déjà épris de théâtre puisqu’il avait monté Les Grenouilles d’Aristophane du temps de l’ENS, avec une compagnie qui se nommait déjà L’Aquarium. Il allait faire comme les étudiants : tracer sa route à travers bois, pour aller de la fac à la Cartoucherie où régnaient déjà Jean-Marie Serreau et le Théâtre de la Tempête, Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil. Et ce fut, en 1973, l’installation du Théâtre de l’Aquarium avec deux artistes comme lui très épris de haute littérature, audacieux et fédérateurs : Jean-Louis Benoit et Didier Bezace. Des années durant, l’Aquarium fut marqué par ce trio très entreprenant, soucieux de son temps et qui dépasse très vite les frontières de l’ancien terrain militaire : Les Marchands de ville à Paris, monté tandis que les travaux se déploient à la Cartoucherie, puis, en 1976, un spectacle en lien avec le combat des « Lip », à Besançon, La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras. En 1986, il fut nommé à la direction du centre dramatique national de région de Languedoc-Roussillon : le théâtre des Treize Vents à Montpellier. Il monte Lorca et Calderon de la Barca, Diderot et Marivaux, mais aussi Euripide, Synge, Eduardo De Filippo, Javier Tomeo, Bernard-Marie Koltès et son cher Serge Valletti. Certains de ces spectacles sont présentés ensuite en tournée dans toute la France et à Paris, Théâtre de la Ville, Colline, ou la ceinture parisienne. Aux Gémeaux de Sceaux, à la Commune d’Aubervilliers, plus tard. Il y créera même des spectacles, les dernières années. Juillet 1996 marque une grande date : il met en scène, pour la cour d’Honneur du palais des Papes d’Avignon La Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire. Un spectacle magistral, inoubliable donné sous la direction de Bernard Faivre d’Arcier. En octobre 1998, Jacques Nichet prend la direction du Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées, dans un bâtiment tout neuf. Il inaugure ce nouveau chapitre avec Serge Valletti, montant de nombreux contemporains : Keene, Koltès, Alexievitch dont il crée Les Cercueils de zinc. Il met également en scène Nicolaï Erdman et Dario Fo, un homme de théâtre qui correspond à ses préoccupations et à son goût d’un théâtre aussi actif que poétique. Dans chacun des choix de Jacques Nichet, dans chacune de ses mises en scène, on retrouve une délicatesse et une acuité, une profondeur et un souci du bonheur du public. Il est très fin, très subtil, très aigu, mais il ne s’enferme jamais : il pense au spectateur, il pense à transmettre, à émouvoir et à éveiller. « J’évite avant tout d’éblouir le public, ce serait l’aveugler : je souhaite lui suggérer ce qui se joue dans l’ombre » disait-il encore dans la première leçon au Collège de France. A 65 ans, en 2007, il avait quitté l’institution. Avec détermination, lucidité, sens du partage et des plus jeunes générations. Il y aurait beaucoup à raconter sur cet homme qui était un artiste ultra-sensible et avait un grand sens du service public. Jusqu’à ces derniers mois, il avait monté des spectacles. On n’oublie pas, en 2009, sa sublime version de La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, à la Commune. Il avait même dit des textes de Leopardi. Il était revenu au TNT en 2018 pour diriger Thierry Bosc dans Compagnie de Samuel Beckett. Une cérémonie d’adieux a lieu le 1er août, à 9h00, en la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. L’inhumation aura lieu le lendemain, 2 août, au vieux cimetière de Béziers, à 13h00. Une soirée d’hommage sera organisée plus tard à Paris. ---------------------------------------------------------------------- Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan, paru le 2 aôut 2019 : Jacques Nichet aura été l’une des grandes figures nées du théâtre universitaire. Au théâtre de l’Aquarium, lui et toute la troupe allaient inventer une autre façon de faire du théâtre où le travail collectif, en prise sur le réel, allait être primordial. Par la suite, il devait diriger ,avec brio mais plus classiquement, le théâtre des Treize-vents à Montpellier puis le TNT à Toulouse. Un cancer foudroyant aura abrégé à 77 ans la riche vie de Jacques Nichet ce 29 juillet. Une longue histoire qui traverse plus de cinquante ans de théâtre. "Un style nouveau, un répertoire original" Tout commence dans les années 60. Élève à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, Jacques Nichet y fonde le groupe 45 . En 1964, le groupe monte Le sacrifice du Bourreau de René de Obaldia et vient avec ce spectacle au festival de théâtre universitaire de Nancy créé l’année précédente par le jeune Jack Lang (qui, lui, anime le Théâtre Universitaire de Nancy) C’est la grande époque du théâtre universitaire en France (et dans le monde entier) d’où sortiront, pour ne citer qu’eux, Patrice Chéreau et Ariane Mnouchkine. Les groupes de théâtre universitaires sont affiliés à la FNTU (-Fédération Nationale de Théâtre Universitaire). Jacques Nichet deviendra un temps président de cette fédération succédant à Patrice Chéreau. Le 4 janvier 1965, le groupe 45 devient le Théâtre de l’aquarium (c’est le nom que les élèves de l’ENS donne à la guérite en verre du gardien) . Nichet en est le directeur et en devient le metteur en scène sans que ce titre soit revendiqué. Aux Grenouilles d’Aristophane succède Et les chiens se taisaient d’Aimé Césaire, spectacle qui tourne dans les villes du sud. Pour la première fois , la troupe rencontre un public non -universitaire. En 66 retour au Festival de Nancy avec Monsieur de Pourceaugnac de Molière La troupe se présente ainsi dans le programme : « nous travaillons dans l’esprit de la fédération nationale de théâtre universitaire : gardant l’anonymat, nous évitons de plagier les professionnels et nous recherchons un style nouveau ou un répertoire original ». L’année suivante Les guerres picrocholines d’après Rabelais reçoit le grand prix au Festival international de théâtre universitaire de Zagreb. Ce qui vaut au spectacle d’être joué cinq fois au théâtre du Théâtre du vieux Colombier et d’être prolongé, aux frais de la compagnie, mais le public répond présent. En 1968, l’Aquarium précède les événements avec un spectacle d’après Les Héritiers de Bourdieu et Passeron. Titre : L’Héritier ou les étudiants pipés écrit par Nichet et un peu par Bourdieu Au fil des spectacles, la troupe se renforce.Jean-Louis Benoit la rejoint pour une tournée en Amérique Latine, Didier Bezace viendra un peu plus tard Comme les meilleurs troupes universitaires qui perdurent, L’Aquarium est de moins en moins universitaire et de plus en plus professionnelle. Le collectif reste le maître mot. Et il se produit une chose qui parait incroyable aujourd’hui : alors que la troupe est en grande difficulté financière, Pierre Cardin programme leur nouvelle création Les évasions de monsieur Voisin, texte écrit par Nichet à partir de documents et d’improvisations. C’est à la fois un style nouveau et un répertoire original qui vont faire les beaux jours et les belles nuits du Théâtre de l’Aquarium lorsque la compagnie s’installera à la Cartoucherie en 1972 à l’invitation d’Ariane Mnouchkine déjà là avec le Théâtre du Soleil Jean-Marie Serreau ne tardera pas à venir occuper d’autre bâtiments auxquels il donnera le nom de Théâtre de la tempête). Tout est à faire dans les locaux de l’Aquarium qui servaient d’entrepôts à Jean-Louis Barrault pour ses décors. Les murs, la verrière, le plateau, les coulisses les toilettes, l’électricité, les bureaux, tout. Chacun s’y met selon ses compétences réelles ou autoproclamées. L’une des actrices de la jeune troupe , Karen Rencurel, excellente photographe, a immortalisé ce chantier. Entre ruelle et brouette on reconnaît Jean-Louis Benoît,Thierry Bosc, Bernard Faivre, Louis Mérino, Martine Bertand, l’administrateur Bruno Genty, j’en oublie. Troupe et triumvirat Et la troupe imprègne les murs à jamais. Égalité de salaires, AG souveraine (comme cela sera le cas du quotidien Libération qui commence à paraître de temps en temps l’année suivante), travail collectif, discussions infinies, sujets d’actualité, une utopie en acte. Jacques Nichet est officiellement le seul directeur de l’Aquarium ( le ministère de la culture ne veut voir qu’une tête) , mais un triumvirat -Nichet, Benoit, Besace- va progressivement s’imposer. Chacun supervise ou initie tel ou tel projet. Cette histoire qu’il faudrait nuancer et préciser a été racontée par le menu dans deux ouvrages La Cartoucherie, une aventure théâtrale par Joël Cramesnil (Les éditions de l’Amandier ,2004) et L’Aquarium d’hier à demain par François Rancillac (Editions Riveneuve.Archimbaud, 2018). En arrivant dans le lieu comme directeur, Rancillac a voulu en connaître l’histoire, il la restitue à travers une pièce documentée et recomposée qui, joliment met en scène les personnages de cette histoire. Jacques Nichet qui en signe la postface conclut : « Tu a écrit, mieux que moi, cher François , l’art poétique implicite de notre théâtre « à brûler », comme disait notre ami Dario Fo. J’espère que mes copains de l’Aquarium auront la même chance que moi de découvrir un tel texte judicieux et jubilatoire! Ils s’y retrouveront, j’en suis sûr, et de tout mon cœur te remercieront : puisse cette page nous permettre de renouer les uns avec les autres, ce serait un joli miracle , un vrai coup de théâtre ! » Car, effectivement, après des années fastes et intenses, des spectacles inoubliables, un esprit sans pareil, l’aventure unique de l’Aquarium, première manière, allait petit à petit se déliter -sans pour autant s’essouffler- comme souvent les aventures où le collectif prime sur l’individu (lequel renaît toujours de ses cendres). Des spectacle comme Les marchands de ville (le titre résume son contenu) -accueilli par Georges Wilson au TNP salle Gémier, puis le premier à être donné à la Cartoucherie Gob (sur la presse et le fait divers de Bruay en Artois) ou encore Tu ne voleras point (un spectacle sur la justice en forme de cabaret), La jeune lune tient la vieille lune toute une nuit dans ses bras (autour de l’entreprise), La sœur de Shakespeare (sur le rôle de la femme, six mois de représentations à l’Aquarium, cinq mois de tournée en France et à l’étranger) sont signés par toute la troupe, même si le rôle de Nichet, en coulisses est prépondérant (mise en forme, écriture, synthèse) après un travail collectif tout azimut. Le acteurs s’affirment, les personnalités aussi, Nichet reste, dans l’ombre , la tête la mieux pensante ? Le collectif connaît de nouvelles recrues mais les collectifs meurent plus vit que ceux qui les ont engendré .Jean Louis Benoît et Didier Bezace portent de bout en bout des projets formidables comme Un conseil de classe pour le premier ou Pépé pour les deux. Nichet (qui lui-même signe la mise en scène d’Ah Q , une pièce chinoise que lui a fait connaître Jean Jourdheuil), n’en prend nullement ombrage. Au collectif succède un collège d’artistes. De Montpellier à Toulouse En 1986, Jacques Nichet laisse l’Aquarium à Didier Bezace (qui sera nommé plus tard au Théâtre de la commune d’Aubervilliers) et à Jean Louis Benoit (qui sera nommé plus tard au théâtre de la Criée à Marseille). Il est nommé à la direction des Treize vents, le CDN de Montpellier, douze ans plus tard il prend la direction du TNT (théâtre National de Toulouse) qu’il quittera en 2007 avec ces mots : « Dans le métier, il est de coutume d’exercer jusqu’à 70 ans. À 65 ans, j’ai senti qu’il fallait boucler un cycle, j’ai décidé de me surprendre moi-même en forçant le destin… La vie n’est intéressante que si elle est surprenante ! » Durant ces longs mandats, ils nous aura surpris et ravi plus d’une fois. En montant de nombreux classiques mais aussi Sik-Sik – Le Haut-de-forme d’Eduardo de Filippo, Monstre aimé de Javier Toméo , Le jour se lève Léopold de Serge Valetti, Faut pas payer ! de son ami Dario Fo ou encore adaptant au théâtre Les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch. Grand moment, il fera entrer dans la cour d’honneur du Palais des papes au festival d’Avignon la parole d’Aimé Césaire en mettant en scène La tragédie du roi Christophe (1996). Cet agrégé de lettres classiques qui enseigna longtemps à Paris VIII devait tenir au Collège de France la chaire de création artistique en 2009-2010. Son dernier spectacle aura été en 2018 un Beckett mettant en scène Thierry Bosc (un vieux compagnon de l’Aquarium) dans Compagnie, un mot qui résume la vie de cet homme par ailleurs discret voire secret, un demi-sourire accroché en permanence aux lèvres. L’inhumation aura lieu aujourd’hui à 13h au cimetière de Béziers Un hommage lui sera rendu à Paris à la rentrée au théâtre de l’Aquarium Jean-Pierre Thibaudat -------------------------------------------------------------------- Franck Riester, ministre de la Culture : Le communiqué de presse : http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Hommage-de-Franck-Riester-ministre-de-la-Culture-a-Jacques-Nichet --------------------------------------------------------------------- Jean-Claude Raspiengeas dans La Croix :
http://sco.lt/6V30pk Le metteur en scène de théâtre Jacques Nichet est mort le 29 juillet à 77 ans.
Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de lettres, il avait cofondé avec Didier Bezace et Jean-Louis Benoit, le Théâtre de l’Aquarium, à la Cartoucherie de Vincennes.
Il incarnait une forme de douceur et d’érudition. Ses mots étaient pesés, son regard bienveillant, son sourire encourageant. Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de lettres, Jacques Nichet avait débuté en 1965 par une mise en scène de la pièce d’Aristophane, Les Grenouilles. Dans la foulée et les ardeurs de Mai 68, jeune Turc de la scène, il avait fondé une troupe universitaire, la Compagnie de l’Aquarium. Quand Ariane Mnouchkine avait posé son Théâtre du Soleil sur le site militaire désaffecté de la Cartoucherie, dans le bois de Vincennes, Jacques Nichet l’avait rejointe pour créer, avec Didier Bezace et Jean-Louis Benoit, le Théâtre de l’Aquarium.
Le trio ébouriffant monte des spectacles hors du répertoire, créations collectives issues de l’autogestion et, bien dans l’air de ce temps-là, des pièces politiques et grinçantes, écrites après enquêtes sur le terrain. « Des formes bâtardes, souvent réalisées en peu de temps et sans trop d’argent qui affirmaient leur originalité et d’autres façons d’inventer le théâtre », rappelait Jacques Nichet, lors de sa conférence inaugurale au Collège de France où il occupa la saison 2010-2011 la Chaire de création artistique, après quarante ans d’expériences au Théâtre de l’Aquarium, au Théâtre des Treize Vents, au Théâtre National de Toulouse, puis à la Compagnie l’Inattendu.
Peu à peu, le Théâtre de l’Aquarium revient aux grands auteurs, Kafka, Ferdinando Camon, Lu Xun. Au milieu des années 1980, Jacques Nichet quitte la capitale et repart vers sa région d’origine, l’Occitanie. Il pose ses valises à Montpellier où il succède à Jérôme Savary à la tête du Centre dramatique national du Languedoc-Roussillon, rebaptisé par lui « Théâtre des 13 Vents », qui met en valeur les textes classiques de Lorca, Calderon, Euripide, et fait connaître des auteurs contemporains comme Serge Valletti.
En 1996, invité au festival d’Avignon, Jacques Nichet fait entendre dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes une mémorable adaptation du grand texte d’Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe.
« La vie n’est intéressante que si elle est surprenante »
En 1998, nouveau départ à la direction du Théâtre national de Toulouse. Il y monte des œuvres de Shakespeare, Dario Fo, Bernard-Marie Koltès, Sophocle, Georges Perec et une adaptation du livre de témoignages sur la guerre en Afghanistan que mènent les Russes, Les Cercueils de zinc, de Svetlana Alexievitch, futur Prix Nobel de littérature. Il s’engage aussi dans la création du Centre international de traduction théâtrale.
En 2007, à la surprise générale, il fait valoir ses droits à la retraite. Il a 65 ans. « Plus on tarde, plus on s’accroche », explique-t-il. Il quitte l’institution et repart sur ses propres chemins de liberté. « La vie n’est intéressante que si elle est surprenante », disait-il. Il met sur pied une nouvelle compagnie, L’Inattendu. Le dernier spectacle de Jacques Nichet, en 2018, était une mise en scène d’un texte de Beckett dont le titre, rétrospectivement, semble boucler le parcours de sa vie : Compagnie. Derrière ce mot, un ancrage et la nécessité d’être avec les autres, toujours.
Comment définissait-il son art, sa voie poétique ? « Cristalliser, saisir quelque chose du temps que nous vivons ensemble. Regarder notre réalité pour y voir plus clair. » ----------------------------------------------------------------------------------------- Brigitte Salino dans Le Monde : (cliquer ici pour accéder à l'article) ------------------------------------------------------------- Gilles Costaz dans Webthéâtre :
Décentralisation, deuxième génération Né à Albi en 1942, Jacques Nichet est le co-créateur du théâtre de l’Aquarium, avec Jean-Louis Benoit et Didier Bezace, fondé en 1970. Avant d’être élève de l’Ecole normale supérieure rue d’Ulm, où fut créée la première version de cette troupe, Nichat avait déjà fait des débuts remarqués à Grenoble quand il était étudiant en hypokhâgne : sa mise en scène du Médecin malgré lui, dans l’amphithéâtre du lycée Stendhal, avait déjà les qualités de farce explosive qu’il devait développer plus tard. Ayant installé l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes, non loin du Soleil d’Ariane Mnouchkine, le trio fit des étincelles en revendiquant de le principe de la création collective, mais chacun avait une personnalité qu’on a vue se distinguer au fil des années : fièvre comique et satirique chez Nichet, ironie politique chez Benoit, goût de la traversée du miroir chez Bezace. Nichet fit vite preuve de ses dons farcesques avec Les Guerre picrocolines d’après Rabelais, qui restera l’une des grandes références de l’Aquarium. Mais les autres spectacles historiques de l’Aquarium sont collectifs et politiques : Marchands de ville (1972) dénonce la spéculation immobilière, Tu ne volerais point (1974) traite des détournements de fonds publics et La Jeune Lune (1976) des occupations d’usines.
Le trio Benoit-Bezace-Nichet se sépare en 1986, Nichet étant appelé à diriger à Montpellier le Centre dramatique national de Montpellier, au domaine Gramont qu’il rebaptise le théâtre des Treize-Vents. Belles années jusqu’en 1998, où l’inspiration préférée de Nichet – le théâtre du Sud, les auteurs du Sud – prend une place majoritaire. On se souviendra particulièrement de La Savetière prodigieuse de Garcia Lorca, du Magicien prodigieux de Calderon, de Domaine ventre de Valletti, de Monstre aimé de Javier Tomeo, avec des incursions dans d’autres veines du patrimoine mondial : Le Rêve de d’Alembert de Diderot, Le Baladin du monde occidental de Synge, Sik-Sik de De Filippo... En 1990, il crée à Montpellier avec Jean-Michel Déprats la Maison Antoine Vitez, Centre international de traduction théâtrale, structure extrêmement vivante et productive, qui a toujours un rôle premier plan dans la circulation et la découverte de textes de tous pays. En 1996, il donne au festival d’Avignon une mémorable Tragédie du roi Christophe d’Aimé Césaire En 1998, il succède à Jacques Rosner à la tête du Théâtre national de Toulouse. Toujours la même politique de textes ardents et de passion du public : Valletti, Dario Fo, Keene, Horvath, Alexievtich… Ensuite, il avait choisi la discrétion, à la tête d’une compagnie modeste, l’Inattendu, qui faisait un spectacle de temps à autre (Braises et Cendres, d’après Cendras, 2014).
Auteur de deux livres, Je veux jouer toujours, Le théâtre n’existe pas (belle contradiction des titres !), réalisateur d’un film, La Guerre des demoiselles, titulaire de chaire au Collège de France à la fin de sa vie, Jacques Nichet était un homme à la fois chaleureux et réservé, assez différent des autres artistes, d’une nature généralement extravertie. C’était sa manière d’être l’un des grands personnages du théâtre français, l’une des figures de proue de cette seconde génération la décentralisation qui a pris la place des Vilar et autres Planchon pour faire un théâtre plus chahuteur et moins obsédé par les classiques. ----------------------------------------------------------------------- Jérôme Gac dans Blog Culture 31 : Le bâtisseur de théâtres ----------------------------------------------------------------------- Stéphane Capron dans Sceneweb :
-------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 26, 2020 6:51 PM
|
Par Armelle HÉLIOT dans son blog - 26 septembre 2020
Stéphane Braunschweig signe la mise en scène de la tragédie de Racine dans une scénographie marquée par la distanciation. Cela donne une sévérité certaine à la représentation portée par un ensemble de comédiens sensibles répartis en formations changeantes. Si l’on en croit les photographies du livret de salle remis aux spectateurs des Ateliers Berthier, il n’y a pas seulement deux comédiens en alternance pour chaque rôle dans ce travail, mais une combinaison très changeante, mouvante comme l’est discrètement la mer immense qui sert de double toile de fond à la représentation d’Iphigénie. L’entrée dans l’immense espace impressionne. Un podium central recouvert de noir, comme l’ensemble de cette halle. Avec simplement deux chaises. De chaque côté, sur le sol, sont installées les mêmes chaises, blanches, deux par deux. Les murs, à l’arrière de chaque ensemble de sièges, portent d’immenses écrans sur lesquels seront continûment diffusées des images de la mer, la mer à l’infini et le ciel parfois déchiré du vol d’un oiseau. L’une des extrémités de l’estrade centrale s’ouvre sur les corridors de la salle, l’autre est fermée par une paroi et une porte. Une fontaine à eau flanque l’un des côtés. Stéphane Braunschweig l’explique, il a commencé à travailler avec les comédiens au printemps dernier et a pensé cet espace, cette scénographie qu’il signe, dans la perspective de la pandémie et de la distanciation. Curieusement, la mort hante le lieu, évoquant les froids et monumentaux funérariums de certains pays. Mais Iphigénie ne peut s’inscrire autrement que dans un monde que hante la mort. Mort à venir, et mort du monde même puisque les vents sont tombés et aucun souffle ne semble vouloir jamais reprendre. Le dispositif impose aux protagonistes un éloignement certain, mais parfois les personnages se retrouvent, se rapprochent, s’agrippent les uns aux autres et alors, il faut l’avouer, l’émotion touche plus. Un léger défaut affecte la sonorisation : cela peut se corriger. Mais le soir où nous avons vu Iphigénie, le si talentueux Claude Duparfait, Agamemnon, donnait le sentiment de faire exploser les syllabes, effet dommageable et amendable, qui s’est d’ailleurs estompé au fil du jeu. La blonde et délicieuse Cécile Coustillac, jolie personne de la troupe informelle de Stéphane Braunschweig, possède la lumière, la candeur, la grâce, la voix superbe d’une idéale Iphigénie. Elle connaît d’ailleurs l’œuvre pour l’avoir fréquentée il y a des années. Mais, attention, le podium ne pardonne rien et on voit trop cette merveilleuse jeune fille parler en tendant l’index pour appuyer ses propos. C’est tellement difficile d’être debout sur ce plateau, un pantalon et un petit chemisier, comme si elle revenait de la plage, regardée de tous les côtés en légère contre plongée. Ils ont du cran, tous ces interprètes, qui n’ont aucun appui, n’étaient parfois quelques chaises sur lesquelles ils s’asseyent. Mais ils ont la langue, ils ont Racine, ils servent un chef-d’oeuvre. Peu monté. On n’oublie pas une bouleversante Iphigénie, à la Comédie-Française, il y a trente ans, par Yannis Kokkos, avec Valérie Dréville dans le rôle-titre. On oublie une version laborieuse, il y a quelques étés. La pièce est difficile. De l’intime aux manoeuvres politiques, de l’amour aux nécessités de la guerre, Racine plonge au plus profond des atermoiements des êtres. Le mythe, la grande histoire, mais l’humanité aussi, palpitent en une oeuvre construite magistralement et audacieuse. Rien d’encalminé, ici. Sauf les navires. Claude Duparfait, comédien d’exception, laisse sourdre les flottements du grand Agamemnon, jusqu’à sa lâcheté. Mais il laisse apparaître aussi le débat, la déchirure. D’une manière de se mouvoir, de ployer, d’avoir des fêlures dans la voix : « Vous y serez ma fille », répond-il à Iphigénie, lorsqu’elle demande si son « heureuse famille », sera présente lors du sacrifice que doit accomplir Calchas. Achille, ce soir-là, était joué, parfaitement, par un Pierric Plathier vulnérable, perturbé par ce qu’il devine des menaces. Face à eux, Ulysse, Sharif Andoura, Ulysse sans état d’âme, au début. Pas le choix. Pas de question à se poser. Mais il acceptera le dénouement… Arcas, Thierry Paret, tient parfaitement sa partition, comme le font Astrid Bayiha, Doris, Aegine, Clémentine Vignais, Eurybate, Glenn Marausse. Anne Cantineau est une Clytemnestre fermement dessinée, avec ce qu’il faut d’autorité au personnage, sans amoindrir la passion maternelle. Brune et dorée, d’essence tragique est l’Eriphile de Chloé Réjon, aussi séduisante que déterminée. Théâtre de l’Odéon aux Ateliers Berthier, du mardi au samedi à 20h00, le dimanche à 15h00. Relâches les 27 septembre, 11, 25, 31 octobre et 1er novembre. Durée : 2h15 sans entracte. Tél : 01 44 85 40 40 www.theatre-odeon.eu Légende photo : Cécile Coustillac, Iphigénie, Pierric Plathier, Achille. Photographie de Simon Gosselin. DR.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 13, 2020 4:53 PM
|
Par Armelle Héliot, dans son blog - 4 septembre 2020 Il était l’un des co-fondateurs du Théâtre du Soleil. Forte personnalité de la troupe d’Ariane Mnouchkine, il a travaillé avec d’autres artistes, formé des comédiens et été un spectateur passionné que l’on ne cessait de rencontrer lorsqu’il ne jouait pas.
Un profil d’aigle écrit son ami Jean-Claude Berruti : « ton profil de gentil aigle » dit-il plus exactement dans un hommage publié sur Facebook et transmis par le Théâtre du Soleil. C’était frappant. Une forte personnalité physique, sensible, intellectuelle, Gérard Hardy.
Il avait 85 ans. On ne l’imaginait pas octogénaire car il se tenait très droit, comme un danseur, un athlète affectif aurait dit Antonin Artaud (né un 4 septembre…).
Gérard Hardy s’est éteint dans la nuit du 1er au 2 septembre.
Photo de Guido Mencari (que nous remercions). DR publiée par Olivia Corsini. Le dernier rôle de Gérard Hardy.
Il avait été élève de l’Ecole de théâtre de Chaillot alors que Jean Vilar était encore là et il avait, comme figurant, côtoyé la grande équipe du TNP.
Il avait aussitôt enchaîné avec le groupe réuni autour d’Ariane Mnouchkine, l’Association théâtrale des étudiants de Paris. Il est aux Arènes de Lutèce, en juin 1961. Ils jouent Gengis Khan d’Henry Bauchau.
Sur le site du Théâtre du Soleil, demeurent quelques photographies. Et sur celui de l’INA, on peut retrouver le reportage de Georges Paumier, ancien comédien, réalisateur phare du théâtre à la télévision. Il avait filmé la jeune troupe pour une émission d’Eliane Victor. Un très précieux et émouvant document.
Gérard Hardy est donc là. Si jeune ! Il sera là, quatre ans plus tard, pour fonder, avec Ariane Mnouchkine, Philippe Léotard, Roberto Moscoso, Jean-Claude Penchenat, Françoise Tournafond, le Théâtre du Soleil. Son chemin se confond dans les premières années avec la vie de la troupe qui présente ses spectacles au Cirque de Montmartre, entre autres lieux : en 64 Les Petits Bourgeois de Maxime Gorki en 64, Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier en 1966, La Cuisine d’Arnold Wesker en 1967, Le Songe d’une nuit d’été en 1968, Les Clowns en 1969, puis, en 1970 et 1972, le cycle de la Révolution, 1789 et 1793.
Entretemps, évidemment, la troupe s’est installée à la Cartoucherie. Gérard Hardy sera aussi des aventures de Méphisto de Klaus Mann en 1979 et plus tard L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, grand texte d’Hélène Cixous.
Dès les années 70, Gérard Hardy commence à explorer d’autres univers, même s’il est de l’aventure du film Molière qui sort en 1978 et est tourné en grande partie sur le site même de la Cartoucherie, avec les décors double face de Guy Claude François.
La forte personnalité de Gérard Hardy, sa puissance, son regard ferme, son visage (« aigle gentil » donc, à la Béjart, un peu), son articulation classique, son aristocratie et son engagement sans faille, son attention aux autres, séduisent. Et lui, il a le goût de l’aventure et de la liberté. Mais il est consubstantiel au Soleil. C’est sa maison d’éternité.
Il travaille sous la direction du romanesque André Engel avec Baal de Brecht en 1976, enchaîne avec la Franziska de Wedekind montée par Agnès Laurent. Avec Jean-Marie Simon qui l’engage pour Intrigue et amour de Schiller, en 82 et Gilles Atlan qui le dirige dans Minetti de Thomas Bernhard, il est heureux. Il tourne dans le Danton d’Andrzej Wajda qui sort en 1982…et au théâtre, c’est l’intimidant (et très timide) Klaus Mikaël Grüber qui l’appelle à rejoindre le groupe magnifique de comédiens français qu’il réunit pour La Mort de Danton de Büchner. On est en 1989, année de célébration. Cela se crée à Nanterre-Amandiers. C’est inoubliable.
Et il va entamer un sacré long parcours avec Gilles Bouillon qui dit aujourd’hui, dans les colonnes de la République du centre, son chagrin et son bonheur d’avoir travaillé avec cet homme impressionnant qu’il avait rencontré alors qu’il avait vingt ans et était élève de l’école du TNS. Dès 83, il le dirige dans Le Marchand de Venise. Gérard Hardy est Shylock. C’est à Bourges. Mais ce sera surtout à Tours, alors qu’une profonde amitié les lie, que les deux artistes vont travailler ensemble. Gérard Hardy devient une figure très importante du Nouvel Olympia mais, de plus, comme il dirige des ateliers dans les établissements scolaires, il exerce un ascendant très fort sur plusieurs générations et insuffle le goût du théâtre et des beaux textes à de nombreux jeunes. Citons quelques-uns des spectacles, parmi la bonne douzaine élaborée ensemble : Marivaux, Brecht encore (Dans la jungle des villes) Molière, jusqu’à Dom Juan en 2013.
Gérard Hardy aimait partager. Avec Stuart Seide il plonge toute une année dans les textes de Samuel Beckett et se sent bien dans cet univers aussi musical que métaphysique avant de commencer un long chemin avec celle qui dirige aujourd’hui le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, Claire Lasne-Darcueil. Elle écrit parfois, mais surtout explore Tchekhov sans délaisser Molière ou Shakespeare.
Le cinéma fait signe de temps en temps à Gérard Hardy (mais il est en scène, en tournée, ou dans les régions). On le voit dans Jean Galmot, aventurier d’Alain Maline dans Ridicule de Patrice Leconte en 1996. Et dans les années 2000, dans courts-métrages très remarqués : L’Infante, l’âne et l’architecte de Lorenzo Recio en 2001 et Chevaliers errants de Laurent Leclerc, avec un professeur faisant travailler ses élèves sur Don Quichotte, en 2015.
Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec cet esprit volontiers rebelle, aussi accueillant qu’il pouvait être sévère, le pleurent aujourd’hui. Le Soleil bien sûr et ses amis. Et ceux avec qui il n’a joué qu’occasionnellement Lorsqu’il ne jouait pas, Gérard Hardy allait à l’opéra, au concert, au théâtre. On le croisait partout, beau visage toujours, marqué de rides, regard aigu, enveloppé de grands manteaux…
Une de ses dernières apparitions, il y a un peu plus d’un an, était dans A Bergman affair, travail d’Olivia Corsini et Serge Nicolaï : deux enfants du Soleil, de la nouvelle génération… Ainsi boucla-t-il la boucle, du Soleil au Soleil…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 14, 2020 6:25 PM
|
Marcel Maréchal, biographie et hommages publics
Marcel Maréchal - Biographie concise Né le 25 décembre 1937 LYON (1958-1975) : 1958 - Fondation de la Compagnie des Comédiens du Cothurne. 1960 - La troupe s’installe rue des Marronniers. Elle passera huit ans dans le petit théâtre où avait débuté Roger Planchon. Elle y créera notamment Badadesques et Capitaine Bada de Jean Vauthier et Cripure de Louis Guilloux. 1968 - Ouverture du Théâtre du Huitième avec la création de La Poupée de Jacques Audiberti. L’année suivante, Marcel Maréchal joue Sganarelle dans le Dom Juan de Molière mis en scène par Patrice Chéreau, puis il monte Le Sang de Jean Vauthier. Il commence alors à constituer son répertoire. FESTIVAL D’AVIGNON (1973-1974) : Dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes, en 1973 avec Cavalier seul d’Audiberti et en 1974, avec Holderlin de Peter Weiss, La Poupée de Jacques Audiberti et Fracasse. COMÉDIE FRANÇAISE (1975) : En 1975, sous la direction de Pierre Dux, Marcel Maréchal met en scène La Célestine avec Denis Gence dans le rôle-titre. MARSEILLE (1975-1994) : En 1975, Marcel Maréchal et sa compagnie quittent Lyon pour Marseille. Ils s’installent au Théâtre du Gymnase en attendant que s’ouvre, en 1981, sur le Vieux-Port, dans l’ancienne Criée aux poissons, le nouveau grand théâtre dont ils ont rêvé. La compagnie porte désormais le nom de son créateur et acquiert le statut de Théâtre National de Région. À Marseille, il y aura Molière, Brecht (La Vie de Galilée), Beaumarchais, Tchekhov, ainsi que les grandes fresques populaires comme Les Trois mousquetaires, Fracasse ou le Graal-Théâtre. Mais il y aura surtout, et en nombre, ces auteurs d’aujourd’hui que Marcel Maréchal s’attache à faire connaître : Valère Novarina, Jean Genet, (Les Paravents) David Mamet, Sam Shepard, Nella Bielsky, John Berger, Jean-François Josselin, Marcel Jouhandeau, Pierre Laville et bien sûr Jean Vauthier. Avec Pierre Arditi, Don Juan de Molière et Puntila et son valet Matti de Brecht. PARIS (1995-2000) : En janvier 1995, Marcel Maréchal prend la direction du Théâtre du Rond-Point. Il transforme totalement la grande salle, multiplie les activités et présente en cinq saisons plus de 50 spectacles, pour la plupart des créations contemporaines. Il met lui-même en scène Paul Claudel, Jacques Prévert, David Mamet, François Billetdoux, Jean Vauthier, Jacques Audiberti et joue En attendant Godot de Samuel Beckett, Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg avec Pierre Arditi. Il offre une saison entière à Harold Pinter et fait rencontrer au public, avec France Culture, une trentaine de poètes d’aujourd’hui. LES TRÉTEAUX DE FRANCE (2001- 2010) : En janvier 2001, Marcel Maréchal succède à Jean Danet à la direction des Tréteaux de France, Centre Dramatique National. Il fonde une nouvelle troupe, monte et interprète successivement L’école des femmes de Molière, Ruy Blas de Victor Hugo, La Puce à l’oreille de Georges Feydeau, George Dandin de Molière, Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset, Oncle Vania d’Anton Tchekhov, Lettres d’une mère à son fils de Marcel Jouhandeau, La Maison du peuple de Louis Guilloux, Audiberti & fils, Le Bourgeois gentilhomme de Molière repris au Théâtre 14 à Paris en janvier 2012. Dans le cadre des Tréteaux de France, il a créé et dirigé le Festival Théâtral de Figeac de 2001 à 2010. OEUVRES : La Mise en théâtre (1974), Une anémone pour Guignol (1975), L’Arbre de mai (1984), Fracasse, Un colossal enfant, Rhum-Limonade, Cripure, d’après Louis Guilloux, opéra, musique de François Fayt (création prochaine) DISTINCTIONS : Prix de la Critique dramatique 1969 et 1983 ; par trois fois, Molière de la Décentralisation ; nomination au Molière du meilleur acteur pour le rôle de Puntila… TOURNÉES À L’ÉTRANGER : Russie (Moscou, Saint-Petersbourg), Ukraine, Pologne, Bulgarie, Roumanie, Allemagne de l’Ouest, Allemagne de l’Est, Amérique du sud (Brésil, Argentine, Urugay, Chili), USA, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Togo, Niger, Nigeria, Japon, Chine… Décès le 11 juin 2020 Biographie détaillée : http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html ------------------------------------------------------------ HOMMAGES DANS LA PRESSE ET SUR LES RESAUX SOCIAUX Dans la presse : Hommage de Fabienne Pascaud / Télérama : Mort de Marcel Maréchal, acteur tonitruant et directeur de théâtre contrarié Hommage d'Armelle Héliot / Le Figaro : Marcel Maréchal, poète des tréteaux Hommage de Brigitte Salino / Le Monde : Marcel Maréchal, comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, est mort Hommage sur le site France TV INFO https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/marcel-marechal-comedien-metteur-en-scene-et-fondateur-de-la-criee-a-marseille-est-mort_4005953.html Hommage de Jacques Nerson dans l'Obs : Jusqu’au revoir, Monsieur Marcel Maréchal Le comédien et metteur en scène Marcel Maréchal est mort, ce jeudi 11 juin, d’une fibrose pulmonaire. Il avait 83 ans. C’est l’une des figures majeures de la décentralisation culturelle d’après-guerre qui disparaît. Marcel Maréchal (1937-2020), ici en 2012 dans « Cher menteur », de Jean Cocteau, au Théâtre La Bruyère, dans une mise en scène de Régis Santon. (DELALANDE RAYMOND/SIPA / SIPA) Dans les années 1960-1970, le petit milieu du théâtre lyonnais avait deux pôles. D’un côté les fidèles de Roger (Planchon), de l’autre les partisans de Marcel (Maréchal). Le premier exerçait ses talents au Théâtre de la Cité de Villeurbanne qui allait reprendre le sigle TNP en 1972, le second, de six ans son cadet, dirigeait le Théâtre du Cothurne, puis à partir de 1968 le Théâtre du 8ème à Lyon. Rares étaient les acteurs à faire la navette entre les deux troupes. Au-delà d’une rivalité anecdotique de chefs de bandes, il y avait entre Planchon et Maréchal de profondes divergences. Divergences politiques : l’un et l’autre étaient de gauche, mais Planchon était marxiste, et Maréchal, chrétien de gauche. Divergences esthétiques surtout : Maréchal n’avait pas la rigueur de Planchon. Disons qu’il était plus dionysiaque qu’apollinien. Autrement dit, plus dans la lignée de Jean-Louis Barrault que dans celle de Jean Vilar. De fait ses spectacles n’atteignait jamais la perfection formelle de ceux de Planchon ou, moins encore, ceux de Chéreau ou Strehler. En revanche, grand découvreur de textes, il avait un goût très sûr pour les poètes baroques comme Jacques Audiberti (« le Cavalier seul », 1963, « la Poupée », 1968, « Opéra parlé », 1980) et Jean Vauthier (« Badadesques », 1965, et « Capitaine Bada », 1966, « le Sang », 1970, « Ton nom dans les nuées, Elisabeth », 1976, « les Prodiges », 1997), ou encore pour Louis Guilloux (avec « Cripure », 1967, adapté de son grand roman « le Sang noir », puis « la Maison du peuple », 2002). Un comédien chimiquement pur En réalité Maréchal était, comme Barrault, plus animateur que metteur en scène. Et comédien avant tout. Un comédien chimiquement pur. Nul n’a oublié ses envolées lyriques dans le rôle de Cripure. Courtaud, affligé d’un physique ingrat à la Charles Laughton, il était doté d’un charme irrésistible. Son sourire jovial, ses yeux plissés par la ruse, ce mélange unique de trivialité et de poésie, en faisaient un Falstaff natif. Ajoutez à cela son accent de gone de la Croix-Rousse, jamais tout à fait perdu, même quand il a quitté Lyon pour Marseille où il a fondé et dirigé La Criée (de 1981 à 1994), puis laissé Marseille pour Paris où il a repris le Rond-Point (1995-2000), et enfin pris la tête des Tréteaux de France (2001-2011) dont la mission itinérante s’accordait bien avec le talent baladeur de ce fils de chauffeur routier. J’ai dit qu’aucun de ses spectacles n’était parfait et ne m’en dédis pas. Mais il faut ajouter que ce saltimbanque avait un tel sens de la scène, un tel amour du public, qu’il n’ennuyait jamais. C’est grâce à vous, Marcel, et à Roger aussi, ne vous en déplaise, que m’est venue la passion du théâtre. Mes parents vous ont maudit mais moi, je vous rends grâce. Par Jacques Nerson Publié dans l’Obs le 12 juin 2020 -------------------------------------------------------------------------------- Hommage de Michaël Mélinard / L' Humanité : Marcel Maréchal, L'homme théâtre Metteur en scène et comédien, auteur et adaptateur, directeur, Marcel Maréchal est mort le 11 juin. Il a tout fait sur les planches au fil d’une carrière débutée à Lyon et poursuivi à Marseille, Paris et sur les routes de France. Il a beaucoup travaillé à la reconnaissance d’auteurs contemporains en revenant régulièrement aux classiques. Marcel Maréchal, metteur en scène, acteur, auteur, adaptateur et directeur de compagnie et de théâtre, est mort le 11 juin. « Si, pari stupide, je devais choisir entre toutes mes casquettes, c’est sûr que je choisirais d’être comédien. Parce que jouer est aussi aventureux que les exploits de Bombard ou de Thor Heyerdal » révélait-il dans « un colossal enfant », un livre d’entretiens. Avec lui, disparaît l’un des grands chantres de la décentralisation du théâtre opéré après guerre et un défenseur acharné du théâtre public. Pourtant, ses relations avec le ministère de tutelle n’ont pas toujours été au beau fixe. Né en 1937 à Lyon, il y fonde et dirige le théâtre du Cothurne en 1958. Il met en scène Beckett, Goldoni, Anouilh, Audiberti, Ionesco, Marlowe ou Louis Guilloux. Une ancienne halle aux poissons C’est là que débutent Pierre et Catherine Arditi, Marcel Bozonnet ou Maurice Benichou. En mai 1968, il inaugure le théâtre du Huitième, toujours dans la capitale des Gaules. Avec sa troupe de la compagnie du Cothurne, il revisite Shakespeare, Nazim Hikmet, Georg Buchner ou Kateb Yacine, continuant un travail axé sur les auteurs contemporains, sans délaisser le théâtre classique. L’aventure théâtrale se poursuit à Marseille, d’abord au théâtre du Gymnase à partir de 1975. Mais son grand œuvre reste la fondation du théâtre de la Criée, une ancienne halle aux poissons, située sur le vieux port. Inauguré en 1981, il offre à la cité phocéenne un espace à la hauteur de ses ambitions culturelles. Il y demeure près de 15 ans. Shakespeare, Molière, Beaumarchais, Dumas ou Théophile Gautier y côtoient Sam Shepard, David Mamet, Jean Genet ou Valère Novarina. Lieu itinérant En 1995, il est nommé à la tête du théâtre du Rond-Point à Paris. L’exercice n’est pas de tout repos entre les critiques pas toujours tendres avec lui et les cafouillages de Catherine Trautmann, la ministre de la culture, au moment de sa succession. Il a tout de même contribué à rénover ce lieu, situé à côté des Champs-Elysées et devenu aujourd’hui l’une des salles parisiennes les plus courues. En 2000, à l’issue de son mandat parisien, Maréchal espère faire son retour à Lyon au théâtre des Célestins. Il hérite finalement en 2001 du théâtre des Tréteaux, lieu itinérant comme un pied de nez à son histoire familiale. « L’aventure sous chapiteau me fait rêver depuis longtemps. J’ai deux souvenirs magiques de théâtre rattachés à cette forme de présentation, La Bonne Âme de Se-Tchouan, montée par Jean Dasté, et Richard III, avec Vittorio Gassmann, qui a mené une expérience de théâtre populaire en Italie. J’avais très envie de jouer sous chapiteau. Mon père, qui possédait une petite entreprise de camionnage, aurait bien ri de ma promotion » confie-t-il alors au Figaro alors que son aventure mobile commence. L’histoire se poursuit jusqu’au début des années 2010 où le Bourgeois gentilhomme conclut son parcours aux Tréteaux. S’il a beaucoup joué dans ses mises en scène, il a aussi été dirigé par d’autres : Chéreau dans Don Juam en 1969, Vitez à Avignon, dans la cour des comédiens de Lavaudant en 1996 ou encore dans une adaptation d’Israël Horovitz, Opus Cœur, mise en scène par Caroline Damay en 2015. Affaibli depuis quelques années, il s’est éteint à l’âge de 82 ans. ------------------------------------- Hommage de Stéphane Capron / Sceneweb Un grand nom de la décentralisation théâtrale française vient de mourir, le metteur en scène Marcel Maréchal. Il est décédé à l’âge de 83 ans. Il a dirigé des théâtres prestigieux comme la Criée à Marseille ou les Tréteaux de France. Avec la disparition de Marcel Maréchal, c’est l’un des derniers pionniers de la décentralisation qui s’éteint. Il débute sa carrière à Lyon à la fin des années 50 et fonde le Théâtre du Cothurne qu’il dirige pendant 17 ans. C’est dans cette troupe que Pierre Arditi fait ses premiers pas d’acteur. Lorsqu’il inaugure en 1968, le Théâtre du 8ème toujours à Lyon, il ouvre la programmation à la musique. Il est le premier à accueillir en France Mick Jagger, les Who ou les Pink Floyd… On est alors très loin du théâtre de Jacques Audiberti dont il présente deux pièces dans la Cour d’honneur du Festival d’Avignon en 73 et 74. Dans les années 80, avec le développement de la décentralisation, Marcel Maréchal fonde La Criée, le Théâtre national de Marseille. Il y joue pendant 13 ans, les plus grandes pièces du répertoire. Puis on lui confie en 95 le théâtre du Rond-Point dont il fait moderniser la grande salle qui prend alors le nom de Renaud-Barrault.
En 2001, à 64 ans, il devient le directeur des Tréteaux de France, le seul centre dramatique de France itinérant. Marcel Maréchal peut ainsi continuer de sillonner pendant 10 ans la France en interprétant ses pièces fétiches de Molière, Dandin ou Le bourgeois gentilhomme.
Stéphane Capron ---------------------------------------- Sur les réseaux sociaux : Jack Lang, sur Facebook : Marcel Marechal, celui pour qui Molière et tant d’autres grands dramaturges n’avaient pas de secrets ne rugira plus sur les planches. Quelle tristesse pour le théâtre français. Tout au long de sa vie, il s’est engagé pour celui-ci. Grand militant de la décentralisation culturelle, de Lyon, à Marseille, à Paris, il aura tant oeuvré pour faire vivre les tréteaux de France ! Acteur, metteur en scène, écrivain, j’aimais sa poésie, immense et généreuse, et sa vigueur contagieuse. C’était un prince intrépide et expressif des mots. Comme le mistral qui souffle à Marseille, Il avait la voix forte, orageuse et la faconde si belle, si méditerranéenne. Combien de talents nous a fait découvrir Marcel Maréchal ? Des acteurs, comme Pierre Arditi ou Maurice Bénichou, mais aussi des auteurs, comme Jean Vauthier ou Louis Guilloux. Optimiste déterminé, il avait le goût de la vie et de la joie. Il aura été un artiste total, un homme-orchestre entièrement dédié aux arts et à la culture. Il me manquera beaucoup. Toutes mes pensées vont aujourd’hui à sa famille et à son fils Mathias. ------------------------------------------------------ Le metteur en scène Renaud-Marie Leblanc J'étais encore un jeune adolescent très mal dégrossi, gauche et inculte lorsque dans les années 80, je pénétrais pour la première fois une salle de théâtre. C'était Le Théâtre La Criée à Marseille, dans cette grande salle aux allures de paquebot. On y jouait Capitaine Bada de Jean Vauthier. Je ne connaissais rien du théâtre. Je n'y étais jamais allé. Sur scène, #marcelmaréchal, acteur, metteur en scène et directeur du théâtre. Je me souviens encore de lui comme si c'était hier, virevoltant, incandescent, libre! oui libre. c'est le souvenir que je veux emporter de Marcel, et qui a bouleversé ma vie ce jour-là. Plus tard, il m'aura croisé sur un travail d'atelier où je travaillais Capitaine Bada, justement. C'était très mauvais. il avait été d'une bienveillance extrême, de celle qui n'existe presque plus aujourd'hui. Plus tard, encore, je participerai à l’aventure. Cripure, Tartuffe, Le Malade Imaginaire, La Paix, Les Paravents, Falstafe. Tout cela de mes 21 à mes 25 ans. Marcel enthousiaste, Marcel qui m'appelait Monsieur l'évêque à cause de ce Marie dans mon prénom, Marcel qui me dit un jour à une lecture de note " c'est très bien, je n'ai rien à te dire", Marcel colérique et il fallait déguerpir vite, Marcel te faisant une blague juste avant que tu rentres sur le plateau avec lui, Marcel n'arrivant pas à retenir son texte du monologue du Malade Imaginaire, Marcel farceur, Marcel joyeux, Marcel en apesanteur, un soir, sur scène, réinventant tout... Marcel, chef de troupe : toutes ces rencontres, tous ces gens, toutes ces humanités partagées, ces fêtes aussi, chez lui, dans sa famille; Marcel et sa famille si accueillante, si fragile aussi. Cet homme aura bouleversé ma vie, il m'aura fait aimé le théâtre comme personne. je me souviens aussi de la fascination qu'il avait pour les auteurs, pour la langue. Je crois qu'il restait toujours impressionné par les mots, par la poésie, comme un enfant qui découvre les pouvoirs du langage. Audiberti, Vauthier, Novarina ( oui , on oublie qu'il a été l'un des premiers à faire découvrir l'écriture de Novarina). Plus tard, comme metteur en scène, j'ai monté le Malade Imaginaire de Molière. je me suis souvenu de ce qu'il disait : c'est la pièce la plus Shakespearienne de Molière. Quelque part, Molière , c'était lui, dans ses excès, sa générosité, son élan solaire. Un soleil, oui c'est ça. Marcel, c'était un soleil qui aimait les gens. Simplement. Marcel était autodidacte, il ne faisait rien comme personne. C'était sa force. La liberté. Je t'ai aimé Marcel, comme un autre père, même si tu ne l'as jamais su. et je crois que mon père, le vrai, t'as aimé aussi de m'aimer quelque part un peu. Aujourd'hui Marcel Maréchal s'en est allé. Pas pour moi. Pas pour nous, tous ceux qui ont vibré un jour dans une de tes aventures théâtrales. Tu resteras une étoile incandescente dans la constellation du théâtre. J'ai une pensée émue et profonde pour ses proches et ses enfants, Mathias Maréchal et Laurence. Au revoir Marcel Renaud-Marie Leblanc ----------------------------------------------------------- Marcel Maréchal est mort. S’il y a une origine, c’est celle-ci : 1983 ? 1984 ? Un soir, mes parents nous emmènent, mon frère et moi, voir une représentation des « Trois Mousquetaires » à la Maison des Arts de Créteil. Je crois que c’est le premier spectacle que je vais voir, qui n’est pas spécifiquement destiné aux enfants. Ce que je vois me bouleverse ; tout est merveilleux et magique. Ça y est, je veux être acteur, ou mousquetaire, je veux être là, sur scène, avec eux, courir, combattre, aimer, sous le faux soleil du théâtre, ovationné par huit cents personnes. Cette soirée va, littéralement, changer ma vie. Mes parents vont m’inscrire à l’atelier théâtral d’Ivry ; moi, petit garçon introverti, enfermé en lui-même, je vais découvrir que je peux parler. Surmonter ma peur, la transformer - aller sur scène et parler ! Être regardé, écouté. Jouer avec les autres. Dire les mots des autres. Être plus heureux, plus fort, sur scène - avec eux. Merci maman, merci papa. Et merci, Monsieur Maréchal. Adrien Michaux --------------------------------------------------- Page des Tréteaux de France Si cher Marcel... De grand et de tout coeur avec nos si grands si beaux moments de notre jeunesse... dix-huit ans de partage, côte à côte... le meilleur du théâtre. Mes plus chaleureuses pensées à Luce, Mathias, Laurence. Pierre LavilleNous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de Marcel Maréchal ce 12 juin 2020.
Il aura été un grand comédien, auteur, metteur en scène passionné et un découvreur de talents. Depuis sa compagnie du Cothurne créée à Lyon en 1958, jusqu’aux Tréteaux de France qu'il dirigea de 2001 à 2011, en passant par le Théâtre de la Criée à Marseille et le Théâtre du Rond-Point à Paris, il laissera le souvenir de nombreuses mises en scène foisonnantes et débridées. On se souviendra de ses adaptations des Trois Mousquetaires et de Capitaine Fracasse, de son grand amour pour Alexandre Dumas et Théophile Gautier mais aussi de sa passion pour Audiberti, Louis Guilloux, Kateb Yacine… Toute l'équipe des Tréteaux de France - Centre dramatique national adresse à sa famille et à ses proches leurs pensées de soutien et de réconfort les plus affectueuses. Robin Renucci Comédien, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France CDN ----------------------------------------------------- Merci Marcel ! Marcel Maréchal a quitté la scène du monde.
Avec lui, part un pan de l'histoire d'un théâtre de création populaire de haute tenue.
Avec lui, part un pan de l'histoire de Marseille, de ce Théâtre du Gymnase à cette Criée qu'il a rêvée, inaugurée et dont il a encré définitivement la nature profonde sur les quais du port...
Il y a impulsé et créé, joué et dirigé avec une énergie belle et des envols de poésie touchant, les publics les plus variés si bien qu'il a « fabriqué » durablement le public marseillais.
Incroyable « bête de scène », son sens du plateau l'amenait immanquablement à faire mouche à chaque mot ou regard…
En tant que « patron » et meneur d'équipes, s'il pouvait paraître parfois ailleurs – main sur les babines, brouillant ses traits, regard perdu, cheveux en bataille, au fond, il était là, aux côtés de chacun dans sa singularité et sa capacité à se mettre au service du projet artistique qu'il portait... et partageait d'abord avec ses équipes, ensuite avec le public. Au-delà de son côté un peu ours timide, homme du monde, il savait s'ouvrir et accueillir l'Autre.
C'est comme çà que je l'ai connu alors que, jeune étudiante en Arts plastiques, j'avais demandé à son décorateur de l'époque, Alain Batifoulier, quel chemin prendre, quelle formation effectuer, pour devenir décoratrice de théâtre comme on disait à l'époque... Deux semaines plutard, j'étais assistante de décoration pour les trois créations du Graal théâtre. C'est là qu'entre Marcel, Alain, Bernard Ballet et Gaston Serre, j'ai appris un métier d'humanité, de solidarités et de créativité. Homme de fidélités, il m'a intégrée pour cinq années décisives pour mon parcours personnel à ses équipes dans lesquelles j'alternais entre l'assistanat de décoration et la réalisation des archives du TNM sous la direction du regretté Jean Rouvet, un être hors du commun s'il en fut. Homme de la main tendue, il a accueilli le Théâtre de la mer et les créations d'Akel Akian dans ses programmations, lui ouvrant large les portes de sa « Petite salle ». Nous sommes encore quelques uns à nous souvenir des youyous des mamans des Quartiers Nord à La Criée, que ce soit lors de la conférence de presse de « Baisers d'hirondelles » ou dans la salle au milieu des applaudissements en fin des représentations. Je me rappelle aussi... C'est la dernière fois que je l'ai vu... c'était à la Librairie des Arcenaulx, lors d'une de ses lectures... Il commence à lire, lève les yeux, son regard tombe sur moi... Il s'interrompt... et lance un vibrant hommage à Akel Akian... Sans aucun doute, ces deux anciens lyonnais, l'un des traboules, l'autre émigré des oueds et terres rouges du Maroc, se sont reconnus, rencontrés, à Lyon, à Marseille, sur les scènes et dans ces mondes de poésies où ils respiraient ensemble. Avec Marcel Maréchal une part du théâtre du XXéme siècle s'est refermée. Gageons que chaque parcelle de théâtralité qu'il a semée sur sa trajectoire inspirée germe et germera encore.
Avec lui, s'est écrite une part de mon histoire professionnelle, la plus fondatrice.
A toi, Marcel, reconnaissante !
Que les scènes de l'imaginaire te fassent une place de choix où continuer à jouer, à l'infini...
Frédérique Fuzibet, metteuse en scène, scénographe ------------------------------------------------------------ Mon Merlin l’enchanteur C’était en 1977, j’avais 11 ans. Avec ma classe de 6e, pour la première fois, j’allais au théâtre, voir Merlin l’enchanteur. Au Théâtre du Gymnase. On était tout en haut, dans la promenade, debout tout du long, émus ensemble, transportés.
Depuis ce jour l’amour du théâtre ne m’a pas quittée, ce bonheur quand les lumières s’éteignent et que les acteurs apparaissent, ce plaisir de leur présence véritable dans un espace qui, pourtant, n’est pas tout à fait réel…
Marcel Maréchal m’a conduite au théâtre. Avec la magie de Merlin, puis avec les Trois Mousquetaires, le capitaine Fracasse, cette culture populaire qu’il revisitait comme un enfant. Puis il m’a fait aimer Vauthier, Audiberti surtout, Louis Guilloux. Et il a aiguisé mon sens critique parce qu’il ne connaissait pas ses textes, bafouillait, ouvrait les bras et partait en funambule sur des sommets improvisés. Parce qu’il ne comprenait pas Genet, ne s’intéressait pas aux pièces de femmes, montait Beaumarchais comme un Labiche, Brecht, Shakespeare et Tchekhov comme un Beaumarchais… et Novarina comme il aurait dû monter Shakespeare !
Mais justement c’est à La Criée, dans ce théâtre qu’il avait fondé, que je suis venue au monde. A ce second monde que j’aime tant hanter aujourd’hui encore, même lorsque j’y suis déçue, parce qu’il suscite la parole, la relation, l’ouverture. Le débat, la critique, l’écriture. La vie, le plaisir, la pensée, la joie. Marcel Maréchal nous a quittés alors que nous sommes encore privés de spectacle. Que nos corps réclament de se retrouver, côte à côte, le regard tourné vers le même horizon, la même fable, la même illusion incarnée. Plus que jamais nous avons besoin de théâtre. Ancien, nouveau, exigeant, populaire, et toujours d’aujourd’hui. Agnès Freschel, journaliste, directrice du magazine Zibeline -------------------------------------------------------------- La chose que je voudrais ajouter concernant Marcel Maréchal, c'est qu'il était le plus fidèle à Jean Vilar au regard des nombreux metteurs en scène de sa génération qui lui avaient tourné le dos voire qui le dénigraient. Bruno Boussagol, metteur en scène -------------------------------------------------------------- Serge Pauthe, comédien MARCEL MARÉCHAL NOUS A QUITTÉS Sa vie s’est envolée cette nuit et tous les souvenirs qui me rattachent à lui à l'instant me reviennent. Afflux d'émotions reliées autant à la vie tout(e) court(e) qu’au théâtre partagé quelques années ensemble à Lyon, puis à Marseille. Ce fut mon patron pendant 8 ans. A Lyon, au Théâtre du Huitième. Puis à Marseille au Théâtre de la Criée. D’abord, j’étais l’un de ses spectateurs au petit théâtre de la rue des Marronniers à Lyon. J’ai vu son « Capitaine BADA » de Jean Vauthier. En compagnie de Luce Mélite, il interprétait ce personnage, déchiré par la souffrance d’un amour absolu. Porté par une voix intérieure semblable à un murmure, parfaitement timbrée et teintée d'un lyrisme qui sera toujours reconnaissable dans ses rôles futurs. Je ne le cache pas. J’étais un fana de ce nouveau comédien et je ne manquais aucune de ses créations. Particulièrement au Festival de Couzan, un petit village du Haut-Forez à quelques encâblures de Saint-Etienne. Là-haut, dans les ruines d’un château médiéval, il joua LA MOSCHETA de l’auteur Ruzante, ce noble Vénitien qui montrait comment vivent les pauvres à toutes les Seigneuries, Doges en tête, dans la Venise du XVème Siècle. Nous n’étions pas loin de 1968 et Maréchal, avec Bernard Ballet, Jean-Jacques Lagarde et Jacques Angéniol, décorateur et acteur, avaient assemblé, au milieu des murailles moyenâgeuses éparpillées sur le sol, tout un fatras de matériaux que les pauvres du monde entier récupèrent dans les poubelles pour se construire une maison, dans les bidonvilles des banlieues de Paris ou de Mexico. Le cri de Ruzzante se propageait ailleurs qu’à Venise et vous emplissait de fureur et d’émotion. Voilà l’artiste tout neuf dont je fis connaissance en ce temps-là. Il vint jouer en 1972 son « FRACASSE » à la Comédie de Saint-Etienne. Heureux de nous revoir, il me demanda si je voulais le rejoindre à Lyon au Théâtre du Huitième. J’acceptais à condition qu’il me permette de monter un spectacle poétique à partir de l’œuvre de Nâzim HIKMET, ce poète turc que je chérissais comme un frère. Promesse tenue. Geste fraternel d'un comédien hors-pair envers un poète universel. Cela restera gravé en moi et j'aurai toujours pour Marcel une reconnaissance éternelle. Marcel Maréchal, c'est un artiste né à Lyon, le soir de la Noël. Il s’appelait parfois Marcel-Noël Maréchal, c’est joli, non ? Il admirait Laurent Mourguet, le créateur du Guignol Lyonnais au temps de la Révolution. Son coté râleur et bon vivant l'inspirera au point qu’il écrivit une pièce pour raconter sa vie. Mais Marcel était fait de chair, d’os, de rires et de larmes. Il porta sur la scène les plus grands textes devant un public immense qui savait l'apprécier. Il était populaire au meilleur sens du terme. Il bannissait les méchantes critiques par un surcroît de travail. Toujours inspiré par la lecture permanente de ses poètes et auteurs favoris. Je cite au hasard Rimbaud, Audiberti, Molière, Guilloux et son Cripure.. Ah! Cripure! Surnom donné par les élèves du lycée de Saint-Brieuc au Professeur Merlin, objet de moqueries. Ce prof’ adorait enseigner Kant et sa « Critique de la Raison Pure » et les chenapans l’avait donc surnommé « Cripure »…Donc, Maréchal interpréta magistralement ce personnage. Y a t'il dans la vie d'un acteur une telle fusion avec un personnage né dans l’imagination d’un auteur ? Peut-être entre Knock et Jouvet? Ou Luchini avec…Luchini ? Au temps où Maréchal vivait à Lyon, la vie théâtrale ne manquait ni d’émulation, ni de confrontation. En 1968, le Ministère nomma Maréchal à la tête du Centre Dramatique de Lyon. Mais à Villeurbanne, Roger Planchon et son Théâtre de la Cité avait « pignon sur rue » depuis les années 50. Maréchal était son cadet et il lui fallait exister à coté de son génial voisin. On disait parfois que Brecht était à Villeurbanne et Aristophane dans le 8ème Arrondissement de Lyon. C’était parfois comme deux navires au large de Saint-Malo qui se tiraient la bourre pour arriver bon premier. Mais heureusement, l’ami Jean-Jacques Lerrant, fin critique au « Progrès de Lyon », les aimait bien tous les deux. Et le public ne désertait aucune des salles. Il ne choisissait pas selon l’humeur du moment. C’était encore le beau temps du Théâtre Populaire. Maréchal créait une pièce de Kateb et invitait Gatti. Planchon « Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale » de Brecht avec Jean Bouise dans le rôle titre… J’ai vécu toutes ces années au cœur de ce creuset théâtral et je le dois tout de même à Marcel qui donna tout son talent pour que vive une intense activité théâtrale. Qui donna lieu à l’éclosion de nouveaux artistes. Toutes mes pensées émues vont ce matin vers son fils Mathias, sa sœur et sa maman. Et à tous ses compagnons qui sont restés si proches de lui. Et à tous mes ami..e…s Lyonnais qui ont vécu ces années-là et que j’embrasse affectueusement. Serge PAUTHE ------------------------------------------ Marcel Maréchal, un grand homme de théâtre qui a fait vibrer plein de belles nuits du Théâtre de la Mer à Sète. Il a enchanté nos jeunes années d'élèves de ce métier. Je me souviens du "Fracasse", et de toutes ses géniales mises en scènes, comme "La moscheta" de Ruzzante, "Godot,"Les prodiges" de Vauthier"... où nous apprenions tant. Énergie, invention, audace, sens du plaisir. Un de nos maîtres. Moni Grégo, comédienne -------------------------- Documents audio et vidéo, liens : Archive INA-France Culture 5 entretiens radiophoniques de 28 minutes : https://entretiens.ina.fr/en-scenes/Marechal/marcel-marechal Archive Ina : La Puce à l’oreille par la Comédie-Française, 1985 : https://fresques.ina.fr/en-scenes/fiche-media/Scenes00377/la-puce-a-l-oreille-de-georges-feydeau-mise-en-scene-par-marcel-marechal.html Archive vidéo « Rêver peut-être de Jean-Claude Grumberg, avec Marcel Maréchal et Pierre Arditi : https://www.youtube.com/watch?v=iRVkieN8p9U Rencontre avec Marcel Maréchal, masterclass en février 2014 : https://www.youtube.com/watch?v=96zJdlVQ4N8 Présentation de « En attendant Godot » de Beckett, avec Pierre Arditi, Robert Hirsch, Jean-Michel Dupuis, Marcel maréchal, mise en scène Patrice Kerbrat au Théâtre du Rond-Point (1997) : https://www.ina.fr/video/I00013833 En 2009, dans l'émission de France 3 "Les Mots de minuit", il évoque Jacques Audiberti :
"Audiberti avait une sorte de fils spirituel : Marcel Maréchal, un saltimbanque coloré, joyeux et angoissé. Celui-ci a lui-même un fils, spirituel et biologique cette fois, un jeune homme gracieux. Tout cela, c’est la même famille poétique, venue de la Méditerranée. Audiberti et fils. Ils sont tous réunis sur la scène, corps et âme. Et dans une adaptation ingénieuse et une mise en scène délicate, signées François Bourgeat, ils chantent la chanson de la filiation, la chanson de l’humanité, de l’origine à l’éternité, la chanson du mystère de l’homme et de sa reproduction. Le père apprend la vraie vie à son fils qui rêve la vie.”
Philippe Tesson. Le Figaro, 15 octobre 2007. En lien une vidéo extraite des "Mots de minuit" en 2007, où Marcel Maréchal évoque son rapport à l'oeuvre et la personne d'Audiberti. http://www.memoiresdeguerre.com/2020/06/marcel-marechal.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 20, 2020 11:57 AM
|
Par Armelle Héliot dans Le Figaro - 19 mai 2020 Dès son adolescence, ce fils d'un violoniste et d'une pianiste, a aimé jouer. Malgré sa formidable carrière au cinéma, il n'a quasiment jamais quitté les planches
Un homme debout. Grand et droit. Avec un dos large. Des épaules à porter des tourments. Un front haut que dégagent les cheveux bruns et denses et que barrent deux sourcils noirs qui approfondissent le regard. Toujours été le même, Michel Piccoli qui s'est éteint à 94 ans. Les cheveux avaient grisonné, étaient devenus moussus sur les côtés. Mais il était tel qu'en 1945, lorsqu'il avait débuté. Un beau ténébreux tout enveloppé du charme de son ascendance italienne, mais surtout un très jeune homme de vingt ans, discret, timide, peu sûr de lui. Cependant porté par la certitude que le théâtre était sa patrie. Au collège d'Annel, à Compiègne, lors de la première apparition sur les planches du tout jeune adolescent de 10 ans – on est un enfant en 1935 - un adulte s'était écrié : « Mais il existe, ce petit ! » Jamais, pourtant, Michel Piccoli ne fit autre chose, au théâtre sa passion fondatrice, comme au cinéma, son allégresse enchantée, que de mettre à l'épreuve son talent, son métier, ses certitudes. Il avait une formule : « Que le jeu de l'acteur ne soit plus la peinture de nos hypocrisies, qu'il en soit le scalpel. » Elle était empruntée à l'un de ses maîtres. Il n'aurait pas imaginé ne pas aller vers ses aînés. Se plier à leurs disciplines. Au cours de Madame Bauer-Thérond qui se soucie d'articulation et de grands textes et que fréquentent Maria Casarès et Luis Mariano, histoire d'amender leurs accents, le jeune Piccoli rêve de Jacques Copeau, du Cartel. Jouvet, Baty, Pitoëff. Et Dullin, bien sûr, qu'il voit un jour sur un quai de métro, frêle et aigu. Une image qu'il gardera comme un talisman et dont il parlait souvent. En Georges Douking, comédien, metteur en scène, décorateur, homme de théâtre complet et personnalité hors normes, il va trouver l'idéal d'une relation de maître à élève et aller d'engagement en engagement dès 1945. Il travaille alors avec toute la jeune création de l'époque. Georges Vitaly, Michel de Ré, Jean-Pierre Grenier, Jacques Mauclair, Jean-Marie Serreau, Claude Régy, Jean-Louis Barrault, Raymond Gérôme, Jean Mercure, Jacques Deval. Évidemment, sa route croise celle de Jean Vilar. Des années plus tard, lorsqu'il évoquait cet épisode assez violent – mais oui, violent - on le sentait encore désarmer devant l'intransigeance du fondateur du Festival d'Avignon, malgré l'humour avec lequel il le racontait. C'est en 1957. Il a trente-deux ans. Un long parcours. Et au cinéma aussi. Le maître du TNP monte Phèdre : Maria Casarès, Alain Cuny dans Thésée. Vilar lui-même s'est réservé le rôle de Théramène et demande à Piccoli du jouer Hippolyte. Mais le metteur en scène ne semble pas passionné. Il réprime des bâillements sans ambiguïté…Quant au jeune Piccoli, il trouve son costume, une ample robe rouge, tout simplement ridicule. Casarès et Cuny : ce sont déjà des monstres sacrés, mais il espère, après la création à Strasbourg, rendre son rôle. Vilar refuse. Mais le jour de la générale, il le remplace. Il ne veut plus lui adresser la parole… Ils se retrouveront bien plus tard, au moment du Dossier Oppenheimer. Discuteront. Confronteront leurs points de vue. Mais pour un être aussi détaché, aussi généreux que Michel Piccoli, l'âpreté vilarienne était assez difficile à comprendre. Michel Piccoli est enfant de la balle. Les grands-parents, les grands oncles étaient qui officier, qui sénateur, qui gouverneur du Niger, qui industriel. La guerre de 14 a balayé les fortunes mais pas les sensibilités. Son père est violoniste. Un poème d'homme. Très petit, fragile d'apparence. Des années et des années plus tard, il fera des apparitions au cinéma, chez Jacques Tati et Marco Ferreri. Sa mère est pianiste et donne des leçons dans leur appartement du XIII ème arrondissement. Elle a souffert. Perdu un enfant, un petit garçon né avant Michel. Longtemps il n'en parla pas. Ce n'est que bien plus tard qu'il s'analysait parfois comme «un enfant de remplacement », lui à qui on avait donné comme prénom celui de cet aîné. Mais il fut Michel et non Jacques, et non Daniel. Et avec ce petit frère, ce petit blond diaphane, il dialoguait avec lui. Et cherchait dans la vraie vie, un frère, un autre frère. Sa voix douce, au timbre feutré, cette voix très tendre, presque féminine – il devance Depardieu - cette voix subtilement musicale –qui ne l'empêche pas de tonner, d'exploser : nul n'oublie les déjeuners des amis…- cette voix traduit l'essence même de ce grand caractère. Il n'a eu dans sa vie que des femmes belles et à la personnalité puissante, d'Éléonore Hirt (ils ont une fille, Anne-Cordelia), à Ludivine Clerc en passant par Juliette Gréco. Des amitiés fortes, des admirations. Romy Schneider, Bulle Ogier. Des années durant il a pris la route en compagnie de Dominique Blanc pour célébrer René Char. Souvent Paul Veyne se joignait à eux. Et Marie-Claude Char écoutait, inlassable, ce trio d'exception. Il serait prétentieux, tant il a tourné, joué, de prétendre ici résumer ce chemin formidable. Comédien, il était ultra-sensible, très imaginatif, très complexe. Il se réinventait sans cesse. Il a attendu d'avoir près de soixante-dix ans pour tourner ses premiers films. Il y a perdu beaucoup d'argent. Mais on les aime, ces films. Il avait été à l'école de Luis Bunuel avec qui il a beaucoup tourné. Ils étaient en dialogue ouvert, tous les deux. Michel Piccoli a également aimé travailler avec Manoël de Oliveira, et souvent on pense à l'enchanteur lusitanien lorsque l'on voit les films de Michel Piccoli : Train de nuit, Alors voilà, La Plage noire, C'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé. On pense au cinéma de l'Est, la Pologne de ses deux enfants les plus jeunes, et aussi à Raul Ruiz. Un grand homme et un homme simple. Un homme qui ne méprisait pas le monde, mais qui n'aurait jamais prétendu changer la face de la planète. Il était un esprit engagé. Il avait des convictions humaines, politiques. Mais il n'avait pas la manie de la pétition. On pense à lui qui n'a jamais fait défaut à un ami pour l'aider, coproduire des longs-métrages non assurés de sauter en haut du box-office. Il s'est ruiné, parfois. Avec Mastroiani. Il s'amusait, Piccoli, devant les journalistes : Marcello, une star, moi, un comédien. Mais il testait les teneurs de micros. Pour renflouer les caisses du producteur, il tournait des publicités. Les esprits forts ironisaient. Michel Piccoli les ignorait, ces juges, du haut de son mètre quatre-vingt-quatre. Il savoura ses heures de maturité. Avec Peter Brook qu'il avait retrouvé, en 81, pour une inoubliable Cerisaie ; avec Patrice Chéreau, avec qui il inaugura en 1983 le règne des Amandiers de Nanterre en jouant avec Philippe Léotard, Sidiki Bakaba, Myriam Boyer, Combat de Nègre et de chiens, avant, entre autres, Le Retour au désert ou l'entrée de Jacqueline Maillan dans le monde de Bernard-Marie Koltès. Auparavant, il avait été un merveilleux jongleur de sentiments dans La Fausse suivante de Marivaux. Il y côtoyait sa chère Jane Birkin, amie indéfectible, elle aussi. Avec Luc Bondy pour qui il joua Terre étrangère, d'Arthur Schnitzler et obtint le prix du syndicat de la critique comme meilleur acteur. Avec lui, il fut aussi le roi cruel et malheureux du Conte d'Hiver et l'impressionnant John Gabriel Borkman d'Ibsen. C'était en 1993. Le rideau se levait sur un homme immense, de dos, accroché à une échelle, devant une monumentale bibliothèque. Il était prêt pour un Robert Wilson épuré : La Maladie de la mort d'après Marguerite Duras, avec Lucinda Childs et pour s'aventurer, en toute confiance, comme un Petit poucet rêveur, en compagnie de Klaus Michael Grüber dans les mystères envoûtants de la magie et des Géants de la montagne de Luigi Pirandello. À Catane, où il avait joué alors qu'il recevait le prix Europa du Théâtre, il apparaissait entre les plis du rideau de velours si haut, si large, de l'opéra, visage illuminé, dominant son monde : une salle magnifique. À l'orée des années 2000, Bernard Murat l'avait conduit jusqu'à Sacha Guitry. Il s'amusait, il était heureux dans un monde un peu différent, et dans les répliques ciselées de La Jalousie. Son cher Peter Brook lui fit signe encore pour Ta main dans la mienne de Carol Rocamora, une manière de retrouver Tchekhov. Enfin deux personnages à sa mesure se présentèrent. Deux rôles-titres. Le Roi Lear qu'il interpréta sous la direction d'André Engel, aux Ateliers Berthier, en 2005 et 2006. Là encore, on le revoit de dos, immense, pris dans la tempête de la nature déchaînée et de la folie. Bouleversant. Et puis Minetti, à la Colline et en tournée. Encore la neige, encore la tempête, encore Lear. Mais version Thomas Bernhard. Une vie pour le théâtre. Une vie de théâtre. C'était le titre de la pièce de David Mamet traduite par Pierre Laville que Michel Piccoli mit en scène aux Mathurins en 1988. Après, il s'essaierait à la réalisation… On n'avait jamais oublié, et lui non plus, mais il s'en moquait ces dernières années, comment la critique arrogante l'avait accueilli, en 1971, lorsqu'il avait créé la pièce de Pierre Louki, Allo ! C'est toi Pierrot ? Un si méchant accueil qu'il s'arrêta dix ans durant. Un grand homme et un homme simple. Un homme qui ne méprisait pas le monde, mais qui n'aurait jamais prétendu changer la face de la planète. Il était un esprit engagé. Il avait des convictions humaines, politiques. Mais il n'avait pas la manie de la pétition. Il ne s'engagea qu'avec sincérité et puissance. Loyauté. Il était demeuré réservé comme lorsqu'il était jeune. Il ne jugeait pas les personnes sur leurs préférences. Il les écoutait. C'était l'un des hommes les moins sectaires qui soient. Avec Ludivine Clerc, il pénétra dans le monde des chevaux lui qui avait été l'inoubliable Dom Juan à cheval de Marcel Bluwal, ce film du Dom Juan de Molière, avec Claude Brasseur en Sganarelle. Il aimait les chevaux. Il aimait la discipline des cavaliers. Un jour, il prit un coup de tête et une méchante fracture du crâne s'en suivit. Un vrai grave accident. Il en parlait plus tard avec son cher Bartabas. Il n'aurait jamais raté un spectacle. Il admirait. Il riait. Il avait un grand rire d'enfant et d'ogre. Il avait de l'appétit pour la vie. Un homme grand. Armelle Héliot / Le Figaro À lire : « Dialogues égoïstes » de Michel Piccoli, Grand Document, Marabout.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 15, 2020 12:14 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog, le 12 mars 2020 Fondateur de théâtres, metteur en scène, chef de troupe, directeur d’institutions, lettré, comédien aimé des cinéastes, il s’est éteint prématurément, vaincu par la maladie, mercredi 11 mars.
Le hasard a voulu que l’on apprenne la mort de Didier Bezace alors que l’on attendait un bus pour se rendre à Sartrouville et découvrir la version de Penthésilée de Kleist proposée par Sylvain Maurice, avec Agnès Sourdillon, entourée de musiciens et chanteuses.
Agnès Sourdillon, l’Agnès de L’Ecole des femmes de Molière, avec Pierre Arditi dans le rôle d’Arnolphe. Première dans la cour d’Honneur du palais des Papes d’Avignon. L’orage le plus violent qu’il nous ait été donné de voir en des dizaines d’années. Un orage éclatant quelques minutes avant 22h00, alors que les comédiens étaient évidemment déjà dans leurs costumes, prêt à entrer en scène. Un orage fantastique qui donna l’impression à ceux qui avaient pu se glisser dans le bâtiment, pour réconforter les artistes et techniciens, que la cour était sous l’eau, littéralement sous l’eau… C’était en juillet 2001.
Ce n’était pas la première fois que Didier Bezace était à l’honneur à Avignon. Dès les années 80, avec l’ami Nichet, il avait présenté un Feydeau déménage concocté loin de la Cartoucherie, qui était alors sa base. C’est là, en effet, qu’avec Jean-Louis Benoit et Jacques Nichet, Didier Bezace avait fondé –et construit ! – le Théâtre de l’Aquarium. Pour revenir à Avignon, il y présenta de mémorables spectacles, élaborés à partir de textes non forcément théâtraux. Ainsi Le Piège de Bove, ainsi que Pereira prétend d’après Tabucchi, deux mises en scène de 1996, avant la formidable découverte du Colonel Oiseau de Hristo Boytchev, en 99 avec ses comédiens et avec Jacques Bonnaffé. Avignon revient d’abord, à causes de minces circonstances. Mais une pluie d’images et de souvenirs nous assaille dès lors que l’on est devant ce fait si triste : la mort d’un grand homme de théâtre, un défenseur du service public et aussi un comédien adoré des cinéastes et d’un large public. On ne peut revenir sur chacun des spectacles mis en scène et/ou joués par l’artiste intransigeant que fut, sans trêve, Didier Bezace. Un caractère très intransigeant, mais sans raideur aucune, ni posture, ni calcul. Un grand esprit, une âme forte, un homme courageux dans ses choix comme face à la maladie, puisqu’il aura repris il y a quelques mois à peine, avec son amie Ariane Ascaride, ce qui aura été son ultime spectacle, créé en 2019 au Lucernaire : Il y aura la jeunesse d’aimer, d’après Louis Aragon et Elsa Triolet. Un message, sans doute, d’un être pudique, ferme dans ses actions, profondément politique dans sa manière de penser le théâtre service public et d’offrir des choix de haute qualité au public du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers qu’il dirigea de 1997 à 2013. Jack Ralite avait pensé à lui. Jacques Nichet était à Toulouse. Benoit resta seul un moment dans leur berceau de l’Aquarium. Didier Bezace ne se contenta pas de proposer un programme brillant et fédérateur. Il réussit à renouer avec le public qu’il fit revenir dans une institution un peu désertée, un public large et ouvert. C’est cela, l’œuvre de Didier Bezace, par-delà les dizaines et les dizaines de mises en scène, les bonheurs partagés dans les salles, l’art qu’il avait de réunir des interprètes fins et originaux, l’art de la troupe, car, depuis ses tout débuts, Didier Bezace n’aura jamais exercé son métier de vivre comme un exercice solitaire, mais comme un travail à partager. Et ce dès 1976, lors de la création collective à succès de La jeune lune tient la vieille lune toute la nuit dans ses bras. S’il était né et avait grandi à Paris, c’est à Nancy qu’il s’était glissé dans son premier centre de formation, avant, 68 aidant, de plonger dans le grand bain de l’Université du Théâtre des Nations que dirigeait alors André-Louis Perinetti. Il connaissait ses aînés, les écoutait, de Bernard Dort à Gilles Sandier, ne lâchait jamais les fils de la transmission et engageait de grandes figures, d’Isabelle Sadoyan pour le merveilleux Conversations avec ma mère d’après le film de l’Argentin Santiago Carlos Oves, en 2007 et repris en 2011 ou Emmanuelle Riva pour Duras, en 2014, à l’Atelier. Que choisir ? Que retenir ? Il n’a jamais cessé de travailler et de beaucoup travailler. Défendant l’institution, jouant au théâtre mais aussi beaucoup au cinéma et à la télévision. Les réalisateurs et réalisatrices aimaient sa personnalité forte. Un charme, une voix très harmonieuse, un regard, une autorité. Claude Miller, Bertrand Tavernier, André Téchiné, Marcel Bluwal, Jeanne Labrune, Caroline Huppert, Thierry Binisti, Jean-Daniel Verhaeghe, Claude Zidi ou le plus rare Jean-Pierre Darroussin, pour n’en citer que quelques-uns se sont appuyés sur son jeu sûr. Il agissait. Il pensait aux autres. Il ne se mettait pas en avant. Il y avait les textes, que lecteur impénitent il rêvait de porter au théâtre, de partager. Il y avait sa troupe, tous ces comédiennes et comédiens qui s’accordaient à l’esprit particulier de leur camarade. Et puis ces pépites, Marguerite et le Président dès 92 ou encore La Femme changée en renard en 94, Chère Elena, La Version de Browning, les pièces de Daniel Keene ou encore, à la fin, le joyeux et noir Feydeau de Grignan, il y a à peine cinq ans, sous le titre Le Diable s’en mêle. Vers la fin des années Aubervilliers, il s’était à nouveau inspiré d’un film, qui se passait en Roumanie, Au Diable Staline ! Vive les mariés d’Horatiu Malaele pour mettre en œuvre Que la noce commence ! Il le disait alors : « Au coeur de la comédie politique se cache en outre un sens profond qui m’incite à faire de ce projet le signe de ma démarche artistique depuis le Théâtre de l’Aquarium jusqu’à celui de La Commune d’Aubervilliers. Que la noce commence est aussi un hommage au théâtre. Comme ces acteurs italiens dont on dit qu’ils ont inventé mime et pantomime pour contourner les contraintes d’une censure de plus en plus rigoureuse et continuer à parler quand même sur le tréteau des places publiques, les villageois roumains, réduits au silence par l’oppresseur, réinventent un vocabulaire gestuel pour parler leur noce ; résistants et poètes, ils sont le théâtre populaire, tour à tour tonitruant, farceur, silencieux et inventif : vainqueur par imagination, vaincu par la bêtise. Comédiens et gens du peuple sont ces gens de peu, infiniment petits et fragiles, infiniment grands et forts, de cette force inattendue toujours réinventée et imprévisible que craignent tant les puissants parce qu’elle est le germe de la révolte. » Un grand aveu, simple et noble, fraternel, en quelques lignes. Au sortir du Théâtre de la Commune, il avait fondé une nouvelle compagnie, au très beau nom, L’Entêtement amoureux. Dans un livre publié aux Solitaires Intempestifs, il parle, humblement et clairement du grand travail de sa vie : D’une Noce à l’autre, un metteur en scène en banlieue. Crédit photo : France Inter/DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 28, 2020 6:37 PM
|
par ARMELLE HÉLIOT dans son blog le 28 février 2020
Dans « Toute nue », elle marie Feydeau et Norén. Rien d’incongru, mais un grand morceau de théâtre interprété à la perfection par un groupe de comédiens audacieux.
Il y a des soirs où, en quelques minutes, une toute petite poignée de minutes, on est submergé par le sentiment d’une évidence : on est devant du grand théâtre, un travail intelligent, jubilatoire, à la fois très pensé et très libre.
C’est le cas avec Toute nue, spectacle sous-titré « Variation Feydeau Norén ». Pourtant, autant le dire, on était un peu circonspect devant cet intitulé ! Marier Feydeau et Norén, quelle drôle d’idée ! Or, c’était méconnaître la femme qui a rêvé ce projet huit années durant avant de parvenir à ses fins ! Emilie Anna Maillet a conçu Toute nue, signant dramaturgie et mise en scène. Entourée d’une équipe excellente, elle a réuni les interprètes adéquats. Il y a vingt ans, elle a fondé une compagnie de théâtre, « Ex voto à la lune ».
Elle est une artiste qui pousse les murs : sa formation plurielle l’a conduite à mêler les disciplines sur le plateau. Musicienne, chanteuse, comédienne, danseuse, elle a compris ce que la magie nouvelle comme les technologies numériques sophistiquées pouvaient apporter à la représentation, tout comme les subtilités de la spatialisation du son et un usage pertinent de la vidéo.
Comédienne, Emilie Anna Maillet a travaillé avec de grands metteurs en scène, des regrettés Pierre Debauche et Piotr Fomenko, à Alain Françon, en passant par André Engel, Jean-Pierre Vincent, Krystian Lupa ou Julie Brochen. Un sacré beau parcours.
Elle a signé bon nombre de mises en scène après son passage par l’unité nomade du conservatoire. Shakespeare comme Durif, Brecht comme Marivaux, Strindberg comme Jean-Claude Carrière, elle s’est colleté à des univers très différents, jusqu’à Jon Fosse dont elle a monté Hiver en 2012 à la Ferme du Buisson et qui nourrissait le spectacle présenté au Paris-Villette il y a cinq ans, Kant.
Ce qui est formidable dans Toute nue c’est que tout est juste, même les décisions qui peuvent apparaître incongrues, comme la présence, au milieu du salon des Ventroux, d’une batterie ! Derrière, un as, François Merville, qui, en plus, joue le rôle de Victor, le valet. Et bien cette idée est très pertinente, efficace, et ajoute mine de rien à tout ce qu’il y a de trépidations dans les deux écritures.
Dans un espace simple apparemment, mais très travaillé, imaginé par Benjamin Gabrié, un appartement, trois parois principales, se déploie la comédie féroce. A gauche pour le spectateur (jardin), un écran par quoi tout commence. A droite (cour), derrière une paroi de verre, la cuisine. Au fond, même système, c’est la salle de bains. Les passages sont continus et, surtout, Emilie Anna Maillet utilise à merveille tout le théâtre, ses escaliers, ses ouvertures, ses étages.
La vidéo n’est pas circonscrite au seul premier mur, celui par lequel on entre dans le jeu, avec une conversation entre Ventroux (Sébastien Lalanne) et un homme très pressé, en voiture ou à table, très occupé, style homme politique entre deux rendez-vous, qui lui assène des instructions que l’on n’entend pas, mais auxquelles Ventroux répond, très nerveux déjà, car il attend quelqu’un… La vidéo inonde parfois les autres murs, et c’est toujours à bon escient. Elle est signée Maxime Lethelier et Jean-François Domingues
Les costumes sont malins, notamment les vestes étriquées de Ventroux ! Clarisse, (Marion Suzanne), son épouse, abandonne rapidement sa jolie robe rouge. Il fait chaud, si chaud. On est dans Feydeau et plus précisément dans Mais n’te promène donc pas toute nue ! On en retrouve tous les personnages : Ventroux, récent député qui pense qu’il va devenir ministre de la Marine, celui qui a pourri sa campagne des législatives mais qui a besoin de lui, Hochepaix (Denis Lejeune), enfin Romain de Jaival (Matthieu Perotto), journaliste au Figaro. Et bien sûr Victor, dont nous avons parlé, le grand musicien François Merville.
Ici, puisque l’on est en 2020, il y a un peu plus : le journaliste travaille en vidéo et il est accompagné. Il y a ceux que Ventroux consulte et que jouent David Migeot et Fabrice Pierre. Et puis, à la fin, puisque ses fenêtres donnent sur l’appartement, voici (après Deschanel, lui aussi évoqué) … Clémenceau…joué par François Kergourlay ! Feydeau puise dans les affres de son couple, son inspiration noire et fustige au passage les mœurs politiques de la IIIème République…
Ce qui est fou, c’est que l’on a l’impression d’une charge écrite pour notre monde…et cela va plus loin, on a ce temps-ci un effet d’actualité incroyable !
Mais rien n’est surligné. C’est simplement interprété à la perfection par les comédiens. Très bien dirigés, sur des rythmes très étudiés, de Feydeau aux « pastilles » égrenées de Lars Noren et puisées dans plusieurs de ses pièces : les couples qui se déchirent, ne se parlent pas, ne se comprennent pas, il en a semés partout. On va donc du côté de La Veillée, Détails, Démons et Munich-Athènes. C’est bien plus âpre que Feydeau. On ne rigole plus. Feydeau, il est féroce, mais joyeux quand il donne des ailes à Clarisse ou qu’il lui offre une piqure de guêpe piochée, paraît-il, dans sa vraie vie… Elle a de l’insolence et de l’espièglerie, Clarisse. Nulle haine, au contraire des personnages torturés de Norén.
Ne racontons pas tout ! Ils sont magnifiques, précis comme des horloges suisses. Ventroux est au bord de la crise de nerf. Sébastien Lalanne est ici un virtuose de la folie mondaine : le pouvoir, le pouvoir, voilà ce qui le passionne…Prêt à tout, même à faire alliance avec celui qui l’a traîné dans la boue…Et l’autre, Hochepaix, Denis Lejeune, idéal, se présente sans aucun complexe…Ces adhérences, ces ententes lamentables, Georges Feydeau les dénonce, mais de fait, elles sont contemporaines…et l’on croit reconnaître les vedettes du monde politico-médiatique de février 2020….
Leur engagement est autant physique qu’intellectuel. Ils jouent toutes les notes. Ils suivent au soupir près toutes les indications. Entré plus tôt dans le jeu que chez Feydeau –si l’on se souvient bien- le journaliste dont Ventroux ne parvient pas à retenir le nom, est formidablement bien incarné par Matthieu Perotto (en alternance avec Simon Terrenoire). Les répliques de Georges Feydeau sont d’une fraîcheur incroyable…C’est ce qui nous fait rire : double détente magistralement tenue par Emilie Anna Maillet.
Louons maintenant une très grande femme. Marion Suzanne, que l’on a souvent applaudie au théâtre, et notamment dans les spectacles de Nicolas Liautard, mais pas seulement. Une brune, une belle brune à l’autorité indéniable, avec une voix qui nous a toujours évoqué les manières à la fois graves et évaporées d’une Catherine Samie, une belle brune qui ne craint pas la nudité complète et la violence des scènes, qu’elles tiennent aux mots ou aux gestes. Elle est remarquable. Une Clarisse ligotée par les hommes, mais une Clarisse qui brise, en riant, en se moquant, en feignant l’inconséquence, les règles de fer des hommes. Un modèle, Clarisse telle que l’incarne, fière, rebelle, insolente, et redisons le, espiègle, Marion Suzanne.
Théâtre Paris-Villette, du mardi au jeudi à 20h00, vendredi 19h00, samedi 20h00, dimanche 15h30. Durée : 1h15. Tél : 0140 03 72 23. Jusqu’au 21 mars.
www.theatre-paris-villette.fr
A signaler deux rencontres, l’une le dimanche 1er mars à l’issue de la représentation, avec Anne-Laure Benharrosh, professeure de littérature. Et le mercredi 4 mars, avec Camille Froidevaux-Metterie, professeure de science politique.
Légende photo : Les hommes ont l’air bien sages, eux, non ? Photographie Maxime Lethelier.DR

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 16, 2019 4:25 PM
|
Par ARMELLE HÉLIOT dans son blog le 6/12/2019
Au Théâtre de la Reine Blanche, il raconte la triste histoire d’un homme qui aimait les arbres. A ses côtés, le violon d’Alexandrine Brisson et les leçons un peu rigides de Christophe Dejours.
Jean-Pierre Bodin est un poète avant d’être un homme de théâtre. Il vient de la grande galaxie de Jean-Louis Hourdin -qui a d’ailleurs participé à ce travail, du temps, où, avec le regretté Robert Gironès, le chef de troupe officiait en Poitou-Charentes.
C’était il y a trente-cinq ans…Jean-Pierre Bodin entre dans ce groupe, actif, aimant la belle littérature et se souciant de politique. Régisseur, comédien, dix années durant, il se fond dans la troupe.
Et puis, en 1994, il crée, avec le grand François Chattot, un spectacle extraordinaire et inoubliable, aussi insolite que son titre, Le Banquet de la Sainte-Cécile…
Depuis, Jean-Pierre Bodin n’a jamais cessé de nous proposer des rendez-vous insolites. Des spectacles marquants. Du vrai théâtre, mais avec toujours un fond de réflexion sur la société. Mais des spectacles où le jeu, la joie, le partage l’emportaient toujours.
C’est le cas avec Chemise propre et souliers vernis, il y a dix ans, c’est le cas avec Les Gravats, spectacle épatant et profond vu à Avignon, il y a deux étés.
C’est un peu moins le cas avec L’Entrée en résistance. D’ailleurs, ce n’est pas un titre pour lui, d’autant plus que ses amis artistes ont toujours été, comme lui, sur la brèche.
Il y a pourtant beaucoup de sa propre poésie, de sa présence généreuse dans ce moment qui tient plus du récit et de la conférence que d’un spectacle de théâtre.
Sur le plateau de la Reine Blanche, deux écrans, l’un très grand, l’autre moins large, que le comédien va manipuler, déplacer à plusieurs reprises. Des images vidéo, belles et touchantes, sont continûment projetées. La dominante est à la forêt et à la forêt sous la neige.
Il y a aussi trois étranges candélabres, imposants. Comme de pauvres troncs d’arbres prisonniers…transformés en luminaires…Franchement, on ne comprend pas ce que veulent nous dire ces objets….
Il y a peu de monde sur le plateau, mais beaucoup de personnes en amont et en coulisses. Images de Gyomh, travail d’Alexandrine Brisson, qui joue aussi son violon et un chef opérateur, Pierre Befve.
Lumières, régie, costumes, tout ici est pensé précisément.
Mais pour l’essentiel le spectacle est l’alternance du récit de Jean-Pierre Bodin qui raconte sa vie de forestier, et c’est aussi touchant que passionnant. En fait, il s’inspire d’un fait divers tragique, le suicide d’un homme de la forêt, écrasé par les exigences des ingénieurs…Une vraie histoire.
Médecin du travail, formé comme psychiatre, psychanalyste, spécialiste de la souffrance au travail, auteur de livres et d’articles, Christophe Dejours avait été appelé à analyser le cas de ce malheureux forestier.
Certainement un impeccable savant. Mais pas un homme susceptible de captiver. Jean-Pierre Bodin est trop timide avec lui. Il n’a rien osé dire.
Mais d’une part Dejours ne porte pas la voix et malgré le micro il demeure dans un ton de confidence qui ne convient absolument pas.
Articuler, se faire entendre, partager sans coquetterie, est un métier qui n’est pas le sien. On ne va pas au théâtre pour que l’on nous fasse la leçon. La souffrance au travail, on connaît et s’il faut faire passer les cas, les analyses, les réflexions par la scène, encore faut-il trouver le juste ton et un peu de distance spirituelle.
C’est dommage car l’on sait la sincérité de Jean-Pierre Bodin, on sait sa manière légère apparemment d’aborder le plus grave et de transmettre, par l’émotion et la délicatesse, les sentiments et les vérités.
La conférence du Docteur Dejours, aussi exacte soit-elle, est d’un profond ennui. Ce n’est pas la musique qui peut éclairer les humeurs de satisfaction que le scientifique distille.
Du théâtre, on voudrait du théâtre ! Pas que l’on s’adresse à nous comme si nous étions des abrutis, indifférents à la société actuelle. Si c’était le cas, on n’irait pas au théâtre. Et encore moins applaudir Jean-Pierre Bodin.
Théâtre de la Reine Blanche, du mercredi au samedi à 20h45, dimanche à 16h00. Durée : 1h40. Tél : 01 42 05 47 31. Jusqu’au 5 janvier.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 18, 2019 1:24 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 18 septembre 2019
La comédienne s’est confiée à la journaliste Anne Diatkine. Sous le titre paradoxal de J’ai oublié, elle se souvient de tout.
Bulle. On l’appelait ainsi avant même qu’elle ne vienne au jour ! Bulle ! Elle en a les irisations et l’aptitude à échapper, voler, s’envoler, flotter dans les airs.
Avec Anne Diatkine, journaliste que l’on lit depuis longtemps dans les colonnes de « Libération », une journaliste qui s’intéresse de près au théâtre et signe de sagaces et fins portraits, Bulle Ogier s’est donc prêtée au jeu du souvenir.
Qui la connaît un peu, qui a déjà eu l’occasion de parler avec elle, sait combien elle s’exprime magistralement, sans superbe aucune, avec un naturel merveilleux. Sa langue est fluide et vive et si elle a beaucoup rêvé dans la vie –parce que son métier de vivre est le jeu- elle est d’une lucidité saisissante. Elle ignore la méchanceté, le fiel.
Elle a l’air toute fragile, depuis toujours. Mais c’est une fille du feu. Naturellement exigeante et résistante.
Pourtant, elle donne le sentiment de savoir flotter…De ne pas donner prise, ainsi !
Pour qui rêve de cerner parfois plus précisément certains épisodes de sa vie et de son art, ce livre vient à point. Il reflète à merveille la densité humaine et la profondeur de pensée et de sentiment d’une femme qui est pudique, qui ne s’est jamais mise en avant. Une femme intelligente, venue d’une bourgeoisie cultivée où la musique avait une grande part.
Mais une femme à part, Bulle Ogier. Avec l’éternelle fine silhouette et la blondeur lumineuse d’une éternelle toute jeune fille. Jeune toujours et avec éclat et si dans le livre elle répète souvent « à mon âge », et si elle n’a plus vingt ans depuis longtemps, il y a en elle quelque chose de la force de la radieuse jeunesse.
Digne, aristocratique, elle ne s’appesantit pas sur les chagrins les plus terribles. Elle parle de la mort de sa fille Pascale, bien sûr. Mais elle célèbre la longue et magnétique beauté avec acuité. Sans pathos.
La souffrance, les chagrins, les peurs, les catastrophes intimes –jusqu’aux violences- elle les affronte. Bulle s’échappe, Bulle s’envole, Bulle sait flotter, mais elle est crâne.
Elle répète donc sans cesse « j’ai oublié », mais c’est pour mieux retenir les images, les visages, les faits. Elle a beaucoup d’esprit. Elle est drôle. Elle n’a pas l’esprit de sérieux. Elle aime.
On croise un monde fou dans ces deux cents pages. On recompose son chemin étonnant. Elle a rencontré jeune ses amis à la vie à la mort et l’homme qu’elle aime.
Elle a vécu d’extravagantes aventures et notamment le tournage de l’incroyable film de Barbet Schroeder La Vallée. Mais tant d’autres, moins héroïques mais tout aussi épiques. C’est incroyable : Bulle est d’abord une aventurière !
On ne répètera pas ici tous les noms, on ne reprendra pas ce qu’elle livre d’elle-même et de ses manières de vivre.
Il y a du sourire dans ces pages. Car Bulle a non seulement du caractère, de l’esprit. Mais elle est comme les enfants qui décryptent tout des grandes personnes.
N’en disons pas plus. La composition du livre vous étonnera peut-être. On dirait une suite de croquis, jetés sans que les liens, les liaisons soient lourdement établis. Mais elle a des cailloux plein les poches. Ils brillent. Ils racontent plus que de longs discours. C’est un peu un kaléidoscope.
« J’ai oublié », éditions du Seuil. Fictions & Cie. 19€.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...