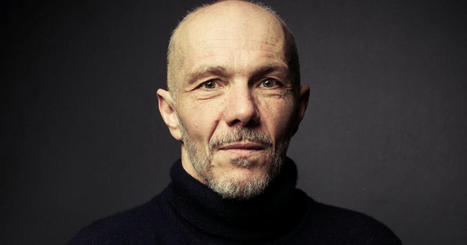Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 22, 2024 11:32 AM
|
par LIBERATION et AFP le 22 août 2024 L’actrice Charlotte Arnould avait porté plainte contre le comédien de 75 ans en 2018. Elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier à Paris. Le parquet de Paris a demandé un procès pour viol contre Gérard Depardieu, révèle une source proche du dossier ce jeudi 22 août. Le ministère public a requis le 14 août le renvoi devant la cour criminelle départementale de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, précise la même source, confirmant une information de BFMTV. Il revient désormais à la juge d’instruction chargée de ce dossier d’ordonner ou non un procès. Ces réquisitions «sont le résultat d’une longue instruction qui a permis de rassembler les éléments qui corroborent la parole de ma cliente», a réagi auprès de l’AFP Me Carine Durrieu-Diebolt, l’avocate de Charlotte Arnould. «Pour elle, c’est un immense pas en avant plein d’espoir dans l’attente de l’ordonnance du juge d’instruction qui clôturera l’instruction». En août 2018, la comédienne Charlotte Arnould – aujourd’hui âgée de 28 ans – avait porté plainte contre l’acteur de 75 ans, qu’elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier, situé dans le 6e arrondissement de la capitale. En juin 2019, le parquet de Paris avait classé sa plainte sans suite, au motif que les faits paraissaient insuffisamment caractérisés. Charlotte Arnould avait alors déposé, en mars 2020, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, laquelle entraînait la saisine d’un juge d’instruction. Fin juillet 2020, le parquet de Paris avait requis l’ouverture d’une information judiciaire après réexamen de la procédure et, en décembre 2020, l’acteur était mis en examen pour «viols» et «agressions sexuelles». Accusé par d’autres femmes de violences sexuelles, Gérard Depardieu conteste les accusations. «Jamais au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme», avait-il affirmé en octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould. L’acteur sera aussi jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage du film de Jean Becker, «Les volets verts», en 2021.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 10, 2024 5:19 PM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 5 juin 2024 Le maintien ou l’annulation des dates de spectacle du comédien, accusé de violences sexistes et sexuelles par six femmes, est guetté par le secteur culturel. Lequel continue ses réflexions sur les dilemmes et défis posés aux programmateurs à l’ère post-#MeToo. «A ce jour», souligne avec prudence le site du théâtre Anthéa, à Antibes, les dates du spectacle d’Edouard Baer sont bien maintenues les 14 et 15 juin. Comme elles l’ont été sans chahut aucun le week-end dernier à Roubaix. Et ce, même si d’autres structures culturelles, privées comme publiques, ont ces jours derniers pris la décision de déprogrammer l’artiste à la suite des accusations de violences sexuelles et sexistes pesant sur lui depuis le 23 mai. En effet, dans un article conjoint de Mediapart et du média féministe Cheek, six femmes pointaient des comportements du comédien qualifiables d’agressions sexuelles et de harcèlement, subis par elles entre 2013 et 2021. Des «gestes» et «propos» dans lesquels Edouard Baer ne se «reconnaît pas», a-t-il fait savoir à Mediapart, tout en présentant «toutes [ses] excuses» et exprimant ses «regrets que [son] comportement ait mis mal à l’aise ou blessé ces femmes». L’absence de dépôt de plainte et le mea culpa public n’y ont rien fait. Le théâtre Antoine, à Paris, où devait démarrer l’exploitation de son nouveau spectacle Ma Candidature le 4 juin, annonçait l’annulation des dates dans la foulée. Une structure privée implique un traditionnel exercice de promotion. La production JMD (pour Jean-Marc Dumontet) trouvait celui-ci trop délicat. Le festival les Nuits de Fourvière, à Lyon, en revanche, est une structure publique à forte visibilité, non soumise aux mêmes impératifs commerciaux, mais redevable à des collectivités publiques. Le 31 mai, la direction annonçait elle aussi la déprogrammation d’un autre spectacle d’Edouard Baer, le Journal de…, initialement programmé le 12 juin, en restant étrangement fuyante sur les motivations exactes de ce geste, en dépit de sa portée politique, se contentant pour l’heure de répéter que les «conditions» pour faire un «beau spectacle» n’étaient «pas réunies». La décision est «trop fraîche», ajoute-t-elle auprès de Libé. Nœuds de cerveau Dommage, car elle ne passe pas inaperçue dans un secteur qui cherche à tâtons, depuis les premiers dossiers #MeTooThéâtre, survenus en 2018, quel cap éthique tenir entre respect de la présomption d’innocence et soutien aux combats féministes. Au moment des affaires Jan Fabre (en 2018) ou Michel Didym (2021) – deux artistes accusés de violences sexuelles dont les œuvres ont été retirées de certaines affiches –, les débats entre programmateurs portaient sur leur degré de légalisme : attendre la décision de justice pour déprogrammer ou se retirer du jeu dès la mise en examen, voire dès lors qu’une plainte est enregistrée ? Le cas Edouard Baer sort aujourd’hui de ce cadre, puisque aucun dépôt de plainte n’a encore été enregistré. Preuve que «les mentalités bougent à grande vitesse», note cette directrice de théâtre, sous couvert d’anonymat, qui considère cependant le cas Edouard Baer comme un «cas limite». «Ça m’interroge sur la gradation des sanctions appliquées par la profession : Edouard Baer reçoit donc le même traitement que [le metteur en scène] Pierre Notte, accusé de viol sur mineur et mis en examen ?» D’autres ne s’embarrassent pas de tels nœuds de cerveau, à l’instar du directeur du Colisée de Roubaix, Bertrand Millet, où le spectacle d’Edouard Baer était maintenu le 2 juin. «Pourquoi [la date] aurait-elle été annulée ? interrogeait-il dans les colonnes du Parisien. Ce sont des personnes qui se sont plaintes anonymement par voie de presse, il n’y avait pas d’éléments suffisants pour annuler un contrat signé depuis des mois et empêtrer mon théâtre dans une situation juridique délicate.» Une trentaine de personnes sur 1 700 sièges avaient demandé à être remboursées, précisait-il encore, trouvant le chiffre «marginal». Charte éthique Au Syndicat national des scènes publiques, sa présidente, Véronique Lécullée, confirme que le sujet occupe de plus en plus les adhérents : «Notre position philosophique est claire : on ne refuse pas la complexité, mais on crédite la parole des femmes. Et on tente de distinguer deux idées : mettre en retrait ne revient pas à accuser.» Cependant, les cas restant pour l’heure limités, aucune table ronde, débat, charte n’est actuellement à l’étude sur ce sujet pourtant crépitant, indique le SNSP. Le secteur du spectacle vivant est plus occupé à sensibiliser sur l’ampleur des coupes budgétaires qui le frappe (une mobilisation nationale est prévue pour le 13 juin). Dans le secteur du cinéma, en revanche, certains professionnels se sont mis au travail lors d’une table ronde organisée à Cannes par l’Association française des cinémas d’art et d’essai (AFCAE) intitulée «Comment programmer à l’ère post-MeToo ?». Première du genre sur le sujet, elle réunissait le collectif 50 /50 (qui milite pour plus de parité dans le cinéma) et des exploitants de salle qui s’étaient parfois trouvés «bien seuls» face à des «injonctions contradictoires» lors des sorties de films impliquant des artistes accusés de violences sexuelles. Elle inaugurait un chantier de réflexion sur la nécessité d’établir ou non une charte éthique ou de s’en tenir à un accompagnement au cas par cas. «Ces sujets provoquent un bouillonnement d’interrogations sur la place du cinéma dans la société, notait Laurent Callonnec, directeur et programmateur de la salle de cinéma d’art et d’essai l’Ecran, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Paradoxalement, ces discussions avaient rarement lieu. Ça bouge.» Eve Beauvallet / Libération Légende photo : Edouard Baer à la Mostra de Venise, le 7 septembre 2023. (Gabriel Bouys/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 20, 2024 11:26 AM
|
Publié sur le site d'ARTCENA - 6 mai 2024
POLITIQUE CULTURELLE
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 2 mai 2024.
Auditionnée le 14 mars 2024 par l’Assemblée nationale, la comédienne Judith Godrèche – qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour viols sur mineure – avait conclu son propos liminaire en demandant aux députés de « prendre l’initiative d’une commission d’enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma, et en particulier ses risques pour les femmes et les enfants ». Le jour même, la députée écologiste de la 2e circonscription des Hauts-de-Seine, Francesca Pasquini, émettait une proposition de résolution allant dans ce sens. Justifiée, a-t-elle rappelé dans l’exposé des motifs, par la nécessité de « briser les mécanismes d’omerta autour de ces violences », cette commission d’enquête concernera les violences commises dans le secteur du cinéma, mais aussi ceux de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité. La députée a également précisé que ses travaux devront porter sur « toutes formes d’abus, qu’ils soient sexuels, physiques ou psychologiques », ce qui permet de définir le champ des atteintes aux mineurs. Soumise au vote le 2 mai 2024, la proposition de résolution a été adoptée à l’unanimité par les 52 députés présents. La commission d’enquête sera chargée : • d’évaluer la situation des mineurs évoluant au sein des secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité ;
• de faire un état des lieux des violences commises sur des majeurs dans ces secteurs ;
• d’identifier les mécanismes et les défaillances qui permettent ces éventuels abus et violences et d’établir les responsabilités de chaque acteur en la matière ;
• d’émettre des recommandations sur les réponses à apporter. Le texte complet du rapport déposé Francesca Pasquini tendant à la création d’une commission d’enquête relative à la situation des mineurs dans les industries du cinéma, du spectacle vivant et de la mode est disponible ici : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b2451_rapport-fond

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 16, 2024 12:32 PM
|
Par Lara Clerc dans Libération - 16 mai 2024 Mercredi 15 mai, lors de la montée des marches sur la Croisette à l’occasion de la projection de son court métrage «Moi aussi», Judith Godrèche et son équipe ont posé leurs mains devant leur bouche en soutien aux victimes de violences sexuelles contraintes au silence. Mercredi 15 mai, alors que Judith Godrèche, actrice et réalisatrice venue présenter son court métrage Moi aussi, foulait le tapis rouge des marches du Festival de Cannes, elle et son équipe, ainsi que Rokhaya Diallo, ont posé leurs mains devant leurs bouches, symbole du silence imposé aux victimes de violences sexuelles. Un geste lourd de sens, alors que l’actrice de 52 ans est devenue une figure de proue du mouvement #MeToo dans le cinéma français depuis sa plainte visant les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour «viol sur mineur de moins de 15 ans par personne ayant autorité», déposée en février. Judith Godrèche dit avoir reçu, depuis, plusieurs milliers de témoignages de victimes de violences sexuelles via une boîte mail créée à cet effet, auxquels elle dit avoir voulu faire honneur et «redonner un visage». Moi aussi, qui a été projeté pour la première fois le mercredi 15 mai lors de la cérémonie d’ouverture de la sélection un Certain regard, met en scène plusieurs centaines de victimes ainsi que Tess Barthélémy, la fille de Godrèche et de l’acteur Maurice Barthélémy, présente aux côtés de sa mère sur la Croisette. Après la première projection de son court métrage, une seconde projection publique a eu lieu au Cinéma de la plage. Après cette montée des marches remarquée, de nombreux internautes ont relayé l’image sur les réseaux sociaux et repris le geste symbole de Godrèche pour témoigner de leur solidarité et soutenir cette mise en lumière des victimes de violences sexuelles dans le cinéma. Parmi eux, l’actrice et réalisatrice Ariane Labed, l’Association des acteur·ices (ADA), la journaliste Camille Nevers ou encore le directeur de casting et créateur du #MeTooGarçons Stéphane Gaillard. Lara Clerc / Libération Légende photo Judith Godrèche et son équipe, ainsi que Rokhaya Diallo, à Cannes, le 15 mai. (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 1, 2024 5:10 PM
|
Par Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre dans Le Monde - magazine - publié le 1er mai 2024 PORTRAIT Après le témoignage de Judith Godrèche, l’actrice et réalisatrice dévoile à son tour ses blessures intimes et les mécanismes de la prédation dans un récit autobiographique, « Dire vrai », à paraître aujourd’hui. Lire l'article sur le site de M le magazine du Monde : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2024/05/01/isild-le-besco-rescapee-de-la-violence-prisonniere-de-mes-manques-materiels-et-affectifs-j-etais-le-terrain-parfait-pour-toutes-les-maltraitances_6230849_4500055.html
Tous les matins, quand le réveil déchire le brouillard de son sommeil agité, Isild Le Besco se demande pourquoi elle a décidé de publier un livre. Pourquoi elle s’apprête à déposer sur les tables des librairies du pays son intimité percutée par la violence. Pourquoi s’imposer tout ça, les médias, les inévitables réactions virulentes de ses proches, les controverses pénibles. Le fil de ses pensées l’emmène toujours au même endroit : elle n’a pas le choix, il y va de sa survie. « Chacune des femmes poussées dans l’horrible, qui a réussi à se récupérer, parce que certaines ne se récupèrent pas et en meurent, a le devoir de parler pour les autres. Moi, c’est grâce à mes enfants que je ne me suis pas suicidée. Je ne serai pas tranquille tant que je n’aurai pas restitué ce que j’ai réussi à surpasser », affirme-t-elle, dans une de ces envolées affûtées qu’elle formule parfois. Ce livre, Dire vrai, qui paraît aux éditions Denoël ce 1er mai, n’aurait peut-être jamais existé sans un voyage en train. Celui qui relie la Drôme, où vit, depuis le confinement, l’autrice et réalisatrice de 41 ans, et Paris, qu’elle rejoint pour ses obligations. A bord de ce TGV, en avril 2023, une passagère très agitée agresse les passagers. Isild Le Besco se lève et lui demande de partir. La femme, âgée d’une vingtaine d’années, l’insulte, lui assène des coups de poing, lui plante un doigt dans l’œil. Elle s’en sort avec une cornée abîmée, vingt-quatre jours d’incapacité temporaire de travail et le besoin de répéter en boucle au téléphone à sa petite sœur qu’elle n’est « pas une victime ». Son agression dans le train constitue la scène d’ouverture de son livre. Cet événement est aussi le début d’une prise de conscience : les violences qu’elle a subies ne sont pas des incidents isolés, mais des événements liés qui s’autoengendrent. « Prisonnière de mes manques matériels et affectifs, j’étais le terrain parfait pour toutes les maltraitances », écrit-elle. Isild Le Besco trace une continuité entre son enfance, ses débuts dans le cinéma français, la relation de sa sœur aînée, l’actrice et réalisatrice Maïwenn, avec le metteur en scène et producteur Luc Besson, la prédation exercée sur elle par le cinéaste Benoît Jacquot (au début de leur relation Isild Le Besco a 16 ans, lui 52), l’histoire avec le père de ses enfants et le fait qu’aujourd’hui elle en ressorte broyée mais portée par la nécessité d’écrire pour se reconstruire. Son ouvrage vient s’ajouter à d’autres récits similaires produits ces dernières années par des femmes telles que Flavie Flament, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Hélène Devynck ou Judith Chemla. Elle n’était pas encore prête Il y a à peine trois mois, nous avions déjà voulu rencontrer l’actrice, alors que nous enquêtions sur le cinéaste Benoît Jacquot, contre lequel la comédienne Judith Godrèche s’apprêtait à porter plainte pour « viol et violences sur mineure ». Mais Isild Le Besco, qui a joué le rôle principal dans Sade (2000) et Au fond des bois (2010), de Benoît Jacquot, qu’elle finira par quitter à 24 ans, n’était pas encore prête à « dire vrai ». Elle voulait trouver ses mots à l’écrit avant de les prononcer publiquement. Cette mère de deux adolescents de 12 et 14 ans s’était contentée de nous faire parvenir quelques phrases, où elle évoquait entre les lignes les atteintes subies. Cette phrase, notamment : « Comme pour beaucoup [de comédiennes], mon histoire personnelle me prédisposait à être utilisée, objectifiée ». Quelques semaines après la tempête qui s’est abattue sur le cinéma français, devant la gare où nous l’attendons, Isild Le Besco apparaît au volant d’une voiture familiale. Sous le vent froid et le soleil, elle s’enquiert de la qualité de notre voyage, regrette une météo décevante pour la saison. Des échanges de banalités pour commencer, comme s’il fallait recouvrir l’intimité de son livre. La voiture grimpe un chemin escarpé, franchit un portail en fer forgé pour se garer à proximité d’une grande maison des années 1960 aux volets lavande. La piscine n’a pas encore été remplie, l’herbe est haute. Des chiens et des chats s’ébrouent au milieu de jeux d’enfants. Dans la cuisine, les murs sont recouverts de tableaux peints par la propriétaire des lieux et où figurent souvent des personnages sans visage. Les meubles aussi sont peints, bleu roi, pourpre, doré. Isild Le Besco porte une chemise rose fluo, propose un thé vert fluo, qu’elle sert en cherchant une feuille pour écrire. L’entretien n’a pas démarré, mais c’est elle qui s’attache à prendre des notes de la discussion informelle, au revers d’un dessin de son fils. Elle y inscrit des expressions comme « le viol est une annexion mentale » ou « la parole des victimes génère un effet de rupture de sens ». Elle commence à préparer le déjeuner, taille un concombre en biseau, s’interroge : « Faut-il avoir été soi-même victime de violence pour comprendre son fonctionnement ? » La violence vécue attaque la capacité des victimes à se lier. Pour Isild Le Besco comme pour les autres, il y a toujours un saut à faire, un pari à prendre : celui de faire confiance à son interlocuteur et de sauter dans le vide. La cucurbitacée prête, elle décide de tutoyer. « Les blessures physiques au moins, ça se voit, ça donne le droit d’être victime », dit-elle, revenant sur son agression dans le TGV. A la suite de cet événement, elle s’enferme chez elle, délaisse son portable et dort pendant trois semaines. Quand elle se réveille, elle se demande ce qu’elle a fait de mal pour mériter tout ça, puis contacte une amie médecin à l’étranger qui dresse ce diagnostic : « You don’t embrace yourself. » Elle se met à noircir les pages de son ordinateur, pour tenter de « s’aimer » elle-même. Elle réfute toute impudeur. « Les faits que j’ai subis n’ont rien à voir avec mon intimité, revendique-t-elle. Ça n’est pas évident de s’en défaire, mais ce n’est pas ma vie, cela ne me définit pas. » La violence, une langue natale La violence est une langue natale que l’on apprend dans les maltraitances de l’enfance, dans les négligences du quotidien. Avec ses frères et sœurs, Maïwenn, Jowan, Léonor et Kolia, Isild grandit à Belleville, dans la précarité d’une vie parisienne ballottée entre ses parents séparés. Dans le même immeuble vivent alors ses grands-parents maternels au premier et son père, au quatrième. Depuis la séparation, sa mère a déménagé quelques rues plus loin. Le père, Patrick Le Besco, un ethnolinguiste brillant et cultivé, parle une dizaine de langues mais peine à s’adresser à ses enfants, à s’en occuper même, et donne des coups. Ce Franco-Vietnamien, issu d’une famille de militaires affectés en Indochine, n’a pas assez de lits pour accueillir ses petits et, selon sa fille, ne leur sert à manger que du riz au nuoc-mâm et des yaourts nature. « Je n’ai pas le souvenir de m’être endormie dans un lit propre, avec des draps frais », écrit l’actrice, qui ménage malgré tout son géniteur : « Il nous a donné toute l’affection dont il était capable. » Elle garde aussi de la bienveillance pour sa mère, Catherine Belkhodja, fille d’un Berbère combattant du côté du FLN pendant la guerre d’Algérie et d’une infirmière issue d’un milieu ouvrier qui se sont rencontrés dans une cellule du Parti communiste. « Une marginale, une femme libre » et une « beauté puissante », qu’Isild Le Besco trouverait « fascinante » si elle n’avait pas également un rôle de mère à tenir. Car elle aussi est violente, écrit-elle. « Je me souviens de la dernière fois : ma mère m’avait tapée si fort que je m’étais évanouie. Je m’étais dit que c’était fini, que je me défendrais désormais. Elle n’a plus recommencé. » Elle ajoute : « On ne sait pas vraiment comment c’était, la vie de notre mère avant nous. ». Enfant, Catherine Belkhodja subit les coups de son propre père autoritaire, quand sa mère s’enfonce dans la dépression. Sa sœur finit par se suicider au Destop après de nombreuses poussées psychotiques. Dans la case « profession de la mère », sur les fiches à compléter pour l’école, Isild Le Besco n’a pas assez de place pour donner la liste des métiers exercés par la sienne, ex-égérie du cinéaste Chris Marker : « actrice, réalisatrice, journaliste, peintre, architecte, philosophe… ». Une non-éducation sauvage et destructurée Catherine Belkhodja ne remplit pas le frigo de l’appartement, n’offre aucune sécurité affective ou économique à ses enfants, mais elle leur donne accès aux meilleures formations artistiques, dans le but assumé qu’ils deviennent des stars, quel que soit le domaine. « Mes parents étaient autoritaires et violents. (…) Ils m’ont transmis autant leurs schémas toxiques que la force de ne pas m’en contenter », proclame dans son livre l’autrice, qui les remercie néanmoins pour leur transmission d’une « liberté créative et profonde ». Cette non-éducation sauvage et déstructurée, Isild Le Besco l’a racontée dans son premier film, Demi-tarif (2003), tourné avec une seule caméra alors qu’elle avait 17 ans. Un moyen-métrage brut et bouleversant, filmé à hauteur d’enfant, qui dépeint l’existence de trois gamins livrés à eux-mêmes, obligés de survivre dans l’absence obsédante de leur mère. Œuvre saluée à sa sortie par Chris Marker, Jean-Luc Godard et la presse. Catherine Belkhodja a lu le livre d’Isild Le Besco il y a quelques jours seulement. Jugeant certaines anecdotes « parfois légèrement exagérées », elle salue néanmoins le résultat auprès de M Le magazine du Monde : « La démarche d’Isild me semble d’une très grande sincérité. Ce qui compte surtout, c’est sa perception et son vécu sur les choses, qu’elle analyse et décrypte avec beaucoup de lucidité et de courage. (…) Je trouve ce livre merveilleusement écrit. Par ces pages, on peut mieux comprendre le processus de l’emprise. Isild a toujours refusé de se considérer comme victime. C’est un vaillant petit soldat qui affronte tous les obstacles en refusant d’écouter ses faiblesses. » Interrogée sur les maltraitances qui lui sont reprochées, elle reconnaît « une certaine rudesse, pour que [ses filles] soient fortes et autonomes ». Et regrette que, du fait de sa vie « un peu acrobatique », elle n’ait « peut-être (…) pas su leur exprimer tranquillement tout [son] amour et [son] affection. » Le père, Patrick Le Besco, n’a pas eu connaissance du texte avant sa sortie. « Bien que je n’aie pas lu le livre d’Isild, je respecte infiniment son ressenti, ainsi que celui de tous mes enfants. Je soutiens ce travail de réparation qu’elle entame car c’est aussi une forme de réparation pour moi », écrit-il à M. Il tient à évoquer le contexte post-colonial de l’époque : « Je me suis marié en 1975, moi, venant d’une famille de militaires ayant effectué leur carrière aux colonies, avec une femme dont le père avait été militant actif du FLN en région parisienne. Deux mémoires conflictuelles. Le contexte dans lequel nous vivions était à fleur de peau, marqué par la mémoire de nos parents que, sans nous en rendre compte, nous reproduisions. » Les membres de la fratrie ont lu le livre avant sa publication. Le plus jeune demi-frère, Kolia Litscher, 33 ans, salue le travail entrepris : « Isild a pris pleinement conscience de ce qu’elle a vécu. Avant, elle savait que quelque chose n’était pas normal. Elle est en train de ranger ses pensées, elle est sur la bonne voie. » Jowan Le Besco, 42 ans, se montre admiratif : « Je la soutiens complètement. Elle ne fabule pas. C’est très courageux de sa part, se livrer ainsi n’est pas naturel pour elle, c’est difficile. » La cadette d’Isild, sa demi-sœur Léonor Graser, 39 ans, a participé à l’accouchement de ce texte rédigé en quelques mois, en aidant l’autrice de Dire vrai à mettre ses notes en forme. Elle constate avec joie que sa grande sœur n’est plus aussi fragile et hermétique que par le passé. « Le changement est radical, extraordinaire », observe Léonor Graser. Un réflexe de soumission Il n’y a que l’aînée, la plus célèbre de la famille, qui n’a pas lu le texte avant sa parution. Réalisatrice à succès du cinéma français, autrice des films Polisse (2011), Mon roi (2015), Jeanne du Barry (2023), Maïwenn, 48 ans, apparaît pourtant dès la quatrième page du récit d’Isild Le Besco, avec l’évocation d’un souvenir récent. En 2019, les deux sœurs marchent dans la rue avec une amie, à la sortie d’une projection. La plus âgée se décrit soudain en enfant battue, dit vouloir porter plainte contre leurs parents. Elle craque, tape contre un arbre. Isild étreint Maïwenn, la console – « Je t’aime, ne m’en veux pas, ne disparais pas », sanglote l’aînée. S’ensuit une nuit blanche passée ensemble consacrée « à pleurer [leur] drame commun ». C’est aussi la dernière fois, selon Isild Le Besco, que les deux femmes ont réussi à s’accorder. Aujourd’hui, elles ont coupé les ponts, ne se voient plus, ne se parlent plus. « Elle manque à notre radeau de survivants », écrit la plus jeune. « Enfant, Isild était en admiration de Maïwenn, c’était fusionnel, se souvient une amie des deux sœurs, qui ne souhaite pas être nommée. Mais aujourd’hui il y a une incompatibilité entre elles, car Isild n’est plus docile. Et Maïwenn a besoin de gens qui valident sa façon d’être et de faire. » L’héritage traumatique légué par les parents peut provoquer un réflexe de soumission à plus fort que soi pour survivre. C’est ainsi qu’Isild Le Besco relit aujourd’hui la rencontre de sa grande sœur, Maïwenn, 15 ans à l’époque et aspirante comédienne, avec un homme de 31 ans, déjà célèbre, Luc Besson. Pour elle, la différence d’âge et de situation sociale était telle que la relation entre sa sœur et le réalisateur à succès de Subway (1985), du Grand Bleu (1988) et de Léon (1994) n’a cessé d’être déséquilibrée. Isild Le Besco n’a jamais accepté non plus que Luc Besson quitte sa sœur, alors jeune mère. Sollicitée pour cet article, Maïwenn n’a pas répondu. « Nous n’avons rien à voir l’une avec l’autre. Je ne veux pas qu’on m’associe à elle », a déclaré, le 20 avril, Maïwenn à propos de sa sœur dans le journal en ligne britannique The Independent. Maïwenn, la deuxième maman En 1991, Maïwenn, la deuxième maman des « enfants sauvages de Belleville », quitte le désordre et la pauvreté de l’appartement du 19e arrondissement de Paris pour rejoindre son compagnon et le luxe dans lequel il baigne. « Luc incarnait le rêve d’un ailleurs, une porte de sortie qui s’est avérée être une boucherie », éclaire Isild Le Besco au cours de notre conversation. Elle se souvient des appartements aux couloirs immenses, des séjours à Eurodisney et des vacances dans la demeure avec piscine du réalisateur : « Nous passions du confort des somptueuses propriétés de Luc à notre taudis. De ma grande sœur adorée, chaleureuse et joueuse, au vide affectif et à la violence. » Sur les tables de nuit du cinéaste, la jeune Isild tombe sur des grosses coupures. Elle culpabilise en pensant à son père qui, lui, dit ne vivre qu’avec 1 franc par semaine et elle dépose parfois dans son portefeuille un billet subtilisé. Quelques mois plus tard, lors d’un voyage de classe, la maîtresse de l’un des membres de la fratrie découvre, en guise de contenu de sa valise, un tas de vêtements sales. Elle fait un signalement à la DDASS, qui n’aboutit pas en placement car, écrit Isild Le Besco, « Luc s’est présenté avec ma sœur à un rendez-vous pour s’engager à protéger l’équilibre de notre vie. Maïwenn était encore mineure, et lui, il allait devenir notre garant parce qu’il était riche et connu. » Avec vingt-cinq ans de recul, Isild Le Besco se réjouit de ne pas avoir été placée, mais regrette que les services sociaux ne se soient pas interrogés sur l’âge de ce « sauveur ». 1993. Maïwenn, 16 ans, accouche de Shanna, la fille du couple qu’elle forme avec Luc Besson, et part vivre à Los Angeles avec le cinéaste. Le réalisateur travaille alors sur Le Cinquième Elément (1997), qui deviendra à l’époque le plus grand succès commercial d’un film français à l’étranger. Sur le tournage, il rencontre Milla Jovovich, 21 ans à l’époque, l’actrice principale, pour laquelle il quitte Maïwenn. Isild Le Besco ressent encore aujourd’hui dans son propre corps l’humiliation de sa sœur : « Après coup, cela donne l’impression qu’on faisait partie d’un film où Luc se donnait le beau rôle et où nous étions le prolongement de notre sœur aînée. Et puis, il a zappé le film. » Adolescente, celle qui adore garder sa nièce voit sa grande sœur, revenue seule des Etats-Unis, devenir mère célibataire précaire. Isild Le Besco se retrouve à jouer les intermédiaires avec Luc Besson. « Ma sœur voulait que je demande à Luc de faire quelques courses : la pension alimentaire qu’il lui versait était insuffisante », raconte-t-elle. Elle se rend chez lui, lui demande d’acheter du lait de soja pour la fillette. « D’un air de chien battu, il me répondait comme un pauvre homme qu’il ne pouvait pas se permettre ça. Il avait fait un enfant à ma sœur de 16 ans, l’avait trompée, puis abandonnée, et rechignait désormais à dépenser pour que son enfant mange », poursuit-elle. Contacté par l’intermédiaire du porte-parole de sa société, Luc Besson indique « attendre la parution du livre » pour réagir. Emmanuelle Bercot et la sexualisation des jeunes filles Sur la terrasse de sa maison drômoise, Isild Le Besco porte alternativement un chapeau pour se protéger du soleil et un manteau quand les nuages s’amoncellent. Elle hésite de la même façon quand il s’agit d’aborder ses débuts de comédienne dans le cinéma français auprès de réalisatrices : « Elles ont probablement été traitées comme des choses dans leur jeunesse, peut-être pire même, mais c’est l’illustration d’une époque, de comment on traite une petite fille sur un plateau et plus largement dans le monde. » En août 1997, l’été de ses 14 ans, elle tient le premier rôle du film d’une jeune metteuse en scène de même pas 30 ans qui sort tout juste de la Fémis, Emmanuelle Bercot. Le scénario du moyen-métrage La Puce (1998), dans lequel jouent plusieurs membres de la famille d’Isild, dont sa mère, n’a rien à envier à ceux de ses homologues masculins de l’époque, comme Benoît Jacquot ou Jacques Doillon, en termes de sexualisation des jeunes filles. C’est l’histoire d’une adolescente qui se donne à un homme bien plus âgé. La comédienne se rappelle encore le malaise qui l’avait saisie au moment de tourner la scène du dépucelage de son personnage, lorsqu’elle est confrontée à l’érection de son partenaire. Deux ans plus tard, elle tourne pour Emmanuelle Bercot dans Le Choix d’Elodie (1999), un téléfilm qui sera diffusé sur M6. « Elle m’avait fait jouer la première, j’étais prête à tout pour elle », déclare-t-elle. Peut-on filmer la violence sans être violent ? Isild Le Besco en est convaincue. Elle raconte la trentaine de gifles de plus en plus fortes, comme autant de prises nécessaires, pour la scène où la mère d’Élodie lui met une claque. L’adolescente ressent trop d’admiration à l’endroit de la réalisatrice pour oser lui dire stop et qu’elle a mal. « J’étais dans un état de survie émotionnelle, j’étais choisie plus que je ne choisissais ». Emmanuelle Bercot n’a pas souhaité réagir : « Je ne saurais vous être utile », nous a-t-elle répondu. Grâce à ses premiers cachets, Isild Le Besco peut aider sa mère à payer le loyer de l’appartement, où elle vit désormais en autonomie avec ses frères et sœurs. Parfois, un directeur d’école appelle à la maison pour leur demander d’arrêter de sécher les cours ou la police intervient après des vols dans des magasins. Rares souvenirs d’autorité pour l’artiste, qui arrête l’école après avoir raté son brevet. Benoît Jacquot, rencontré à 16 ans L’entretien, suspendu à la tombée du jour, n’a pas permis d’épuiser tous les sujets. Le lendemain, il fait toujours aussi froid et Isild Le Besco n’a plus de voix. Dans les ruelles étroites de la ville où elle vit, elle se demande si c’est le fait d’avoir tant parlé après un aussi long silence qui lui cause cette extinction. Un confortable salon de thé offre le cadre rassurant pour parler d’un autre personnage cardinal de sa vie et de son livre : Benoît Jacquot. Contactés, ni le cinéaste ni son avocate n’ont répondu à M. Isild Le Besco rencontre le réalisateur dans un café. Il a aimé sa prestation dans La Puce et convainc la jeune première de 16 ans de jouer Emilie de Lancris dans son prochain film consacré au marquis de Sade. Il met en place avec elle la même stratégie de conquête qu’avec Judith Godrèche sur le tournage des Mendiants, en 1986 : « Il a demandé à la production de me prendre une chambre dans le même hôtel que lui. Le soir, nous dînions en tête à tête. Il disait qu’il m’aimait beaucoup », développe-t-elle dans son livre. Sa mère l’a prévenue, cet homme-là a été avec toutes ses jeunes actrices : « Ça m’avait gênée qu’elle m’imagine cédant à ce vieux monsieur », écrit-elle. Elle se rappelle : « Benoît Jacquot avait l’obsession qu’on me voit nue, allongée, face caméra. Je ne le voulais pas et l’avais annoncé dès le départ. » Le week-end précédant le tournage de cette scène, en 1999, il lui donne sa carte bancaire et, raconte-t-elle, l’autorise à acheter tout ce qu’elle veut : « Une carte bleue contre mon corps d’adolescente et le dépassement de mes limites. » Isild et sa fratrie dévalisent le supermarché de bonbons, de gâteaux et de boissons. La semaine suivante, l’actrice accepte de jouer la scène érotique tant désirée par le réalisateur. Mais, juste après, il porte plainte pour le vol de sa carte de crédit et elle se retrouve au commissariat, convoquée pour un interrogatoire qui dure des heures. À la demande du cinéaste, assure-t-elle, elle devra dire aux policiers qu’elle lui a emprunté sa carte pour lui faire une blague. Contrôle des vêtements, de la nourriture, du corps Le tournage achevé, Benoît Jacquot continue de solliciter Isild Le Besco. Il insiste pour l’emmener dans sa chambre d’hôtel, raconte la jeune femme, lui proposant de devenir son professeur, de lui apprendre à écrire des scénarios – il l’aidera notamment pour l’écriture de son deuxième film, Charly (2006). Immature, traumatisée par l’abandon de sa sœur par Luc Besson, Isild Le Besco pense se protéger de la blessure amoureuse en veillant à ne pas s’attacher à Benoît Jacquot. Le réalisateur l’emmène à Venise, comme il l’a fait avec Judith Godrèche et le fera plus tard avec Julia Roy, qui ont toutes deux porté contre lui des accusations recueillies par le parquet de Paris dans le cadre d’une enquête préliminaire. « C’est sur l’un de ces si jolis ponts, au-dessus des gondoles, que Benoît m’a giflée pour la première fois », écrit Isild Le Besco. Il lui a promis de ne jamais la toucher mais se montre de plus en plus pressant pour obtenir des rapports sexuels. Ils finissent par avoir lieu, sans tendresse dit-elle, sans baisers ni mots doux. Elle l’a vécu avec souffrance et le sentiment d’être en apnée, dans l’attente que ça passe. Leur relation se poursuit plusieurs années, même s’ils ne vivent pas ensemble et que Benoît Jacquot est marié. Il établit des règles identiques à celles qu’ont vécues d’autres de ses compagnes, sur le contrôle des vêtements, de la nourriture et du corps, le tout s’accompagnant du dénigrement permanent des femmes ayant le malheur d’avoir plus de 25 ans. Lors d’un voyage au Japon, le réceptionniste refuse qu’ils fassent chambre commune : la jeune femme est encore mineure. Ailleurs, en Italie, et à une autre époque, Judith Godrèche a vécu la même scène. « Avec Benoît Jacquot, c’était une relation d’emprise, juge Léonor Graser. Il était devenu la personne de référence. Tout ce qu’il disait, elle le répétait ensuite. Elle était coupée de tout le monde à l’époque, elle ne faisait que travailler. On se voyait, certes, mais il n’y avait pas d’espace pour parler, pour commenter son mode de vie, tout ça était complètement normalisé. » A l’époque, le comédien et réalisateur Jérémie Elkaïm était proche d’Isild Le Besco et « militai[t] pour qu’elle fasse des rencontres » : « Je voyais que cela n’allait pas, il était indéniable que tout n’était pas dans les bons écrous. Mais il était aussi indéniable que cette histoire lui donnait une force spectaculaire. Je la trouvais absolument incroyable. Ce mélange de liberté et de sauvagerie chez elle vous donnait l’impression d’avoir pleinement affaire à une artiste. » Isild Le Besco a d’autant plus de mal à quitter Benoît Jacquot – auquel elle se réjouit de n’avoir jamais dit « je t’aime » – qu’il lui fait du chantage au suicide. Une nuit de 2007, alors que la séparation est enfin enclenchée, il l’appelle, désespéré, dit qu’il ne peut pas vivre sans elle et qu’il va sauter par la fenêtre. Elle traverse tout Paris pour le calmer. Il finit, selon elle, par la pousser dans les escaliers du cinquième étage. Elle rentre brisée et secouée, le poignet et le bras douloureux, comme l’a confirmé une amie témoin de la scène qui a souhaité rester anonyme. « Quand je l’ai quitté pour de bon, Benoît a juré de me nuire, écrit Isild Le Besco : je ne ferais plus de films, ni comme actrice, ni comme réalisatrice. Mon génie, c’est lui qui l’avait créé. » Cette phrase, Julia Roy aussi l’a entendue. Impossible de mesurer les conséquences de ces menaces, mais les deux femmes n’ont presque plus tourné après avoir quitté Benoît Jacquot. Une histoire trop douloureuse pour être racontée Dans les années qui suivent la rupture, Isild Le Besco peint, écrit, poursuit sa carrière de réalisatrice, avec le film Bas-Fonds (2010), qui se distingue par sa noirceur dans la description de l’enfance. Dans son livre, elle reconnaît avoir eu des comportements abusifs en tant que cinéaste, notamment sur son petit frère de 14 ans quand elle le fait tourner. « Qui suis-je pour dénoncer les autres si je n’étudie pas ma propre domination ? » Après Benoît Jacquot, elle se met en couple avec un photographe, le père de ses deux garçons. La violence l’avale de nouveau. Sur cette histoire, trop douloureuse, Isild Le Besco n’est pas encore prête à parler. En 2018, un an après l’explosion du mouvement MeToo, elle voit Natalie Portman, sa copine d’adolescence rencontrée par l’intermédiaire de Luc Besson, dénoncer le mauvais souvenir de l’hypersexualisation subie sur le tournage de Léon. Tous ces instants de prise de conscience s’agrègent peu à peu, jusqu’à la bascule opérée à la suite de l’agression dans le TGV. A l’origine, Isild Le Besco a écrit son texte pour elle, et non pour le publier. Mais Judith Godrèche rend les choses urgentes. Benoît Jacquot a vu Icon of French Cinema, la série de cette dernière pour Arte, et s’inquiète pour sa réputation. Il envisagerait de porter plainte pour diffamation, comme il l’explique en décembre 2023 à Isild Le Besco autour d’un café qu’elle a accepté de prendre avec lui. Tandis qu’il cherche son soutien, elle tente de lui expliquer le mal qu’il lui a fait : « J’aime bien les oppositions civilisées, j’essayais de remettre les choses à leur place, pour ne pas être encombrée par la colère après ce qu’il m’a fait », argumente-t-elle aujourd’hui. Il s’excuse vaguement, lui propose, dit-elle, de réaliser avec elle un film sur une femme de Picasso anéantie par la toxicité du peintre. « Les prédateurs n’intègrent jamais la version de leur proie », relève dans son livre Isild Le Besco. Que faire de ce mot « viol » ? En février 2024, les enfances volées par Benoît Jacquot sont donc devenues une procédure judiciaire. La policière chargée de l’enquête appelle plusieurs fois Isild Le Besco pour l’auditionner – en vain, jusqu’à présent. « Ça m’énerve ce traitement de faveur qu’on accorde aux stars », justifie-t-elle. Elle se pose des questions. La première : contre qui doit-elle porter plainte ? Contre ses parents violents ? Contre Benoît Jacquot ? Contre Luc Besson, coupable à ses yeux d’avoir « condamné Maïwenn à voir [leur] histoire comme une histoire d’amour » parce qu’ils ont eu une fille ensemble ? Contre la sexualisation des jeunes filles par le cinéma français ? « Ou suis-je victime de n’avoir pas habité mon propre corps quand d’autres l’utilisaient ? Suis-je victime de n’avoir pas su me défendre moi-même ? » A l’endroit de Benoît Jacquot, l’autrice et réalisatrice se trouve face à sa deuxième interrogation : la qualification des faits. Que faire de ce mot, « viol », qu’elle écrit en toutes lettres mais considère trop réducteur ? « Dire que Benoît m’a violée, c’est évident », juge-t-elle, mais aussi approximatif, car il a d’abord, selon elle, « violé [son] esprit » pour obtenir son corps. « Comme tout prédateur, Benoît ne fait pas l’amour. Le sexe n’est qu’un outil, comme on ferait des trous avec un marteau-piqueur pour fragiliser les murs d’un édifice. Ce n’est pas le fait de faire des trous qui importe, c’est le résultat. L’acte sexuel permet de s’emparer de l’autre jusque dans les profondeurs de l’être. » Ecrire ces lignes a été violent pour Isild Le Besco. Douleurs au ventre, insomnies : les symptômes classiques du traumatisme réactivé. Le salon de thé s’est vidé. Il ne reste plus que nous, dissertant sur l’existence de traces matérielles de ses affirmations : des fragments, des lettres ou des documents qui renforceraient son récit. Tout est stocké dans des boîtes fermées, qu’elle ouvre sitôt rentrée chez elle. Isild Le Besco nous envoie des photos de cartons ouverts, d’albums jetés par terre. Le lendemain, lors d’un dernier déjeuner, elle arrive le sac à main lourd des images qu’elle veut nous montrer. On la voit, si juvénile, sur ses tournages d’adolescente. Ou en compagnie de ses frères, de Maïwenn et de Luc Besson attablés dans un restaurant aux Etats-Unis, dans une étrange image de recomposition familiale. Isild Le Besco nous raccompagne à la gare où des trains de marchandises passent sans s’arrêter. Le fracas masque le bruit de ses larmes. Bientôt, c’est elle qui montera à Paris, pour porter sa volonté de « dire vrai ». Lorraine de Foucher Jérôme Lefilliâtre pour M le magazine du Monde Légende photo : Isild Le Besco, chez elle, dans la Drôme, le 22 avril 2024. BETTINA PITTALUGA POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 26, 2024 12:35 PM
|
Propos recueillis par Anne Diatkine dans Libération - 26 avril 2024 Dans un entretien exclusif, l’actrice revient sur ses débuts au cinéma à la lumière de la révolution #MeToo. Evoquant les nombreuses scènes de nu, les rôles systématiquement sexualisés ou encore les agressions sur les tournages. C’est une parole qui va vite, aussi rapidement que la jeune actrice au milieu des années 80 qui veut exercer son art – au théâtre d’où elle vient car ses deux parents sont comédiens, et au cinéma, peuplade étrangère dont elle ignore alors totalement les codes, les coutumes et le vocabulaire. «Casting» fait partie des mots inconnus. C’est l’histoire d’une jeune fille animée par une nécessité intérieure que rien ne peut décourager. Elle découvre un monde, certes brillant et désirable, mais constamment susceptible de malmener son intégrité ou la mettre en danger. Où mettre les limites ? Comment les appréhender quand on a 18, 20 ans, avec pour seul guide son intuition ? C’est la parole d’une actrice devenue star, à la filmographie internationale, époustouflante en raison de la diversité des grands cinéastes qui jalonnent sa route – Leos Carax, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis, Olivier Assayas, André Téchiné pour n’en citer que quelques-uns, et récompensée par les prix les plus prestigieux (oscar, coupe Volpi à la Mostra de Venise, césar, prix d’interprétation à Cannes). Juliette Binoche a une particularité : même quand elle était très jeune, elle n’a jamais fait du silence sa loi. Ne pas s’encombrer, mais revisiter sans anachronisme ses débuts à la lumière de la révolution #MeToo : tel est le pari de cette rencontre avec Libération. En France, aucune actrice de renommée internationale n’avait jusqu’à présent pris la parole. L’entretien s’est fait en plusieurs temps, et Juliette Binoche, qui l’a relu et peaufiné pour préciser certaines formulations ou détails, s’est investie largement dans son écriture. «Mes tout débuts se résument à deux questions : Comment survivre ? Comment faire de ce désir de jouer une réalité ? Encore au lycée, j’ai eu la possibilité de prendre un café avec Dominique Besnehard qui m’a proposé de passer à son bureau pour apporter une photo de moi nue, précision qui m’avait embarrassée, dans l’éventualité d’être prise dans Mortelle Randonnée de Claude Miller au début des années 80. Je n’ai pas accédé à ce (petit) rôle, mais Besnehard m’a fait un cadeau inespéré : les coordonnées d’un agent. A partir de là, bac en poche, je me suis mise à courir les castings à droite à gauche tout en étant caissière au BHV et en poursuivant mes cours de théâtre le soir chez Véra Gregh, ma boussole. Les réponses étaient souvent négatives. Je passais parfois plusieurs tours, mais dans cette grande foire aux enchères des actrices, je ne parvenais jamais à la dernière étape. Le tout premier casting (je ne connaissais pas encore ce mot) c’était pour les Meurtrières, un film que Maurice Pialat n’a finalement pas tourné. Au mur, était placardée une affiche de Diva de Jean-Jacques Beineix avec le profil d’un comédien que je venais de croiser, Dominique Pinon. Pialat a suivi mon regard : “Vous aimez ce film ?” J’ai répondu «oui !» : «Eh bien, prenez la porte.» J’ai pris la porte sans l’emporter, la tête brouillée. Puis on m’a rappelée peu de temps après… pour me poser des questions sur mon rapport à la mort. «Jean-Luc Godard a vu une photo de toi, il aimerait te voir» «Quelques mois plus tard, j’ai tourné deux jours dans Liberty belle. Le réalisateur Pascal Kané m’invite à dîner à l’hôtel Nikko dans les hauteurs d’une tour pour me parler, m’avait-il assuré, d’un autre projet. Alors qu’il me désigne la vue sur le front de Seine, il se jette sur moi pour m’embrasser. Je l’ai repoussé vigoureusement : “Mais j’ai un amoureux !” Je n’en revenais pas. J’avais quelques repères de méfiance, une première fois pour avoir été touchée par un maître d’école à 7 ans qui m’apprenait à lire en caressant mon sexe derrière son bureau devant la classe. Le choc était de m’apercevoir que ce réalisateur se servait lui aussi d’un stratagème et de ma bonne foi pour arriver à ses fins. Quelques années plus tard, j’ai relaté l’agression de Kané dans une revue de cinéma, et il a exigé que je demande un rectif, pour dire que la journaliste m’avait mal comprise. Refus de ma part. En plus il faudrait se taire ? «Vient le jour où mon agent me dit : “Jean-Luc Godard a vu une photo de toi, il aimerait te voir.” A l’époque, il fallait avoir ses propres photos qu’on déposait dans diverses officines, ça coûtait une blinde. J’avais transformé ma salle de bains en labo et développais moi-même les images que prenait mon amoureux. J’avais réussi mon premier rendez-vous, je devais passer mon deuxième examen. J’étais obnubilée par une infection oculaire attrapée trois jours avant au BHV et la crainte de n’être pas choisie à cause de cet œil déformé. J’arrive, Jean-Luc me donne les instructions. Me déshabiller, tourner autour d’une table toute nue en lisant un poème tout en me peignant les cheveux pendant qu’il filme. S’il avait exigé que je décroche la Lune, j’aurais sans doute trouvé le moyen d’y parvenir. Je n’ai pas eu le rôle. Quelques jours plus tard, un message m’apprend que Godard avait créé un rôle «rien que pour toi», précise le répondeur, «tu seras la copine de Marie». C’était pour Je vous salue Marie. On est restée plusieurs mois à attendre dans un hôtel en Suisse, sans scénario, avec en prime, pour moi, des cours de basket. J’étais impressionnée par la présence de Jean-Luc, il baillait à l’intérieur des phrases, son regard paraissait inatteignable derrière ses lunettes fumées, mais il avait la main généreuse quand il signait nos chèques. On pouvait survivre. Pendant le tournage, j’ai couru ramasser une balle de basket qui était partie hors champ à la fin d’une prise. Réaction cinglante du cinéaste : «Fais pas semblant d’aider.» J’avais justement appris à aider ou être aidée dans les cours de théâtre, mais là, plus de prévenance, ni de bienveillance, il s’agissait de ne pas s’approcher, saisir la bonne distance, sans père ni maître, seule. Dès lors, j’ai compris qu’il n’y avait rien à attendre d’un metteur en scène, je devais être grande à 20 ans. La violence d’un Pialat ou d’un Godard me disait : tu es sur ton chemin, fais de cette solitude un art. «Juste après l’épisode Kané, j’ai obtenu un petit rôle l’été 84 dans la Vie de famille de Jacques Doillon, avec Sami Frey. Doillon, c’était une référence pour les actrices de ma génération. Sur place, tout de suite je devais retirer ma robe tee-shirt dès la première scène en hurlant. J’étais cap, c’est ce qui comptait. Pas consciente du méli-mélo de répliques perverses, trop émue d’avoir été choisie face à Juliet Berto, ma mère dans le film. Rétrospectivement, certaines répliques que m’adresse Sami Frey, qui joue mon beau-père, font froid dans le dos : “Ta mère veut que je t’aime. Elle rêve que nous fassions l’amour ensemble. Alors je vais t’aimer.” Pas sûre d’avoir compris ces répliques à l’époque. J’ai pourtant gardé un bon souvenir de ce tournage. Sami Frey était très respectueux avec moi. Et d’ailleurs, quand il a vu Rendez-Vous, le film d’André Téchiné qui m’a fait connaître, il m’a drôlement engueulée : “N’accepte jamais de te laisser filmer comme ça, il ne faut pas te laisser faire.” L’avait particulièrement choqué un gros plan de mon pubis avec la tête de Lambert Wilson à côté dans l’autre sens. C’est filmé de haut, bien cadré. J’étais surprise par son indignation. Je ne voulais pas de conflit avec le réalisateur. Ma mère aussi a poussé un cri que j’ai pris pour de l’admiration, quand elle a découvert Rendez-vous à Cannes : «Comment t’as fait ?» Elle était horrifiée, je ne l’ai compris qu’après. Moi, j’étais au-delà de la joie. Le film était grandement accueilli à Cannes. «Pendant ces deux ans interminables où je me suis débattue pour survivre dans ma quête d’être actrice, il était souvent demandé de se déshabiller pour passer un casting. Je m’exécutais. Mais il y a eu une fois de trop : sous le regard de Sébastien Japrisot, auréolé du succès de l’Eté meurtrier qu’il avait écrit, nous devions jouer les mêmes scènes encore et encore en sous-vêtements et jarretelles. Je suis sortie en plein milieu de ce casting en rage, j’avais compris que le dessein poursuivi n’était pas celui du film. «Pour Rendez-vous, je n’ai pas passé d’essai. André Téchiné m’a choisie contre la volonté du producteur Alain Terzian, trois jours avant le début du tournage. André m’a demandé d’aller le voir à son bureau. J’avais investi dans une robe et un manteau Alaïa, que je portais dans les moments importants. Je me revois remonter l’avenue Messine en pleurant à l’idée de me présenter, afin, j’en avais conscience, de me vendre. Il m’a bien détaillé des pieds à la tête en insistant sur les parties qui l’intéressaient. On a parlé quelques minutes à peine et il m’a congédiée. «Il ne m’échappait pas complètement que ce besoin effréné de corps nus au cinéma dans les années 80-90 ne concernait que les jeunes femmes, rarement les hommes, sauf avec Chéreau et par la suite Téchiné. Ça ne me révoltait pas, je prenais cette exigence en patience. Il n’y avait pas un scénario sans une scène nue. A chaque fois c’était difficile. J’ai appris à sauter dedans, comme on plonge en mer froide, tête la première. Je voyais la date des scènes nues arriver avec effroi sur le plan de travail : plus qu’une semaine, plus que deux jours… L’angoisse montait comme le courage. Sur Rendez-vous, pendant l’hiver glacial 84, j’avais assimilé les exigences du tournage : froid, nudité, humilité. Et parfois humiliation. J’acceptais tout avec fougue. A chaque fois qu’on tournait une scène de sexe, le producteur Terzian s’installait devant sur le plateau avec son gros cigare à la bouche. Mais sa présence ne pouvait entamer ma ferveur, j’étais trop occupée à tourner les scènes difficiles qui m’attendaient : me faire cracher dessus, mimer une pipe et prétendre faire l’amour sur des escaliers. Il y a une scène où Nina, le personnage que j’interprète, dit à Jean-Louis Trintignant : “C’est ma chance et je ne la laisserai pas passer.” C’était tellement extraordinaire d’avoir été choisie qu’il fallait que je donne tout ce que je pouvais. Si je ne m’étais pas engagée physiquement autant, peut-être que ce rôle n’aurait pas été investi complètement. «La marchandisation de mon corps s’est reproduite» «Ces épreuves m’ont rendu plus forte : je plaquais au sol ma vulnérabilité. Mais je savais qu’il y avait des interdits : on ne touche pas aux parties intimes. Ce qui m’avait attristée à l’époque de la sortie du film de Doillon est que même avec un tout petit rôle, j’apparaissais seins nus sur l’affiche. Cette exposition me mettait très mal à l’aise. La marchandisation de mon corps s’est reproduite ensuite avec l’affiche de Rendez-vous d’André Téchiné où je suis de dos cabrée totalement dénudée. C’était la machination consensuelle d’Alain Terzian, de Bettina Rheims la photographe et du graphiste Benjamin Baltimore. Il fallait vendre, que ça marche, que ça marque. Cette séance photo avec la présence du producteur où j’étais déshabillée face à Lambert Wilson habillé me laissait démunie, désespérée au fond, sans voix. Scandale : des gens l’arrachaient sur les colonnes Morris. Et dans ma famille paternelle, cette exposition associée au nom de Binoche fâchait. André Téchiné, lui, était contre tout ce marketing, il ne voulait pas de cette affiche. «La focale, le cadre, les mouvements de caméra : tous ces mots m’étaient inconnus. Je remarquais à peine la caméra. On tournait bien sûr en pellicule, il n’y avait pas de retour vidéo à montrer aux acteurs. Ma bouée de secours, c’était la confiance. Elle le reste ! C’est elle qui permet de se donner corps et âme, de rester solidaire avec le film quoi qu’il advienne. Cette confiance a été trahie quelques années plus tard, sur le deuxième film qu’on a fait ensemble, André et moi, pour Alice et Martin. L’idée d’un plan dénudée ne me plaisait pas. André a juré qu’il l’enlèverait si je le lui demandais une fois le film monté. Il n’a pas tenu parole. Il a fallu l’intervention du producteur. Cette trahison m’a vraiment déçue, peut-être plus encore que le plan lui-même. Une première fois déjà, sur Rendez-vous, il y a eu un geste que je préférerais oublier. Une main, tandis qu’on tournait, est venue me toucher subitement le sexe. On ne m’avait pas prévenue, et encore moins demandé mon accord. J’étais stupéfiée. Mais je n’ai pas été capable de le dire. Je n’ai jamais su si cette main provenait d’une demande du metteur en scène, ou si c’était l’acteur qui avait pris cette liberté et je n’ai pas trop envie de le savoir. Focaliser ma colère sur une personne précise ? Pourquoi ? «Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je pouvais exiger quand les scènes l’imposent, un plateau fermé. Ou remettre en question dans un scénario une scène nue que je ne trouvais pas nécessaire. J’ai pu le faire sur Bleu de Krzysztof Kieślowski. J’ai été tellement rassurée sur l’Insoutenable légèreté de l’être, quand j’ai réalisé que le producteur Saul Zaentz était absent quand on tournait les scènes nues alors qu’il était sur le plateau tous les autres jours. L’Insoutenable légèreté de l’être était mon premier film à gros budget, à l’étranger, avec une star montante, Daniel Day-Lewis. Là aussi j’ai été choisie une semaine avant le tournage et les scènes nues étaient nombreuses… Même sur ce film, le réalisateur est entré dans ma caravane pour me peloter. Je l’ai repoussé, il n’a pas insisté. Lena Olin, qui tenait l’autre rôle féminin, m’a dit qu’elle avait eu droit aux mêmes tentatives. «Au fond, tout est pardonné. Tout est transformé, tout m’a sculpté» «Toutes ces blessures provoquent une rage, une révolte. Mais aucune envie d’arrêter. Les coups bas, les gestes déplacés, les remarques sexistes : je ne les oublie pas, elles empoisonnent la vie, mais elles restent secondaires. Au fond, tout est pardonné. Tout est transformé, tout m’a sculpté. Le désir de me donner à travers le jeu reste plus fort, l’art du jeu est une forme de connaissance jubilatoire secrète, impossible à saisir, à voler. «Je n’ai pas toujours su protéger mes camarades. Avant Rendez-vous, j’avais rendu visite sur un tournage à une amie actrice de mon âge alors très en vogue. Son partenaire de jeu avait sa tête dans son entre-jambe. Elle était nue sans aucune protection. Ils filmaient sans gêne, je suis restée sans voix. Je n’ai pas su trouver les mots, elle semblait si insouciante. Je suis partie vite, défaite. Une autre fois, j’ai compris avec le recul, c’était à peine perceptible, qu’une figurante se faisait violer par un acteur dans les Enfants du siècle au cours d’une scène d’opium dans un bordel. J’ai aperçu la jeune femme partir sonnée une fois le tournage terminé, comme si elle avait reçu un coup de poing. J’avais la haine. Cet acteur est mort aujourd’hui. «Peut-être en raison de mon histoire personnelle, j’ai vécu dans une idéalisation du metteur en scène et défendu les cinéastes auteurs et indépendants. Avec une certaine soumission que j’associais à de la protection. J’avais le sentiment d’appartenir à une caste, d’approcher au plus près une forme artistique, nouvelle, vibrante. Obéir était une façon aussi de ne pas être totalement moi-même, d’être dans une dépendance qui me rassurait. Au fil du temps, cette relation est devenue plus égalitaire, circulaire. Mais j’ai dû gagner cette indépendance, par des combats, des crises, des séparations. J’ai encore du chemin à faire. Aujourd’hui je n’ai plus besoin d’être sauvée par cette image masculine du père protecteur ou de l’amant qu’il faut satisfaire. «A l’époque de Mauvais Sang, rien ne me semblait plus merveilleux que d’être filmée par Leos Carax, par l’homme que j’aimais et qui m’aimait, de faire œuvre avec lui. Et de me battre pour notre film, notre enfant. Quand Téchiné a vu le film, il a critiqué fermement la façon dont Leos m’avait filmée, l’image de la femme parfaite, icône de beauté. J’étais idéalisée. Sans doute enorgueillie par cette nouvelle image, j’ai avancé dans le cinéma avec un certain poids : le désir de perfection. Par la suite, j’ai poussé Leos à créer des personnages plus réels, qui transpirent, qui se lavent, dans les Amants du Pont-Neuf. Leos avait horreur de toutes ces scènes nues “hystériques” comme il disait. Il n’en voulait pas. C’est moi qui lui ai demandé de tourner cette scène dans les Amants où je me lave dehors nue, de loin. Scène que j’avais vue dans la rue quand j’étais en préparation. «Sauter en parachute, plonger dans la Seine à 6 degrés, s’épuiser à la mesure des personnages qu’on joue : pendant des années, ne pas faire semblant était pour moi la moindre des choses. J’adorais ces challenges physiques. Sur les Amants du Pont-Neuf, pendant ma préparation du film, j’ai accompagné une jeune femme Véronique qui vivait dans la rue, ancienne toxico. Elle faisait la manche, pendant que je dessinais. J’avais gardé le patch sur l’œil que je porte dans le film. Ça me semblait important d’éprouver la vie de mon personnage, même si à la grande différence de tous ceux que je côtoyais, j’avais une carte de crédit dans la poche arrière de mon pantalon. Deux fois, durant ces immersions qui pouvaient durer plusieurs semaines, j’ai été agressée, et une autre fois, j’ai vraiment eu peur, j’ai failli me faire violer dans un hôtel misérable à Strasbourg-Saint-Denis qui s’est révélé être un hôtel de passe. «Maintenant, c’est la vie ! Rien que la vie» «Sur les Amants du Pont-Neuf, un événement fatidique est survenu. Lestée de douze kilos autour de la taille pour pouvoir descendre cinq mètres sous l’eau, d’une perruque, d’un lourd manteau, de bottes, j’ai échappé d’un cheveu à la noyade. Denis Lavant et moi étions censés être en sécurité, sous le regard de deux plongeurs professionnels. Il était convenu qu’on fasse le mouvement de la main des plongeurs si on manquait d’oxygène. Quand je suis arrivée au fond de l’eau, je n’avais plus du tout d’air. J’ai fait le signe. En vain. J’ai été obligée de batailler de toutes mes forces en apnée, sans qu’aucun secours ne me soit apporté, pour parvenir à la surface malgré mon barda et les cinq mètres d’eau au-dessus de moi. Au moment de la remontée, qui m’a parue si longue, j’ai pris une décision : “Maintenant, c’est la vie ! Rien que la vie !” Le premier assistant me voit bouleversée en train de reprendre mon souffle difficilement : “On y retourne. — Sans moi.” Non seulement personne ne m’a présentée d’excuses ou a paru comprendre à quoi je venais de réchapper, mais quand je suis allée voir le plongeur responsable de ma vie, il m’a expliqué qu’il avait ordre d’attendre que le metteur en scène lui donne l’autorisation pour venir à mon secours. Et quand j’en ai parlé à Leos, il m’a dit ne pas s’en souvenir. Etait-ce imputable à la mauvaise organisation du premier assistant ? Etait-ce autre chose ? Je ne le saurais jamais mais ce jour-là, mes limites encore mal définies jusqu’alors sont devenues brusquement nettes. «La solidarité entre actrices n’a pas attendu ces dernières années pour se manifester. En 2003, je devais travailler avec Arnaud Desplechin. Mais lorsque j’ai découvert le scénario de Rois et Reine – il m’est apparu flagrant que certains épisodes de la vie de son ancienne compagne, l’actrice Marianne Denicourt, étaient utilisés et instrumentalisés. Il me paraissait évident qu’il fallait que je m’assure que Marianne était au courant de ce projet et pleinement en accord. Son fils n’étant pas encore majeur, les conséquences pouvaient être dramatiques. Je l’ai appelée, elle ignorait tout du film en préparation et était extrêmement blessée. Je n’ai pas eu d’autre choix que de refuser ce projet quoi qu’il m’en coûte. Comme d’ailleurs l’avait fait Emmanuelle Béart avant moi. Comme l’ont fait après d’autres actrices. «Je suis soulagée de voir et d’entendre les témoignages de femmes et d’hommes qui osent exposer les abus qu’elles et qu’ils ont subis. Ce n’est pas facile d’exposer sa vie intime, et nous devrions tous les remercier. C’était une première notable et très joyeuse qu’aux césars, les cinq actrices en lice pour la meilleure interprétation le soient pour des films signés par cinq femmes et pour des rôles étonnamment forts. «Quand on est acteur on signe un contrat d’amour avec un metteur en scène, qu’il soit homme ou femme, qu’on forme un couple ou pas, peu importe, il y a cette joie d’élever une partie de soi vers un ailleurs, vers soi-même aussi, mais unis dans un mystère, qu’on découvrira plus tard. Ne pas se méprendre : je sais très bien quels abus sont susceptibles de générer ce pacte, quelles impostures aussi. On développe une intuition de plus en plus fine du seuil à ne pas laisser franchir. J’ai dû apprendre à dire non, à reconnaître ce que je devais quitter. «Quand la jeune actrice, mutante, hésitante se donne à travers un rôle, elle se tend vers son réalisateur pour avoir son approbation. Entière, elle est à lui, à elle-même, au monde. Cette demande de la jeune actrice ne donne-t-elle pas l’illusion au cinéaste que tout est pour lui ? N’a-t-il pas perçu que cet extrême désir de l’actrice en cache un autre, qui n’est pas forcément charnel, mais invisible, intouchable, un désir d’absolu qui le dépasse et la dépasse ? Peut-être se joue un nouvel horizon, un désir de connaissance, une consécration qui échappe, par une grâce inexplicable. Il ne voit pas encore l’artiste dans l’actrice. Il croit l’actrice instrument de possession. Il ne voit pas encore une égale. Faire le chemin ensemble, unis dans l’œuvre, est long, ardu et parfois si simple. Si par bonheur on trouve ce chemin, on se dit que rien n’est plus beau.» Légende photo : Juliette Binoche à Paris, le 17 avril. (Jérôme Bonnet/Modds pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 15, 2024 12:18 PM
|
Par Callysta Croizer dans La Croix - 15 avril 2024 Dix ans après sa création au Théâtre du Chêne noir, à Avignon, Andréa Bescond reprend « Les Chatouilles » au Théâtre de l'Atelier. Seule en scène, la comédienne-danseuse raconte l'horreur d'un viol pédophile et ses séquelles, avec une énergie sans faille et un humour cathartique.
Créé au Chêne noir d'Avignon en 2014, « Les Chatouilles ou la danse de la colère » a d'abord été adapté au cinéma. Dix ans, un Molière et deux Césars plus tard, le seule-en-scène d'Andréa Bescond n'a (hélas) pas pris une ride. Au Théâtre de l'Atelier, dans la mise en scène d'Eric Métayer, la danseuse comédienne replonge dans le récit d'Odette (son quasi-double fictionnel) pour exorciser un traumatisme de viol par la danse et le rire. Ce titre enfantin de « Chatouilles » renvoie, non pas à d'innocents jeux tactiles, mais bien aux manipulations d'un adulte pédophile. En l'occurrence, Gilbert profite de ses visites chez un couple d'amis pour retrouver Odette, 8 ans à peine, en cachette dans la salle de bains. Pour échapper à la douleur de ces rendez-vous interdits, la jeune fille se sauve dans et par la danse, les shots et les rails de coke. Devenue jeune femme, elle veut recoller les morceaux de son enfance et renouer avec sa mère, emmurée dans le déni. Au fil des allers-retours entre souvenirs, séances de thérapie et fantasmes, Andréa Bescond donne corps et voix à une vie de tabous. Exutoire salutaire Avec ses jeux de lumières et ses transitions rythmées, la mécanique du spectacle est d'une précision impeccable. Du gala de danse du village aux tournées mondiales des comédies musicales, Odette danse sur « Coppélia » et sur « Mamma Mia » comme il lui chante. Dans cette odyssée intérieure où l'imagination ne souffre d'aucune limite, Andréa Bescond prend tous les rôles à bras-le-corps. Passant d'un personnage à l'autre avec une fluidité et une énergie brillantes, elle maîtrise aussi bien le phrasé occitan de la prof de danse que le verlan de Manu, le pote alcolo-toxico d'Odette. Entre sketch et confessions, la comédienne et féministe engagée met aussi le doigt sur des stéréotypes qui infusent le monde de l'art chorégraphique. Assignations genrées, hypersexualisation des corps, précarité des contrats, autant de violences qu'elle traverse par ses gestes convulsifs et contorsionnés. Face à ces sujets lourds, l'autrice a su trouver un subtil équilibre entre une ironie mordante et irrévérencieuse, et une pudeur tout en délicatesse. A l'évocation des agressions traumatisantes lors du procès de Gilbert, ses mots restent muets tandis que la musique et la danse prennent le relais. Entre la création et la reprise actuelle, #MeToo et #BalanceTonPorc sont passés par là. Aujourd'hui, son texte entre en résonance avec les voix qui ébranlent le monde du cinéma et évoque les affaires de violence policière et judiciaire. En une décennie, Andréa Bescond a fait des « Chatouilles » un exutoire salutaire et poursuit son chemin de résilience, main dans la main avec son enfance. LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE d'Andréa Bescond. Mise en scène d'Eric Métayer. 1 h 40. Jusqu'au 1er juin, au Théâtre de l'Atelier (Paris). theatre-atelier.com Callysta Croizer / LA CROIX

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 6, 2024 7:10 AM
|
Par Faustine Kopiejwski dans Les Inrocks - 2 février 2024 Dans un premier livre sidérant, “Notre silence nous a laissées seules”, l’actrice, comédienne et chanteuse lyrique Judith Chemla livre le récit des violences conjugales qu’elle a subies. Et éclaire les mécanismes les plus sombres de l’âme humaine, ainsi que de la société. Le premier livre de Judith Chemla est un chemin. Un chemin vers la lumière et vers la vie, d’abord, pour celle dont le visage tuméfié s’est affiché sur Instagram un 4 juillet, en 2022, révélant les violences subies un an plus tôt au sein de son couple. Dans Notre silence nous a laissées seules, qui vient de paraître chez Robert Laffont, Judith Chemla raconte : deux relations conjugales consécutives violentes (l’autrice a souhaité anonymiser les protagonistes, qu’elle désigne par “Le Prince” et “Le Loup”), aussi bien physiquement que psychologiquement, qui l’ont vue mourir un peu, avant qu’une sage-femme ne lui annonce, au cours d’un avortement, sa propre (re)“naissance”. L’amour qui n’en est pas, le mécanisme infernal de l’emprise, la sidération, les rechutes, l’aliénation, l’impuissance de la justice, l’incapacité de la société à protéger les mères et les enfants, l’impunité des agresseurs. Mais aussi l’extrême consolation de l’art, la bienveillance qui répare, la sororité qui panse, la maternité qui exige. Au cours de ces trois cents pages, dont le style lyrique du début se dépouille progressivement pour laisser place à la puissance crue des faits, Judith Chemla parcourt également un chemin de la fiction vers la réalité, tout en questionnant sa place de créatrice et de femme dans la société. Le récit d’un éveil féministe et un témoignage puissant, sidérant souvent, qui transcende la matière noire. Vous relatez dans votre livre, parfois de manière très précise, les faits de violence physique et psychologique que vous avez subis. Ces faits, quand avez-vous commencé à les décrire et dans quelle optique ? Judith Chemla – Ceux qui concernent ma première relation violente sont ceux qui m’ont marquée. Il ne s’agit pas d’un inventaire : je ne raconte pas tout. S’ils se sont imprimés comme ça dans ma mémoire, c’est qu’ils m’ont impactée, saisie et, sur le moment, sidérée. Au départ, j’ai voulu continuer ma vie sans m’appesantir sur ces événements, en les transcendant par l’art, la résilience. C’est au cours de la deuxième relation violente que j’ai réalisé que je n’étais pas sortie de ce cercle. Dans la dernière année de calvaire, de harcèlement, j’écrivais quasiment tous les jours pour m’en sortir, pour comprendre. L’écriture était ma seule façon de tracer une ligne entre les événements qui m’accablaient et la vie vers laquelle je tendais, une vie dans laquelle je pourrais enfin respirer. Pour cette seconde partie du livre, j’avais donc beaucoup de notes de faits très précis, plus d’éléments, des photos, des vidéos, des papiers, des audios de scènes terribles que j’ai enregistrées pour me protéger. “Ce trajet-là m’a appris que l’amour, ce n’est pas tout accepter jusqu’à se faire broyer” Chacune de vos deux histoires commence par un faisceau d’avertissements que vous avez ignorés. Certains signaux vous alertaient du danger à vous engager dans ces relations, mais vous l’avez fait quand même. Avec le recul, comprenez-vous pourquoi vous avez muselé votre instinct ? Au début de ma première histoire, mon instinct m’alertait, en effet. Mais j’ai choisi d’aller dans les bois, de faire l’expérience. À l’époque, j’étais très mal informée. Je n’étais pas du tout au fait de la lutte des femmes pour exister à travers l’Histoire. Je croyais complètement au récit de l’égalité des sexes, à ma liberté. Pour moi, elle était acquise. C’est pour cela que c’est si important de savoir d’où l’on vient. Et puis, je me sentais très puissante aussi, comme on se sent avec l’amour. L’amour nous donne beaucoup de force, on est capable de tout. Mais aimer, ça s’apprend. Ce trajet-là m’a appris que l’amour, ce n’est pas tout accepter jusqu’à se faire broyer. Vous écrivez qu’à l’époque de votre première relation, avec celui que vous appelez Le Prince, vous vous sentiez “chanceuse de vivre avec un génie”. Cette admiration pour l’artiste a-t-elle été la condition de votre emprise? Elle l’a été, aussi, car mon émerveillement pour son œuvre était sans borne, mais pas seulement. La culture de l’amour romantique, cette image usée de la femme transie, abandonnée, qui nous est répétée, rabâchée, était très prégnante en moi. J’ai l’impression que c’est structurel, ce fantasme de l’accomplissement à travers l’amour d’un homme, c’est hallucinant à quel point on nous vend le modèle du couple comme réussite sociale. On ne valorise pas le fait d’être une aventurière de sa propre vie : ils sont rares, les modèles de femmes libres ! On en a pourtant plus que jamais besoin aujourd’hui. On a besoin de se construire avec des figures féminines fortes qui ne soient pas forcément déchirées par l’amour ou le manque d’amour. Sinon, pour peu que l’on ait des failles affectives, on n’apprend pas bien à tenir debout par soi-même. C’est tellement puissant ce sentiment amoureux, ça comble tellement, que c’est un vrai piège aussi. Avez-vous adhéré par le passé à ce mythe du génie dont les débordements sont nécessaires à la création ? Non. J’ai toujours su, en ce qui concerne celui que je nomme Le Prince, qu’il n’avait pas besoin de ça pour être génial. J’espérais qu’il comprenne qu’il pouvait être cet artiste fantastique tout en se départissant de ses accès de cruauté, car moi, j’en étais persuadée. Penser que si l’on renonce à nos pulsions destructrices on va perdre quelque chose, vraiment, je n’y crois pas une seconde et il me semble que ça mérite d’être déconstruit de toute urgence, car l’attachement à cette fausse croyance nécrose les artistes. Chez moi, la possibilité de l’emprise s’est ancrée à d’autres endroits, mais pas à celui-là. Vous dénoncez en creux la complicité qui se met en place autour des hommes violents : celle des collaborateur·ices, ami·es, celle des parents. S’agit-il d’un déni généralisé ? En ce qui concerne le milieu professionnel, c’est un réseau complexe car tout le monde voit, mais tout le monde subit. L’écrasement des autres, au fond, personne n’en jouit vraiment. Tout le monde est un peu désolé mais personne ne sait quoi faire. Personne ne se sent le droit de dire que c’est intolérable. Au pire, les gens partent les uns après les autres. Ce sont des choix personnels à chaque endroit. Mais, maintenant, cela tend vers autre chose. Si l’on arrive à s’emparer de ce mouvement, chacun va se sentir autorisé à se dire que même au travail, certaines situations sont intolérables. Le plus grand déni, aujourd’hui, réside pour moi dans les familles et se retrouve dans la société au niveau politique et institututionnel. Sauver ce qui brille et couvrir ce qui est laid. C’est un réflexe de préservation, comme si on allait pouvoir ne retenir que le beau. Mais non, ça fout tout en l’air en fait, de ne pas oser dire que même pour tel grand artiste, ce comportement est intolérable. Que c’est non. Ce déni-là, il crée de la folie, la perpétuation des violences et une société malade, car ce sont des réalités parallèles qui se creusent, une schizophrénie qui se développe. On est obligé de se raconter des histoires dans lesquelles les responsables deviennent les victimes. “C’est une stratégie de survie de l’agresseur. Retourner la culpabilité, nier et attaquer en retour” Dans l’histoire de celui que vous appelez Le Loup, justement, ce motif revient sans cesse : il se fait constamment passer pour la victime… Ça, c’est un sujet majeur. C’est partout et tout le temps. La défense de l’agresseur est ingérée partout, dans tous les recoins de notre société. Nos institutions ont du mal à se départir de cette inversion des responsabilités chère à ceux qui veulent conserver ce pouvoir d’écraser dans l’intimité. Je reçois des témoignages par centaines et quel que soit le milieu social, la culture, c’est un systématisme, un modus operandi. C’est une stratégie de survie de l’agresseur. Retourner la culpabilité, nier et attaquer en retour. Le pire, c’est que ça marche! Ça marche un temps avec les victimes, qui pensent être responsables du mal qu’on leur fait. Elles subissent le dénigrement, l’écrasement de leur dignité, se prennent des coups, mais c’est quand même de leur faute. Et ensuite, si elles osent dénoncer, la pauvre victime devient celui qui va en garde à vue, qui est jugé, qui est mis en lumière publiquement. Mais on n’aurait pas à mettre publiquement en lumière les agresseurs si la justice pouvait vraiment faire son travail. Si les tribunaux n’étaient pas surchargés, si 80 % des plaintes n’étaient pas classées sans suite, si la chaîne pénale était mieux formée à ces violences de l’intime, il n’y aurait pas de “tribunal médiatique”. On pourrait enfin vivre notre vie tranquille. On pourrait enfin “parler d’autre chose”, comme le dit Lola Lafon. En 2017, année de #MeToo, vous avez déjà vécu une première relation violente et vous mettez votre fille au monde. Dans votre livre, le mouvement ne résonne que comme un écho lointain. Comment l’avez-vous vécu au départ ? C’était très loin de moi, en effet. Les personnalités avec lesquelles j’ai vécu m’empêchaient totalement, par leur pensée, d’être une féministe – même si c’était aussi un manque de culture de ma part à l’époque. J’étais conditionnée à “faire la part des choses”, respecter la “présomption d’innocence”, à m’apitoyer sur “les pauvres hommes accusés qui ne pourront plus jamais travailler”. Des années plus tard, je comprends pourquoi. Il y avait une telle peur que ce qui est dans la sphère privée, intolérable, surgisse dans la sphère publique. Désormais, le dénigrement de la pensée féministe est pour moi un red flag total. Votre éveil féministe vous semble-t-il correspondre, cinq ans après #MeToo, à celui de l’ensemble de la société ? Le vieux monde réactionnaire dit sa peur de se voir guillotiné par les féministes radicales mais, si l’on regarde bien, combien d’affaires y a-t-il ? Au-delà de celles qui sont emblématiques, très peu, finalement. Les femmes ont peur, elles préfèrent tout faire pour d’abord réussir leur vie, leur carrière. Personne ne gagne jamais à s’exposer de la sorte. C’est très lourd et cela, les femmes le savent. Dans l’image publique, cela les enferme, les assigne à une place de victime. Personne ne désire cela. Ça ne rapporte pas non plus d’argent, au contraire. Les procédures judiciaires nous saignent, littéralement. On n’a pas les moyens. On le fait par survie, et quand on en a la capacité, mais on est peu à pouvoir aller au bout. Tant vivent encore dans l’injustice, tant sont écrasées, condamnées à survivre dans le danger. Les stigmates des violences subies dans le secret des familles abîment les êtres à vie, et corrompent des générations futures si on garde le silence. Ce qu’il faut bouger, au-delà des consciences, ce sont nos institutions. Et pour l’instant, ça ne bouge pas. Pourquoi, d’après vous ? C’est une question de volonté politique. On a beau dire que c’est la grande cause du quinquennat, ce n’est pas parce que l’on dit quelque chose qu’on l’a fait. Là, ce serait même l’inverse, d’ailleurs : on fait des annonces POUR ne pas faire les choses. C’est complètement schizophrénique. On met en place la CIIVISE (Ndlr : Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) pour ne pas appliquer ses préconisations. On dit qu’on va protéger les enfants pour ne pas le faire. C’est ça, la réalité. Aujourd’hui, il n’y a plus de secrétariat à l’Enfance. Le juge Durand a révélé l’ampleur des dégâts, des failles judiciaires, des dossiers qui sont traités n’importe comment et qu’est-ce qu’on fait ? On le vire, on essaie d’étouffer ses révélations. On ne peut pas vivre dans ce monde-là, dans ce monde à l’envers. On sent que le sujet des violences faites aux enfants vous porte aussi beaucoup, notamment à la fin de votre livre… Oui, beaucoup de femmes qui vivent des violences sont des mères. Et les violents conjugaux ne se transforment pas en pères responsables en un coup de baguette magique. Le titre de votre livre déplore en creux la solitude des femmes victimes de violence, et votre récit rend hommage à toutes celles, victimes ou non, qui vous ont tendu la main. La bienveillance entre femmes est-elle l’une des clefs pour lutter contre les violences patriarcales ? Absolument. Pour moi, c’est l’autre monde que le patriarcat a étouffé. Ce sont nos forces vives et réelles, c’est un tissu différent. C’est la matière du monde non-violent, elle est entre nos mains. On est en train de le créer en se parlant, de le retisser en se reconnaissant, en étant des alliées, en s’écoutant, en se tendant la main, en se rassemblant, en se sentant responsables les unes et les uns des autres. Car, ce qui est très beau aussi, c’est de voir des hommes sensibles à cette nécessaire transformation du monde. Des alliés masculins qui désirent vivre dans le respect. Vous avez vécu des violences visibles et d’autres pas. Les violences psychologiques, invisibles, sont-elles pour vous l’angle mort de la lutte contre les violences conjugales ? Oui, et elles sont souvent pires car on croit que, comme les bleus qui disparaissent, l’esprit se régénère. Moi, j’ai une grande force de résilience et de régénération mais quand on se régénère et qu’on oublie, cela creuse des sillons d’acceptation de plus en plus dangereux. “J’ai repris vie par le fait de formuler des phrases, de chercher le sens, de questionner” Ces sillons sont-ils colmatés aujourd’hui ? Le chemin intellectuel que vous avez parcouru vous protège-t-il ? Oui, écrire m’a permis de retourner sur les lieux, de décoller mon corps encore englué dans ces situations et de remettre de la vie là où il n’y en avait plus, là où j’avais fait silence. De faire retentir un peu ma voix dans ce passé-là. J’ai repris vie par le fait de formuler des phrases, de chercher le sens, de questionner, de frapper aux portes de ces moments de ma vie, de me harnacher à mon propre pouvoir pour en sortir vraiment. C’est gigantesque d’écrire, c’est un acte extrêmement puissant. Comme je le dis dans le livre, je me suis beaucoup nourrie de fiction, de beauté, de la création d’autres mondes. Le monde réel, jusqu’ici, je ne me le coltinais pas trop. C’est ça, qui m’est arrivé ces dernières années. Ce chemin est douloureux et laborieux, mais c’est une grande vitalité retrouvée pour moi. Et cela me permet de sentir que le reste de ma vie, je vais vraiment l’inventer. Votre parcours s’est-il accompagné de lectures ou d’œuvres qui vous ont aidée ? Oui, bien sûr. J’ai enregistré dernièrement un livre audio de Phyllis Chesler, Lettres aux jeunes féministes, tellement limpide dans le récit de son réveil et de ses expériences de lutte. Le livre de Titiou Lecoq, Les Grandes oubliées, m’a beaucoup éclairée. J’ajouterais Défendre les enfants, du juge Édouard Durand, et Réinventer l’amour, de Mona Chollet. Femmes qui courent avec les loups, de Clarissa Pinkola Estés, m’a vraiment permis de reconstituer mes forces de l’intérieur lors de ma première relation. Mais c’était à double tranchant, car ce livre m’a convaincue un temps que tout se jouait à l’intérieur de moi-même, que j’allais régler les choses de l’intérieur, ce qui est vrai quelque part… Mais parfois, il faut juste se barrer (rires) et exiger une société moins violente. Et puis Impunité, le livre d’Hélène Devynck, que j’ai par ailleurs rencontrée, a aussi nourri mon trajet. Parce que c’est dur d’oser parler de soi. C’était dur d’oser accepter cette proposition de l’éditrice. C’est parce que j’ai vu que ça rejoignait l’histoire de tant de femmes que j’ai compris que mon récit révélé dans l’espace public pouvait avoir un sens. Après ce retour forcé au réel, la fiction peut-elle être de nouveau un champ d’exploration, un endroit où transformer ces histoires? Retourner à l’imaginaire, à la fiction, voilà ce à quoi j’aspire, évidemment. Parce qu’avant tout, je crois à l’art. Je crois aux pays imaginaires, à nos pays intérieurs et je crois qu’ils sont vastes et qu’on doit leur donner des espaces nouveaux. Il faut se confronter au réel, réussir à le voir tel qu’il est, et puis il faut des espaces d’invention immenses en nous, aussi. C’est vital et c’est ce qui fera un monde sain. C’est aussi pour ça que j’ai fait ce livre, c’est mon rempart. Maintenant, je veux être protégée et pouvoir créer, inventer de nouveaux mondes. Pour impacter le monde réel. Et faire surgir de la beauté. Notre silence nous a laissées seules de Judith Chemla, Robert Laffont, 368 p., 21 euros

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 14, 2024 12:32 PM
|
Publié par Libération le 14 mars 2024 «Libération» publie in extenso le discours prononcé ce jeudi par l’actrice, auditionnée par les délégations aux droits des enfants et aux droits des femmes de l’Assemblée nationale. Elle demande une commission d’enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma. par Judith Godrèche, Actrice, réalisatrice prononcé à l'Assemblée nationale le 14 mars 2024 «Merci de me faire l’honneur de me recevoir aujourd’hui et d’avoir convié à cette même table, la délégation aux droits des enfants et la délégation aux droits des femmes. Ces derniers jours, alors que je me préparais à cette audition, et que j’essayais de rassembler mes pensées pour venir vous exposer avec le plus d’éloquence possible mon humble vision de la société dans laquelle j’évolue, je me suis surprise à répéter ces mots à haute voix. Les Droits des Femmes. Les Droits des Enfants. Leur fort pouvoir évocateur guidait la construction de mes pensées. Mais, comme un jeu de chaises musicales, la phrase évocatrice que je murmurais en boucle a perdu des mots en chemin. Va savoir pourquoi. Mon inconscient a pris la liberté de faire un drôle de tri, en perdant en route les deux premiers mots qui définissent vos délégations : les droits. Dans ma tête à moi, comme dirait la petite fille que je suis. Ne résonne que les mots : femme et enfant. Tout seuls. Isolés. Dans le silence. Curieusement ce tour de passe-passe imposé par mon cerveau taquin, la disparition symbolique de ces mots, incarne parfaitement mon propos. Cette solitude qui est la mienne et celle de milliers qui m’écrivent. Un jour, des hommes sont partis en voyage loin, loin, loin avec ces mots-là. En effet, je ne suis toujours pas en mesure d’affirmer que des hommes n’ont pas tous les droits sur nous. Et a fortiori tout le pouvoir. Puis pour aller plus loin dans cette pensée : le pouvoir, les gouvernements et le patriarcat ne font qu’un. Et la petite fille que j’étais, devenue la femme qui se trouve devant vous aujourd’hui est encore à la recherche d’un équilibre, de la preuve absolue de cette égalité dont nous parlons tant. Cette égalité dans le pouvoir. Ne me croyez pas ingrate, je célèbre moi aussi le progrès, les avancées, les victoires. Avec passion et optimisme. Je danse de toutes mes forces avec mes sœurs anonymes quand une loi qui nous protège est votée. Mais soyons honnêtes : quand, encore aujourd’hui un homme balaie si facilement du revers de la main la parole d’un enfant qui se confie à la société dans l’espoir d’être entendu, quand un autre homme puissant viole inlassablement des mineures en toute impunité, quand les non-lieux se suivent et se ressemblent, quand la société du cinéma agresse, manipule et sadise les enfants depuis des décennies – tout cela devant un parterre d’aficionados conquis et silencieux – en pleine béatitude, sans l’ombre d’une révolte, d’un dégoût, d’un sursaut… Quand on s’adresse à des techniciennes comme à des sous-fifres, quand elles se font maltraiter et hurler dessus : ou puis-je trouver ces deux mots perdus en chemin : «les droits». Les droits. Les droits des femmes. Les droits des enfants. Le droit de dire non. Peut-être est-ce les sévices subis dans mon enfance par des réalisateurs adorés par l’intelligentsia française qui m’ont incapacité. Qui ont rendu impossible la possibilité d’inscrire ma confiance en un monde régenté par des adultes, qui, en ce qui me concerne, dans l’univers du cinéma, n’ont fait justement qu’abuser de cette même confiance pure et innocente que je plaçais en eux. La société incestueuse du cinéma n’est que le reflet de notre société. Les mêmes mécanismes sont à l’œuvre… Comme l’écrivait le psychanalyste Sandor Ferenczi dans son article «Confusion de langue entre les adultes et l’enfant», le plus souvent l’adulte abuseur n’est pas un inconnu pour l’enfant. C’est une personne de confiance, son père, son éducateur, son réalisateur… Lors d’une agression, le premier mouvement de l’enfant serait le refus, la haine, le dégoût, une résistance violente : «Non, non, je ne veux pas, c’est trop fort. Ça me fait mal, laisse-moi !» Ceci, ou quelque chose d’approchant, serait la réaction immédiate si celle-ci n’était pas inhibée par une peur intense. Les enfants se sentent physiquement et moralement sans défense, leur personnalité encore trop faible pour pouvoir protester, même en pensée, la force et l’autorité écrasantes des adultes les rendent muets, et peuvent même leur faire perdre conscience. Cette opération est coûteuse. L’enfant est plongé dans un état quasi hallucinatoire. La réalité est modifiée afin que l’enfant puisse maintenir la situation de tendresse antérieure. C’est-à-dire que l’adulte ne passe pas pour un agresseur à ses yeux. Ainsi l’enfant peut rêver un adulte tendre à son égard. Moyennant l’identification, l’enfant s’approprie la culpabilité de l’adulte. Il pense que sa soumission mérite punition. Cela produit des enfants savants qui adoptent très facilement un rôle maternel à l’égard des adultes. Ils deviennent de véritables nurses à leur tour. Il s’opère alors un clivage (un split) de la personnalité de l’enfant qui, d’une part, maintient son besoin de tendresse antérieur et, d’autre part, acquiert la langue de l’adulte et sa culpabilité. A ce sujet, Ferenzci parle de «fragmentation» et d’«atomisation» de la personnalité de l’enfant. Tout cela je l’ai vécu. L’amnésie de la victime peut être longue. Comme je l’ai souvent dit ces derniers temps, moi, Judith, 51 ans, actrice réalisatrice et mère de deux enfants, j’ai passé toute ma vie, depuis mes 14 ans, à repeindre la chambre en rose. Un réalisateur puis un autre firent de moi leur objet. Ils se disputaient l’enfant «Judith». Et tout autour de nous, dans ce monde d’érudits, de savants et de génies, le silence. La permissivité de la société. La sacralisation de ces auteurs faite par les journalistes de cinéma. Par les acteurs et actrices adultes. Des livres entiers les encensent. Les avez-vous parcourus ces livres ? Oui je comprends, cela semble être une question étrange, ou naïve peut-être, mais nécessaire pour illustrer ce déni sociétal collectif qui assure l’impunité des agresseurs. La société cultivée, capable de lire Gilles Deleuze et de le comprendre, ne sait pas interpréter les interviews de ces réalisateurs ? En tirer des conclusions sur leur humanité ? La société du cinéma a perdu la mémoire, la vision, l’ouïe. Mais, une fois encore, il suffirait de quelques-uns, parmi les puissants pour «autoriser» les autres à recouvrir la mémoire, la vision, l’ouïe. Donner l’exemple – dans notre société, dans le gouvernement – nous ne sommes pas tous des Martin Luther King mais pouvons-nous au moins rendre leur image aux enfants fantômes. Ceux qui s’éteignent comme autant de petites filles aux allumettes. Qu’avez-vous fait du juge Edouard Durand ? Je ne suis pas allée à l’école très longtemps mais je sais, que lorsqu’un réalisateur se vante de se nourrir de l’histoire intime des enfants, «glamourise» le viol ou l’inceste, dévalorise la possibilité du «non», il y a un problème. Que faisaient les érudits, les savants, les journalistes, les directeurs de cinémathèque et autre filmothèque, les ministres de la Culture, les festivals, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), pendant tout ce temps ? Les dîners mondains, les soirées arrosées au champagne, les échanges de bons mots, les citations de Cioran et d’Althusser, l’entre-soi, nous savons faire. Quid de la morale ? De notre sens des responsabilités ? Plus on transgresse, plus on est invités ? Tiens, il y en a même dont le nom est inscrit en doré sur le porte-serviettes… Alors que tout le monde savait. Comment dans ce contexte-là imaginer que les bouches des petites filles, des jeunes femmes, des jeunes hommes abusés puissent bouger pour exprimer autre chose que : pas de problème. Oui j’ai compris. Je me tais. Que contiennent les souvenirs des petites filles et petit garçons dans le silence ? Des choses assez équivalentes que ce que vous pouvez voir dans les pages de ces livres sur ces réalisateurs que vous devriez feuilleter de nouveau. Récemment une inconnue bienveillante m’envoie une photo d’un livre sur un réalisateur avec qui j’ai travaillé. Les personnes qui ont publié ce livre ont cru bon d’inclure à droite de l’éloge que fait de lui le producteur de la Désenchantée, une photo de moi, nue, face caméra, à 17 ans. Pourquoi ? Je vous parle aujourd’hui et c’est comme si tout recommençait ou tout était à inventer. Combien d’aujourd’hui vont devoir se succéder pour que la société regarde les choses en face ? Dans les rues de Paris, je marche le 8 mars, des jeunes filles, des femmes plus âgées, se précipitent vers moi, me remercient, pleurent. Ont-elles aussi été abandonnées par la société ? Elles me serrent dans leur bras avec l’énergie d’un espoir : attendaient-elles la prochaine voyageuse privilégiée qui ose parler publiquement ? Celle qui, dans le rayon de lumière de la notoriété, a le privilège de pouvoir parler de l’ombre. Oui, je suis privilégiée. Un privilège que j’ai décidé d’utiliser dorénavant à bonne fin. Quand j’étais petite je me disais souvent, c’est pas grave, je ferais ça dans ma deuxième vie. Cette chose-là, je ne peux pas la dire. Je la dirais dans ma deuxième vie. Il n’y a pas de deuxième vie. C’est ici et maintenant. Le choc, les larmes, la bataille, la possibilité de ne plus travailler, être haï par le milieu, le réalisme des procès en diffamation, tout cela n’a rien d’enviable. Mais, ce n’est rien comparé à la peur des jeunes actrices, des enfants acteurs laissés seuls dans des pièces avec des directeurs de castings rabatteurs, des agents pour enfants sans licence – non obligatoire – des réalisateurs tout-puissants qui volent l’intimité, l’endroit de l’histoire d’une enfant qu’elle n’a pas envie de partager lors d’un rendez-vous avec un étranger, mais que le réalisateur pille encore et encore pour nourrir ses scénarios… Certains adultes se livrent dans notre société à la négation pure et simple des conduites incestueuses. Le silence de l’entourage de la victime est une négation des faits pour l’enfant. De la même manière, sur qui doit-on compter pour s’assurer dorénavant qu’aucun enfant ne sera victime de violence sexuelle ou morale sur un plateau ou lors d’un casting ? Allons-nous garder le silence ? Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous pour protéger les enfants, ne plus les livrer au cinéma sans aucune protection. Mais vous savez. Ce sont les mêmes hommes. Les mêmes systèmes. Que ceux de l’éducation, de la médecine, de l’édition, du sport par exemple, pour lequel vous avez ordonné une commission d’enquête. Vous savez ce que fait le pouvoir aux femmes. Il les viole. Les enfants ? Ils en disposent comme ils veulent. Parlons concrètement : Un directeur de casting est un homme ou une femme qui peut du jour au lendemain décider d’être directeur de casting. Il peut être le meilleur ami du réalisateur, sa meilleure amie. Il ou elle se trouve la plupart du temps seul dans une pièce avec un enfant. Un enfant seul face à cette autorité, cette promesse d’un rôle, cette excitation dans la famille : «Tu vas passer des essais tu te rends compte ? Tu pourrais être comme telle ou telle star que tu aimes !» Une petite fille à qui on demande de raconter sa vie – pourquoi ? Est-elle chez son psy ? Non… qui sont ses étrangers qui veulent tout d’elle ? Elle se sent obligée. Et si elle n’avait pas le rôle ? Et si elle n’était pas choisie ? Elle serait déçue. Sa famille serait déçue. Ses copines seraient déçues. Quelques jours plus tôt dans la même pièce, une jeune femme majeure s’est retrouvée dans la même situation, pas de texte, pas de dialogues : donne-nous toi. Qui es-tu ? Parle-nous de ta sexualité ? As-tu un petit ami ? Suivant les réponses, la fragilité, un homme est appelé. Parfois il est déjà là. Parfois il est déjà trop tard. Ensuite il est encore trop tard. L’emprise. L’autorité. La peur. Mais je ne vous apprends rien, nous le savons depuis des décennies. En grandissant, je me pensais mauvaise, sale, coupable. Je sais maintenant que je n’ai rien fait. Mais la société est coupable parce qu’elle les adule, parce qu’elle les soutient, parce qu’elle les protège. Notre société et ces hommes-là. Pour finir je vais vous lire le Petit Chaperon rouge, la version de Perrault donne la clef de cette métaphore très ancienne de la dévoration d’un enfant par un loup, avec vérité et subtilité. «… On voit ici que les petits enfants, Le plus souvent des jeunes filles, Belles bien faites et gentilles Font très mal d’écouter toutes sortes de gens Et que ce n’est pas chose étrange S’il en est tant que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups Ne sont pas de la même sorte : il en est d’une humeur accorte, Sans bruit sans fiel et sans courroux, Qui privés complaisants et doux, Suivent les jeunes demoiselles Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ; Mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux.» Je vous demande de prendre l’initiative d’une commission d’enquête sur le droit du travail dans le monde du cinéma et en particulier sur les risques pour les femmes et les enfants. Judith Godrèche Légende photo : Judith Godrèche à l'Assemblée nationale le 14 mars. (Boby/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 29, 2024 5:56 PM
|
Par Marine Turchi dans Mediapart - 29 février 2024 Auditionnée jeudi, l’actrice et réalisatrice a réclamé une commission d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes dans le cinéma, mais aussi le retrait de Dominique Boutonnat, qui doit être jugé pour « agression sexuelle » sur son filleul.
« Comme vous pouvez le voir, je n’ai pas grand-chose à perdre. » Auditionnée jeudi 29 février par la délégation des droits des femmes du Sénat, Judith Godrèche a usé de la tribune qui lui était à nouveau donnée pour livrer un discours coup de poing et des propositions pour lutter contre les violences sexuelles dans le monde du cinéma. Près d’une semaine après avoir confronté cette industrie à son silence face aux violences sexuelles, lors de la cérémonie des César, l’actrice et réalisatrice a demandé l’ouverture d’une commission d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, mais aussi le retrait du président du CNC (Centre national du cinéma), Dominique Boutonnat, qui doit être jugé prochainement pour « agression sexuelle » sur son filleul. « Je vous parle ici mais je suis nombreuse, ou en tout cas soutenue », a-t-elle assuré. Devenue l’un des visages du mouvement #MeToo en France, et notamment de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants depuis qu’elle a porté plainte pour « viol sur mineure » contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon, Judith Godrèche a affirmé qu’elle s’exprimait forte des 4 500 témoignages reçus sur l’adresse mail qu’elle a créée à cet effet. « Toutes ces femmes invisibles qui travaillent dans l’éducation, l’édition, les hôpitaux, toutes ces femmes qui m’écrivent et qui se posent la question de savoir si tous ces coups que je donne sur la porte vont finir par la faire céder », a-t-elle déclaré. « À travers l’incarnation du “je”, je leur donne la possibilité du “nous” », a-t-elle ajouté. L’actrice a aussi évoqué ses nombreux échanges « avec des productrices, des sociologues, des juges, des activistes, des jeunes femmes qui s’intéressent à la société et au monde, des avocates, des journalistes ». Parmi eux, le juge Édouard Durand, ancien dirigeant de la Ciivise (commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants), auquel elle a rendu un vibrant hommage, critiquant « cette décision de [le] retirer à la tête de la Ciivise pour la laisser choir sur le sable, mort-née ». En brandissant le silence du monde du cinéma, elle espère montrer qu’il est « le reflet de notre société ». « Cette famille incestueuse n’est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois », a-t-elle insisté, expliquant qu’aujourd’hui, la société française était « systématiquement organisée autour de l’écrasement de la parole ». Durant cette audition de deux heures, Judith Godrèche a fait une série de propositions concrètes. Outre la création d’« une commission d’enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma », elle demande d’« imposer un référent neutre » auprès des mineur·es sur les tournages, qui soit « formé », et « pas payé par la production », afin « qu’un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage » et qu’il ait « sa personne » à lui, un « représentant », un « médiateur ». Elle réclame aussi la présence, sur les plateaux, d’un « coach intimité pour les scènes qui impliquent de l’intimité, de la sexualité », et d’un « un coach de jeu », « car, oui, ça fait peur de se retrouver dans des scènes face un adulte qui vous crie dessus », a-t-elle cité en exemple. Enfin, elle souhaite la mise en place d’un « système de contrôle plus efficace et un suivi par la Ddass », qui, une fois l’autorisation accordée pour que l’enfant de moins de 16 ans participe à un tournage, devrait se rendre sur le plateau pour s’assurer des conditions dudit tournage. L’actrice demande le retrait du président du CNC Mais, durant son audition, l’actrice s’est longuement arrêtée sur un point précis : le maintien de Dominique Boutonnat à la tête du CNC, malgré son renvoi devant le tribunal correctionnel pour « agression sexuelle » sur son filleul de 20 ans – des accusations qu’il conteste. Loin d’être suspendu, ce proche d’Emmanuel Macron (il fut un grand donateur de sa campagne présidentielle 2017) avait même été nommé, trois semaines après l’annonce de son renvoi, au conseil d’administration de France Télévisions, en tant que représentant de l’État. Ce qui avait provoqué l’indignation des syndicats de l’audiovisuel public. Jeudi, Judith Godrèche a exhumé une lettre adressée en 2021 à Emmanuel Macron par plusieurs syndicats et collectifs de la profession, qui demandait « une gouvernance refondée et relégitimée à la tête du CNC », et donc « la mise en retrait temporaire du président du CNC suite à sa récente mise en examen ». À LIRE AUSSI Affaire Dominique Boutonnat : ce dossier de violence sexuelle que Macron a choisi d’ignorer 14 novembre 2022 « Sans remettre en question le principe fondamental de la présomption d’innocence, ni la qualité du travail effectué avec Dominique Boutonnat depuis sa nomination, sa mise en examen va interférer dans les nombreux et importants chantiers sur lesquels nous travaillons actuellement avec le CNC », insistait ce courrier. Cette mise en retrait était réclamée conformément à la règle imposée initialement au gouvernement par le chef de l’État, mais aussi au principe « prôné par le CNC dans le cadre de la formation obligatoire des professionnels bénéficiant d’aides pour prévenir les violences sexistes et sexuelles ». « [Le CNC est] une institution dans laquelle se rendent les producteurs, tout en rigolant parce qu’ils se disent : “C’est drôle, je vais aller faire une formation sur les violences sexuelles et sexistes à l’intérieur d’une institution dont le président est lui-même accusé de violences sexuelles…” C’est quoi cette blague ? », a ironisé Judith Godrèche, réclamant elle aussi le « retrait de Dominique Boutonnat ». « Cette bataille est politique » L’actrice et réalisatrice a longuement expliqué que pour « pour que la parole des autres [les témoins – ndlr] se libère, il [fallait] qu’ils soient eux aussi protégés », qu’ils soient certains de ne « pas perdre leur travail ». « C’est une industrie dans laquelle on efface les gens [qui parlent], on les écarte », a-t-elle souligné, expliquant qu’une personne victime ou témoin de violences sexuelles et sexistes sur un tournage ne savait pas, aujourd’hui, vers qui se tourner et que les « témoins sont eux-mêmes en danger » s’ils sonnent l’alerte, car ils ont besoin « de continuer de travailler » pour gagner leur vie. Notamment parce que les référents harcèlement existant sur certains tournages sont le plus souvent des personnes liées à la production. « Le cinéma, c’est quand même un petit milieu, et si ce milieu tout entier ne décide pas qu’il faut justement, dès que quelqu’un signale quelque chose, donner la place, écouter et dire : “Je te crois, je t’entends et je ne vais pas d’évincer, je ne vais pas te demander de te taire pour faciliter la bonne continuation de ce tournage”, c’est normal que le jeune acteur, le technicien, le perchman, ou le monsieur qui travaille à la cantine, se dise : “Qu’est-ce que je fais si on me vire ? [...] Si je suis blacklisté, qu’est-ce que je fais ?” » Elle raconte avoir elle-même, malgré ses « privilèges » et son « statut », eu peur que sa série (Icon of French Cinema), qui relate son histoire, ne soit, en France, « mise dans un tiroir », « annulée » car perçue « comme une série #MeToo » et « un règlement de comptes ». « J’avais peur de m’inscrire dans un mouvement #MeToo dont, aux États-Unis, nous n’avions pas honte quand j’y vivais, mais en France, c’était très très mal vu, parce que ça vient avec le wokisme, parce que les militantes sont des hystériques », a-t-elle expliqué. « Alors imaginez ce que peut penser une jeune actrice, un technicien, une femme qui travaille dans une industrie dont elle n’est pas le CEO », a-t-elle ajouté. Aujourd’hui, elle assume une parole « politique ». « Non pas parce que je m’associe à un parti politique ou que je vais être récupérée par un parti politique, mais parce que cette bataille est politique, parce que mon militantisme [...] est politique, parce qu’aujourd’hui, avec de la pédagogie, on n’obtient rien. Avec des lettres polies, bien écrites, et signées par un groupe de gens importants, ils n’ont rien obtenu. » Dans cette « bataille politique », Judith Godrèche s’est décrite comme un simple « écho », « un yoyo qui clignote », et a rendu hommage à certaines de celles qui, avant elle, ont tenté de briser l’omerta : « Camille Kouchner, Adèle Haenel, Hélène Devynck, Vanessa Springora, pour ne citer qu’elles, “tout le monde savait”. [...] Combien de petites filles, de petits garçons, combien de petits pieds dans la porte seront nécessaires avant que cette société réagisse pour toujours ? Afin que nous puissions jouer les rôles de notre vie sans nous faire voler notre enfance, abuser, frapper. Sans que nous soyons réduites à un pâle souvenir, l’image douloureuse d’une jeune femme en robe noire pailletée, qui ressort aujourd’hui dans la presse, sur Internet. Elle est assise sur un canapé, un verre à la main. Adèle, où es-tu ? Adèle, quel aurait été ton destin si ce soir-là, la salle des César avait été peuplée de juges Durand ? » Légende photo : Judith Godrèche lors de son audition par la délégation des droits des femmes du Sénat, le 29 février 2024. © Capture d’écran Public Sénat

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 28, 2024 5:18 PM
|
Publié par Libération avec AFP- 28 février 2024 Ce roman, le seul qu’ait publié la comédienne, était paru en 1995 dans la foulée de sa séparation avec le réalisateur, contre qui elle a porté plainte début février pour viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans. Une réédition, sous forme électronique. Point de côté de Judith Godrèche, roman de 1995 qui racontait la fin d’une relation d’une adolescente avec un homme plus âgé, va être réédité par Flammarion. L’ouvrage, épuisé depuis de longues années, sera disponible à l’achat en ligne «dans les prochains jours». «Nous réfléchissons à l’idée de le republier», a par ailleurs ajouté la maison d’édition. Ce roman d’inspiration autobiographique, le seul publié par l’actrice, est sorti peu après sa rupture avec le réalisateur Benoît Jacquot, de vingt-cinq ans son aîné. Judith Godrèche, âgée de 22 ans à l’époque, mettait en scène Juliette, jeune cinéphile, qui au début de la vingtaine reprenait sa liberté. «C’est une fille qui a vécu très jeune avec un homme, qui est restée très longtemps avec lui, et qui peut-être n’a pas eu d’adolescence […] Elle n’a pas appris à être une femme», décrivait l’artiste dans l’émission «Le Cercle de minuit», sur France 2, en février 1995. Gifles, coups de ceinture et coups de poing La comédienne a porté plainte début février contre Benoît Jacquot, 77 ans, et un autre réalisateur, Jacques Doillon, 79 ans, pour «viol sur mineur de 15 ans». Elle avait tourné à 15 ans dans les Mendiants de Jacquot, sorti en 1988, début d’une relation dont elle a rendu publics des éléments longtemps tus, tels que gifles, coups de ceinture et coups de poing administrés par celui qui menait dans le même temps une carrière d’auteur estimé, enchaînant les longs métrages. Concernant Doillon, elle évoque durant le tournage de la Fille de quinze ans, plus de 45 prises où le cinéaste la «pelote» et lui «roule des pelles». Devenue depuis plusieurs semaines la porte-voix du monde du cinéma contre les violences sexuelles et sexistes qui y règnent, Judith Godrèche a dénoncé avec force lors de la cérémonie des Césars vendredi un «trafic illicite de jeunes filles». «Où êtes-vous, que dîtes vous ?», a-t-elle lancé à destination des acteurs. Sans obtenir beaucoup d’écho jusqu’à présent. Elle sera par ailleurs entendue au Sénat ce jeudi matin par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. A lire aussi L’anthropologue Pascale Jamoulle, spécialiste de l’emprise, explique pourquoi les adolescentes peuvent être des cibles pour les abuseurs et comment la «déprise» peut advenir. Pour elle, la dénonciation par l’actrice de l’aliénation exercée par Benoît Jacquot participe de son émancipation. «Benoît Jacquot pensait savoir mieux que moi qui j’étais et ce que je pensais.» Témoignant pour la première fois de sa relation avec le cinéaste, l’actrice Isild Le Besco évoque comme Judith Godrèche une relation d’emprise et des violences psychiques et physiques. Comment fonctionne l’emprise, cette terrible mécanique mise en lumière dans le Consentement de Vanessa Springora en 2020 ? Quatre ans plus tard, il est encore nécessaire de rappeler la «dépossession de soi» qui s’opère chez les victimes, comme l’attestent les propos de l’actrice Anny Duperey : «Six ans avec un réalisateur : sous emprise je veux bien, mais quand même consentante, non ?» L’anthropologue Pascale Jamoulle, qui a enquêté sept ans sur le sujet, tranche : «Dans ces relations, le consentement n’existe pas.» Dans le Hainaut belge, à Paris, en Seine-Saint-Denis et à Marseille, elle est allée à la rencontre de nombreuses personnes qui ont vécu longtemps dans la prison de l’emprise, au sein du couple, de la famille, du milieu professionnel… et qui s’en sont sortis. Son ouvrage Je n’existais plus. Les mondes de l’emprise et de la déprise (La Découverte) rend compte de ce travail immersif colossal qui révèle les traits structuraux de l’emprise. Après Judith Godrèche, Isild Le Besco a utilisé le terme d’«emprise destructrice» pour qualifier sa relation avec le réalisateur Benoît Jacquot. Comment cerner cette notion qui est très souvent mobilisée dans les affaires de violences sexuelles ? La notion d’emprise est imprécise, elle ne donne pas d’indication sur les rôles des abuseurs et des abusés ni sur les degrés d’emprise vécus. A Marseille, où j’ai étudié la vie d’un quartier sous la coupe de microtrafics de drogues, on dit qu’on est sous emprise quand on est «emboucanés jusqu’à l’os». Mon enquête multisites révèle que l’emprise est une machinerie, une mécanique de destruction qui fonctionne toujours de la même façon. Elle permet de s’approprier les personnes ou les groupes dans tous les lieux où le pouvoir peut devenir abusif, où les modes de régulation sont inexistants ou dysfonctionnels. Les personnes sous emprise relatent un état de soumission et de dépendance à un pouvoir abusif qui les a utilisées comme des objets, en prenant possession de leur esprit, de leur corps, de leur vie sociale et économique, mais aussi de leur parole, en les mettant sous silence. C’est un processus qui se met lentement en place jusqu’à devenir un système totalitaire, qui impose allégeance, adhésion et silence. Réduire l’emprise à une relation psychologique toxique entre un bourreau et sa victime, un pervers narcissique et une proie, revient à méconnaître sa dimension systémique, le poids de l’environnement, de même que la variété des formes qu’elle peut revêtir. On le voit dans le cas de Judith Godrèche : tous connaissaient cette relation, mais qui l’a questionnée ? Le milieu du cinéma considérait comme logique et normal d’instrumentaliser une petite fille de 14 ans. - Peut-on consentir quand on vit sous emprise ? Etre sous emprise désigne les effets de l’anéantissement progressif et violent de l’identité personnelle, de la coupure avec les proches, du renoncement aux liens sociaux hors du système d’emprise, de la dévitalisation du corps, de la destruction même de la capacité de penser l’emprise. Car elle produit de la confusion, un asservissement mental qui empêche de réfléchir au système dans lequel on est pris. Les personnes sous emprise sont dépossédées de tout, leur subjectivité n’est plus là, elles ne pensent plus par elles-mêmes, leurs facultés rebelles sont éteintes. «J’ai été vampirisée», disent les personnes que j’ai rencontrées. Comment consentir quand on est à ce point aliéné ? Dans ces cas, le consentement n’existe pas, il y a abus de faiblesse. - Judith Godrèche témoigne : «J’étais endoctrinée, c’est comme si j’avais rejoint une secte. Je suivais les règles de mon gourou.» Est-ce que ce parallèle avec l’emprise sectaire est pertinent ? Tout à fait. Vous laissez entrer dans votre tête une personne qui vous dit comment vivre, quelles sont les règles, et qui commence à vous terrifier. Parce que si vous ne les respectez pas, vous risquez d’être exclu, d’être dissident. Vous êtes emprisonné mais on vous donne le sentiment que hors de la prison c’est bien pire. - Pourquoi l’emprise s’exerce-t-elle particulièrement sur les adolescentes ? L’adolescence est un moment où vous n’avez pas beaucoup d’expérience, vous cherchez des modèles, et vous n’avez pas encore les petites lumières rouges qui alertent quand ils vous détruisent. Mais toutes les adolescentes ne sont pas sous emprise : il y a souvent un terreau, des vulnérabilités liées à l’histoire familiale, des traumatismes, des modes éducatifs où les personnes ont eu beaucoup de mal à se construire en tant que sujet. «J’avais un trou dans la tête et c’est par là qu’il est rentré», disait une femme. La socialisation de genre expose aussi. Les femmes sont plus sujettes à l’emprise au sein du couple. Il peut être plus difficile pour elles d’exister pour elles-mêmes et de se protéger, quand elles ont vécu dans un milieu qui diffusait insidieusement l’idée qu’être une femme suppose de se soumettre à l’autorité d’un homme «plus grand que soi», plus âgé, avec plus de connaissances, d’expérience. C’est pourquoi il est urgent de sortir du mythe du prince charmant à qui se donner tout entière, par amour. - Une des défenses de Benoît Jacquot et d’autres abuseurs est de souligner le caractère amoureux de la relation. Comment le discours amoureux est-il utilisé dans cette relation ? C’est ce discours amoureux qui va légitimer l’anéantissement de l’autre, qui va alimenter la dépendance affective de l’autre. C’est au nom de l’amour que l’emprise va s’exercer et au nom de l’amour que les personnes sous emprise vont rester dépendantes. La parole de l’autre est confisquée et le discours romantique va être mis en avant comme un paravent pour cacher toute la souffrance vécue, un paravent bien ancré dans l’imaginaire Disney. - Comment on en sort ? Comment ce que vous appelez la «déprise» peut-il advenir ? Pour s’en sortir, il faut trouver des recours. Tout peut servir contre l’emprise : une parole émancipatrice, un geste, une pensée flottante. Lentement, les femmes ou les hommes que j’ai rencontrés, aliénés par leur conjoint, leur travail, une secte, un gourou, s’en sortent parce qu’ils défont les nœuds de l’emprise. Ils ont pu imaginer qu’une autre vie était possible, ils se sont appuyés sur des fragments du moi qui subsistaient, ils ont été aidés par d’autres. Isild Le Besco a dit : «Si j’avais fait des études, peut-être, j’aurais pu m’en sortir, j’aurais eu plus de lucidité.» La reprise d’études peut être une façon de se renarcissiser, de se construire sa propre place sociale. L’amour qu’on a reçu par le passé peut aussi être remobilisé pour nous empêcher de nous considérer comme de simples objets. Judith Godrèche raconte comment elle a dénoué un à un les nœuds de l’emprise pour se reconstruire comme personne. Elle se sépare de Benoît Jacquot, elle prend une distance physique avec son abuseur ; elle ira aux Etats-Unis, ce qui lui permet sans doute de récupérer un peu de for intérieur. Elle écrit un livre, Point de côté, une prise de parole qui est la sienne et donc, progressivement, elle déconstruit le lavage de cerveau qu’elle a subi. Dès qu’on prend la parole, on est comme un dissident, on brise l’interdit et le silence que le système d’emprise imposait. Avec ses prises de parole dans les médias, elle poursuit sa dynamique de déprise, elle décrypte les faits vécus avec beaucoup de justesse. Judith Godrèche a fait de sa colère un carburant pour faire ce qu’elle veut faire ; elle fait de son expérience un savoir émancipateur, une source de créativité. Ce qu’elle fait et que nous faisons collectivement en ce moment est crucial pour notre liberté d’êtres humains. Mise à jour dimanche 25 février après la prise de parole de Judith Godrèche aux césars

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2024 10:31 AM
|
Mise à jour le 26 février 2024 de l'article publié par Lara Clerc le 21 décembre 2023 dans Libération Mises en examen, plaintes, enquêtes judiciaires et témoignages transmis à la justice… Depuis 2018, l’acteur, qui clame son innocence, est poursuivi pour plusieurs faits de violences sexuelles, dont des viols. Alors que l’acteur de 75 ans continue de nier tout fait de violence envers les femmes, Gérard Depardieu fait pourtant l’objet de plusieurs procédures judiciaires. Mis en examen pour «viols» depuis le 16 décembre 2020, l’acteur a choqué par ses propos diffusés dans Complément d’enquête en décembre 2023, lançant un débat public sur sa figure de «monstre sacré», alimenté par les propos d’Emmanuel Macron, qui a dénoncé une «chasse à l’homme» contre Gérard Depardieu. Février 2024 : une cinquième plainte pour «agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes» Amélie, décoratrice de 53 ans, a porté plainte le vendredi 23 février pour des faits «d’agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrages sexistes», qui auraient eu lieu sur le tournage du film Les volets verts, de Jean Becker en 2021. Sur le plateau, l’acteur aurait tenu des propos graveleux puis, plus tard, l’aurait «attrapée avec brutalité» et lui aurait «pétri la taille, le ventre, en remontant jusqu’à ses seins». Ce sont les gardes du corps du comédien qui auraient mis fin à la scène. Une autre femme, Sarah, 33 ans, troisième assistante réalisatrice sur le film, accuse également Gérard Depardieu de lui avoir touché à deux reprises «la poitrine et les fesses» quelques jours auparavant, le 31 août 2021. Janvier 2024 : une quatrième plainte pour «agression sexuelle» Le 9 janvier 2024, une femme a déposé plainte dans un commissariat de Paris pour des faits d’«agression sexuelle sur une personne vulnérable par personne abusant de l’autorité de sa fonction» lors d’un tournage à Doué-en-Anjou (Maine-et-Loire) en mars 2014. Une enquête a été ouverte, a précisé le vendredi 16 février le parquet de Paris. C’est sur le tournage du film de Jean-Pierre Mocky, Le Magicien et les Siamois, que la plaignante de 24 ans - qui souhaite rester anonyme - aurait été assistante. Elle mentionne «ses paluches partout sur [son] corps» et les «mots indécents» de l’acteur sur le plateau. Décembre 2023 : une troisième plainte, pour «viol» En Espagne cette fois. Ruth Baza, autrice et journaliste âgée aujourd’hui de 51 ans, décrit des faits survenus à Paris en 1995, lors d’une interview quand elle avait 23 ans et Depardieu 46 ans. «Je ne pouvais pas bouger», raconte-t-elle. La police espagnole qualifie les faits de viol, ce qui est englobé dans le délit d’agression sexuelle dans le droit espagnol. Les faits étant prescrits, cette plainte a peu de chances d’aboutir. Septembre 2023 : une deuxième plainte, pour «agression sexuelle», classée sans suite L’actrice Hélène Darras porte plainte pour des faits d’«agression sexuelle» remontant à 2007. Elle a alors 26 ans quand elle rencontre Gérard Depardieu sur le plateau du film Disco, de Fabien Onteniente. Elle décrit qu’il lui aurait passé la main «sur [ses] hanches, sur [ses] fesses». Interrogé par Libération, le parquet explique alors que la plainte est «en cours d’analyse». Le 22 janvier 2024, le parquet de Paris a annoncé que la plainte a été classée sans suites, les faits étant jugés prescrits. Hélène Darras en a été informée le 29 décembre. Avril 2023 : des femmes apportent leurs témoignages à la justice Mediapart publie une enquête recoupant treize témoignages qui dépeignent le «mode opératoire» de l’acteur. Une actrice qui aurait été agressée sur un plateau de tournage explique : «Il y avait tellement de témoins oculaires […] personne n’a rien dit.» Trois des victimes ont apporté leurs récits à la justice mais seule la comédienne Hélène Darras a porté plainte quelques mois plus tard. Mars 2022 : refus de la demande en nullité de Gérard Depardieu En mars 2022, la cour d’appel de Paris tranche en défaveur du comédien, qui contestait sa mise en examen dans l’affaire Charlotte Arnould et demandait sa nullité. Le tribunal confirme même la présence d’indices suffisants pour enquêter sur des faits de «viols» et d’«agressions sexuelles». Août 2020 : ouverture d’une information judiciaire et mise en examen pour la même plainte La comédienne Charlotte Arnould dépose une deuxième fois plainte en août 2020, se constituant partie civile cette fois, ce qui aboutit à l’ouverture d’une information judiciaire. L’enquête est confiée à un juge d’instruction, qui estime qu’il existe des indices «graves et concordants». Gérard Depardieu est donc mis en examen pour «viols» quatre mois plus tard, en décembre 2020. Au micro de BFM TV le 23 mai 2023, elle évoquait qu’après les faits, elle se sentait «morte». Août 2018 : une première plainte pour «viol» classée sans suite Le 27 août 2018, la jeune comédienne Charlotte Arnould dépose plainte contre Gérard Depardieu dans les Bouches-du-Rhône. Elle raconte aux enquêteurs que le comédien l’a violée à deux reprises à six jours d’intervalle, les 7 et 13 août, dans son domicile parisien. L’actrice de 22 ans préservait alors son anonymat. Deux mois plus tard, en novembre 2018, l’interprète de Cyrano est entendu par la police judiciaire de Paris, sans être placé en garde à vue. En juin 2019, la plainte de Charlotte Arnould est classée sans suite, selon le parquet de Paris, car «les infractions n’ont pas pu être caractérisées». Mise à jour le 26 février 2024, avec ajout d’une cinquième plainte pour «agression sexuelle» contre Gérard Depardieu. Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 23, 2024 3:57 PM
|
Compte-rendu du Monde, le 23 février 2024 Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/live/2024/02/23/en-direct-cesars-2024-suivez-la-49-ceremonie_6218213_3246.html
Judith Godrèche : « Depuis quelque temps, la parole se délie, l’image de nos pères idéalisés s’écorche »
Deux semaines après l’enquête du Monde sur la relation d’emprise exercée par le réalisateur Benoît Jacquot sur Judith Godrèche, alors âgée de 14 ans, l’actrice prend la parole pendant la cérémonie. « C’est compliqué de me trouver devant vous tous ce soir », débute Judith Godrèche. « C’est un drôle de moment pour nous, non ? Une revenante des Amériques vient donner des coups de pied dans la porte blindée. Qui l’eût cru ? », poursuit-elle. Avant de déclarer :
« Depuis quelque temps, la parole se délie, l’image de nos pères idéalisés s’écorche, le pouvoir semble presque tanguer. Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face ? Prendre nos responsabilités ? Etre les acteurs, les actrices d’un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? » « Nous sommes sur le devant de la scène. A l’aube d’un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma », poursuit Judith Godrèche. « Ça, ça donne le ton, comme on dit. On ne peut pas ignorer la vérité parce qu’il ne s’agit pas de notre enfant, de notre fils, notre fille. On ne peut pas être a un tel niveau d’impunité, de déni et de privilège qui fait que la morale nous passe par-dessus la tête. Nous devons donner l’exemple, nous aussi », continue l’actrice. Judith Godrèche évoque également « les 2 000 personnes qui m’ont envoyé leur témoignage en quatre jours » . « Vous savez, pour se croire, faut-il encore être cru ». L’actrice a poursuivi son discours, pour le conclure par un petit bout de dialogue d’un film de Jacques Rivette. « Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. Les petites filles sont des punks qui reviennent déguisées en hamster. Et, pour rêver à une possible révolution, elles aiment se repasser ce dialogue de Céline et Julie vont en bateau [film de Jacques Rivette, sorti en 1974] : Céline. « Il était une fois.
Julie. — Il était deux fois. Il était trois fois.
Céline. — Il était que, cette fois, ça ne se passera pas comme ça, pas comme les autres fois. » ___________________________ Elle n’avait ni infirmé, ni confirmé son intervention sur la scène de l’Olympia ce vendredi soir. Introduite par Ariane Ascaride, elle est arrivée devant une standing ovation et repartie dans les mêmes conditions, émue face à ses pairs qui l’applaudissent debout. Nul ne voyait comment la cérémonie des Césars pouvait se passer d’une prise de parole de Judith Godrèche, sous l’impulsion de laquelle le #MeToo du cinéma français a pris une envergure radicalement inédite ces dernières semaines. En déposant plainte pour viol sur mineure de moins de 15 ans contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon début février, et donnant à reconsidérer sous un jour sinistre les fétiches du cinéma d’auteur post-Nouvelle Vague des années 80-90, l’actrice et réalisatrice, c’est peu de le dire, a jeté un pavé dans la mare, entraînant avec elle une nouvelle série de témoignages sur les violences sexistes et sexuelles dans l’industrie. «Beaucoup de vous m’ont vue grandir», a déclaré l’actrice et réalisatrice, qui a rappelé n’avoir jamais «rien connu d’autre que le cinéma», et s’est décrite comme «une revenante des Amériques qui vient donner des coups de pieds dans la porte blindée». Evoquant dans un poème les «petites filles dans le silence», «les jeunes hommes qui n’ont pas su se défendre», Judith Godrèche a dédié ses mots aux victimes de violences encore terrées dans le silence, s’émouvant de l’omerta qui sévit encore au-delà du milieu du cinéma, en dépit d’une parole qui commence à se délier. «Serait-il possible que nous puissions regarder la vérité en face, prendre nos responsabilités, être les actrices et acteurs d’un univers qui se remet en question ? Depuis quelque temps je parle, je parle mais je ne vous entends pas, ou à peine. Où êtes-vous, que dites-vous ? […] Je sais que ça fait peur de perdre des subventions perdre des rôles perdre son travail. Moi aussi j’ai peur.» A cette «curieuse famille» du cinéma qui l’aura vu errer en costume de hamster dans sa série autofictive, Icon of French Cinema, où elle revient sur sa jeunesse d’actrice sous la coupe d’un cinéaste Pygmalion, Judith Godrèche a déclaré, en écho à cette formule de plateau «Silence, moteur demandé» : «Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. J’imagine pourtant l’incroyable mélodie qu’on pourrait composer ensemble faite de vérité. Ça ne ferait pas mal, je vous promets. […] C’est tellement rien comparé à un coup de poing dans le nez, à une enfant prise d’assaut comme une ville assiégée, assiégée par un adulte tout-puissant sous le regard silencieux d’une équipe. Un réalisateur qui, tout en chuchotant, m’entraîne sur son lit sous prétexte de devoir comprendre qui je suis vraiment. C’est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de quinze ans.» Alors que le cinéaste Jacques Doillon annonçait jeudi son intention de porter plainte pour diffamation, Judith Godrèche concluait son discours en exhortant à avoir «le courage de dire tout haut ce que nous savons tout bas, n’incarnons pas des héroïnes à l’écran pour rester cachées dans les bois dans la vraie vie.», reprenant les termes de «trafic illicite» utilisés par Benoît Jacquot, dans un documentaire de Gérard Miller détonateur de sa prise de conscience, pour demander : «Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ?» «Parce que vous savez que cette solitude, c’est la mienne mais également celle de milliers dans notre société. Elle est entre vos mains. Nous sommes sur le devant de la scène. A l’aube d’un jour nouveau. Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma.» L’espoir d’une « possible révolution », «l’aube d’un jour nouveau» a fait figure d’horizon. «Ne croyez pas que je vous parle de mon passé, de mon passé qui ne passe pas. Mon passé, c’est aussi le présent des 2000 personnes qui m’ont envoyé leur témoignage en quatre jours.» a déclaré celle qui ouvrait récemment une boîte mail dédiée aux témoignages des autres victimes. «Merci de m’avoir donné la possibilité de mettre ma cape ce soir et vous envahir un peu. […] Il faut se méfier des petites filles, elles touchent le fond de la piscine, se cognent, blessent mais rebondissent.» concluait l’actrice avant de terminer sur une référence au film Céline et Julie vont en bateau de Rivette : «Il était une fois. Il était deux fois il était trois fois. Il était que cette fois ça ne se passera pas comme ça pas comme les autres fois». Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2024 12:20 PM
|
ENQUÊTE Par Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre / Le Monde du 3 juillet 2024 Le réalisateur a passé deux jours en garde à vue, lundi 1er et mardi 2 juillet. Une étape judiciaire importante, dans une affaire qui a débuté avec la prise de parole de l’actrice Judith Godrèche.
https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/07/03/je-ne-veux-plus-jamais-que-tu-me-fasses-ca-trois-nouvelles-plaintes-pour-viols-et-tentative-de-viol-visent-le-realisateur-jacques-doillon_6246523_3224.html
Au commencement des grandes affaires de violences sexuelles, il y a souvent une victime qui ouvre la voie. Une première plaignante, dont la prise de risque judiciaire et médiatique rassure les autres femmes et leur permet de dire : « Moi aussi. » L’actrice Judith Godrèche, en déposant une plainte contre Jacques Doillon, le 6 février, a non seulement déclenché l’ouverture d’une enquête préliminaire à la brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire de Paris, mais permis aussi l’éclosion de nombreux témoignages, que Le Monde a recueillis ces derniers mois. Trois d’entre eux ont abouti à des plaintes, qui sont à l’origine de la garde à vue de quarante-huit heures du réalisateur, levée pour « raisons médicales » au soir du mardi 2 juillet, puis de la transmission de la procédure au parquet de Paris, « ce jour pour apprécier le périmètre et les modalités des suites à y donner », a annoncé une source judiciaire mercredi.
Les récits des victimes, portant sur des faits s’étendant des années 1980 à 2012, présentent des récurrences significatives. Ils émanent de femmes ayant croisé la route du cinéaste, alors qu’elles étaient jeunes et aspiraient à intégrer le monde du cinéma. De leurs histoires personnelles, disent-elles, cet homme d’autorité et de prestige nourrissait ses projets artistiques, et, de leurs corps, il faisait son territoire. Contactée par Le Monde, l’avocate de Jacques Doillon, Marie Dosé, n’a pas souhaité faire de commentaire : « Au vu des questions que vous me posez, je constate que je suis moins bien renseignée que vous sur les éléments de cette enquête après quarante-huit heures de garde à vue. Je ne peux donc décemment vous répondre. » Le réalisateur de 80 ans, auteur d’une trentaine de films, a remporté plusieurs Césars pour deux de ses longs-métrages, La Drôlesse (1979) et Le Petit Criminel (1990). « Je n’ai jamais promis de rôle à quiconque ni profité de ma position de réalisateur pour obtenir des faveurs sexuelles, avait-il répondu dans Le Parisien, le 10 avril. Si j’étais l’horrible bonhomme que Judith Godrèche dit que je suis, son appel à témoins aurait dû susciter beaucoup plus de témoignages. » Joe Rohanne, qui a été en relation durant trois années avec le cinéaste de quarante-trois ans son aîné, et a eu avec lui une fille, porte la seule plainte qui ne semble pas couverte par la prescription. Au moment des faits, Joe, qui fait notamment état de trois viols, de coups et blessures, et de violences psychologiques, portait un autre nom. Cette personne, trans non binaire, que l’on socialisait à l’époque comme une jeune femme, a demandé que son histoire soit racontée en écriture inclusive dans cet article, avec l’emploi, à son égard, du pronom « iel ». « Bombardement amoureux » Lorsqu’ils font connaissance, en 2009, la différence de statut social est patente : Joe Rohanne a 22 ans et étudie le cinéma à Bruxelles, Jacques Doillon est un réalisateur primé âgé de 65 ans. L’asymétrie est d’autant plus forte que Joe vit au même moment une épreuve personnelle, comme garde-malade de sa mère, qui a conduit à son hospitalisation pour cause d’épuisement. Dans son quotidien en lambeaux, le cinéma reste l’une de ses rares lueurs d’espoir. Le 20 février 2009, l’Association des scénaristes de l’audiovisuel, dont Joe fait partie, accueille Jacques Doillon à Bruxelles pour une conférence. Au dîner précédant l’événement, les deux sympathisent, parlent littérature et cinéma, évoquent la meurtrissure du cancer – le cinéaste vient d’en avoir un. « Je me sentais mal à l’aise, car il ne parlait plus qu’à moi, se souvient Joe. Il me regardait très fixement, je n’avais pas l’idée de son désir, vu notre différence d’âge. » Le lendemain, Jacques Doillon envoie une déclaration d’amour par courriel à Joe, « ce miracle » qu’il cherche depuis longtemps. Il fait du « bombardement amoureux » par écrit, insiste pour revenir à Bruxelles. Joe, qui a quitté l’hôpital quinze jours auparavant, lui répond n’être pas en état de le voir. Pourtant, le 25 février 2009, Doillon l’attend à la gare du Midi. N’imaginant pas pouvoir refuser le rendez-vous, Joe Rohanne le rejoint. Sans le moindre mot, le cinéaste l’embrasse sur la bouche pour lui dire bonjour. Dans l’appartement de Joe, qui tente de maintenir la conversation sur le cinéma, la sidération s’installe. « Il m’emmène vers lui dans le canapé, puis dans la chambre. Il me déshabille, se déshabille, va pour me pénétrer. Je peux à peine protester du fait que je ne prends pas la pilule qu’il me répond que ce n’est pas grave, qu’on va faire un enfant. » Juste après, il repart en Normandie, où il vit, l’appelle beaucoup, évoque ce « signe du destin » que représente leur rencontre et lui propose de l’accompagner à New York dix jours plus tard. « Durant le voyage, je me souviens de lui avoir raconté ma vie, mais que ça ne l’intéressait pas du tout. Il m’a dit qu’il n’était pas mon psy et que je ne devais pas polluer les autres avec mes problèmes. »
A l’été 2009, Joe, qui vient de perdre sa mère, fait une fausse couche alors que se prépare le tournage de Mariage à trois (2010), le prochain Doillon, pour qui iel travaille désormais. Sur le plateau, une hémorragie survient, des suites probables de la fausse couche. Doillon ne l’emmène pas à l’hôpital, c’est la directrice de la photographie, Caroline Champetier, qui le fait. Joe subit un curetage. Le lendemain, le cinéaste l’accuse d’avoir gêné son travail. Nuit de cauchemar Tous deux s’installent en Belgique, où se déroule le montage du film. C’est là que le premier viol a lieu, selon Joe Rohanne. Un matin de l’automne 2009, iel se réveille, après une nuit de cauchemar, avec du liquide entre les jambes. Au petit déjeuner, Joe interpelle son compagnon : « Tu m’as pénétré.e pendant que je dormais ? » Il finit par reconnaître qu’il pensait qu’iel était réveillé.e, tout en sachant que, à la suite de la maladie, puis de la mort de sa mère, Joe consomme de puissants somnifères. « Je ne veux plus jamais que tu me fasses ça. » En mars 2010, Joe retombe enceinte et accepte de vivre chez le réalisateur. Les journées sont réglées, entre jardinage, lecture, écriture et visionnage de films, qu’il choisit toujours. Les premières tromperies émergent : « Tu sais, une femme, après 20 ans, elle perd sa beauté », répète-t-il souvent, selon le récit de Joe Rohanne. Il met en place un contrôle, sur ses vêtements, puis sur la gestion de la maison, en piquant de grosses colères ménagères : « Il n’y avait quasiment pas de tendresse ni de gestes d’affection, juste tout qui n’était jamais assez bien. » A l’été 2010, le couple part en vacances. Sa grossesse compliquée conduit Joe à l’hôpital, qui note que le gynécologue est le seul, jusqu’ici, à manifester sa surprise quant à leur différence d’âge. Il alerte Jacques Doillon : ce dernier doit à tout prix arrêter les rapports sexuels, au risque de lui faire perdre l’enfant. Tandis que le ventre de Joe s’arrondit, le cinéaste drague de plus en plus de jeunes filles, puis, à l’automne, s’envole vers la Thaïlande pour une rétrospective de ses films. « Là, je reçois par erreur un mail qu’il envoyait à une agence de prostituées. » Joe lui demande des explications sur ce message. Doillon argue de son appétit sexuel et en fait un point non négociable. En décembre 2010, Joe, qui, à 23 ans, vient d’accoucher, pressent, « horriblement triste », qu’il faut s’enfuir et commence par installer une distance géographique. A la fin de l’été 2012, après des mois d’angoisse, Joe le quitte définitivement, mais les agressions se poursuivent. Une première fois dans les coulisses d’une séance photo : Jacques Doillon attrape ses seins, puis force un baiser. La trace d’une morsure Une deuxième fois, le 5 octobre 2012. Joe Rohanne doit se rendre à Lisieux (Calvados), pour l’avant-première de son premier long-métrage. Le distributeur n’a pas le budget d’une nuit d’hôtel : Joe demande à Jacques Doillon, qui n’habite pas loin, s’il est possible de dormir chez lui. Séparés, ils font chambre à part. Mais, le lendemain matin, il s’introduit dans son lit et pénètre Joe. « Comme lorsque nous étions ensemble. Il me prenait toujours à sa guise, mon corps était à sa disposition. » Un mois plus tard, iel doit repasser dans la maison normande pour lui confier leur fille pour le week-end et récupérer des affaires. Joe s’y rend avec un homme avec qui iel a entamé une relation intime quelques semaines plus tôt ; il les accompagne, avec sa fille, pour les soutenir. Ce témoin, qui a requis l’anonymat, livre le même récit que Joe Rohanne. Tandis que l’homme reste dans la voiture à distance du domicile de Jacques Doillon, Joe accompagne son enfant dans la maison et monte dans son ancienne chambre. « Il surgit, m’attrape par les seins, me mord et ensuite me prend. Je pensais qu’il m’avait assez utilisée physiquement, mais non, il fait ça pour me salir auprès de mon nouveau compagnon. Mes vêtements sont en pagaille, je suis seul.e, choqué.e. Que faire ? Que dire ? » Sur la place du village, non loin, où il l’attend pour déjeuner, le témoin s’impatiente, n’a pas de nouvelles, l’appelle : il a faim, et l’heure tourne. Joe ne répond pas, puis réapparaît en lisière du chemin de terre qui mène à la maison de Doillon, où son compagnon est revenu l’attendre, et monte dans la voiture : « Iel est bouleversé.e, me dit que Jacques Doillon l’a poussé.e puis lui a mordu le sein jusqu’au sang. Je me souviens des traces de dents, des gouttes qui perlaient. Si on avait fait un plâtrage de la blessure, on y aurait retrouvé la dentition de Jacques Doillon, décrit-il. Je sens bien que c’est plus grave que juste les morsures, je veux l’emmener au commissariat, qu’une plainte soit déposée, ou au moins une main courante. » L’échange tourne à l’accrochage, car Joe Rohanne craint la puissance sociale du père de sa fille et ne veut rien faire. Douze ans plus tard, quand Judith Godrèche dénonce le cinéaste, le témoin pense tout de suite à cette scène, se dit que c’est le moment, que Joe va enfin pouvoir parler. « Je n’ai jamais oublié cette scène de la voiture, et j’étais content de sentir qu’iel n’avait plus peur », se réjouit-il. Mardi 2 juillet, dans les locaux de la BPM, une confrontation entre Joe Rohanne et Jacques Doillon a été organisée. Relation « pas correcte » Hélène M. avait 15 ans, soit sept ans de moins que Joe Rohanne, lorsqu’elle a fait la connaissance du cinéaste. Elle était encore dans l’adolescence, l’âge des premières fois, des expériences marquantes, qu’elle notait dans un petit carnet rouge, vert et violet, scellé d’une serrure métallique. Comme le dimanche 19 juillet 1992, où, âgée de 12 ans, elle écrit : « J’ai réussi pour la première fois de ma vie à faire un scoubidou. » Le 5 juillet 1995, nouvel événement inoubliable : « A 10 h 48 et 45 secondes, j’ai pris le métro pour la première fois de ma vie, seule. C’était à la station Parmentier en direction de Gallieni. » Le 8 décembre 1995, alors qu’elle vient d’avoir 16 ans, son écriture n’est plus au stylo-plume de l’enfance, mais au Bic. « Vers les 20 heures, je me suis fais [sic] sodomiser pour la première fois de ma vie par Jacques Doillon. C’était douloureux et peu agréable. Hôtel Relais Christine. » Ce petit carnet, Hélène M., 44 ans désormais, l’a retrouvé il y a quelques mois, en fouillant dans la cave de son logement, au Canada. Depuis 2017 et le déclenchement de la vague #metoo, elle repensait souvent à la relation « pas correcte » qu’elle avait entretenue à l’adolescence avec le réalisateur de Ponette (1996). « Mais cette histoire de sodomie, j’en doutais, dit-elle aujourd’hui. Je me rappelais quand même que, quand j’allais au lycée, j’avais parfois mal, parce que j’avais vu Doillon avant. J’étais contente de retrouver ce carnet, je me suis dit : “Ouf, j’ai une preuve.” » Cette diplômée en philosophie et anthropologie sociale a montré cet élément matériel à la BPM de la police judiciaire de Paris, le 27 mars, lorsqu’elle a déposé une plainte pour viol. En février 1995, c’est Hélène M., jeune fille tourmentée, qui entre en contact avec le réalisateur. De Jacques Doillon, la Franc-Comtoise, qui vit alors à Paris, a adoré les films Le Jeune Werther (1993) et Le Petit Criminel. Elle déniche son adresse grâce aux renseignements téléphoniques, et, sans lui donner la sienne, commence à lui envoyer des lettres, qui sont comme un journal intime en épisodes. « Je me disais que cet homme-là avait compris quelque chose sur l’adolescence. Je voulais un lecteur, et il m’apparaissait comme la bonne personne. » Quelques mois plus tard, elle rencontre finalement le réalisateur et le voit plusieurs fois, à son domicile et à son bureau. Tout se passe bien : la jeune fille, qui rêve de filmer et d’écrire, parle, à cet homme qu’elle admire, de cinéma, de littérature et de sa vie. Selon le récit d’Hélène M., la relation bascule le 8 décembre 1995, quand Jacques Doillon, alors âgé de 51 ans, lui demande de la rejoindre au Relais Christine, un luxueux hôtel parisien. « Je pense que j’étais contente d’y aller. Je me vois parler avec lui sur le canapé, mais je n’ai pas le souvenir de la façon dont il me met dans le lit. C’est allé très vite, j’étais dans la sidération. Je n’avais pas mon mot à dire, pas de désir. Je me rappelle que je ne peux pas bouger, je suis sur le ventre et je subis cela. Je me dis : “Ça doit être comme ça.” » « Pas de reconnaissance » Après cette pénétration imposée, Hélène M., qui avait très peu d’expérience sexuelle, se persuade qu’elle est entrée « dans une relation amoureuse » : « Je me sentais valorisée. Doillon s’intéressait à moi. » Elle continue à fréquenter le cinéaste à un rythme irrégulier. Elle peut le voir deux fois par semaine ou n’avoir plus de nouvelles pendant quelques mois. A l’époque, elle ne perçoit pas leurs rapports sexuels comme relevant du droit pénal. « Il y a eu de la contrainte, des choses que je ne voulais pas faire », estime-t-elle néanmoins. Dans une lettre, datée du 7 novembre 1996, adressée à une amie, elle écrit : « Le plus cruel, c’est de s’apercevoir qu’après ses contacts physiques que [sic] trop douloureux l’homme ne t’appelle, ne te veut que pour l’image que tu es censée représenter, celle d’une jeune fille, celle du sexe. » Interrogé par Le Monde, le père d’Hélène M. confirme l’histoire racontée par sa fille. Il dit avoir désapprouvé cette relation et essayé d’y mettre fin. « On a envisagé de porter plainte à l’époque, mais on a compris que cela ne servait à rien », explique-t-il en ressortant un livre de sa bibliothèque, les œuvres poétiques de Verlaine en « Pléiade », avec une dédicace manuscrite du cinéaste : « Pour Hélène. 17 + 1 ? Bravo. Jacques. » Un cadeau pour les 18 ans de la jeune femme, en septembre 1997, comme l’indique une note au crayon de l’intéressée, sur une autre page. La relation entre Jacques Doillon et Hélène M. se double en parallèle d’une captation artistique. Le cinéaste demande à l’adolescente de participer à l’écriture d’un film, dont le titre provisoire est « La Groupie ». La jeune fille transmet des idées, « des histoires à [elle] » qui nourrissent le scénario, participe à des essais, se voit même promettre un rôle, qu’elle n’aura jamais. Du jour au lendemain, raconte-t-elle, elle est évincée du projet, et la relation avec le réalisateur se termine. « J’ai l’impression que mon âme a été violée, dit Hélène M. Je n’ai pas été informée que le film sortait, il n’y a pas eu de clin d’œil au générique, pas de reconnaissance, rien du tout. A l’époque, cela m’avait bouleversée. » Le film est sorti sous un autre titre, Trop (peu) d’amour, en mars 1998. Il a été tourné dans le Jura, à la fin du printemps 1997, et raconte l’histoire d’un réalisateur de cinéma « libertin », incarné à l’écran par Lambert Wilson. Le surgissement d’une adolescente de 17 ans, qu’il a invitée à le rejoindre après qu’elle lui a écrit des lettres, bouleverse sa vie. Au milieu du film, le personnage principal impose au second rôle féminin une relation sexuelle brutale sur une voiture, qualifiée de « viol » dans la scène suivante. « La “méthode Doillon” » Dans le film, l’adolescente est jouée par Elise Perrier. Celle qui est devenue journaliste et vit aujourd’hui en Suisse se remémore un tournage éprouvant : « J’avais 16 ans, j’étais naïve, encore une enfant dans un corps de femme. J’étais une matière 100 % malléable. Jacques Doillon cherchait cette faille, ce moment où ça craque, où ça va trop loin. La “méthode Doillon” était extrêmement valorisée à l’époque. Elle était considérée comme un cadeau pour l’acteur, poussé à être toujours plus vrai face à la caméra, comme si tout était permis au nom de l’art. » Jacques Doillon a toujours revendiqué une méthode de travail s’apparentant à une « vampirisation », ainsi qualifiée dans une interview au magazine Rolling Stone, en 1990 : en amont des films, et parfois pendant les tournages, il fait longuement travailler ses comédiens sur des essais, qui sont à la fois des répétitions et des ateliers d’écriture, où il puise dans la vie intime de ses acteurs, en quête d’authenticité. Selon de multiples témoignages, ces séances ont aussi été l’occasion pour le cinéaste d’imposer des actes sexuels à des comédiennes souvent jeunes et potentiellement vulnérables. C’est exactement ce qu’ont déjà raconté Judith Godrèche et Isild Le Besco : la première dénonce un viol pendant une séance de travail pour La Fille de 15 ans, film de 1989 ; la seconde affirme avoir été écartée des essais de Carrément à l’ouest, long-métrage sorti en 2001, après avoir refusé de coucher avec le cinéaste. Par ailleurs, Anna Mouglalis a rapporté au Monde avoir été la cible d’une agression sexuelle dans sa maison de famille du Gard, à l’été 2011. Le cinéaste, qui qualifie cette accusation de « grotesque », l’aurait embrassée de force, après lui avoir proposé de monter une pièce de théâtre avec elle. Enfin, Jessica Tharaud, l’une des adolescentes du Jeune Werther, a détaillé pour Paris Match l’agression sexuelle dont elle aurait été victime dans une chambre d’hôtel, alors qu’elle avait 14 ans. Jacques Doillon a toujours cherché à collaborer avec des néophytes. En 1987, pour la comédie dramatique L’Amoureuse, le réalisateur a dirigé une troupe d’apprentis comédiens, venus du Théâtre des Amandiers, à Nanterre, formés par Patrice Chéreau. Elle comportait huit femmes, dont Agnès Jaoui, Valeria Bruni Tedeschi et Marianne Denicourt. « Doillon voulait partir de nos histoires pour écrire le scénario, se rappelle cette dernière. Chaque semaine, avant le tournage, il passait au théâtre récupérer nos copies. Mais on n’a jamais eu de scénario ! On avait des textes au fil de l’histoire, sur le tournage qui se déroulait en Normandie. Le soir, à l’hôtel, Doillon les glissait sous la porte de nos chambres. Il tapait pour entrer, disait vouloir parler de la scène, de façon très douce. Il n’était pas explicite sur ce qu’il attendait, mais il nous plaçait, nous comédiennes de 20 ans, dans une situation terrible. Il y avait un système de séduction malvenu. » « Le plus malin de tous » Idem pour Julie Jézéquel. L’actrice a donné la réplique à Jeanne Moreau sur un film de Jacques Doillon, à l’automne 1982, L’Arbre. « J’avais 18 ans et demi. J’étais très heureuse de travailler avec le réalisateur de La Femme qui pleure [1979]. » Elle a conservé des Polaroid du tournage, à Autun (Saône-et-Loire), où on la voit à l’Hôtel des Ursulines, en compagnie du réalisateur. « A sa demande, je rejoignais Jacques Doillon dans sa chambre le soir pour travailler les scènes du lendemain et l’écriture. Il commandait à dîner, il buvait du vin, du saint-amour qu’il noyait dans de l’eau. » Lors de ces rendez-vous, ils ont des rapports sexuels. « Contrairement à d’autres metteurs en scène que j’ai connus, Doillon, qui était le plus malin de tous, ne m’a pas agressée », précise la comédienne, qui n’emploie pas les termes « viol » ou « emprise », mais préfère parler d’un « endormissement du discernement » de l’adolescente qu’elle était. Et d’ajouter : « Je n’ai pas été agressée, mais j’ai été victime d’un mode opératoire. C’est en entendant Judith Godrèche que j’ai compris que c’était une méthode. » Aurélie Le Roc’h, elle, a déposé une plainte, le 29 février, pour « tentative de viol ». Son histoire, la comédienne et réalisatrice de 46 ans l’avait déjà relatée en 2017, mais de façon anonyme. La prise de parole de Judith Godrèche l’a décidée à s’exprimer publiquement sur ce moment qui la « hante ». Dans sa cuisine, à Paris, elle a la gorge étranglée par les sanglots en expliquant à quel point il a déterminé sa carrière. « Je n’ai jamais joué sur la féminité, la sensualité, le corps. C’est un handicap dans ce métier », commence celle qui a choisi de s’orienter vers la comédie. En juillet 1998, Aurélie Le Roc’h, étudiante de 21 ans, est embauchée comme stagiaire sur un film de Jacques Doillon, Les Petits Frères, tourné dans une cité d’Aubervilliers. Rapidement, le réalisateur lui demande de tourner une scène de figuration avec lui. « On marche tous les deux vers le RER. Plus on fait de plans, plus il me parle. Je me sentais très privilégiée. En vérité, il me reniflait. » Le lendemain, le réalisateur lui propose de l’aider à se lancer dans le cinéma. « Pour moi qui voulais faire ce métier, c’est extraordinaire. Je me sens flattée et soutenue, et aussi, dans ma tête de jeune fille, protégée. » Quelques jours plus tard, rendez-vous est donné dans un café, en début de soirée. Mais, au dernier moment, Doillon l’invite chez lui. « Une maison à plusieurs étages, avec une porte noire et une grande verrière attenante à la cuisine », relate Aurélie Le Roc’h, pas sûre de l’adresse exacte. A l’intérieur, Jacques Doillon ouvre des bières, sert une pizza, propose de la glace et, surtout, parle. « Deux heures de monologue et de vantardise. Il m’explique que toutes les grandes actrices ont commencé avec lui, Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, qu’il est un passage obligé. J’avais la sensation de jouer mon avenir. » « Le souvenir de sa langue dégueulasse » Au milieu du repas, le cinéaste suggère une visite de la maison. Il ouvre une porte donnant sur un escalier, dont Aurélie Le Roc’h ne sait pas qu’il mène à une chambre à l’étage, sans autre issue possible. « D’un coup, je me sens très mal et je me dis : “Non, tu ne me fais pas ce coup-là…” Quand je monte, j’ai les genoux qui flageolent, mon corps dit non, et mon esprit me dit de me détendre, de me comporter comme la grande actrice que je veux être. Lui est derrière moi. » Là-haut, pendant que Doillon s’allonge sur le lit, elle essaie de gagner du temps, s’assoit sur un fauteuil, fume une demi-cigarette. « Tout à coup, il saute dans une autre position, m’attrape par le bras et me tire vers le lit. On lutte. Pas un instant je ne fléchis. Et j’arrive à m’en sortir, je fuis en lui disant : “Tu dois avoir un problème avec ta mère, tu devrais consulter un psychiatre.” Je dévale l’escalier. Lui me suit en disant qu’il n’y a pas de souci. Moi, j’en sors humiliée, complètement traumatisée. » De retour sur le tournage, le lendemain, elle se trouve face à une équipe très distante. « On me regarde de travers, et on essaie de me faire passer pour une fille légère. » Elle dit avoir alerté le directeur de production, Yvon Crenn, qui lui aurait demandé de ne pas faire de vagues. Contacté, ce dernier dit n’avoir aucun souvenir de cet épisode. Un autre membre de l’équipe, Jérémie Nassif, que la comédienne assure avoir informé, se rappelle qu’elle avait été « mise à l’écart », mais pas du reste. « Elle me l’a peut-être dit de façon implicite, et je n’ai pas compris », concède Jérémie Nassif, pour qui « elle dit sûrement la vérité aujourd’hui ». Pour constituer la distribution de ses films, Jacques Doillon et ses équipes avaient l’habitude de prospecter dans la rue ou à la sortie des lycées parisiens, en proposant à des jeunes femmes de passer des castings qui se déroulaient parfois chez le cinéaste. Plusieurs personnes nous ont dépeint le même processus. Comme Capucine – son prénom a été modifié –, qui a tourné un film avec le cinéaste après avoir été repérée dans la rue, à Paris, en 2003, et avoir effectué de longs essais avec lui, au cours desquels elle a dû repousser ses assauts, « des caresses sur les mains, des yeux doux, des tentatives de baiser ». Son récit nous a été en partie confirmé par un tiers ayant assisté à l’une de ces répétitions. Isabelle – son prénom a été modifié – a, quant à elle, témoigné devant les enquêteurs de la BPM, sans porter plainte. A la fin des années 1980, cette adolescente jolie et désargentée rêve de cinéma, avec ce « petit visage à la mode », et passe un casting pour Jacques Doillon, qui lui donne rendez-vous dans une pièce sombre et mansardée. « Je me revois assise sur le bureau à côté de lui, à regarder le scénario. Il se met debout, m’embrasse, je suis sidérée, parce que je ne m’y attendais pas et que je suis très amoureuse de mon copain. J’ai gardé le souvenir de sa langue dégueulasse. » Que s’est-il passé ensuite ? La mémoire d’Isabelle a effacé ces images datant du siècle dernier. Elle n’a jamais eu de nouvelles du film pour lequel elle faisait des essais et a oublié cet événement. Jusqu’à ce que Judith Godrèche prenne la parole. « Quand elle a dit Jacques Doillon, j’ai eu l’impression de me désagréger comme du sable », observe Isabelle, qui tient aujourd’hui à parler « pour toutes les petites filles de 14 ans qui ont rêvé et ont été agressées ». Lorraine de Foucher Jérôme Lefilliâtre LE MONDE - 3 juillet 2024 Crédit photo : AXELLE DE RUSSÉ POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 24, 2024 8:18 AM
|
Par Lara Clerc dans Libération - 24 mai 2024 Dans une publication Instagram de «Après les violences», une action photo pour les victimes de violences conjugales, Catherine Hiegel témoigne des coups portés par Richard Berry. Il a déjà été mis en cause devant la justice par leur fille qui l’accuse d’inceste, une plainte classée sans suite car prescrite. Des faits déjà connus à grands traits mais pas dans le détail et qui n’avaient pas provoqué grand bruit. Dans une publication du compte Instagram Après les violences datée du jeudi 23 mai, la comédienne Catherine Hiegel dénonce les violences conjugales commises par Richard Berry. Les yeux droits dans l’objectif, l’actrice tient un bloc de papier sur lequel elle décrit les coups de son ex-compagnon : «Il cogne ma tête contre le lavabo, recousue à l’arcade ; plusieurs gifles bien sûr… La dernière enceinte de sept mois m’explose le tympan. Coline se retourne dans mon ventre. Condamnée à une césarienne. Je n’ai pas porté plainte, je l’ai quitté !!». Page Instagram de Marc Melki : IL COGNE MA TÊTE
CONTRE LE LAVABO,
RECOUSUE À L’ARCADE ;
PLUSIEURS GIFLES
BIEN SÛR … LA DERNIÈRE
ENCEINTE DE SEPT
MOIS, M’EXPLOSE LE
TYMPAN. COLINE SE
RETOURNE DANS MON
VENTRE. CONDAMNÉE
À UNE CÉSARIENNE.
J’AI PAS PORTÉ PLAINTE,
JE L’AI QUITTÉ !!
Catherine Hiegel
UN IMMENSE MERCI à CATHERINE HIEGEL
Elle témoigne et pose pour @apres_les_violences
Photographiée à Paris le 22 mai 2024. ©Marc Melki.
Le foetus, victime non reconnue des violences conjugales :
dans 40 % des cas les violences conjugales commencent pendant la grossesse et peuvent être plus graves pendant la grossesse pour 2 femmes sur 3 ; 4 fois plus de femmes signalent de très mauvais traitements pendant la grossesse : le fœtus se retrouve alors en danger.
Alison Blondy @lily_antovska
UN IMMENSE MERCI à @colineberryrojtman de m’avoir mis en contact avec ta maman.
#AprèsLesViolences est une action photographique collective et solidaire avec les femmes et les enfants victimes de #violencesintrafamiliales, comme avec les familles victimes de féminicides.
J’expose #APRÈSLESVIOLENCES du 24 au 30 juin au 61 3 rue de l’Oise Paris 19è.
Merci le @61.paris et @yael.caux
VERNISSAGE le 27 juin à 19h
Prises de parole : @laurarapp_1 , Bruno Solo, Alizé Bernard, @douiblucien , Alison Blondy, @me_godefroy , @sofia_sept7 Jérôme Giusti, @stephaniegateaumagy …
Soirée spéciale le 25 juin à 19h, rencontre avec des victimes, ex-victimes et présentation de la magnifique enquête autour de l’inceste de @romanebrisard pour @lesjoursfr « J’ai enlevé ma fille »
------------------------------------------------------------------------------------------------- C’est la première fois qu’elle s’exprime aussi directement sur les violences commises par le comédien d’aujourd’hui 73 ans, qui a lui même reconnu avoir battu sa femme dans les colonnes du Monde en 2021, sans y revenir par la suite. C’est dans cet article que la fille des deux comédiens, Coline Berry-Rojtman, a rendu publiques ses accusations. Elle dénonce les relations incestueuses imposées par son père dans son enfance (entre 1984 et 1985), plus précisément des baisers sur la bouche avec la langue de son père et des «jeux sexuels» auxquels elle devait se soumettre, également en compagnie de sa belle-mère de l’époque, la chanteuse Jeane Manson. Depuis, Jeane Manson a poursuivi Coline Berry-Rojtman en justice pour diffamation. Si cette plainte a abouti à deux premières condamnations en première instance et en appel, la Cour de cassation a annulé en décembre 2023 la condamnation de Coline Berry-Rojtman et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. La plainte de la fille de Catherine Hiegel et Richard Berry dénonçant des faits de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant et de corruption de mineur a, elle, été classée sans suite pour cause de prescription. C’est d’ailleurs Coline Berry-Rojtman qui a mis en contact Catherine Hiegel avec le photographe Marc Melki, derrière le compte Après les violences. Depuis le 3 juillet 2022, il publie sur le réseau social des clichés de victimes de violences conjugales. Son intention : «[revenir] sur le moment où tout a basculé, sur la fois de trop qui les a poussées à quitter leur conjoint devenu violent pour elles comme pour leurs enfants. La fois où elles ont pu dire stop. Le déclic. Elles sont toutes sorties des violences conjugales parfois après des années d’emprise et de calvaire». Quand certaines ne peuvent pas prendre la parole, il demande à des célébrités de poser pour elles, comme Nagui, Anna Mouglalis ou Bruno Solo. Il exposera ses œuvres du 24 au 30 juin au 61-3 rue de l’Oise, dans le XIXe arrondissement de Paris. Lara Clerc / LIBERATION Légende photo : C’est la première fois qu’elle s’exprime aussi directement sur les violences commises par le comédien de 73 ans aujourd’hui, qui a lui même reconnu avoir battu sa femme dans "Le Monde" en 2021, sans être réinterrogé sur la question plus tard. (Bertrand Guay/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 17, 2024 3:53 PM
|
Editorial d'Alexandra Schwartzbrod dans Libération - 17 mai 2024 Il a suffi d’une vidéo postée sur X dans laquelle le réalisateur Benoît Jacquot s’exprime de façon abjecte sur sa relation avec l’actrice pour que celle-ci cesse de trembler et sorte de son silence. C’est l’histoire d’une actrice, longtemps femme-enfant comme on le disait à la fin du XXe siècle, qui, au cours des premiers mois de 2024, s’est muée du jour au lendemain en guerrière contre ceux qui l’avaient utilisée et agressée, avant de devenir icône du combat contre les violences sexuelles. Que s’est-il passé pour que Judith Godrèche, qui avait quitté la France et les écrans depuis de nombreuses années, sorte soudain de son silence, aimantant journalistes, politiques et surtout ces milliers de femmes victimes comme elle d’hommes prédateurs ? La colère. L’indignation. Le trop, c’est trop. Il y a d’abord eu le succès de sa série, Icon of French Cinema, une autofiction pleine d’autodérision qui lui a sans doute redonné confiance en elle. Il a suffi ensuite d’une vidéo postée sur X dans laquelle le réalisateur Benoît Jacquot – avec qui elle a vécu dès l’âge de 15 ans – s’exprime sur cette relation de façon abjecte pour que Judith Godrèche cesse de trembler. Et l’ouvre. Conseillée par différentes femmes, agressées elles aussi dans le passé par des hommes assurés de leur impunité, parmi lesquelles Hélène Devynck, qui fédère les victimes de PPDA. C’est ça que raconte notre enquête, ce long processus qui a conduit l’actrice à se révéler figure de proue du mouvement #MeToo dans le cinéma. Cette métamorphose ne s’est sans doute pas faite sans casse, elle a laissé des zones d’ombre que nous tentons d’éclaircir. Mais à tous ceux et peut-être aussi toutes celles qui murmurent leur ras-le-bol de ce déchaînement de haine contre des hommes vieillissants soudain cloués au pilori, il faut expliquer que les abus des hommes de pouvoir sur des jeunes filles ou des femmes sans défense – il ne se passe pas de semaine sans que de nouveaux exemples émergent – ont été tels, année après année et dans la plus parfaite indifférence si ce n’est approbation de la société, qu’il est normal que le balancier soit entraîné dans l’autre sens. Il faut que ça sorte. Un jour il reviendra à l’équilibre et l’on repensera avec émotion à ces femmes qui l’ont forcé à bouger. Légende photo : Judith Godrèche à Paris, le 8 mai. (Marie Rouge/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 6, 2024 2:14 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 6 mai 2024 L’homme de théâtre prolifique fait l’objet d’une plainte déposée en 2021 par l’un de ses anciens élèves, qui relate à «Libération» des années «d’assujettissement dominé par la peur» et les viols dont il aurait été victime dès l’adolescence. Pierre Notte, qui bénéficie de la présomption d’innocence, parle quant à lui d’une histoire d’amour. C’est l’histoire d’un homme de théâtre, dramaturge prolifique joué dans la France entière, écrivain et metteur en scène réputé, au parcours ascensionnel jalonné d’honneurs et de prix, et d’un jeune homme silencieux qui se percevait comme invisible tant sa présence n’était jamais interrogée. Alban K., 37 ans, a porté plainte le 10 décembre 2021 pour viols et agressions sexuelles sur mineur par un adulte ayant autorité. L’adulte ayant autorité est donc Pierre Notte, 54 ans, écrivain publié chez Gallimard dans la collection Blanche, homme de réseaux et de pouvoir, qui fut entre autres secrétaire général à la Comédie-Française de 2006 à 2009 puis rattaché à la direction du Rond-Point durant les années Ribes jusqu’en 2022. Mis en garde à vue, Pierre Notte a été entendu pour la première fois mercredi 24 avril par un officier de la police judiciaire. Selon nos informations, une confrontation avec le plaignant a eu lieu dans la foulée. A l’issue de celle-ci, Notte, présumé innocent, a été présenté à un juge d’instruction qui l’a mis en examen pour viol sur mineur commis par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction. Il est actuellement placé sous contrôle judiciaire. C’est un coup de théâtre, autorisons-nous ce cliché, et en tout cas le signe très net que quelque chose se fissure au royaume de l’impunité, y compris lorsqu’on prend soin de se construire une façade pro #MeToo : le dernier grand succès de Pierre Notte, Je te pardonne (Harvey Weinstein), créé après le confinement en 2021, est un réquisitoire en chansons contre les prédateurs sexuels et Weinstein en particulier qu’incarnait au plateau… l’auteur en personne. Pour Alban K., qui découvre la pièce à sa création, c’est un choc : «Je me souviens d’un effondrement total, d’un trou noir pendant quarante-huit heures, où je me dis ce n’est pas possible, l’impunité n’aura jamais de fin, ça va continuer. Après le déguisement en grand défenseur de la cause #MeToo, quelle sera la prochaine étape ?» C’est la vision de cette pièce qui décide Alban K. à joindre l’avocate Léa Forestier, qui a par ailleurs été le conseil juridique de Vanessa Springora dans l’affaire Matzneff. «Il fallait absolument que j’aille voir quelqu’un qui comprenne de quoi je parle.» Effectivement, l’histoire d’Alban K. telle qu’il la relate permet de comprendre les rouages subtils à l’œuvre sous le gros mot d’emprise. Quand Alban K. rencontre pour la première fois Pierre Notte en 2002, il a 15 ans et est en classe de seconde au lycée privé catholique Saint-Louis Saint-Clément à Viry-Châtillon. Pierre Notte, qui n’a pas encore créé la pièce qui le rendra célèbre et lui vaudra un molière et un prix de la SACD, Moi aussi je suis Catherine Deneuve, est son enseignant à l’option théâtre, coanimée par sa professeure de français, mariée à un grand ami de Notte, Thierry Jopeck. A 15 ans, l’adolescent traverse une période particulièrement éprouvante : il est stigmatisé, harcelé, insulté par ses camarades en raison de son orientation sexuelle tandis que son père, hospitalisé tantôt en clinique, tantôt à la maison, se bat contre un myélome multiple des os dont il décédera en décembre 2013. Dans ce contexte, nous explique Alban K., Pierre Notte va peu à peu gagner sa confiance en apparaissant comme «très protecteur», voire l’unique personne à qui il peut se confier. Comme il le dit dans sa plainte déposée le 10 décembre 2021 que Libération a pu consulter, Pierre Notte, une vingtaine d’années de plus que son élève, lui apparaît alors comme l’homme capable de sermonner devant lui les élèves qui le traitent de «pédale», de «tantouze», «fiotte» et autres insultes. C’est d’autant plus précieux que le milieu éducatif n’est pas encore suffisamment sensibilisé à la question du harcèlement. En première, l’enseignant Notte continue d’apparaître comme un «bouclier» pour l’adolescent. «Il me soulève comme un morceau de bois mort» Vient le jour d’un premier rendez-vous suscité par l’élève au Starbucks de l’Opéra – rappelons qu’il habite à une vingtaine de kilomètres de Paris. Surprise : l’adulte refuse d’entrer dans le café, et conduit le jeune homme de 16 ans, dans ce qui lui apparaît comme un labyrinthe, jusqu’à la rue du Pélican au centre de Paris, où il habite. Alban K. nous raconte alors d’une traite : «Et très vite, dès le portail rouge de l’immeuble, j’arrête de parler. On monte les deux étages, on est chez lui, on s’assoit à une petite table. Je suis assis sur une chaise, il est à genoux devant moi, mais même dans cette position, il est à ma hauteur, et là, il m’embrasse, aucune réaction de ma part. Juste le souvenir de l’horreur de sa barbe et le goût du café dans la bouche. Je ne dis rien, je ne réagis pas. Je suis prostré. Assez vite, il me soulève comme un morceau de bois mort car je ne marche pas moi-même. L’appartement est petit et il baisse mon pantalon et frotte son visage sur mes parties génitales, et tout ça se fait dans un silence total, sans aucun dialogue, sans aucune réaction de ma part, je me souviens que je fixe le plafond.» Comment se refuser à l’autorité d’un enseignant qui se présente comme un sauveur lorsqu’on vit une tragédie familiale et qu’on est victime de harcèlement en classe ? «Se crée alors une forme de dépendance dominée par la peur», peut-on lire dans la plainte. Le deuxième rendez-vous a lieu dans l’appartement de la professeure de français, comme Pierre Notte le relate de manière à peine transposée dans Quitter le rang des assassins, récit autobiographique au titre programmatique emprunté à Kafka, paru en 2018, chez Gallimard. Il est introduit dans la prestigieuse maison par le soutien de Matzneff, Christian Giudicelli, qui devient son éditeur. Une différence de taille tout de même : dans le récit, le personnage dénommé Not, «qui déshabille l’enfant de 17 ans, lentement, et l’embrasse partout», agit sur un corps qu’il dote de consentement. Pour Alban K., l’acte sexuel qu’il qualifie «d’agression» est d’autant plus «traumatisant» que tout se passe dans le lit de sa prof de français «qui ne sait rien de cette histoire, ni même que je suis chez elle». «Je dois me maintenir à disposition» Pierre Notte achète ensuite une chambre de bonne rue Jean-Jacques Rousseau, à Paris, qu’il surnomme de manière éloquente «la boîte». Alban K. se souvient : «Ce sont des rendez-vous qui se répètent et qu’il est impossible de refuser. Je sais que je dois y aller. Et donc je viens avec un sac que je remplis du plus d’affaires possibles car je ne sais jamais quand je vais pouvoir partir. Même quand il sort travailler, il est clair que je ne peux pas sortir, je dois l’attendre, me maintenir à disposition.» Alban K. se décrit comme réifié. En particulier, son mentor lui interdit de se laver. «Si jamais je prends une douche, ce sont des crises sans fin. Il me renifle partout, sous les bras, et s’il sent une odeur de savon, c’est un tribunal pendant au mieux des heures parfois des jours, avec la nuit, des cris – “Si tu te laves, tu le fais pour me contrarier.” Au point qu’au bout de plusieurs semaines, je puais, c’était horrible. Et en repartant chez moi, à chaque fois, je passais des heures à me laver. Il y a la libération par la douche.» Est également passée au crible son alimentation : «Il n’y avait aucune liberté ni dans le choix des aliments ni dans leur quantité toujours restreinte.» Avant de retrouver Notte, Alban K. prend donc l’habitude de manger un sandwich en cachette. Le contrôle semble sans limite : c’est clandestinement qu’Alban K. se souvient d’entrer dans des librairies. Il recouvre ensuite les livres achetés, et les dissimule au fond de son sac à dos. De fait, selon le plaignant, c’est toute activité autonome comme l’est par définition la lecture, qui devient proscrite sous peine de susciter des crises et colères terrifiantes dont Pierre Notte fait d’ailleurs état dans Quitter le rang des assassins. Tandis qu’en milieu scolaire, selon la plainte, Notte paraît souffler le chaud et le froid, alterne les scènes d’humiliation et de glorification d’Alban K., les rendez-vous se poursuivent soit dans la «boîte», ou dans l’appartement principal de l’homme de théâtre qui vit en couple, pacsé, comme Alban K. le découvre accidentellement au bout de quelques années – cette découverte est également racontée dans Quitter le rang des assassins. Ce qui n’est pas sans questionner Alban K. : «Pendant trois ans, j’ai été dans un appartement où il était imperceptible qu’un autre homme que Notte habite. Il n’y avait pas d’affaires, aucune trace, photo, objet. Tout était à lui, à son image.» La première sodomie, sans capote, a lieu à Saint-Brieuc pendant un voyage professionnel alors qu’Alban est en première. Rester sage comme une image Il y a un jour où, celui que Notte nomme «l’enfant» dans plusieurs textes, craque et explose en sanglots pendant un cours d’anglais. L’enseignante demande à l’élève de quitter la classe avant de recueillir ses confidences sur sa relation avec le professeur de l’option théâtre. La prof d’anglais s’en est-elle ouverte à sa collègue, prof de français ? L’après-midi même, Alban K. reçoit un appel du mari de cette dernière qui l’aurait exhorté à «rectifier le tir» auprès de la prof d’anglais afin de se protéger d’un «scandale» dont il aurait été très difficile de se relever. Alban K. n’imagine pas pouvoir mentir de vive voix. Il obéit à l’ordre mais par écrit. Nous n’avons pas réussi à joindre la professeure d’anglais, qui aurait, selon nos informations, corroboré les faits, par ailleurs relatés dans la plainte. Les liens et ce qu’Alban K. nomme «assujettissement» ne s’interrompent pas après l’obtention du baccalauréat. L’étudiant, qui s’est inscrit en études théâtrales à l’université Sorbonne Paris 3 reste très isolé, ce que confirme à Libération son unique amie rencontrée à la fac. «Alban K. a surgi dans le couloir comme apparition : en justaucorps, cheveux longs, androgyne, différent de tous. Il ne s’est pas confié à moi tout de suite. Sa relation avec ce monsieur Notte était cachée.» Alban K. lui apparaît sans cesse pressé : «Il avait peur, il devait faire des courses pour lui. Son empressement mêlé de terreur était frappant. Je n’ai croisé Pierre Notte qu’une seule fois furtivement place Colette à Paris.» De même qu’Alban K. se cache pour se nourrir, de même il voit son amie «dans la clandestinité», souvent au Quicampe, rue Quinquampoix, qui dispose d’une arrière-salle – «pour éviter que les passants puissent nous voir de la rue». Pierre Notte se déplace avec son garçon trophée partout, l’emmène à des premières, à des soirées mondaines, des dîners entre gens aisés et connus, et toujours beaucoup plus âgés que lui. Mais tout se passe comme si sa beauté confondante suffisait à justifier sa présence et, selon Alban K., personne ne songe à s’intéresser à ce qu’il aime, pense ou même à la nature de sa relation avec Notte. Il va de soi qu’il doit rester sage comme une image. De fait, nous relate Alban K., quand lors d’un dîner, il fait mine de rire, ou s’exprimer, un regard de son mentor suffit à l’en dissuader. Une seule fois, une femme lui pose une question personnelle : l’actrice Valérie Lang. C’était tellement inhabituel qu’Alban K. s’en souvient. De même à la Comédie-Française où Notte exerce un haut poste et où, dans son bureau, Alban K. voit défiler tous les comédiens sans qu’ils ne semblent s’apercevoir de sa présence. A l’exception de Muriel Mayette-Holtz, à l’époque administratrice de la maison de Molière, qui décrit «un jeune homme silencieux qui marchait toujours derrière Pierre Notte». Pour autant, l’année universitaire se révèle un pas vers la liberté. Alban K., qui ne peut toujours ni lire ni étudier chez Pierre Notte, va peu à peu fomenter son évasion grâce à un job d’étudiant au théâtre des Variétés. En cachette de Pierre Notte, Thierry Jopeck, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions, accepte de se porter caution. Sentiment d’une rupture d’égalité entre le plaignant et le mis en cause Selon la plainte, en 2009, un week-end à Trouville est décisif. Notte, furieux de voir Alban K. lui échapper, menace de se tuer ou de le tuer. Le risque doit être sérieux pour que l’ami Jopeck, qu’Alban K. appelle en détresse, lui conseille de s’enfuir par la fenêtre – pendant qu’il lui prend un billet de train. «Silence, peur, bruit de couteau : la mort n’était vraiment pas loin ce jour-là», se remémore Alban K.. Une «tyrannie» dont Pierre Notte semble avoir conscience selon un courrier que nous avons pu consulter où il évoque ce week-end. Mais c’est un an plus tard, et beaucoup plus loin, au Canada, qu’Alban K. choisira de s’enfuir. Il y vit pendant cinq ans grâce à des bourses et un poste d’auxiliaire de recherche afin de poursuivre des études de lettres. Loin, il écrira une première pièce de théâtre dont il détectera bien après sa parution qu’elle porte sur le viol et l’enfermement. Dans sa préface, Thierry Jopeck atteste avoir connu Alban K. adolescent et fait une corrélation curieuse entre ses souvenirs de l’auteur à cet âge, les désirs qu’il inspirait, et Gabriel Matzneff. Lorsqu’on le rencontre une première fois à la mi-février 2024 dans le bureau de ses conseils Léa Forestier et Alix Aubenas, Alban K. frappe par sa précision et l’étayage de ses formulations en dépit de la terreur perceptible que lui inspire encore Pierre Notte, quatorze ans après la fin de toutes relations. Le processus judiciaire est alors enlisé. Près de trois ans après le dépôt de plainte et malgré la gravité des accusations, l’enquête prend du temps à démarrer, donnant le cruel sentiment à ses conseils et à Alban K. d’une rupture d’égalité entre le plaignant et le mis en cause. Selon Léa Forestier, Pierre Notte «dispose d’une forme d’agora médiatique, avec ses projets qui lui permettent de montrer publiquement un engagement professionnel en faveur du mouvement #MeToo», tandis qu’Alban K. et ses conseils sont tenus au silence par respect de la procédure. Et surtout, selon les avocates et leur client, un risque demeure : Pierre Notte, qui présente des master class au cours Florent où certains étudiants ont moins de 18 ans, peut être susceptible de répéter un comportement prédateur auprès de très jeunes gens. Confrontation libératrice Tout s’accélère cette fin avril. Mieux : une confrontation que redoutait infiniment Alban K. se révèle libératrice et en partie réparatrice. Pendant la confrontation, où le mis en cause est dos au plaignant – ils ne se dévisagent donc pas –, Alban K. s’est senti libre de poser toutes les questions qui le travaillent depuis quinze ans. D’une certaine façon, avant même qu’on sache si un procès aura lieu, la justice permet au plaignant d’avancer. «L’énorme poids sur la poitrine que je porte depuis ma rencontre avec cet homme s’est dissous», nous dit-il, d’une voix pour la première fois joyeuse. De son côté, Pierre Notte, qui n’a pas souhaité nous rencontrer, nous écrit par mail qu’il est «anéanti par la situation». Il dit avoir vécu «avec Alban, du printemps 2004 à l’année 2011, une histoire d’amour qui s’est, les derniers mois, fragilisée et délitée, comme le font souvent les histoires d’amour». Et qu’il «conteste et réfute définitivement, fermement, absolument, toutes les accusations d’agressions sexuelles et de viols portées par Alban». Plus précisément, il qualifie leur relation de «strictement et absolument amoureuse». Et explique : «Nos nombreux échanges (les lettres, les messages audios qu’il me laissait, les photos et les mails qu’il m’adressait, etc.) montrent qu’Alban n’était ni terrorisé, ni impressionné, ni contraint, ni forcé, ni soumis. Notre relation n’était pas cela, elle ne reposait pas, en aucun cas, absolument pas, sur des inégalités. Nous communiquions abondamment, amoureusement et sainement.» Pour le plaignant, ce qu’il nomme le «déni» de Pierre Notte est d’autant plus surprenant que son attitude et ses propos tenus lors de la confrontation (filmée) lui ont semblé d’une tout autre teneur. Légende photo : Le dramaturge Pierre Notte à Paris, le 12 décembre 2022. (Corentin Fohlen/Divergence)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 30, 2024 5:03 PM
|
par LIBERATION et AFP le 30 avril 2024 Dans une autobiographie à paraître le 1er mai, Isild Le Besco revient sur sa relation avec le réalisateur alors qu’elle n’avait que 16 ans et lui 52. L’actrice explique qu’elle n’est pas encore prête à porter plainte, bien qu’affirmant que le réalisateur l’a «violée». Elle ne sent pas encore prête. Dans Dire vrai (éditions Denoël), une autobiographie à paraître mercredi 1er mai, Isild Le Besco explique que, pour l’instant, elle ne s’imagine pas porter plainte contre Benoît Jacquot, dont elle estime pourtant qu’il l’a «violée». Dans son livre, elle revient sur sa relation avec le réalisateur, entamée sur le tournage de Sade, alors qu’elle avait 16 ans et lui 52. «Je n’ai pas envie de me confronter encore à ces institutions poussiéreuses, pensées et régies par des hommes […] C’est déjà tellement éprouvant d’écrire. De nommer. De faire face à ses maux», décrit l’actrice de 41 ans, sœur de la réalisatrice Maïwenn. Elle dit ne pas avoir répondu aux enquêteurs de la brigade des mineurs, qui souhaitent pourtant l’entendre. «Ils me sollicitent et me sollicitent encore pour recueillir ma plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon.» Se décrivant comme une adolescente «fragile et malléable», Isild Le Besco expliquait en février les effets destructeurs qu’a eue sur elle la relation entretenue entre ses 16 ans et ses 21 ans. Elle dénonçait une relation faite de «violences psychologique» ainsi qu’une emprise que le réalisateur de 52 ans exerçait sur elle. «Être victime, oui, mais de qui ? Et de quoi exactement ? De la sexualisation de mon corps au cinéma ? Des années d’emprise de Benoît Jacquot ? Du manque d’éthique professionnelle de Jacques Doillon ?», s’interroge-t-elle dans son ouvrage. Elle complète : «Dire que Benoît m’a violée, c’est évident […] J’étais une adolescente et je lui ai donné mon entière confiance. Il s’est substitué à mon père, ma mère, à toute figure d’autorité. En cela, son viol est aussi incestueux». Toujours en février, Isild Le Besco avait déclaré qu’il était «probable qu’à un moment» elle porte plainte contre les deux réalisateurs, en réaction aux accusations portées contre eux par l’actrice Judith Godrèche. Sa plainte a déclenché l’ouverture d’une enquête à leur encontre pour «viol sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité», et lancé un débat public sur les violences sexistes et sexuelles faites aux mineurs dans le cinéma. Si les deux réalisateurs nient toute accusation de relations non consenties, Jacques Doillon va plus loin, se disant victime de «mensonges», et en «mort sociale». Légende photo : Isild Le Besco, le 12 juin 2020. (Dominique Charriau/WireImage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 18, 2024 3:06 AM
|
par Bruno Deruisseau dans Les Inrocks - 16 avril 2024
Publié le 16 avril 2024 à 19h00
Mis à jour le 26 mars 2024 à 17h36
Nous avons sollicité une trentaine de comédiens. Seuls six d’entre eux, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Reda Kateb, Jérémie Renier, Corentin Fila et Nahuel Pérez Biscayart, nous ont répondu.
“Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas.” Cette phrase prononcée par Judith Godrèche sur la scène de la 49e cérémonie des César résonnait toujours une fois la soirée terminée. Car son discours eut bien peu d’échos durant le reste de la soirée. Quasiment aucune parole masculine publique pour apporter un soutien à l’actrice-réalisatrice, que ce soit avant, pendant ou depuis la cérémonie. Ce silence des hommes sur les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS) dans le milieu du cinéma devient assourdissant. C’est pour le briser que nous avons demandé à une trentaine d’acteurs du cinéma d’auteur français de s’exprimer sur la vague MeToo qui arrive enfin sous nos latitudes. De l’absence de réponse au refus non justifié, en passant par la frilosité à se politiser sur ce sujet ou le manque de temps, le malaise de la plupart des acteurs est palpable. Seuls six d’entre eux ont accepté de répondre, avec, il faut le souligner, un vrai souci de précision dans leur parole et un investissement non feint : Melvil Poupaud, Niels Schneider, Reda Kateb, Jérémie Renier, Corentin Fila et Nahuel Pérez Biscayart. “Nous avons tous quelque chose à nous reprocher” Pour Melvil Poupaud, c’est “un sujet très sensible chez les hommes, comme chez les femmes ; pas facile pour une personne victime d’abus – et il y en a chez les garçons plus qu’on ne peut l’imaginer – d’oser parler ; délicat pour ceux qui n’ont pas la conscience tranquille d’oser faire leur examen de conscience, voire des excuses, voire des aveux. Sans parler de ceux qui risquent gros…Nous avons tous quelque chose à nous reprocher, de la mauvaise blague à des faits bien plus graves. Il faut du courage pour parler de ce qu’on a subi ; il en faut aussi pour reconnaître ses fautes”. Si Nahuel Pérez Biscayart (la révélation de 120 Battements par minute) évoque la difficulté à “rompre une forme d’allégeance à la masculinité”, tous s’accordent pour témoigner de leur admiration devant le courage et la force des prises de parole de Judith Godrèche. Pour Niels Schneider, “on est arrivé à un moment où la société ne veut plus des VHSS. C’est important que les acteurs, et plus largement les hommes, écoutent et encouragent ces prises de parole dans un premier temps, puis expriment leur soutien par une parole privée, mais aussi médiatique quand cela est nécessaire et réclamé par les premières concernées”. “J’ai le sentiment que nous, les hommes, avons plus de mal à nous investir dans une cause lorsque nous ne nous sentons pas directement concernés” Jérémie Renier Tandis que Jérémie Renier observe chez la plupart des hommes une plus grande difficulté à être sensibilisé sur ce sujet : “Je le vois même à travers mon implication dans Cut, une association qui promeut la transition écologique du secteur du cinéma : c’est une majorité de femmes qui s’engagent sur ces questions. Que ce soit les VHSS ou l’écologie, j’ai le sentiment que nous, les hommes, avons plus de mal à nous investir dans une cause lorsque nous ne nous sentons pas directement concernés. Nous avons collectivement une marge de progression sur nos capacités d’écoute et d’engagement.” Des éducations féministes La dialectique du privé et du public semble au cœur du soutien des hommes. En plus d’un indispensable mais souvent douloureux examen de conscience, les acteurs prêts à soutenir la parole des actrices ont souvent à leurs côtés une femme engagée sur ces questions, que cela soit une compagne, une fille ou une mère qui a participé à leur éducation féministe. Il s’agit aussi d’hommes dont le parcours est marqué par une mise à distance des clichés liés au patriarcat. “Si je suis sensible à ces questions, c’est aussi parce que je ne me suis jamais reconnu dans une forme de masculinité hégémonique. J’ai très tôt trouvé ça assez archaïque de devoir réserver la douceur, la tendresse et le soin au genre féminin. Cette binarité n’a, pour moi, pas de sens”, nous dit Niels Schneider. “Il s’agit simplement de protéger la moitié de l’humanité d’agressions graves” Reda Kateb De son côté, Corentin Fila, César du meilleur espoir masculin pour Quand on a 17 ans en 2016, revendique l’influence de sa compagne, l’actrice Daphné Patakia, cofondatrice de l’ADA (Association des acteur·rices), dans son éveil sur ces questions : “Elle a fait mon éducation et m’a permis de prendre conscience du caractère systémique de ces violences, des liens avec d’autres formes de discriminations comme le racisme et des ravages en matière de troubles et de pathologies chez les victimes. Je lui suis énormément reconnaissant pour cela. À son contact, j’ai pris conscience des comportements problématiques que j’ai pu avoir par le passé et j’ai réalisé que chaque homme est conditionné à être un potentiel agresseur.” Melvil Poupaud rend quant à lui hommage à sa fille, “très concernée par ces causes, et qui a (re)fait [son] éducation” : “Sans elle, je serais un encore plus gros boomer !” Être un allié consiste notamment pour Reda Kateb à “choisir consciencieusement ses collaborateurs et collaboratrices en plaçant l’éthique au centre”, à militer pour généraliser la présence de référent·es VHSS sur les plateaux et de coordinateur·rices d’intimité sur les scènes de sexe “pour travailler dans un climat sain et rassurant pour tout le monde” et, enfin, à récuser le terme de “chasse aux sorcières, alors qu’en fait il s’agit simplement de protéger la moitié de l’humanité d’agressions graves”. Des collaborations problématiques Alors, que se passe-t-il lorsqu’on fait remarquer aux acteurs ayant accepté de répondre qu’ils ont travaillé avec des cinéastes accusés d’agressions ou de harcèlement sexuels, que cela soit Woody Allen (Melvil Poupaud et Niels Schneider), André Téchiné (Nahuel Pérez Biscayart et Corentin Fila), Benoît Jacquot (Nahuel Pérez Biscayart et Niels Schneider) et Roman Polanski (Melvil Poupaud) ? Il y a ceux qui affirment en toute bonne foi qu’ils n’étaient pas au courant à l’époque du tournage, ceux qui revendiquent le fait de ne pouvoir se substituer à la justice et ceux qui jugent le sujet trop complexe pour motiver leur décision en quelques mots. Complexe, le sujet l’est assurément, les faits reprochés et les situations judiciaires de chacun des cinéastes étant tous différents. “Je n’ai rien remarqué de particulier sur le tournage. Cependant, avec ce que je sais aujourd’hui, ce que raconte le film m’interroge” Nahuel Pérez Biscayart Comme le souligne Niels Schneider : “Il est important de laisser aussi la possibilité d’une rédemption, dans certains cas et selon la gravité des faits, sans parler de justice, car la façon dont la justice peine à condamner les agresseurs est un autre débat tout aussi important. Mais le préalable à toute rédemption, c’est la reconnaissance de la souffrance infligée aux femmes. Le fait d’accepter que, non, ce n’était pas rien, qu’au contraire, c’est très grave. La négation de la parole des femmes est insupportable et pourtant quasi systématique. C’est à cet endroit que la révolution que nous vivons se joue.” D’autres se désolidarisent des cinéastes en question ou mettent en perspective leur œuvre avec les accusations dont ils font l’objet. “Quand j’arrive sur le tournage du film de Benoît Jacquot, je ne parle pas un mot de français., se souvient Nahuel Pérez Biscayart. Je comprends assez vite que l’actrice principale du film, Isild Le Besco, a été en couple avec le cinéaste. Mais je n’ai rien remarqué de particulier sur le tournage. Cependant, avec ce que je sais aujourd’hui, ce que raconte le film m’interroge. J’y joue une sorte de sauvage qui ensorcelle le personnage d’Isild pour l’amener à lui. Pour moi, le film parle clairement du consentement : est-elle avec mon personnage parce qu’elle le veut ou parce qu’elle est sous emprise ? Quant à Téchiné, avec qui j’ai fait un film qui va sortir, je lui reproche des choses qui n’ont rien à voir avec les VHSS. Il a été méprisant et violent verbalement avec moi. J’ai dû mettre un frein à son comportement.” La fin de l’impunité sur les plateaux ? Pour Jérémie Renier, signataire comme Nahuel Pérez Biscayart d’une tribune contre le sexisme dans le cinéma français lors du dernier Festival de Cannes, apporter son soutien à la cause des femmes passe aussi par le choix d’incarner de nouveaux récits : “En choisissant de faire un film comme Slalom de Charlène Favier, où je joue un coach de ski qui exerce une emprise et abuse sexuellement de son élève, il y a, entre autres, le désir de participer à l’ouverture d’un nécessaire débat sur ces questions.” Tous ont vu ou entendu des histoires de harcèlement ou d’agressions durant leur carrière, comme l’affirme Nahuel Pérez Biscayart : “Depuis cinq ans, j’entends des histoires qui me glacent le sang. L’abus de pouvoir des cinéastes et des producteurs en France est très grave. Tout le monde est au courant. Ce que nous savons aujourd’hui n’est que la partie émergée de l’iceberg.” Alors comment réagir ? “Ce qui est révoltant, c’est que le cinéma ait servi à certains de couverture à des comportements qui n’ont rien à voir avec de l’art” Niels Schneider “Il est arrivé que j’apprenne que plusieurs actrices avaient été agressées par un acteur avec qui je devais tourner. J’ai prévenu le producteur que s’il se passait le moindre problème sur le tournage, je quitterais le projet”, affirme Niels Schneider. Corentin Fila nous confie qu’en 2018, il a “été témoin des attouchements auxquels s’est livré un chef opérateur libidineux d’une cinquantaine d’années sur une actrice de 17 ans. Personne n’a rien fait, je n’ai rien osé dire, ce serait différent aujourd’hui”. Quant à l’impunité particulière dont jouissent les auteurs de VHSS en France, tous s’accordent à dire qu’il existe particulièrement chez nous une confusion entre liberté créatrice et abus de pouvoir : “Ce qui est révoltant, c’est que le cinéma ait servi à certains de couverture à des comportements qui n’ont rien à voir avec de l’art”, dit Niels Schneider, tandis que selon Reda Kateb, “la pire période va des années 1970 aux années 1990. Durant cette période, il y a eu une vague d’abus dont la presse était d’ailleurs complice. Abus dont ne sont pas seulement victimes les femmes d’ailleurs. Au-delà de la condition féminine, le débat mérite d’être aussi élargi à la protection des enfants et des personnes vulnérables”. “Un système d’allégeance et de complicité envers les agresseurs” Pour Nahuel Pérez Biscayart, “il y a une grande confusion entre le travail et la vie intime en France. C’est arrivé qu’après que j’ai décroché un rôle, le réalisateur m’écrive pour réclamer qu’on se mette au travail et qu’on s’aime, comme si ça allait de pair. Il n’y a qu’en France que l’expression ‘on ne peut plus rien dire’ est si populaire. Je crois que ces personnes confondent liberté d’expression et privilèges. Il n’y a aussi qu’en France qu’on parle de ‘la grande famille du cinéma’. Quand on sait à quel point les VHSS sont d’abord intrafamiliales, ce terme est révélateur et symbolise bien le système d’allégeance et de complicité envers les agresseurs, système dont le CNC [Centre national du cinéma et de l’image animée] fait partie en conservant à sa tête un président accusé d’agression sexuelle par son filleul. En tant qu’hommes, nous avons comme devoir d’écouter et de croire la parole des femmes, d’être solidaires de leur combat. J’essaie pour ma part de tisser un réseau de tendresse et de bienveillance avec les gens avec qui je travaille. Il faut faire comprendre aux agresseurs qu’il y a de moins en moins de complices de leurs actes”. Légende photo : Reda Kateb et Melvil Poupaud © Francois Berthier et Sebastien Vincent//Contour by Getty Images

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 8, 2024 5:16 PM
|
Publié par Le Monde avec AFP le 8 avril 2024 La police croate a ouvert une enquête après les aveux du réalisateur de 49 ans, qui a souvent utilisé ses films pour faire la critique de la culture patriarcale et des violences faites aux femmes. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/international/article/2024/04/08/prime-au-festival-de-cannes-dalibor-matanic-celebre-realisateur-croate-avoue-plusieurs-agressions-sexuelles_6226678_3210.html
L’un des réalisateurs les plus célèbres de Croatie, Dalibor Matanic, 49 ans, a avoué dans un long post sur Facebook, après la publication de plusieurs articles de presse, avoir agressé sexuellement plusieurs femmes, déclenchant un tonnerre de réactions. La police croate a ouvert une enquête. « Tout ça a eu lieu à des moments où j’étais sous l’influence de l’alcool ou de drogues. Notre travail est terriblement stressant – mais cela ne justifie certainement pas mon comportement », a-t-il écrit, après la parution d’articles de presse faisant notamment état de gestes et d’invitations déplacés et d’envois de photos et de messages à caractère sexuel. Environ deux cents femmes seraient concernées par les agissements du réalisateur, qui a annoncé qu’il allait entrer dans un centre de désintoxication. « D’après les informations publiées dans la presse, il pourrait s’agir d’actes criminels », a déclaré le responsable de la police, Antonio Gerovac, cité par l’agence de presse officielle HINA, annonçant l’ouverture d’une enquête. Jusqu’à présent, la police n’a enregistré aucune plainte, a-t-il ajouté. « Il se présentait comme un allié » Par ailleurs, l’Académie des arts dramatiques de Zagreb, où M. Matanic donnait occasionnellement des cours, a annoncé que leur coopération avait « pris fin à la fin du semestre d’hiver » et qu’elle ne serait pas renouvelée. Le réalisateur, primé à Cannes en 2015 pour son film Soleil de plomb (Prix du jury Un certain regard), a souvent utilisé ses films pour faire la critique de la culture patriarcale et des violences faites aux femmes. « C’est un choc terrible, car il se présentait comme un allié », a réagi la militante des droits des femmes Sanja Sarnavka. La violence et les agressions sexuelles ont longtemps été considérées comme des sujets tabous dans les Balkans, où les valeurs patriarcales restent très ancrées. Ces questions ont cependant pris davantage d’importance ces dernières années après l’avènement du mouvement #metoo et une affaire en Serbie voisine où une actrice a accusé son ancien professeur d’art dramatique, Miroslav Aleksic, de viol, ce qui a incité des milliers de femmes à raconter leur propre histoire. Le Monde avec AFP --------------------------------------------- Violences sexuelles #MeToo cinéma : le réalisateur Philippe Lioret accusé par dix comédiennes d’agressions sexuelles et «d’abus de pouvoir» Radio France a recueilli le témoignage de dix actrices dénonçant le comportement «inapproprié» du cinéaste, en particulier lors des castings pour son film «Toutes nos envies», en 2010. par LIBERATION La chape de silence entourant le cinéma français se fend-elle, pas à pas ? Ce mardi 9 avril, c’est un nouveau réalisateur qui est mis en cause, après les cas Doillon et Jacquot en début d’année. Pas moins de dix comédiennes dénoncent auprès de la cellule investigation de Radio France le comportement de Philippe Lioret, mêlant baisers forcés, gestes et demandes inappropriés. C’est en particulier le casting de son film Toutes nos envies, inspiré du roman D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère, qui est pointé. En été 2010, le cinéaste, auréolé des succès Je vais bien ne t’en fais pas et Welcome, effectue des castings avec le Tout-Paris. «Une cinquantaine d’actrices», reconnaît-il auprès de Radio France, dont Judith Godrèche, Emma de Caunes, Mélanie Bernier, Cécile Cassel, Laetitia Casta, Virginie Efira ou encore Marie Gillain, auditionnées pour le rôle de Claire, magistrate en couple avec Stéphane (joué par Vincent Lindon) et Céline, une mère surendettée. Les témoignages recueillis par Radio France font état d’un même procédé, Lioret donnant rendez-vous pour une séance de travail, parfois le samedi alors que les bureaux de production sont fermés, et choisissant une scène intime dans laquelle il donne la réplique à l’actrice auditionnée. «Je me dis : “Pourquoi ce choix de scène ? Il est le réalisateur, pas l’acteur avec lequel je jouerai.” C’est gênant, relate Hélène Seuzaret, l’une des actrices qui témoignent, avec Elodie Frenck, Emilie Deville, Marie Gillain, Amandine Dewasmes et d’autres qui ont préféré garder l’anonymat. Une fois dehors, alors qu’on retourne à nos véhicules respectifs, [Philippe Lioret] essaye de m’embrasser sur la bouche. Ce n’est pas du tout ce dont j’avais envie. C’est comme un abus de pouvoir : il se permet, parce que je suis en attente de ce rôle, de me voler un baiser.» «Avec le recul, je pense que c’est une agression sexuelle» Une comédienne, anonyme, ayant vécu la même chose dans les années 90, raconte : «C’est humiliant de se faire embrasser violemment comme ça. D’où a-t-il le droit de m’embrasser sans que j’aie donné mon consentement ? D’où a-t-il le droit de me traiter comme ça, de manière brutale ? A cette époque, je ne me disais pas que c’était une agression sexuelle. Mais aujourd’hui, avec le recul, je pense que c’en est une.» C’est le cas aussi d’une autre actrice, embrassée sur la bouche par surprise après un dîner vécu comme un «piège», en marge des auditions de Toutes nos envies : «Il voulait sans doute savoir si j’étais ‘‘souple’’, si j’étais prête à ça pour avoir un rôle, raconte l’actrice. J’ai été utilisée à cette fin de pouvoir me consommer. Voilà comment je l’ai vécu. Il n’y avait rien d’artistique là-dedans.» La comédienne Emilie Deville, elle, parle «d’abus de pouvoir». Elle raconte, lors d’un essai pour ce même film, le choix d’une scène entre une mère et son enfant. «[Philippe Lioret] fait l’enfant de 6 ans, il se met à genoux et il attrape mes hanches. Il colle son visage sur mon sexe en disant : “Maman !” Il me demande de caresser ses cheveux, de consoler le soi-disant enfant que j’ai entre les jambes, lui qui à l’époque avait 53 ans !» Certaines comédiennes, relate Radio France, affirment que le réalisateur leur aurait demandé de «montrer leurs seins». L’assistante de la directrice de casting témoigne également que le cinéaste «ne se privait pas de toucher la naissance des seins, de se mettre dans le cou des comédiennes. Les actrices étaient tellement mal à l’aise dans les bras de Philippe de se faire tripoter comme ça». «Je n’ai jamais eu la sensation d’essayer d’abuser de qui que ce soit de toute ma vie», s’est défendu Philippe Lioret, interrogé sur ces témoignages. «Qu’il ait pu tenter de séduire, ça, c’est tout à fait possible. Mais il s’est toujours arrêté dès lors qu’il s’est trouvé face à un refus», a réagi son avocate, Solange Doumic.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2024 12:43 PM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération - 25 mars 2024 Adaptée d’un roman de Marieke Lucas Rijneveld, la pièce du metteur en scène belge décortique une mécanique pédocriminelle à la Villette à Paris. Elle a 14 ans, Kurt en a 49. Elle n’a pas de prénom, désignée dans la distribution comme «la fille». Décidément, quelque chose ne va pas. Son père est fermier, il se tait depuis la mort du petit frère. Elle se rêve rock star comme Kurt Cobain, fascinée par le «club des 27» ; mourir jeune et reconnue, elle a encore le temps, alors elle se rappelle la lettre d’adieu du chanteur avant son suicide, quelque chose comme : «Il y a du bien en nous tous, et je pense que j’aime trop les gens tellement que ça me rend triste.» Heureusement, il y a Kurt, le vétérinaire, marié, un enfant, qui fait de la mob sur le plateau, emmène La Fille danser, c’est de leur âge. Kurt comme Cobain, c’est un signe. Un type sympa avec qui partager ses rêves, chanter un Total Eclipse of the Heart de circonstance en se marrant, se coucher dans la paille pour regarder ensemble le ciel, les nuages, les merveilleux nuages qui passent sur l’immense écran panoramique au-dessus de la scène. Le père, lui, écoute Vivaldi, il n’a encore rien compris. Et puis un jour, on annonce «le petit taureau est mort» à cette Agnès de la campagne. L’orage éclate sur la vidéo, sur scène, on a changé de disque, c’est I Will Always Love You qu’ils gueulent tous les deux, «We both know I’m not what you, you need», – «nous savons tous les deux, que je ne suis pas celui /celle qu’il te faut». Elle 14 ans, Kurt 49, sous la pluie qui inonde le plateau. C’est un jeu pour La Fille qui mime la star sous les éclairs comme dans un clip avec son pote le véto. Ça ne l’est plus du tout pour Kurt, avec passage à l’acte : le baiser. Forcément, puisqu’ils se comprennent, qu’ils sont complices, le baiser c’est ce qu’on fait quand on «always love you». Point de vue Mais ça, c’est le discours de Kurt, qu’il s’est construit depuis des années à visiter le père de La Fille pour soigner ses vaches. C’est son point de vue pédophile, qui s’exerce dans le roman, best-seller controversé en 2021, de Marieke Lucas Rijneveld – 23 ans, écrivain·e non-binaire, premier·ère romancier·ère néerlandais·e à remporter le Booker International Prize – de la même manière qu’Humbert Humbert était le narrateur du Lolita de Nabokov. Cette histoire d’amour, c’est ce qu’il se raconte, Kurt, 49 ans quand même, avec un passé qu’on découvre traumatique dans des scènes de violence sexuelle sous la domination d’une mère incestueuse. Le roman était la confession écrite en prison de Kurt. Encore une parole de prédateur, s’était-on offensé à sa sortie. Dans un entretien, Marieke Lucas Rijneveld expliquait ce choix : «Ce roman est en partie basé sur mon vécu. J’ai connu une situation plus ou moins similaire, mais je ne pensais pas écrire sur le sujet. J’ai choisi le vétérinaire comme narrateur, car il aurait été trop difficile pour moi, trop proche, de devenir la narratrice, d’expliquer que la jeune fille a laissé les choses se passer…» En adaptant le texte sur scène, Ivo Van Hove déplie magnifiquement la parole de La Fille et fait entendre ce que Rijneveld ne pouvait alors écrire : son théâtre a guéri le roman. Responsable La force de la mise en scène est de juxtaposer sur le plateau à découvert, sans changement de décor, ni de comédiens, l’enfance violée de Kurt et celle de La Fille. Ça n’excuse pas le baiser, ni le reste, ça montre qu’il y a deux enfants sur le plateau, mais avec des années de différence, et ça, ça fait interprétation. D’ailleurs voilà Freud qui débarque en personne dans la ferme. Y a du boulot au vu de ce qui se dit : «Il y a en moi un petit garçon démuni qui aimerait tant jouer avec toi… Tu me fais sentir jeune et je suis sûr que tout ça est arrivé à cause de ma mère… Elle m’a laissé une blessure durable que j’essaie de guérir grâce à toi…» La Fille, puisqu’il est admis qu’elle n’a pas de nom – comment en aurait-elle un quand elle n’est qu’instrument de réparation ? Donnons au moins celui de la jeune comédienne, excellente : Eefje Paddenburg – va devoir alors prendre tout sur elle. Quatorze ans et responsable de tout : de Kurt et de sa mère aux jambes écartées, mais aussi de la mort violente de son petit frère, du silence du père qui regarde passer les Saisons chez Vivaldi, des vaches malades qu’on va devoir abattre, du «petit taureau [qui] est mort», et puis le 11 Septembre, c’est elle, elle le sait ; la mort de Jésus, toujours elle. Qu’en dit le Freud qui s’avance pour la deuxième fois sur le plateau ? On a noté dans le noir de la salle, pour ne rien perdre, quelque chose comme : «Il faut aimer quelqu’un pour ne pas tomber malade. Au bout du compte, ça se résume à ça : les gens tombent malades quand ils ne peuvent pas aimer.» Mon Bel Animal, d’après le roman de Marieke Lucas Rijneveld, mise en scène d’Ivo van Hove, du 28 au 30 avril, Grande Halle de la Villette, Paris Légende photo : Katelijne Damen, Hans Kesting et Eefje Paddenburg dans «Mon Bel Animal». (Jan Versweyveld)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 4, 2024 4:13 AM
|
Publié sur le site de Francetvinfo.fr - 8 février 2024 "C'est de la pédocriminalité, ce n'est pas autre chose", affirme jeudi sur franceinfo Geneviève Sellier, professeure émérite en études cinématographiques à l’université Bordeaux Montaigne. "Le cinéma d'auteur depuis la Nouvelle Vague a favorisé ce type de comportement", a estimé jeudi 8 février sur franceinfo Geneviève Sellier, professeure émérite en études cinématographiques à l’université Bordeaux Montaigne et directrice de publication du site "Le genre & l’écran". L’actrice Judith Godrèche a confié jeudi sur France Inter avoir été victime d'abus de la part du réalisateur Jacques Doillon sur le tournage du film La Fille de quinze ans. Elle a également porté plainte contre le cinéaste Benoît Jacquot pour viols sur mineure. Le cinéma d’auteur met "au pinacle l'idée que la création est associée à l'expression du désir masculin comme quelque chose de forcément transgressif", a expliqué Geneviève Sellier. Selon elle, c’est une spécificité française. "Des gens comme Woody Allen et Roman Polanski sont les rois en France alors qu'ils sont des criminels à Hollywood", a-t-elle regretté. franceinfo : Il y a quelque chose de systémique dans le cinéma français ? Geneviève Sellier : Je suis accablée par toutes ces révélations, en particulier par la dimension de violence de ces relations perverses. Il faut quand même mettre des mots là-dessus. C'est de la pédocriminalité, ce n'est pas autre chose. Ce qui est très troublant pour nous, c'est que le cinéma français, en particulier le cinéma d'auteur depuis la Nouvelle Vague, a évidemment favorisé ce type de comportement en mettant au pinacle l'idée que la création est associée à l'expression du désir masculin comme quelque chose de forcément transgressif et donc original, remarquable, artistique, etc. Il y a vraiment un climat délétère qui s'est installé dans le cinéma français d'auteur depuis la Nouvelle Vague et qui est largement responsable de ces abus. La libération sexuelle dans les années 70 a-t-elle joué un rôle dans ces graves dérives ? Le problème, c'est que la soi-disant libération sexuelle des années 70 a été en réalité un blanc-seing accordé à l'expression du désir masculin dans un contexte de domination totalement asymétrique entre les hommes et les femmes. En fait, la combinaison entre le culte de l'auteur généré par le mythe de la Nouvelle Vague et ce climat de pseudo-libération sexuelle qui autorisait des gens comme Benoît Jacquot à considérer que c'était transgressif de violer des filles à peine pubères. Ce climat-là est systémique. Est-ce que c’est spécifique au cinéma français ? Ce qui est spécifiquement français, c'est le culte de l'auteur qui fait que des gens comme Woody Allen et Roman Polanski sont les rois en France alors qu'ils sont des criminels à Hollywood. Il y a une différence. Et la différence, c'est le culte de l'auteur, c'est-à-dire l'idée que l'artiste est au-dessus des lois. Ça s'est développé en France et pas ailleurs parce que la culture est associée à la fois à une sorte de culte de l'éros comme forcément transgressif. Ça autorisait en quelque sorte une forme de perversion qui est de la pédocriminalité à s'exprimer comme quelque chose de valorisé esthétiquement et artistiquement. Pourquoi dans les années 80, personne dans le cinéma français ne condamne ? La libération sexuelle des années 80 est totalement dans ce déni de la domination masculine. Pendant toute cette période, il y a une valorisation de la nudité des filles, pas des hommes, et des filles de plus en plus jeunes. Tout cela se fait au nom du caractère transgressif d’une sexualité qui est dans le caractère dominateur et totalement invisible. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre d'un mythe du créateur et de sa muse ? C’est Pygmalion. C'est l'idée que grâce à son génie l’artiste donne vie à sa créature. Ce n'est pas un hasard s'il s'agit toujours de personnes extrêmement jeunes. Mais le ver est dans le fruit. Si vous regardez les premiers films de Godard, c'est exactement le même phénomène. Il choisit Anna Karina. Elle a 17 ans, elle parle à peine français et il va en quelque sorte la créer. Ce mythe de Pygmalion est au cœur de la Nouvelle Vague et il va générer l'idée que l'inspiration de l'artiste est liée à l'expression de son désir pour une femme qu'il crée en quelque sorte, qu'il transforme en actrice. En même temps, on l'autorise à en changer pour stimuler sa créativité. On est dans une perspective totalement de collection "donjuanesque". François Truffaut a fait ça toute sa vie. C'était un séducteur compulsif, tout le monde le savait. Légende photo : L'actrice Judith Godrèche, le 1er septembre 2023 au festival de Deauville (Calvados). (FRANCK CASTEL / MAXPPP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 29, 2024 11:14 AM
|
Par Lara Clerc dans Libération le 29 février 2024 Auditionnée ce jeudi 29 février devant le Sénat, la comédienne demande la création une commission d’enquête sur les violences sexuelles dans le cinéma, le retrait du président du CNC Dominique Boutonnat et le retour du juge Durand à la tête de la Ciivise. «Tout le monde le savait, dans l’industrie du cinéma, qu’un agresseur déguisé en réalisateur fait souffrir les petites filles pour les faire pleurer.» Ce jeudi 29 février au Palais du Luxembourg, Judith Godrèche s’adresse aux parlementaires de la délégation au droit des femmes. Durant cette audition d’une heure trente retransmise en direct, la comédienne dénonce l’«écrasement de la parole» et l’«invisibilisation de la souffrance des enfants» dans l’industrie du cinéma. Elle réclame au Sénat de constituer une commission d’enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma, et demande le retrait de Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), mis en cause pour violences sexuelles sur son neveu. «Cette famille incestueuse du cinéma n’est qu’un reflet de notre société», assène la comédienne pour qui le dialogue sur les violences sexuelles face à une gouvernance du CNC délégitimée sur ce terrain même (en 2022, Boutonnat était renouvelé à la présidence du CNC alors qu’il était mis en examen depuis un an, au grand dam des associations) est forcément «mort-né». Judith Godrèche revient également sur le besoin de discuter avec les enfants, de les questionner en leur demandant, tout simplement : «Es-tu victime de violence ?» Pour elle, un enfant ne doit «jamais être laissé seul sur un tournage». Elle appelle à la mise en place d’un système de contrôle plus efficace, et réclame la présence de référents neutres sur les tournages auxquels des enfants participent ou de coordinateurs d’intimité. «Sur les plateaux de cinéma […], il n’y avait pas de Judith. Uniquement une petite fille sans prénom que se disputaient les adultes libidineux, sous les yeux d’autres adultes passifs, soumis à la toute-puissance du patriarcat.» Et elle ? «Je ne savais pas qu’il y avait la possibilité [de dire] non.» Tel «un boomerang» revenant dans la figure des «agresseurs déguisés en réalisateurs», elle dénonce leur emprise et ce au nom des autres victimes. Et si elle parle au passé, «aujourd’hui encore sont nombreuses les désenchantées», rappelle-t-elle, mentionnant aussi les autres enfants frappés par les violences sexuelles. Car elle le martèle, «tout le monde savait». Mais selon elle, les victimes sont de plus en plus attaquées en diffamation, de quoi les dissuader de dénoncer des comportements illégaux. Elle préconise pour lutter contre cela de permettre aux victimes d’avoir le même avocat car quand «les victimes [d’un même homme] se rencontrent, la force se décuple». «200 témoignages de techniciennes» C’est pourquoi elle demande au Sénat la réhabilitation du juge Edouard Durand, évincé de la Ciivise en décembre 2023 – point sur lequel le Sénat la rejoint, assure Dominique Vérien, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. La comédienne interpelle également Adèle Haenel, se remémorant son claquage de porte lors de la cérémonie des césars 2020, après la victoire de Roman Polanski : «Adèle, où es-tu ? Quel aurait été ton destin si ce soir-là, le public des césars avait été peuplé de juges Durand ?» Parmi les fameuses «désenchantées», elle cite également les personnes de l’ombre du cinéma, dont elle a reçu des témoignages depuis sa prise de parole. «En une journée, j’ai reçu 200 témoignages de techniciennes qui ont toutes reçu un selfie du sexe d’un réalisateur français. […] Elles étaient sur des tournages différents, et elles ont toutes reçu cette photo, comme ça… […] Il y a des techniciennes à qui un réalisateur a dit : “Tu veux me sucer la bite ?” […] Elles sont allées voir le producteur qui leur a répondu : “Tu ne vas pas faire d’histoire, ça va”». Judith Godrèche a plus tard souligné la peur de ces techniciennes de retrouver du travail si elles dénonçaient ces faits. L’actrice et réalisatrice dit ne «plus avoir grand-chose à perdre aujourd’hui, puisque je suis moi-même forte de toutes ces femmes invisibles […], qui se demandent si tous ces coups que je donne sur la porte vont finir par la faire céder». C’est pour cette raison qu’elle envisage de faire appel au président de la République, ayant déjà évoqué avec Rachida Dati le soir de son discours aux césars la possibilité d’être reçue à l’Elysée. Prise de parole inédite C’est la première fois que la Chambre haute reçoit une artiste. «Ce qui se joue en ce moment, c’est une révolution sociétale», a dit en inauguration de l’audition Dominique Vérien avant d’ajouter : «Comme vous, nous appelons à un sursaut et à une prise de conscience collective.» Vendredi 23 février, Judith Godrèche avait déjà prononcé un discours durant la cérémonie des césars dans lequel elle dénonçait le «niveau d’impunité, de déni et de privilège» du milieu du cinéma. Devant l’Olympia ce soir-là, un rassemblement organisé par la CGT et certains collectifs féministes lui apportait son soutien, parmi lesquels Sophie Binet ou Anna Mouglalis, cette dernière considérant sa prise de parole comme «d’utilité publique». Mise à jour : ajout à 14h10 de la reconduction de Dominique Boutonnat à la présidence du CNC, malgré une mise en examen. Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 27, 2024 10:07 AM
|
Chronique de Michel Guerrin, rédacteur en chef au Monde -24 février 2024 Difficile de trouver une réponse nuancée alors que les cas de réalisateurs, d’acteurs ou de chanteurs mis en cause sont très différents, observe dans sa chronique, Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde ».
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/02/24/jusqu-ou-aller-dans-l-effacement-des-uvres-et-des-artistes-au-nom-d-un-juste-combat-contre-les-violences-sexuelles_6218336_3232.html
En une poignée d’années, le saut est vertigineux. Il n’y a plus grand monde pour dire qu’il faut dissocier l’homme de l’artiste. Plus grand monde pour invoquer la présomption d’innocence. L’artiste accusé de violences sexuelles n’est plus un artiste. Il est réduit au silence, effacé. Trop lente, impuissante face aux preuves évanouies, la case procès est également rayée. Le soupçon vaut culpabilité. Les rares voix discordantes sont inaudibles. Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de la Colline, à Paris, qui, en 2021, disait refuser de se substituer à la justice pour justifier la présence discrète du chanteur Bertrand Cantat dans un spectacle, est traité d’horrible sexiste. Les temps changent et les Français suivent. Selon un sondage OpinionWay, publié dans La Tribune du 18 février, une personne sur deux estime qu’un cinéaste ou acteur mis en cause pour agression sexuelle doit être « interdit de travailler avant d’être jugé et condamné ». Et 67 % considèrent comme plutôt « un progrès » qu’une « personnalité publique » ne retrouve pas son métier après avoir purgé sa peine. Les plus jeunes sont les plus intransigeants. Ce sondage révèle une alliance de circonstance entre une jeunesse progressiste, portée par la vague #metoo, qui lutte contre les conservatismes dans l’art, et une opinion très droitière, gourmande de voir tomber des figures de l’élite culturelle de gauche. Du reste, dans le même sondage, Marine Le Pen est considérée comme la responsable politique défendant le mieux les femmes. Lenteur judiciaire Les Césars, dont la cérémonie a lieu vendredi 23 février à l’Olympia, sautent aussi la case justice en imposant cette année la « non-mise en lumière » de figures du cinéma en attente d’un jugement. Et puis à quoi sert la justice si une plainte classée sans suite (le metteur en scène de théâtre Jean-Pierre Baro) ou une peine purgée (Bertrand Cantat) ne font pas sortir du purgatoire ? Seuls le temps étiré ou la mort favorisent un retour. Et encore. Il sera périlleux de monter une exposition des œuvres de Gauguin, indésirable pour avoir eu des relations sexuelles avec de toutes jeunes Tahitiennes. Pour compenser la lenteur judiciaire, certains ont pensé à un ordre des artistes sur le modèle de celui des médecins – il n’est plus à l’ordre du jour. La sanction naît alors de l’action d’une multitude d’agents d’influence aux intérêts divers : victimes, médias, militantes, réseaux sociaux, corps intermédiaires (producteurs, patrons de lieux culturels), figures culturelles, ministère de la culture, public… Plusieurs critères jouent dans l’intensité de l’effacement d’un artiste : le nombre et la nature des accusations, sa notoriété et celle des victimes supposées, l’émotion suscitée. Sans compter une part irrationnelle, notamment dans le décalage entre un cinéma sous le feu des « affaires », et les autres disciplines, comme le rap et les arts plastiques, plutôt épargnés alors qu’elles sont riches en « monstres sacrés » comme on dit. Difficile de trouver une réponse nuancée Avec la justice en sourdine, une question qui générait moult débats il y a dix ans se trouve escamotée : jusqu’où aller dans l’effacement des œuvres et des artistes au nom d’un juste combat contre les violences sexuelles ? L’actrice Emmanuelle Devos a eu le mérite de la sincérité, sur Arte le 8 janvier : « Bien sûr qu’il y a des têtes qui vont tomber et qui n’auraient peut-être pas dû tomber, mais c’est ça les révolutions. » Ce qui lui a valu cette réponse de l’avocate Marie Dosé, défenseuse de proscrits (Jacques Doillon, Frédéric Beigbeder, Philippe Caubère mais pas Gérard Depardieu, qu’elle a refusé), le 14 février dans Libération : « J’ai adoré la vague #metoo. (…) Mais #balancetonporc, c’est le début de l’arbitraire. Cette révolution qui n’a aucun scrupule à couper des têtes m’effraie. » Il est en effet difficile de trouver une réponse nuancée alors que les cas de créateurs mis en cause sont très différents. Faut-il déjà empêcher la sortie en salles de Belle, de Benoît Jacquot et de CE2, de Jacques Doillon (le 27 mars), au risque de pénaliser toute une équipe ? En fait ces films sont déjà plombés. Le cas Polanski le montre. Son J’accuse (2019) a totalisé 1,5 million d’entrées en France et autant à l’étranger avant de recevoir trois Césars. Le cinéaste était pourtant déjà dans la tourmente. Mais nous étions en 2020, soit une époque fort lointaine. Son dernier film, The Palace, dévoilé à Venise en septembre 2023, où il s’est fait démolir, n’a pas trouvé de distributeur en France. Peut-on encore dire, comme l’Observatoire de la liberté de création, qu’une œuvre peut être montrée à partir du moment où son contenu n’est en rien dommageable pour les victimes présumées ? Et que leur présentation publique soit encadrée par un travail critique, comme le suggère la sociologue Gisèle Sapiro dans son essai Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ? (Seuil, 2020). Ensuite laissons le public décider de voir ou pas Polanski, Doillon, Jacquot, Woody Allen ou Depardieu. Du sexe contraint La question vaut aussi pour le devenir patrimonial de ces noms. La rétrospective Polanski, en 2017 à la Cinémathèque, semble impossible aujourd’hui car un tel événement, dans une institution publique, vaut célébration. Ecarter un film du petit écran est plus contestable. Début février, Paris Première a déprogrammé Les Valseuses. France Télévisions entend faire une « pause » concernant Depardieu. En janvier, le Festival de Gérardmer (Vosges), a dû retirer, dans le cadre de la rétrospective « vampires », Le Bal des vampires (1967), de Polanski. Il serait plus utile de placer cette énergie visant à purifier la création passée dans deux combats du présent. D’abord celui de la parité derrière la caméra, centrale pour sortir de récits standardisés de domination ou de fantasmes. Le second est à lire dans Libération du 6 février. Les actrices Alice de Lencquesaing, Clotilde Hesme et Ariane Labed racontent comment tant de scénarios, à l’écriture floue, cachent une scène tournée devant toute une équipe qui s’apparente à du sexe contraint. Ce n’est plus une agression en marge du tournage mais comment le tournage devient agression. Edifiant. Michel Guerrin (Rédacteur en chef au « Monde ») Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 25, 2024 11:06 AM
|
Billet par Sabrina Champenois dans Libération - 24 février 2024 Au lieu d’une multiplication des soutiens à l’actrice après sa prise de parole digne et limpide, la cérémonie mettant à l’honneur le cinéma français est revenue à sa routine habituelle. Allait-elle gueuler ou faire sobre ? Court ou long ? Nommer ou taire les assaillants ? Pleurer ? Tenir le coup ou s’effondrer, là, en direct ? On s’est demandé tout ça, juste avant que vienne le tour de Judith Godrèche à la 49e cérémonie des césars. L’affaire était forcément casse-gueule – redire devant la profession ce que ce même biotope a permis à son égard, lui demander de reconnaître cette permissivité, demander que les choses changent, tu parles d’un programme de fête. Elle a fait son entrée en scène en tailleur pantalon noir dont la veste à boutons dorés, seule fantaisie, rappelait l’apparat militaire. Mais il n’y a rien eu de martial ou de belliqueux dans le discours de la femme de 51 ans qui tente de rendre justice à l’adolescente qu’elle fut. Judith Godrèche a trouvé une ligne de crête incroyable. Elle a de tout temps la voix douce, et régulièrement un sourire, ou une esquisse de sourire. Ils étaient là. Idem, ce calme qui, depuis qu’elle prend la parole pour dénoncer les abus dont elle a été victime, décuple la violence des faits par effet de contraste. Impossible d’oublier son «Hummmm…. la même chose», prononcé doucement sur France Inter le 8 février, en réponse à cette question de Sonia Devillers : «Mais qu’est-ce qu’il veut de vous, Doillon ?» «Votre corps ?» poursuit Devillers. Juste un «hum» d’assentiment. La version vidéo de l’échange montre qu’il est accompagné de l’esquisse de sourire qui, dans ces circonstances, est surréaliste. On pense à ces fous rires nerveux qui surgissent aux enterrements. Ou alors à une quiétude de yogi insensible aux clous. Le tout est déflagratoire, explose d’autant plus à nos gueules du fait de la manière, minimaliste. Pareil, vendredi soir. Devant l’assemblée des césars, Judith Godrèche secoue le cocotier avec la silhouette et le regard bien droits, et posée. Comme si, de toute façon, elle avait déjà tout déposé. Pas d’évitement, elle y va, dit les choses. Le malaise de la situation («Nos visages, face à face, les yeux dans les yeux […] C’est un drôle de moment pour nous, non ? Une revenante des Amériques qui vient donner des coups de pied dans la porte blindée»). Le manque de réponse («Depuis quelque temps, je parle, je parle, mais je ne vous entends pas ou à peine. Où êtes-vous ? Que dites-vous ? Un chuchotement, un demi-mot, ce serait déjà ça, dit le Petit chaperon rouge»). Le risque («Je sais que ça fait peur. Perdre des subventions, perdre des rôles, perdre son travail. Moi aussi, j’ai peur. J’ai arrêté l’école à 15 ans. Je n’ai pas le bac. Rien. Ce serait compliqué d’être blacklistée, ça ne serait pas drôle»). La souillure («C’est tellement rien comparé à 45 prises avec deux mains dégueulasses sur mes seins de 15 ans»). L’enjeu, la possibilité de donner l’exemple («Nous pouvons décider que des hommes accusés de viol ne puissent pas faire la pluie et le beau temps dans le cinéma. Ça, ça donne le ton, comme on dit»). La revanche («Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. Les petites filles sont des punks qui reviennent déguisées en hamsters»). Cran, sincérité, limpidité, dignité, absence d’auto-apitoiement : de l’autre côté de l’écran, on a été saisie, impressionnée. On s’est dit que sur place, ça devait être démultiplié, sept minutes fichées droit dans les plexus. Alors oui, la salle a applaudi, s’est levée. Mais après ? On s’attendait à mieux, à plus. A ce que «Soutien total à Judith Godrèche» scande toutes les interventions après la sienne, comme un engagement collectif. Au lieu de quoi, à quelques allusions près, la cérémonie a repris son cours habituel, avec son lot de vannes, d’hommages émus, de bouffées antiguerres, de sketchs plus ou moins bancals, la routine. Alors même qu’elle venait de leur dire, «Où êtes-vous ? Que dites-vous ?» Pas forcément à ses côtés et pas grand-chose, manifestement. Dans l’évitement, pour le coup. Comme on le ferait avec un membre de la famille qui pète un plomb lors d’un repas de fête et dont on se dit, «ça va lui passer, passons». En 2020, Adèle Haenel a claqué un fauteuil, gueulé, s’est cassée. Vendredi, Judith Godrèche a dit de sa voix douce et remercié. Existe-t-il seulement un ton pour que la profession du cinéma se mette enfin au diapason ? Sachant que ce que demande Judith Godrèche n’est pas un scénario si fou que ça : juste prendre la résolution de ne plus fermer les yeux sur l’abus de pouvoir dans les coulisses du cinéma. Alors, où êtes-vous, que dites-vous ?
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...