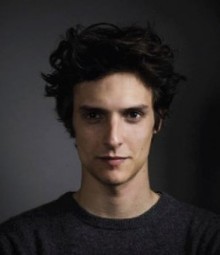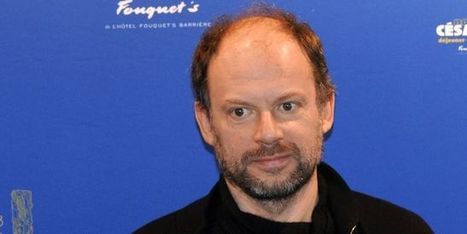Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 28, 2016 4:53 PM
|
Sur Théâtral Magazine
Gilles David a découvert le théâtre de Michel Vinaver grâce à Alain Françon qui l’avait dirigé dans Les Huissiers en 1999. Depuis il a joué dans L’Ordinaire mis en scène par Michel Vinaver lui-même et rêvait de monter La demande d’emploi. "C'est pour moi la pièce idéale pour faire des exercices d'acteur. Elle est écrite en 30 morceaux et je l’ai beaucoup utilisée pour enseigner le théâtre à de jeunes gens. Je ne me trompais pas beaucoup, puisque Michel Vinaver l’avait d’abord appelée L’école du théâtre avant de la rebaptiser La demande d’emploi. Il l’a écrite après Par-dessus bord sa grande saga sur le monde de l'entreprise comme une petite forme pour quatre acteurs. Elle parle de l'entreprise, du chômage des cadres. Mais j'ai pris pour axe l'école du théâtre parce que l’aspect socio-politique transparaîtra toujours."...
La demande d’emploi, de Michel Vinaver, mise en scène de Gilles David
Studio-Théâtre de la Comédie-Française
99 rue de Rivoli Carrousel du Louvre 75001 Paris, 01 44 58 15 15
du 26 mai au 3 juillet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 15, 2016 6:41 AM
|
Par AFP, publié sur RTBF.be
La Comédie-Française donne jusqu'au 23 juillet un "Britannicus" très actuel, dont les intrigues politiques n'ont rien à envier aux séries télévisées d'aujourd'hui, selon son metteur en scène Stéphane Braunschweig.
"Quand on lit Britannicus, au début, on se dit: qu'est-ce que c'est que cette histoire en toges? Et puis très vite, on comprend que ça parle des coulisses du pouvoir, des stratégies de communication: est-ce qu'un empereur ou un président doit plaire à l'opinion publique ou se faire craindre ? Ce sont des questions qui sont vraiment celles du pouvoir encore aujourd'hui", explique-t-il.
Lorsque les comédiens lui ont demandé ce qu'ils devaient lire pour préparer la pièce, il leur a plutôt conseillé "de regarder House of Cards ou Borgen".
Une grande salle de réunion, des portes derrière lesquelles se manigancent de sombres desseins, des comédiens en costumes sombres comme à la Maison Blanche: le cadre froid est celui d'un lieu de commandement aujourd'hui.
"Stéphane Braunschweig voulait le décor d'un haut lieu de pouvoir, ça pouvait être la Maison Blanche, l'Elysée ou bien Moscou, chez Poutine", raconte la comédienne Dominique Blanc, qui a intégré en mars dernier la Comédie-Française pour incarner Agrippine.
Si la pièce écrite par Racine en 1669 s'appelle "Britannicus", ce dernier n'est qu'un des pions de la sombre machination montée par Agrippine. "Ma tragédie n'est pas moins la disgrâce d'Agrippine que la mort de Britannicus", écrivait Racine dans sa préface.
Agrippine, mère de Néron, a oeuvré sans relâche pour placer son fils sur le trône, mais celui-ci l'écarte et suit ses propres penchants. On est à un tournant du règne de celui qui restera un des pires tyrans de Rome dans la postérité.
Vaincre ou périr
Dominique Blanc campe une formidable Agrippine, une femme puissante, qui lui rappelle la marquise de Merteuil qu'elle vient de jouer dans "Les Liaisons dangereuses".
"Cette Agrippine est une guerrière et tout comme la marquise de Merteuil, ce qui l'intéresse, c'est vaincre ou périr", lance-t-elle. "On méconnait totalement cette femme, c'était un grand génie politique, un fin stratège", explique-t-elle.
Stéphane Braunschweig a voulu une Agrippine "loin des clichés habituels". "On a pas ce cliché d'Agrippine en fureur, sa couleur dominante est sa détermination, sa vitalité aussi."
Le front haut et le verbe incisif, Dominique Blanc est impériale. Tour à tour autoritaire et enjôleuse, elle tente en vain de contrer la soudaine autonomie de Néron qui, après deux ans de règne vertueux, s'affranchit pour le pire de l'autorité de sa mère et de ses conseillers.
Dans le rôle de Néron, Laurent Stocker campe toute l'ambiguïté du personnage, entre fils falot et empereur cruel. Le jeune Britannicus de Stéphane Varupenne est tout en candeur et innocence. Les conseillers, le sage Burrhus (Hervé Pierre) et le fourbe Narcisse (Benjamin Lavernhe) sont d'une grande justesse.
Dans la bouche des comédiens du Français, les alexandrins coulent avec une telle fluidité qu'on n'y prend pas garde.
Le pouvoir, le sexe, le poison: tous les ressorts des séries sont là. Néron est le jouet de sa passion soudaine pour Junie mais celle-ci aime Britannicus, et il ira jusqu'à empoisonner son rival.
"Il n'y a pas de raison pour que les hommes politiques soient des machines, ils sont comme tout un chacun pris dans des affects. Ce dont parle Racine, c'est l'intrication des affects et du politique et ça a quelque chose d'assez effrayant évidemment", remarque Stéphane Braunschweig.
Un thème qui trouve une résonance dans l'intrusion de la vie privée dans le politique aujourd'hui.
"On a voulu raconter cette histoire non pas comme une pièce de musée du 17e siècle français mais comme une pièce qui nous raconterait une part du monde d'aujourd'hui à travers une part du monde d'hier."

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 11, 2016 5:55 AM
|
Par Sophie Jouve pour Culturebox
Ce « Britannicus » de Racine est la première mise en scène de Stéphane Braunschweig à la Comédie-Française. Braunschweig qui vient de passer de la direction du théâtre de la Colline à celle de l’Odéon. C’est aussi le premier rôle de Dominique Blanc en tant que nouvelle sociétaire du Français. Une grande Agrippine.
Une haute porte blanche en avant-scène ouvre sur une salle de réunion moderne, froide, impersonnelle, avec sa grande table et ses fauteuils chromés. C’est là que vont converger et s’exacerber les conflits. Celui d’Agrippine, l’ancienne impératrice avec son fils l’empereur Néron. Celui de Néron lui-même avec son demi-frère Britannicus pour la possession de la belle Junie. Celui des confidents Narcisse, Buurrhus et Albine, qui ne peuvent exister qu’en influençant leurs maîtres.
Dominique Blanc, Hervé Pierre et Clothilde de Bayser
Dominique Blanc, Hervé Pierre et Clothilde de Bayser © Brigitte Enguérand/Comédie-Française
Une grande entreprise contemporaine
En fond de scène on devine d’autres portes, fermées ou entrouvertes, comme le réceptacle d’autant de secrets ou de machinations qui se trament dans le palais de Néron. Braunschweig, qui comme souvent signe également la scénographie, opte pour un décor et des vêtements résolument contemporains : pardessus ou costumes noirs et chemises blanches. Le drame ne se jouera pas dans une de ces royautés tyranniques aujourd’hui disparues mais dans une grande entreprise contemporaine où les coups bas et les trahisons sont tout aussi cruels.
Hervé Pierre (Burrhus) et Dominique Blanc (Agrippine)
Hervé Pierre (Burrhus) et Dominique Blanc (Agrippine) © Brigitte Enguérand/Comédie-Française
L’intime et le psychologique, si inextricablement liés aux décisions politiques chez Racine, résonnent avec autant de force dans le cadre de nos économies mondialisées. Mais bien sûr et contrairement au titre donné par Racine à sa pièce, c’est la relation entre une mère et son fils qui continue à être le sujet du spectacle.
Laurent Stocker en Néron incarne un despote enfant qui veut se libérer de l’emprise de sa mère sans se résoudre à la détester vraiment. Stéphane Varupenne est un assez surprenant Britannicus, bien trop physique et solaire aux yeux du jaloux Néron qui n’aspire qu’à lui ravir Junie, la sensible et sombre Georgia Scalliet.
Laurent Stocker (Néron) et Stéphane Varupenne (Britannicus)
Laurent Stocker (Néron) et Stéphane Varupenne (Britannicus) © Brigitte Enguérand/Comédie-Française
Les deux conseillers, le fidèle et le perfide, sont incarnés avec le même brio par Hervé Pierre, Burrhus au parler vrai ("Ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde") et Benjamin Lavernhe aux yeux revolvers, qui en Narcisse perfide manipule l’hésitant empereur.
Dominique Blanc est souveraine, arrogante et lucide
Dominique Blanc en costume noir elle aussi (qui pour Braunschweig est la couleur du pouvoir autant que du deuil), est souveraine, arrogante et lucide. Elle se rebelle contre l’enlèvement de Junie par Néron, pressent ainsi sa propre disgrâce ("Je le craindrai bientôt s'il ne me croyait plus"). Mais elle a l’orgueil de se croire capable jusqu’au bout, de conserver sur son fils l’ascendant d’une mère.
Agrippine et son fils Néron
Agrippine et son fils Néron © François Guillot/AFP
La langue de Racine coule de la bouche des acteurs, sans que les alexandrins ne sonnent appuyés ou déclamatoires. Tous donnent à leur personnage cette ambivalence si racinienne et que creuse Braunschweig avec dextérité, passionné par ce point de rupture qui voit soudain l’homme de pouvoir se décomposer.
La pièce file (moins de deux heures) et se regarde comme un passionnant thriller politique. Du Racine à l’os et sans pathos.
Infos pratiques
"Britannicus" de Jean Racine
Comédie-Française, salle Richelieu
Place Colette, Paris 1er
Du 7 mai au 23 juillet 2016
01 44 58 15 15
Comédie -Française

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 4, 2016 11:59 AM
|
Sonia Devillers reçoit Vincent Macaigne à l'occasion de la diffusion du téléfilm inédit "Dom Juan & Sganarelle" jeudi 5 mai à 22h50 sur Arte.
Emission à écouter en suivant ce lien : http://www.franceinter.fr/emission-l-instant-m-quand-la-tele-arrache-dom-juan-au-theatre
Oh non que je n’avais pas envie de voir un Dom Juan noyé dans l’alcool, les orgies, les tatouages, les seringues, la musique pop. Pourtant, la colère et le désespoir mortifère de ce libertin suicidaire y trouvent une expression aussi puissante que juste et sensible. Vincent Macaigne, metteur en scène, s’empare du texte de Molière, l’arrache à la Comédie Française et le transpose pour la télévision. Non, il ne le transpose pas, il l’explose pour la télévision. Tant se repose ici l’éternelle question du théâtre à l’écran.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 2, 2016 3:11 PM
|
Par Patrick Sourd dans le Monde
¨L’actrice est Agrippine, dans « Britannicus », à partir du 7 mai. Un rôle qui marque son entrée au Français.
Pensionnaire à la Comédie-Française depuis mars, l’actrice se prépare à y jouer Agrippine dans Britannicus, de Racine. Une double consécration pour cette comédienne au parcours singulier.
Etre aujourd’hui pensionnaire de la Comédie-Française revêt quel sens pour vous ?
J’étais très émue quand j’ai signé mon contrat. J’ai été accueillie par toute l’équipe. C’était à la fois un bonheur, un honneur et une fierté. Je tenais à en faire une fête et nous avons sablé le champagne. Il s’agit de bien plus qu’une invitation à jouer, j’entre dans une troupe et dans une maison de théâtre vieille de plus de trois siècles. Entrer au Français est une des envies qu’ont les jeunes actrices au sortir du Conservatoire. L’événement a d’autant plus d’importance qu’il se passe à un moment de ma vie et de ma carrière où je n’imaginais plus pouvoir faire un jour partie de cette famille.
Quelle a été votre réaction quand Eric Ruf vous a proposé le rôle d’Agrippine sous la direction de Stéphane Braunschweig ?
C’était incroyable pour moi de me savoir ainsi désirée simultanément par l’administrateur du Français, et par ce metteur en scène… Deux hommes pour qui j’ai le plus grand respect. Je trouvais surprenant qu’ils me proposent le rôle d’Agrippine. Je ne m’y voyais pas du tout, mais je pense que ce type de rôle est encore plus intéressant quand on ignore au départ jusqu’où il peut vous mener. Savoir que j’allais jouer aux côtés de Clotilde de Bayser, Laurent Stocker, Hervé Pierre, Stéphane Varupenne, Georgia Scalliet et Benjamin Lavernhe était aussi la promesse d’une grande aventure. J’ai dit « oui » à tout ça…
Et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que j’ai commencé à me rêver dans le rôle.
Comment décririez-vous votre parcours au théâtre ?
Depuis son tout début, il se déroule hors des clous et à rebours de la tradition. Je désirais apprendre le théâtre, mais ni le Conservatoire ni l’école de la rue Blanche n’ont voulu de moi. J’ai toujours eu le désir d’être d’une école, d’une tribu, d’un clan. Je me suis rapidement rendu compte que ça ne marcherait pas ainsi pour moi, que mon chemin se ferait hors des sentiers battus et qu’il serait un chemin solitaire. C’est grâce à Patrice Chéreau que les choses ont changé. Il m’avait repérée lors d’un travail que je présentais dans un atelier avec Pierre Romans au cours Florent et m’a proposé un petit rôle dans sa mise en scène de Peer Gynt d’Ibsen. Une année durant, j’ai observé de l’intérieur le travail des répétitions de la troupe magnifique qu’il avait réunie. La seule façon, pour moi, d’apprendre mon métier a été cette école du regard. Mais Patrice Chéreau a quitté son théâtre à Nanterre et, comme souvent dans cette profession, je suis revenue à la case départ.
La dernière fois que vous avez interprété Racine, c’était Phèdre sous la direction de Patrice Chéreau. Eric Ruf jouait Hippolyte.
J’y repense toujours avec beaucoup d’émotion. A cette époque Patrice Chéreau m’avait dit : « Tu n’as jamais fait de tragédie, moi non plus, c’est peut-être là qu’est notre principal atout. » Avec lui, il fallait tordre le cou à la tradition. Faire jaillir le sang et les larmes… Quand on y arrivait, le plaisir était fou et l’on avait le sentiment d’accéder à une liberté de jeu extraordinaire. On a souvent distribué Hippolyte en jeune adolescent immature. S’agissant d’Eric Ruf, il lui donnait la stature d’un homme. Cela changeait la donne de nos échanges et j’avais une confiance totale en lui comme partenaire.
Comment se déroulent les répétitions avec Stéphane Braunschweig ?
Il monte souvent sur scène. Il ne joue pas, mais nous indique avec une grande précision ce qu’il aimerait nous voir faire. Stéphane Braunschweig est capable d’une grande concentration dans le travail, mais il sait aussi s’amuser. Il a beaucoup d’humour. C’est un homme particulièrement heureux en ce moment après sa nomination à la tête de L’Odéon-Théâtre de l’Europe et c’est un artiste épanoui. Comme ce fut le cas avec Patrice Chéreau, lui aussi se confronte pour la première fois à la tragédie avec Britannicus.
Quel est le point de vue de Stéphane Braunschweig sur la pièce ?
Chaque metteur en scène a son avis sur le vers racinien. L’important étant que les comédiens se conforment à cette règle pour que le souffle du texte s’accorde entre eux tous. C’est à travers notre jeu choral que la pièce va trouver son unité, son rythme et sa respiration. Britannicus est basée sur les intrigues du pouvoir. Stéphane Braunschweig l’inscrit dans un décor d’aujourd’hui pour en faire l’écho de batailles politiques qui pourraient se dérouler à notre époque. Son parti pris est très contemporain. Incarner une femme politique de notre siècle me permet d’aller dans le sens de la grande modernité qui existe dans le personnage d’Agrippine.
Propos recueillis par Patrick Sourd
Britannicus, de Jean Racine, mise en scène de Stéphane Braunschweig. Avec Dominique Blanc, Clotilde de Bayser, Laurent Stocker, Hervé Pierre, Stéphane Varupenne, Georgia Scalliet, Benjamin Lavernhe. A la Comédie-Française, Salle Richelieu. Place Colette, Paris 1er. Tél. : 01-44-58-15-15. Du 7 mai au 23 juillet. www.comedie-francaise.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 24, 2016 6:40 PM
|
Photo : Ivo van Hove © JAN VERSWEYVELD
Par Fabienne Pascaud dans Télérama :
L'administrateur du Français explique pourquoi ce retour après vingt-trois ans d'absence, et le choix du metteur en scène flamand Ivo Van Hove pour monter une adaptation des “Damnés” de Visconti.
Ce fut une belle surprise ! Le retour de la Comédie-Française au Festival d’Avignon où on ne l’avait pas vue depuis 1993. Soit depuis la mise en scène par Jacques Lassalle du Dom Juan de Molière dans la cour d’honneur du palais des Papes avec Andrzej Seweryn dans le rôle-titre, la jeune Jeanne Balibar dans Elvire… et déjà, dans un petit rôle, l’actuel administrateur de la maison, Eric Ruf, frais émoulu du Conservatoire. Et selon lui encore peu habile, voire très mauvais dans son petit rôle. Est-ce par désir de revanche qu’il souhaite aujourd’hui faire revenir sa troupe sous ce mistral qu’elle avait régulièrement affronté lorsque Pierre Dux, Jean-Pierre Vincent ou Antoine Vitez la dirigeait ?
Questions à Eric Ruf descendu lui-même à Avignon annoncer ces Damnés, d’après le film de Luchino Visconti, mis en scène par Ivo Van Hove avec Didier Sandre, Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre, Denis Podalydès, Eric Genovèse. Le spectacle bouclera aussi sa première saison salle Richelieu, à Paris …
Pourquoi ce désir de revenir à Avignon, où la troupe n’a pas réussi que des chefs-d’œuvre par le passé ?
L’absence – depuis 23 ans ! – de la Comédie-Française dans un festival où se voit ce qu’il y a de mieux en matière de théâtre, me semblait dommageable pour notre maison, renforçait son côté insulaire, son refus de se confronter aux comparaisons, aux évaluations. Sachant qu’Olivier Py aimait ces grands textes dont nous sommes si porteurs, ayant beaucoup aimé certains de ses spectacles, comme La Servante bien sûr, à Avignon même, je lui ai fait des propositions. Peer Gynt, par exemple, que j’avais moi-même mis en scène avec les comédiens français. Nous avons commencé à discuter, lors d’un dîner chez lui, à Ouessant, après un tournage commun…
Il était d’accord sur le choix du Flamand Ivo van Hove ; je pensais que c’était bien d’avoir un grand artiste étranger dans la Cour… On a tourné avec ce dernier autour de Shakespare. Mais je me méfiais de Shakespeare, il est trop identifié au palais des Papes, à son côté opératique. C’est certes rassurant, mais je ne pense pas qu’on gagne en rassurant.
Ivo van Hove a proposé Les Damnés, il a souvent monté au théâtre des adaptations de films… En plus, Visconti a toujours dit que Les Damnés était son œuvre la plus directement inspirée de Shakespeare ; on y revenait malgré tout… Certes, c’est aussi un pari scénographique, puisque le spectacle doit revenir ensuite salle Richelieu… Mais ce pari excite intellectuellement Ivo van Hove, m’a-t-il dit... Et moi je trouve que cette histoire de grand capital et de haine, ce côté tragédie antique convient parfaitement à la salle Richelieu.
Pourquoi le choix d’Ivo van Hove ?
J’ai vu sa mise en scène de Marie Stuart à Amsterdam, en flamand, sans comprendre. Et rien qu’à regarder le spectacle, je saisissais les lignes de force de la pièce. Quel metteur en scène ! Je l’ai rencontré. Et j’ai été fasciné aussi par son côté droit, posé, sa radicalité tranquillement affirmée. Sans posture. Je rencontrais une espèce de pasteur, comme il y en avait dans ma famille. J’étais en confiance.
Que vous évoque Avignon ?
J’ai toujours annoncé que je souhaitais renouer le travail avec les grandes institutions théâtrales. Or Avignon en est une. Essentielle. Par la profusion de propositions qui y sont faites au public et par la joie d’être bousculé par ces propositions. Son côté « grand théâtre national populaire » aussi m’émerveille. « Populaire », pour que les gens viennent ; mais exigeant, pour qu’ils restent…
Comme comédien, j’ai enfin vécu dans la cour d’honneur, pendant Dom Juan, une expérience à la fois désastreuse et extraordinaire. D’abord, j’avais peur parce que je venais de rentrer au Français et que j’étais mis en scène par l’administrateur même de la maison. Ensuite je n’avais pas la technique, je ne comprenais pas comment faire les pianissimo nécessaires, même dans ce lieu immense. Mais quelle beauté de jouer là-bas... Sur scène, on voit encore les étourneaux voler, on les entend, la nuit descend, avec cette masse noire du public devant vous, ça devient étrangement un concentré d’érotisme. Le vent vous caresse la joue et soulève votre chemise… Quel acteur n’a rêvé d’avoir le vent qui balaie ses cheveux et fasse flotter sa chemise ?

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 16, 2016 6:21 PM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks :
Fruit de la douzième collaboration entre les deux hommes, La Mer d’Edward Bond fait son entrée au répertoire de la Comédie-Française dans une mise en scène d’Alain Françon. A 81 ans, l’auteur britannique croit plus que jamais en la place essentielle du théâtre dans la société.
Malicieux, facétieux, Edward Bond a habilement détourné le fil de l’interview qu’il nous a accordée pour parler de ce qui lui tient le plus à cœur : le théâtre comme activité spécifique au genre humain, à la fois témoin et acteur des grands bouleversements civilisationnels.
Vous venez d’un milieu ouvrier d’origine paysanne. Comment en êtes-vous arrivé à l’écriture théâtrale ?
Edward Bond – Aujourd’hui, il y a une séparation entre le théâtre et la télévision, mais quand j’étais petit, elle n’existait pas. Dans les villes, le prolétariat allait au music-hall toutes les semaines voir des cabarets, des chansons, des sketches patriotiques et il y avait une relation très proche entre le public et les comédiens. Cela n’a rien à voir avec le fait de regarder un écran devant lequel on ne fait rien. On se contente de le regarder. Au music-hall, le public interpellait les artistes et cette relation le rendait créatif.
Ma sœur était l’assistante d’un prestidigitateur. Un jour, elle m’a proposé de venir regarder le spectacle depuis les coulisses en me demandant de ne pas faire de bruit. Ce soir-là, un acteur comique se produisait et à la fin de son sketch, me voyant dans les coulisses, il est venu me demander : “Pourquoi n’as-tu pas ri ?” Je lui ai répondu que ma sœur m’avait dit de ne pas faire un seul bruit et il a sorti une pièce de six pence de sa poche et me l’a donnée en me disant : “Mon garçon, ne fais jamais ce qu’une femme te demande !”
Avez-vous le souvenir d’une pièce de théâtre à cette époque ?
Pendant la guerre, il y avait des bombardements et chaque nuit, j’avais peur de mourir. Mais c’est devenu une habitude et nuit après nuit, on arrête d’avoir peur et on commence à s’intéresser à la peur. C’est une attitude complètement différente. D’une certaine façon, on arrive à analyser la peur. A la fin de la guerre, les travaillistes sont arrivés au pouvoir et le gouvernement a décidé que tout le monde devait aller au théâtre. On m’a emmené voir Hamlet avec un très grand acteur, Donald Wolfit. Je me souviens de ce qu’il faisait dans la scène du poignard avec une clarté absolue. C’était la première fois que quelqu’un me parlait de la vie que j’avais menée jusque-là. Shakespeare savait très exactement ce que ça veut dire que de se faire bombarder. C’est sûrement ça qui a fait de moi un écrivain.
Qu’est-ce que ça vous fait de vous replonger dans l’une de vos premières pièces, La Mer, écrite en 1973 ?
Je n’y pense pas de cette façon. C’est juste une pièce dans laquelle j’essayais de traiter d’un sujet particulier. Mais je ne me souviens absolument pas de l’avoir écrite ! Mais c’est très intéressant parce que, maintenant, j’arrive à voir comment elle est construite.
Avec le sentiment de voir qui vous étiez comme jeune auteur ?
C’est un sujet tellement énorme que je me demande comment l’aborder. Je préfère parler des questions fondamentales du théâtre. On est l’espèce qui fait du théâtre. On est des êtres humains et c’est ça qu’on fait et qui nous différencie de toutes les autres créatures. On fabrique du théâtre et on a un regard théâtral. Un enfant fait naturellement du théâtre et c’est toujours le cas aujourd’hui, malgré les machines, les écrans, les jeux vidéo. Parce qu’un enfant se crée lui-même.
J’ai écrit beaucoup de pièces pour le jeune public et ce qui est drôle, c’est que lorsque je vais dans les écoles, les professeurs pensent que les enfants ne comprendront jamais ce que j’écris et que, de toute façon, ils ne peuvent pas rester tranquilles plus de cinq minutes. Mais la vérité, c’est que leur extrême concentration est effrayante. Une fois, il m’est arrivé d’observer un public d’enfants de 9 à 11 ans. Il régnait un silence absolu et j’étais censé leur parler après la représentation. Mais je n’ai pas pu, je me demandais où j’avais déjà vu une telle expression sur des visages et ça m’est revenu plusieurs jours après : c’était sur le visage d’enfants qui meurent de faim. Mais ces enfants à l’école ne manquent de rien. Alors, que désirent-ils qu’on ne leur donne pas ?
Dans Hamlet de Shakespeare comme dans La Mer, on retrouve le théâtre dans le théâtre. Dans quel sens l’utilisez-vous ?
Mes pièces sont toujours faites d’une pièce dans une pièce dans une pièce… et d’un plateau sur un plateau sur un plateau. C’est la seule façon de montrer la réalité de ce qui se passe. Parce que, très franchement, qu’est-ce qu’on pourrait imaginer de plus con que de donner de l’argent pour s’asseoir et regarder des gens faire semblant d’être quelqu’un d’autre ? Pourquoi les gens font-ils ça ?
Les enfants ont leurs jouets, mais les adultes ? En fait, c’est juste qu’ils ont changé de jouets. Ce que font les enfants avec les jouets est très particulier. On pourrait croire qu’ils commandent à la poupée, mais en fait, c’est la poupée qui éduque l’enfant. C’est exactement l’inverse de ce qu’on voit. La poupée lui apprend à devenir citoyen, c’est comme ça et c’est très bien. Mais il reste une question que se pose l’enfant et à laquelle la poupée ne peut répondre : qu’est-ce que ça veut dire d’être humain ? C’est de cette question aussi que traite le théâtre, en tant qu’institution culturelle. Ce qu’il y a de passionnant chez les humains, c’est que le théâtre est antérieur à la culture et il se manifeste à des périodes particulières où l’individu ne peut plus se sentir bien en vivant dans la société.
Cela est arrivé deux fois, la première chez les Grecs, la seconde au moment de la Renaissance et de la réforme en Europe, avec le théâtre des Tudor, avant Shakespeare. Ce qui rend les Grecs intéressants, c’est que c’est une démocratie, avec des tribunaux, un parlement législatif. ça devrait suffire, mais non, ils ont besoin d’un théâtre parce que c’est là qu’on pouvait dire ce qu’est un être humain. Ils ont une vision très claire des problèmes de fond qui sont tous liés à la famille et à la société.
La dernière pièce grecque, c’est la chrétienté qui reprend tous les personnage des tragédies grecques et change leurs noms. Cela a duré deux mille ans jusqu’à la Réforme. A cette époque, ça ne marche plus parce qu’on connaît trop bien le monde. Si on continue de brûler les scientifiques qui disent que la Terre tourne autour du Soleil, on n’aura jamais les machines. Sans elles, pas de capitalisme. Alors, on a eu besoin d’une nouvelle forme de théâtre et le principal produit de cette évolution, c’est Shakespeare.
Il a inventé le monologue : un acteur arrive sur scène et parle de lui-même. C’est vraiment révolutionnaire.
Shakespeare a montré comment fonctionnait la relation entre l’individu et la société mais il ne pouvait pas résoudre le problème politique de la vie dans une société. Alors, il a écrit trois tragédies : Hamlet, Lear et Macbeth. Toutes traitent d’une famille : Lear, c’est le père de Macbeth et Macbeth, c’est Hamlet quand il passera à l’action. Hamlet est la grande figure de ce théâtre, c’est lui qui va rendre possible la révolution industrielle. Si on réunit les figures de Macbeth et d’Hamlet, on obtient un tyran. C’est Hitler, les camps de concentration et Auschwitz.
L’autre grande figure de ce théâtre, c’est Dom Juan de Molière. Molière se méfie constamment de l’autorité et son théâtre entraîne la France et l’Europe. Au cœur de Dom Juan, il y a une scène dans la forêt avec un mendiant que Don Juan tente sans succès de faire blasphémer et à qui il finit par donner de l’argent “par amour de l’humanité”. Cette phrase est le point de départ du théâtre moderne parce que ça modifie complètement la relation entre l’individu et la société telle que la voyait les Grecs. Dom Juan en sait plus sur Dieu que la statue du Commandeur. Si jamais il y a un Dieu… C’est presque un cliché. La solution de Molière, c’est la Révolution française, qui est l’événement le plus important de toute l’époque moderne. Après cela, le monde ne sera plus jamais comme avant. Toute la culture de l’Europe vient de la culture française. Ce qui signifie que la culture mondiale, c’est la culture française. L’opposé de ça, c’est la télévision, le modèle américain.
La Mer est la douzième de vos pièces qu’Alain Françon met en scène. Un long compagnonnage ?
Oui ! J’ai d’ailleurs fini par lui écrire cinq pièces, Quinte de Paris, qui s’inspirent de la Révolution française pour parler du problème et du coût qu’il y a à être humain dans la société. Et je n’ai pu le faire que parce que j’ai cette relation avec Alain Françon. Je crois vraiment que ce sont les pièces les plus importantes que j’ai écrites.
Vous intervenez pendant les répétitions ?
Je le laisse faire. Il pose beaucoup de questions et je ne suis pas sûr d’avoir les réponses. Mais c’est ça qui fabrique une relation forte. Une fois que les répétitions sont avancées, je viens regarder le travail et je donne mon avis. Avec toute l’autorité de l’auteur ! Mais le théâtre est fait pour être joué et un acteur peut faire beaucoup plus qu’un auteur. La relation avec Alain est bonne parce que fondée sur une confiance mutuelle. Hier, j’ai vu un filage de La Mer et j’ai pensé : “Ah! C’est de ça dont parle la pièce !” Pour être clair, ma dette envers Alain est énorme.
Vous allez mettre en scène une de vos pièces en Angleterre cet été. Pouvez-vous nous en parler ?
J’ai déjà dirigé plusieurs de mes pièces au National Theater, à la Shakespeare Company. C’est très utile. On ne devrait pas compartimenter les tâches au théâtre. Euripide montait ses propres pièces. Ma prochaine pièce s’appelle DEA, comme Médée. Si on considère le XXe siècle, le personnage important, c’est Antigone. Même Brecht écrit son Antigone. Ce n’est pas qu’il ait compris quoi que ce soit. On continue de dire qu’il était marxiste, ce qui est une connerie, c’est un staliniste. Il faut qu’on se débarrasse de Brecht ! Mais Médée est le personnage du XXIe siècle. Dans cette pièce, j’essaye de comprendre les relations entre la famille et la société en y intégrant toutes les figures du théâtre grec : Œdipe, Antigone, Médée… Mais je préfère ne pas trop en parler, c’est trop tôt !
Propos recueillis par Fabienne Arvers. Traduction David Tuaillon.
La Mer, d’Edward Bond, mise en scène Alain Françon, en alternance jusqu’au 15 juin, Salle Richelieu de la Comédie-Française.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 12, 2016 10:48 AM
|
Du haut de ses 81 ans, le célèbre dramaturge britannique Edward Bond est un incontournable du théâtre d’après-guerre. Depuis le lundi 7 mars, il est aussi devenu l’un des seuls auteurs à voir son œuvre jouée à la Comédie-Française de son vivant. Sa tragicomédie "La Mer" fait une entrée remarquée dans le répertoire de la prestigieuse institution.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 5, 2016 1:01 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde
Mieux vaut tard que jamais : à 81 ans, le dramaturge britannique Edward Bond entre au répertoire de la Comédie-Française, avec La Mer, une pièce écrite en 1972. On peut se réjouir, même si La Mer fait partie des textes les moins radicaux de l’auteur de Pièces de guerre, que cette œuvre qui questionne la barbarie au cœur de l’humain accède ainsi à une reconnaissance plus large. Entretien avec Alain Françon qui, à 71 ans, met en scène Bond pour la onzième fois depuis 1992.
En 1994, quand vous montiez « Pièces de guerre », vous souhaitiez poursuivre avec Edward Bond un « entretien continuel ». C’est ce que vous avez fait, en montant, depuis, une dizaine de ses pièces. Pourquoi ?
Tout d’abord, il faut dire que ce n’est pas moi qui ai proposé à la Comédie-Française de monter cette pièce. Elle a été choisie par le comité de lecture, à l’unanimité, en 2011. Quand Eric Ruf est arrivé à la tête du Français, il a pensé qu’il était largement temps de la montrer. Cela dit, il est vrai que j’ai noué avec Edward Bond, dès 1992, quand j’ai monté La Compagnie des hommes, une relation de travail étroite et continue. Dès ce premier spectacle, il avait été intéressé et surpris par notre travail. Quand je suis devenu directeur du Théâtre de la Colline [en 1996, et jusqu’en 2010], il m’a semblé évident de monter ses pièces au fur et à mesure qu’il les écrivait et qu’il nous en donnait les droits. Parce que c’est un des auteurs contemporains les plus importants.
A 81 ans, Edward Bond apparaît pour certains comme un auteur daté, à d’autres il fait peur par sa radicalité. Et il fait l’objet de malentendus, sur son rapport à la violence et son côté « donneur de leçons », notamment…
Bond dit de lui-même qu’il est un « extrêmophile » : il faut toujours qu’il travaille sur des situations extrêmes. Il n’est pas le premier : les Grecs et Shakespeare l’ont fait avant lui. A partir du moment où on s’affronte à ces situations, on prend un risque littéraire, sur tous les plans. Dans toutes ses pièces, il part d’une situation extrême, et il met à l’intérieur des personnages, des figures qui n’ont pas la carte de compréhension de la situation qu’ils vivent, qui en général est une situation de violence. A partir de là, ils sont obligés de faire des choix, dont Bond dit que c’est « un impératif catégorique à être humain » qui les conduit dans ces choix.
« CE N’EST PAS UN THÉÂTRE DE LA VIOLENCE, MAIS UN THÉÂTRE QUI ANALYSE LES PROCESSUS DE LA VIOLENCE, SANS LA REPRODUIRE »
Est-ce cet impératif kantien qui est pour vous au cœur du théâtre d’Edward Bond ?
Oui, et il est lié à une idée de la justice. Le théâtre de Bond ne porte pas sur le bien et le mal, mais sur le juste et l’injuste – ce qui explique son lien profond avec le théâtre grec. Ce n’est pas non plus un théâtre de la violence, mais un théâtre qui analyse les processus de la violence, sans la reproduire.
Pourtant, il y a dans nombre de ses pièces des situations insoutenables que, d’ailleurs, certains spectateurs ne supportent pas.
C’est vrai, et je suis bien placé pour savoir que dans Naître (2005) et Café (1995), par exemple, beaucoup de spectateurs ont quitté la salle. Mais on peut s’interroger sur ce que le spectateur ne supporte pas. Prenons Café, une pièce que Bond a écrite d’après le témoignage d’une femme réchappée du massacre de Babi Yar, en Ukraine, pendant la seconde guerre mondiale. Dans la scène qui a fait polémique, des soldats étaient en haut sur une colline avec des mitraillettes et tiraient sur les victimes qui étaient en bas et tombaient dans une fosse. On ne voyait pas les victimes, on voyait juste les soldats tirer et on voyait qu’ils tiraient comme on le fait à la fête foraine, avec la même joie, la même insouciance. Face à la polémique, Bond a répondu, dans Le Monde d’ailleurs, que si la pièce s’était appelée Sang et qu’on avait montré les victimes baignant dans leur sang, personne ne serait parti… Ce qui a choqué, c’est l’inconscience des soldats buvant tranquillement leur café après le massacre, qui était une image plus large de l’inhumanité du XXe siècle.
En quoi Bond change-t-il la manière de faire du théâtre politique, par rapport à la tradition brechtienne, notamment ?
Je pense qu’idéologiquement il ne s’est jamais vraiment défini. Mais, surtout, il ne prend pas son crayon en se disant : je vais écrire une pièce pour démontrer telle ou telle chose, ce qui, de manière un peu grossière, était le déroulement brechtien normal. Quand il commence une pièce, il n’a pas la solution : il fait une expérience, avec et sur ses personnages. C’est un théâtre plutôt optimiste, qui croit en l’être humain, en fait.
De quelle manière ?
C’est vraiment un théâtre de l’instant, du présent, qui n’est pas construit sur des continuités psychologiques, où le sens se fabrique au fur et à mesure. C’est aussi pour cela qu’il n’est pas un donneur de leçons : ses personnages, au contraire de ceux de Brecht, sont dans une compréhension à la fois consciente et inconsciente de leur situation, justement parce qu’ils sont dans l’instant. Et dans l’instant il y a tous les paradoxes possibles : comment va-t-on réagir face à l’impensable ? On ne le sait pas à l’avance. C’est là que paradoxalement ce n’est pas un pessimiste, et qu’il a une confiance totale dans ce qu’il appelle notre impératif catégorique : il pense que les solutions à ces situations extrêmes ont à voir avec la justice. Ce n’est pas un théâtre de la guerre, mais un théâtre de la paix.
« DANS SES PIÈCES, IL POUSSE LE BOUCHON LE PLUS LOIN POSSIBLE, AVANT D’OUVRIR SUR UN HORIZON DE SENS »
Comment expliquez-vous alors que ce ne soit pas toujours très bien perçu ?
Parce que le chemin qu’il a choisi est une voie étroite : dans ses pièces, il pousse le bouchon le plus loin possible, avant d’ouvrir sur un horizon de sens. Il y a toujours à la fin quelque chose de l’ordre du grain de sable qui va permettre une refondation. Mais c’est vraiment tout à la fin… Il affronte des situations extrêmes pour, comme ses personnages, entrer dans une compréhension de ces situations, et ouvrir sur autre chose. Mais il ne dit pas quelle conduite adopter.
Bond est un homme qui a fait un choix complexe et fort, dans sa vie : après avoir écrit les dialogues et une partie du scénario de Blow-up, le film d’Antonioni, un boulevard s’ouvrait devant lui à Hollywood et dans le cinéma. Mais il a fait un autre choix, parce qu’il avait en lui cette force de conviction, cette énergie du sens qu’il a toujours aujourd’hui.
Son théâtre est-il plutôt politique ou plutôt existentiel ?
C’est un mélange des deux, et c’est là sa singularité et sa puissance. La Mer en témoigne bien, qui comporte une dimension sociale passionnante, en montrant une société complètement fermée, bloquée sur tous les plans, mais aussi le parcours intérieur qu’effectuent les personnages.
Quelle place cette pièce occupe-t-elle dans son œuvre ?
Bond l’a écrite en 1972, presque au même moment que son Lear. Comme Lear était une pièce tragique, il voulait écrire une comédie. C’est un de ses paradoxes, que lui-même évoque souvent en riant : le fait qu’il ne soit pas un pur tragique, mais aussi un auteur comique. Il y a des passages très drôles dans certaines de ses pièces. C’est le cas dans La Mer, où le tragique et le comique sont intimement liés.
La pièce surprend par une facture plus classique, une ambiance plus romanesque que les autres œuvres de Bond que vous avez montées…
Oui, cela m’amuse, d’ailleurs, car c’est la première fois que je mets en scène une de ses pièces en costumes d’époque, puisque l’histoire se déroule en 1907. C’est une pièce qui contient des scènes spectaculaires, celle de la tempête, notamment. Mais, en même temps, c’est toujours le même parcours que Bond fait effectuer à ses personnages : la pièce commence par un naufrage, qui pour l’un des deux garçons se solde par la mort, et pour l’autre par une seconde naissance. La mort et la naissance sont indissociables chez lui, toute son œuvre est marquée par cette dualité.
C’est important, comme symbole, son entrée au répertoire de la Comédie-Française ?
Très important, et Bond en est lui-même très heureux. Mais je pense qu’il serait bien aussi que le Français poursuive sur cette lancée en proposant une pièce plus contemporaine, plus emblématique de la singularité et de la radicalité d’Edward Bond.
La Mer, d’Edward Bond. Mise en scène d’Alain Françon. Comédie-Française, place Colette, Paris-1er. Mo Palais-Royal. Tél. : 01-44-58-15-15. A 14 heures ou 20 h 30, en alternance, du 5 mars au 15 juin. De 5 € à 41 euros. Rencontre exceptionnelle avec Edward Bond, lundi 7 mars à 10 heures, à la salle Richelieu, dans le cadre de l’entrée au répertoire de La Mer. Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles, à l’adresse suivante : rencontre.bond@comedie-francaise.org
Une rencontre organisée dans le cadre de la journée d’étude « Au bord de La Mer : Edward Bond, dramaturge comique ? ».
Fabienne Darge
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 20, 2016 7:34 PM
|
Lundi 7 mars à 10 heures, une rencontre exceptionnelle avec Edward Bond à la Salle Richelieu est organisée dans le cadre de l'entrée au répertoire de La Mer, spectacle mis en scène par Alain Françon à partir du 5 mars.
Entrée libre sur réservation, dans la limite des places disponibles, à l'adresse suivante :
rencontre.bond@comedie-francaise.org
Cette rencontre est organisée dans le cadre de la journée d'étude "Au bord de La Mer : Edward Bond, dramaturge comique ?"
Journée d'études conçue et présentée par Catherine Naugrette, Jérôme Hankins et David Tuaillon
Programme :
Salle Richelieu
10h Présentation d'Edward BOND, par Éric RUF (Administrateur général de la Comédie-Française)
10h10-12h30 Conférence d'Edward BOND (présentation David TUAILLON, traduction J. HANKINS)
12h30-14h Pause déjeuner
Bibliothèque nationale de France, site Richelieu (réservation obligatoire au 01 53 79 49 49)
14h Début des interventions et communications à la Bibliothèque nationale de France, Ouverture par Joël HUTHWOHL, Présidente de séance Catherine NAUGRETTE
14h10-15h Tony COULT "« Rire dans la nuit », le sens de la comédie chez Edward Bond" (traduction David TUAILLON)
15h15 Alexandru BUMBAS, "Le rire dystopique dans La Mer d'Edward Bond"
15h45 Jérôme HANKINS, "Traduire La Mer, ou la tragédie des ventriloques"
17h Conversation entre Alain FRANÇON et David TUAILLON
17h45 Parole de clôture d'Edward BOND
Journée co-organisée par l'IRET (Institut de Recherches en Études Théâtrales) de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III ; le CRAE, Centre de Recherche en Arts et en Esthétique de l'UFR des Arts de l'Université de Picardie Jules Verne ; la Comédie-Française et la Bibliothèque nationale de France.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 16, 2016 5:51 PM
|
Par Laurence Liban pour son blog "Les lendemains de la générale" : Le titre n’est pas gai, le sujet non plus _ la grande guerre vue et commentée depuis l’arrière, côté autrichien et allemand_ et pourtant, on sort de ce spectacle tristement édifiant le sourire aux lèvres et bizarrement revigoré.
Karl Kraus a été monté sur la scène française à de nombreuses reprises mais jamais avec cette verve vivace, cette légèreté et ce goût du théâtre de composition déployés ici par le metteur en scène David Lescot.
Imaginez. 1915. Premières victoires. Le peuple germain bombe le torse. Au café du commerce, on suppute, on dispute, on fait de la politique à trois sous, on rodomonte façon Bouvard et Pécuchet. Une jeune et jolie journaliste balade son micro sous le nez des héros. La guerre est une plaisanterie qui risque d’être un peu courte. Dommage…
Puis, ça se gâte. La baderne décorée gonfle comme la grenouille qui. Le troufion perd de sa valeur mais non de son utilité. La chair à canon abonde davantage au front que la chair à saucisse sur les étals de Francfort et de Munich. Les derniers jours de l’humanité approchent.
Bruno Raffaelli et Denis Podalydès (Photo Raynaud de Lage)
Composée à partir de « choses vues et entendues » par l’auteur, la pièce tient dans un bouquin d’au moins mille pages où Denis Podalydès, narrateur, vient piocher de quoi alimenter la grosse Bertha. Agrémenté de films d’actualités et de chansonnettes, les sketches se succèdent comme au cabaret. Podalydès interprète le locuteur et l’interlocuteur, la bonne vieille et la baderne et c’est un régal. Sylvia Bergé et Bruno Raffaelli (impayable en gamine aussi bavaroise que capricieuse), se donnent la réplique sur tous les tons, et Pauline Clément, récente recrue de la Comédie-Française, nous fait tourner la tête, aussi piquante que charmante dans le rôle de la journaliste (façon Audrey Hepburn) et du brave petit soldat.
Tout cela est fort gai et fort intelligent. J’y retourne immédiatement.
Vieux Colombier, Paris (VIè). Jusqu’au 28 février.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 14, 2016 2:34 PM
|
Par Fabienne Darge, pour le Monde Maëlle Poésy, sœur de l’actrice Clémence, s’affirme à 31 ans comme une des étoiles montantes du théâtre français. Le talent ne se mesure pas au kilo, et deux petits Tchekhov valent mieux que bien des poids lourds, surtout s’ils sont mis en scène avec sensibilité et intelligence. Ce qui est le cas avec Le Chant du cygne et L’Ours, deux bijoux fort bien montés au Studio-Théâtre de la Comédie-Française par Maëlle Poésy, sœur de l’actrice Clémence, qui s’affirme à 31 ans comme une des étoiles montantes du théâtre français. En janvier, à la Cité internationale, le Candide signé par la metteuse en scène a connu un joli succès. La jeune femme sera au prochain Festival d’Avignon avec Ceux qui errent ne se trompent pas. Un spectacle sur la démocratie écrit avec le dramaturge Kevin Keiss, qui cosigne avec elle cette adaptation des deux pièces de Tchekhov. Hommage au théâtre Qu’il est beau qu’une jeune femme d’aujourd’hui ouvre son premier spectacle à la Comédie-Française par cet hommage au théâtre si délicat, si déchirant qu’est Le Chant du cygne… Tchekhov a concentré tout son art dans ce court chef-d’œuvre dont « l’action se passe la nuit, après le spectacle, sur la scène d’un théâtre de province de second ordre ». A cette heure-là, Vassili Vassiliévitch Svetlovidov s’est endormi dans sa loge, vieil acteur alcoolique et seul. Du moins le croit-il : soliloquant comme un fantôme dans le théâtre vide, il réveille Nikita Ivanytch, le souffleur, qui dort sous la scène, trop pauvre pour habiter ailleurs. Alors Vassili Vassiliévitch va jouer pour lui tous ces grands rôles qu’il n’a jamais eus, une dernière fois avant de se fondre dans les murs du théâtre. Tragique et comique de nos vies C’est cela, Le Chant du cygne : le théâtre comme une maison que l’on va devoir quitter, un moment qui passe, et qui contient tout : la vie, ratée, la mort inéluctable, et le théâtre, qui permet de rejouer cette vie mais ne sauve ni du ratage ni de la mort. Tchekhov prend dans le même mouvement le tragique et le comique de nos vies, mais si dans Le Chant du cygne, c’est le tragique qui révèle le comique et l’absurdité de l’existence, dans L’Ours, monté en miroir par Maëlle Poésy, c’est le contraire : le comique qui révèle le tragique. Car Dieu sait qu’elle est drôle, cette petite pièce qui voit Elena Ivanovna Popova, jeune veuve, pleurer toutes les larmes de son corps, sept mois après la mort de son mari, qui l’a pourtant allégrement trompée. Elle se grise de son rôle tragique, quand débarque Grigory Stépanovitch Smirvov, propriétaire foncier comme elle. Ce n’est pas de l’amour qu’il vient lui demander, mais de l’argent, que le mari d’Elena lui devait. Il repartira avec l’amour. Pourtant l’homme est un goujat, un de ces types mal embouchés qui professent leur détestation des femmes. Un ours. Mais, dans cette nouvelle version d’Elena et les hommes, il ne faudra que deux temps, trois mouvements pour que la veuve éplorée et l’ours mal léché tombent dans les bras l’un de l’autre. Ô inconstance humaine… Formée à la danse Pas étonnant que Maëlle Poesy se soit formée à la danse, avec les chorégraphes Hofesh Shechter, Damien Jalet et Koen Augustijnen, après être passée par le Conservatoire, l’école du Théâtre national de Strasbourg et la London Academy of Music and Dramatic Art. Il y a quelque chose de très physique dans ce spectacle qui se joue dans un unique décor mis en abyme, une petite cuisine qui, dans la première pièce, serait le décor dans le décor de la deuxième. C’est ainsi que Maëlle Poésy prend à bras-le-corps le théâtre, sans rien d’éthéré, mais avec de la finesse dans la lecture et une vraie maîtrise dans la direction d’acteurs. Lesquels sont excellents, incarnant leurs personnages avec force et couleur. Humains trop humains, Gilles David, Christophe Montenez, Julie Sicard, irrésistible, et, surtout, Benjamin Lavernhe, que l’on n’avait jamais vu aussi génial, faisant montre d’une telle démesure. Il semblerait bien que la jeune Poésy ait de beaux jours devant elle. Le Chant du cygne et L’Ours, d’Anton Tchekhov. Mise en scène : Maëlle Poésy, d’après la traduction de Georges Perros et Génia Cannac. Studio-théâtre de la Comédie-Française, 99, rue de Rivoli, Paris 1er. Tél. : 01-44-58-15-15. Du mercredi au samedi à 18 h 30, jusqu’au 28 février. Durée : 1 heure. www.comedie-francaise.fr Fabienne Darge
Journaliste au Monde
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/scenes/article/2016/02/11/deux-petits-bijoux-de-tchekhov-a-la-comedie-francaise_4863160_1654999.html#Ucd2bLX3AJO5bhGG.99

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 7, 2016 4:07 PM
|
A la Comédie-Française, salle Richelieu du DU 5 MARS AU 15 JUIN 2016 (en alternance) Figure majeure du théâtre contemporain, Edward Bond a toujours revendiqué le caractère salutaire de ses mises en scène violentes, explorant sans relâche les pouvoirs du théâtre à examiner des situations extrêmes, à revisiter les moments, les lieux où l’humanité a été niée. « La vie perd son sens lorsque vous cessez d’agir sur la chose qui vous importe le plus : votre engagement moral dans la société. L’indifférence et le cynisme, une pseudo-philosophie (nous sommes tous des animaux), une pseudo-psychologie (nous sommes tous fondamentalement égoïstes) et une pseudoscience (nous avons tous en nous un peu d’agressivité), cela donne en fin de compte cette pseudo-profondeur : la vie est absurde. S’il me fallait donner un nom à mon théâtre je l’appellerais le Théâtre Rationnel. » Créée en 1973, La Mer, inscrite au répertoire de la Comédie-Française depuis 2011 sans y avoir jamais été donnée, est une clef d’entrée pour aborder l’oeuvre de l’auteur dans laquelle elle occupe une place à part, relevant d'un registre plus romanesque. Défricheur d’Edward Bond, Alain Françon a parcouru ses textes avec constance, du Théâtre national de la Colline pour Café, Le Crime du xxie siècle ou Naître, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis pour Les Gens, en passant par le Festival d’Avignon pour Chaise. Il poursuit avec La Mer son chemin avec la Troupe qu’il retrouve ici pour la septième fois.
Nouvelle traduction de Jérôme Hankins
L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.
www.arche-editeur.com DistributionCécile Brune : Louise RafiÉric Génovèse : Le PasteurCoraly Zahonero : Mafanwy PriceCéline Samie : RachelLaurent Stocker : EvensElsa Lepoivre : Jessica TilehouseSerge Bagdassarian : CarterHervé Pierre : HatchPierre Louis-Calixte : ThompsonStéphane Varupenne : HollarcutJérémy Lopez : Willy CarsonAdeline d'Hermy : Rose JonesJennifer Decker : Jilly Élèves-comédiens :
Une femme : Pénélope Avril
Davis et une femme : Vanessa Bile-Audouard
Homme du village : Hugues Duchêne
Homme du village : Laurent Robert Dossier de presse du spectacle : http://www.comedie-francaise.fr/images/telechargements/presse_lamer1516.pdf
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 28, 2016 2:49 PM
|
Par Stéphane Capron pour Sceneweb
18 créations en 2016/2017 à la Comédie-Française dans les trois salles et parité parfaite femme-homme ! Comme quoi tout arrive. Pour sa deuxième saison à la tête de l’institution française, Eric Ruf, l’administrateur est parvenu à réussir une équation que beaucoup de directeurs de théâtre ont encore beaucoup de mal à réaliser. 9 des créations seront mises en scène par des femmes Et ce n’est pas uniquement la seule bonne nouvelle, car la saison permet aussi à une nouvelle génération d’accéder à la grande maison. C’est le cas de Julie Deliquet qui ouvrira le bal du Vieux-Colombier en septembre avec une nouvelle version de Vania de Tchkehov.
On savait déjà que la brésilienne Christiane Jatahy allait mettre en scène une pièce à Richelieu, ce sera une adaptation de La Règle du Jeu, le film de Jean Renoir. L’adaptation Des Damnés de Visconti par Ivo van Hove (qui a débuté cette semaine les répétitions) sera programmée fin septembre. On va découvrir en 2017 le travail de la metteuse en scène allemande Katharina Thalbach. Son nom de vous dit peut-être rien mais c’est la fille du grand metteur en scène suisse Benno Besson et de l’actrice allemande Sabine Thalbach. Elle a joué au Berliner Ensemble alors forcément elle mettra en scène du Brecht, L’irrésistible ascension d’Arturo Ui (à partir de 1er avril à Richelieu).
On vous l’annonçait cette semaine Isabelle Nanty va s’atteler à une nouvelle version de L’hôtel du Libre Echange de Feydeau ( en mai à Richelieu). Anne Kessler mettra en scène La Ronde de Schnitzler en novembre au Vieux-Colombier, Véronique Vella Les contes du chat perché de Marcel Aymé en novembre au Studio et Deborah Warner Le Testament de Marie dans le cadre d’une coproduction avec l’Odéon.
Pascal Rambert va mettre en scène Une vie, un de ses textes en mai au Vieux-Colombier, Jacques Lassalle La cruche cassée de Kleist en mars (toujours au Vieux-Colombier) et l’on découvrira le travail au Studio de Laurent Delvert de la compagnie NTB (il a été l’assistant d’Eric Ruf et de Denis Podalydès sur des opéras) dans un Musset en mars.
Les comédiens de la troupe sont comme toujours mis à contribution. Il y aura un cabaret préparé par Serge Bagdassarian pour débuter la saison du Studio en septembre. Clément Hervieu-Léger aura les honneurs de Richelieu avec Le petit-maitre corrigé de Marivaux puis pour sa reprise du Misanthrope. La deuxième édition du festival de monologues Singulis se déroulera entre février et avril au Studio avec quatre créations et parmi les reprises il y a bien sûr 20 000 lieues sous les mers et le très beau Les enfants du silence qui sera donné dans le privé au Théâtre Antoine en janvier. Public/privé, masculin/féminin…sur le papier c’est une très belle saison !
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 14, 2016 6:50 AM
|
Parue dans La Revue du spectacle
"Grisélidis", Comédie-Française Studio, Paris >> Festival Off d'Avignon au mois de juillet
Du fond de la salle à l'avant-scène, Grisélidis (jouée par Coraly Zahonero) parle d'elle, de sa vie et tient colloque. Prostituée, sociologue, anarchiste, écrivain. Les mots hésitent à la caractériser.
Accompagné par la plainte du violon et les gémissements du saxo qui peuvent s'accorder et s'exacerber en une danse endiablée, le personnage est à la lisière des mondes, joue avec l'ombre (ses ombres) pour donner du relief à la lumière.
Un rideau s'ouvre comme un paravent, elle s'installe à sa table de toilette ou son lit de parade et le lointain s'élargit à l'azur. D'apartés en apartés, Grisélidis conquiert la scène de sa vie et la scène du théâtre. Ce qui pourrait être monologue fermé devient témoignage et dialogue. L'intimité est partagée. Une immense solitude enfermée par tous les tabous devient ainsi concertante et déconcerte…
Car Grisélidis dit les choses en tout réalisme. Un langage populaire glisse en une langue recherchée. Sans à-coups, ni effets littéraire de genre. Jamais complaisant, jamais argotique. Plutôt que de développer un pittoresque du malheur, le personnage lucide sur lui-même et la misère qui l'accompagne, tient un discours d'amour et de compréhension. Insistant sur le rôle social éminemment positif de la prostituée.
Coraly Zahonero a de l'enfant le sens de la gravité et de l'émerveillement : le caractère mutin, la conscience et la présence. Tout se passe pour le spectateur comme si cette femme avait accumulé, concentré en elle, tous les désirs inaccomplis de ses aïeules et, dans une fulguration d'énergie, avait franchi la ligne comme un accomplissement des fantômes et inversé la courbe des destins. Fût-ce au prix de la pesanteur du quotidien.
La comédienne installe dans l'instantané du théâtre le miroir de la jouissance du premier amant aimant aimé, rétablit l'émerveillement de cet instant qui annihile toutes les durées de souffrance. Et de sa misère qui accompagne toutes les misères fait jaillir l'altruisme, le temps d'un petit bonheur. Ce spectacle est une très belle illustration de ce que peut être l'effet théâtre. Et Grisélidis rejoint le paradigme de Marie Madeleine.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 7, 2016 11:51 AM
|
Par Armelle Héliot pour son blog de Mediapart :
Parmi les très bons moments à signaler, quatre monologues traités selon la personnalité des interprètes qui en sont complètement responsables.
Denis Podalydès, avec une force intérieure retenue, quelque chose de déterminé et pourtant comme lézardé dans sa présence, a dit ce que j'appelle oubli de Laurent Mauvignier. Dans des lumières de Stéphanie Daniel, il reprend ce texte qui ne commence ni ne finit, file sur soixante pages sans que jamais la moindre pause ne soit ménagée.
Urgence à dire. Le propos de Laurent Mauvigner est un peu de l'ordre de la magie. La parole n'efface rien, la parole pourtant, parce qu'elle demeure ouverte, suspendue et ouverte, laisse comme une espérance de consolation.
Un homme a bu une canette dans les rayons mêmes d'un supermarché. Il a été repéré. Quatre vigiles se sont jetés sur lui. Il en est mort. C'est un fait divers véritable de l'été 2009.
Laurent Mauvignier a fait ce texte d'adresse au frère.
Denis Podalydès, intelligence aigüe, ultra sensibilité communicative, dit ce texte.
Première station.
Rupture de ton. Elliot Jenicot propose Les Fous ne sont plus ce qu'ils étaient, d'après Raymond Devos. Hommage sincère et espiègle à la fois. Le Belge qui sait tout du music hall ne pouvait que rencontrer "sérieusement" Raymond Devos un jour. Son hommage est fraternel. Parfois l'on devine même des montées de pudeur, des frémissements. Il se demande s'il sera aussi bien que le très grand homme. Ce qui est joli dans le moment Jenicot, c'est cette modestie et ce courage qu'il faut pour y aller, en toute simplicité. Le mime, la pantomime sont des moyens qu'il maîtrise. Mais il y a toujours un infime excès en plus, sous le regard de Frédéric Faye. Une interprétation virtuose et sans aucun surlignage, dans des lumières de Philippe Lagrue.
La rigueur de Beckett et son goût du romanesque, c'est ce qu'a choisi Christian Gonon. Il s'est appuyé sur un dramaturge, Pascal Antonini et c'est, pour ce spectacle, Julien Barbazin qui signe les lumières, très importantes dans ce travail. Très importantes et suscitées par les textes de Samuel Beckett.
Le comédien a pu utiliser la musique originale composée en 1984 par Philip Glass, Compagny. Compagnie est un texte long, difficile. une voix peu à peu dissipe la ténèbre d'où elle vient. Peut y retourner.
Au commencement le texte de Compagnie n'est pas pensé pour la scène. Samuel Beckett en a composé lui-même une version scénique. On se souvient de Pierre Dux (ancien Sociétaire et Aministrateur général de la Comédie-Française, et formidable comédien) interprétant, sous le regard intransigeant de Pierre Chabert, qui connaissait très bien les écrits du futur prix Nobel de littérature, cette partition complexe.
Il y a quelque chose d'un "flamenco puro", ici. C'est du pur Beckett, un acteur pur qui nous parle avant de se taire...Et le travail sur la voix, les voix est ici aussi essentiel que tenu avec art.
Seule jeune femme dans ce quatuor, Coraly Zahonero a choisi les écrits d'une femme dont on entend beaucoup la voix au théâtre ces temps-ci. Mais il est toujours intéressant de découvrir une autre façon d'incarner Grisélidis Réal et ses mots.
Coraly Zahonero a puisé dans les écrits et aussi dans les interviews données ici et là par cette femme de grand caractère, cette femme dérangeante.
Elle a construit un spectacle assez sophistiqué, s'entourant de deux jeunes musiciennes très douées à la belle présence : Hélène Arntzen aux saxophoens et Floriane Bonanni au violon.
Dans un décor de maison confortable et mystérieuse, la comédienne a cherché une vraie ressemblance physique avec Grisélidis Réal. Longs cheveux bruns encadrant le visage, regard fardé (maquillages et coiffures de Véronique Soulier-Nguyen), lumières de Philippe Lagrue. Une atmosphère qui convient aux passages crus comme aux moments les plus mélancoliques.
Grâce aux enfants de Grisélidis Réal, l'interprète donne à entendre des textes que l'on ne connaît pas forcément et surtout l'on découvre, dans le foyer du Studio, des dessins saturés, colorés et un livre, exemplaire unique créé pour l'un de ses amoureux.
On reverra ce spectacle les 17 et 18 mai au Théâtre Jean-Vilar de Suresnes et, un peu plus tard, du 8 au 30 juillet, à Avignon, au Petit Louvre, dans le cadre du festival off.
Et normalement, ces "Singulis" sont destinés à être repris dans la programmation de la Comédie-Française la saison prochaine.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 4, 2016 11:55 AM
|
Publié dans Sceneweb.fr
Julien Frison,nouveau visage de la troupe de Comédie-Française. Il est engagé en tant que pensionnaireJulien Frison,nouveau visage de la troupe de Comédie-Française. Il est engagé en tant que pensionnaire depuis le 27 avril 2016. Il y interprétera son premier rôle, Bobin, neveu de Nonancourt, dans la reprise d’Un chapeau de paille d’Italie d’Eugène Labiche, Salle Richelieu du 31 mai au 24 juillet 2016.
D’origine belge, Julien Frison commence sa carrière au cinéma : il joue dans Odette Toulemonde (Éric-Emmanuel Schmitt, 2006), Big City (Djamel Bensalah, 2007), Un monde à nous (Frédéric Balekjan, 2007), Sommeil blanc dans lequel il tient son premier rôle principal (Jean-Paul Guyon, 2008), Un ange à la mer (Frédéric Dumont, 2008). Il tourne également dans la
série Revivre diffusée sur ARTE (2008). En 2010, il partage la vedette avec Jean-Pierre Marielle dans Rondo, film d’Olivier Van Maelderghem et, en 2016, il est à l’affiche du dernier film de Yann Samuell, Le Fantôme de Canterville. Il joue par ailleurs dans de nombreux téléfilms, entre 2007 et 2016.
Julien Frison débute sa formation théâtrale en 2012 au Cours Florent, et entre en 2013 au Conservatoire national supérieur d’art dramatique, dans les classes de Sandy Ouvrier, Nada Strancar et Xavier Gallais. Il y interprète Novecento d’Alessandro Barrico mis en scène par Emmanuel Besnault, dans le cadre d’une carte blanche. En 2015, il joue dans De l’ambition, une création de Yann Reuzeau, présentée au Théâtre du Soleil.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2016 7:41 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog de Mediapart
Le metteur en scène russe revient à la Comédie-Française pour la troisième fois. Une fois de plus, il surprend, déroute, éblouit en mettant en scène « La Musica » et « La Musica Deuxième » de Marguerite Duras. Mémorable.
Jamais depuis les travaux qui ont emporté un peu de son âme, la scène du théâtre du Vieux-Colombier n’aura paru si haute, si large, si profonde. Deux escaliers en colimaçon, dont on ne voit que l’amorce, descendent dans les dessous. Un autre escalier fragile et aérien monte jusqu’aux cintres. A la face, un proscénium augmente les lignes de fuite du plateau. Côté jardin, un triangle de verre nous appelle vers le dehors. Côté cour, tout l’espace joue, y compris la partie derrière le cadre de scène où les deux acteurs viennent s’assoir sur l’une des multiples chaises qui sont entassées comme dans un débarras, et la plupart des spectateurs ne voient alors que l’amorce de leurs corps.
Un espace à la fois confiné, immense et plein d’appels d’air. Jusqu’au pigeonnier qui, ponctuant chaque mouvement, descend des cintres et dont les roucoulements de plaisir accompagnent la représentation. Un espace, un univers nullement réaliste, volontiers symboliste, ironique, ludique, cosmique, romanesqueselon les phases du spectacle. Comment ne pas voir également dans ce pigeonnier la jonction entre les deux colombes, emblème du Théâtre du Vieux Colombier de son créateur, Jacques Copeau et la mouette, emblème du théâtre d’art de Moscou, où Anatoli Vassiliev signa son premier spectacle à l’âge de 31 ans, il en a 73 aujourd’hui.
Et, petit à petit, tout se renversa
Deux des nombreuses chaises, agglutinées avec un amas de tables et de guéridons, figuraient dans « Le bal masqué », premier spectacle de Vassiliev à la Comédie-Française, salle Richelieu, il y a vingt-quatre ans. Un spectacle qui suscita l’ire ou la consternation de nombreux abonnés. Lors des premières représentations ils quittaient le spectacle par rangs entiers. Les acteurs, Jean-Luc Boutté en tête, défendirent bec et ongles ce spectacle magnifique. Et, petit à petit, tout se renversa. Les dernières représentations furent triomphales. Ce spectacle est devenu une légende. Il y a un avant et un après Vassiliev à la Comédie-Française dira Eric Ruf en prenant ses nouvelles fonctions d’Administrateur, rendant hommage à ce maître qui, dans la vieille maison de Molière, « bouscule nos habitudes et nos hiérarchies et fait grandir notre art ». Trop jeune pour avoir vu "Le bal masqué", Ruf, put décrypter son décapant « Amphitryon » de Molière en 2002.
Ce sont deux acteurs de ce spectacle, Florence Viala et Thierry Hancisse, que Vassiliev a choisi pour incarner Anne-Marie Roche et Michel Nollet, le couple des deux "Musica" de Duras qui se retrouve dans le hall d’un hôtel de province du Nord de la France à la veille de leur divorce. Cela faut plusieurs années qu’ils ne se sont pas vus, le temps a passé, mais le passé les travaille au corps, l’amour qui les habitait reste une braise sur laquelle souffle leur retrouvailles: l'un et l'autre voulaient "se revoir'".
Cest ce feu qu'allument Anne-Marie et Michel et qu'entrteinet le couple d’acteurs magnétiques que forment Florence Viala et Thierry Hancisse. Cela nous arrive par bouffées, par brèves bourrasques provoquées par la puissance des regards, l’incendie des corps,les déflagrations de la parole, une multitude d’infime saisissements jalonnant le lent écoulement du temps, de la fin du jour au petit matin, -un écroulement tout autant- où le silence parle autant sinon plus que les mots. Duras insiste sur ce point : « Ils restent –une minute pleine- sans rien dire » («La Musica »), « silence énorme d’une minute pleine » (« La Musica Deuxième »). Vassiliev lui rend, ô combien, la politesse.
Des chargeurs d'énergie
En chimiste des tréfonds de l’être humain (c’est ce qui l’intéresse chez l’acteur, son être profond, non son art du paraître), il orchestre la parole de ces silences parlants. C’est en passant par cette enfouissement, et venant de très loin, que les mots affleurent aux lèvres des deux acteurs et jaillissent parfois violemment comme ces chevaux longtemps retenus dans leur box avant la course et dont on lâche soudain la bride. Les deux escaliers en colimaçon que les acteurs empruntent sans nécessité narrative, mais par injonction rythmique, créent un mouvement circulaire vertical et apparaissent comme des chargeurs d’énergie des corps, des voix et des regards dans un jeu sans cesse recommencé d’apparitions –disparitions : réitération du premier regard.
Mouvement (ceux-là et bien d’autres) qui reviennent en ritournelles, créant chez le spectateur -de plus en plus relâché, au fil des trois heures et quelques de la représentation- une poétique ample et diffuse, au bougé constant, comme deux images qui se superposent sans se fondre, figure mêmedu tremblement d’être, du trouble du désir qui sont le cœur même de la pièce et plus encore du spectacle.
Florence Viala et Thierry Hancisse dans "La Musica" © Laurencine Lot/ collection Comédie-Française
Duras avait écrit « La Musica » en 1965 pour la BBC. Elle ne trouvait pas la pièce insatisfaisante mais inachevée. Vingt ans durant elle porta le désir d’aller plus loin. Et en 1985, elle écrivit, la « Musica Deuxième », pièce en deux parties. Vassiliev a lu Duras en russe lorsque quelques-unes de ses pièces furent traduites au début des années 2000 par Natalia Isaieva. Il mit en scène à Budapest et Kaposvar « Des journées entières dans les arbres » avec une grande actrice hongroise, Mari Töröcsik. Et quand Ruf lui proposa de revenir mettre en scène au Français, il hésita entre Koltès et Duras et opta pour le voyage dans le temps (du théâtre aussi bien) que constitue la succession en trois temps des deux « Musica ».Vassiliev place son spectacle sous le regard d’une pendule qui, au fond du décor, voit son balancier être éclairé ici et là, par des chatoyants éclairages. Une trilogie. Un concerto en trois mouvements. Les trois niveaux du monde chamaniste aussi bien.
Un, deux, trois, soleil
Trois comme le mari, la femme et l’autre, amant unique ou amantes multiples, aventures brèves d’hôtels où l’on ne fait que passer. Comme des amants atypiques, Anne Marie et Michel, mariés, vécurent de longs mois dans cet hôtel en attendant d’avoir leur maison (Michel est architecte) quelque chose de définitif, de stable, le contraire même de l’amour, le début de sa fin. Et les voici de retour dans cet hôtel.
Magie des mouvements circulaires oùs’inscrivent des traides qui n’en finissent pas d’innerver la représentation. Les acteurs, ces bêtes de scène, inventent comme les animaux des parcours qui leur sont propres, des postes de refuge où observer, écouter l’autre. En schématisant, disons que l’espace est réparti en trois zones : la zone des chaises et des deux escaliers en colimaçon, lieu du regard, de la redécouverte ; la zone de l’avant-scène jardin, lieu circulaire des approches et des frôlements ; et, troisième zone, le triangle vitré de l’en dehors, lieu des étreintes furtives et sauvages, lieu des amant(e)s nu(e)s et de ce qui relie l’homme et la femme à l’extérieur, le téléphone. Rien de cela n’apparaît évidemment pendant la représentation aux signes multiples jamais soulignés, jamais expliqués (comme ces trois bougies allumées, ce gong liés à je ne sais quel souvenir du couple ou pas), aux gags désarmants (comme la multiplication des bouteilles et des verres ou encore les trois téléphones). C’est plus tard, longtemps après que cette poétique sensible vous revient et s’organise dans la mémoire.
Mouvement circulaire de la sphère sonore tout autant. A commencer par les reprises lancinantes du thème (mais aussi les solos de batterie) de « Caravan » par l’orchestre de Duke Ellington ou les effluves de musiques répétitives. Répliques, rires reviennent, se répètent mais autrement. Un seul exemple, la première réplique, après le premier regard. Dans « La Musica », « Lui » apparait dans l’escalier en colimaçon le plus près du public, « Elle » est assise à la face derrière le cadre de scène (manteau d'une élégance stricte et un peu provinciale, chapeau), une jambe repliée, l’autre pas ( pan de peau désirable), ils se regardent et dans une tension extrême, une violence contenue, une souffrance infinie, « Lui » dit : « je voulais vous dire…si nous avez besoin de moi… pour ces meubles qui sont au garde-meuble.. ». Terrible, bouleversant. La même réplique revient dans « La Musica Deuxième ». Vassiliev fait en sorte que Lui et Elle se tiennent au fond du plateau sous l'escalier aérien, côte à côte. Ils nous regardent et se regardent sans s’attarder, Elle porte une robe colorée légère, Lui dit la même réplique mais sur un ton enjoué, presque primesautier, joueur, Elle rigole, Lui rit aussi. Renversant.
Le trouble, l'obscur, l'incertain
Ces deux premières parties du spectacle, l’une psychologique, l’autre ludique, nous préparent au lit profond de la troisième partie, le deuxième acte de « La Musica Deuxième ». Dans le « texte pour la presse » qui conclut la publication de la pièce publiée seule chez Gallimard, Duras écrit : « vingt ans que j’entends les voix brisées de ce deuxième acte, défaites par la fatigue de la nuit blanche. Et qu’ils se tiennent toujours dans cette jeunesse du premier amour, effrayés ».Un homme détruit et une femme qui sait désormais. Qui sait ce que lui se sait pas encore, encore un peu terrien devant cette femme devenue céleste et comme débarrassée de toute pudeur, de tout non-dit. Sublime.
Pour les deux acteurs, ce qui fut un parcours du combattant (et dont on devinait encore un peu les traces le soir de la première) au fil des jours de répétition est devenu une expérience sans pareille, une traversée accélérée d’une histoire du et de théâtre, une immersion en eaux profondes où le trouble, l’obscur, l’incertain mènent versune sorte d’intensité solaire naissante, comme l’aube sur laquelle s’achève le spectacle. Si Vassiliev déstabilise les acteurs, c’est pour enlever leur peau d’habitudes, d’automatismes, de savoir-faire, de savoir-dire. Il en fait autant pour les spectateurs. C’est peu dire que Florence Viala et Thierry Hancisse atteignent, dans ce spectacle, un sommet de leur art. Avec humilité, modestie et ténacité, ce qui ne veut pas dire sans avoir été inquiets et déboussolés, ils frayent les chemins insensés, imprévisibles où les entraîne l’immense Anatoli Vassiliev. Duras (dans « Ecrire ») : « si on savait quelque chose de ce qu’on va écrire, avant de le faire, avant d’écrire, on n’écrirait jamais. Ce n serait pas la peine ». Remplacez « écrire » par « jouer » ou « mettre en scène », c’est la même chose.
Le premier soir, une jeune pensionnaire de la Comédie Française venue assister au spectacle vit, effarée, des spectateurs partir ou ne pas revenir après l’entracte. Comme il y a vingt-quatre ans. Et comme pour « Le Bal masqué », la critique sera, est déjà, divisée. Mais il ne fait aucun doute que ce spectacle sans pareil entrera dans la légende du Vieux-Colombier. Les pigeons du spectacle en roucoulent déjà.
Comédie-Française au Théâtre du Vieux Colombier, mar 19, du mer au sam 20h30, dim 15h, jusqu’au 30 avril.
Photo : Scène de "La Musica" © Laurencine Lot/ collection Comédie-Française

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 21, 2016 2:42 PM
|
Par Christian-Luc Morel dans Froggy's Delight
Comédies dramatiques de Marguerite Duras, mise en scène de Anatoli Vassiliev, avec Thierry Hancisse, Florence Viala, Agnès Adam, Hugues Badetet Marion Delplancke.
La Comédie-Française sait aborder Marguerite Duras et l’on se souvient d’un beau "Savannah Bay" avec Catherine Samie et Catherine Hiégel.
Cette fois, sont proposées deux pièces écrites à vingt ans d’écart, "La Musica" et "La Musica deuxième" œuvres sœurs et presque ennemies, tant elles s’opposent en se ressemblant.
Un couple se retrouve à Evreux, à l’Hôtel de France. Ils s’y sont tant aimés avant d’acheter une maison dans la ville, là où la routine et le malheur, mérules de charpente, ont grignoté leur amour.
Le divorce gigote, horrible, après la première infidélité de la femme, jugée "abominable", attendu avec frénésie par les êtres de rechange, qu’ils ont rencontré dans l’étendue morne de l’"après", mais eux, ne s’aiment-ils pas toujours, jusqu’à regretter l’enfer conjugal ? Des heures et des heures, avec des mots, ils vont tout éprouver de nouveau, en s’éprouvant comme jamais. Une pièce ne finit rien, sa suite s’amuse à imaginer le possible.
Eric Ruf, qui doit n’aimer rien plus que le "Pourquoi pas ?", a invité un vieux maître russe, un enragé du texte et de la fidélité, un trousseur d’habitudes, qui doit pratiquer l’autopsie à vif, Anatoli Vassiliev.
Les gardiens du Temple durassien, cet auteur du chuchoté-hurlant, du frôlement brutal, doivent s’étrangler de rage : le russe impose son univers, son plateau encombré, le réalisme à larmes et crachat, les nudités crues des "pièces rapportées" déshabillées par l’absence : "Ou es-tu, Marguerite ?".
Si la première pièce convainc difficilement, la seconde emporte l’adhésion, tour réussi du vieux magicien, qu’on imagine se frottant les mains de satisfaction. Et puis Duras, grand auteur français donc universel devait enfin être volée. Guetté par Agnès Adam (la tenancière de l’hôtel), Hugues Badet et Marion Delplanque (les dénudés) le couple est composé de deux comédiens magnifiques : Thierry Hancisse, séducteur brisé au pouvoir intact, troublant, pervers, face à une Florence Viala sublime de féminité, de force et de jeu, jetant sa gangue comme une robe d’une autre heure.
Tout cela sera difficilement pardonné. N’est-ce pas le sujet de ces pièces ?

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 13, 2016 6:07 PM
|
Par Stéphane Capron pour son blog Sceneweb
Alors que sa version des Trois Soeurs de Tchekhov s’achève au Théâtre National de la Colline, la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy va poursuivre sa carrière en France. Artiste associée à l’Odéon – Théâtre de l’Europe la saison prochaine, elle va également mettre en scène à la Comédie-Française à la demande d’Eric Ruf. Christiane Jatahy était d’ailleurs présente lundi soir pour la générale de presse de « La Mer » dans la salle Richelieu. Une salle qu’elle retrouvera en 2016/2017 avec un texte que l’on ne connait pas encore car il n’a pas encore été validé par le comité de lecture. Il s’agit d’une pièce qui fera son entrée au répertoire.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 10, 2016 8:01 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos :
Un vent vif semble avoir fouetté la troupe du Français. Ravageurs, les dix-sept comédiens déployés sur la scène de la salle Richelieu transformée en plage écumante, portent haut la langue acérée d'Edward Bond. « La Mer », pièce de 1973 du dramaturge anglais, fait une entrée fracassante au répertoire de la Maison de Molière. Pas de bons marins sans grand capitaine : avec sa mise en scène au cordeau, Alain Françon confirme qu'il est un des meilleurs directeurs d'acteurs du moment.
Il faut beaucoup de travail et de talent pour orchestrer cette tragicomédie, aussi morbide qu'hilarante. Un soir de tempête de 1907, deux navigateurs font naufrage sur une plage du Suffolk. Le beau Colin, fiancé à la jeune Rose, se noie, alors que son ami Willy réussit à se sauver. Hatch, le garde-côte (et marchand de tissus) n'a pas voulu les secourir, les prenant pour des extraterrestres. Louise Rafi, grande dame revêche qui fait la loi dans le village, est indignée. Entre deux répétitions d'« Orphée » - le spectacle qu'elle monte avec ses amies villageoises -, elle met le commerçant au ban, causant sa ruine. Devenu fou, Hatch poignarde le corps du noyé rejeté par la mer. Après des funérailles épiques, où les cendres s'envolent et où les dames s'évanouissent, Louise convainc Rose et Willy de partir loin, ensemble… Vies bornées, solitude, peur de la mort, du vide, rêves tordus, complotisme, loi du plus fort, désir de reconnaissance… Etrange, virtuose, la pièce de Bond pose toutes sortes de questions existentielles, sans chercher à y répondre - jusqu'à la dernière réplique de Willy, inachevée. Familier de l'auteur, Alain Françon maintient sans faillir la tension entre rires et larmes, extirpant la douloureuse humanité de chaque personnage, dans le décor surréel et poétique imaginé par Jacques Gabel (la mer, tel un tableau vivant).
HILARANTE ET BOULEVERSANTE CÉCILE BRUNE
Les morceaux de bravoure s'enchaînent. Tour à tour hilarante et bouleversante, Cécile Brune campe avec panache Louise Rafi ; Hervé Pierre (Hatch) subjugue en marchand dément aux airs de Caliban ; Elsa Lepoivre est irrésistible en dame de compagnie sentimentale ; Jérémy Lopez émeut en rescapé mélancolique ; Eric Génovèse amuse en pasteur fantasque ; Laurent Stocker incarne avec une belle retenue Evens, l'ermite philosophe ; Stéphane Varupenne (Hollarcut) joue à merveille le prolétaire rageur… Le théâtre brille comme un phare dans la nuit du monde. Edward Bond et son noir humanisme sont entrés au Français par la grande porte.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 4, 2016 6:15 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde
Pourquoi, quand Podalydès parle, il vous transperce
Dit par lui, « Ce que j’appelle oubli », de Laurent Mauvignier, est de ces textes qu’on n’oublie pas.
Il aurait pu partir en courant. Essayer de s’enfuir. Il n’a pas bougé. Quand les vigiles se sont approchés de lui, qui buvait une canette de bière, dans une allée du supermarché, l’homme a laissé faire. Il a entendu leurs voix, et il s’est replié dans le silence. Il a vu leurs corps, leurs têtes, leurs bras qui allaient l’empoigner, et il est resté là, à finir sa bière, dans l’allée du supermarché où les vigiles l’ont cerné, puis traîné, avant d’aller le cogner à mort sur une dalle de ciment... Cette histoire, vous l’avez lue dans les faits divers. Mais, si vous allez au Studio-Théâtre de la Comédie-Française, vous l’entendrez et elle vous traversera le corps, parce qu’elle est racontée par Denis Podalydès, et écrite par Laurent Mauvignier, dans Ce que j’appelle oubli.
Publié aux éditions de Minuit, ce texte n’a pas de majuscule, pas de point final, et il tient en une seule phrase, de soixante-quatre pages. Exactement comme La Nuit juste avant les forêts, de Bernard-Marie Koltès, dont Laurent Mauvignier a choisi de s’inspirer, après avoir vu, un soir, placardée sur un mur, une affichette sur laquelle il était écrit : « le procureur, ce qu’il a dit, c’est qu’un homme ne doit pas mourir pour si peu. »
PLAIE DE L’ABSENCE
Cela, Laurent Mauvignier le relate dans la bible du spectacle, qui en est un parce qu’il donne à voir, au sens propre, et qui, en même temps, s’en distingue parce qu’il est transcendé par la présence d’un grand acteur, seul en scène, immobile pendant une heure, entièrement tendu, de tous ses muscles, de tout son être, vers un récit qui tient en une question : comment relater ce qu’on ne peut expliquer ?
Laurent Mauvignier donne la parole à un narrateur qui s’adresse au frère de l’homme mort. Il semble bien le connaître, il sait que rien ne refermera jamais la plaie de l’absence, mais il veut lui donner des mots, comme on met son manteau sur les épaules de quelqu’un qui grelotte de douleur, en sachant que c’est le geste qui importe, et que nul manteau ne peut réchauffer un froid intérieur. Souvent, les mots du narrateur mots font mal : ils sont violents, pas en eux-mêmes, mais parce que la réalité qu’ils traduisent est violente. C’est celle d’une solitude qui mène un jour un homme à prendre une canette de bière dans un supermarché, parce qu’il a soif, tout simplement soif, et que ses poches sont « cousues ».
THÉÂTRE DE LA VIE
Au Studio-Théâtre, c’est tout le corps de Denis Podalydès qui semble « cousu ». Vêtu d’un tee-shirt rouge et d’un pantalon gris, l’acteur a les deux pieds, nus, fichés dans le sol. Le gauche est en retrait, de biais ; le droit, de face, dans l’angle de la jambe, légèrement pliée. Dans cette immobilité-là, il y a la tension terrible d’un élan arrêté net. Les bras, eux, semblent vouloir, comme ceux d’une pietà, offrir un don : ils bougent à peine, mais pourraient tenir l’humanité entière dans le demi-cercle consolateur qu’ils dessinent. Rien que pour ça, on a envie de dire « merci » à Denis Podalydès, qui s’est dirigé lui-même, dans le décor sobre d’une pièce noire éclairée par Stéphanie Daniel.
Et puis, il y a la voix, cette voix sans pareille de Denis Podalydès : quand elle s’adresse à vous, vous avez l’impression qu’elle vous regarde, comme vous transpercent les yeux noirs de l’acteur. Du plus banal, cette voix fait naître une histoire. Du moindre mot, elle crée une image. Ce n’est pas son timbre qui est le plus marquant, mais ce qu’elle évoque : sa force narratrice est telle qu’elle peut donner forme même « à l’ombre d’un homme », comme celui dont on suit la trajectoire dans Ce que j’appelle oubli, qui commence et finit dans le noir. Comme le théâtre. Et le théâtre de la vie, ici à son acmé.
Ce que j’appelle oubli, de Laurent Mauvignier. Mis en espace et interprété par Denis Podalydès. Studio-Théâtre de la Comédie-Française, galerie du Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli, Paris 1er. Tél. : 01-44-58-98-58. Du 16 au 25 mars. A 20 h 30. Relâche les 21 et 22 mars. www.comedie-francaise.fr
Le texte est publié aux Editions de Minuit (64 p., 7,10 €).
Brigitte Salino
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 17, 2016 1:52 PM
|
Par Sabine pour son blog Pianopanier 1. La reprise de l’excellent Cyrano mis en scène par Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton, c’est au Théâtre de la Porte Saint-Martin et c’est à ne louper sous aucun prétexte : – « Créé en 2013 au Théâtre national de Bretagne, à Rennes, le spectacle surprend avec son Cyrano crâne rasé, bipolaire à la limite pathologique. » – Le JDD – « Sur scène, Philippe Torreton possède un corps, une présence, un phrasé impeccable qui permet aux spectateurs de comprendre le moindre murmure, du premier au dernier rang. Il est une bête de scène. » – RTL – « Le comédien se métamorphose sur les planches pour rentrer dans la peau du mythique personnage créé par Edmond Rostand. La mise en scène de ce Cyrano de Bergerac est très originale. » – France TV Info – « Dominique Pitoiset, le metteur en scène, transpose la pièce de Rostand dans un hôpital psychiatrique d’aujourd’hui, où le Cyrano de Philippe Torreton est un homme qui s’imagine qu’il a été Cyrano. C’est puissamment mélancolique, profondément sensible, magistralement joué. » – Le Monde – « On est surtout emporté par la sincérité et le panache de Philippe Torreton, totalement investi dans son personnage. Il est exceptionnel. » – Le Parisien – « En situant la scène dans la salle de jour d’un hôpital psychiatrique, Dominique Pitoiset opère une mise en abîme de ce classique tant rebattu et lui donne un éclat nouveau, vif et cinglant. » – La Terrasse – Interview de Philippe Torreton pour France Inter 2. A la Comédie des Champs-Elysées, Jérémie Lippmann met en scène La Rivière avec Nicolas Briançon et Emma de Caunes… sans convaincre : – « Mais d’où sort donc cette pièce incompréhensible et prétendument mystérieuse, poétique, voire fantasmatique, dans ses décors piètrement oniriques… » – Telerama – « Jérémie Lippmann met beaucoup d’énergie dans sa mise en scène. Mais, pris au piège du naturalisme, il ne parvient pas à créer suffisamment de mystère et de tension. » – Les Echos – « La mise en scène bucolique et sauvage de Jeremie Lippmann enchante le public, en faisant notamment appelle à la vidéo projection. » – RTL – « Jérémie Lippmann a eu un coup de cœur à New-York lorsqu’il a vu Hugh Jackman. La version française a peut-être perdu de sa poésie en traversant l’Atlantique. » – Scene Web – Interview d’Emma de Caunes pour France TV Info 3. Maëlle Poésy pousse la porte de la Comédie-Française avec un diptyque de Tchekhov, Le Chant du cygne et l’Ours : – « La jeune metteuse en scène met en regard deux petits vaudevilles tchekhoviens qui ravissent par leur férocité comique. » – La Terrasse – « L’Ours – la plus comique des deux – est d’ailleurs celle qu’on a le plus de plaisir à voir : celle où le duo Julie Sicard/Benjamin Lavernhe nous convainc. » – Telerama – « A un microdrame (les derniers feux d’un comédien has been qui dialogue la nuit avec le souffleur) succède sans temps mort une micromédie (le coup de foudre entre une jeune veuve inconsolable et son créancier énervé), le tout en une heure chrono. » – Les Echos – « Deux pièces rarement jouée et rarement vues ensemble, qui fonctionnent assez bien dans leurs contrastes. » – Toute la Culture – « Qu’il est beau qu’une jeune femme d’aujourd’hui ouvre son premier spectacle à la Comédie-Française par cet hommage au théâtre si délicat, si déchirant qu’est Le Chant du cygne… » – Le Monde – « Curieusement, c’est par ces deux petits bijoux que le grand Tchekhov est entré par la petite porte à Comédie-Française, en 1944 et 1945. » – Le Parisien – « Maëlle Poésy donne vie à la phrase, à l’espace, à la durée, à l’acteur et aux émotions. » – France Culture

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 15, 2016 7:02 PM
|
Invité de l'Humeur vagabonde de Kathleen Evin sur France Inter, parle du grand Cycle de lectures au Louvre jusqu'au mois de mai prochain et de la mise en scène de Mithridate de Mozart au Théâtre des Champs Elysées jusqu'au 20 février, puis en tournée à Dijon les 26 et 28 février et 1er mars.
Enfin, également en tournée, la comédie-ballet Monsieur de Pourceaugnac de Molière et Lully,
Clément Hervieu-Léger © Stéphane Lavoué, coll. Comédie-Française Patrice Chéreau avait, on le sait, commencé sa carrière au théâtre pour, ensuite, explorer la mise en scène d’opéra avant de devenir, aussi, réalisateur de films. Trois facettes de sa prodigieuse capacité à diriger ses interprètes, à leur faire exprimer, par leurs corps mêmes, les sentiments, les émotions, les paroles de leurs personnages. Et le voir, sur scène, tourner autour des acteurs, ou des chanteurs, leur parler à l’oreille, les toucher, en accompagnant chacun de leurs gestes, jusqu’à les amener à la parfaite expressivité, était en soi déjà un formidable spectacle. Il avait monté, en 2005 à Aix en Provence un Cosi Fan Tutte resté dans les mémoires. Et pourtant il n’en était pas satisfait, disait-il plus tard. Expliquant que Mozart était particulièrement difficile à mettre en scène, par rapport aux opéras de Wagner dont la théâtralité existe déjà dans l’écriture musicale. Clément Hervieu-Léger, pensionnaire à la Comédie Française où il est entré en 2005, justement l’année de ce Cosi sur lequel il a été l’assistant de Patrice Chéreau, demeure profondément marqué par sa rencontre et les années passées à travailler avec lui. C’est là qu’il a appris l’importance de ce langage des corps qui, plus que les mots, raconte la vérité des personnages. Ce savoir, il le confronte depuis quelques années à la réalité des plateaux, de théâtre comme d’opéras. En 2014 il a ainsi monté Salle Richelieu un magnifique Misanthrope avec Loïc Corbery et Georgia Scalliet, et, en 2011 il avait signé sa première mise en scène d’opéra avec La Didone de Cavalli sous la direction de William Christie. Ces jours-ci, c’est au théâtre des Champs Elysées, encore pour quelques jours, puis à Dijon, que l’on peut écouter un magnifique Mithridate de Mozart, dirigé par Emmanuel Haïm, qu’il a mis en scène. Et, à l’auditorium du Musée du Louvre, jusqu’en mai, vous pouvez aller déguster de délicieusesLectures de textes du XVIIIème dont il a conçu la mise en espace. Et, ce soir, Clément Hervieu-Léger est l’invité de l’Humeur Vagabonde.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 11, 2016 6:33 PM
|
Par Joëlle Gayot pour Télérama - Sortir Paris : Formée à l'école du Théâtre national de Strasbourg, la comédienne de 32 ans assume son statut de chef de troupe.
Ses parents l'emmenaient, fillette, au cirque, à la danse et au Théâtre du Soleil. Pas question de rater les créations d'Ariane Mnouchkine. Née en 1984, Maëlle Poésy ne pouvait échapper au théâtre ! Si le cinéma a fait main basse sur sa soeur, l'actrice Clémence Poésy, les planches sont le territoire de Maëlle. Elle y assouvit une passion qui l'habite à plein temps. Formée dès 2007 à l'école du Théâtre national de Strasbourg, elle en ressort comédienne. L'exercice de la mise en scène la rattrape au vol. Un premier succès, avec la création de Candide, d'après Voltaire, la signale aux regards des puissants. Le Festival d'Avignon la sollicite pour l'été 2016.
La Comédie-Française devance l'appel en lui ouvrant les portes du Studio-Théâtre. Elle y monte d'un seul jet un doublé tchekhovien (Le Chant du cygne et L'Ours), éclairé en sous-main par le film Opening Night, de John Cassavetes.
Elle aime le théâtre lorsqu'il est ciselé à la virgule près. Ne revendique qu'une influence, celle de Joël Pommerat : même recours au conte pour évoquer la société, même rapport au fantastique pour dire la réalité. Au TNS, elle a compris l'impact des compétences lorsqu'elles sont fédérées. Présent à ses côtés depuis les origines, le dramaturge Kevin Keiss. Travailler en équipe, rire avec ses acteurs : voilà pour la méthode. Mais quand il s'agit de trancher, c'est elle seule qui décide. Elle est la chef de troupe. Et l'assume.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...