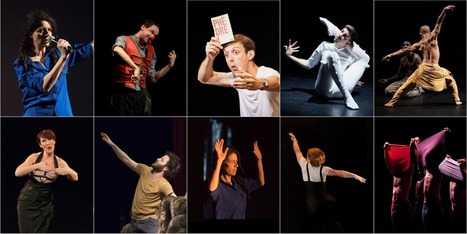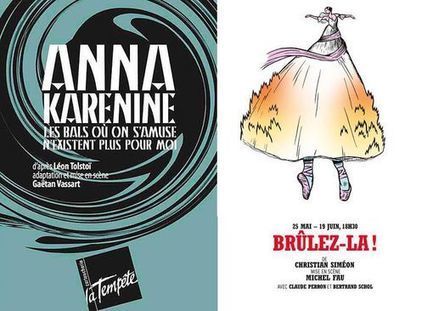Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 10, 2024 7:25 PM
|
par Sonya Faure dans Libération, le 8 déc. 2024 Dans un secteur du spectacle vivant en crise et saturé, les jeunes compagnies sont vulnérables. Des structures existent pour aider les artistes émergents, comme le réseau Prémisses ou le festival Impatience, qui s’ouvre le 10 décembre. Un texte exigeant, très littéraire, que porte seule la comédienne en scène, Ambre Febvre, comme elle porte sa lourde robe-armure en bris de verre. Ce jour de novembre, c’est le filage de la pièce la Cavale, dans la salle Christian-Bérard du vieux théâtre de l’Athénée. Une histoire de traque, de folie et de cauchemar. Le texte écrit par Noham Selcer, 34 ans, est entièrement dégenré ; un comédien ou une comédienne peuvent indifféremment jouer le personnage de la Cavale sans qu’un seul son ne change car «la peur, explique Noham Selcer, concerne tout le monde». Le spectacle sera joué pour la première fois le lendemain, dans la même salle. «Là on arrive au moment où il nous faut jouer devant un public pour avancer», dit le jeune metteur en scène Jonathan Mallard, qui a créé sa compagnie il y a trois ans. Ambre Febvre enchaîne : «Je n’ai pas de partenaire et j’ai maintenant besoin de sentir des réactions dans la salle, des souffles, des raidissements, des petits rires pour aller plus loin.» Le spectacle bougera chaque soir, expliquent-ils, «c’est pour cela que c’est si important d’avoir une série longue». Une «série longue», c’est-à-dire une dizaine de jours à être programmés dans une même salle, pouvoir s’installer dans ses murs et prendre le temps de faire évoluer à la marge le jeu ou les lumières. Patiner le spectacle. Se conforter, se consolider. Et avoir le temps de profiter des retombées du bouche à oreille s’il est bon. Or jouer dix jours dans un même lieu est devenu un petit luxe dans les théâtres, surtout pour des compagnies émergentes qui sont les premières à pâtir de la crise économique du spectacle vivant. L’inflation (des prix de l’énergie notamment) et la stagnation des subventions publiques ont contraint les salles à réduire leur budget consacré à la programmation, reportant, de facto, les difficultés sur les compagnies dont le nombre de représentations a baissé, quand elles n’ont pas tout simplement été annulées. Proposer des formes innovantes pensées par de jeunes artistes inconnus ? Trop risqué pour la plupart des lieux qui doivent s’assurer d’attirer un maximum de public pour «faire de la billetterie». «Le constat se précise d’année en année : les jeunes compagnies connaissent un immense problème de précarité. Précarité sociale surtout mais aussi manque de moyens pour monter leurs créations, témoigne Arnaud Antolinos, secrétaire général de la Colline à Paris et administrateur de la Fondation Entrée en scène, créée en 2020 par l’Ensatt et la Colline comme un «incubateur de talents». Elles ont un cruel besoin de visibilité, au risque de se faire arnaquer par des salles sans scrupule.» Et quand on n’a pas encore de carnet d’adresses, comment montrer son travail ? «La saturation du réseau est telle que les jeunes compagnies n’arrivent même plus à rencontrer des programmateurs, confirme Véronique Bellin, directrice adjointe du Théâtre public de Montreuil. C’est là que se sont montées «les Permanences du TPM», trois journées portes ouvertes par saison où les jeunes artistes peuvent rencontrer n’importe quel membre de l’équipe, de la diffusion à la technique en passant par les relations presse, pour lui poser des questions précises et se faire aider dans ses démarches. De nombreux dispositifs ont été mis sur pied pour soutenir les compagnies émergentes. Des festivals, des résidences, des mécanismes de subvention, comme le Jeune théâtre national (JTN) qui contribue aux salaires des élèves issus d’écoles d’art dramatique, des compagnonnages, comme celui de l’association Actée, ou des collectifs créés par les jeunes compagnies elles-mêmes comme Urgence Emergence. Ce mois-ci, pas moins de deux festivals consacrés à la jeune création lancent leur nouvelle édition : Impatience, déjà bien installé dans le paysage, et le plus jeune festival du Nouveau théâtre de l’Atalante. Au téléphone, José-Manuel Gonçalvès, le directeur de la salle du Centquatre, à Paris, à l’origine du festival, le répète : Thomas Jolly, le pape des cérémonies des Jeux olympiques, est passé par Impatience en 2009, tout comme Julie Deliquet, Yuval Rozman ou Chloé Dabert. C’est d’ailleurs Jolly qui présidera le jury cette édition. Ces dernières années, le festival recevait 240 dossiers de candidatures. Il en a reçu 340 en 2024. Si Noham Selcer, l’auteur de la Cavale, a quant à lui eu l’opportunité de faire jouer son texte près de deux semaines dans la petite salle d’un théâtre de renom, l’Athénée, c’est grâce au réseau de Prémisses. Le dispositif existe depuis sept ans et accompagne chaque année plusieurs jeunes diplômés des écoles supérieures d’art dramatiques afin qu’ils structurent leur compagnie. «L’idée, c’est de mutualiser les moyens sur les artistes formés dans nos écoles publiques, leur assurer une bonne insertion professionnelle : qu’ils travaillent et qu’ils travaillent correctement», rapporte Raphaël de Almeida, qui a repris la direction de Prémisses à la suite de Claire Dupont, aujourd’hui directrice du Théâtre de la Bastille. «Le risque d’une jeune compagnie c’est de mal prévoir la suite et d’utiliser 10 000 euros de subventions simplement dans une location de salle à Avignon pour une poignée de dates. Voire même de s’endetter pour cela. Le spectacle n’existe plus après ces quelques représentations», détaille-t-il. Le budget du dispositif est de 60 000 euros par an, financé par la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) d’Ile-de-France. Chaque année, Prémisses lance un appel à projet et sélectionne plusieurs candidats qui présenteront une maquette de leur projet devant 70 professionnels. Pendant trois ans au moins, le lauréat sera accompagné pour construire ses premiers spectacles (que Prémisses coproduit), apprendre à rédiger une fiche de paie ou une demande de subvention publique, cibler la diffusion, travailler avec les collectivités locales, organiser sa communication… Aujourd’hui Prémisses suit une dizaine de jeunes artistes : les lauréats des trois dernières années mais aussi ceux parmi les plus anciens dont le Covid a retardé les projets «et d’autres qui n’ont pas fini lauréats, mais que nous ne voulons pas lâcher pour autant», ajoute Raphaël de Almeida. Noham Selcer l’a emporté en 2021. Il est aujourd’hui auteur associé au Théâtre des Amandiers. Comme la comédienne et metteuse en scène Mina Kavani qui a joué I’m deranged, pour la première fois dans la salle Christian-Bérard de l’Athénée l’année dernière… et le jouera dans la Grande Salle le mois prochain. Ou encore les géniales autrices du Collectif Marthe dont Rembobiner tourne à salles pleines depuis plus de deux ans et dont le nouveau spectacle sera créé en janvier à la MC2 Grenoble avant d’être joué au Théâtre de la Bastille à Paris. «On ne veut pas être un hypermarché de la jeune création» En septembre dernier, c’est Joaquim Fossi, 26 ans, qui est devenu le nouveau lauréat de Prémisses. Il a présenté, en vingt minutes comme c’est la règle, la maquette de son spectacle le Plaisir, la Peur, le Triomphe : une performance en forme de stand up avec vidéoprojecteur, sur les images de catastrophes et ce qu’elles créent de peur en nous. Gros succès. A l’issue de la journée de sélection, Joaquim Fossi était devenu artiste associé à la Scène nationale d’Orléans, et avait déjà la certitude de créer le Plaisir… au Théâtre de la Bastille en janvier 2026, puis d’enchaîner sur une tournée de trois mois dans toute la France. «Notre but, maintenant, c’est de calmer le jeu, d’éviter les spéculations sur un spectacle, tempère Raphaël de Almeida. On ne veut pas être un hypermarché de la jeune création.» C’est d’ailleurs un reproche parfois fait aux festivals dédiés à l’émergence : ils offrent une visibilité formidable aux spectacles… qui peut les mettre en danger. «Ça nous est arrivé», reconnaît Arnaud Antolinos, du théâtre de la Colline. «Grâce à l’un de nos programmes de soutien à la jeune création, nous avions repéré l’auteur d’un texte brillant, qui n’a finalement pas réussi à faire une mise en scène à la même hauteur. Quand on a montré le spectacle, on a dû éviter qu’on en parle trop en mal. Le public habitué à voir de grands metteurs en scène dans un théâtre national n’est pas forcément préparé à voir de jeunes artistes.» Depuis le théâtre accompagne toujours des projets, mais ne les montre plus à domicile. «Dans nos écoles d’art dramatique, nous avons été formés à la mise en scène, pas à devenir chefs d’entreprise», résume Matthieu Roy, metteur en scène et aujourd’hui responsable, avec Johanna Silberstein, de la Maison Maria-Casarès, à Alloue, en Charente. «Seul opérateur culturel dans un rayon de 30 kilomètres», précise-t-il. Avec le dispositif Jeunes pousses, financé par la Drac Nouvelle-Aquitaine, la Maison Maria-Casarès est devenue un lieu «d’incubation artistique» lors de résidences d’un mois. Les équipes sont logées, nourries, et ont un plateau technique à disposition. Marion Conejero a bénéficié de Jeunes Pousses en 2017 quand elle montait l’Eveil du printemps. Sept ans après son «incubation» à la Maison Maria-Casarès, son nouveau spectacle la Vague a été retenu pour le festival Impatience ce mois-ci… on reste décidément longtemps émergent dans le théâtre. «L’écosystème du secteur est saturé, confirme Matthieu Roy. Il y a eu un déplacement : aujourd’hui, un festival comme Impatience ne découvre plus, il confirme et légitime des artistes au parcours déjà long.» Marion Conejero, 32 ans, dit qu’elle n’aurait «jamais émergé sans Jeunes Pousses». Elle a implanté sa compagnie en Charente, dont elle n’est pas originaire, travaille beaucoup dans les lycées du département, est désormais artiste associée à la scène nationale d’Angoulême. Mais elle dit aussi qu’elle ne sait pas bien «à quel moment on sort de l’émergence…» Sa situation est encore vulnérable : «J’ai fait le choix avec la Vague de monter un gros spectacle avec six acteurs au plateau, ce qui coûte très cher… j’ai bénéficié de subventions mais j’ai aussi injecté de l’argent… bref j’ai tout mis. Et pour l’instant ma compagnie… ce n’est que moi. C’est un peu épuisant.» A tel point qu’on ne sait plus très bien ce que veulent dire ces mots, «émergence» ou «jeune création» . Quels critères choisir : l’âge ? Le nombre de spectacle déjà mis sur pied ? On dit de plus en plus souvent que ce qui fait l’émergence, c’est avant tout la précarité. Le mois dernier, lors d’une table ronde consacrée au sujet aux Assises de la mise en scène tenues à Poitiers, Baptiste Amann, metteur en scène très «émergé», lui, puisque son spectacle Lieux communs jouait cet été dans le In du festival d’Avignon, disait toute sa prudence face à ce mot «apparu il y a dix ou quinze ans» : «Le terme émergence est utilisé pour des dispositifs “vitrine”, concurrentiels : c’est quoi le nouveau gagnant du festival Impatience ? Il y a un effet de consommation, comme si l’émergence c’était la nouveauté, la fraîcheur, là où s’inventent les nouveaux génies… Pour moi c’est plutôt ce moment de bascule où petit à petit tu comprends ce que c’est ce métier. Le passage d’une nécessité évanescente à la mise en place matérielle de ce qu’on a dans la tête : est-ce que tu t’intéresses aussi à la technique et à l’administratif ? Est-ce que tu te couches et te lèves avec ton projet en tête ? Est-ce que tu es prêt à faire ta vie avec ça ?» «Impatience», du 10 au 19 décembre au Centquatre Paris, au Théâtre 13, au Jeune Théâtre National, au Théâtre Louis-Aragon à Tremblay-en-France, aux Plateaux Sauvages et au Théâtre de Suresnes Jean-Vilar, avec Télérama. «Festival NTA 2024», du 27 novembre au 20 décembre au Nouveau Théâtre de l’Atalante, 75018. Sonya Faure / Libération Légende photo : Le collectif Marthe, dont le spectacle «Rembobiner» est un succès, fait partie des lauréats de Prémisses. (Theatre du Point du Jour/Marthe Prod)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 19, 2023 4:26 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 19 déc. 2023 Trois spectacles belges, « En une nuit », fine évocation de Pasolini, « Abri », réjouissant OVNI apocalyptique, et « La Fracture », émouvante autofiction de Yasmine Yahiatène, ont été couronnés au Festival du théâtre émergent 2023. Revue de détails. La Belgique triomphe au Festival du jeune théâtre émergent Impatience. Trois jeunes compagnies d'outre-Quiévrain ont été distinguées lundi 18 décembre à l'issue de cette édition 2023. Le quatuor formé par Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer a reçu le Prix du jury et le Prix du public pour « En une nuit - Notes pour un spectacle ». Le comité des fêtes/Silvio Palomo a remporté le Prix SACD pour « Abri ou les Casanier.es de l'apocalypse ». Yasmine Yahiatène a pour sa part été distinguée par les lycéens pour « La Fracture ». Parmi les neuf propositions montrées au 104 Paris - partenaire historique de l'évènement avec Télérama -, au Théâtre Louis Aragon à Tremblay, au Théâtre 13, aux Plateaux Sauvages et au Jeune Théâtre National, ces trois spectacles se sont facilement imposés. Le jury professionnel (composé également de journalistes, dont nous-même) était présidé cette année par l'administrateur de la Comédie-Française, Eric Ruf, fidèle compagnon de route d'Impatience. La grande parade « En une nuit » est une jolie variation sur la mort de Pasolini. Mort d'un poète qui dérange, mort d'un monde gangrené par la société de consommation, mais pas la mort de l'espérance tant que le théâtre saura ranimer la flamme rebelle. Sur la scène, mi-plage, mi-terrain vague, une silhouette couchée (chaque acteur à tour de rôle) évoque la fin tragique de Pier Paolo en novembre 1975. S'inspirant de la méthode des « notes » de l'écrivain-cinéaste, le collectif propose l'esquisse d'un spectacle composé de saynètes ardentes et contrastées, tour à tour drôles ou poignantes. Témoignages des proches, vraies fausses interviews, vraie fausse enquête policière, surprises poétiques, jusqu'à cette réjouissante parade des films en forme de revue flamboyante : les quatre comédiens surdoués nous projettent avec intelligence et justesse dans le chaos des questionnements d'aujourd'hui. Avec Pasolini pour guide. Deux prix bien mérités donc ! Six personnages en quête de hauteur « Abri » est un drôle d'ovni, mystérieusement sous-titré « Les Casanier.es de L'Apocalypse ». Si c'est de survivants qu'il s'agit, les six héros de la pièce ont l'air quelque peu déphasés, voire aphasiques. Six personnages en quête de hauteur… et de sens. Sortant d'une petite cabane en bois plantée dans un décor du même matériau aux allures de boîte géante, ils font assaut de bienveillance, échangent des banalités, applaudissent des lieux communs, comme pour singer un hypothétique « vivre ensemble ». Puis ils se lancent dans des projets absurdes, en mode pilotage automatique : ils emboîtent de grands panneaux pour former un horizon de montagnes, se déguisent en rochers… Alors que le langage patine et s'étiole, l'environnement se fait plus fantastique et menaçant. Jeux de lumière, de fumée, maison qui lévite… Plastiquement, ce spectacle - modèle de « non sense » - est une pure merveille. Un beau prix de la SACD… Prime à l'émotion Les quinze lycéens, venus de plusieurs établissements d'Ile-de-France, ont été conquis par l'émotion et la radicalité de «La Fracture ». Seule en scène, traçant à la craie un terrain de foot sur le plateau puis manipulant avec dextérité des images souvenirs et une caméra vidéo, Yasmine Yahiatène évoque la tragédie d'un père kabyle détruit par l'alcoolisme. Ce père né dans la même région que la famille de Zinedine Zidane, apparemment bien intégré en Europe, est lesté par le poids de son départ forcé d'Algérie et celui des exactions de l'armée française à l'égard de sa famille. Evitant les pièges d'une autofiction compassée ou d'un spectacle-tract, l'artiste plasticienne délivre son auto fable aussi intime que politique par fragments, en composant des images et des gestes flash qui vont droit au coeur et à l'âme. Recevoir le prix des lycéens, celui de la jeunesse, l'a visiblement bouleversée. Dès le 1er janvier, de jeunes compagnies pourront poser leur candidature pour l'édition 2024 d'Impatience (ouverte pour la première fois à la Suisse). En 2023, elles ont été près de 250 à postuler. L'émergence se bouscule au portillon. Le (jeune) théâtre a visiblement de beaux jours devant lui. Philippe Chevilley Le Festival Impatience 2023 s'est tenu du 8 au 18 décembre à Paris. Dossiers de candidature 2024 à déposer à partir du 1e janvier 2024 www.festivalimpatience.fr Légende photo : « En une nuit », spectacle furieusement pasolinien, prix du jury professionnel et du public. (© Annah Schaeffer)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2023 12:02 PM
|
Communiqué de presse du ministère de la Culture - 18.12.2023
Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, en plein accord avec Joël Bruneau, maire de Caen, Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville-Saint-Clair, Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados et Hervé Morin, président du conseil régional de Normandie, a donné son agrément à la nomination d’Aurore Fattier à la direction de la Comédie de Caen, Centre dramatique national de Normandie. Formée à l’Institut national supérieur des arts du spectacle de Bruxelles avant de fonder sa compagnie Solarium, Aurore Fattier poursuit depuis plusieurs années un travail artistique sur de grands formats de spectacles en collaboration avec d’illustres maisons de théâtre européennes comme le Théâtre de Liège, le Grand Théâtre de la ville de Luxembourg, le KVS-Koninklijke Vlaamse Schouwburg, le Théâtre national Wallonie-Bruxelles ou le Teatre nacional de Catalunya. Aurore Fattier porte un projet fédérateur et résolument transdisciplinaire pour la Comédie de Caen. Accompagnée d’une équipe d’artistes complices et notamment de quatre metteurs en scène, Julien Gosselin, Julie Duclos, Céline Ohrel et Claude Schmitz, elle souhaite transmettre les grands textes classiques et contemporains au plus large public possible. Elle entend réaffirmer la dimension européenne du théâtre et en faire un lieu vivant, ouvert et généreux. Aurore Fattier prendra ses fonctions le 1er janvier 2024, succédant ainsi à Marcial Di Fonzo Bo, nommé en juillet au Centre dramatique national d’Angers. Rima Abdul Malak salue l’action de celui-ci à la tête de la Comédie de Caen, dont il a fait un établissement de référence pour les écritures contemporaines et l’accompagnement des jeunes artistes.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 17, 2023 9:06 AM
|
Critique de Marie Plantin dans Sceneweb - 15 sept. 2023 Bertrand de Roffignac fait jouer son imagination dense, noire et délirante dans un spectacle dont il est tout à la fois l’auteur, le metteur en scène et l’un des interprètes. Une dystopie sombre et amorale qui pèche par saturation et excès mais déploie des images pénétrantes que l’on n’est pas près d’oublier. C’est sous chapiteau que se joue cette épopée cinématographique, cauchemardesque et mégalo, sortie de l’imagination éruptive et transgressive de Bertrand de Roffignac, comédien remarquable et remarqué, dont le rôle d’Arlequin – personnage principal de Ma Jeunesse Exaltée d’Olivier Py, lui a valu le Prix de la Révélation Théâtrale du Syndicat de la Critique cette année. Avec le Théâtre de la Suspension, la compagnie qu’il a créée il y a quelques années, le jeune homme n’en est pas à son coup d’essai et cette dernière création est en réalité le deuxième volet (qui fonctionne en autonomie et peut tout à fait se voir séparément) d’une trilogie plus vaste amorcée avec Les Sept Colis sans Destination de Nestor Crévelong, repris en décembre au Cent-Quatre dans le cadre du Festival Impatience. Le Grand Œuvre de René Obscur, dans la lignée des précédents, arbore un titre à rallonge, énigmatique, annonciateur de fiction pure et partant, attirant. La distribution est jeune, nombreuse, éclectique, elle varie les plaisirs des disciplines réunies, théâtre, danse et cirque, et ancre le spectacle dans un foisonnement de rôles et de scènes portés par une énergie sans faille. Mais si le spectacle, dont l’esthétique est le point fort, en met plein la vue et les oreilles, il peine malheureusement à faire sens et nous rallier à sa cause. Certes, l’intrigue cultive le mystère, les zones d’ombre et les flous éthiques à propos de son (anti) héros ambigu, artiste visionnaire ou mythomane invétéré, véritable révolutionnaire ou opportuniste corrompu, et cela crée d’emblée un appel fictionnel, l’envie d’en savoir plus et de lever le voile sur la vie de cet homme trouble et troublant, ce démiurge transgressif et tyrannique au cœur brisé. Mais la langue mise en jeu, si elle a ses qualités, ses fulgurances même, un élan qui entraîne, des formulations qui font mouche, nourrie, on le sent, d’une envie d’en découdre avec la loi, la morale, la bien-pensance, nous perd à force de tirades boursouflées. A vouloir trop en dire, le sujet est noyé dans une complexité qui sonne faux. Le niveau sonore n’y est pas pour rien. Musique live électrique en surdose, jeu outrancier et criard, dur de tenir le rythme de cette proposition qui a pourtant le mérite immense de l’originalité et de l’ambition forcenée. Car les images offertes sont renversantes, l’univers déployé puise dans le cinéma fantastique son esthétique dystopique (on pense au Caro et Jeunet de La Cité des enfants perdus), l’histoire semble sortie de nulle part ou d’un cerveau en surchauffe de créativité. Il y a quelque chose de profondément déroutant dans cette représentation sous chapiteau qui ose inventer une forme de science-fiction spectaculaire, un bain névrotique et atmosphérique orchestré par un fou sans foi ni peur, ogre s’abreuvant à la chair fraîche de la jeunesse pour peupler ses films érotico-futuristes d’une faune à sa merci qui y laisse sa vie. Les métaphores sont nombreuses et renvoient à notre société malade aussi, les passerelles entre pornographie et politique se traversent allègrement, la pièce s’engouffre dans des élucubrations sur l’art, le désir, l’argent, qui nous interpellent ou nous laissent froids, certaines scènes comiques sortent du lot, le glissement qui s’opère du cinéma contestataire au produit de propagande est intéressant. Beaucoup de pistes sont lancées, beaucoup d’idées, il y a là une tentative très ambitieuse qui mérite d’être saluée mais le jeu, aussi extrême soit-il, gagnerait à être nuancé, et les chorégraphies, au demeurant très bien exécutées, manquent d’incarnation paradoxalement. Quelques moments suspendus, où le cirque s’invite dans le décor notamment, viennent à point nommé exercer leur pouvoir de fascination. Fascination que l’on aurait aimé garder tout du long du spectacle dont le début mystérieux happe et électrise mais qui s’étiole sur la longueur pour se muer en malaise. On retiendra néanmoins, outre quelques tableaux scéniques organiques et enfumés de toute beauté, l’image hallucinante du réalisateur dans les airs, caméra en main, filmant frénétiquement sa projection fantasmatique. Marie Plantin – Sceneweb.fr Le Grand Œuvre de René Obscur
Conception, texte et mise en scène : Bertrand de Roffignac
Scénographie : Henri-Maria Leutner – Assistanat scénographie : Benjamin Marre
Création et Régie Lumière : Grégoire de Lafond / Thomas Cany
Création Sonore : Axel Chemla
Création masques et accessoires : David Ferré
Régie Générale : Charlotte Moussié / Clément Balcon – Régie Son : Martial de Roffignac
/ Antoine Blanc – Administration : Dany Krivokuca
Interprètes : Adriana Breviglieri, Axel Chemla, Bertrand de Roffignac, Gall Gaspard, Marion Gautier, Xavier Guelfi, Loup Marcault-Derouard, François Michonneau, Pierre Pleven, Erwan Tarlet, Baptiste Thiébault
Le Grand Œuvre de René Obscur est la deuxième pièce d’une trilogie initiée avec Les Sept Colis sans
Destination de Nestor Crévelong (créé au Théâtre de Vanves en janvier 2023 et repris au CentquatreParis, dans le cadre du Festival Impatience en décembre 2023)
Soutiens : Cirque Électrique, Théâtre du Châtelet, Jeune Théâtre National.
Coproduction du théâtre de l’Arsenal scène conventionnée d’intérêt national « art et création pour la danse » de
Le Grand Œuvre de René Obscur Nouvelle création du Théâtre de la Suspension Cirque électrique
du 12 au 24 septembre 2023
Place du Maquis de Vercors, 75020 Paris, métro Porte des Lilas

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 4, 2021 5:21 AM
|
Par Gérald Rossi dans L'Humanité - Mardi 4 Mai 2021
Légende photo : Les artistes compagnons et compagnonnes du TnBA. © Pierre Planchenault
Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où l’école d’art dramatique n’a pas cessé de fonctionner, ni les auteurs, comédiens, techniciens de répéter, se déroulera les 6 et 7 mai la première édition du festival Focus. Entretien avec Catherine Marnas, directrice du TnBA.
Au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, où l’école d’art dramatique n’a pas cessé de fonctionner, ni les auteurs, comédiens, techniciens de répéter, se déroulera les 6 et 7 mai la première édition du festival Focus. Entretien avec Catherine Marnas, directrice du TnBA. Le TnBA n’ouvrira pas ses portes au public avant plusieurs semaines, mais l’activité des apprentis comédiens ne s’est pas interrompue dans les salles de ce théâtre national à Bordeaux. De nombreux professionnels s’y sont aussi retrouvés afin de lancer des créations, de poursuivre des répétitions. Sa directrice, Catherine Marnas, s’explique sur cette activité foisonnante comme sur l’urgence d’une réouverture, pour les acteurs, auteurs, techniciens, comme pour le public. Rencontre. Le TnBA, comme tous les théâtres, n’accueille pas encore à nouveau le public, mais que se passe-t-il derrière les portes closes de cette belle bâtisse de la place Pierre-Renaudel ? CATHERINE MARNAS Le lieu est forcément fermé au public, mais nous n’avons cessé d’accueillir des équipes pour des répétitions, et surtout notre école de théâtre, avec ses 14 élèves, n’a pas cessé ses activités. C’est un jeune cœur de troupe que l’on entend battre au quotidien et c’est réconfortant. Entre des demandes de remboursement de spectacles annulés et la tentative d’élaboration d’une programmation sans cesse remise sur le chantier, quelle chance, pour nous, que de pouvoir entendre des bribes de Shakespeare, de Claudel… Une partie des cours est dispensée à distance, mais les autres se font sur place, dans le respect des règles sanitaires, avec des tests réguliers, etc. Vous parlez d’accueil d’équipes… CATHERINE MARNAS Je pense par exemple à la compagnie de Raphaëlle Boitel, qui s’est retrouvée dans l’impossibilité de continuer à travailler à l’Opéra de Bordeaux, et qui risquait de perdre les sommes engagées pour le filmage de son spectacle, qui s’est finalement déroulé au TnBA. Le TnBA est-il solidaire des actions revendicatives ? CATHERINE MARNAS La banderole accrochée sur la façade en témoigne. Le soutien à la lutte est clair. Tout comme l’engagement des jeunes de notre école, très motivés pour dénoncer le projet gouvernemental de réforme de l’assurance-chômage. Ils ont passé des heures et des jours à convaincre d’autres jeunes, des danseurs, à la fac, au conservatoire, à l’école de cirque, etc. À l’approche de l’été, de la période des festivals, comment vivez-vous cette situation inédite ? CATHERINE MARNAS Je suis très vigilante pour le respect des consignes sanitaires, des gestes barrières, du télétravail pour le maximum de personnes, mais vraiment il est temps que l’on en sorte. Les équipes veulent revenir au travail, se rencontrer réellement. C’est bien la preuve que les technologies, aussi performantes soient-elles, ne remplacent pas les échanges humains, la proximité, le contact d’une main… Nous avons décidé de donner leur chance au plus grand nombre de spectacles, en restant ouverts jusqu’à la fin du mois de juillet. Comment imaginez-vous la reprise ? CATHERINE MARNAS C’est en vérité encore difficile à imaginer concrètement. Certains spectacles en sont à leur quatrième report. D’ailleurs, nous n’avons pas encore édité une nouvelle plaquette de programmation. On ne veut pas gâcher du papier comme du travail. Une certitude : nous avons décidé de donner leur chance au plus grand nombre de spectacles, en restant exceptionnellement ouverts jusqu’à la fin du mois de juillet, comme en tentant de transformer des pièces initialement pensées pour être jouées dans des salles en spectacles de rue. N’oublions pas que notre mission est notamment d’attirer un public autre que celui qui se sent directement concerné par le spectacle vivant. Mais vous n’envisagez pas de raccourcir la durée d’exploitation des spectacles pour en accueillir davantage ? CATHERINE MARNAS Non. On essaie seulement de pousser un peu les murs. D’autant que nous serons sans doute contraints à une limitation du nombre de spectateurs par représentation, distanciation oblige. N’oublions pas que notre mission est notamment d’attirer un public autre que celui qui se sent directement concerné par le spectacle vivant. Nous n’avons pas le droit moral de nous couper d’une partie de nos spectateurs. Et pour cela il faut du temps et de l’espace d’accueil. Il y a une autre inconnue : est-ce que tous ces gens vont revenir immédiatement ? Est-ce que cette vie de repli sur soi qui nous est imposée depuis des mois ne va pas trop laisser de traces ? En attendant, pourquoi avez-vous décidé de lancer Focus, festival de la ruche, qui se déroulera les 6 et 7 mai, un festival sans public ? CATHERINE MARNAS C’est un projet relativement ancien, et nous avons décidé de le maintenir en dépit du contexte. Parce qu’il est conforme au désir de transmission, au mien comme à celui de beaucoup de « compagnons et compagnonnes » qui travaillent ici. Je parle des artistes associés au TnBA, qui sont comédiens, metteurs en scène, auteurs, techniciens, musiciens… L’idée de départ était de montrer au public tout un pan du travail habituellement invisible. Lorsque l’on organise des répétitions publiques, on sait le plaisir de ceux qui découvrent la face cachée de la création théâtrale. Alors nous nous sommes dit : arrêtons le travail à un moment « T » pour le montrer en construction. Sauf que seuls quelques professionnels pourront y assister. Mais poursuivre le projet nous est vite apparu indispensable pour nous-mêmes. Et pourquoi « la ruche » ? CATHERINE MARNAS Nous avons gardé le mot « festival », parce que ces deux journées seront à l’opposé des spectacles congelés que l’on aurait fabriqués chacun dans son coin et, par ailleurs, j’ai souvent parlé du TnBA comme d’une ruche vibrante de la rumeur créative des artistes en répétition, en laboratoire, en recherche… C’est toujours vrai. Et ce n’est pas près de finir. Quelle en est l’affiche ? CATHERINE MARNAS Il y aura une dizaine de spectacles, certains très avancés, d’autres à peine ébauchés. Ce sera l’occasion de découvrir les aventures proposées par Baptiste Amann, Jerémy Barbier d’Hiver, Julien Duval, Monique Garcia, Aurélie Van Den Daele, qui travaille sur son prochain spectacle, Soldat inconnu, et qui propose là une première forme, Spectacle inconnu, Yacine Sif El Islam, les Rejetons de la reine, le collectif OS’O et sa petite forme pour le jeune public, pour ne citer qu’eux, sans oublier une table ronde sur le thème : « Pour une éthique de la relation entre artistes et lieux culturels ». Ce sera l’occasion de retrouver quelques anciens élèves de notre école, et d’autres partenaires, qui ont trouvé là un abri, un lieu de partage, de croisements de leurs expériences et cela me semble particulièrement sensible de le dire dans la période trouble que nous traversons tous. Vous présenterez aussi l’ébauche de votre prochaine création… CATHERINE MARNAS Ce sera une première approche, une lecture avec Yuming Hey d’un texte écrit par Herculine Barbin, née en 1838 dans un corps de garçon mais déclarée comme fille. Herculine s’est suicidée à 28 ans. Et ce texte est comme une bouteille à la mer pour parler du genre aujourd’hui. C’est le témoignage d’une personne que l’on disait à l’époque hermaphrodite et dont le témoignage douloureux avait été sauvegardé par le médecin qui a procédé à son autopsie ; texte retrouvé des années plus tard par Michel Foucault lors de ses recherches pour écrire son Histoire de la sexualité. Je devais d’abord m’attaquer au Rouge et le Noir de Stendhal, cet hiver, mais l’ambiance Covid ne m’a pas donné l’énergie nécessaire pour gravir cette montagne… Ce sera une future création. Entretien réalisé par Gérald Rossi

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 13, 2019 9:45 AM
|
Par Marin de Viry dans Le Figaro - 5 septembre 2019
CHRONIQUE - Georgia Azoulay parvient à glisser une touche de comique dans le texte grave de Virginia Woolf.
Le célébrissime Les Vagues, de Virginia Woolf, ni roman, ni poème, mais «playpoem» selon l’auteur lui-même, rassemble trois hommes et trois femmes autour d’un personnage mort. Ce texte splendide est au fond une réflexion poétique sur la dignité, ce centre de la personne attaqué de toutes parts, en vagues successives et incessantes, par la mort, et qui se défend comme il peut. Georgia Azoulay, au Théâtre de Belleville, propose une nouvelle facette de l’œuvre. Elle l’actualise en y incorporant, si l’on peut dire, plus de social contemporain.
Les personnages cherchent leur centre, leurs limites, leur caractère, quelque chose d’un peu stable qui pourrait les définir à leurs propres yeux. Ils sont constamment tentés d’abandonner leur quête de singularité, de se dissoudre, de se distraire, de basculer dans la folie. Individuellement et collectivement, il s’agit de gagner un combat perdu d’avance contre la mort. Cela ne rend ni le texte de Woolf ni la pièce tristes, mais les oblige à mélanger la drôlerie de la bataille et l’angoisse de la défaite annoncée dans la trame de nos vies.
Georgia Azoulay a une lecture très précise de l’œuvre de Woolf. Une lecture en trois tiers. Un tiers philosophique: la lutte de l’être contre son indifférenciation. Il veut persister, se définir, se situer, développer un caractère, rencontrer son âme. Et enfin, trouver une posture pour faire face à l’éternité, représentée par cet océan hostile dont la surface de vagues érode l’âme.
Quête chaotique du solide
Un tiers sociologique: la «société liquide» de Zygmunt Bauman fait son entrée dans la lecture du texte de Woolf. Le but de la société contemporaine, pour Bauman: tout rendre liquide, y compris l’identité. Tout noyer dans l’échange en «cash», y compris l’irréductible, l’intime. L’horizon de la fin de l’originalité, le «tous pareils» létal, sinistre, se déploie comme une menace à l’horizon, tout au long du spectacle. Paradoxalement, le néant futur de la société exerce une pression énorme sur le psychisme des personnages. La fatigue du vide, le travail de sape de la nuit donnent sa feuille de route à l’éclairagiste.
Georgia Azoulay tire des scènes comiques, bien servies par des acteurs doués, jeunes et fringants
Un tiers poétique et burlesque: la fragilité de la perception est au cœur de l’expérience des personnages. On ne sait plus quelle était la couleur des lèvres de l’ami disparu, ses propres enfants sont interchangeables avec d’autres enfants futurs, on débine la robe de son amie pour oublier qu’on n’a jamais su soi-même comment s’habiller.
De cette quête chaotique du solide, de l’aspérité, du détail qui reste, du quant-à-soi durable, Georgia Azoulay tire des scènes comiques, bien servies par des acteurs doués, jeunes et fringants, qui sont chacun très psychologiquement typés, comme dans le texte de Woolf. Thomas Ducasse (Bernard), apathique et enténébré, est tout en silence souffrant et en défaite secrète ; Alexandra d’Hérouville (Rhoda), fine mouche pleine de ressentiments, incarne la malignité et son langage naturel, la vacherie. Théophile Charenat (Louis) est parfait en conformiste raté. Marie Guignard (Suzanne) joue très bien une dépressive profonde en permanence à la limite du passage à l’acte. Pénélope Levy (Néville), exaltée et incohérente, fait la mouche qui tape contre la vitre, ou un soprano qui se rate en haut de la portée. Enfin, Laura Mélinand, en peste joueuse, indifférente, discrètement mais férocement matérialiste, est excellente. Quand cette troupe se rassemble pour les scènes collectives, l’interaction délirante entre les personnages marche à plein.
Au total, ce spectacle est-il recommandable? Oui, à la condition que vous soyez un brin cérébral, que vous ne vous fâchiez pas aux quelques clins d’œil un peu appuyés aux effets scéniques contemporains qui font de-ci, de-là, un peu de bruit et de longueur - petites coquetteries cryptiques dont on pourrait faire l’économie - et que la postérité du texte sublime de Woolf vous intéresse.
Les Vagues , durée: 1 h 20, jusqu’au 27 septembre au Théâtre de Belleville, Paris (XIe). Tél.: 01 48 06 72 34.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 27, 2019 5:52 AM
|
SÉLECTION par le Service culture du Monde 27 juillet 2019
Dans le « in » comme dans le « off », les journalistes du « Monde » qui ont couvert la 73e édition du festival ont sélectionné des œuvres marquantes, à découvrir partout en France en 2019 et 2020.
Parmi l’incroyable diversité des propositions du Festival d’Avignon, dans le « in » comme dans le « off », côté danse ou côté théâtre, nos journalistes ont fait une sélection de spectacles qu’elles ont le plus aimés et qui sont programmés à travers toute la France dans des tournées en 2019 et 2020.
« Le Syndrome du banc de touche »
de et par Léa Girardet
Léa Girardet dans la pièce « Le Syndrome du banc de touche ». PAULINE LE GOFF
Comment résister quand on ne réussit pas dans le métier qu’on a choisi ? Léa Girardet en sait quelque chose : elle a connu l’humiliation de s’entendre dire, par les agents artistiques ou Pôle emploi, qu’elle était une comédienne « moyenne », et qu’elle devait peut-être envisager une reconversion. Elle aurait pu s’effondrer, elle a tenu, en pensant à l’entraîneur de football Aimé Jacquet, qui, lui aussi, s’est fait humilier avant de mener l’équipe de France à la victoire, lors du Mondial 1998. Et ce sont ces deux histoires parallèles qu’elle raconte dans Le Syndrome du banc de touche.
Seule en scène, drôle, énergique et émouvante, Léa Girardet prouve que, oui, tout espoir n’est jamais perdu. Le message a rempli d’enthousiasme la salle du Théâtre du Train bleu, dans le « off » d’Avignon, où le spectacle a été joué, et Léa Girardet le fera entendre dans plus de 25 villes françaises à partir de la rentrée. Brigitte Salino
Laval, le 18 septembre. Brest, du 15 au 19 octobre. Beauvais, du 4 au 9 novembre. San Francisco (Californie), du 17 au 23 novembre. Saint-Quentin (Aisne), du 19 et 20 décembre. www.scene2-productions.fr
« Phèdre ! »
de François Gremaud
Romain Daroles interprète le texte de François Gremaud, qui est lui-même une réinterprétation de la pièce de Jean Racine. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
Oui, c’est bien Phèdre, celle de Racine. Mais telle que vous ne l’avez jamais entendue. Si elle s’appelle Phèdre ! avec un point d’exclamation, qui autrefois était appelé « point d’admiration », c’est parce qu’elle est vue par le Suisse François Gremaud. Cet as du théâtre décalé imagine un conférencier fou d’amour pour la tragédie, qui vient faire partager sa passion au public. Il est tellement pris par son sujet qu’il en oublie les règles de l’art : il use de jeux de mots à la noix de coco et de citations de refrains de chansons populaires (« Colchique dans les prés, c’est la fin de Médée », « Alexandrin, Alexandrie, Alexandra »), et affiche une fausse naïveté à la Bourvil.
Dans ce rôle, le comédien Romain Daroles fait merveille : les rires fusent dans la salle, mais cela n’empêche pas sa Phèdre ! d’offrir une connaissance magnifique de Phèdre à tous, et à tous les âges. Un régal, à voir en France et en Suisse en 2019-2020. B. Sa
Lire aussi
Festival d’Avignon : « Phèdre ! », avec un point d’admiration
Montbéliard (Doubs), du 20 au 23 novembre. Cognac (Charente,) les 26 et 27 novembre. Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), du 3 au 6 décembre. Vevey (Suisse), du 9 au 13 décembre. www.2bcompany.ch
« Le Fantôme d’Aziyadé »
de Florient Azoulay et Xavier Gallais, d’après Pierre Loti
C’était au temps où, en 1877, Pierre Loti, jeune officier de marine, rencontrait Aziyadé à Istanbul. Le Bosphore ressemblait de jour à un Canaletto, des lanternes fouillaient nuitamment les rues étroites, des lueurs trouaient le ciel des soirs de ramadan, des regards interdits s’échangeaient… Un grand amour était né. Puis Pierre Loti, appelé par son service, dut quitter Istanbul, où il revint, dix ans plus tard, pour retrouver Aziyadé. En vain…
Les deux livres qui racontent cette histoire, Aziyadé et Fantôme d’Orient, ont été réunis en un seul, Le Fantôme d’Aziyadé, par Florient Azoulay et Xavier Gallais, qui joue seul. En ravivant la « mémoire endormie » de Pierre Loti et, avec elle, la nostalgie de la géographie d’une ville qui recouvre la peau d’un amour, le comédien fait entendre, de sa voix douce, le grain proche et lointain du souvenir. C’est magnifique. B. Sa
Lire aussi
Festival d’Avignon : Xavier Gallais donne voix au souvenir de Pierre Loti
Paris, Théâtre Lucernaire, du 12 janvier au 8 mars 2020.
« O agora que demora. Le Présent qui déborde. Notre Odyssée II »
d’après Homère, mise en scène Christiane Jatahy
Dans cette 73e édition du festival placée sous le signe des odyssées, la Brésilienne Christiane Jatahy a triomphé avec sa vision d’Homère. Ce n’est pas une pièce qu’elle a proposée, mais un spectacle d’agitprop communautaire : projeté sur un grand écran, un film, tourné au Liban, en Palestine, en Afrique du Sud et au Brésil, montrait des Ulysse d’aujourd’hui privés d’Ithaque – une terre et une maison où ils seraient chez eux – et des comédiens jouant des passages de l’Odyssée.
Pendant la projection de ce film, qui durait deux heures, les spectateurs étaient invités à participer, en dansant par exemple, ou en imitant le bruit de la pluie en tapant d’un doigt dans la paume de la main – ce qu’ils firent avec un plaisir fou. On peut s’interroger sur la portée de la démarche de Christiane Jatahy, mais on ne peut nier la force d’attraction de son spectacle, qui abolit les frontières de la scène pour parler des frontières de la terre. B. Sa
Lire aussi
Au Festival d’Avignon, Christiane Jatahy présente son odyssée intérieure
Paris, au Centquatre, du 1er au 17 novembre. Strasbourg, au Maillon, du 4 au 6 décembre. En tournée en France en 2020.
« Le Sublime Sabotage »
de et avec Yohann Métay
Yohann Métay s’est fait connaître avec La Tragédie du dossard 512, spectacle singulier dans lequel il racontait avec brio une épopée physique, celle de la folle course de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Après quelque 900 représentations, cet ancien professeur d’éducation physique formé à la ligue d’improvisation a rendu son maillot mais n’en a pas fini avec la scène. Sa nouvelle création, Le Sublime Sabotage, présentée au festival « off », constitue une belle surprise et confirme le talent de ce comédien.
Dans cette épopée comique de la création, Yohann Métay raconte sa quête éperdue du spectacle que tout le public attendrait, sa soif d’absolu, sa peur de rater. A chercher l’impossible, forcément il se perd. Mais l’échec pathétique se transforme en un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps qui passe. Sincère, inventif et bien écrit, ce « sublime sabotage » est d’une formidable liberté. Sandrine Blanchard
Paris, Théâtre Lucernaire, du 1er octobre au 18 décembre. Grenoble, du 3 au 5 octobre. Troyes, les 13 et 14 décembre.
« Féministe pour homme »
de et avec Noémie de Lattre
Noémie de Lattre est une féministe qui a l’art de parler aux hommes. Ecrit avant le coup de tonnerre de l’affaire Weinstein et le mouvement #metoo, son one-woman-show – qui a rencontré cet été à Avignon le même succès qu’à Paris – ne cherche pas à donner de leçon ou à opposer les sexes mais simplement, et efficacement, à expliquer le féminisme pour les nul(le)s, à ouvrir des pistes de réflexion sur la condition féminine.
Tour à tour enjouée ou tourmentée, cette comédienne pleine de charme alterne des séquences burlesques et d’autres d’émotion. C’est (très) drôle, intelligent et mis en scène avec précision. Dans une ambiance de cabaret, Noémie de Lattre se dévoile dans tous les sens du terme, assumant le croisement entre confession, manifeste et stand-up. S. Bl
Paris, à La Pépinière-Théâtre, à partir du 7 octobre, tous les dimanches à 19 heures et lundis à 20 heures.
« aaAhh Bibi »
avec Julien Cottereau, mise en scène Erwan Daouphars
Quel bonheur de retrouver Julien Cottereau dans une nouvelle création. Après Imagine-toi et Lune-air, ce clown-mime-bruiteur-acteur a choisi le « off » d’Avignon pour présenter aaAhh Bibi, nouvelle pépite de poésie, de nostalgie et de drôlerie qui ravira enfants et adultes. Dans cet hommage à son papy qui l’appelait Bibi, Julien Cottereau nous emmène dans une histoire de passation entre un vieux et un jeune clown, une aventure initiatique entre rêve et réalité où tous les éléments (le feu, l’eau, l’air…) et toutes les disciplines circassiennes (équilibrisme, acrobatie, jonglerie, etc.) sont réunis pour construire un univers idéal et sans frontière.
Bourré d’empathie et de bienveillance, cet artiste, longtemps membre du Cirque du soleil, a su garder un pied dans l’enfance, une imagination débordante et une incroyable énergie. Eternel rêveur, il fabrique un monde peuplé de rires et de tendresse qui dégage une humanité réconfortante. S. Bl
Lire aussi
Avignon : Julien Cottereau, en équilibre sur la corde de l’enfance
Paris, Théâtre Lucernaire, du 6 novembre 2019 au 12 janvier 2020.
« Le Champ des possibles »
de et avec Elise Noiraud
C’est le dernier volet de la trilogie intimiste d’Elise Noiraud, et le meilleur. Dans Le Champ des possibles, l’un des succès mérités du festival « off », cette comédienne livre une partition particulièrement aboutie sur les affres du passage à l’âge adulte. Son seule-en-scène, à la force émotionnelle et à la drôlerie irrésistibles, nous raconte une histoire d’émancipation a priori banale – les premiers pas d’une jeune provinciale débarquant à Paris – mais qui se transforme en comédie humaine universelle, où se mêlent névroses familiales, espoirs déçus, désirs enfouis et rencontres déterminantes.
Passant avec une aisance bluffante d’un personnage à l’autre, Elise Noiraud nous renvoie à nos propres souvenirs de jeunesse et nous force à nous interroger sur ce qui a fait de nous des adultes. Bien sûr, c’est le personnage de sa mère qui constitue le fil rouge du spectacle. De cette relation faite d’amour véritable et de non-dits redoutables, la comédienne tire des séquences d’une justesse et d’une sincérité bouleversantes. S. Bl
Festival d’Avignon : le bouleversant récit d’émancipation d’Elise Noiraud
A Billère (Pyrénées-Atlantiques), le 19 décembre, au théâtre de Lacaze. A Pont-Sainte-Maxence (Oise), le 31 janvier 2020, pour jouer l’intégrale de sa trilogie sur la scène de La Manekine.
« Outside »
de et par Kirill Serebrennikov
Assigné à résidence pendant presque deux ans, libéré en avril mais toujours sous le coup d’une interdiction de territoire, le metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov a signé le spectacle le plus fort de cette édition 2019. Un geste artistique d’une liberté souveraine, mêlant théâtre, danse, musique et photographie. L’artiste y interroge sa situation de dissident de manière intime et singulière, au regard de la destinée d’un autre irrécupérable : le photographe chinois Ren Hang, qui s’est suicidé en 2017, à la veille de ses trente ans. Fabienne Darge
Lire aussi
Festival d’Avignon : Kirill Serebrennikov s’évade en beauté
Tournée à venir lors de la saison 2020-2021
« Nous, l’Europe, banquet des peuples »
de Laurent Gaudé et Roland Auzet
Face à une Europe de Bruxelles désincarnée, face aux désenchantements qui collent aux basques d’une construction européenne toujours fragile, l’écrivain Laurent Gaudé et le metteur en scène et compositeur Roland Auzet opposent l’énergie jubilatoire d’un spectacle total. Le poème dramatique remonte le cours de l’histoire du continent jusqu’à l’invention de la locomotive à vapeur, tandis que la mise en scène chorale met à l’épreuve du plateau un peuple européen en miniature, celui que forment de formidables performeur(se)s et des amateurs de tous âges. F. Da
A Amiens, les 7 et 8 octobre. Tournée en 2020 avec de nombreuses dates.
« Final Cut »
de et par Myriam Saduis
Actrice, metteuse en scène et désormais auteure, Myriam Saduis raconte l’histoire d’une folie familiale. La sienne, ou plutôt celle de sa mère, prise dans les rets de la grande histoire. Ou comment cette mère, une Italienne de Tunisie, a pendant toute son enfance caché à sa fille l’existence de son père, parce qu’il était arabe. Partant du plus intime, Myriam Saduis tisse avec une constante justesse de ton un spectacle bouleversant sur la manière dont l’histoire, en l’occurrence celle de la colonisation, peut briser la raison des individus. F. Da
A Paris, Centre Wallonie-Bruxelles, les 9 et 10 octobre. Puis tournée en Belgique et en France sur la saison 2020-2021
« Pelléas et Mélisande »
de Maurice Maeterlinck, par Julie Duclos
De l’œuvre maîtresse du poète symboliste belge, écrite en 1892, la jeune metteuse en scène Julie Duclos livre une version qui tient en équilibre la poésie et le mystère, et un regard contemporain sur cette « tragédie du quotidien » qui met en jeu une jeunesse empêchée de vivre dans un monde trop vieux. Les clapotis de l’âme humaine s’y font entendre tout autant que les échos de notre monde de peurs et d’exils, en un geste de mise en scène où la vidéo, le son, la scénographie, la lumière jouent à part avec les – excellents – acteurs. F. Da
Lire aussi
« Pelléas et Mélisande » : une jeunesse empêchée dans un monde trop vieux
A Reims, du 16 au 18 octobre. A Rouen, les 14 et 15 novembre. A Lille, du 27 au 30 novembre. A Besançon, les 17 et 18 décembre. Tournée en France en 2020.
« Vies de papier »
par la compagnie La Bande passante
Un jour d’automne, Benoît Faivre et Tommy Laszlo, de la compagnie La Bande passante, dont la spécialité est le théâtre d’objets documentaires, sont tombés sur un étrange album photos, au marché aux puces des Marolles, à Bruxelles. En remontant le fil de l’histoire de la jeune Allemande qui en était au cœur, ils ont remonté celui de l’histoire européenne, telle qu’elle s’est nouée avec la seconde guerre mondiale, et celui de leurs propres histoires familiales. De toute cette matière, ils font un spectacle beau comme une vaste lanterne magique, un festival de papiers découpés aussi délicat que vertigineux. F. Da
Lire aussi :
« Vies de papier » : une vie dessinée grâce à un album photos
A Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), les 26 et 27 septembre. A La Courneuve (Seine-Saint-Denis), le 11 octobre. A Fécamp (Seine-Maritime), le 15 octobre. A Avranches (Manche), les 17 et 18 octobre. Aux Lilas (Seine-Saint-Denis), le 7 novembre. A Bruxelles, du 14 au 16 novembre. A Calais (Pas-de-Calais), du 28 au 30 novembre. A Commercy (Meuse), le 6 décembre. En tournée en 2020.
DANSE
« Outwitting the Devil »
d’Akram Khan
Il veut désormais raconter des histoires, parler des mythologies d’hier et d’aujourd’hui, s’engager pour dire le monde comme il va. Avec sa nouvelle pièce Outwitting the Devil, pour six interprètes, créée dans la Cour d’honneur du Palais des papes, le danseur et chorégraphe britannique d’origine bangladaise Akram Khan met en scène un récit apocalyptique autour du désastre écologique.
Il s’appuie sur un fragment, retrouvé en Irak en 2011, des douze tablettes de L’Epopée de Gilgamesh qui évoque la destruction de la forêt et de ses animaux par le jeune Gilgamesh. Le héros devenu vieux se souvient. Elliptique, cette fresque au rythme lent, sertie dans une scénographie calcinée, compte sur la danse guerrière et tourbillonnante, dessinée au muscle près des danseurs, pour raconter la violence des pulsions. Rosita Boisseau
Lire aussi
Festival d’Avignon : Akram Khan invoque les ombres de la Cour d’honneur
Paris, Théâtre de la Ville, du 11 au 20 septembre.
« Oskara »
de Marcos Morau
« Oskara », pièce pour cinq interprètes masculins chorégraphiée par Marcos Morau. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE
Avec Oskara, pièce pour cinq interprètes masculins chorégraphiée par Marcos Morau, la compagnie basque Kukai Dantza, fondée en 2001, réussit un très joli coup : tresser au plus fin la tradition basque avec le geste contemporain en distinguant superbement la beauté du folklore. Un homme en train de mourir remonte le temps en renouant à travers la danse avec ses racines, les figures anciennes du carnaval de son enfance. Il fait corps dans des rondes, des chaînes qui le relient à son patrimoine et à ses ancêtres.
Le répertoire chorégraphique somptueux atteste de la richesse complexe des traditions basques. Des chants a capella accompagnent la pièce, irriguant la traversée initiatique du personnage. Visuellement très élégant, Oskara est un merveilleux ambassadeur de la culture basque. R.Bu
Lire aussi
Festival d’Avignon : « Oskara », l’intrigant pas de deux entre traditions basques et danse contemporaine
Arcachon (Gironde), le 20 septembre. Ponferrada (Espagne), le 10 octobre.
« Multiple-s »
de Salia Sanou
Salia Sanou, 50 ans, invite trois artistes, la danseuse et chorégraphe Germaine Acogny, l’écrivaine Nancy Houston et le musicien-compositeur Babx, à partager le plateau avec lui dans Multiple-s. Pour chacun, il ouvre une parenthèse délicatement particulière. Dans les pas de « Maman Germaine », il se souvient de sa formation en tant que jeune interprète né au Burkina Faso. Face-à-face avec Nancy Huston, il s’interroge sur le nomadisme et l’identité, la langue et l’imaginaire. Côte à côte avec Babx, il s’immerge dans les textes d’Aimé Césaire et Gaston Miron tout en se laissant aller à un petit numéro copain-copain léger et burlesque.
Au passage, on retrouve la danse pulsante, ondulante et profondément enracinée de Salia Sanou qui s’était éloigné pendant sept ans des plateaux pour mettre en scène des pièces de groupe. Opus intimiste et doux, Multiple-s se savoure pour ce qu’il est : un moment heureux avec des amis. R. Bu
Lire aussi
Danse : tendre voyage identitaire pour Salia Sanou
A Floirac (Gironde), le 16 octobre. Puis en tournée en 2020 dans toute la France.
« Ordinary People »
de Wen Hui et Jana Svobodova
La chorégraphe chinoise Wen Hui et la metteuse en scène tchèque Jana Svobodova se sont bien rencontrées. Ensemble, elles ont conçu le spectacle Ordinary People, avec quatre complices chinois et cinq tchèques. Danseuse, musicien ou ouvrier-retraité, nés entre 1942 et 1988, ces interprètes se sont livrés au jeu des confidences entre souvenirs personnels et commentaires sociétaux, superposant leurs parcours et leurs vies dans deux pays aux histoires chahutées par le communisme.
Entre les places Tiananmen, à Pékin, et Venceslas, à Prague, les thèmes de la liberté, de la peur, de la censure circulent, auréolés pour chacun des témoignages, tous directs et simples, d’une couleur singulière. La musique rock jouée par tous les performeurs, les danses partagées des Chinois et des Tchèques font de cette pièce documentaire un réel moment d’échange. R. Bu
Lire aussi
Festival d’Avignon : la Chine et la République tchèque, si loin et si proches pour les « Ordinary People »
Paris, Théâtre des Abbesses, du 5 au 9 novembre.
« Näss »
de Fouad Boussouf
Näss (« les gens » en arabe), créé en 2018 par Fouad Boussouf, provoque une transe irrésistible à partir des chansons du groupe marocain des années 1970 Nass El Ghiwane mais aussi des atmosphères récoltées par le chorégraphe Roman Bestion, expert en musique nord-africaine, à Marrakech, à Salé (Maroc) et dans les rues de Tunis.
Entre hip-hop et inspirations traditionnelles marocaines, comme par exemple les rondes berbères ahidous, sept hommes décollent dans des envolées successives toujours plus ardentes. L’une des dernières images en dit long sur la tension du spectacle : les danseurs, au bord de l’épuisement, continuent de sauter sur place comme s’ils ne pouvaient plus s’arrêter. Avec cette pièce, actuellement en tournée dans le monde entier, Fouad Boussouf a inscrit le nom de sa compagnie Massala en haut de l’affiche. R. Bu
Lire aussi
Festival d’Avignon : avec « Näss », la danse passe de la transe à l’extase
Saint-Jean-de Védas (Hérault), le 22 octobre. Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône), le 15 novembre. Mulhouse (Haut-Rhin), les 20 et 21 novembre. Les Ulis (Essonne), le 22 novembre. Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), les 29 et 30 novembre. Tournée mondiale et dates françaises en 2020.
« Inging »
de Simon Tanguy
Simon Tanguy, passé par une formation de philosophie, de clown, de danse contemporaine, touille tous ses talents dans Inging, une performance surprenante sur la parole et le geste en direct. Pendant quarante-cinq minutes, il monologue sans s’arrêter, tout en se faufilant entre les spectateurs rassemblés autour de lui sur le plateau.
Léger et rapide, il enclenche une logorrhée réjouissante, jetant dans le bouillon de sa pensée des propos philosophiques, des commentaires quotidiens, des confidences personnelles… Inging reprend, façon Simon Tanguy, la performance créée en 2010 par la new-yorkaise Jeanine Durning. Le dispositif – un bureau, un ordi – est le même, mais le contenu évidemment différent est nouveau à chaque représentation. R. Bu
Lire aussi
Au Festival d’Avignon, Simon Tanguy danse sur le flot des mots
Inging, de et par Simon Tanguy
A Toulon, les 21 et 22 septembre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2019 6:11 PM
|
Par Anne Diatkine Envoyée spéciale à Avignon pour Libération
— 22 juillet 2019
Invitée dans le off du Festival d’Avignon, la jeune compagnie Nova explore la mémoire des acteurs du conflit avec une énergie et un talent incontestables.
Il arrive que les spectacles se fassent signe alors que tout les oppose dans leur choix esthétique, leur économie, et le type de théâtres dans lesquels ils se donnent. Tandis que le collectif allemand Rimini Protokoll se plonge dans la mémoire cubaine avec Granma, les trombones de La Havane (lire ci-contre) au même moment dans le off, la jeune metteuse en scène Margaux Eskenazi et la compagnie Nova font un tabac en explorant les traces de la guerre d’Algérie à travers, là aussi, la génération des grands-parents.
Torture
Acteurs, metteuse en scène : tous ont recueilli les témoignages de leurs aïeux et de leur entourage afin de construire une pièce kaléidoscopique qui restitue des parcours intimes parfois jamais dits. Sont portés sur le plateau aussi bien une extraordinaire réunion d’anciens combattants qui tourne au désastre (Eva Rami, formidable) que des militants du FLN ou le procès de Jérôme Lindon pour la publication de livres condamnant la torture. Ou encore le discours d’entrée à l’Académie française d’Assia Djebar en 2006 (topissime Loup Balthazar).
Qu’est-ce qui nous emporte dans ce mouvement, un brin didactique ? De toute évidence, ce sont les acteurs, jeunes, complètement investis, qui interprètent une multitude de rôles, hommes, femmes, Algériens, Français, à l’énergie et au talent parfaitement visibles.
Promesse
D’accord, l’absence de sonorisation les oblige à projeter leur voix, loin des conventions désormais habituelles pour le distingué public du in et du théâtre subventionné. Les acteurs jouent franc jeu, ils exposent dès leur entrée leur démarche documentaire et les rôles qu’ils interpréteront, mais on oublie vite la légère frayeur que peut susciter la clarification, tant la pièce tient sa promesse de faire advenir des bribes de mémoire, sans la figer. L’un des plus beaux moments advient lorsque Daniel, harki, raconte son arrivée en France avec ses parents dans le camp de Bias (Lot-et-Garonne), où ils resteront entassés dix ans.
La pièce est ambitieuse, elle embrasse tout, tous azimuts, on y croise tout autant Edouard Glissant que Zidane et Thuram, ou encore des anonymes. Et pourquoi pas ? Le titre, Et le cœur fume encore, est tiré d’un poème de Kateb Yacine, il sera dit par l’un des personnages, émigré algérien, au côté d’un harki. Ils ont grandi ensemble et se retrouvent à Mantes-la-Jolie (Yvelines) dans la même HLM, pacifiant malgré eux.
Anne Diatkine Envoyée spéciale à Avignon
Et le cœur fume encore d’Alice Carré et Margaux Eskenazi Gilgamesh Belleville, Avignon (84). Jusqu’au 26 juillet.
Légende photo : La pièce d'Alice Carré et Margaux Eskenazi est jouée dans le off d'Avignon. Photo Loïc Nys. Sileks

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 18, 2019 1:50 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 15 juillet 2019
Joie, conception, texte et jeu de Anna Bouguereau, mise en scène de Jean-Baptiste Tur.
On a tous, hélas et heureusement, des souvenirs d’enterrement de proches dont les fantômes – rappel mémoriel des disparus qui étaient alors encore bien vivants et éloignés de perspectives plus sombres, et qui hantent à jamais notre imaginaire.
Des images fiévreuses de conversations infinies, auréolées de silences paisibles. Un paysage de paix en effet, une sérénité existentielle où les conflits ne semblent pas avoir leur place, si ce n’est précisément le surgissement abrupt et absolu de la mort.
Aussi Anna Bouguereau, l’auteure interprète de Joie, a-t-elle voulu évoquer les états d’âme et les sentiments de ceux qui restent quand les êtres chers quittent la vie.
Une manière bien personnelle de combattre une société où la peur de la mort a remplacé le bonheur tangible et sensible d’exister. Pour la conceptrice du spectacle, combattre la mort, c’est déjà la regarder en face et puis apprendre à vivre après.
La faille viendrait de la teneur de nos sociétés industrialisées vidées de leur sens, de leurs rêves, de leurs croyances, de l’absence de vrais rites mortuaires consentis, au profit d’une fuite en avant perpétuelle sans se retourner sur son passé et sur soi.
Respecter la mort – qu’on en parle librement et non pas plus ou moins honteusement, sans la masquer – revient finalement à faire l’éloge de la vie.
Et paradoxalement, se sentir pleinement exister dans l’œil de la tempête des événements tragiques qui jalonnent la présence au monde de tous les êtres.
La locutrice assiste donc à l’enterrement de sa tante Catherine qu’elle aime toujours en nièce affectueuse, reconnaissant la belle capacité humaine de la disparue.
« Jean-Michel a fait un discours, Jean-Michel c’est le mari de ma tante Catherine, et c’était déchirant parce qu’il pleurait pas du tout. Il était digne. C’est nul comme mot mais c’est ça il était digne ça m’a donné envie d’être digne… Et il avait toujours un petit sourire intérieur derrière ses mots l’air de dire, oui c’est terrible mais non c’est pas triste, c’est beau je vous regarde vous êtes tous là vous êtes vivants. »
Celle qui s’exprime, un peu coincée au départ, comme bridée par la situation pathétique de la mise en terre, se laisse aller peu à peu à l’évocation des rêves enfouis qui l’habitent – le désir d’aimer et d’être aimée -, le souvenir, à l’écoute d’une chanson, du premier slow dansé avec un garçon qu’elle avait elle-même sollicité.
Son cousin pour lequel elle éprouve un attachement peu avouable la reconduit en voiture à la gare, et elle ne lui en dira jamais davantage, consciente de sa folie.
Or, au-delà d’un fort sentiment de solitude et d’isolement personnel, elle prend progressivement conscience de cette vie pleine qui l’envahit malgré elle avec joie.
Le metteur en scène Jean-Baptiste Tur installe la comédienne Anna Bouguereau sur un plateau envahi d’ombre nocturne que seule éclaire une longue table lumineuse de banquet à nappe blanche – réceptacle de multiples bouquets de fleurs colorées.
Métaphore de convivialité festive déjà vécue et à revivre encore, métaphore de l’emplacement terreux de la tombe au cimetière, de l’habitacle fermé de la voiture du cousin, et de son bureau d’écriture, où elle rédige une lettre au mari de la défunte.
La jeune femme éplorée lutte contre sa peine et sa tristesse intérieures, signifiant en échange, dans la proximité des spectateurs, les désirs qui l’assaillent et la font tenir debout, sourire aux lèvres dans ses adresses au public interpelé, radieuse de vie.
Véronique Hotte
Théâtre du Train Bleu, 40 rue Paul Sain à Avignon, Tél : 04 90 82 39 06, jusqu’au 24 juillet à 16h40.
Crédit photo : KarimC.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 30, 2017 6:57 PM
|
La Truite
CRÉATION
21 > 31 MARS
TEXTE BAPTISTE AMANN
MISE EN SCENE RÉMY BARCHÉ
Une histoire de famille où tout paraît extraordinairement banal, et merveilleux à la fois.
info : http://bit.ly/2jkacSe
résa : http://bit.ly/2j92ACA
-------------------------------------------------------------------
Toute la programmation : lacomediedereims.fr
-------------------------------------------------------------------
Vidéo réalisée par La Production rémoise / laproductionremoise.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 16, 2016 6:52 PM
|
Par Alicia Dorey dans Les 5 pièces
Disgrâce : "C'est à ça que servent les putes."
“ C’est à ça que servent les putes, à encaisser les extases des êtres disgracieux.
Universitaire de cinquante ans amateur de prostituées noires et d'étudiantes blanches, David Lurie n'est pas à proprement parler ce qu'on pourrait appeler un chic type. Accusé d'avoir été trop loin avec l'une des élèves de son cours de Littérature, il fuit Le Cap pour se réfugier chez sa fille Lucy, éleveuse de chiens lesbienne en pleine campagne sud-africaine. Une fois installé, la découverte d'une autre réalité encore plus cynique et plus brutale que celle qu'il pensait avoir quitté le prend à la gorge, et culmine le soir où trois hommes noirs s'en prennent à la ferme, violant sa fille et tuant les cabots. Anéanti face à l'indifférence générale et persuadé d'avoir été puni pour le crime commis quelques mois auparavant, il retourne se présenter devant les parents de son ancienne étudiante, se heurtant au refus catégorique de sa fille à quitter le pays.
Pour qui doit-on ressentir de la pitié ? Le vieux beau qui ne comprend plus ni son pays ni sa progéniture, tout perdu qu'il est depuis la fin de l'apartheid ? La population noire, revancharde mais finalement « dans son droit » ? Le roman de Coetzee prend un malin plaisir à brouiller les cartes, et l'adaptation qu'en fait Jean-Pierre Baro est plus qu'à la hauteur de l'exercice : d'un décor aseptisé d'appartement à une cahute en tôle au fond de la brousse, tous changent de couleurs, deviennent chiens, criminels, et désespérés.
Alicia Dorey
Au Th. national de la Colline jusqu'au 3 déc. Au Théâtre de Sartrouville du 7 au 9 déc.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 14, 2016 6:34 AM
|
Teaser
Une pièce de Koffi Kwahulé dans une mise en scène d'Alexandre Zeff avec Jean-Baptiste Anoumon et Thomas Durand.
Présenté au Théâtre national de la Colline les 10 et 11 juin dans le cadre du festival Impatience

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 21, 2016 4:05 PM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération
Chloé Dabert met en scène avec brio un thriller psychologique au pays du multiculturalisme, signé par l’auteur britannique Dennis Kelly.
«A quoi ça ressemble de vivre au quotidien dans un quartier dans lequel vous vous sentez, à chaque minute, physiquement menacé ? » interrogeait l’auteur britannique Dennis Kelly en parlant d’Orphelins, trépidant thriller méphistophélique enfermé dans le cocon d’un dîner de famille. Que deviennent nos grandes valeurs de tolérance quand notre clan est agressé ? Ce «petit frère» qui vient d’entrer sur scène le tee-shirt maculé de sang n’est-il qu’un psychopathe auteur d’un crime raciste ? N’est-il pas, lui aussi, comme l’affirme sa sœur, la victime collatérale d’une fracture sociale ultra violente qui abrase ce quartier multiethnique de la banlieue de Londres ? Et cette violence ne s’explique-t-elle que par le contexte économique et social pourri ? Dans ce cas, quid de la responsabilité individuelle ? Autrement dit : expliquer, est-ce excuser ?
Papillote
On ne vous épargnera pas la liste des résonances qu’entretient cette pièce portée pour la première fois à la scène en 2009 avec le paysage socio-politique actuel : montée du communautarisme, ressentiment de classe, assignation identitaire, déni, dépression des classes moyenne… A croire que Dennis Kelly a synthétisé pour nous, dans une heure trente chrono de théâtre, les grandes problématiques autour desquelles s’écharpent par tribunes interposées les figures médiatiques des sciences politiques et sociales, de Hugues Lagrange à Alain Badiou. A ceci près que le résultat n’a rien d’un essai pointu et tout d’un scénario de polar impeccablement ficelé (presque trop - ce sera notre seul bémol), avec suspense cuisiné aux petits oignons, arcs narratifs bien solides et dilemmes moraux hérités de l’antique Antigone. On n’en attendait pas moins de ce quadragénaire tout à la fois dramaturge en pleine reconnaissance internationale (plusieurs Awards) et coauteur des séries TV à succès Pulling (2006) et Utopia (2013).
Orphelins raconte l’irruption de la violence la plus crue dans le plus respectable des foyers. Attention spoiler : tout le talent est donc de nous faire admettre comment Dany, incarnation de la droiture d’esprit et de la réussite middle class, va finir par quitter son assiette de saumon papillote pour torturer un musulman innocent dans un garage. Et si les marchepieds de cette descente aux enfers scorsesienne sont habiles, c’est bien le style des dialogues qui nous maintient vissés à l’action - singularité qui permet à Orphelins de cumuler les traits du thriller psychologique et ceux de la comédie noire centrée sur la communication (ou plutôt l’échec de la communication), tendance Harold Pinter. Aucune gratuité à ce que les dialogues n’avancent que par phrases tronquées, syncopées, refoulées, jamais finies, par bugs permanents et mots contournés. «Je veux dire, est-ce que tu penses, est-ce que tu as pensé… ? -Non. Peut-être. je ne sais pas. Peut-être. Peut-être oui.» Car, pour Dany, pour Helen et pour Liam, comment nommer les problèmes sans crainte d’amalgamer, de stigmatiser, d’être pris au mot ?
Cocotte-minute
Ces personnages qui ne savent plus quoi penser, qui incriminer, semblent donc mériter une conversation poussée aux limites du compréhensible et de l’absurde. Et c’est toute la finesse de la metteure en scène Chloé Dabert et du trio d’acteurs réuni autour d’elle (les excellents Joséphine de Meaux, Julien Honoré et Sébastien Eveno), d’avoir su dégager le potentiel rythmique de ce texte, en se plaçant juste en deçà du naturalisme - condition pour faire de ce huis clos oppressant une cocotte-minute au bord de l’explosion.
Orphelins de Dennis Kelly m.s. Chloé Dabert. CentQuatre, 5, rue Curial, 75019. Jusqu’au 4 mai. Rens.: www.104.fr
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 2, 2024 7:05 AM
|
Par Kilian Orain dans Télérama - 31 janvier 2024 REPÉRÉ – Rien ne le prédestinait au théâtre. À 31 ans, il excelle pourtant dans l’exercice de la mise en scène, notamment en transposant “Par les villages”, de Peter Handke. Lire sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/theatre-spectacles/le-metteur-en-scene-sebastien-kheroufi-j-essaie-de-guerir-de-mon-histoire-7019098.php Actualité En juin dernier, il a présenté son adaptation d’Antigone, de Sophocle. Succès immédiat pour ce metteur en scène inconnu, repéré par Nasser Djemaï à sa sortie d’école. Le directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry (94) accueille, jusqu’au 11 février, Par les villages, le deuxième volet de son triptyque consacré à l’histoire de sa famille, transposé de l’ouvrage éponyme de Peter Handke. Ne lui parlez pas d’adaptation, « c’est une contextualisation dans les années 1990, dans les cités de banlieues ». Ascendants Il grandit à Meudon-la-Forêt (92) entre une mère élevant seule ses trois enfants et un père vivant dans un foyer Emmaüs parisien, à qui il rend visite chaque week-end — « Ma mère y tenait ». À 16 ans, il retrouve celui-ci mort dans sa chambre. « Là, je me dis que je ne veux pas finir ma vie dans un foyer. » Après un BEP mécanique, il enchaîne les petits boulots avant de s’installer à Londres, à 24 ans. « Tout le monde autour de moi était en prison, il fallait que je parte. » Homme de ménage dans un cinéma, il apprend l’anglais en lisant les sous-titres des films pour malentendants, et découvre un cinéma d’auteur. « Cette poésie m’a touché tout de suite. » Signes particuliers De retour en France, il s’inscrit au conservatoire de Meudon-la-Forêt, découvre la puissance des mots, et réussit le concours de l’École supérieure d’art dramatique de Paris (Esad). « Je fais ma rentrée en 2018, j’ai 26 ans, et là, je prends une claque. Je me sens humilié parce que je n’ai pas la bonne culture. » Mais il travaille avec acharnement et saisit toutes les opportunités. « Je n’ai jamais rien eu dans ma vie, donc tout ce qu’on me donne, je le prends. » Au gré des rencontres et grâce à sa force de persuasion, le jeune metteur en scène trace son sillon dans un milieu réputé difficile, hanté par une question : « Pourquoi moi j’arrive à m’en sortir ? » Projets Le mot « endroit » revient souvent dans ses phrases. Sans doute parce qu’il évolue dans des sphères différentes, et s’adapte en permanence, tel un caméléon. En mars, il entrera en résidence à la Villa Médicis, à Rome, pour écrire le troisième et dernier chapitre de sa fresque. « Avec ces trois pièces, j’essaie de guérir de mon histoire. Rien que d’en parler, ça me remue. Mais je refuse d’écrire avant d’entrer en résidence, c’est trop douloureux. Une fois là-bas, je vais sortir tout ce qui m’habite. Et après, je verrai ce que je ferai. » Par les villages, de Peter Handke, mis en scène par Sébastien Kheroufi, jusqu’au 11 fév., TQI, Ivry-sur-Seine (94) ; 16-18 fév., Centre Pompidou, Paris 4e ; 7 fév., L’Azimut, Châtenay-Malabry (92). Légende photo : Sébastien Kheroufi : « Je n’ai jamais rien eu dans ma vie, donc tout ce qu’on me donne, je le prends. » Photo Welane Navarre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2023 7:21 PM
|
Publié dans Sceneweb le 18 décembre 2023 L’édition 2023 du festival Impatience s’est déroulée du 8 au 12 décembre au CENTQUATRE-PARIS, Jeune Théâtre National, Les Plateaux Sauvages, TLA – scène conventionnée à Tremblay-en-France et Théâtre 13, avec Télérama. En une nuit – Notes pour un spectacle récolte deux prix. Voici le palmarès : Prix du jury et prix Public : Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer – En une nuit – Notes pour un spectacle
Prix SACD : Le Comité des fêtes / Silvio Palomo – ABRI ou les casanier·es de l’apocalypse
Prix Lycéen : Yasmine Yahiatène – La Fracture
Encourageant les démarches scéniques innovantes, stimulant les expérimentations et éveillant la curiosité, Impatience met en lumière les ambitions artistiques, scénographiques et textuelles des metteurs, metteuses en scène et collectifs émergents. Pour cette 15e édition, 9 spectacles avaient été présentés dans 5 lieux en Ile-de-France Les Sept colis sans destination de Nestor Crévelong
Nom de la compagnie : Théâtre de la Suspension
Mise en scène et écriture : Bertrand de Roffignac La Taïga court / Bleu Béton
Nom de la compagnie : Azür
Mise en scène : Timothée Israël
Écriture : Sonia Chiambretto FORTUNE – Récits de littoral #2
Nom de la compagnie : ATLATL
Mise en scène et écriture : Jennifer Cabassu et Théo Bluteau En une nuit – Notes pour un spectacle
Nom du collectif, mise en scène et écriture : Collectif Ferdinand Despy, Simon Hardouin, Justine Lequette et Eva Zingaro-Meyer (d’après Pier Paolo Pasolini) Grand crié
Nom de la compagnie : Ensemble Facture
Mise en scène et écriture : Nicolas Barry La Fracture
Nom de la compagnie : Little Big Horn
Mise en scène et écriture : Yasmine Yahiatene, Sarah-Lise Maufroy Salomon, Zoé Janssens, Olivia Smets, Samy Barras, Jérémy David, Charlotte Ducousso Sirènes
Nom de la compagnie : 52 Hertz
Mise en scène et écriture : Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche Entre ses mains
Nom de la compagnie : Cie le Grand Nulle Part
Mise en scène : Julie Guichard
Écriture : Julie Rossello-Rochet ABRI ou les casanier·e·s de l’apocalypse
Nom de la compagnie : Le Comité des Fêtes
Mise en scène : Silvio Palomo
Écriture : Comité des fêtes avec le CENTQUATRE-PARIS, le Jeune Théâtre National, Les Plateaux Sauvages, le TLA – scène conventionnée d’intérêt national à Tremblay-en-France et le Théâtre 13, en complicité avec Télérama Le festival Impatience est soutenu par la Région Ile-de-France.
Le festival Impatience est conventionné par le Ministère de la Culture.
Avec le soutien d’ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 18, 2023 4:22 PM
|
Par Sophie Trommelen pour le site artsmouvants.com 17 sept. 2023 Prix de la Révélation Théâtrale du Syndicat de la Critique, auteur, metteur en scène et interprète, Bertrand de Roffignac présente au Cirque Électrique Le Grand Œuvre de René Obscur, deuxième opus d'un triptyque initié avec les Sept Colis sans destination de Nestor Crévelong et repris en décembre au Cent-quatre dans le cadre du Festival Impatience. Bertrand de Roffignac nous plonge dans un univers fantasmagorique ou science-fiction et fantastique sont portés par un récit intense. La fiction s'inspire du mythe de Prométhée, à la différence que René Obscur n'offre pas le feu à ses semblables mais la promesse de retrouver la jouissance perdue, leur feu intérieur. Producteur de films contestataires à caractère pornographique, René Obscur aspire à offrir au public l’accès à l'orgasme ultime, une jouissance aussi sexuelle que spirituelle. Une révolution par l'image qui permettrait à l'homme, noyé dans une société vénale, véreuse, et vérolée d'enfin retrouver la conscience de soi. Le réalisateur s'affaire alors à créer une caméra dont l'objectif n'est autre que son propre œil droit. Un dispositif si puissant qu'il consume ses acteurs. Bertrand de Roffignac nous immerge dans l'atelier de cet artiste fou, tyrannique et névrosé qui aspire à créer le film parfait, obscène dans ce qu'il offre de libertaire. Sous le chapiteau du Cirque Électrique, acteurs, musiciens, danseurs et circassiens vont alors évoluer dans une scénographie à l'esthétisme puissant. Les images sombres d'un monde terreux et caverneux, plein de fumée et d'argile rompent avec toute temporalité. Bertrand de Roffignac nous plonge dans la fiction par la force de son récit et par la force des images que la scénographie soulève. Dialogues et tirades grandiloquentes se mêlent aux intermèdes dansés et aux envolées circassiennes qui s'imbriquent à l'univers dystopique. Si le récit se dilue parfois tant les sujets abordés foisonnent, l'énergie déployée ne perd jamais son souffle épique et étourdissant. Métaphore de la création artistique, critique des médias et de l'industrie culturelle, Bertrand de Roffignac déploie dans Le Grand Œuvre de René Obscur un imaginaire foisonnant aussi inquiétant que réjouissant. Conte sombre, épopée fantasque, Le Grand Œuvre de René Obscur révèle un esthétisme et un sens de la mise en scène flamboyants. Le Grand Œuvre de René Obscur - Bertrand de Roffignac / Théâtre de la Suspension jusqu'au 24 septembre au Cirque Électrique. Conception, texte et mise en scène : Bertrand de Roffignac Scénographie : Henri-Maria Leutner Interprètes : Adriana BREVIGLIERI, Axel CHEMLA, Bertrand DE ROFFIGNAC, Gall GASPARD, Marion GAUTIER, Xavier GUELFI, Loup MARCAULT-DEROUARD, Francois MICHONNEAU, Pierre PLEVEN, Erwan TARLET, Baptiste THIÉBAULT Assistanat scénographie : Benjamin Marre Création et Régie Lumière : Grégoire de Lafond / Thomas Cany Création Sonore : Axel Chemla Romeu-Santos Création masques et accessoires : David Ferré Régie Générale : Charlotte Moussié / Clément Balcon Régie Son : Martial de Roffignac / Antoine Blanc Administration : Dany Krivokuca Soutiens : Cirque Électrique, Théâtre du Châtelet Avec la participation du Jeune Théâtre National. Coproduction du théâtre de l’Arsenal scène conventionnée d’intérêt national « art et création pour la danse » de Val-de-Reuil. Sophie Trommelen /Artsmouvants, vu le 16 septembre au Cirque Électrique Crédit photo : © Vahid Amanpour

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 6, 2021 6:37 AM
|
ENTRETIEN. Un festival de théâtre d’un nouveau genre se tiendra les 6 et 7 mai à Bordeaux. Catherine Marnas évoque sa genèse et sa programmation. Catherine Marnas entend « transformer son théâtre en une ruche bourdonnante d'artistes en répétition... » © Frédéric Desmesure Ce sera un festival en petit comité… comme une répétition générale avant la grande reprise du 19 mai prochain. « Focus », la manifestation dédiée à la création contemporaine qui se tient cette semaine au théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) n'en devrait pas moins permettre aux jeunes troupes invitées de montrer enfin leur travail au public. À l'origine de ce nouveau festival, Catherine Marnas, directrice de ce centre dramatique national, en explique le principe. Le Point : Le festival Focus, dont vous organisez la première édition les 6 et 7 mai prochains à Bordeaux, intervient juste avant la réouverture des salles de spectacle. Allez-vous pouvoir accueillir du public avant les autres théâtres ? Catherine Marnas : Non. Nous ne pourrons malheureusement pas ouvrir nos portes au grand public. Cette édition sera réservée à un auditoire restreint de professionnels : programmateurs et directeurs de salle. Si l'une des propositions sera montrée en extérieur, ce ne sera que dans le cadre d'un protocole sanitaire très strict. Mais nous avons bon espoir que les spectacles qui seront montrés au TnBA pourront tourner dans l'Hexagone la saison prochaine. Comme tous les théâtres de France, nous attendons le 19 mai avec impatience… Comment avez-vous vécu la saison dernière ? Nous n'avons pu jouer que 19 fois sur la saison 2020-2021, là où, d'habitude, nous proposons entre 170 à 180 représentations par an. Mais nous avons quand même beaucoup travaillé. C'est tout le paradoxe de la crise que nous traversons. Notre lieu avait beau ne pas accueillir de spectateurs, nous n'avons pas cessé de répéter dans les trois salles de notre centre dramatique national. Si j'osais une image, je dirais que nous avons réalisé un travail de Pénélope. Comme la femme d'Ulysse, nous détricotions le soir ce que nous avions tissé pendant la journée. Certains de nos spectacles ont été repoussés quatre fois ! Cela veut dire que nous devions être prêts à la date dite, mais que les circonstances nous ont, chaque fois, contraints à retarder le moment où nous pourrions montrer le résultat de notre travail. Alors, nous reprenions les répétitions… À LIRE AUSSI Scène – L'art de se réinventer Le festival que vous créez cette année est-il une réponse à la crise que nous traversons ? Je l'ai imaginé avant la pandémie. Son objectif est de mettre en avant la création contemporaine. Je suis engagée de longue date dans ce projet qui vise à aider une nouvelle génération d'hommes et de femmes de théâtre à émerger. Je suis entourée de beaucoup de jeunes compagnies. Je dirige l'École supérieure de théâtre de Bordeaux Aquitaine (Estba), d'où sortent, tous les trois ans, quatorze diplômés. Si j'aime l'idée qu'ils se frottent à la vraie vie en sortant de chez nous, je souhaite néanmoins leur offrir la possibilité de montrer ce qu'ils font ici. Nous avons en Aquitaine de nombreux créateurs de talent, nous avons conduit avec eux de nombreux entretiens par vidéo pendant le premier confinement. Et tous nous ont dit la même chose : les conditions de production et de distribution sont de plus en plus difficiles. Pourquoi ? Les temporalités sont cruelles. Il faut deux ans en moyenne pour mettre sur pied un projet, pour réunir une coproduction, répéter et trouver des dates. Or, le monde change à une telle vitesse que ces jeunes ont envie de partager immédiatement leur travail. L'idée du festival Focus est de leur permettre de montrer une forme, même inaboutie, de ce qu'ils préparent. Un peu comme si un peintre organisait une journée « portes ouvertes », pour qu'on voie où il en est. Vous allez montrer neuf spectacles, à différentes étapes de leur réalisation. Le premier d'entre eux fait penser à une chanson de Dominique A puisqu'il s'intitule Le Courage des oiseaux… Oui. C'est une lecture-performance de Baptiste Amann. Ce sera un geste en forme de « making-of » de la trilogie qu'il a écrite et qui sera programmée au Festival d'Avignon cet été. Cela va bientôt faire sept ans que Baptiste développe ce projet intitulé « Des territoires ». C'est une exploration géographique et générationnelle de la scène qui vise à répondre à une question : quelle histoire écrire lorsque'on est, comme ses personnages, héritiers d'un patrimoine sans prestige et représentants d'une génération que l'on décrit comme désenchantée ?… Les deux premiers spectacles ont été créés en 2015 et 2017. Baptiste ne présentera pas ici le troisième opus de ce projet, mais un spectacle où il racontera les sept années qu'il a passées sur les routes pour créer ces trois œuvres. Je ne sais pas encore très bien la forme que cela prendra. Je peux juste vous dire qu'il a demandé un piano sur scène et que je ne doute pas que cela sera très abouti. Est aussi annoncée une lecture de Jérémy Barbier d'Hiver. De quoi s'agit-il ? Ce sera un texte très personnel que Jérémy a écrit : le monologue d'un homme qui parle à la tombe d'un père qu'il n'a pas connu. Cette pièce dont le titre provisoire est Mine de rien est en quelque sorte une suite à la « carte blanche » que notre théâtre lui avait déjà proposée. Ce sera son premier spectacle personnel. Il en proposera une lecture au plateau… Cet ancien élève de l'Estba est aujourd'hui membre du collectif « Les Rejetons de la reine » qui sera également programmé cette semaine. Effectivement. Ce collectif, constitué outre de Jérémy, de Clémentine Couic, d'Alyssia Derly et de Julie Papin, s'est formé au cœur de l'Estba en 2019. Il présentera sa première création : Un poignard dans la poche. Un texte de Simon Delgrange qui sera d'ailleurs à l'affiche du TnBA en octobre 2021. L'histoire se développe autour d'un repas de famille. On y parle beaucoup de politique et cela dégénère très vite. C'est du théâtre contemporain de l'absurde que je situerais volontiers entre Roland Dubillard et Roger Vitrac. Une table ronde, organisée le vendredi 7 mai, de 9h30 à midi, permettra aux « compagnons » du TnBA de partager avec le public la manière dont ils envisagent les « nouvelles relations entre équipes artistiques et lieux culturels ».© Pierre Planchenault Quels seront les autres temps forts du festival ? Julien Duval, fondateur du Syndicat d'initiative, proposera une forme courte, avec son acolyte Carlos Martins, autour d'une formule bien connue de Voltaire qui résonne étrangement par ces temps de Covid : « Il faut cultiver son jardin. » Une pièce qui est susceptible d'être jouée en appartement. Le collectif Os'o composé par des élèves de la première promotion de l'école (Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Roxane Brumachon et Tom Linton. Denis Lejeune étant « invité » pour l'occasion) mettra en scène un spectacle « jeune public » qui parlera d'ovnis et de science-fiction (Qui a cru Kenneth Arnold ?). Une pièce qui sera proposée, à la rentrée, dans les écoles du territoire. De son côté, Aurélie Van Den Daele adaptera La Chambre d'appel de Sidney Ali Mehelleb, un beau texte qui parle de mémoire. Enfin, Monique Garcia, cofondatrice du Glob Théâtre qu'elle dirige avec Anne Berger, jouera dans la rue une pièce étonnante (Fortune Cookie) à l'attention d'un seul spectateur à la fois. Pour ce faire, elle l'embarquera pour quelques minutes dans un tuk-tuk pour une parenthèse enchantée où il sera question de divination et de magie. Les deux dernières propositions du festival présentent la particularité d'être très biographiques… Yacine Sif El Islam et son compagnon, Benjamin Yousfi, raconteront l'agression homophobe dont ils ont été victimes en septembre 2020 et qui les a conduits à l'hôpital. En jetant ce choc sur le papier, en partageant les comptes rendus médicaux et l'avancée de l'enquête de police, Yacine met à distance ce traumatisme et signe un spectacle touchant (Sola Gratia) qui met en perspective cet événement avec des moments de son enfance. Reste votre propre pièce qui raconte le destin d'un hermaphrodite du XIXe siècle, Herculine Barbin. Pourquoi avoir choisi d'adapter sur scène le destin de cette femme, devenue homme ? J'étais partie pour adapter Le Rouge et le Noir, mais la pandémie m'a poussée à reporter ce projet. En racontant la vie d'Herculine, née femme en 1838, puis « réassignée » homme en 1860, sous le nom d'Abel, après examen médical, j'ai l'impression de traiter d'un sujet brûlant dans notre société. Lorsque je participe aux jurys qui doivent départager les 750 jeunes qui déposent un dossier pour intégrer notre école, je me rends compte que cette question de genre taraude cette génération. Je ne compte plus les candidats et candidates qui évoquent devant nous ce sujet lors des oraux. Or, c'est cela le théâtre pour moi : traiter dans l'urgence d'une question, à chaud. Partager avec des spectateurs, le temps d'une cérémonie païenne, une expérience qui nous bouleverse. Allez-vous modifier votre programmation pendant l'été ? Bien sûr. Nous allons prolonger les spectacles tout au long de l'été. Et jouer dehors s'il le faut. Le square en face du théâtre nous le permet. Nous avons plus que jamais besoin de théâtre… 2021ENTRETIEN. Un festival de théâtre d’un nouveau genre se tiendra les 6 et 7 mai à Bordeaux. Catherine Marnas évoque sa genèse et sa programmation.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 9, 2019 7:03 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottellothéâtre - 9 octobre
Villa Dolorosa de Rebekka Kricheldorf, traduction de Leila-Claire Rabih et Frank Weigand (Editions Actes-Sud), mise en scène de Pierre Cuq – Lauréat du Prix du Jury – Prix Théâtre 13 /Jeunes metteurs en scène 2019 pour ce spectacle.
La pièce Villa Dolorosa de l’auteure allemande Rebekka Kricheldorf apparaît comme une adaptation « décapante » des Trois Sœurs de Tchekhov – tendance bobo, soit bourgeoise et bohème – d’un début de XXI è siècle immédiatement contemporain.
Macha exprime librement le passage de ses états d’âme et de ses pensées intimes :
« Se lever, se laver, vivre, se laver, dormir, se lever, vivre, se laver, dormir, se lever, se laver, vivre, se laver, dormir, misère, Je crois que je vais me foutre en l’air. »
Ennui morose et sentiment de lassitude vaine depuis la monotonie terne des jours.
Le temps de la représentation, Irina fête son anniversaire trois fois – 28 ans, 29 ans puis 30 ans -, et à chaque fois, le même désenchantement et la même déception.
Ses sœurs sont présentes à ses côtés, la mélancolique Macha, éternellement assise sur son fauteuil malgré son jeune âge, et qui fuit son mari ; Olga, l’enseignante et directrice de lycée, critique incisive de l’état du monde – la seule qui ait un salaire.
Souvent, raconte-t-elle, elle se dit qu’elle aurait préféré épouser un dentiste, en bourgeoise insouciante et consommatrice ; or, elle accomplit –corps et âme – sa mission pédagogique d’enseignement, ce à quoi ses deux sœurs ne prétendent pas.
Il arrive à la professeure de penser tout bas alors qu’elle fait front quotidiennement à une classe médiocre ; elle profère à part soi ce qu’elle aimerait faire savoir à tel élève :
« … aucun avenir ne t’attend qui serait meilleur que le présent, mieux vaut quitter cette planète dès maintenant, ça t’évitera de tourner à vide pendant des milliers d’heures…, mais tu n’as pas le droit de faire ça, tu es la personne référente qui doit transmettre des valeurs positives … »
Irina, éternelle étudiante, passe d’une recherche doctorale à l’autre, sans l’accomplir jamais, restant à réfléchir oisivement dans le désœuvrement de la maison familiale.
Le frère Andreï accompagne à distance les trois sœurs, écrivain en herbe peu probant, et employé au service culturel de la mairie de la bourgade allemande.
Sa femme Janine cultive un quant-à-soi pratique et populaire qui ne sied guère aux affectations sororales – ce sentiment d’appartenance à une classe sociale supérieure aux prétentions morales, culturelles, littéraires, musicales, si étrangères à l’intruse.
Georg est présent également, ami du frère et amoureux de Macha qui l’aime, écartelé entre les tentatives de suicide de son épouse et le désir de changer de vie.
Juste reconnaissance d’un petit monde, le nôtre – zoom avant dirigé sur les générations montantes, avides de vivre mais dont le bel élan juvénile est empêché par la sensation prégnante et collective d’avoir l’herbe coupée sous le pied.
Rancœur et amertume, les êtres se dégagent de toute responsabilité individuelle pour ce qui est de la vision du chaos social, de l’ordonnancement désuet du monde.
Les personnages parlent et discourent, conversent et s’entretiennent, maîtres d’une parole qu’ils dominent avec aisance et nonchalance, sûrs de ce pouvoir, si ce n’est qu’ils ne cessent en même temps de contourner toute action efficace, préférant donner refuge à leur destin dans une velléité aléatoire d’agir, non dans une volonté.
La mise en scène de Pierre Cuq est décidée et enlevée, sûre de sa démonstration.
Les acteurs, Pauline Belle, Cantor Bourdeaux, Olivia Chatain (en alternance avec Pauline Tricot), Sophie Engel, Grégoire Lagrange, Aurore Rodenbour sont magnifiques d’énergie, de vitalité et d’ardeur, en dépit du désenchantement joué.
Face public, les yeux plantés dans les yeux des spectateurs, ils assènent leur vérité et leurs certitudes, prenant chacun à témoin, incarnant une volonté paradoxale d’en découdre scéniquement, au-delà de la désespérance de leurs paroles et regards.
Une résistance tonique, une vision du monde qu’ils s’emploient systématiquement à déprécier, à rendre négative, s’amusant d’un certain cynisme en vogue, l’ironie de cette fierté à se sentir apte à commenter l’effondrement même de leurs convictions.
L’humour, les situations cocasses et comiques participent du dynamisme de la mise en scène, quand les acteurs prennent plaisir à rire des autres et d’eux-mêmes.
Expressions éloquentes et grimaces, attitudes codées, réflexes de classe et de génération, ces contemporains obéissent encore à des règles rigides intériorisées.
Le public en sourit davantage, amusé de reconnaître les travers de chacun et de soi.
Véronique Hotte
Théâtre 13/Scène, 30 rue du Chevaleret 75013 Paris, du 8 au 20 octobre 2019, du mardi au samedi à 20h, dimanche à 16h. Tél : 01 45 88 62 22.
Crédit photo : Olivier Allard.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 1, 2019 8:15 AM
|
Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore dans l'Oeil d'Olivier 1 septembre 2019
Silhouette longiligne, chevelure flamboyante, Geoffrey Rouge-Carrassat est une nature. Sur scène, il impose son style tranchant, direct. Avec Roi du Silence, créé l’an passé, il présente cette année une première ébauche prometteuse de sa prochaine pièce Dépôt de bilan. Des pièces à voir, un artiste à suivre.
Tel un Hamlet et son crâne, Geoffrey Rouge-Carrassat fait face à l’urne qui contient les cendres de sa mère. La cérémonie s’est bien passée. La famille, les amis, les proches, sont venus en nombre. Pourtant, il manque une personne, l’ami d’enfance, le soutien, l’autre qui obsède ses pensées, le voisin du dessus. Cette absence qui ronge l’âme du jeune homme est l’occasion pour lui de se débarrasser d’un poids, d’une vérité qu’il a toujours tue pour ne pas blesser cette génitrice étouffante, aimée, détestée.
Par touche, ce Roi du silence se libère de ses chaines. Il fait face, il confie ses doutes, il dit qu’il est, qui il aime. La parole est puissante, salvatrice, les mots coulent avec fluidité, rapidité. Ils sont le reflet de son âme, de son cœur. Incandescents, brûlants, ils disent la passion dévorante, le désir qui incendie le creux de ses reins pour ce garçon trop timide qui habite ses rêves depuis l’adolescence.
Avec une fureur toute retenue, une élégance crue, Geoffrey Rouge-Carrassat donne vie à ses propres mots, ses propres questionnements. Évidemment, ce récit est fictionnel, mais en creux révèle quelques pans de l’identité de l’auteur, du poète, du comédien. Sous le regard bienveillant d’Emmanuel Besnault, sculpté par les belles lumières d’Emma Schler, il explose littéralement, fait vibrer la carcasse dépouillée de cet ancien garage, qui sert de salle de représentation. Sensible, humain, tendu à l’extrême, il habite son personnage. Un peu trop précis, trop parfait, il masque encore ses failles, ses parts d’ombres, d’incertitudes, d’ambiguïtés qui vont à terme faire de lui, on lui souhaite, un artiste rare, bouleversant.
Conscient de cette rigidité, Geoffrey Rouge-Carrassat présente en matinée une étape de travail de sa prochaine création, Dépôt de bilan, où il conte la vie d’un jeune homme, d’un cadre supérieur obsédé par son travail, auquel il sacrifie sa vie, sa jeunesse, sa famille. De sa verve ciselée, il esquisse les contours d’une dépression, les failles d’un être qui s’est perdu en route, a oublié qui il était pour se noyer dans une carrière qu’il croit à tort l’essence même de son existence. Ayant perdu ses proches, ses amis, il les remplace par des mannequins. L’image est forte, frappante.
Totalement sous le charme du jeune homme, à l’allure androgyne, conscient d’avoir assisté à un moment singulier, d’avoir touché de près la naissance d’un comédien, d’un auteur prometteur, le public ne s’y trompe pas et applaudit les deux spectacles avec la même intensité, le même enthousiasme.
Olivier Fregaville-Gratian d’Amore – envoyé spécial à Villerville
Roi du silence de Geoffrey Rouge-Carrassat
Un festival à Villerville
Garage
10 Rue du Général Leclerc
14113 Villerville
Jusqu’au 31 août 2019 à 22h00
Durée 3h00
Tournée du 4 au 22 février 2020 aux Déchargeurs, Paris
Dépôt de Bilan de Geoffrey Rouge-Carrassat
Garage
10 Rue du Général Leclerc
14113 Villerville
Jusqu’au 1er septembre 2019 à 15h00
Durée 3h00
Mise en scène et jeu de Geoffrey Rouge-Carrassat
Collaboration artistique d’Emmanuel Besnault
Lumière d’Emma Schler
En partenariat avec le Jeune Théâtre National (JTN)
Crédit photos © Victor Tonelli

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 24, 2019 4:27 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog 23 juillet 2019 Joie, d'Anna Bouguereau Final cut de Myriam Saduis So Chic, par Henry-Jean Servat Quand un artiste est à part, original, on craint de se mettre à l’écriture parce que l’on est toujours en dessous de ce que l’on a ressenti. Voici trois grands caractères. Très différents.
Honneur à la plus jeune. On l’avait repérée à La Loge, en 2016. Elle jouait dans une version très particulière de 4.48 Psychose de Sarah Kane. Une mise en scène de Brune Bleicher qui avait permis au public de prendre la mesure d’une présence, d’une voix très personnelle et belle.
Anna Bouguereau avait déjà un peu travaillé, après sa formation et a poursuivi depuis son chemin.
A Avignon, elle a imposé sa radieuse intelligente en interprétant un texte qu’elle a composé. Joie est un bijou de délectation sensible, macabre –on y parle d’enterrement- mais le texte est espiègle et spirituel.
Auteure, Anna Bouguereau connaît la concision, l’ellipse. Elle ne s’attarde pas. Elle va à la vitesse des pensées qui se bousculent dans la tête de la narratrice.
Joie ! Elle a choisi d’intituler son monologue Joie. L’une des tantes de la jeune femme qui s’adresse à nous vient de mourir. Un enterrement, son premier enterrement. Une longue table couverte de bouquets, des lumières très bien dosées de Xavier Duthu, une mise en scène incisive de Jean-Baptiste Tur et une collaboratrice artistique fine, Alice Vannier.
Ce spectacle a immédiatement été l’un des beaux succès du off. Et cette Joie a permis de mettre en valeur tous les dons d’Anna Bouguereau. Une haute silhouette, sensible et sensuelle, un regard en amande, des yeux de chat, un visage un peu slave, une manière harmonieuse de bouger. Cette voix, déjà louée mais dont elle n’abuse pas. Elle est stricte, rigoureuse. Ferme. Autoritaire et douce.
Anna Bouguereau, auteure, possède une alacrité grisante. On rit beaucoup car ses pensées battent la campagne. N’en disons pas plus ! On retrouvera Anna Bouguereau, c’est certain !
C’est une autre personnalité de femme qui aura marqué le festival off. Une artiste que l’on connaît et dont on suit le travail depuis longtemps. On connaissait l’adaptatrice, la metteuse en scène, la directrice d’acteurs, l’intellectuelle.
On découvre l’auteure et la comédienne. Et dans un exercice très particulier : celui d’une quête personnelle, une quête du père. La quête de la vérité de sa naissance et de sa vie.
Myriam Saduis réside et travaille principalement en Belgique. Après La Nostalgie de l’avenir d’après Tchekhov en 2012 et Amor mundi/Hannah Arendt en 2016 que l’on a vu en France, elle a donc écrit Final cut.
Elle l’a interprété, seulement accompagnée de Pierre Verplancken, durant tout le festival.
Un texte ardu, dense, tout en ruptures mais avec une armature très souple et solide. Allers et retours. Une mère italienne, catholique, ayant vécu en Tunisie. Un père tunisien, musulman. Disparu ou plutôt effacé par la volonté des adultes venus s’installer en France, après les événements de Bizerte.
Derrière un bureau, cette femme brune, au visage volontaire mais tendre, au regard sombre, profond et doux, à la voix très bien placée, nous raconte son histoire. Son enquête.
Elle se lève, se déplace, danse. La présence, discrète et claire de Pierre Verplancken est très séduisante.
Un appui d’images, mais sans excès. Isabelle Pousseur, metteuse en scène délicate et lucide, qui dirige le théâtre Océan Nord, à Bruxelles, là où travaille Myriam Saduis, a participé à la mise en scène.
Une bande-son avec chansons, une création de Jean-Luc Plouvier, des lumières de Nicolas Marty, des conseillers artistiques, un travail vidéo de Joachim Thôme, l’interprète a su s’entourer.
Elle sait trop que le théâtre est question de collectif et que, pour donner plus de force à cette histoire si intime et bouleversante, il faut être parfait.
Le public ne s’y est pas trompé qui a tout de suite fait salle comble à la Manufacture, après des représentations triomphales au Festival de Carthage, Tunisie oblige, où le spectacle a été créé.
La construction du texte est remarquable, comme l’est l’interprète, avec son timbre aux moirures fermes. Une interprète qui se garde de tout pathos, comme se tenant à distance.
On reverra Final cut dès octobre, à Paris, au Centre Wallonie-Bruxelles, puis en tournée en Belgique. En attendant d’autres rendez-vous.
Enfin, signalons, un nouveau venu dans le off. Un journaliste qui aime le cinéma, le théâtre, auteur de livres très documentés et aimants, Henry-Jean Servat.
Des premières années Libération à Paris Match, en passant par la télévision et la publication de nombreux albums, son amour des artistes fait merveille. So chic est une conférence amicale et déliée au cours de laquelle le reporter-écrivain nous fait pénétrer dans l’intimité des grands et grandes de ce monde, de Michèle Mercier à Dalida, de Soraya à Arlette Laguiller, sans oublier Brigitte Bardot, bien sûr. Pour n’en citer que quelques-unes. Le Pape Jean-Paul II est également présent, pour une représentation théâtrale unique, donnée dans sa résidence de Castel Gandolfo, le 28 juillet 1988.
A la demande du Pape, qui avait aimé et pratiqué le théâtre dans sa jeunesse, écrit des pièces, Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy, mis en scène par Jean-Paul Lucet avec Bernadette Le Saché, Catherine Salviat, Françoise Seigner avait été donné. En présence d’Antoine Vitez, nommé alors administrateur générale de la Comédie-Française. Les échanges du Pape Jean-Paul II et de Vitez, ancien militant communiste, ont fait l’objet depuis d’une pièce de Jean-Philippe Mestre, donnée avec succès.
C’est l’une des histoires savoures racontées par Henry-Jean Servat, témoin de cette rencontre improbable qui fit s’évanouir Françoise Seigner, trop émue…Dans une langue française très riche, avec cette manière très policée et savoureuse de s’exprimer, ce conférencier ravit le public !
« Joie », Train Bleu, jusqu’au 24 juillet, 16h40. Durée : 50 minutes.
« Final cut », La Manufacture, jusqu’au 25 juillet, 18h10. Durée : 1h30.
« So chic », Mercure Pont d’Avignon, jusqu’au 28 juillet, 21h00. Durée : 2h00.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 20, 2019 7:38 PM
|
Propos recueillis par Fabienne Darge dans Le Monde - le 05 juin 2019 L’auteure-metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen revient sur le succès international rencontré par son spectacle « Saïgon ».
Depuis sa création au Festival d’Avignon, le 8 juillet 2017, Saïgon, la pièce de Caroline Guiela Nguyen, a connu un succès comme on en voit peu, tournant en France et à l’étranger – partout en Europe, d’Athènes à Moscou, en Chine, au Vietnam et en Australie – pendant deux ans. Ce spectacle magnifique, qui aborde les blessures de la colonisation et de l’histoire franco-vietnamienne par le biais de l’intime, est repris aux Ateliers Berthier de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris (6e), avant de repartir en tournée. Parallèlement, Caroline Guiela Nguyen présente un spectacle en appartement, Mon grand amour. Entretien avec l’auteure-metteuse en scène qui, à 38 ans, fait figure de nouvelle étoile du théâtre français, non sans évoquer une Ariane Mnouchkine d’aujourd’hui.
Avez-vous été surprise par le succès de « Saïgon » ? En quoi est-il révélateur, selon vous ?
On ne s’attendait pas à rencontrer un tel enthousiasme de la part du public, non, avec un spectacle joué en partie en vietnamien, avec des acteurs amateurs… Mais je pense que c’est justement ce qui a fait le succès de Saïgon : on y raconte une histoire qui n’avait pas été racontée, avec des êtres humains que l’on n’a pas l’habitude de voir sur les plateaux. Apparemment, cette histoire avait manqué à beaucoup de monde, et pas seulement en France et au Vietnam.
Comment expliquez-vous l’écho que « Saïgon » a eu à l’international ?
Jamais je ne me suis dit, pendant la création, qu’on allait raconter une histoire universelle. Je n’aime pas ce mot, je trouve qu’il est aujourd’hui totalement perverti. Au contraire, on est partis d’une histoire singulière, celle de cette femme qui tient un petit restaurant vietnamien à Paris. Ce qui a été infiniment émouvant, c’est de voir à quel point cette histoire précise renvoyait des échos que ce soit en Chine, en Suède ou en Hollande : on a vu que l’histoire venait se loger en plein cœur chez beaucoup de spectateurs. En Europe, je pense que la pièce résonne fortement par rapport aux histoires coloniales, mais aussi sur la question actuelle de l’exil. En dehors des frontières de l’Europe, j’ai senti que Saïgon réveillait des interrogations sur la manière dont l’histoire de l’Europe s’est construite.
Comment se sont passées les représentations à Ho Chi Minh-Ville, ex-Saïgon ?
Très bien. Nous avons pu jouer le spectacle dans son intégrité, sans censure. Les représentations ont été très chargées en émotions. Pour les comédiens viets kieu [Vietnamiens de la diaspora], qui n’étaient jamais retournés au pays, notamment. Les Vietnamiens se posent énormément de questions sur le sort de ces derniers. C’était comme s’ils avaient devant eux la part manquante de leur histoire, en une sorte de négatif des représentations françaises. Le spectacle, qui peut agir comme une forme de réconciliation entre le Vietnam et la France, a eu ici la valeur d’une réconciliation entre les Vietnamiens et les Viets kieu. On a senti que les enjeux étaient très forts.
Pensez-vous faire un théâtre politique ?
J’ai été très étonnée du débat qui a eu lieu en France sur la question de savoir si notre théâtre est politique ou non. On l’a soupçonné de ne pas l’être : parce qu’on part d’histoires intimes, que l’on n’a pas peur de l’émotion, que l’on passe une chanson de Sylvie Vartan dans le spectacle ? Partout hors de France, la dimension politique est apparue comme évidente. Dans un monde où les mots se vident de leur sens, Saïgon montre que, derrière chaque personnage, il y a une histoire : qu’est-ce qu’être en exil, ne pas se sentir chez soi, perdre sa langue maternelle, vivre dans une autre culture ? Le spectacle redonne un visage aux acteurs de cette histoire.
D’où part votre réflexion sur les « récits manquants », les visages, les corps manquants dans le théâtre français ?
De mes années à l’école du Théâtre national de Strasbourg. L’exercice même de l’école veut que l’on soit avec des jeunes de notre âge, de milieu plus ou moins homogène. Je sentais que mon imaginaire était en panne dans ce contexte. Je suis allée faire une pièce avec des dames en maison de retraite, et tout s’est débloqué chez moi. Là, j’avais un autre grain de voix, d’autres histoires, d’autres visages, un autre lieu, un autre rythme. Cette expérience m’a ouverte sur ce que je voulais faire : rencontrer des gens qui allaient venir peupler mes récits. Mes spectacles ne partent jamais de « sujets », je ne me dis jamais : « Je vais faire un spectacle sur la colonisation ou sur le deuil » – cela, c’est totalement abstrait, pour moi. En revanche, je rencontre des personnes, des lieux – un restaurant, un appartement –, et je me dis : « J’ai envie de raconter des histoires avec eux. » C’est très concret : la rencontre m’amène vers un sujet, que je déplie ensuite.
Pourquoi cet attachement au récit, aux personnages, et ne pas aller vers une forme documentaire ? Quel est le rôle de la fiction dans votre théâtre ?
Parce que l’imaginaire est le lieu même du politique, contrairement à ce que l’on croit souvent. J’aime beaucoup cette expression du langage courant : « Je n’arrive pas à m’imaginer » – par exemple : « Je n’arrive pas à m’imaginer ce que c’est que de prendre un bateau et de quitter son pays. » Eh bien justement, le théâtre – ou le cinéma, en tout cas la puissance du récit – nous permet de continuer à imaginer l’humain. Quand on parle de migrants, d’intégration, d’identité, on a l’impression que, derrière ces mots-là, il n’y a personne. L’endroit qui peut être profondément politique, c’est de refaire apparaître des gens, de créer de l’imaginaire : remettre des êtres, des visages, des corps, derrière des mots abstraits. C’est quand on n’arrive plus à imaginer l’humain que l’on tombe dans les pires dérives. L’imaginaire me paraît être l’outil le plus urgent à remettre en marche aujourd’hui.
Que pensez-vous de la crispation actuelle autour des débats sur les questions postcoloniales ou décoloniales, comme lors de l’affaire de l’interdiction des « Suppliantes », d’Eschyle, à la Sorbonne ?
On a fait appel à moi pour signer la lettre-tribune intitulée « Pour Eschyle » [publiée dans Le Monde du 11 avril, et signée notamment par Ariane Mnouchkine et Wajdi Mouawad]. Et je n’ai pas signé. Parce que je pense que cette lettre est d’une naïveté incroyable. Ce qui me gêne terriblement, c’est qu’en en faisant uniquement un débat de censure, on annule le débat réel, qui me semble capital pour la France d’aujourd’hui, sur la représentation des diversités. Je suis la première à m’élever contre les interdictions. Il faut que les spectacles se jouent. Mais il faut aussi entendre ce qui se joue dans des événements comme celui-ci : ce que cela remue, ce que cela crée comme violence, comme peine, comme incompréhension. Si on étouffe ce dialogue-là, on va dans le mur. Franchement, je crois qu’il y a autre chose à faire que d’écrire des lettres pour Eschyle. Il y a à écrire des lettres, des récits pour nous, pour les générations et le théâtre à venir.
Saïgon, de et par Caroline Guiela Nguyen. Les Ateliers Berthier-Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris 17e, du 5 au 22 juin. Puis tournée jusqu’en mai 2020, en France et à l’étranger.
Mon grand amour, dans un appartement du 13e arrondissement de Paris, du 16 juillet au 3 août, dans le cadre du festival Paris l’été.
Légende photo : Caroline Guiela Nguyen, auteure-metteuse en scène, Paris, le 4 juin. Frédéric STUCIN / PASCO / POUR LE MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 3, 2019 7:47 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 3 juin 2019 Sous le titre « Sous d’autres cieux », Kevin Keiss a traduit et Maëlle Poésy mis en scène une adaptation libre des six premiers chants de « L’Enéide » de Virgile, ceux du temps de la guerre et du long exil. Un remarquable poème scénique où chaque poste compte. Un spectacle créé au festival Théâtre en mai à Dijon qui offre, chaque année, une vue panoramique sur la jeune création française.
Chaque année en mai, ce qui me plaît, c’est d’aller à Dijon au festival Théâtre en mai. C’est un festival qui, sous différents noms, s’est installé dans la ville des ducs de Bourgogne depuis longtemps. François Chattot, l’ancien directeur du Centre dramatique national Dijon-Bourgogne, lui avait donné un nouvel essor avant que l’actuel directeur, Benoît Lambert (qui lui-même y avait fait ses premiers pas en 1998), et sa collaboratrice Sophie Chesne ne lui donnent une orientation dominante : un panorama de la jeune création française ou, dit autrement, un carrefour de singularités et d’aventures singulières.
Artistes associés
Cela va de créations ici ou là en France de la saison qui s’achève à des créations récentes ou nouvelles des artistes associés à la maison. Pas de thématique, fort heureusement, ce qui laisse le champ ouvert à une curiosité sans œillères. Et de pouvoir déroger à la règle en invitant une troupe étrangère comme cette année la compagnie Brasilerio do Teatro dont le spectacle chaotique Preto est comme le tracé sismographique de la situation affolante du théâtre au Brésil après l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir. A ce sujet, Thomas Quillardet organise une soirée de soutien au « Brésil démocratique et à ses artistes » le 23 juin à 20h au Théâtre Monfort.
Du côté des artistes associés au CDN de Dijon, on a pu ainsi voir ou revoir La Bible de Céline Champinot, spectacle créé au Théâtre en mai 2018 (lire ici), Perdu connaissance par la compagnie Théâtre déplié d’Adrien Béal et Fanny Descazeaux créé au début de la saison 18-19 (lire ici), et découvrir Sous d’autres cieux d’après L’Enéide de Virgile, écrit par Kévin Keiss et mis en scène par Maëlle Poésy (on y vient).
Je suis arrivé trop tard à Dijon pour voir la création de Dernière ascension avant la plaine par Myriam Boudenia et Pauline Laidet, j’ai croisé avec plaisir Céline Milliat-Baumgartner qui y donnait Les Bijoux de pacotille (lire ici) et j’ai pu voir des spectacles que j’avais ratés lors de leur création cette saison : Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute de Rebecca Chaillon, Que viennent les barbares de Sébastien Poitevin et Myriam Marzouki, et Harlem quartet d’après le roman Just above my head de James Baldwin, adapté par Kevin Keiss (encore lui !) et mis en scène par Elise Vigier (un spectacle ample de premier ordre, créé il y a quelques mois et qui tournera la saison prochaine, j’y reviendrai prochainement à l’occasion d’un portrait de Baldwin que prépare Vigier au CDN de Caen).
J’ai regretté que ne soient pas programmés des spectacles forts de « jeunes compagnies » créés cette saison comme Je suis la bête de Julie Delille (lire ici) ou Crime et Chatiment par Nicolas Oton (lire ici) – deux spectacles à l’affiche du Printemps des comédiens qui vient de s’ouvrir –, J’ai la douleur du peuple effrayante au fond du crâne mis en scène par Margaux Eskenazi (lire ici), Orphée aphone de Vajrayana Khamphommala (lire ici) ou encore Saint-Félix d’Elise Chatauret (lire ici). Sophie Chesne s’en excuse par avance dans le programme : « Il y a beaucoup de compagnies passionnantes actuellement, bien plus que nous ne pouvons matériellement en accueillir. D’un strict point de vue artistique, le théâtre se porte très bien en France aujourd’hui, même si, sur le plan matériel, c‘est une tout autre histoire. »
Sauf que le plan matériel a tôt fait de gangrener le « point de vue artistique ». D’où cette impression que l’on a parfois – un « parfois » qui confine au « souvent » – de voir des spectacles inaccomplis comme arrêtés au milieu du guet. Manque de temps ? Manque de préparation en amont ? Manque de quoi financer une période de répétitions conséquente ? Manque d’exigence intime ou au contraire plongeon putassier dans la piscine de l’air du temps ? Trop grande place laissée à une intériorisation de la réception supposée du spectacle par les programmateurs ou frilosité de ces derniers conduisant à raboter les arêtes d’un spectacle ?
Identité et équipes nationales
On croise certains de ces éléments dans le spectacle de Myriam Marzouki (mise en scène) et Sébastien Poitevin (texte et dramaturgie) Que viennent les barbares. Un casting d’enfer : Albert Camus, Jean Sénac, Constantin Cavafis, James Baldwin, Mohamed Ali, Claude Levi-Strauss et j’en oublie. Autant de personnages incarnés par d’excellents actrices et acteurs comme Louise Belmas (troublante Jean Sénac) ou Marc Berman (surprenant Levi-Strauss). Hélas, cela tient plus d’un catalogue (genre : j’ai tout en magasin ; si si, servez-vous), d’un bout à bout (de grosses ficelles) sans articulation, avec, de surcroît, un décor dont les différents mouvements pèsent sur le déroulement de la représentation qui parvient mal à déployer son sujet, l’identité nationale, et à sortir le théâtre du seul discours, cette maladie infantile d’un théâtre prétendument politique.
Plus personnel est le spectacle de Rebecca Chaillon, Où la chèvre est attachée il faut qu’elle broute, consacré à une plongée affective et sans fard dans les coulisses du football féminin. Tandis que sur un écran se déroule un match de l’équipe de France féminine contre celle de l’Autriche (aucun suspense, le match est passé, la France a largement dominé), dans le même temps, 90 mn + 15 mn de vestiaires + arrêts de jeu, se déroule le spectacle. Cela commence par un long préambule où Rebecca Chaillon, assise en haut d’un gradin dressé au fond de la scène, boulotte une des trois pizzas apportées par un livreur pendant l’entrée du public et finit par nous parler foot-femmes. Préambule à l’entrée des joueuses qui, venues des coulisses en petites foulées, se réunissent sur un côté de la scène, tenant lieu de vestiaires. Elles se déshabillent pour revêtir leur tenue (maillot, short, protège-tibias, crampons). Toutes sauf une qui n’en finit pas de se déshabiller-rhabiller une bonne dizaine de fois, oscillant entre deux tenues, celle de la pompom girl ou groupie en tenue fluo et celle de la joueuse en maillot, tandis que les autres s’échauffent sur une bande de terre étalée sur la scène tenant lieu de terrain. Une scène qui insiste comme d’autres qui vont suivre, telle l’organisation d’un crachat collectif sur deux footballeuses qui s’embrassent au centre de la scène.
Pas de pelouse verte, mais de la terre où les corps viennent s’abîmer et se frotter avec délectation. On retrouve là ce côté animal cher à Rebecca Chaillon. Après la terre du terrain vient l’eau de la douche et on remet ça. Rebecca Chaillon se déshabille à son tour, se douche et, nue, retourne à sa place en haut des gradins où elle va façonner un tableau de genre : sainte Rebecca entourée des joueuses-anges agglutinées autour de ses cuisses ouvertes et lui suçant ses généreuses mamelles.
Le reste est plus anecdotique et fonctionne par accumulation : les filles en rang devant le public se déchargent la vessie avant le match (soit accroupie cul nu, soit debout comme les mecs) ; une joueuse jongle au pied avec un ballon encouragée par les copines assises sur les gradins dont l’une de plus en plus vociférante ; séquence d’interview des filles par l’une d’elles venue dans la salle avec micro, au passage questionnant vaguement le public sur sa connaissance footballistique mais surtout dialoguant avec ses copines assises sur les gradins pas forcément d’accord entre elles. Pourquoi le foot ? Depuis quand ? Violence ou pas violence, etc ? Cela s’éternise.
Maëlle Poésy et Kévin Keiss, duo de choc
C’est à ce moment que, sans grand regret, j’ai dû quitter la salle (le spectacle ayant commencé en retard et étant plus long qu’annoncé) pour ne pas rater le début, en ce soir de première, de Sous d’autres cieux d’après les premiers chants de L’Eneïde de Virgile, un spectacle traduit et écrit par Kevin Keiss et co-adapté par Maëlle Poésy qui signe la mise en scène. Un grand moment.
Vous fuyez. Une ville en feu, un pays occupé, un village assailli. Vous craignez pour votre vie, celle de votre famille, celle des voisins, des amis qui vous accompagnent dans la fuite en avant, loin, ailleurs, dans un autre pays. Vous devenez ce que vous n’avez jamais pensé être : un exilé. Vous n’y êtes pas préparé, votre vie organisée, réglée, verse dans l’improvisation, l’inattendu, l’imprévisible. Vous devez affronter des tas d’obstacles : des pluies diluviennes, des vents terribles, des tempêtes, des animaux sauvages, des individus rapaces, des frontières pleines de chausses-trappes. Vous avancez malgré tout, on vous dépouille de tout sauf de votre âme, mais celle-ci reste pour l’instant dans son coin, il y a trop de choses concrètes qui vous assaillent. Vous arrivez dans un pays dont vous ne parlez pas forcément la langue, dont vous ignorez les mœurs, les lois. Vous avez faim, vous avez tout le temps faim, vous avez soif de tout. Vous êtes une bête affamée, apeurée. Vous êtes comme un enfant qui après la bêtise craint les coups, les insultes, la privation de ses jeux. Vous avez oublié ce que veut dire jouer. Parfois, dans une lueur, vous pensez à votre maison perdue, peut-être occupée, peut-être incendiée. A tout ce que vous avez laissé. C’est comme un uppercut, une blessure ouverte, vous ravalez vite votre mémoire au fond du fond de votre âme. Vous apprenez les mots de l’ailleurs en vous y raccrochant comme à une bouée. On vous regarde parfois avec pitié, parfois avec compassion, souvent avec hostilité, peur, méfiance. Une porte s’ouvre, héberge, accompagne, nourrit. Une autre se ferme : qu’ils retournent d’où ils viennent, ceux-là. Vous repartez, ailleurs, toujours ailleurs, vous devenez un spécialiste du sans feu ni lieu. Votre âme qui s’est réveillée est tourmentée, instable, vous dormez mal, des cauchemars vous assaillent. Plus rien n’est fiable, pas même les souvenirs, surtout pas les souvenirs qui viennent hanter vos jours et vos nuits. Voilà ce qu’on éprouve en sortant de Sous d’autres cieux.
C’est ainsi depuis la nuit du temps des hommes et c’est ce que racontent les six premiers chants de L’Eneïde de Virgile : l’errance des vaincus, le voyage des exilés. Enée, aidé par Vénus, fuit Troie en portant son père Anchise sur son dos et son fils entre ses bras. Son épouse Créuse s’égare en cours de route, etc. Homère raconte l’histoire du côté des Grecs, vainqueurs. Virgile, du côté des vaincus, ce qui reste des Troyens fuyant leur ville en flammes, aidés par les dieux qui leur ont assignés une tâche : fonder Rome. Cela ne se fera pas sans guerre. Mais c’est une autre histoire, celle des six derniers chants de L’Enéide. Sous d’autres cieux s’en tient à la fuite, à l’exil, à Enée et aux Troyens vaincus, à ce qui leur arrive, aux dieux qui les observent et les manipulent. Et cela, non dans un ordre chronologique mais dans le prisme et l’espace-temps d’une mémoire traumatisée. Celle de tout exilé. Pour préparer le spectacle, Maëlle Poésy a passé beaucoup de temps au centre Primo Levi à Paris où l’on accueille les exilés en souffrance.
Une danse sauvage
C’est, au centre de la scène, une danse sauvage, rythmée, secouée de gestes cassés, de têtes comme rejetées sur le côté après la gifle qui les ont déstabilisées, c’est une marche vengeresse, comme une barque qui chaloupe dans les intempéries. Cela va, cela vient soutenu par une musique qui assène ses coups comme une enclume, c’est impressionnant, puissant. Noir. Une faible lumière (nocturne) se fait sur un homme assis sur un fauteuil côté jardin. Enée boit un verre, ramasse quelque chose sur le sol : une tête en bois, celle d’un cheval. Alors il se souvient de tout. Du cheval de Troie et du reste. C’est ainsi que cela commence. Cette danse initiale qui reviendra au fil des étapes du voyage est la base rythmique du spectacle.
« Nous voici face au silence insondable de l’immensité / Le bruit des rames et le bruit des eaux / Nous confions nos voiles au destin sans savoir où celui-ci nous portera / Sans savoir où nous arriverons / Les jours passent / Les jours passent / Le soleil surgit et le soleil s’écrase dans les flots / Nous voguons sans un mot / Chacun perdu dans son fracas », dira l’un des Troyens fuyant sa ville dévastée. Quel émigré ayant traversé la Méditerranée ne se reconnaîtrait pas dans ces mots ? « Même détruits par le sort / Même accablés / Même errants à travers les mers / Même rejetés, apatrides, de port en port / Votre existence m’est intolérable », dira Junon, comme diraient Orban, Marine Le Pen et bien d’autres Européens. L’actualisation d’un tel texte se fait d’elle-même.
Maëlle Poésy et Kevin Keiss sont sortis d’une même école, celle du TNS, il y a une dizaine d’années. C’est pour Maëlle que Kevin a traduit Purgatoire à Ingolstadt de Marieluise Fleisser, son premier spectacle à part entière créé en 2011 au Théâtre de Chalon-sur-Saône (lire ici). Depuis, ils forment un efficace tandem où le travail de l’un mord amicalement sur celui de l’autre. En 2014, Kevin écrit le texte de Candide, si c’est ça le meilleur des mondes d’après Voltaire (lire ici), spectacle créé à Théâtre en mai avant une longue tournée. En 2016, Kevin écrit pour Maëlle Ceux qui restent ne se trompent pas (lire ici) qui sera à l’affiche du 70e Festival d’Avignon comme l’est cette année leur vision de L’Enéide. Un beau parcours, une belle collaboration qui ne les empêche pas d’œuvrer chacun ailleurs. Elle du côté de l’opéra, du jeu ou de travaux en Amérique du Sud. Lui en étant l’un des auteurs du groupe Traverse ou en travaillant pour les metteuses en scène Laetitia Guédon, Lucie Berelowitch et Elise Vigier, en bricolant au Japon ou en Amérique du Sud, ou encore enseignant à Bordeaux et ailleurs.
Un tournant dans une aventure
Sous d’autres cieux marque un tournant. Kevin Keiss retrouve sa passion pour l’Antiquité grecque et romaine qui lui avait valu d’effectuer un doctorat sous la direction de Florence Dupont. Il se mesure, avec brio, à une nouvelle traduction de Virgile. « Malgré la complexité de la langue latine, je ne choisis pas comme certains traducteurs de construire des “effets d’étrangeté” susceptibles de rendre audible la langue ancienne dans la langue française. J’accorde une grande importance à une intelligibilité immédiate. Il s’agit de trouver une langue physique, sensuelle, âpre et directe », écrit-il. Il y parvient avec fluidité et clarté. Quant à Maëlle Poésy, cette langue orale et rythmée de Kevin Keiss, le travail adaptation mené en commun et une équipe complice (souvent de longue date) lui permettent de faire aboutir avec force une démarche – ici et là en filigrane dans ses précédents spectacles – celle d’une écriture scénique chorale faisant avancer de front tous les postes ; le jeu (fermeté de sa direction d’acteurs), la danse extraordinaire des corps (Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, Roshanak Morrowatian, Rosabel Huguet) et du décor transformable (Damien Caille-Perret), le son (Samuel Favart-Mikcha en collaboration avec Alexandre Bellando), la lumière (César Godefroy), la vidéo (Romain Tanguy). Un poème scénique qui embrasse l’air(e) du plateau et qui, sous le ciel étoilé du Cloître des Carmes, devrait prendre un surcroît d’ampleur.
Un théâtre porté vigoureusement par un commando d’acteurs parlant en français, en espagnol, en italien et en farsi (Harrison Arevalo, Genséric Coléno-Demeulenaere, Rosabel Huguet, Marc Lamigeon, Roshanak Morrowatian, Philippe Noël, Roxane Palazotto, Véronique Sacri, et la voix de Hatice Ozer) sans autre logique que celle de la langue natale des acteurs. Si bien que tout se croise. L’histoire racontée et celle du spectacle. Jusqu’au spectateur qui, lui aussi, par les enroulements du texte, exerce sa mémoire du spectacle en train de se faire devant lui, de se souvenir de Junon en écoutant Vénus, de quitter Anchise dans une monde et de le retrouver dans un autre. Quelle joie de voir les morts revenir parler aux vivants ou les accueillir dans l’au-delà, quel baume de voir les dieux pleurer, eux aussi. Et puis quel grand plaisir pour le spectateur que de mêler celui des sens et celui de l’intelligence comme le fait constamment ce spectacle.
Sous d’autres cieux a été créé au Théâtre du Parvis à Dijon dans le cadre du festival Théâtre en mai du 31 mai au 2 juin. Il sera à l’affiche du Festival d’Avignon au Cloître des Carmes du 6 au 14 juillet. Puis, la saison prochaine, grande tournée de novembre à avril à Dijon, Belfort, Antibes, Châteauvallon, Château-Arnaux, Châteauroux, Saint-Nazaire, Toulouse.
Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, du 3 au 6 juin au Nouveau Théâtre de Montreuil, le 13 juin à la Scène nationale d’Orléans.
Perdu connaissance, en novembre et décembre à Beauvais, Béthune, Châtillon, Vitry-sur-Seine, Lorient.
Les Bijoux de Pacotille, en tournée de novembre à mars : Morlaix, Annecy, Miramar, Mondeville, Pont-Audemer, Conches -en-Ouche, Chevilly-la-Rue, Noisy-le-Sec, Nancy, Agen.
Scène de "Sous d'autres cieux" © Vincent Ardelet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 19, 2016 7:08 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan
Pour sa première mise en scène, Laurence Cordier réunit trois actrices de trois générations différentes au fil d’un montage de textes extraits de trois livres d’Annie Ernaux. Paroles de fille, de femme, de mère. Ceux qui découvrent l’écrivaine la liront, ceux qui la retrouvent la reliront.
Il est beau de donner pour titre à un spectacle qui est comme une offrande, ‘Le quat’sous », ce lieu de l’interdit. Le terme apparaît dès la première page du premier récit publié parAnnie Ernaux « Les armoires vides » . La narratrice est sur la table de l’avorteuse qui vient de lui poser une sonde. « J’ai engueulé la vieille, qui bourrait de ouate pour faire tenir. Il ne faut pas toucher ton quat’sous, tu l’abimerais... »
Faire entendre les voix de l'écriture
Je ne sais pas si ce premier livre d’Ernaux a été le premier lu par Laurence Cordier. Qu’importe l’ouvrage que l’on lit d’elle pour entrer dans son univers, on est pris, on est dedans, on n’en sort plus. Tous les livres d’Annie Ernaux se répondent, ils reviennent sur des épisodes, des êtres évoqués ailleurs. Elle a fait de sa vie un roman et quand on lui a proposé de les réunir dans un « quarto » elle a choisi ce titre générique : « Écrire la vie ».
« J’ai rencontré les mots d’Annie Ernaux il y a dix ans et depuis ils ne m’ont plus quittée » dit Laurence Cordier. On connaissait l’actrice, souvent vue dans les spectacles de Patrick Pineau. Et un jour son envie a été la plus forte au point de la submerger: il fallait qu’elle partage son amour des livres (et de la personne, les deux sont liés) d’Annie Ernaux avec d’autres, faire entendre cette voix (et à travers elle d'autres voix) qui court sous tous ses livres.C’est ainsi que Laurence Cordier a basculé dans la mise en scène. « Le quat’sous » est le premier spectacle de sa compagnie La course folle.
Implacable incipit
Elle y tresse les mots de trois romans autour du personnage de Denise Lesur, double transparent d’Annie Ernaux, et de sa mère : « Les armoire vides » (1974), « Une femme » (1988) et « La honte » (1997). Des trois romans, elle donne à entendre les incipit, les premières phrases, toujours foudroyantes. Début de « La honte »: « Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l’après-midi. J’étais allée à la messe de midi moins le quart comme d’habitude ». Implacable. Comme l’étaient les incipit d d’Henri Calet, l’auteur de « La belle lurette » . Dans son récit « Les deux bouts », Calet écrit ( initialement pour un journal) une série de portraits de gens modestes, le livre s’achève par le portrait d’un couple qu’il connaît bien ; son père et sa mère. Mais Calet est un dilettante qui aime baguenauder, Ernaux est plus abrupte, plus centrée, plus entière. Tous ses livres (ou presque) n’en font qu’un. Et le tressage du montage que propose Laurence Cordier Cordier glisse avec tact et fluidité d’un livre l’autre.
L’idée forte et fondatrice de sa mise en scène est de confier le texte, non à une seule actrice mais à trois, d’âge et de nature différents. Non pour leur confier à chacune un rôle – la plus âgée serait la mère, la seconde la jeune femme et la troisième, la gamine- mais pour les réunir (comme trois sœurs, trois copines, ou le trio la mère-la petite fille-la cliente) afin, par moments, de mieux les séparer ( la scénographie faite de panneaux transparents sur roulettes que l’on manipule et macule y travaille).
"La-dessous, protégée, immobile, heureuse"
Nous sommes au théâtre, c’est un jeu, la parole tourne, se régénère. La langue d’Ernaux, piquée au vif, s’anime, son humour (moins perceptible à la muette lecture) fait des étincelles, en particulier dans sa façon de marquer socialement le langage. Le gouffre entre le langage compensé, coincé et excluant de l’institution, de la bourgeoisie, de l’école (« suspendez votre vêtement à la patère »)» et celui du café-épicerie des parents près d’Yvetot , là où l’on entend « le vrai langage » : « le pinard, la bidoche, se faire baiser, la vieille carne, dis bonjour ma petite besotte »
Les trois actrices choisies, Laurence Roy, Aline Le Berre et Delphine Cogniard, jouent avec conviction et pugnacité la partition, comme un chœur de femmes dont Annie Ernaux serait l’invisible coryphée. Le montage s’ouvre sur la rencontre avec un homme puis l’avortement (sujet central de son troisième livre « L’événement ») avant de reprendre un fil chronologique à partir de la naissance de la mère à Yvetot puis très vite le mariage, le café-épicerie Lesur à Lillebonne à 25 kilomètres d’Yvetot, la naissance de la narratrice, la copine Monette, et la concentration autour de la mère passant ses journées dans la boutique, sa fille se faufilant « sous le comptoir » écoutant les conversations de sa mère avec les clientes « et elle, là-dessous, protégée, immobile, heureuse ».
La mention récurrente du « quat’sous » rythme le récit scénique qui précipite le temps autour du couple mère-fille: la mère vieillit vite, la fille grandit vite (« elle n’a pas aimé me voir grandir »). « Saoule » un homme déflore la fille devenue majeure. Traduit en Ernaux cela donne :« traversé pour la première fois, écartelée entre les sièges de la bagnole ». Et puis ceci pour presque finir, incipit de « Une femme » (la mère) :« Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de l’hôpital de Pontoise ». Il faudra du temps à Annie Ernaux pour écrire dans « Mémoire de fille », son dernier livre (2016) : « elle est dans la légèreté d’être déliée des yeux de sa mère ».
Difficile après ce spectacle amoureux de ne pas avoir envie d’ouvrir un livre d’Annie Ernaux et de ne pas avoir envie de suivre Laurence Cordier après cette première mise en scène, délicate comme un bouquet de fleurs des champs.
Théâtre national de Bordeaux, jusqu’au 19 nov
Théâtre de Châtenay-Malabry la Piscine les 23 et 24 nov
Théâtre de Choisy-le-Roi le 29 nov
Théâtre Gallia, Saintes le 2 déc
puis en mars 2017 Tours, Chambéry, Épernay
Les livres d’Annie Ernaux sont publiés chez Gallimard (plusieurs disponibles en Folio) tout comme le Quarto « Écrire la vie »
Photo : De gauche à droite Aline Le Berre, Laurence Roy, Delphine Cogniard © Frédéric Desmesure

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 30, 2016 5:18 PM
|
Emission d'Arnaud Laporte du 30 mai 30 mai
Avis sur Brûlez-la, de Christian Siméon, mise en scène Michel Fau (Théâtre du Rond-Point)
et sur Anna Karénine, d'après Tolstoï, mise en scène Gaetan Vassart, avec Golshifteh Farahani
La Dispute : l'émission en replay et ses archives en réécoute sur France Culture. Consultez les programmes à venir et abonnez-vous au podcast !
Pour écouter : http://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/la-dispute-lundi-30-mai-2016

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 9, 2016 4:21 PM
|
Golshifteh Farahani interprètera Anna Karénine à la Tempête. CR : Antonia Bozzi
Devant un tel monument, il fallait bien sûr couper, retailler, sculpter à sa manière. Gaëtan Vassart a choisi de centrer sa version d’Anna Karénine sur le personnage central du roman, en soulignant à quel point celui-ci constitue une figure d’émancipation féminine. Dès lors, confier le rôle à Golshifteh Farahani, actrice iranienne et française, prend un sens tout particulier. Cette dernière s’est exilée d’Iran en raison des persécutions consécutives à son succès hollywoodien. Elle a ensuite posé nue à la une d’Egoïste dans un geste politique. Huit comédiens issus du Conservatoire l’accompagneront pour déployer la fresque légendaire.
Eric Demey
A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT
ANNA KARÉNINE (LES BALS OÙ ON S'AMUSE N'EXISTENT PLUS POUR MOI)
du 12 mai 2016 au 12 juin 2016
Théâtre de la Tempête
Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris, France
du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Tel : 01 43 28 36 36.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...