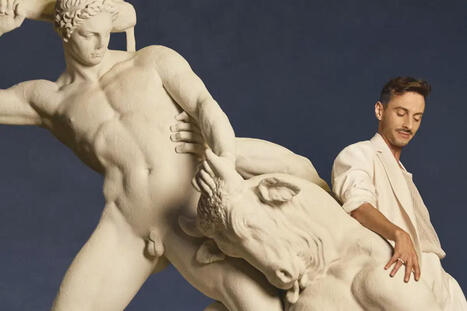Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 9, 2024 6:16 AM
|
Les cérémonies orchestrées par le metteur en scène ont célébré les corps – des sportifs, des interprètes et aussi celui, collectif, du public.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/09/paris-2024-le-spectaculaire-marathon-creatif-de-thomas-jolly_6308386_3246.html
En dramaturge subtil, Thomas Jolly, 42 ans, aura su écrire les temps des quatre cérémonies de ces Jeux olympiques (JO) et paralympiques comme autant de chapitres d’un récit dont il a été l’auteur principal. La beauté de Paris, la célébration d’une France qui n’est pas une mais multiple, l’utopie fédératrice des Jeux, l’inclusion des personnes en situation de handicap… Tout en basculant de la Seine à la place de la Concorde pour boucler la boucle au Stade de France (Seine-Saint-Denis), la trame imaginée par le metteur en scène a associé de plus en plus étroitement le sport, la musique et la danse. Au bout du bout, c’est vers une célébration du corps qu’auront tendu les étapes de ce marathon créatif. Corps des sportifs, corps des interprètes en scène et, enfin, corps collectif du public, qui, après avoir écouté Aya Nakamura et Céline Dion, lors de la cérémonie d’ouverture des JO le 26 juillet, puis chanté en chœur de grands tubes iconiques français, s’est dressé pour danser, bras levés, la nuit du 8 septembre, au Stade de France à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Le producteur Romain Pissenem s’inquiétait de la possibilité de « rendre le spectacle immersif » même pour ceux qui sont « perchés en haut des gradins ». Cette préoccupation fut une obsession identique chez Thomas Jolly. Sauf qu’en ce qui concerne ce dernier, le désir de toucher chaque personne assise dans la salle déborde le lieu géographique de la représentation pour gagner celles et ceux qui n’en franchissent pas les portes. S’il faut toucher les présents, il faut surtout convaincre les absents de venir. Ce que Romain Pissenem appelle « spectacle immersif », le metteur en scène le nomme, pour sa part, « théâtre populaire ». Intellect et l’émotionnel Depuis qu’il met en scène, Thomas Jolly cherche à rallier le plus grand nombre de spectateurs. Et y parvient. La jeunesse, au premier chef, qui plébiscite des spectacles que ne renieraient d’ailleurs pas des chanteurs rock rompus aux concerts live. Fumigènes, jets de laser, lumières qui sculptent l’espace, bandes-son musicales et comédiens qui se jettent dans la bataille des mots et des actions sans jamais s’économiser. Qu’il propose un marathon shakespearien d’une durée de dix-huit heures (Henri VI) ou qu’il revisite l’opéra rock Starmania, en convoquant, entre autres effets pyrotechniques, l’hologramme de France Gall, l’artiste provoque l’intellect et l’émotionnel. Les larmes, les rires, l’effroi, l’émerveillement, il n’y a pas de sentiments devant lesquels il recule. Et pas de défis, aussi démesurément olympiques soient-ils, qui ne l’effraient. Le défi a brillamment été relevé. Vidéo : les grands moments de la cérémonie d'ouverture des JO (4 mn30) Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympique Paris 2024, au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 8 septembre 2024. MATHIAS BENGUIGUI POUR « LE MONDE »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 11, 2024 9:25 AM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 11 août 2024
Le danseur-breakeur-contorsionniste de 32 ans tient le rôle principal dans « Records », le spectacle imaginé et mis en scène par Thomas Jolly.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/sport/article/2024/08/11/arthur-cadre-homme-caoutchouc-et-golden-voyageur-de-la-ceremonie-de-cloture-des-jo-de-paris_6276353_3242.html
Lorsque Arthur Cadre déplie tranquillement son presque double mètre – 1,86 m précisément sous la toise –, on a du mal à superposer les images des invraisemblables acrobaties dont ce danseur-breakeur-contorsionniste est capable. La vedette de Records, qui incarne le « golden voyageur » (« voyageur en or ») du spectacle de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024 sous la direction de Thomas Jolly, est un homme-caoutchouc dont le répertoire gestuel stupéfiant, visible sur les réseaux sociaux, entre extrême flexibilité et tension graphique, éblouit. « Il faut mettre plus d’efforts dans les mouvements évidemment, car, quand on est grand, tout prend plus d’ampleur, glisse-t-il. Mais après, les lignes sont plus longues. » Voir la vidéo Dans un agenda blindé – il annonce trois cents jours de voyage en tournée par an dans le monde entier –, cet artiste de 32 ans, également architecte, metteur en scène, acrobate de cirque, photographe et mannequin, a répondu illico oui à la proposition de Thomas Jolly deux mois seulement avant le show. « J’avais très envie de travailler avec lui », confie-t-il. C’est après être allé voir Starmania – à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), en 2023 – « magnifique ! » – qu’il entre en contact avec Thomas Jolly par Instagram. Et la suite file. Les deux artistes se rencontrent, et voilà Arthur Cadre au cœur de la « dystopie » imaginée par Thomas Jolly qui, dit-il, lui a laissé « beaucoup de liberté créative » : « Je lui propose des choses et il me donne un retour. » Arthur Cadre, cité en 2022 parmi les trente jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui comptent par le magazine américain Forbes, affiche calme et sérénité. Mercredi 7 août, il émerge d’une répétition de nuit au Stade de France de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Impressionné par les 2 800 mètres carrés du plateau et par les 80 000 spectateurs attendus ? Arthur Cadre est un habitué des maxiformats scéniques. Celui qui se consacre « à la création du spectacle de demain », comme il le déclare sur son site Internet, a déjà du très lourd derrière lui. Parmi une liste d’événements énormes et prestigieux, entre Venise et Los Angeles en passant par Zanzibar, il évoque, par exemple, son rôle principal dans La Perle, créé en 2018 à Dubaï par Franco Dragone (1952-2022), le fondateur du Cirque du Soleil, qui le remarque en 2015 au Festival mondial du cirque de demain, à Paris. Il jouera mille fois ce mégashow. En mars, il a conçu la production Asayel, avec quarante danseurs et vingt-cinq chevaux, à Riyad, en Arabie saoudite. En décembre, il sera à Las Vegas en tant que « concepteur créatif » sur Hope Road, autour de Bob Marley, produit par la famille du musicien, au Mandala Bay. Breakeur d’abord, Arthur Cadre a démarré la danse hip-hop à l’âge de 9 ans dans sa chambre, à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor), où il a grandi et où il retourne régulièrement. La famille baigne dans le sport. Son père, champion de planche à voile, a participé aux Jeux olympiques en 1988, à Séoul. Sa mère était dans l’équipe de France de volley-ball. C’est la vision du clip Freestyler de Bomfunk qui lui donne envie de plonger dans le breaking. Vite, il a 13 ans, lorsqu’il participe à des compétitions de breakdance, où son profil et ses enchaînements de pas vertigineux le distinguent. « La culture hip-hop vous forge en matière de motivation, dit-il. On est directement confronté aux gens, au public, et l’aspect communauté est vraiment intéressant… » En 2007, il apparaît pour la première fois dans l’émission « La France a un incroyable talent ». Rebelote en 2015, où il se qualifie en finale. Entre-temps, en 2011, une de ses vidéos de « yoga breakdance » devient virale. La même année, il débarque à Montréal, où il vit jusqu’en 2015, y décroche son diplôme d’architecte tout en finançant ses études en participant à des pubs, des performances. « L’architecture a beaucoup d’influence sur mon mouvement en matière de lignes, de rythmes, de volumes… », précise-t-il. Baptisé « Lil Crabe » – ce qui en dit long sur sa signature stylistique –, il déploie une gestuelle variée et complexe où le breaking s’enrichit des multiples techniques engrangées au fil du temps, dont celles de la danse classique et contemporaine, des claquettes, du cirque, de la magie, du yoga qui nourrissent l’imaginaire et l’écriture de cet autodidacte. Curieux, il travaille actuellement sur la lévitation. « C’est un outil pour raconter des histoires et transporter les gens », souligne celui qui aime bien mélanger tous ses pinceaux : la danse, l’architecture, le cirque, le théâtre, la photo, la mode… Et incarner ses visions mirifiques. Voir la vidéo Légende photo : Le danseur, contorsionniste et architecte français Arthur Cadre, artiste principal de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, le 23 juillet 2024. JOEL SAGET / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 25, 2024 4:54 PM
|
par Copélia Mainardi dans Libération - 25 juillet 2024 Habile pour rompre avec les usages, le directeur artistique des cérémonies s’est attelé durant deux ans à imaginer et livrer une parade pharaonique malgré des contraintes tout aussi titanesques. Elle coule en contrebas, imperturbable, ignorante des milliers de regards bientôt rivés sur elle. Voilà deux ans que Thomas Jolly a fait de la Seine son fief et sa partenaire. Nul hasard qu’on le rencontre près d’elle, en plein cœur de la capitale, dans un hôtel dont le dernier étage offre une vue panoramique sur les berges désertes, étrange réminiscence d’une période de confinement déjà lointaine. Lui en haut, elle en bas. Le directeur artistique des cérémonies olympiques apparaît souriant, enthousiaste – détendu, oserait-on presque. «Je me sens plus impatient que stressé, mais peut-être suis-je simplement inconscient.» Sans doute faut-il l’être pour garder le cap de ce projet pharaonique, dont les chiffres de la seule soirée d’ouverture suffisent à donner le tournis : trois heures et quarante-cinq minutes, 6 kilomètres, 10 ponts, 80 écrans géants, 3 000 artistes, 500 habilleurs, coiffeurs et maquilleurs, de 900 à 3 000 euros la place, 300 000 spectateurs. C’est la première fois qu’une cérémonie n’aura pas lieu dans l’enceinte d’un stade et c’est précisément ce qui séduit Jolly : rompre avec les usages. Il a imaginé cette parade olympique façon grand show, comme il en a l’habitude. A la phase de conception où tous les rêves sont permis, a succédé la découverte de contraintes titanesques – le patrimoine, le budget, la technique, la sécurité, mais aussi les ponts, le vent… Et même les poissons ! «Le réel qui rattrape, résume-t-il. Ne rien rogner à l’intention initiale a été une lutte de chaque instant.» Besoin de sortir des cadres Depuis dix ans, Thomas Jolly est partout. Théâtre public et structures privées, Palais des Papes et collèges de banlieue, de chaque côté des planches, parfois metteur en scène et rôle principal d’un même spectacle. «De Britten à Britney», comme il aime dire. Avec plus ou moins de succès, il jongle avec les recettes, les formules, les formats, s’est essayé à l’opéra (citons entre autres Fantasio à l’Opéra-Comique ou Roméo et Juliette à Bastille en 2023) et bien sûr à la comédie musicale : sa mise en scène du culte Starmania, en tournée mondiale, a déjà réuni près d’un million de spectateurs. Machinerie rodée et efficace, le spectacle allie variété populaire et sophistication scénographique – notamment des effets laser et stroboscopiques hypnotiques, l’une de ses marques de fabrique. C’est pourtant avant tout un enfant du théâtre public. Après avoir fréquenté assidûment les ateliers théâtre de sa ville de Rouen, ce fils d’une infirmière et d’un imprimeur intègre à l’âge de 20 ans l’école du Théâtre national de Bretagne, alors dirigée par Stanislas Nordey. «J’ai tout de suite repéré le metteur en scène derrière l’acteur, raconte ce dernier. Il était déjà fédérateur, a toujours aimé être parmi les autres, les voir évoluer.» En 2006, retour à Rouen et coup double ; Jolly fonde sa compagnie, la Piccola Familia, dans la foulée de l’une de ses premières mises en scène, Arlequin poli par l’amour de Marivaux. Léger, inventif, artisanal : c’est la naissance du théâtre de tréteaux à la Jolly. Dix-huit ans plus tard, Arlequin tourne encore. Une fois lancé, Thomas Jolly assume son besoin de sortir des cadres. Le public avignonnais le découvre en 2014, en sortant un peu hagard d’un Shakespeare de… 18 heures. Son Henry VI réunit théâtre élisabéthain et culture pop, assume les références à Beyoncé et Game of Thrones sans sacrifier à l’exigence du texte. A 33 ans, il décroche le Molière du théâtre public et monte la suite, Richard III, avec nul autre que lui-même dans le rôle du tyran cruel et fascinant. En 2022, au CDN Le Quai d’Angers – dont il assure la direction depuis deux ans, avant de démissionner pour se consacrer aux JO –, il assume l’intégrale : 24 heures de représentation, dix ans tout pile après la création de la première partie. Standing ovations, selfies et autographes, ados en larmes à la mort de Jeanne d’Arc ou suspendus aux frasques du rebelle Jack Cade : on ne sait plus si c’est du Shakespeare ou un concert de rock, mais qui a dit que les jeunes n’allaient plus au théâtre ? «Prendre le temps d’écrire la suite» L’artiste rêve toujours plus grand, plus fort, plus haut – ce qui peut sembler paradoxal quand on sait qu’il défend depuis toujours un théâtre populaire et accessible, persuadé qu’on peut faire des merveilles avec trois bouts de ficelle. Que retrouve-t-on de son ADN dans cette cérémonie d’ouverture ? «Le même rapport d’adresse au public, malgré les cadres qui changent, affirme-t-il. La création d’une communauté pour produire un récit qui peut plaire, crisper, dérouter – et on ne sait jamais qui.» Il est vrai que Jolly n’a pas été épargné. Libé, par exemple, n’a pas toujours goûté son «esthétique ampoulée», tout en lui reconnaissant une maîtrise de l’espace et du décor certaine. Au-delà de ses choix artistiques, on a pu lui reprocher sa prétention à l’ubiquité, dont son équipe angevine aurait notamment pâti. «Mais il fonctionne ainsi, en étant porté par une idée impossible qu’il parvient à réaliser envers et contre tout, avec une équipe qu’il pousse à se dépasser malgré les résistances de personnes parfois déstabilisées, analyse l’auteur et acteur Damien Gabriac, qui travaille avec lui sur les cérémonies des JO et le côtoie depuis l’école. A mon sens, c’est un metteur en scène, avant tout. Et si ses responsabilités n’ont fait qu’augmenter depuis vingt ans, il a conservé la même méthode de travail, la même manière de relever les défis.» Malgré ces constantes, Thomas Jolly a depuis deux ans vu «la vie changer fort, très fort». Reconnaît une forme «d’hibernation», «d’accaparement total» duquel on ne sort pas indemne. «J’ai tout mis dans cette aventure, fait tapis», lâche-t-il. Ce n’est jamais sans conséquences. A quoi pourra donc ressembler l’après ? Son nom circulait avec insistance, mais c’est Julien Gosselin qui prendra finalement la tête du théâtre de l’Odéon. Jolly reconnaît qu’il aurait aimé «porter» ce lieu, sans pour autant paraître affecté outre mesure : «J’étais ailleurs.» De cet ailleurs, il va pourtant falloir revenir. «Je ne sais pas ce que je veux, ni même s’il y aura du théâtre, reprend-il. A 42 ans, il est temps de clore un grand chapitre et de prendre le temps d’écrire la suite.» Celle-ci sera peut-être moins artistique que personnelle : quand on l’interroge sur ce qui lui a le plus manqué dernièrement, il répond «l’amitié». Presque sans hésiter. Copélia Mainardi / Libération Légende photo : Le directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris, Thomas Jolly, à Saint-Denis le 7 juin 2024. (Florence Brochoire/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 25, 2024 7:29 AM
|
Par Éric Demey, publié sur le site d'Artcena le 24 juillet 2024
Thomas Jolly, bouillon de cultures
PORTRAIT
Il sera sans doute dans quelques jours le metteur en scène français le plus connu du monde. Que Thomas Jolly ait été chargé de concevoir la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 paraît s'inscrire naturellement dans l'élan de son audace, de son goût pour le spectaculaire et de sa capacité à surprendre, à se déplacer là où on ne l'attend pas. Mais aussi de son talent. Tentative de portrait d'un artiste bouillonnant d'idées.
Dans la campagne rouennaise, au sein d'une famille modeste, Thomas Jolly grandit dans un milieu qui ne le porte pas forcément au théâtre. Aiguillonné par une vocation précoce, il traverse cependant les frontières pour surgir là où on ne l'attend pas, connaît un succès croissant qui dépasse les cadres traditionnels du théâtre public et acquiert avec Starmania et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques une visibilité à nulle autre pareil. Pourtant, s'il est adepte des grands formats, Thomas Jolly l'est aussi de formes courtes diffusées dans l'espace public et d'un théâtre de textes qui conjugue artisanat et effets spectaculaires. Cet artiste baroque sous influence shakespearienne vise en fait à rendre au théâtre sa dimension populaire. Balancer de la musique pop dans une tragédie n'empêche donc pas un rapport scrupuleux au texte. Un œil sur l'auteur, l'autre sur le spectateur, Thomas Jolly ne veut pas, en fait, signer ses mises en scène mais comprendre, transmettre, rendre accessible en laissant toute sa place à l'acteur. Une démarche qui s'appuie sur une foi presque anachronique dans le théâtre et sa capacité à créer un espace d'illusion commune. Autre article sur Thomas Jolly, par Eric Demey : Thomas Jolly L' artisan Hollywoodien : Eric Demey / ARTCENA Site de La Piccola Familia
www.lapiccolafamilia.fr
Crédit photo © Anthony Dorfmann

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 22, 2024 11:09 AM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama. 22 juillet 2024 LES JO DE JOLLY – Le directeur artistique oscille entre “l’exaltation [et] la déprime” alors qu’approche l’ouverture des Jeux de Paris 2024. Dernières impressions avant le jour J des JO. Quelques jours avant la grande cérémonie d’ouverture sur laquelle il travaille depuis bientôt deux ans, il répond sur son portable à de dernières questions en déambulant à pied au milieu de gigantesques hangars blancs. Lui-même vêtu de blanc : raccord. Il a dû s’extirper d’ultimes répétitions de danse. Heureux de ce qu’il voit, il n’évoque pas le moins du monde, alors, la grève de danseurs intermittents du spectacle qui menace certains tableaux sur la Seine le 26 juillet et les trois prochaines cérémonies à venir. Il dira même le lendemain, par SMS, n’avoir rien su à ce moment-là du mouvement qui touche les danseurs et danseuses les plus précaires recrutés pour les JO, à savoir ceux qui ne sont pas permanents aux Ballet de Lorraine, Malandain Ballet Biarritz, Ballet de Bordeaux ou Ballet Preljocaj. La direction artistique ne négocie pas les contrats de travail, son boulot est déjà colossal et l’organisation tellement vissée que partout les secrets règnent. Quand il marche à toute vitesse, ce matin-là, Thomas Jolly refuse en riant de dire où il se trouve. En région parisienne, visiblement. Surgit sur son chemin une jeune vigile qui surveille les intrus et ne le connaît pas, lui demande donc qui il est. Et Thomas Jolly de très sérieusement répondre « opération Aurore ». De l’autre côté du portable, on tombe des nues. Nous voilà, sous le ciel bleu, dans OSS 117 aux JO. [Avec les coauteurs de la cérémonie,] nous étions tous d’accord sur la vision d’une France inclusive, joyeuse, pétrie d’humanité partagée. Pourtant ont été enfin divulgués – dans l’ultime ligne droite – les noms des quatre auteurs du récit choisis en 2022 par Thomas Jolly pour structurer la balade des péniches sur la Seine, du pont d’Austerlitz au pont d’Iéna. Sans doute les derniers évènements politiques – élections européennes, dissolution, législatives – ont-ils poussé nos coauteurs à vouloir garder distance, discrétion et réserve en ces temps tourmentés. Mais voilà désormais publiquement nommés l’historien Patrick Boucheron, la scénariste Fanny Herrero, la romancière Leïla Slimani et le dramaturge Damien Gabriac. Quatre mousquetaires complémentaires, selon Thomas Jolly, qui a assisté à chacune de leurs séances de travail, et a construit avec eux, depuis le printemps 2023, le scénario de la cérémonie d’ouverture. « Nous n’avons pas forcément les mêmes choix politiques ou idéologiques, mais nous étions tous d’accord sur la vision d’une France inclusive, joyeuse, pétrie d’humanité partagée. Notre diversité était le reflet des messages de liberté, de tolérance qu’on souhaitait envoyer autour de notre relecture de l’histoire française. Aucune chronologie dans le récit que nous avons forgé. C’est le fil même de la Seine qui a dicté les douze tableaux. Évidemment, certains lieux sont plus chargés d’histoire que d’autres. Par exemple, le Pont-Neuf. Avec la statue équestre d’Henri IV ; le souvenir cinématographique des Amants du Pont-Neuf, de Leos Carax ; la place Dauphine, “sexe de Paris” selon le surréaliste André Breton qui y fait apparaître son héroïne Nadja ; et Monet ou Turner qui l’ont peint… On a rassemblé toutes ces infos et réfléchi à une thématique autour de… l’amour. À moi, ensuite, d’être leur traducteur fidèle et imaginatif. » Un puzzle à assembler À la question de savoir si une majorité absolue du RN aurait pu changer quelque peu leur récit, Thomas Jolly de rétorquer qu’il aurait semblé plus fort encore, sans même y toucher, dans cet autre contexte. Tant y est développée l’aspiration à vivre ensemble avec toutes nos différences, nos altérités. Et il répète une fois de plus qu’en tant que directeur artistique des JO, il ne relève pas, de toute façon, du politique, qui n’a jamais tenté, affirme-t-il, la moindre ingérence dans son travail. Ainsi n’aurait-il pas bougé d’un cheveu la cérémonie du 26 juillet. On peut le croire, tant on sait l’artiste courageux, obstiné, calme et vif à la fois. Aujourd’hui, il dit se retrouver devant « un puzzle de cent mille pièces ». Chacune est magnifique. Reste à les rassembler. Ils étaient une petite bande d’une quarantaine de créateurs au début, ils se retrouvent dix-huit mille aujourd’hui à régler les tempos, à vérifier les décors, les éléments concrets sur les quais, sur les rives, sur l’eau, sous l’eau, dans les airs, histoire de réussir ensemble « le plus beau spectacle du monde ». Ce sont les autres qui font. Un peu comme dans les mises en scène à l’opéra. En bien plus grand. Je ne peux plus intervenir qu’à la marge. S’il a vu in extenso la cérémonie en 3D – sur écran comme dans un jeu vidéo – pour avoir un point de vue global, Thomas Jolly ne l’a jamais répétée en entier, fait un « filage » comme on dit dans le métier du théâtre. Tout se passe actuellement bout par bout, jour et nuit, dans des hangars. Car il faut aussi faire des « répétitions caméra » pour ajuster la captation télévisée réservée aux deux milliards de téléspectateurs espérés. Plus qu’un spectacle, la cérémonie d’ouverture sera forcément une sorte de géante « performance ». « Aujourd’hui, je me sens désemparé parce que j’ai tout légué à des équipes, et je me retrouve à errer de répétition en répétition, de hangar en hangar, de tableau en tableau. Je ne suis déjà plus vraiment à la manœuvre. Ce sont les autres qui font. Un peu comme dans les mises en scène à l’opéra. En bien plus grand. Je ne peux plus intervenir qu’à la marge. Est-ce que j’ai peur ? On n’est jamais à l’abri d’une mauvaise surprise ou d’un coup de théâtre de dernière minute. Mes journées sont de véritables ascenseurs émotionnels. Je passe de l’exaltation à la déprime. Je n’avais pas anticipé que le moindre détail pouvait devenir montagne, tel ce talon de chaussure qui gêne in extremis le déplacement d’un artiste… Pourtant on a tout imaginé, tout anticipé. On a même fait des cérémonies catastrophes, avec du vent, de l’orage, de la pluie, des malades. La sécurité nous a fait imaginer mille plans. Mais non, je n’ai pas peur. Il est trop tard pour avoir peur. Je suis impatient. Tout se prépare, mais tout est encore mouvant. Le temps peut tout changer, un artiste peut avoir accident. » Thomas Jolly : “La cérémonie promet des surprises bien plus radicales que la présence ou pas d’Aya Nakamura” Pas de panique : Thomas Jolly a choisi plusieurs stars et pas une seule pour le 26… On ne demande même plus lesquelles, on sait depuis des mois maintenant qu’il ne le dira pas. Il n’y a que les péniches aujourd’hui dont Thomas Jolly est parfaitement sûr. Rendez-vous le 26. Et tout de suite après, c’est promis, il nous fera le « débrief », comme ils disent. Propos recueillis par Fabienne Pascaud / Télérama Dernier épisode… la semaine prochaine À voir, lundi 22 juillet sur France 2, les deux premiers épisodes du documentaire des frères Naudet sur la préparation des Jeux. Déjà disponibles sur france.tv.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 19, 2024 5:12 AM
|
Par Laurent Carpentier dans Le Monde, le 18 juin 2024 Avec la chorégraphe Maud Le Pladec, le directeur artistique orchestre, à Saint-Denis, les répétitions de la représentation qui doit être donnée sur les berges et les ponts de la Seine, le 26 juillet.
Lire l'article sur le site du "Monde" :https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/06/18/paris-2024-thomas-jolly-leve-un-pan-du-voile-sur-les-ceremonies-des-jeux-olympiques_6241007_3246.html
« Je ne vous cache pas que je passe des nuits où j’angoisse un peu… Et aussi des jours. » Le jour – le 7 juin – où l’on rencontre Thomas Jolly, l’homme choisi il y a deux ans pour organiser les cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024, l’Assemblée nationale n’a pas encore été dissoute. On imagine que, depuis, ses nuits ne sont guère meilleures. La perspective de retrouver, côte à côte à la tribune, le président de la République, Emmanuel Macron, la maire (socialiste) de Paris, Anne Hidalgo, et un premier ministre issu du Rassemblement national, n’est plus une chimère inenvisageable. Mais, pour l’heure, le metteur en scène qui a le vent en poupe (la rumeur le donne comme l’un des favoris pour l’Odéon-Théâtre de l’Europe à la rentrée) a d’autres questions en tête. Dans un hangar de banlieue au toit en béton armé et verre, près des voies ferrées de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), il vient découvrir les premiers pas d’une chorégraphie imaginée par Maud Le Pladec sur une musique de Victor Le Masne. Satisfaction visible à son sourire anguleux. Cinquante danseurs répètent les mouvements hachés et joyeux que la chorégraphe, longs cheveux châtains, paupières surlignées, visage encadré de bijoux argentés, ongles à l’identique, sur un survêtement noir aux trois bandes blanches, vient de leur montrer. C’est populaire et contemporain à la fois. Quelques minutes seulement, mais qui suffisent à imaginer l’énergie et la synchronicité de ce qui va être donné à voir lors de la cérémonie d’ouverture sur les berges et les ponts de la Seine, tandis que, sur des bateaux, défileront les délégations d’athlètes. « Pour les JO, la danse, c’est moi, sourit Maud Le Pladec, qui dirige actuellement le Centre chorégraphique national d’Orléans avant de prendre, en 2025, la direction du ballet de Lorraine à Nancy. C’est mon ADN. [comprendre : cette énergie, cette foule compacte de danseurs] Pas un pont, pas une berge qui ne sera habitée par un événement artistique. » « Hors du stade » Ces cinquante performeurs ne sont en réalité qu’une partie des quatre cents qui composeront le tableau travaillé ici en « petit » comité… Quatre scènes. Dix ou douze tableaux sur les berges. Trois mille danseurs professionnels au total, d’ici et de partout, de France et d’au-delà… Une centaine de bateaux. « Un théâtre rêvé nommé Paris. Et son fleuve, s’enthousiasme la chorégraphe. Et, pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, pas dans un stade, mais hors du stade. » C’était l’idée de Thierry Reboul, le Marseillais spécialiste de l’événementiel, directeur exécutif des cérémonies, des événements et de la marque Paris 2024. Thomas Jolly, directeur artistique, y a ajouté sa patte imaginative. Alors que, traditionnellement, le show suit le défilé très protocolaire des athlètes, il a persuadé ses commanditaires de mélanger les deux. Une double première. « Le show, la parade, les éléments du protocole, j’ai décidé de tout entremêler, glisse le metteur en scène habitué des spectacles gargantuesques et amateur de voies nouvelles pour escalader des sommets classiques. Faire que toute la cité danse, se synchronise. Jamais il n’y a eu de cérémonie qui ne soit pas dans un stade. Du coup, il n’y a pas de modèle. Il faut tout remettre en question en permanence. » Ses relectures de la trilogie d’Henri VI ou de Richard III de William Shakespeare ont fait date. Un Molière pour le premier, découpé en un presque feuilleton, et un sacre pour le second, dont il offre deux approches : R3m3 et L’Affaire Richard. Dans le hangar de Saint-Denis flotte un parfum de secret-défense. La presse a été conviée, mais avec moult précautions : embargo, pas de caméra s’il vous plaît (sauf pour les partenaires sponsors). Il s’agit de lever un coin du voile pour appâter sans rien dévoiler, de façon à maintenir le suspense et à garder la surprise. « Je suis un coffre-fort, s’amuse-t-il, gourmand. En ce moment, je suis mi-homme, mi-coffre fort. Entendre les fantasmes des gens, moi qui sais ce qui va se passer, ça me fait souvent sourire. » Réalités budgétaires A la tête du Centre dramatique national d’Angers, Thomas Jolly, 42 ans aujourd’hui, en a démissionné sitôt qu’il a été nommé directeur artistique de « la cérémonie la plus populaire de tous les temps » à l’automne 2022. Il a fait venir Maud Le Pladec dans la foulée pour travailler avec lui. Les deux se connaissent depuis longtemps – depuis dix ans déjà, lorsqu’ils étaient tout deux artistes associés au Théâtre national de Bretagne, à Rennes. En 2016, lorsque Thomas Jolly monte son premier opéra, Eliogabalo, de Cavalli, pour l’Opéra de Paris, c’est déjà à Maud Le Pladec qu’il fait appel pour les parties dansées. « Maud a une culture large de la danse », glisse-t-il en aparté, alors qu’en compagnie de Tony Estanguet, l’ancien champion de canoë-kayak et président du comité d’organisation des Jeux olympiques, il assiste – les deux hommes ne cachent pas leur plaisir – aux balbutiements du futur spectacle. « On a commencé à travailler sur les JO en décembre 2022, dit-il. La structure de la cérémonie a été posée en juin 2023. Et, depuis mars, cela devient concret. Les costumes sortent des ateliers, et l’on voit ici, pour la première fois, la danse de Maud épouser la musique composée par Victor Le Masne… » Entre-temps, le chemin n’a pas été simple. De septembre 2023 à février, le « récit » imaginé par l’homme de théâtre avec ses trois scénaristes comme les rêves de mise en scène ont été renvoyés au purgatoire de leur faisabilité. « Je voulais construire une tour Eiffel inversée, ça, ce n’était pas possible. » Il a fallu se confronter aux réalités budgétaires (pas forcément les plus compliquées) mais aussi aux codes de l’environnement, aux règles patrimoniales, aux mesures de sécurité. Et même aux lois de la physique. « Sur l’un des ponts [il ne dira pas lequel], on voulait faire un grand ballet de deux cents danseurs. Les experts ont calculé qu’avec la résonance, les vibrations du poids des danseurs, le pont ne résisterait pas. On a dû transformer le tableau. » De quoi faire douter ? Pas le genre du bonhomme. « Chaque spectacle que j’ai imaginé dans ma tête n’est jamais arrivé semblable à ce que j’imaginais. Non, ça ne crée pas de frustration : si une idée ne va pas jusqu’au bout, c’est qu’elle n’est pas bonne », assène-t-il. Sur le tapis de bal, Maud Le Pladec montre un nouveau pas à la bouillonnante assemblée réunie depuis une semaine dans cette salle de répétition improvisée. Au cinquième jour de répétition, étonnamment, de cette foule d’inconnus, on sent déjà émerger une troupe. Quelques pas en avant, des bras tendus, des entrelacs, un cri primal… On n’en saura pas plus. Teasing. Pour le reste, c’est : « Rendez-vous le 26 juillet. » Laurent Carpentier / LE MONDE Légende photo : Maud Le Pladec et Thomas Jolly, lors des répétitions des cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 7 juin 2024. PARIS 2024

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2023 9:31 AM
|
Par Marie-Aude Roux dans Le Monde - 18 juin 2023 Absent de la scène lyrique parisienne depuis 1985, le chef-d’œuvre de Charles Gounod est présenté jusqu’au 15 juillet dans la deuxième mise en scène du Français à l’Opéra de Paris. A l’actif de la production, un couple de chanteurs exceptionnels formé par Elsa Dreisig et Benjamin Bernheim.
Lire l'article sur le site du "Monde":
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/06/18/romeo-et-juliette-dans-l-ecrin-spectaculaire-de-thomas-jolly-a-l-opera-bastille_6178134_3246.html
Si autour de lui ne se pressaient pas personnalités – dont la ministre de la culture, Rima Abdul Malak – et médias télévisuels, Thomas Jolly pourrait se confondre avec la juvénile assemblée réunie mercredi 14 juin à l’Opéra Bastille à l’occasion de l’avant-première jeunes – réservée aux moins de 28 ans – du Roméo et Juliette de Charles Gounod, qui sera à l’affiche jusqu’au 15 juillet. La petite quarantaine du metteur en scène français ne lui a pas fait perdre les traits de l’adolescence. En 2016, la première incursion à l’Opéra de Paris de celui qui n’était pas encore le nouveau maître de la comédie musicale Starmania ou le grand chambellan des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 s’était soldée, avec Eliogabalo, de Cavalli, par un échec. Cette fois, avec Shakespeare, l’homme est sur son terrain. Il a également retenu la leçon lyrique apprise avec Fortunio, d’André Messager, à l’Opéra-Comique (2017) puis avec Macbeth Underworld, de Pascal Dusapin, au Théâtre de La Monnaie de Bruxelles (2019) : impossible de faire de l’opéra sans la musique. Est-ce d’avoir trébuché en 2016 sur les marches du Palais Garnier ? Thomas Jolly s’offre une revanche avec Roméo et Juliette en conviant le spectaculaire décor du grand escalier d’apparat de l’opéra parisien (conçu par Bruno de Lavenère) monté sur une tournette. Triple volée de marches, rampes cintrées et balustrades, femmes-torchères et candélabres scénarisent tour à tour le palais des Capulet, les ruelles, les soubassements du « bâtiment » s’engouffrant sous un pont, où s’embarquera – au sens propre – le drame, du mariage secret au sépulcre en passant par le lit conjugal. Après une sombre ouverture prémonitoire, qui voit des hommes en noir charger dans des charrettes les cadavres des rues victimes de la peste (Shakespeare fait brièvement allusion à l’épidémie à Vérone, précise le metteur en scène), la grammaire visuelle de Thomas Jolly s’inscrit dès la première scène du bal masqué au jardin des Capulet. Espaces fuligineux traversés d’une orgie lumineuse façon concert pop (de l’éclairagiste Antoine Travert), costumes hybridés de carnaval mêlant masques de commedia dell’arte et geste pictural, entre Bosch et Brueghel (Sylvette Dequest aux costumes), fureur épileptique des danseurs de waacking strictement chorégraphiés par Josépha Madoki sur la musique (une gestuelle volubile et violente, sensuelle, héritée des communautés gay, noire et afro-latino de Los Angeles). De vrais moments de théâtre Thomas Jolly l’affirme : pas question ici de livrer l’œuvre, absente au répertoire de l’Opéra de Paris depuis 1985, à une interprétation ou à une lecture nouvelle. Seulement « offrir à ce joyau du répertoire théâtral l’écrin scénique lui permettant d’être pleinement reçu ». Sans doute est-ce dans l’observance de cette prudence cardinale (d’un autre âge, même à l’opéra), autrement dit dans ce relookage « moderne » d’une vision traditionnelle que se noue le succès de la production, qui a soulevé le public d’enthousiasme. Et il est vrai que les tableaux, jouant comme avec le souvenir d’illustrations d’époque, séduisent : la mutine scène du balcon, entre chien (le flirt à cache-cache des amoureux) et loup (les Capulet à la recherche de Roméo) ; la convocation de fantômes ancrés dans le réel, qu’elle soit traitée sur le mode fantastique (la danse du voile dans la Ballade de la reine Mab) ou de l’effroi – Tybalt, mort, apparaissant à l’esprit troublé de Juliette. Les différentes atmosphères nocturnes, l’impressionnant réglage des combats entre mecs très énervés sont de vrais moments de théâtre. Tout comme le facétieux ballet des mariées derviches tourneurs, la sèche gifle de Capulet jetant à terre son enfant récalcitrante, ou encore l’effigie mortuaire de Juliette dans son flamboyant autel de bougies, avant la scène finale où seuls les candélabres brûleront dans la nuit. Thomas Jolly laisse respirer la musique, lui donne la main, la regarde s’épanouir. Il a, il est vrai, sur le plateau un couple d’amants resplendissant de jeunesse et de vie, de passion et de poésie. Force et ferveur A la tête de cette distribution qui fera date, le Roméo de Benjamin Bernheim tutoie les étoiles. Puissance, ampleur, finesse, élégance (un « Ah, lève-toi soleil » d’anthologie), le ténor français est dans la plénitude de ses immenses moyens. Son intelligence dramaturgique, sa grâce émouvante, et la séduction naturelle d’un timbre rond et soyeux enchantent. La Juliette d’Elsa Dreisig, qui fait ici une prise de rôle, est de la même eau. Gracieuse et fraîche, fragile et déterminée, elle partage avec Bernheim une intelligibilité prosodique rare, jusque dans de lumineux aigus portés avec force et ferveur. Du côté de leurs partisans, la Gertrude de caractère de Sylvie Brunet-Grupposo s’impose sans caricature tandis que le frère Laurent de Jean Teitgen confère au religieux une sorte de componction compassionnelle. Si le Mercutio d’Huw Montague Rendall tient sans faiblir son rôle hargneux de petite frappe, le Tybalt déjanté de Maciej Kwasnikowski se dressera sur les ergots d’une intonation un peu haute dans les aigus. Patriarche inflexible, le père Capulet de Laurent Naouri a la vocalité de pierre qui tuera sa fille. Quant au Stephano gavroche de l’irrésistible Lea Desandre, il fera tout simplement un tabac. Quelques décalages dans les chœurs aux taquets rappelleront que cette soirée était encore une ultime séance de travail. Dans la fosse, la direction de Carlo Rizzi se révélera aussi attentive à soutenir les voix que la richesse dramaturgique d’une partition qui signa en 1867 le dernier grand succès de Charles Gounod. Roméo et Juliette de Charles Gounod. Avec Elsa Dreisig, Benjamin Bernheim, Laurent Naouri, Jean Teitgen, Thomas Jolly (mise en scène), Bruno de Lavenère (décors), Sylvette Dequest (costumes), Antoine Travert (lumières), Josépha Madoki (chorégraphie), Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Paris, Carlo Rizzi (direction). Opéra Bastille, Paris. Jusqu’au 15 juillet. Operadeparis.fr Transmission en direct le 26 juin à 19 h 30 sur Culturebox (France.tv) et dans les salles UGC, CGR et des cinémas indépendants en France et en Europe. Le 8 juillet, à 20 heures, sur France Musique. Marie-Aude Roux / Le Monde Légende photo : « Roméo et Juliette », mis en scène par Thomas Jolly, à l’Opéra Bastille, à Paris, le 12 juin 2023. VINCENT PONTET/ONP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 3, 2022 5:49 PM
|
Propos recueillis par Eric Nunès dans Le Monde 3/12/22 « Le Monde » interroge une personnalité sur ses années d’études et son passage à l’âge adulte. Ce mois-ci, le metteur en scène Thomas Jolly, choisi pour orchestrer les cérémonies des Jeux olympiques de Paris en 2024, et dont l’adaptation de « Starmania » rencontre un grand succès, revient sur ses années de formation.
Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/campus/article/2022/12/03/thomas-jolly-metteur-en-scene-le-harcelement-au-college-n-a-fait-que-renforcer-celui-que-j-avais-envie-d-etre_6152775_4401467.html
« Généralement je m’ennuie après une minute trente », avertit Thomas Jolly lorsqu’on le rencontre dans le café qui borde La Seine musicale à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), quelques heures avant une nouvelle représentation de la comédie musicale Starmania qu’il a montée. Le metteur en scène hyperactif, âgé de 40 ans, prend néanmoins de son temps pour raconter son cheminement, depuis son enfance normande jusqu’à ses succès en cascade. Un parcours mené avec une énergie qu’il n’économise pas : après l’adaptation de Starmania, il prépare un Roméo et Juliette pour le Palais Garnier et sera le maître des cérémonies des Jeux olympique (JO) de Paris en 2024. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés JO Paris 2024 : pour Thomas Jolly, « on ne peut pas opposer sport et culture » Quel a été votre premier rendez-vous avec la scène ? D’aussi loin que je m’en souvienne, la première rencontre a lieu alors que je n’ai que 4 ou 5 ans. Cela se passe dans ma chambre d’enfant : j’ai pris dans la discothèque de mes parents une cassette audio, La Force du destin de Verdi. Ce n’est pas un ballet, mais je m’improvise chorégraphe, je fais des grands gestes avec les bras, je donne des indications à des danseurs imaginaires. C’est mon premier souvenir de scène, lié sans doute à ma pratique de la danse classique, qui n’a duré qu’un temps. Le théâtre est apparu un peu plus tard. Votre passion est-elle née dans l’enfance ? J’ai grandi à La Rue-Saint-Pierre, un tout petit village de Seine-Maritime situé entre Rouen et Dieppe : il y avait une école, une église, mais pas de magasin. Mes parents n’allaient pas à l’opéra, nous n’allions pas au théâtre, juste au cinéma une ou deux fois par an. Mais je me rappelle avoir vu un documentaire sur le Palais Garnier : j’ai 6 ans, cela fait deux ans que je fais de la danse dans la salle des fêtes du village. Je lève la tête et je dis à ma prof que je pars. Je lui explique que ce que nous faisons n’est pas assez beau, que l’endroit est moche. Moi, je voulais des tutus chatoyants, des dorures, un décorum fastueux, je voulais déjà monter Le Lac des cygnes, même si, à cette époque, je ne le connaissais pas ! Vos parents vous ont-ils encouragé ? Mes parents ont été géniaux car ils m’ont toujours laissé faire ce que je voulais : danse classique, piano, puis théâtre. Cela coûtait pourtant 700 francs (110 euros) par trimestre, une somme pour eux. La seule chose qu’ils me demandaient, c’était la réussite scolaire. Y a-t-il une influence familiale dans votre goût pour la scène ? Peut-être, mais je l’ai découverte plus tard. En 2005, alors que je suis élève à l’école du Théâtre national de Bretagne à Rennes, le directeur, Stanislas Nordey, m’accorde une carte blanche, c’est-à-dire la possibilité de monter mon propre spectacle. Je propose un projet autour du dramaturge Jean-Luc Lagarce. Pour le long monologue d’un personnage féminin, à la fin de la pièce, Nordey me suggère de choisir quelqu’un qui a du sens pour moi et je pense à ma grand-mère. Je lui propose, elle accepte et j’apprends qu’elle a toujours rêvé d’être actrice et qu’elle ne l’a jamais fait. Lire aussi Thomas Jolly, metteur en scène : « Quand ma grand-mère est entrée pour la première fois sur le plateau, j’ai pleuré à torrents » Est-ce qu’il y a quelque chose qui a sauté une génération ? Je ne sais pas ! Mais il y a un truc quand même, car depuis que c’est mon métier, ma mère s’est mise au théâtre, mon oncle également. Il y a une filiation… à l’envers. Comment êtes-vous passé de la danse classique au théâtre ? Enfant, ma mère m’a offert un livre de Pierre Gripari, Sept farces pour écoliers, que j’ai monté dans ma chambre, où je préparais des spectacles pour mes parents. Je jouais et surtout je mettais en scène. Dès le début de ma vie, j’ai voulu organiser le monde autour de moi, je voulais diriger. A l’école, étiez-vous un bon élève ? Le primaire passe vite et bien dans ma petite école municipale. Je saute même la classe de CE1. Ensuite arrive le collège. L’établissement, la période… tout est atroce, sordide. Entre nous, les ados, on est des chiens. Je me prends de plein fouet les regards sur moi, sur ma féminité, sur mes goûts et je ne comprends pas. Ma mère m’a raconté cette anecdote que je trouve mignonne et en même temps d’une tristesse folle : un soir de l’année de 6e, je rentre et raconte que je me suis fait traiter de « pédale » dans la cour. Je ne comprends pas : quelle est cette blague en lien avec un vélo ? Je demande à ma mère. Et discrètement, elle part pleurer. Vous avez été un élève harcelé ? Clairement. Mais j’ai nourri, durant ces années, non pas une rancœur, mais une force. Je me suis dit : je suis comme ça et c’est tout. Je ne vais pas changer, au contraire. Je me souviens aussi avoir été fan des chaussures Dr Martens, et j’en voulais des jaunes ! J’ai eu une paire pour mon anniversaire et les porte en classe. Dans un collège de campagne au début des années 1990, c’est une déflagration. Tout le monde ne parle que de ça. J’ai été harcelé, poussé dans les couloirs, enfermé dans les chiottes par les grands, désapé par ces types qui veulent savoir si je suis un garçon ou une fille. Je suis brutalisé mais cela ne fait que renforcer celui que j’ai envie d’être. Je développe de nouvelles compétences, par le théâtre notamment, qui est un espace de liberté et d’expression, mais aussi un exutoire. Où jouez-vous alors ? J’intègre à 11 ans, en 1993, la compagnie Théâtre d’Enfants dans la banlieue rouennaise. Je suis le seul rural du groupe, je joue avec les gosses de riches de l’agglomération, et je me sens plus proche d’eux que de ceux de mon collège. En fin de 3e, j’intègre le lycée Jeanne-d’Arc de Rouen qui change ma vie : je suis avec une autre jeunesse, plus ouverte, en lien avec des activités culturelles. Enfin, en classe de 1re, je suis admis au sein de la classe théâtre du lycée : je suis alors dans mon monde. Je vais au théâtre chaque semaine voir des spectacles, dont ceux de Stanislas Nordey, qui aura un rôle plus tard dans ma carrière. Je bosse avec des acteurs professionnels, je fais chaque semaine plus de dix heures de théâtre. J’obtiens mon baccalauréat de justesse grâce à une moyenne de 19 sur 20 en théâtre, en théorie et en pratique. Ensuite, je choisis logiquement de faire une licence arts du spectacle à l’université de Caen. La faculté me laisse beaucoup de temps, je rencontre plein de gens, on monte des compagnies, des spectacles. Nous avons même les clefs de la Maison de l’étudiant qui dispose d’un petit théâtre, et après la licence, je suis admis au sein de l’école du Théâtre national de Bretagne [TNB], à Rennes, dirigé par Nordey. Vous gardez de bons souvenirs de votre passage à l’école du TNB de Rennes ? La première année, en 2003, c’est le bonheur absolu, je navigue de stage en stage, je suis certain d’être à ma place. Puis, au début de la deuxième année, je traverse une forme de crise, je pense alors qu’être acteur ce n’est pas simplement être un bon technicien, mais qu’il faut vivre, ressentir. A la fin de la troisième et dernière année, l’école prépare un spectacle de sortie. Il y a dans la pièce un personnage nommé Minus. Comme son nom l’indique, il est minuscule, il a trois lignes de texte. C’est moi qui en hérite. Je ne le vis pas bien du tout. A la dernière heure du dernier jour de la dernière année, Nordey dresse le bilan de ce que nous avons accompli. Il me lance : « Thomas, cela fait trois ans que tu es là, je ne sais toujours pas qui tu es. » Quelle a été votre réaction ? Je décide de faire mon théâtre et d’écrire mon histoire. Mais je me retrouve sans boulot. Puisque mon téléphone ne sonne pas, je décide de monter ma compagnie. Je réunis des gens que j’estime amicalement et artistiquement, des anciens de l’université de Caen ou du TNB, avec lesquels je monte, en 2006, Arlequin poli par l’amour, de Marivaux. Lire le portrait : Article réservé à nos abonnés Avignon : Thomas Jolly, une certaine idée du théâtre populaire Nous nous installons dans des locaux désaffectés à Gaillon [Eure] et le théâtre de Cherbourg [Manche] nous programme : la compagnie La Piccola Familia est née. C’est mon premier spectacle. Seize ans après, il se joue toujours – il est actuellement à Mulhouse [Haut-Rhin], jusqu’au 30 décembre. C’est une aventure unique que j’ai lancée à 24 ans. Ce spectacle lance votre carrière. Suivront « Henry VI », « Thyeste »… Des créations où vous mélangez les genres et les références. Comment s’est construit votre paysage culturel ? J’ai grandi avec la discothèque de mes parents. J’y ai trouvé Verdi, mais aussi Boney M, Les Innocents et Francis Cabrel. Adolescent, je regarde M6, des clips, des émissions musicales. Cela forge une culture musicale éclectique. Et puis il y a le jeu vidéo, la télévision… J’utilise cette culture pop parce que c’est la mienne. Vous présentez aujourd’hui un nouveau « Starmania », qui met en scène des jeunes gens en rébellion. Y a-t-il, dans cet opéra-rock, des résonances avec vos 20 ans ? J’ai retiré tout l’aspect futuriste un peu cheap de l’œuvre pour me concentrer sur la matière noire et l’énergie du désespoir. Tous les personnages ont le mal de vivre, sont dans une quête de sens de leur existence. Ils ne savent pas comment se réaliser dans un monde qui ne leur ressemble pas. Cela passe par la violence, l’image qu’on veut avoir de soi, la volonté d’accéder à la notoriété par le mensonge, la brutalité, le sexe. Starmania est une œuvre sur la dépression. C’est cette force sombre qui fait le succès de Starmania depuis quarante ans. 20 ans a-t-il été pour vous le plus bel âge ? Le plus bel âge est celui qui arrive. Je ne l’ai pas encore. Eric Nunès Légende photo : Le metteur en scène Thomas Jolly, à Paris, le 3 novembre 2022. JOEL SAGET / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2022 9:12 AM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama - 18 nov. 2022 Choisi pour concevoir les cérémonies des jeux Olympiques, Thomas Jolly a préféré quitter la direction du Centre dramatique national d’Angers. En interne, on lui reprochait notamment ses ambitions de spectacles démesurés. À tort ? À l’heure où une jeune génération de metteurs en scène – recélant force talents – renâcle à diriger des centres dramatiques nationaux (CDN), la récente démission de Thomas Jolly de son mandat au Quai, CDN des Pays-de-Loire, à Angers, pose des questions auxquelles il faudra répondre. Thomas Jolly ne pouvait en effet mener à bien deux missions qui – à des échelles différentes – participent du rayonnement culturel de la France : œuvrer et créer sur le territoire grâce au CDN, versus concevoir les cérémonies des JO 2024 pour représenter l’Hexagone sur les écrans du monde entier. Lire aussi : “Starmania” : un opéra rock qui résonne de façon troublante avec l’actualité 4 minutes à lire Comme pour Starmania (dont il avait signé le contrat de mise en scène avant son recrutement au Quai), il n’a pas résisté à cette nouvelle opportunité de créer de grands spectacles populaires. Doit-on le lui reprocher ? Évidemment non, même si l’on regrette que son expérience au sein du centre dramatique, commencée début 2020, en pleine pandémie, soit si brutalement interrompue. Mais on peut aussi trouver injustes les critiques qui le ciblent en interne, relatées dans l’enquête de Libération du 15 novembre dernier. Les moyens de mûrir leurs ambitions Il ferait des spectacles démesurés pour se mettre en avant ? Jusqu’à preuve du contraire, les trente-huit centres dramatiques nationaux existent pour donner aux artistes les moyens de mûrir leurs ambitions. S’il faut désormais préférer le modèle de la compagnie pour prendre des risques et monter des coproductions audacieuses, l’avenir de ces maisons de théâtre public risque d’être très… confidentiel. Novice dans son costume de directeur, Thomas Jolly a sans doute commis des erreurs, mais il appartient à une génération tentée par de multiples expériences, qu’elles soient scéniques (théâtre, opéra), médiatiques ou cinématographiques, comme pour Caroline Guiela Nguyen dont on attend toujours l’officialisation de la nomination à la tête du Théâtre national de Strasbourg. Et le ministère de la Culture devra sans doute reformuler le contrat de confiance pour déclencher, chez ces jeunes artistes, le désir de postuler. Lire aussi : Thomas Jolly démissionne du CDN d’Angers : “Je ne voulais pas qu’on me reproche de cumuler”2 minutes à lire Légende photo : Le metteur en scène Thomas Jolly, à Paris le 3 novembre 2022. Photo Joel Saget/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 10, 2022 7:33 AM
|
Publié le 9 nov. 2022 dans Ouest-France Choisi pour créer les cérémonies d’ouverture et de clôture des JO de Paris 2024, en plus de la comédie Starmania qu’il met en scène, le directeur du Quai a annoncé ce mercredi soir 9 novembre aux salariés qu’il ne pouvait plus assurer ses fonctions à Angers.
La nouvelle est tombée tardivement ce mercredi 9 novembre sur la messagerie des salariés du Quai. Le metteur en scène Thomas Jolly, qui dirige le centre dramatique national angevin depuis janvier 2020, a averti tous ses collaborateurs qu’il était contraint de démissionner de ses fonctions. C’est la rançon d’un trop grand succès pour l’artiste âgé de 40 ans qui a été choisi en septembre dernier pour mettre en scène les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024 et qui inaugurait ce mardi à La Seine musicale, à Paris, la nouvelle version de la comédie musicale Starmania qu’il a été chargé de dépoussiérer.... (suite de l'article réservée aux abonnés) Autre article publié le 10/11 Appelé à occuper la fonction de directeur artistique pour les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Thomas Jolly a annoncé mercredi soir son départ du Quai d’Angers, le Centre Dramatique National (CDN) où il avait été nommé directeur en janvier 2020 : Au lendemain matin de cette annonce, la Ville d’Angers salue l’artiste dans un communiqué intitulé : « Merci pour l’émotion, merci pour l’ambition… et bonne chance pour la suite Thomas Jolly ». Voici l’intégralité du texte : « Contrarié par la crise sanitaire, qui a durement touché les structures culturelles, le projet de Thomas Jolly pour le Quai-CDN a su demeurer ambitieux et s’est adapté continuellement. Dès l’été 2020, une programmation inédite, intitulée « Quai l’été », a permis au public et aux professionnels du spectacle de se retrouver après des mois sans culture vivante. Au cours de ces trois années, le public aura pu vibrer et rêver dans un lieu mis en mouvement. » LIRE AUSSI | Thomas Jolly contraint de démissionner de la direction du théâtre Le Quai « Thomas Jolly a dirigé l’équipe du CDN dans un lieu souvent fermé, accueillant les artistes quand il l’a pu, mais jamais cet enfant du théâtre public n’a renoncé à son ambition d’une « Maison commune », d’un théâtre ouvert aux spectacles et aux rencontres, bouillonnant de création et d’audace pour permettre à chacun de s’émouvoir et de se questionner grâce au théâtre. » Un théâtre populaire, exigeant et festif « À Angers, avec l’équipe du Quai, il a accompagné, par une étroite collaboration avec les partenaires locaux, la mise en place du Cycle d’orientation professionnelle et de la Classe préparatoire aux études supérieures visant à la professionnalisation des élèves en théâtre du Conservatoire à rayonnement régional ; dans le domaine de l’écriture et avec la participation du public, il a créé le DESC (Département des Écritures pour la Scène Contemporaine) ; il a favorisé le lien avec le public par l’aménagement chaleureux d’un forum mis « en scène » à qui il a donné toute sa place de lieu de rencontre convivial et d’échange ; il a permis au public et aux professionnels de se retrouver avec le Go Festival. » « Avec son projet d’un théâtre populaire, exigeant et festif, il a tenu à relever le défi de donner l’envie à tous de « vouloir aller au théâtre ». Pari réussi avec ses dernières créations : « La nuit de Madame Lucienne », « Le Dragon » et surtout cet incroyable marathon théâtral proposé en juin 2022 : la tétralogie « H6R3 » de Shakespeare (Henry VI & Richard III), trésor du théâtre universel en lien avec l’histoire d’Angers, qui a été jouée en une seule fois et durant 24 heures. « Si le monde est un théâtre, comme le dit Shakespeare, la ville d’Angers est fière d’avoir été la scène des créations et actions de Thomas Jolly, notamment de cette épopée shakespearienne pionnière et inédite, liant patrimoine et création. Les spectateurs chanceux qui l’ont vécu resteront marqués par cette expérience théâtrale intense », évoque Nicolas Dufetel, Président de l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Le Quai-CDN et Adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d’Angers. « Aujourd’hui, la ville d’Angers est partagée entre l’émotion ressentie au départ de l’une de ses étoiles et la fierté que celle-ci ait brillé en Anjou et brille bien au-delà désormais », souligne Jean-Marc Verchère, maire d’Angers.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 21, 2022 8:29 AM
|
Par Nicolas Lepeltier dans Le Monde - 21 septembre 2022 Les organisateurs des Jeux olympiques veulent faire de ce spectacle au cœur de la capitale « un moment de rassemblement et de fierté pour tous les Français ». Le dispositif sécuritaire n’est pas encore arrêté, mais la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) de Paris 2024 a au moins un directeur artistique. Le Comité d’organisation des Jeux (Cojop) a porté son choix, mercredi 21 septembre, sur l’acteur et metteur en scène Thomas Jolly. Après le chorégraphe Philippe Découflé (Albertville 1992) et le réalisateur Danny Boyle (Londres 2012), c’est donc un jeune artiste (40 ans), directeur du centre dramatique du Quai, à Angers, qui a été retenu pour animer les différents plateaux artistiques d’une cérémonie qui se déroulera en plein cœur de Paris, avec la Seine comme fil conducteur. « Pour des soucis de cohérence », avance le Cojop, Thomas Jolly sera également chargé de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques (du 28 août au 8 septembre) et des deux cérémonies de clôture. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Amélie Oudéa-Castéra : « Pour l’ouverture des JO, l’enjeu est d’élever notre niveau sur la sécurité » « Thomas Jolly représente le spectacle vivant, la jeune garde théâtrale, il a déjà fait preuve d’audace. Il est capable de mêler des choses classiques très pointues à d’autres plus grand public, comme avec Starmania, qui sera relancé dans quelques semaines. Il a cet éclectisme cher à Paris 2024 », vante Thierry Reboul, le directeur des grands événements et des cérémonies à Paris 2024. Thomas Jolly a été sélectionné parmi un panel de soixante-dix profils du monde de la culture approchés par les équipes de Paris 2024. Le jeune dramaturge s’est notamment fait connaître pour sa mise en scène en 2010 de l’intégralité de la trilogie Henri VI de William Shakespeare, qui lui vaudra un Molière en 2015. Sa pièce Thyeste, de Sénèque, fait l’ouverture du Festival d’Avignon en 2018. Et sa tétralogie de Shakespeare – vingt-quatre heures de théâtre – au Quai cette année le consacre parmi les metteurs en scène en vue de sa génération. Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Henry VI », l'épopée de Thomas Jolly éclaire la nuit d'Avignon « Thomas Jolly, c’est une histoire de rencontres. Ce qui m’a frappé, c’est sa personnalité, énonce Tony Estanguet, le patron du Cojop. Dès les premières discussions, il m’a embarqué avec ses idées sur les tableaux et les univers qu’on pourrait présenter lors de la cérémonie. » Sur et autour de la Seine Rompu aux marathons scéniques, Thomas Jolly aura pour tâche, dans les prochaines semaines, de s’entourer d’une équipe d’auteurs et de talents scénographiques, chorégraphiques et musicaux afin de créer un spectacle vivant sur et autour de la Seine. Il aura carte blanche, assure Tony Estanguet. « No limit, dans le budget imparti, précise le triple champion olympique de canoé. Je veux que la créativité artistique française s’exprime pleinement à l’occasion de ces cérémonies. » Les équipes de Paris 2024, qui affirment avoir réalisé « un gros travail sur le récit national avec des philosophes et des historiens », et Thomas Jolly doivent désormais réfléchir à la mise en scène opérationnelle de cette cérémonie ; en clair : savoir quelle histoire dérouler le long des 12 kilomètres de quai. Les grandes lignes narratives seront détaillées « au printemps », espère le patron du Cojop. Les organisateurs des Jeux de Paris 2024 veulent faire de la cérémonie d’ouverture « un moment de rassemblement et de fierté pour tous les Français ». Voire un marqueur de l’histoire de l’olympisme, comme l’avait fait il y a trente ans la cérémonie des Jeux d’hiver d’Albertville par Philippe Découflé. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Jeux olympiques 2024 : le « défi sécuritaire » de la cérémonie d’ouverture sur la Seine Reste la question, épineuse, du coût. Une enveloppe de 137 millions d’euros est pour l’instant inscrite au budget de Paris 2024 pour les quatre cérémonies des JO. Elle doit être affinée d’ici au conseil d’administration du Cojop du 12 décembre. Une rallonge n’est pas exclue si le dispositif sécuritaire de la cérémonie d’ouverture devait être réévalué. En juillet, l’Elysée et le ministère de l’intérieur avaient affirmé qu’il serait dimensionné quand le projet artistique de la cérémonie serait lui-même défini. Il reste désormais au préfet de police, Laurent Nunez, à mettre en scène la chorégraphie entre les différents services de sécurité concernés. De 90 euros à 2 700 euros pour assister à la cérémonie d’ouverture La jauge du public pouvant assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques le 26 juillet 2024 fait toujours l’objet d’« instructions » entre les équipes du Comité d’organisation de Paris 2024 (Cojop) et les services de l’Etat, font savoir les différentes parties prenantes. S’il semble acquis que près de 100 000 spectateurs payants pourront assister au spectacle sur les quais bas, des incertitudes demeurent sur la jauge admise pour la partie haute des quais (entrées gratuites) : 400 000 à 500 000 personnes sont espérées par les organisateurs. Un chiffre qui doit être affiné pour des raisons de sécurité. La grille tarifaire des billets à la cérémonie d’ouverture a, elle, été communiquée mardi 20 septembre : il en coûtera de 90 euros à 2 700 euros pour assister au spectacle sur les quais bas de la Seine. Nicolas Lepeltier / Le Monde Légende photo : Thomas Jolly, en septembre 2015, au Théâtre national de Bretagne. JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 23, 2022 8:31 AM
|
Par Fabienne Darge (Angers, envoyée spéciale) dans Le Monde (22 janvier 2022) Légende photo : Clémence Boissé, Théo Salemkour et Damien Marquet, dans « Le Dragon », au Quai, à Angers, le 17 janvier 2022. NICOLAS JOUBARD Au Quai d’Angers, le metteur en scène tire de la pièce d’Evgueni Schwartz une satire jouissive de la servitude volontaire.
Il crache du feu et flamboie sans vergogne, ce Dragon que met en scène Thomas Jolly. Pour sa première création en tant que directeur du Quai, le centre dramatique national d’Angers, le jeune metteur en scène surdoué signe un spectacle réjouissant et fédérateur, qui mêle le show et la fable politique, et a emballé le public lors de la première, le 18 janvier. Thomas Jolly y montre une nouvelle fois sa capacité à réinventer un théâtre populaire pour aujourd’hui, sans céder sur une forme d’exigence. Sa première bonne idée est d’être allé retrouver cette pièce merveilleuse et rarement montée sous nos latitudes. Le Dragon a été écrit en 1944 par le journaliste, écrivain et dramaturge russe Evgueni Schwartz (1896-1958). Celui-ci n’était pas trop en odeur de sainteté auprès des autorités soviétiques, et ce, depuis les années 1930, quand il avait signé des pièces inspirées de contes d’Andersen qui faisaient clairement référence à la réalité de son pays sous la coupe de Staline. Politique et satirique Héros de guerre pour avoir participé, en 1941, à la défense de Leningrad, il ne s’est pas tenu tranquille pour autant et, en 1944, il a écrit Le Dragon, qui a été aussitôt interdit après sa première représentation, la même année. Il faut dire que, sous couvert du conte, le Russe faisait feu aussi bien en direction du nazisme que du stalinisme. L’amusant, dans l’affaire, c’est que Schwartz et son Dragon ont été réhabilités après la guerre par les brechtiens français, notamment le metteur en scène Benno Besson, qui signe la version française sur laquelle s’est appuyé Thomas Jolly (en la retravaillant par endroits). Lire aussi Thomas Jolly, metteur en scène : « Quand ma grand-mère est entrée pour la première fois sur le plateau, j’ai pleuré à torrents » Il était une fois, donc, une ville sur laquelle régnait, depuis quatre siècles, un terrible dragon à trois têtes. Quand tout commence, les habitants ont renoncé depuis bien longtemps à combattre le monstre et lui paient un lourd tribut, lui offrant la plupart de leurs ressources. Chaque année, ils lui sacrifient également une jeune fille, qui meurt de dégoût après la nuit de noces. Cette année-là, c’est la noble et douce Elsa, la fille de l’archiviste de la ville, qui a été choisie. Elle s’est résignée à son sort, comme toutes les autres. Mais voilà qu’arrive dans la cité un homme providentiel, « héros professionnel » répondant au nom de Lancelot. Le preux chevalier défiera le dragon et le terrassera. Une fois le monstre abattu, la monstruosité n’a pas disparu pour autant. Elle a seulement changé de visage Si la pièce s’en était tenue là, elle aurait pu être une œuvre épique édifiante, charmante mais sans grand intérêt. C’est sa deuxième partie qui lui donne toute sa profondeur et sa dimension politique et satirique. Car, une fois le monstre abattu, la monstruosité n’a pas disparu pour autant. Elle a seulement changé de visage. L’hydre n’a plus trois têtes mais cent, mais mille. Le mal est en chacun. Le dragon, d’ailleurs, avait prévenu Lancelot : « L’âme humaine est vivace. Coupe le corps d’un homme en deux, il crève. Mais, si tu lui taillades l’âme, il ne meurt pas. Il devient docile. Tu ne rencontreras jamais nulle part des âmes comme celles qui végètent dans ma ville : des âmes culs-de-jatte, des âmes manchotes, sourdes, muettes, des âmes damnées. (…) Des âmes trouées, des âmes vendues, des âmes brûlées, bossues, châtrées, et surtout corruptibles, toutes ! Des âmes mortes ! » Théâtralité superlative Mais l’héroïsme aussi, de ce fait, change de visage et s’adapte. On ne racontera pas la suite. Dans ce Dragon se niche une magnifique réflexion sur la servitude volontaire, le fantasme de l’homme providentiel, la fin du courage et les voies pour retrouver le goût du combat. Et c’est un bonheur que de (re)découvrir une pièce pareille, à l’heure où tant d’œuvres prétendument politiques, platement réalistes et bêtement dénonciatrices, donc inutiles, sont produites. L’arme du fantastique, du merveilleux, de la métaphore a sa puissance, un peu trop oubliée de nos jours. Et ce Dragon est bien entendu du pain bénit pour Thomas Jolly, qui lui permet de déployer une théâtralité superlative et jouissive. Il y a toujours un côté grand spectacle assumé chez le metteur en scène, mais on est bien au théâtre, et les effets spéciaux, s’il y en a, relèvent d’un artisanat, donc d’une poésie, et pas de la grosse machine hollywoodienne. Ce qui n’empêche pas le spectacle de lancer des clins d’œil du côté de Harry Potter, de Tim Burton et de La Famille Addams. Les costumes, les maquillages, l’atmosphère un peu gothique, la musique de Clément Mirguet, les lumières d’Antoine Travert, le superbe décor, à la fois caverne aux livres et parchemins et antre du dragon, signé Bruno de Lavenère : tout concourt à cette fantaisie noire et onirique, autant que débridée. Idem du côté des acteurs, dans ce théâtre de troupe où brillent pourtant de belles individualités, à commencer par Hiba El Aflahi dans le rôle d’Elsa, qui porte ce personnage de jeune fille cheminant sur la voie de sa libération – et de celle des autres – avec beaucoup d’émotion et d’intensité intérieure. Le Lancelot de Damien Avice, lui, déjoue avec humour les codes du héros romantique. Même si certains comédiens poussent un peu loin le curseur du burlesque délirant, à l’image de Bruno Bayeux dans le rôle du bourgmestre (mais il le fait très bien), c’est toujours un plaisir de voir un ensemble tel qu’on en voit rarement sur les plateaux aujourd’hui. Avis aux grincheux, le ventre est toujours fécond d’où peut sortir la bête immonde d’un théâtre désespérément naturaliste. Mais Thomas Jolly est là pour enfourcher le dragon échevelé d’un art dramatique flamboyant, qui n’a pas dit son dernier mot face aux assauts des séries et du cinéma à grand spectacle. Le Dragon, d’Evgueni Schwartz (traduit du russe par Benno Besson), mise en scène de Thomas Jolly. Au Quai, centre dramatique national d’Angers, jusqu’au 25 janvier. Tournée jusqu’à fin avril, au Théâtre national de Strasbourg, du 31 janvier au 8 février, puis Charleroi (Belgique), Martigues (Bouches-du-Rhône), Grenoble, La Rochelle, Rouen, Paris (Grande Halle de La Villette), du 27 au 30 avril, et Lille. Fabienne Darge(Angers, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 15, 2022 6:19 AM
|
Par Valentin Pérez dans Le Monde - 15 janvier 2022 Légende photo : Thomas Jolly, âgé de 4 ans, en 1986. « A cet âge-là, je commençais déjà à mettre en scène ma famille et mes copains dans des spectacles à la maison », raconte-t-il. THOMAS JOLLY Le metteur en scène, remarqué très jeune, monte la pièce « Le Dragon » à Angers et s’apprête à recréer « Starmania » à la Seine Musicale. Il se souvient des spectacles de son enfance et de son aïeule, qui aurait voulu être une actrice. « Me voici lors de ce qui doit être le réveillon de Noël 1986, en Normandie. J’ai 4 ans et les cheveux encore raides. J’aime ce canapé en velours, ces petits chaussons et ce costume brillant que m’avait fabriqué ma grand-mère Denise. Plus tard, il y aura d’autres costumes pour d’autres Noël : je me souviens notamment d’un modèle tout d’or et d’argent… A cet âge-là, je commençais déjà à mettre en scène ma famille et mes copains dans des spectacles à la maison, à La Rue-Saint-Pierre, un village de Seine-Maritime. Avant que je ne m’attaque à Sept farces pour écoliers, de Pierre Gripari, que m’avait offert ma mère vers 6 ans, je montais des scènes de dessins animés. J’ai de grands souvenirs d’Astérix et Cléopâtre, notamment, où une amie jouait le goûteur quand c’est moi qui incarnais Cléopâtre ! J’allais régulièrement en vacances chez mes grands-parents, du côté de Saint-Martin-du-Vivier. Mon grand-père donnait dans leur maison des cours de catéchisme à des enfants, je les voyais débarquer le mercredi et, moi qui n’ai pas reçu d’éducation religieuse, j’étais à côté, écoutant d’une oreille sans bien comprendre. Ma grand-mère, elle, avait été infirmière. Ah, ma grand-mère… Une femme très belle, un côté fantasque que j’ai toujours aimé. Des foulards, des bijoux, des chapeaux, des gants, des couleurs… Elégante. « Je pensais à quel point nous, gens de théâtre, avions déjà perdu, à 20 ans, la dimension exceptionnelle de ce que c’est que d’entrer en scène. » A la fin de mes études au Théâtre national de Bretagne, en 2005, Stanislas Nordey, qui était le directeur, nous a donné carte blanche pour monter une pièce. J’ai choisi La Photographie, de Jean-Luc Lagarce, un texte peu joué autour de l’amitié, cette relation complexe qui reste pour moi un mystère. La pièce raconte l’histoire de sept anciens amis qui ont vécu un drame. Avec une absente, Catherine. Les membres de ma promotion, âgés de 20 à 25 ans, jouaient les personnages, et je voulais qu’on imagine que ces jeunes étaient en réalité des morts et que cette Catherine, qui a un monologue, était la seule à avoir survécu. Pour cela, il fallait une actrice plus âgée. “Demande à Isabelle Huppert”, m’a suggéré Nordey, alors que je n’étais qu’un étudiant de 23 ans. J’ai eu une autre idée : et si je proposais à ma grand-mère ? Sans trop y croire, je l’appelle et elle me répond : “Oui, bien sûr, j’arrive.” J’étais ému. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Thomas Jolly, le théâtre comme principe vital Sur scène, je lui demande de partir du fond du plateau, de venir s’asseoir sur une chaise à l’avant-scène. Elle devait demeurer statique, silencieuse, pendant que le texte du monologue était projeté derrière elle et que résonnait L’Ile des morts, de Rachmaninov. Quand elle est entrée pour la première fois sur le plateau, pendant les répétitions, j’ai pleuré à torrents. e pensais à quel point nous, gens de théâtre, avions déjà perdu, à 20 ans, la dimension exceptionnelle de ce que c’est que d’entrer en scène. Je la voyais dans une grande vulnérabilité parcourir les vingt mètres que j’avais tracés et cela me terrassait. Lors d’un déjeuner, je l’ai encore remerciée d’avoir accepté. C’est là qu’elle m’a confié que, plus jeune, son premier rêve était de devenir actrice. J’étais bouleversé. Peut-être est-ce là l’une des clés de ma vocation ? Est-ce que le désir de jeu passe de façon filiale, de manière souterraine ? Dans cette famille où personne n’allait au théâtre ou à l’opéra, c’est comme si j’avais hérité, sans en avoir conscience, d’un désir frustré pour le faire enfin aboutir. » Le Dragon, d’Evgueni Schwartz, mis en scène par Thomas Jolly. Au Quai d’Angers, du 18 au 25 janvier. Puis en tournée. Valentin Pérez
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 9, 2024 4:03 AM
|
Propos recueillis par Fabienne Pascaud dans Télérama - 9 septembre 2024 Il a ébloui le monde en orchestrant les cérémonies des Jeux de Paris 2024. Alors que la parenthèse olympique se referme, le metteur en scène fait le bilan de deux années de travail fortes en émotions. Quatre cérémonies olympiques durant, il aura étonné, enchanté, rassemblé tous les publics. De Paris, de France, du monde. Magicien d’une démesure généreusement partagée. Comme au théâtre, où monter l’intégrale du Henri VI de Shakespeare en dix-huit heures n’a pas fait peur à Thomas Jolly, 42 ans aujourd’hui. Pour le Centre dramatique d’Angers qu’il dirige jusqu’en 2022, il y ajoute même Richard III, qu’il interprète avec insolence : vingt-quatre heures de spectacle fracassant. Thomas Jolly quittera quand même Angers. Le bosseur inspiré au style tout ensemble ténébreux et flamboyant est trop demandé. Pour la comédie musicale Starmania, pour l’opéra Roméo et Juliette à l’Opéra Bastille. Et vient encore la nomination à la direction artistique des jeux Olympiques ! Il démissionne pour ne pas troubler davantage ses équipes. L’artiste a tous les courages, et pas seulement une énergie passionnée et un imaginaire délirant. Il l’a prouvé cet été. Vous avez fait rayonner les JO. Êtes-vous sportif ?
Pas du tout. Pas de sport en salle, pas de piscine. Du ruban, autrefois, ma passion ; mais j’étais le seul garçon. J’avais déjà arrêté la danse enfant, quand j’avais appris que je ne porterais pas de tutu ! Quand j’entends les sportifs parler du geste parfait, de la qualité de la respiration, de la concentration, je vois des points communs avec les acteurs, et une même philosophie. Il ne s’agit pas de prôner la perfection du corps, mais l’épanouissement de l’être au monde. Pourquoi ne ferions-nous pas nous aussi une coupe du monde du spectacle vivant ? Comme au temps des Grecs. Les gradins des JO ressemblent à ceux d’un théâtre.
La direction artistique des JO a-t-elle été votre aventure la plus excitante ?
La plus dense, la plus vertigineuse, la plus complexe, oui. C’est Thierry Reboul, directeur exécutif de Paris 2024, qui a eu la magnifique idée de la cérémonie d’ouverture sur la Seine, de sortir la suivante des stades où cela se faisait traditionnellement pour mettre les festivités dans la ville, épreuves sportives comprises. En septembre 2022, quand il m’en a proposé la direction artistique, j’ai immédiatement pensé que j’en étais incapable, mais j’ai eu confiance en sa folie. Ce projet démesuré n’avait pas d’équivalent et paraissait irréalisable vu la somme des contraintes climatiques, techniques, patrimoniales, financières, sécuritaires. Bizarrement, je me fais davantage confiance quand je ne maîtrise pas l’aventure au départ. J’aime travailler, et un travail acharné permet toujours de trouver.
Avez-vous conçu les quatre cérémonies comme des mises en scène de théâtre ?
J’aime raconter des histoires. Dans mes spectacles, je donne toujours une place énorme à la fiction. Le théâtre est le seul art qui donne plus de poids au « croire » qu’au « savoir ». Mais quelle histoire raconter pour ces JO, sachant que nous allions travailler sur la Seine devant des lieux symboliques, Conciergerie, Notre-Dame ou l’Assemblée nationale ? Comme au théâtre, où je pars toujours d’un texte, je me suis vite entouré d’auteurs complémentaires et différents que j’estimais – la scénariste Fanny Herrero, la romancière Leïla Slimani, l’historien Patrick Boucheron et un jeune dramaturge qui a souvent travaillé avec moi, Damien Gabriac. L’essentiel de notre récit devait tourner autour de cette simple thématique : « Bonjour à tous les pays, bienvenue en France, voilà ce que nous sommes. » Mais qu’est-ce que la France ? Emmanuel Macron, qui m’avait reçu à l’Élysée pour me féliciter de ma nomination par le CIO, m’a répondu : « Un récit en perpétuel mouvement dans le grand récit mondial. » Exactement ce que je pensais déjà. Commence alors avec les auteurs la période la plus excitante, la plus libre : l’écriture collective des cérémonies qu’il s’agissait de concevoir globalement sans plaquer de clichés.
La pluralité crée de l’unité, c’est une leçon que j’ai tirée des JO : l’adhésion populaire qu’ils ont suscitée vient de là. Selon quelle ligne maîtresse ?
Saisir dans chaque cérémonie ce grand « nous » qui nous constitue. S’adresser au plus grand nombre, sans exclure personne : mon obsession depuis que je fais du théâtre. C’est en affirmant nos différences respectives que naîtra en effet la fierté d’appartenir à une collectivité qui les respecte. Comme je le disais en jouant naïvement sur les mots dès la présentation de mon projet au CIO, en août 2022 : « Des Jeux, un nous. » Autrement dit : « Des je, un nous. » La pluralité crée de l’unité, c’est une leçon que j’ai tirée des JO : l’adhésion populaire qu’ils ont suscitée vient de là. « Grâce à votre cérémonie, je me suis enfin senti intégré », ou encore « grâce à votre spectacle, je me suis reconnu », ou « la soirée m’a fait pleurer, je suis fier d’être français »… J’ai reçu des milliers de messages. Cette fierté retrouvée m’a bouleversé, et donne sens à notre métier d’artiste : moins on exclut, mieux on rassemble en profondeur.
Avez-vous connu des désaccords lors de l’écriture ?
Non. Seul le réel a rendu certaines idées impossibles. Comme la reprise de cette « rue de l’avenir » qui avait enchanté l’Exposition universelle de Paris en 1900 : un tapis roulant de 3,5 kilomètres installé sur un viaduc autour du site avec neuf stations. Impossible aussi, à cause du vent, cette forêt de montgolfières porteuses d’écrans de cinéma au-dessus du jardin des Tuileries. La vasque imaginée par Mathieu Lehanneur l’a remplacée. Des installations de miroirs sous la tour Eiffel, des ballets nautiques dans la Seine ont été aussi irréalisables. Et le survol de la flamme portée par Zinédine Zidane suspendu à un hélicoptère à trop basse altitude au-dessus de Paris – il était OK. Nous avons beaucoup discuté aussi du choix des dix statues de femmes ayant marqué l’histoire de France, d’autant que notre projet initial était de rétablir la parité avec les deux cent soixante statues d’hommes célèbres que compte Paris ! Impossible d’en installer autant…
Pourquoi aimez-vous la démesure ?
Je m’ennuie si je ne me lance pas de défis. Et j’avoue qu’un théâtre de cinquante places me fait plus peur que la Cour d’honneur du palais des Papes, à Avignon. Dans un espace gigantesque, on n’entend pas tousser, respirer les spectateurs. Enfin, affronter la démesure me rapproche de l’essence même du théâtre : ces tragédies grecques jouées à Athènes devant vingt mille personnes, ce théâtre populaire et politique qu’imagina après guerre Jean Vilar. Je voulais faire revivre cette démesure. Devenir l’artisan, avec toutes les équipes, d’une cérémonie d’ouverture qui aura touché 326 000 spectateurs sur les quais de Paris et 24,4 millions de téléspectateurs en France a été pur vertige. Nous avons même battu le précédent record d’audience télé hexagonal : la finale France / Argentine du Mondial de football 2022 !
Qu’en gardez-vous aujourd’hui ?
La sensation d’avoir vécu une expérience artistique que je ne connaîtrai plus. Le bonheur d’avoir perçu dans l’engouement du public une force fédératrice et le désir, la capacité de faire mieux société ensemble. Grâce au spectacle vivant. N’oublions pas que les premières cités grecques ont bâti simultanément un stade et un théâtre. Sport et scène étaient aussi essentiels à la cité. Que s’est-il passé ? Si le sport, plus que le théâtre, s’est adapté à la marchandisation et au capitalisme, on a mesuré aux JO combien le spectacle pouvait fédérer et unir. « Allez au public ! » recommandait Jean Vilar. Après guerre, les pionniers de la décentralisation culturelle ont tout inventé pour le conquérir. Au fil des ans, beaucoup d’entre nous ont hélas considéré que le travail était fait sans imaginer d’autres formes pour s’adapter à la société nouvelle.
Je n’ai jamais accédé à mes rêves de la manière que je souhaitais. Et du côté des politiques ?
La plupart d’entre eux cherchent à longueur de programmes à définir ce que sont les Français. Or le succès de nos cérémonies a montré que le sentiment d’unité nationale ne renaîtra que si l’on pose d’emblée notre diversité et non une définition restrictive. Voyez la polémique déclenchée par la montée sur le podium de l’athlète voilée marathonienne néerlandaise Sifan Hassan. Sans prendre parti, je trouve bien que son sourire étincelant fasse réfléchir et participe à la circulation des idées. La violence commence quand s’arrête la pensée.
Le « bashing » qui a précédé les Jeux vous a-t-il atteint ?
Les dénigrements, le « bashing » traversés ont été identiques à Londres en 2012. Tant que rien n’est concret, la magie des JO est difficile à imaginer. Même si le CIO avait annoncé que ceux de Paris révolutionneraient le genre : parité chez les athlètes hommes et femmes, mise en parfait miroir des jeux Olympiques et Paralympiques, fin du déroulement classique des cérémonies, si ennuyeux. D’autant que, pour la première fois, elles étaient organisées au cœur de la cité, passé et présent conjugués sur une Seine dépolluée pour l’occasion. Mais l’ambiance était à la crise sociale, politique surtout après les élections européennes et législatives. Peut-être ce contexte nous a-t-il été favorable. Nous avions tous besoin de retrouver une unité malmenée.
À lire aussi : Cérémonie d’ouverture des JO : Thomas Jolly victime de cyberharcèlement, une enquête ouverte Finalement, vous n’aurez jamais pu répéter une cérémonie ?
Non, je les ai découvertes en temps réel face à un mur de cinquante écrans dans la salle de commandement, une sorte de régie d’où sont envoyés les top départ des séquences et prises les décisions urgentes avec Thierry Reboul. Je n’ai même pas entendu les réactions du public. J’aurai mis en scène un spectacle vivant sans le vivre. Ni suivre sa réalisation télévisée qu’on me dit décevante, sur laquelle nous avions pourtant tant répété. Mais pas de regret, quand on prépare une fête, le plus important est que les invités s’amusent, tant pis pour celui qui fait les courses, la cuisine et le ménage après. Bien sûr j’avais vu répéter tous les morceaux, mais dans des ateliers. Tout s’est ensuite monté en kit. Certes on avait « l’animatique », la 3D, qui nous permettait de nous balader visuellement partout pour anticiper la mise en scène, mais ça n’a pas empêché les effets de réel. La pluie a annulé la séquence des breakers, skateurs et BMX comme l’évocation de Louis XIV et de Napoléon.
Vous en avez pleuré de désespoir ?
J’étais hébété. J’ai tout de suite vu que les artistes se surpassaient pour triompher des éléments. La pluie rendait notre travail héroïque. La cantatrice Axelle Saint-Cirel a expliqué qu’elle avait à peine cligné des yeux, une heure durant sur le toit du Grand Palais, pour ne pas faire couler son maquillage. Et tous ces danseurs qui auraient pu glisser. Mais moi, après ces années d’investissement — démission du CDN d’Angers, déménagements à Paris, éloignement de ma famille, de mes amis —, j’ai revu brutalement mon parcours. Avais-je fait les bons choix ?
C’est l’émotion qui a provoqué cette réflexion ?
J’étais à un moment culminant de ma vie artistique et tout m’était contraire. Comme lorsque je candidatais à l’école du Théâtre national de Bretagne et que ma lettre de candidature avait été égarée. Comme lorsque, sorti de cette école, je fus un des rares à n’être engagé nulle part, forcé de créer ma compagnie à Gaillon. Et toujours échouant, même le succès venu, à diriger les institutions dont je rêvais : Théâtre national de Bretagne, Théâtre national populaire de Villeurbanne, Théâtre national de Strasbourg, Odéon. Je n’ai jamais accédé à mes rêves de la manière que je souhaitais. Je voulais jouer avec le monde, et le monde se jouait de moi. Où trouver ma place ? J’apparais fugitivement en Quasimodo lors de la cérémonie d’ouverture sur les toits de Notre Dame… Rétrospectivement, je remercie la pluie. Non seulement elle nous a reliés dans la difficulté, mais à moi qui veux toujours tout maîtriser, l’existence a rappelé que c’était elle qui décidait. Tant mieux. J’adore être un funambule entre les risques, les aléas. Je fais du théâtre pour travailler au présent, avec le vivant.
Aviez-vous imaginé que certaines séquences provoqueraient de tels scandales ?
Pas du tout. D’abord, il ne s’agissait pas de Marie-Antoinette, mais d’aristocrates emprisonnées qui vivaient la Révolution française depuis la Conciergerie. Qu’on ait pu penser à une apologie du terrorisme qui a coûté la vie à Samuel Paty m’a consterné. Je voulais juste théâtraliser la Révolution à l’extrême, comme on le faisait au début du XIXe siècle sur le « boulevard du crime », à Paris. En plus, à ce moment-là, sur la façade de la Conciergerie se déchaînait aussi le groupe de death metal Gojira, tandis que Marina Viotti passait sur le bateau symbolisant Paris et sa devise Fluctuat nec mergitur (« Il est battu par les flots mais ne sombre pas ») tout en chantant Carmen et la liberté de l’amour. L’idée était de mélanger les formes, les genres pour témoigner d’un gigantesque bouleversement, d’un peuple acquérant ses droits dans la violence.
À lire aussi : Une cérémonie généreuse et insolente, le pari follement réussi de Thomas Jolly Certains ont aussi cru voir une caricature de La Cène de Léonard de Vinci avec des drag-queens.
Loin de moi d’y avoir pensé. Je voulais figurer les dieux de l’Olympe, mais un zoom de caméra malencontreux a fixé la scène en banquet alors qu’il s’agissait juste d’un catwalk de défilé de mode. Et qui dit banquet, en France, fait immédiatement référence à la Cène. Quant aux drag-queens, le cabaret, le transformisme font totalement partie de notre culture ! Je ne suis pas un provocateur, je ne l’ai jamais été : je cherche trop à n’exclure quiconque. En plus, comment aurais-je pu faire la satire des chrétiens tout en faisant retentir Notre-Dame ? Ce serait incohérent. On ne peut jamais anticiper la réception des images. Alors que Jeanne d’Arc et la déesse gauloise Sequana confondues étaient censées chevaucher la Seine et porter le drapeau sur ce magnifique cheval d’acier, certains ont vu un cavalier de l’Apocalypse.
Vous avez été victime de centaines de menaces homophobes, antisémites sur les réseaux sociaux…
Nous sommes plusieurs à en avoir reçu dans l’équipe. Mais je ne veux plus en parler, les messages de remerciements furent plus nombreux. Pourtant j’ai porté plainte. Pour l’exemple. La République doit protéger tous ses enfants et personne ne doit tolérer d’être harcelé par les ouvriers du chaos. Traité de pédale quand j’ignorais même ce que cela signifiait, je l’ai trop été durant toute ma petite enfance.
Quelles qualités faut-il pour être directeur artistique ?
De l’obstination, du flair pour recruter sa garde rapprochée et ses équipes, de la combativité.
Avez-vous subi des pressions du président de la République, de la maire de Paris ou des grands sponsors ?
Aucune. Je ne dépendais de toute façon que du CIO.
L’art peut créer de l’unité dans la diversité. Mais une fois cela posé, que fait-on maintenant ? Emmanuel Macron avait évoqué Aya Nakamura.
C’était mon choix premier, et elle chante Aznavour — et non pas Piaf comme il le souhaitait. J’admire depuis toujours son travail sur la langue française. Pour moi, elle va chercher ses mots dans les profondeurs de l’imaginaire et allie à son dialecte malien à la fois Pierre Guyotat et Valère Novarina. Voilà pourquoi je voulais la faire sortir de l’Institut de France et rencontrer la Garde républicaine, autre symbole de notre pays. J’ai adoré cette séquence.
Finalement, que vous restera-t-il des JO ?
Un grand apaisement. Le spectacle a permis aux gens de se sentir vivants et ils ont trouvé ça beau de se sentir vivants ensemble, en même temps. Preuve que la culture peut faire nation en donnant sa place à chacun. Ce constat est merveilleux pour nous les artistes. L’art peut créer de l’unité dans la diversité. Mais une fois cela posé, que fait-on maintenant ?
Et vous, que faites-vous ?
Rachida Dati comme Anne Hidalgo m’ont fait de magnifiques propositions que je ne vous dirai pas. Moi, j’ai aussi fait une contre-proposition. Et peut-être vais-je me lancer dans un livre. J’ai besoin de partir en vacances et de digérer l’héritage immatériel des JO. Le succès comme la lumière sont souvent difficiles à vivre. Même si, depuis longtemps, j’ai appris à m’en passer.
On garde la vasque sur les Tuileries ?
Non ! La beauté du spectacle vivant, c’est l’éphémère. Lui seul permet d’entrer dans la légende, d’être sacralisé. À l’image de tous ces spectateurs qui se taisaient quand s’élevait dans le ciel la vasque olympique. Pareil silence ne se reproduira plus si ce moment devient quotidien. Je sais maintenant que la pluie a rendu la cérémonie bien plus belle.
Propos recueillis par Fabienne Pascaud / Télérama Thomas Jolly en quelques dates
1982 Naissance à Rouen.
2006 Crée La Compagnie Piccola Familia.
2014 Henri VI, de Shakespeare.
2018 Thyeste, de Sénèque, à Avignon.
2020-2022 Dirige le Centre dramatique national d’Angers.
2022 Directeur artistique des cérémonies des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon, à La Seine musicale.
2023 Roméo et Juliette, de Charles Gounod, à l’Opéra Bastille.
Légende photo : Thomas Jolly dans le jardin des Tuileries (domaine du musée du Louvre, à Paris), auprès de « Thésée combattant le Minotaure », de Jules Ramey. Photo Jean-François Robert pour Télérama

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
August 11, 2024 8:59 AM
|
Propos recueillis par Sandra Onana / Libération du 11 août 2024 L'événement inaugural des Jeux a frappé les esprits à travers le monde. A l’approche de la cérémonie de clôture, la romancière française, Prix Goncourt 2016, détaille les inspirations du spectacle cathartique. Quelque chose d’inhabituel s’est produit, le 26 juillet, le long de cette Seine où la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques imaginée par Thomas Jolly s’est déployée avec fracas, sous le déluge. Chose rare, deux semaines après l’événement inaugural et alors que les Jeux sont désormais refermés : le souvenir halluciné de cet acmé persiste, bien au-delà de ce que ce type d’exercice peut laisser présager. Comme avec l’art, cela touche confusément à l’impression qu’ont les spectateurs qu’il leur est arrivé quelque chose, mais quoi ? Leïla Slimani a co-écrit le spectacle, entourée de Patrick Boucheron, historien au collège de France, de la scénariste Fanny Herrero (Dix pour cent) et de l’auteur de théâtre Damien Gabriac. Parce que cette œuvre collective pourrait laisser durablement sa marque, la romancière et prix Goncourt 2016 a accepté de revenir sur le comment du pourquoi. Avec le recul des semaines, quel regard portez-vous sur cette cérémonie pas comme les autres ? Sans même parler de la polémique qui a suivi, vous aviez anticipé qu’elle frappe autant les esprits ? Ce serait hypocrite de prétendre que je suis surprise. On a écrit un spectacle qu’on savait hors normes, qui n’avait pas de précédent, qui n’aurait pas d’équivalent en tout cas à court terme, et on voulait que ce soit quelque chose qui fasse parler, réagir, émeuve. C’était le but de la chose. D’une certaine façon, j’étais convaincue que la réaction serait à la hauteur de l’énergie et de la passion qu’on avait mises dedans. Etant romancière, je suis toujours très attentive au temps long. Pour moi, deux semaines, c’est un temps extrêmement court, qui ne permet pas de prendre le recul nécessaire ni de dire ce qui va en rester. C’est peut-être une grande problématique de l’époque d’ailleurs, cette précipitation – peut-on même parler de polémique ? Je n’en suis pas sûre. La polémique résulte de conditions d’ordre médiatique. Les menaces de mort, le harcèlement [plusieurs plaintes ont été déposées par l’équipe artistique de la cérémonie, ndlr] sont des délits qui peuvent être punis par la loi. Précisément, en tant que romancière, comment avez-vous abordé cette notion de roman national ? C’était absolument passionnant cette idée de construire un récit de la même manière qu’on construit un roman, avec des personnages, un début, un milieu, une fin, un fil rouge qui était assuré par ce personnage masqué qui s’empare de la flamme au début. L’élément qui me dépassait, vous l’avez dit, c’est celui du roman national. Comment on se raconte ? Qu’est-ce qu’on raconte de nous ? Qui a le droit de raconter quelque chose sur nous ? Ça nous amenait à nous poser beaucoup de questions de représentativité, de légitimité, d’exhaustivité – est-ce que si l’on raconte ceci, on ne court pas le risque d’oublier cela ? C’est vraiment un questionnement narratif, de cohérence stylistique, et en même temps, un questionnement philosophique. Que serait un roman national aujourd’hui qui n’exclut pas, qui n’est pas réactionnaire, qui n’est pas dans une nostalgie nauséabonde ? Et qui n’est pas surplombant. En réalité, plus on travaillait, plus le récit se construisait sous nos yeux, et je ressentais une très grande gratitude pour ceux qui nous ont inspirés : la vraie vie, les anonymes dans la rue, les grands auteurs, les grands peintres, les figures politiques qui font la complexité de l’histoire française. Le sentiment que j’ai, c’est que l’on n’a rien inventé, on a juste donné à voir ce qui existait. Il y a des choses qui vous auraient fait claquer la porte si le cahier des charges les imposait ? Bien sûr. J’y suis allée comme écrivaine, mais aussi en tant que militante des droits sexuels et pour la dépénalisation de l’homosexualité [au Maroc], en tant que militante féministe, ancienne représentante de la francophonie, et donc d’un rapport à cette langue ouvert et métissé. Si j’avais ressenti la moindre censure dans la représentation de l’homosexualité, des rapports amoureux, de la représentation des corps ou du métissage, je me serais énervée et j’aurais fait marche arrière, mais ça n’a jamais été le cas. La question de départ n’a jamais tant été celle des écueils à éviter que : qu’est-ce qu’on a envie de faire ? Un spectacle patrimonial grandiloquent, patriote pour dire au monde «Voilà ce qu’est la France» ? Ce n’était pas du tout notre envie. Dès le départ, et c’est lié au fait qu’on était dirigés par Thomas Jolly, qui est metteur en scène, il y avait l’idée d’en faire un geste artistique. La conséquence naturelle était que les gens pourraient ne pas l’aimer. Et peu importe, tant qu’il se prêtait à des critiques qui n’étaient pas d’ordre idéologique ou politique, mais d’ordre artistique. La question, c’est allait-on trouver ça beau, ou pas ? Rétrospectivement, on peine même à saisir comment le spectacle articule autant de pôles contraires, l’enchantement de masse (plus de 85 % de Français jugeant la cérémonie réussie selon un sondage) et la transgression, le kitsch et le sublime… Comme un cadavre exquis où les antinomies fonctionnent ensemble. Il fallait que cela se déplie, avec une progression. La France est un pays associé à tellement de clichés dans la production internationale qu’on ne pouvait pas les ignorer complètement alors l’idée, c’était de les raconter, en allant chercher l’envers sans lequel ces clichés n’existeraient pas. On s’intéressait à cette esthétique fantasque et exagérée à la frontière du carnaval, de la fanfare, ces grands spectacles populaires qui prennent une ville d’assaut. Mais aussi à la frontière de l’horrifique, du terrifiant, de l’anxieux qui rejoint les grands canons du théâtre classique. C’est un spectacle très syncrétique parce que l’on vient tout simplement de mondes très différents, on y a mis nos références et les choses se sont organisées organiquement. L’inquiétant, justement, pouvait s’incarner à travers des têtes décapitées, figures masquées, cette cavalière sans visage, et tout ça laisse au fond le souvenir d’une grosse hallucination collective… Faire coexister la fête et la mort, cela entrait dans le projet d’une célébration païenne ? Fondamentalement. D’emblée, dans la grande bibliothèque mise à notre disposition, on s’est énormément documentés sur les Grecs de l’Olympe. On avait une idée très païenne, burlesque, de ce que devait être une catharsis : ces grands spectacles qui nous déchargent d’un certain nombre de choses qui nous empêchent d’être ensemble. Une scène de théâtre est aussi un endroit où l’on parle de nos cauchemars et de nos peurs collectives. On était tenus de ne pas passer à côté de ça parce que l’on est des artistes, et parce que l’on sort de dix ans très difficiles pour la France, qui est aussi habitée par des démons, de la violence. Et ça, on essaye de le sublimer, de l’incarner artistiquement à travers des visions et des personnages. Ça ne veut pas dire qu’on impose un point de vue là-dessus. C’est là où je trouve que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c’est que de faire un spectacle. C’est dommage de ne pas se laisser simplement prendre par l’émotion, et d’essayer de juger ses émotions, de les moraliser. Il y a des choses merveilleuses et festives dans le collectif qui font la grandeur de la France : on a fait des révolutions pour acquérir des droits, se battre pour plus d’émancipation, d’égalité. Et oui, parfois, le collectif est anxiogène, il y a de la violence, il fallait raconter ça, mais il ne s’agissait pas de porter le moindre jugement moral là-dessus. J’insiste sur cet aspect artistique : ce dont il s’agissait, c’est d’incarner de manière artistique la complexité d’une histoire. A quoi a ressemblé le processus d’écriture avec Patrick Boucheron, Thomas Jolly, Fanny Herrero, Damien Gabriac ? Vous aviez des champs d’intervention distincts ou discutiez à bâtons rompus ? A bâtons rompus. L’un lançait une idée, l’autre lui apportait un éclairage historique, l’autre prévoyait que ça ne marcherait pas à moins de le tourner de telle façon, et on avançait comme ça. Et moi-même ne m’empêchais pas de faire des remarques historiques, et Patrick Boucheron d’ordre littéraire… C’était un travail collectif étonnamment fluide. Cette liberté artistique se conjuguait bien avec des instances de validation à qui vous rendiez votre copie ? Je n’en sais absolument rien. J’étais complètement dans ma bulle, je faisais ce que j’avais à faire aux réunions et rentrais chez moi. Je ne sais absolument pas qui était habilité à dire oui, non, pourquoi. Le timing de cette cérémonie des JO n’a pas été difficile à vivre, après la crise politique de la dissolution qui a failli porter l’extrême droite au pouvoir ? La cérémonie était écrite depuis longtemps. Quand il y a eu les législatives, on s’est dit que finalement, ce qu’on voulait raconter n’allait en être que plus fort. Nous sommes des citoyens, on était tous traversés par un sentiment d’inquiétude, de tristesse, de révolte, de colère. On ne s’est jamais dit que ce serait une cérémonie pour divertir le peuple. On s’est toujours dit que c’était un moment de fusion qui devait appartenir aux gens, qu’ils devaient se l’approprier. Et quoi qu’il allait se passer politiquement, un bon spectacle, comme un bon livre ou tout autre objet artistique, est polysémique. Ces significations sont plastiques, elles évolueront avec le temps, les circonstances, on ne verra pas les choses de la même manière dans dix ou vingt ans mais quelque chose en restera, des nouveaux publics la liront différemment. La France est un grand pays d’audace, c’est le pays où les corps sont libres, et cette liberté des corps est au cœur de l’olympisme. C’est pour cette liberté inaliénable qu’il faut continuer à lutter. On s’est dit qu’on était en cohérence avec nous-mêmes. Ce qu’on a voulu exprimer, on l’a vraiment exprimé. Propos recueillis par Sandra Onana / Libération Légende photo : Une des scènes marquantes de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris le 26 juillet : l'arrivée du drapeau olympique sur un cheval de métal galopant sur la scène. (PA Photos/PA Photos/ABACA)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 25, 2024 9:14 AM
|
Par Léna Lutaud, AFP agence et Ariane Bavelier dans Le Figaro - Publié le 25 juillet 2024 PORTRAIT - Les amateurs de théâtre, d’opéra et les fans de Starmania adorent ses mises de scène. À 42 ans, ce surdoué surnommé « le farfadet » a su s’entourer pour imaginer quatre cérémonies comme on n’en a « jamais vu ». Parce que c’était lui, parce que c’était eux. Nul ne sait encore ce que donnera la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris vendredi soir. Mais Thomas Jolly est exactement l’homme de la situation. La valse du grand escalier du Palais Garnier sur la scène de l’opéra Bastille pour Roméo et Juliette, c’est lui. Thyeste dévorant ses enfants dans Cour d’honneur du Palais des papes dans un opéra de nuit et de lumières, toujours lui. Henri VI de Shakespeare, époustouflant marathon du petit matin au bout de la nuit à Avignon, encore lui. Starmania remonté en grand show à la Seine musicale? Lui, lui, lui... Vendredi soir, 326 000 spectateurs et plus d’un milliard de téléspectateurs découvriront la cérémonie qu’il a conçue pour l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. Il l’a promis : tous devraient en avoir plein les yeux. Avec danseurs, chanteurs, plasticiens, circassiens, funambules, stars internationales - Céline Dion et Aya Nakamura sont annoncées, Lady Gaga espérée -, cette parade de trois heures qui aura pour scène la Seine s’annonce grandiose. «Ce sera le plus grand spectacle du monde», explique Thomas Jolly sans fausse modestie. Rien de pédant, rien d'outré Au lieu de diviser la soirée en trois temps (45 minutes de show, deux heures de parade des athlètes et une heure d’obligations protocolaires), ce surdoué créatif a imbriqué ces différents moments en «une grande fête homogène avec des surprises fortes et radicales» déclinée en une dizaine de tableaux. «La France, c’est la diversité. C’est à la fois Edith Piaf, le rappeur marseillais Jul et Natalie Dessay», expliquait-il à l’AFP il y a quelques mois. Jamais ce metteur en scène n’aura travaillé avec une équipe aussi importante. Jamais il n’aura eu à sa disposition autant de moyens, mais aussi autant de contraintes : une «scène» de plusieurs kilomètres avec des spectateurs tout du long, les caprices de la météo et du fleuve, les consignes hors normes de sécurité, les contraintes de la captation télévisée... Ce frêle Rouennais de 42 ans a les épaules solides. «Plus ça approche, plus je suis heureux», dit-il. Il ne stresse pas, mais écarquille les yeux où brille la joie des petits enfants devant le sapin de Noël. Rien de pédant, rien d’outré chez lui. Il porte une simplicité qui lui va bien, marche dans la rue comme tout le monde et se dit impatient de pouvoir enfin partager sa création classée «secret-défense» sur laquelle il travaille depuis septembre 2022. Il ne joue aucun personnage, s’investit tout entier dans ses créations et possède un enthousiasme devant lequel cède le mot «impossible». Une vision aiguisée auprès des maîtres Né en 1982, d’un père imprimeur et d’une mère infirmière, il tombe dans le chaudron du théâtre à 11 ans, entre en classe théâtre, puis à l’université de Caen -section théâtre forcément-, où il crée sa première troupe. Il joue, met en scène, dirige, veut en savoir plus et plus encore, entre à l’École nationale supérieure de Bretagne à Rennes, dirigée par Stanislas Nordey, et travaille avec Claude Régy, Jean-François Sivadier, Robert Cantarella. Une manière d’aiguiser auprès des maîtres sa propre vision du théâtre... qui ne leur doit rien d’autre. Il la cisèle encore davantage en fondant sa compagnie la Piccola Familia à 24 ans. Ses productions touchent à tous les genres, de Marivaux à Guitry et au théâtre contemporain. Elles sont vite repérées et le monde du spectacle s’éprend de cet enfant prodige, fou de textes et de merveilles. Son Henri VI, à la fois magistral et digne du livre des records, lui vaut le son premier Molière. Starmania, où son spectacle fait oublier à quel point «le monde est stone», lui en apportera deux autres. «Mon mantra depuis que je fais du théâtre est de m'adresser au public le plus large», explique-t-il. Jolly aime la démesure et le partage. Le minimalisme ? Très peu pour lui. Il lui faut de la musique, des lumières, faisceaux, néons, costumes, effets spéciaux si prenants, si proches de l’idée du spectacle total que le mot d’«opéra» naît spontanément sous la plume des critiques de théâtre. Selon Vanity Fair, il sait «ce que doit être le théâtre à l’heure de Netflix». «On n'est pas au théâtre pour voir des choses qui ressemblent forcément à ce qu'on peut voir à la télévision, au cinéma ou même dans nos vies», insiste-t-il. Aura-t-il forcé la dose pour le spectacle des J.O. où tous les moyens lui sont offerts? Travail d’équipe De 2020 à fin 2022, pendant la pandémie, il dirige le centre dramatique national Le Quai d’Angers, lorsque le journal L'Équipe l’interroge comme deux autres artistes sur ce que pourrait être la cérémonie d’ouverture. Il évoque une arrivée des athlètes en chars qui se transformeraient en voitures amphibies, les drapeaux des pays plantés dans la tour Eiffel, Catherine Deneuve en Olympe de Gouges ou encore PNL chantant L'Hymne à l'amour. Ces idées originales lui valent d'être embarqué dans les JO de Paris 2024, comme directeur artistique. Au fil du temps, son projet a évolué. Il a abandonné l'idée d'une tour Eiffel à l'envers qui servirait de vasque à la flamme olympique, de ballets aquatiques dans la Seine - quoique - ou de la présence de Daft Punk, duo séparé depuis 2021. Il y a dix-huit mois, son premier travail a consisté à s'entourer de quatre auteurs, dont la romancière Leïla Slimani et la scénariste de la série «Dix pour cent» Fanny Herrero, pour imaginer «un grand récit» à partir du décor au cœur de Paris - le fleuve et ses monuments. Pour les chorégraphies, il a fait appel à Maud Le Pladec, prochaine directrice du ballet de Lorraine. Daphné Burki signe les costumes. Le récit de la cérémonie d’ouverture se poursuivra dans les suivantes, celles de clôture des JO au Stade de France, d’ouverture des Jeux paralympiques place de la Concorde, puis de clôture, à nouveau dans l’enceinte de Saint-Denis, le 8 septembre. Thomas Jolly pourra alors prendre des vacances. «Depuis deux ans et demi, j'ai beaucoup aggloméré de projets et j'ai tout donné ce qu'il me restait pour ces cérémonies, dit-il. Maintenant, il faut, comme toute bonne terre, que je me mette en jachère.» Ensuite, il aimerait bien jouer pour d’autres. Sur les planches mais aussi au cinéma, glissant avoir «un scénario en cours.» Par Léna Lutaud, AFP agence et Ariane Bavelier dans Le Figaro Légende photo : Les tragédies antiques, Shakespeare, l’opéra, Starmania et, maintenant, les JO en mondovision... Thomas Jolly est un homme-orchestre devant qui cède l'impossible. Tesson/ANDBZ/ABACAPRESS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 24, 2024 6:44 PM
|
Philippe CHEVILLEY dans Les Echos - 24 juillet 2024 Le comédien-metteur en scène de 42 ans s'est réinventé en maître de cérémonie des Jeux olympiques de Paris. Un défi à la mesure de sa fulgurante carrière. Portrait d'un créateur éclectique et surdoué avant le grand rendez-vous du 26 juillet. A 42 ans, l'ex-petit prince normand va devenir pour un soir le roi de Paris, voire le roi du monde, en orchestrant la cérémonie d'ouverture des J.O. 2024. Il est loin le temps où Thomas Jolly bricolait avec trois bouts de ficelle, des paillettes et deux projecteurs une version tonique et gracieuse d'« Arlequin poli par l'amour » de Marivaux. Un joli coup d'éclat qui lui vaut une première reconnaissance des professionnels. On est fin 2006, le jeune comédien-metteur en scène, originaire de Rouen et formé à l'école du Théâtre national de Bretagne, a déjà des étoiles dans la tête. Mais, à 24 ans, il n'ose pas encore croire à la carrière qui l'attend. Le coup du destin est provoqué par une séparation amoureuse à l'aube des années 2010. Pour combattre sa déprime, le jeune esseulé ne trouve pas mieux que de s'attaquer à une oeuvre parmi les plus longues du répertoire, « Henry VI » de Shakespeare - trois pièces, quinze actes et de dix mille vers déclamés par quelque cent cinquante personnages. Toute l'histoire de la Guerre de Deux Roses y passe, avec une traversée de la Manche à la clé (Charles VII, Louis XI versus Albion). Le coup d'Henry VI Thomas Jolly monte la fresque méthodiquement, en trois temps. En 2014, il présente à Avignon puis en 2015, à Paris, à l'Odéon, une intégrale qui signe son triomphe : 18 heures de spectacle en comptant les entractes. La Jeanne d'Arc shakespearienne prend des airs de Lady Gaga et les lords énervés semblent sortis de « Game of Thrones »… Le mélange de théâtre de tréteaux, de film de capes et d'épées, de poésie rock et de musique pop subjugue un public rajeuni. En 2022, le metteur en scène offre une nouvelle version de sa fresque en 24 heures chrono, augmentée de « Richard III », pièce plus tardive de Shakespeare qui clôt le cycle historique. Thomas Jolly incarne lui-même jusqu'au bout de la nuit le sulfureux roi Richard. Les acteurs jouent à l'énergie, le public, extatique, fait des olas… Le Quai d'Angers, qu'il dirige alors encore pour quelques semaines, n'est plus un théâtre, c'est Woodstock… Inventif, ingénieux, fantasque mais toujours respectueux des oeuvres, Thomas Jolly a su aisément transformer l'essai d'« Henry VI » avec ses mises en scène spectaculaires de « Thyeste », tragédie de Sénèque, dans la Cour d'honneur du Palais des Papes d'Avignon (2018), ou du « Dragon », fable d'Evgueni Schwarz (2022). Il s'empare aussi avec brio du répertoire lyrique avec « Fantasio » d'Offenbach (2016) ou « Romeo et Juliette » de Gounod (2022). Le dramaturge n'a pas peur des grands écarts et se moque bien du culturellement correct. « J'assume d'aimer Deleuze et les Spice Girls, Britten et Beyoncé », confie-t-il avec malice. Une philosophie ouverte qui ne lui vaut pas que des amis dans le cercle fermé des gardiens orthodoxes du théâtre public. Le triomphe de Starmania Cet éclectisme, ce goût pour le glamour et les grands gestes lui valent de se voir offrir la maîtrise d'oeuvre de deux grands projets au début des années 2020 : la recréation de l'opéra rock de Michel Berger et de Luc Plamondon, « Starmania », en vue d'une grande tournée ; puis la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des J.O. de Paris 2024. Thomas Jolly rend les clés du Quai d'Angers et s'attelle à la tâche. Sa mise en scène de « Starmania » est bouclée quand il s'attaque aux J.O. en 2022. Mais si le spectacle est mal accueilli, ce sera de mauvais augure. Heureusement, sa relecture de « Starmania » est un triomphe. En suivant une trame plus fluide, l'opéra rock résonne furieusement avec les affres du présent. Le décor rétrofuturiste plutôt sobre contraste avec le maelström lumineux et sonore qui saisit sur scène. Priorité est accordée aux chanteurs et aux chanteuses : jamais le théâtre ne prend le pas sur la musique. Un équilibre qui fait mouche : les fans de l'oeuvre comme les néophytes sont bluffés. Si Thomas Jolly déploie autant de maestria sur la Seine, le soir du 26 juillet, la partie sera gagnée. Il lui restera alors à gérer l'après… Evacuer la pression accumulée et reprendre les chemins du théâtre où il lui reste encore beaucoup à créer et à prouver. Dans cet univers magique, on se doit d'être prince et roi tous les soirs. Philippe Chevilley / LES ECHOS Légende photo : L'homme de théâtre n'a pas peur des grands écarts et se moque bien du culturellement correct. (© JOEL SAGET/AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 16, 2024 4:49 PM
|
Propos recueillis par Ariane Chemin et Franck Nouchi
Publié dans Le Monde le 16 juillet 2024
ENTRETIEN
L’historien Patrick Boucheron, la scénariste Fanny Herrero, la romancière Leïla Slimani et l’auteur de théâtre Damien Gabriac ont travaillé, avec le metteur en scène Thomas Jolly, sur un spectacle en douze tableaux. Ils dévoilent au « Monde » les contours et l’esprit de la célébration du 26 juillet. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/sport/article/2024/07/16/si-la-ceremonie-d-ouverture-des-jo-2024-n-est-la-que-pour-produire-de-l-eclat-ephemere-quel-interet_6250808_3242.html
Patrick Boucheron, Fanny Herrero, Leïla Slimani, Damien Gabriac. Dans le plus grand secret, un historien du Collège de France, une scénariste en vue, une romancière Prix Goncourt et un homme de théâtre ont « écrit » la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (JO) de Paris. Ces personnalités ont été choisies fin 2022 par le metteur en scène Thomas Jolly, chef d’orchestre des cérémonies des Jeux. Les auteurs racontent au Monde dans quel esprit ils ont imaginé ce spectacle offert à plus de 1 milliard de téléspectateurs. Que pouvez-vous nous dire de cette cérémonie d’ouverture du 26 juillet ? Thomas Jolly et Damien Gabriac : C’est un spectacle vivant qui se déroule sur la Seine, 6 kilomètres durant, du pont d’Austerlitz à la tour Eiffel. Trois cent mille spectateurs y assisteront, et la cérémonie sera transmise sur 80 écrans géants. Ce spectacle sera une double première. L’ouverture des Jeux olympiques ne se fera pas dans un stade, contrairement à la coutume. Autre nouveauté, les délégations d’athlètes de chaque pays se mêleront en parade sur le fleuve aux cohortes d’artistes (acteurs, danseurs, acrobates…) et traverseront le spectacle. Tout va s’emmêler, y compris le protocole (les discours, l’ouverture par le chef de l’Etat, les hymnes, etc.). Le reste… Allez, on se tait ! Pour ce spectacle, vous avez convié un historien du Collège de France, une écrivaine Prix Goncourt (2016), une scénariste de séries et un auteur de théâtre. Pourquoi ces personnes, Thomas Jolly ? T. J. : Parler à autant de téléspectateurs, avec les mêmes images, au même moment, c’est une occasion unique. J’avais l’idée d’un immense spectacle, mais il me manquait un récit pour m’adresser au monde entier. Je travaille depuis longtemps avec Damien Gabriac, qui est un auteur de théâtre. J’ai voulu m’adjoindre quelqu’un qui ait un œil sur l’histoire. L’Histoire mondiale de la France, de Patrick Boucheron [Seuil, 2017], est restée longtemps sur ma table de chevet. J’ai contacté Leïla Slimani car j’avais besoin de la littérature, d’une langue aussi – je connais son rapport à la francophonie. Fanny Herrero a apporté son sens du scénario et de l’image. J’ai pensé que tous seraient complémentaires et que ce serait l’équipe idéale. Fanny Herrero, on vous connaît pour votre série à succès « Dix pour cent ». Votre père, Daniel Herrero, a été joueur et entraîneur du club de rugby de Toulon et vous-même avez été une joueuse de volley-ball de haut niveau. Quelle a été votre réaction lorsque Thomas Jolly vous a sollicitée ? Fanny Herrero : Mon premier réflexe, c’était que cette mission était trop grande et trop belle pour moi. J’ai eu peur. Et puis je me suis dit que c’était une aventure unique dans la vie d’une personne. J’ai aimé travailler à quelque chose de mémorable, pas seulement comme technicienne du scénario, mais comme citoyenne, tout simplement. Leïla Slimani : Je me trouvais au fin fond de l’Atlas, attelée à l’écriture du troisième tome de mon roman quand Thomas m’a appelée. Son coup de fil providentiel m’a sortie de la solitude du romancier pour me proposer de frotter mon cerveau à d’autres. J’ai émigré en France à 18 ans et j’ai trouvé que c’était un très grand honneur qu’on me demande mon avis sur cette France qui m’accueille. J’ajoute que je suis aussi une romancière de la sensualité, et il y a un érotisme qui me touche dans le corps des athlètes. Je sais enfin que l’effort sportif est une possibilité d’émancipation, par-delà les nationalités. Comme Fanny, j’ai rapidement dit oui, sans trop réfléchir. Patrick Boucheron : Pour moi aussi, l’occasion était trop grande, trop belle. Comme historien de la ville, ce qui m’a intéressé, c’est qu’il fallait écrire ces récits dans l’espace. Je rappelle que c’est une ville qui accueille les JO, et politiquement, c’est important : ce n’est pas France 2024, c’est Paris 2024. Restait à régler la part de l’historien dans cette aventure. Passer conseiller historique aurait été devenir le gardien du passé – je suis un historien amoureux du présent. Auteur m’allait mieux et l’idée-force du projet me plaisait : ne pas seulement représenter ce que fut hier, mais ouvrir à des promesses, produire des imaginaires (notamment sociaux), faire voir ce qui était resté invisible… Quelles ont été vos références ? Ou vos contre-exemples ? P. B. : Nous avons revu de vieilles vidéos. La cérémonie d’ouverture de Pékin, en 2008, c’est exactement tout ce que nous ne voulions pas faire : une leçon d’histoire adressée au monde depuis le pays d’accueil, une ode à la grandeur et une manifestation de force. Athènes, en 2004, éprouvée par sa dette, nous a donné une leçon d’humilité. En 2012, Londres a su dédramatiser les clichés nationaux par l’autodérision. Mais personnellement, ce qui m’a encouragé, ce fut de visionner sur YouTube la cérémonie imaginée par Jean-Paul Goude pour le bicentenaire de la révolution française, en 1989. Le défilé déjouait les stéréotypes nationaux et ne craignait pas de prôner le « métissage planétaire » avec un optimisme que nous avons aujourd’hui perdu. Ce désenchantement a été en lui-même pour moi une source d’inspiration. Comment avez-vous travaillé en commun sur la cérémonie ? L. S. : : On avait un grand mur dans les bureaux de Paris 2024, et fin 2022 on a commencé à y coller tout ce qui nous passait par la tête dès que cela évoquait la France, et surtout Paris : auteurs, acteurs, livres, photos, poèmes, chansons, tableaux, œuvres d’art, grands événements historiques… On a jeté toutes nos idées sur un grand tableau. Thomas voulait ensuite un spectacle avec un fil rouge, des personnages, un début et une fin. T. J. : On a enfilé nos doudounes et on est descendus en bateau du pont d’Austerlitz jusqu’à la tour Eiffel. On a regardé tout ce qui appartenait à la grande et à la petite histoire : les rues, les monuments, les places, les squares, les statues. On a ausculté les correspondances littéraires, cinématographiques, musicales. Au square du Vert-Galant trône la statue d’Henri IV, en face de la place Dauphine, qu’André Breton appelait « le sexe de Paris », pas loin du Pont-Neuf et des amants [du film] de Leos Carax… De la Seine, on aperçoit aussi le décor de la série « Emily in Paris »… T. J. : Oui, ou d’Amélie Poulain ! Ce sont déjà des visions oniriques de Paris. Evidemment, il fallait jouer avec les clichés, ces regards américains sur la France, mais sans s’en moquer. Le spectacle comporte douze tableaux et s’appuie sur tous les emblèmes de la ville et les sens qu’ils produisent. Notre-Dame, par exemple, c’est à la fois le coq, emblème de la France, Victor Hugo, une cathédrale qui se refait une beauté après un incendie. Tout cela va s’intégrer dans… D. G. : … ce Paris au fil de l’eau… L. S. : … cette grande pièce de théâtre surdimensionnée… P. B. : … cette poétique de l’histoire, de cette frise un peu froissée du temps passé, mais débarrassée de la séduction du déclinisme… F. H. : … ce récit. Thomas nous guidait et décidait : « Ça, j’aime bien », « ça non »… Comme scénariste, j’ai veillé à la dramaturgie, aux enchaînements, aux registres, aux variations d’émotions, comme dans une série, jusqu’au climax final. L’idée n’était pas de raconter l’histoire de France, vous l’avez compris, mais on est néanmoins partis de ce qui fait la France. Les fameuses valeurs, par exemple. Quel symbole dans tel lieu de bord de Seine ? Quel message ? Quelles valeurs avez-vous retenues, alors ? P. B. : La France, par exemple, est pour le monde une promesse de liberté, promesse qu’elle trahit toujours, mais qui lui demeure attachée. L. S. : Je suis une femme vivant au Portugal et qui vient du Maroc. Je connais cette force de Paris, ses ciments. L’une de ses valeurs, c’est celle du collectif, cet impensable qu’on est capable de construire quand on est ensemble. Nous avons eu envie d’un récit très généreux. Il fallait qu’il y ait de la joie, de l’émulation, du mouvement, de l’excitation et de la pétillance, et pas seulement ces fameuses valeurs philosophiques traditionnelles que la France exhibe volontiers avec parfois trop d’assurance… F. H. : Nous avons voulu contrer notre tendance naturelle à faire la leçon. L. S. : Nous nous jouons de l’image que les Français peuvent avoir dans le monde. Par exemple, celle de personnes très sûres d’elles. Nous ne voulions surtout pas d’esprit de sérieux dans cette cérémonie. Il y a beaucoup d’humour, du moins je l’espère, dans notre spectacle. En tout cas, si on a travaillé très sérieusement, on a aussi beaucoup ri. T. J. : Au départ, nos imaginaires n’ont eu aucune limite ! F. H. : J’avais rêvé d’une immense manif qui courait sur 6 kilomètres… P. B. : Nous avions un temps imaginé des statues d’hommes célèbres plongeant de leur piédestal dans la Seine, y coulant des brasses synchronisées, façon grand bain de l’histoire. Notre idée était surtout de faire surgir d’autres statues à leur suite. On a abandonné. Un jour, il faudra raconter l’aventure de cette cérémonie : comment certaines idées s’évanouissent, tandis que d’autres se transforment, et que d’autres lancées en rigolant demeurent intactes dans le spectacle. C’est le cas du prologue filmé, imaginé tel quel dès les premiers jours. Si on comprend bien, votre travail est tout sauf une reconstitution à la manière des spectacles du Puy-du-Fou… En chœur : L’inverse ! F. H. : Surtout pas une histoire figée. P. B. : Le contraire d’une histoire virile, héroïsée et providentielle. Thomas Jolly, vous connaissez les critiques qui ont entouré la parution de l’ouvrage « Histoire mondiale de la France », en 2017, coordonné par Patrick Boucheron. Assumez-vous que le choix de vos auteurs produise des débats ? T. J. : Une cérémonie olympique, c’est revenir sur d’où on vient, où on est, où l’on va. Cette question concerne la France, mais aussi le monde. Si le spectacle d’ouverture des JO n’est là que pour produire de l’éclat éphémère, quel intérêt ? Des athlètes vont traverser les monuments qui ont marqué notre passé commun, ce n’est pas rien. Je note que le trajet du spectacle nous propose lui-même une histoire bousculée. Dans l’espace, ces 6 kilomètres ne font pas une suite chronologique, mais désordonnée. Les monuments cohabitent dans un anachronisme joyeux qui pose mille questions. Comme celle-ci : depuis quand est-on français ? Depuis Clovis ? Avant ? P. B. : J’avais voulu réconcilier le sentiment d’appartenance nationale avec le goût du monde, mais aussi l’histoire savante avec le grand élan d’un récit populaire. Le titre même de mon ouvrage collectif était une tentative de conciliation. La cérémonie des JO doit parler au monde et à la France, plus précisément : parler du monde à la France et parler de la France au monde. Y a-t-il eu des censures ? Des figures imposées ? Des bâtons glissés dans vos roues ? P. B. : Il y a toujours une somme de contraintes, pas seulement politiques. Nous avons livré le scénario complet de la cérémonie en juin 2023. Evidemment, il a changé : c’est l’histoire banale du spectacle vivant. Mais les structures, ça a tenu. J’insiste : nous avons eu carte blanche. T. J. : Il y a aussi les contraintes budgétaires. Les filets du vivant et de la nature sont aussi des contraintes. On ne fait pas tout ce qu’on veut sur un fleuve ! Par exemple, la taille des ponts nous a fait renoncer à une parade artistique avec des barges spectacles. Les sponsors s’en sont-ils mêlés ? T. J. : Comme vous le savez, les Jeux olympiques, c’est de l’argent privé, pas public. Il y a donc des cahiers des charges. On peut se saisir des contraintes de ces partenariats privés en les transformant, en tentant de les intégrer. Vous sembliez fébriles il y a quelques semaines. Que se serait-il passé si, le 7 juillet, l’extrême droite avait remporté les élections législatives anticipées ? T. J. : On était très avancés et le spectacle serait devenu tout autre chose : une sorte de cérémonie de résistance. L. S. : Ça n’a pas eu lieu. Et, par là même, cet aspect de résistance du spectacle sera d’autant plus beau, il me semble. Nous avons infiniment besoin de ce moment apaisé et partagé, de ce temps enfin suspendu, loin de cette violence qui éclate partout. J’ai le très grand espoir que les spectateurs acceptent de se laisser emporter. Comme le dit Thomas, on sera tous là, vivants, dans le monde, en même temps. P. B. : On n’a pas bien dormi ces derniers jours. Le projet promis aurait pu dévier par un effet de contexte inimaginable, et le millésime des JO 2024 devenir un nouveau chrononyme, comme disent les historiens – cette nécessité de nommer un moment dans le temps. Mais ce n’est pas arrivé. F. H. : Notre cérémonie est restée une cérémonie de célébration, de fédération. Pourquoi tout ce secret autour de l’événement ? T. J. : Il ne s’agit pas d’un secret d’Etat. Nous voulons simplement respecter la surprise, l’émotion, l’émerveillement d’un spectacle. Lorsque je monte Roméo et Juliette, de Charles Gounod, à l’Opéra Bastille ou Thyeste, de Sénèque, à Avignon, je ne raconte pas non plus la fin de l’histoire… L. S. : Certains lecteurs me disent souvent : « Tout ça, vos livres, ce n’est pas vrai, c’est un mensonge pour faire rêver. » C’est exact. De la même manière, notre discrétion n’est pas un secret pour le secret, c’est un peu comme ces cadeaux qu’on enferme dans des placards avant Noël, pour ménager la surprise et ajouter de l’impatience à l’émerveillement. Il faut retrouver, le 26 juillet, cette part d’enfance en nous, la joie de la découverte, c’est devenu si rare. Allez, une petite indiscrétion, un teasing du spectacle ? T. J. : Nous n’allons pas investir seulement les quais et les ponts, mais le ciel aussi. Et l’eau. Qui sait, il y aura peut-être un sous-marin. Propos recueillis par Ariane Chemin et Franck Nouchi / LE MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 18, 2024 12:25 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama - 18 juin 2024 LES JO DE JOLLY – “Télérama” suit le directeur artistique des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris Thomas Jolly tout au long de son travail. Huitième épisode, le projet chorégraphique, qui sera interprété par un millier de danseurs.
Les résultats des élections européennes, le triomphe de l’extrême droite n’ont pas abattu l’énergie de Thomas Jolly. Il croit à un sursaut, pense que les abstentionnistes vont se réveiller, aller voter et prouver leur foi dans ces valeurs républicaines qui nous fondent : liberté, égalité, fraternité, universalité, solidarité. Il dit qu’il est de la génération 2002, celle qui a voté pour la première fois à une présidentielle où s’affrontaient Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Après une semaine de tensions et de peurs, Jacques Chirac a bel et bien obtenu un score abracadabrantesque… Le directeur artistique des cérémonies des JO craint juste que celle du 26 juillet soit fragilisée par la violence qui peut surgir d’un pays divisé. D’autant que les forces de sécurité enserreront la ville. Mais à dix-neuf jours du scrutin, la cérémonie ne pourra plus être transformée par quiconque, et ne relève de toute façon pas du politique, mais du Comité international olympique. Et Thomas Jolly se refuse aux prévisions, affirmant qu’elles rajoutent incohérence et embrouillamini. Mieux vaut penser et construire au jour le jour. Le tourmente bien davantage la confusion omniprésente en France : « Avoir mis en scène des tyrans comme Atrée dans Thyeste de Sénèque, le Richard III de Shakespeare, le Dragon d’Evgueni Schwartz ou encore le Zero janvier de Starmania, de Luc Plamondon et Michel Berger, n’a donc servi à rien ? plaisante-t-il tristement. Depuis mes débuts je m’évertue à montrer des monstres politiques pour les dénoncer… » Il semble quand même plutôt détendu ce jour de juin. « Plus la cérémonie approche et plus je vois sortir des ateliers pleins d’effervescence des costumes et des décors magnifiques, des chorégraphies splendides. » Justement, il est venu avec Maud Le Pladec, la chorégraphe qu’il a choisie pour superviser sous sa houlette tout ce qui sera dansé aux quatre cérémonies d’ouverture et de clôture. La brune « tellurique » (comme il dit) accompagne le jeune homme pâle. Ils se sont rencontrés en 2003 au Théâtre national de Bretagne, à Rennes, où il était encore élève à l’école d’art dramatique que dirigeait Stanislas Nordey. Il a 21 ans, Maud Le Pladec, 27. Elle vient de danser au TNB dans un ballet de Loïc Touzé. Coup de foudre pour l’interprète à la coupe au carré façon Louise Brooks. Thomas Jolly trouve d’une puissance féminine incandescente son expression mi-théâtrale mi-dansée. Ils se retrouvent sept ans plus tard toujours à Rennes où Maud Le Pladec est devenue artiste associée et où Thomas Jolly joue avec sa compagnie. Elle vient de remporter le Prix de la révélation chorégraphique du Syndicat de la critique dès sa première pièce, Professor, sur une musique très contemporaine de Fausto Romitelli. La complicité se noue entre la Bretonne née à Saint-Brieuc et le Normand né à Rouen. Chacun a vécu dès l’enfance sa passion de la danse ou du théâtre. Ils travaillent comme des dingues et se sentent transfuges de classe… Je dois tout à notre service public. (…) Comme nulle part ailleurs, on peut ici se former, danser. Maud Le Pladec, chorégraphe « Je viens d’un milieu ouvrier pauvre, raconte Maud Le Pladec. Je suis allée pour la première fois au cinéma à 16 ans et je n’avais vu de danse qu’à la télé. Je l’ai pourtant commencée à l’école dès 6 ans et dans toutes les formations municipales possibles : classique, contemporaine, jazz. Je ne vivais que pour ça ; et mon frère pour la moto. Mes parents se sont saignés pour lui en offrir une ; chaque dimanche, on le suivait en camion dans ses motocross. À 15 ans, pour payer mes cours de danse, j’en donnais déjà moi-même au lycée : douze heures par semaine. Je dansais même dans des fermes. » À 19 ans, elle obtient son diplôme de professeur. « Mais je voulais celui de la formation Ex.e.r.ce au Centre chorégraphique de Montpellier que dirigeait Mathilde Monnier. Je l’ai eu. Je dois tout à notre service public. La France est le berceau historique de la danse et notre système culturel l’a sans fin développée. Comme nulle part ailleurs, on peut ici se former, danser. Dans n’importe quel autre pays un danseur doit travailler à côté pour danser ; en France, il peut vivre de son métier. J’en suis la preuve. Sans ce système, je ne serais jamais devenue chorégraphe. Voilà pourquoi il faut le préserver et pourquoi je veux continuer d’y travailler : pour que des filles comme moi puissent y arriver. Même si Thomas et moi ressentons souvent un peu de mépris dans nos milieux qui ont parfois un sens de la diversité sociale très caché. Ma place ne m’a jamais semblé acquise. » Et Thomas Jolly de sourire en se rappelant qu’on qualifiait ses spectacles de « théâtre pour les nuls » ou de « kermesse » pour « ados dégénérés » : « De peur de passer de l’autre côté du miroir, on a dû énormément bosser et “aller au public” comme y incitait généreusement Jean Vilar. » Et sa directrice de la danse et chorégraphe des quatre cérémonies de renchérir : « J’aime que ton théâtre soit ouvert aux spectateurs qui n’ont pas les codes. Curieusement, je n’ai jamais intellectualisé ma démarche et pourtant je passe mystérieusement dans la profession pour une chorégraphe “pointue”. Ce qui ne m’empêche pas de vouloir m’adresser au cœur ; j’aime la danse qui s’associe au théâtre, à la musique, devient un corps universel. » Maud Le Pladec l’a prouvé, qui après quinze ans de danse chez Georges Appaix, Mathilde Monnier ou Boris Charmatz se lance dans la chorégraphie et travaille avec des metteurs en scène : en 2015 à l’Opéra de Lille avec le Flamand Guy Cassiers pour Xerse, de Francesco Cavalli (et Lully pour les ballets), en 2016 avec Thomas Jolly pour Eliogabalo, de Cavalli, à l’Opéra de Paris. Les deux artistes se sont enfin trouvés sur un opéra où Thomas Jolly mêle constamment la danse à la musique. Mais après l’exercice les voilà bientôt débordés d’autres boulots, au Centre chorégraphique d’Orléans où Maud Le Pladec succède en 2017 à Josef Nadj, ou au Centre dramatique d’Angers que dirigera trop brièvement Thomas Jolly (lire notre épisode 2). Le gigantisme de l’espace était un défi : pour être visible, il faut à chaque tableau au moins cent cinquante danseurs. Maud Le Pladec, chorégraphe Août 2022. Maud Le Pladec vient d’achever Silent Legacy au Festival d’Avignon – dialogue entre une jeune krumpeuse de 8 ans et une danseuse contemporaine – quand Thomas Jolly lui téléphone pour lui proposer d’être la chorégraphe des JO. Elle accepte d’emblée sans y croire. En décembre 2022, elle planche déjà avec l’équipe artistique. En février, le récit qui porte la manifestation du pont d’Austerlitz au pont d’Iéna est dessiné à gros traits. Maud Le Pladec peut commencer à travailler sur la douzaine de tableaux prévus. Corps des athlètes, corps des danseurs : la chorégraphie est la discipline phare de la cérémonie d’ouverture. « Mon rôle est d’y véhiculer les valeurs du sport, de la République, de la France, et de célébrer l’arrivée du break comme la danse classique. L’équipe artistique que nous formons autour de Thomas désire marquer les cœurs comme les esprits, toucher ce monde entier qui va nous regarder. Vu l’ampleur de l’évènement, je n’avais pas envie de m’y coller seule. Je chorégraphierai personnellement cinq tableaux – soit mille danseurs en tout à diriger ! – et j’ai choisi une vingtaine de talentueux chorégraphes et personnalités de la danse pour les autres. Nous avons en tout auditionné deux mille danseurs que je souhaitais de tous âges, couleurs, morphologies et même avec des handicaps. » Comme une comédie musicale au cinéma De prestigieuses compagnies nationales sont encore prévues pour virevolter sur les quais de Seine (deux), les berges, les toits (cinq), les façades (deux), les ponts (deux) et même un escalier : le point fort s’annonçant entre le Pont-Neuf et Notre-Dame où l’on devrait danser la vie parisienne aujourd’hui. « Le gigantisme de l’espace était un défi : pour être visible, il faut à chaque tableau au moins cent cinquante danseurs. Faire se rencontrer le patrimoine et la danse contemporaine en était un autre. Mais pas question de faire de l’illustration, de la danse qui raconte. Plutôt une danse qui exulte un Paris en fête. » La musique, la première à être créée, par Victor Le Masne (lire notre épisode 7), a donné le tempo. Quels corps pourraient au mieux l’incarner ? Chaque tableau s’est ensuite construit comme une comédie musicale au cinéma, en pensant simultanément comment les chorégraphies seraient filmées et magnifiées lors de la retransmission télé mondiale. « Travailler avec des contraintes est ma passion. Tout lieu est intéressant, il n’y a rien d’impossible, il faut juste traduire avec imagination son ambition artistique. » Thomas Jolly ne semble pas s’être trompé en choisissant cette boule d’énergie et d’enthousiasme qui vient d’être nommée directrice du Ballet de Lorraine. Rien ne lui fait peur. Et elle se réjouit avec lui que Paris devienne le 26 juillet un somptueux théâtre en plein air. « La création de Thomas est révolutionnaire, comme l’est Paris. Cette cérémonie gigantesque va nous rassembler, nous inclure sous l’œil du monde entier. » Thomas Jolly la regarde avec ravissement. Mais refuse de répondre sur la présence éventuelle de Céline Dion. « Tant de noms circulent ! Je laisse dire, car ces bruits sont à mon sens le reflet d’envies qui sont transformées en info. Gims prétend avoir été appelé… Et Matt Pokora regrette qu’on ne l’ait pas appelé… Ces rumeurs sont finalement des alliées. Elles sèment le trouble. Et le désir. » À suivre… propos recueillis par Fabienne Pascaud / Télérama Légende photo : Thomas Jolly, directeur artistique des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Photo Damien Grenon/Photo12 via AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 1, 2023 11:14 AM
|
Publié par Véronique Hotte dans son blog Hottello 22/02/23 Rencontre avec André Markowicz autour de Les Juifs de Evgueni Tchirikov, traduit par André Markowicz. Hall du Théâtre Nanterre-Amandiers, le samedi 18 mars de 15h à 17h. Entrée libre. A 18h, spectacle Le Dragon, mise en scène par Thomas Jolly.
Comment parler de ma Russie aujourd’hui, quand la Russie – quand l’armée de Poutine – commet les crimes qu’elle commet en Ukraine ?, interroge André Markowicz. La Russie a toujours connu la dictature, et, toujours, ce sont des écrivains et des poètes, souvent au risque de leur vie, qui ont porté la flamme de l’humanité dans une société où ne règnent que la peur et la haine. Auteur invité au Théâtre Nanterre-Amandiers, après avoir traduit l’ensemble des oeuvres de fiction de Dostoïevski, Eugène Onéguine de Pouchkine, l’ensemble du théâtre de Tchekhov – avec Françoise Morvan – et plus d’une centaine d’autres textes, André Markowicz parlera du travail qu’il mène aujourd’hui, sur des textes moins connus, mais tellement essentiels, les derniers livres parus aux Editions Mesures qu’il anime avec Françoise Morvan – , et surtout d’une pièce dont la publication a été soutenue par le Théâtre : Les Juifs d’Evgueni Tchirikov, – aujourd’hui sombrés dans l’oubli, tant pour la pièce que pour l’auteur, mais d’une acuité incroyable. Ce qui se passe, à l’intérieur du monde juif, quelques jours, puis un jour, puis pendant un pogrom. La pièce a été écrite en 1905, après les pogroms effroyables qui avaient traversé l’Empire russe. Cette pièce, il voudrait que tout le monde la lise… Paru aux éditions Mesures en 2023, l’ouvrage d’Evguéni Tchirikov Les Juifs raconte un drame bouleversant et d’une grande complexité sur toute la vie juive dans la Russie du début du siècle dernier. André Markowicz décide alors de la traduire du russe et d’écrire une préface pour cette parution en France. « Nous avons voulu lui donner une deuxième vie », écrit les éditions Mesures. Cette pièce, montée par Meyerhold en 1906, fut interdite en Russie mais jouée à travers l’Europe et aux Etats-Unis. Véronique Hotte Rencontre avec André Markowicz autour de Les Juifs de Evgueni Tchirikov, traduit par André Markowicz. Hall du Théâtre Nanterre-Amandiers, le samedi 18 mars de 15h à 17h. Entrée libre. A 18h, spectacle Le Dragon, mise en scène par Thomas Jolly.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 19, 2022 7:24 PM
|
Propos recueillis par Brigitte Salino dans Le Monde - 19 nov. 2022 Dans un entretien au « Monde », le directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques 2024 répond à Gérald Darmanin évoquant un report ou une annulation des festivals à l’été 2024. Lire l'article sur le site du Monde :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/19/jo-paris-2024-pour-thomas-jolly-on-ne-peut-pas-opposer-sport-et-culture_6150694_3246.html
Thomas Jolly, nommé à la direction artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de l’été 2024 et metteur en scène de l’opéra rock Starmania, revient sur les déclarations du ministre de l’intérieur, le 25 octobre, annonçant un possible « report ou annulation des grands événements sportifs ou culturels mobilisant de nombreuses forces de police et de gendarmes ». Il dit son inquiétude pour les professionnels et les territoires. Comment avez-vous réagi aux propos de Gérald Darmanin ? J’ai été surpris, puis stupéfait, puis inquiet. Je comprends les impératifs de sécurité, d’autant que, pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d’ouverture n’aura pas lieu dans un stade, mais le long de la Seine, et que des milliers d’athlètes, des centaines de milliers de spectateurs et des chefs d’Etat seront présents. Ce qui m’a surpris, c’est que l’annonce du manque de gendarmes et de policiers ne sorte que maintenant, alors que les Jeux sont annoncés depuis longtemps. « N’oublions pas que tous les Français ne seront pas à Paris en juillet 2024. Chacun a droit à un accès à la culture, où qu’il soit » Ensuite, j’ai été stupéfait que le ministre de l’intérieur oppose la culture et le sport, car c’est contraire aux valeurs de l’olympisme. Et enfin, j’ai été très inquiet pour les festivals que je connais bien pour y avoir travaillé, et pas seulement à Avignon. Pour les professionnels et les territoires, ils sont très importants d’un point de vue économique. Au-delà, ils sont un outil merveilleux. N’oublions pas que tous les Français ne seront pas à Paris en juillet 2024. Chacun a droit à un accès à la culture, où qu’il soit. Iriez-vous jusqu’à mettre votre poste en jeu pour défendre cette cause ? Ce serait triste d’en arriver là. On verra le moment venu. Je comprends qu’il y ait des crispations. Mon mandat a démarré en janvier 2020, avec le Covid-19, il a fallu réinventer de nouvelles façons de travailler. Par ailleurs, l’équipe a dû s’adapter à mon projet, alors qu’elle avait l’habitude de travailler avec mon prédécesseur, Frédéric Bélier-Garcia, qui est resté treize ans en poste. Après ma nomination pour les JO, j’ai démissionné purement et simplement, de manière très « réglo ». Je trouve étonnant que l’on pose une lumière suspicieuse sur cette démission. On pourrait se réjouir que les Jeux olympiques aient choisi un jeune metteur en scène du théâtre public. Quand vous a-t-on proposé d’être le directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques ? En octobre 2021, le journal L’Equipe avait demandé à quelques artistes, dont moi, ce qu’ils imagineraient pour ces cérémonies. L’article a dû faire son petit chemin. En juin, j’ai été approché par Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des JO, et son conseiller Thierry Reboul, puis par Anne Hidalgo, la maire de Paris. Mi-août, ils ont proposé mon nom au CIO [Comité international olympique]. Fin août, j’ai été choisi à l’unanimité. Mi-septembre, j’ai rencontré Emmanuel Macron. Le 27 septembre, j’ai été nommé. Comment le rendez-vous avec le président de la République s’est-il passé ? J’ai présenté les grands axes de mon projet, il les a écoutés. Je lui ai demandé : « Qu’est-ce que la France, pour vous ? » Et il m’a répondu que la France est un récit avant d’être une identité. Un récit qui ne cesse d’être en mouvement, de se construire, de se réinterroger, de se réinventer. Je trouve cette idée d’autant plus inspirante que je n’ai pas l’intention de faire une cérémonie muséale à la gloire de l’histoire de France. Cette histoire est présente dans le trajet de la cérémonie d’ouverture, 6 kilomètres d’Austerlitz au Trocadéro, qui passent par le Louvre, la Conciergerie, la tour Eiffel, Notre-Dame, évidemment… Je suis en train de me familiariser avec ce dispositif, pour trouver un espace de création à l’intérieur. La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques se tiendra sur la place de la Concorde, et les cérémonies de clôture auront lieu au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Thomas Jolly sur les JO de Paris 2024 : « On peut être sobre et spectaculaire » Comment organisez-vous le travail ? J’ai formé un comité dramaturgique, constitué d’auteurs et d’autrices qui travaillent sur les grandes lignes des récits. Je veux insister sur les emblèmes de la France, ceux que l’on connaît à travers notre histoire et ceux que notre histoire, présente et future, pourrait inventer. A partir du printemps, je commencerai à développer le projet scénique, en m’entourant d’un référent ou d’une référente pour chaque discipline, la danse, la musique, l’image filmique, les costumes… Puis je verrai si je mets tout en scène ou si je délègue des parties à des artistes Il y a aura des spectateurs le long des 6 kilomètres. Comment les satisfaire tous ? Même si l’égalité est un frontispice de notre république, elle ne sera pas possible. Sur 6 kilomètres, on ne peut pas tous voir la même chose. En revanche, il y aura une équité : où que l’on soit, un spectacle aura lieu. Propos recueillis par Brigitte Salino Lire aussi JO Paris 2024 : la Seine sera le théâtre de la cérémonie d’ouverture des Jeux, devant 600 000 personnes Légende photo : Thomas Jolly, à Paris, le 13 septembre 2022. ANTHONY DORFMANN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 12, 2022 5:31 AM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 12 novembre 2022 Préférant se consacrer aux cérémonies olympiques et à d’autres projets, le metteur en scène a quitté jeudi l’institution, en proie à des tensions sociales et financières comme le reste des centres dramatiques nationaux. En interne, certains employés semblent soulagés du départ du directeur. Solaire au soir du 8 novembre, Thomas Jolly accourt sur le plateau de Starmania pour recevoir, comme le showman Luc Plamondon et la gigantesque équipe réunie sur la Seine Musicale à Paris, un accueil triomphal. Sa veste semble alors à l’image de sa carrière : elle brille de cent facettes et de mille feux. Sitôt bouclée la recréation de l’opéra rock, le virevoltant «petit prince du théâtre public» – comme l’écrivaient certains – s’attellera au défi herculéen des deux ans à venir : la direction artistique de quatre cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques, activité prenante auquel l’intéressé doit se consacrer parallèlement à la mise en scène d’un Roméo et Juliette de Charles Gounod en juin 2023 à l’Opéra national de Paris. Une grande valse de levés de rideaux, donc. Il fallait bien que l’un d’eux se referme définitivement. Au lendemain de la première de Starmania, ce metteur en scène quadragénaire à l’ascension spectaculaire annonçait par mail à ses équipes sa démission du Quai d’Angers. Le sort de cet établissement culturel d’une quarantaine de salariés que Thomas Jolly dirigeait depuis plus de deux ans était laissé en suspens depuis sa nomination pour Paris 2024 fin septembre. Il suscite depuis plusieurs mois de vives inquiétudes à en croire le dernier rapport d’orientation budgétaire et plusieurs salariés de la maison contactés par Libération. Depuis début 2020, en effet, Thomas Jolly n’était plus seulement le metteur en scène médiatique célébré par une partie du public pour ses marathons théâtraux (Henry VI, Richard III), il était aussi le patron du seul centre dramatique national (CDN) des Pays-de-la-Loire. Une institution où il fut nommé quelques mois après sa déconvenue au Théâtre national populaire de Villeurbanne : son nom n’avait «même pas» été retenu en short-list pour la direction de ce CDN, s’était-il indigné sur les réseaux sociaux en dépit de la clarté de l’avis de consultation réclamant «une expérience significative dans la direction d’un établissement culturel». Ainsi Thomas Jolly atterrissait-il à Angers pour son baptême du feu en tant que patron d’institution. La ville était ravie de voir son navire amiral incarné par ce jeune chouchou des webtélés, célébré pour ses «œuvres monstres» (dixit le ministère) l’esthétique baroque, notamment programmées par Olivier Py au Festival d’Avignon. Le Quai d’Angers, avec un budget annuel de 7 à 8 millions d’euros, a pour mission première de produire et coproduire des spectacles : ceux du directeur Thomas Jolly mais aussi d’autres artistes, accueillis en résidence, engagés dans les actions de démocratisation, impliquant la plus grande diversité possible d’usagers dans la vie du théâtre. Au vu de la stagnation des fonds publics et de l’augmentation des coûts de fonctionnement, au vu des défis écologiques, de la crise de diffusion post-Covid, de la mutation des pratiques du public, de la concurrence des plateformes, la tâche est immense. «C’est mieux pour tout le monde» Pour l’assurer, cumuler comme Thomas Jolly les casquettes de metteur en scène et de commandant de bord est obligatoire : le cahier des charges des 38 CDN du territoire, label indissociable de l’histoire de la décentralisation théâtrale d’après-guerre, implique de nommer un artiste au gouvernail… mais rien n’est dit du cas exceptionnel d’un directeur amené à s’absenter aussi longtemps que lui de son fauteuil, Starmania, Opéra et JO cumulés. Fin septembre, donc, la valse des pronostics s’ouvrait à Angers : leur jeune directeur cumulerait-il les fonctions ? Retrouverait-il son poste au Quai après les Jeux olympiques ? Si oui, choisirait-il lui-même son intérim ? Situation clarifiée. De loin, le retrait de Thomas Jolly ferait l’effet d’une fusée se délestant de ses propulseurs. Mais la démission fut son dernier scénario, il évoque son départ définitif comme un crève-cœur mais l’intérim lui paraissait «trop fragilisant» pour le théâtre. Son départ sera effectif d’ici trois mois. Et au Quai, en interne, le monde est stone ? Comme d’autres de ses collègues interrogés par Libération, un employé semble plutôt soulagé : «C’est mieux pour tout le monde, détaille-t-il. [Thomas Jolly] part l’esprit libre vers d’autres projets d’exception et permet au théâtre de se relancer sur un autre projet même s’il laisse une équipe épuisée côté RH et des perspectives financières difficiles.» Ces derniers mois, les rapports se sont en effet tendus entre le jeune directeur et une partie de l’équipe du Quai. Entérinant une satanée loi de Murphy qui voudrait que l’arrivée d’une nouvelle équipe artistique à la tête d’un CDN aille rarement sans un conflit social plus ou moins préoccupant. Le 11 octobre, soit trois semaines après l’annonce de la nomination aux JO, un rapport d’orientation budgétaire pour 2023 était présenté en conseil d’administration devant les partenaires publics du théâtre et s’alarmait : «Le Quai entre dans une spirale qui risque de lui coûter la part la plus importante de son activité.» Coûts de production importants des pièces (grands plateaux et décors, technique importante), difficulté à les vendre à l’extérieur, à trouver les partenaires désireux de coproduire, à les rentabiliser… «Il nous est impossible de produire ou coproduire sur nos fonds propres un futur spectacle pour ce second semestre 2023», note le rapport. Seule pourrait s’envisager la reprise du Dragon, une autre pièce de Thomas Jolly. Le risque de «décrochage» a, précise le document, été «souvent évoqué» précédemment. Mais ce problème serait «contextuel» et non inhérent à son projet, rétorque le directeur qui a contesté les formulations du document devant les partenaires publics : «J’ai en effet décidé de mettre en place trois nouvelles productions de jeunes metteuses en scène qui ont été portées principalement par le Quai, c’est vrai. En sortie de Covid, elles n’ont pas eu la diffusion escomptée (comme beaucoup d’autres), poursuit Thomas Jolly. Je ne veux pas dire qu’il faut jeter l’argent par les fenêtres mais si la solution c’est de monter des seuls en scène – comme on me l’a dit au Quai –, il y a un souci dans les CDN.» Ruissellement du glamour Lors du dernier conseil d’administration, l’ambiance autour de la table était d’autant plus «glaciale», nous relate-t-on, que le rapport mentionnait en conclusion la «tension sociale» montante dans la maison. Sans plus développer par écrit ce que les membres du comité social et économique (CSE) faisaient remonter au directeur lors de leur dernière réunion début octobre : un document que nous avons pu consulter pointe, entre autres, l’«entre-soi décisionnel» qui serait celui de l’équipe dirigeante, son absence «d’appui sur l’équipe historique». En pomme de discorde, cette phrase figurant sur l’ordre du jour, que l’artiste-directeur nous répète aujourd’hui de mémoire, et qui l’a «violemment blessé, dit-il, car elle remet en question mon éthique, mon projet, mon engagement dans le service public : “Le sentiment que Thomas Jolly utilise le Quai pour son image personnelle et pas pour un projet de service public”». L’artiste a refusé de répondre au CSE, demandé une «médiation extérieure» et a ensuite reposé le sujet «dans une volonté de concorde et d’apaisement» devant l’ensemble de l’équipe lors d’une réunion ultérieure. S’ensuivait, le 14 octobre, une lettre des salarié·e·s, signée à 80 % de l’effectif, renouvelant au directeur leurs «inquiétudes au regard de la situation globale du Quai» et réaffirmant «la légitimité du CSE en tant que représentant» de leur parole. Thomas Jolly, conscient de son «aura médiatique», croit au ruissellement du glamour qui l’entoure sur ces institutions fragilisées. Il soupire de lassitude, s’estime frustré de n’avoir «jamais pu [s]’expliquer avec eux sur ce sujet» et enchaîne : «L’institution, ce doit être un outil et non pas un cadre. J’ai peut-être manqué de pédagogie mais il y a aussi de la résistance au changement.» Depuis, l’ambiance serait «très délicate», confiait un salarié en début de semaine : «Thomas est à Paris sur Starmania, le secrétaire général est en arrêt maladie depuis trois semaines et le directeur adjoint aux productions vient lui aussi de se mettre en arrêt.» Thomas Jolly est loin d’être le seul artiste-directeur à avoir vécu des tensions sociales dans un CDN. Fin 2019, le Monde revenait en longueur sur la multiplication des conflits dans ces maisons où se «livre en coulisse un combat à couteaux tirés entre la liberté de création et le droit du travail». D’un côté, des artistes-directeurs de passage légitimement désireux de réinventer les institutions ; de l’autre, les équipes permanentes des théâtres légitimement irritées de n’être (parfois) pas assez écoutées. Combien sont-ils, ces metteurs en scène propulsés du statut de chef de compagnie à celui de directeur de PME, se cassant les dents à leur arrivée sur les principes de management et de gestion des ressources humaines ? Thomas Jolly voulait faire mentir le sort : «J’ai pris ce poste à Angers parce que j’en avais marre d’entendre ces discours sur l’institution, aussi parce qu’elle est attaquée sur ces motifs par la droite et de plus en plus de mairies. Je voulais anticiper ces problèmes, qu’on se parle…» Système de nomination jugé «absurde» Derrière ces tensions enflant dans l’ombre de la préparation des JO et de Starmania, un problème structurel revient ainsi sur le devant de la scène. Il touche au système de nomination à ces labels jugé «absurde» par une partie du secteur et au cahier des charges «disproportionné». Déficit d’accompagnement de l’artiste en poste, manque de tuilage avec l’équipe sortante, budget artistique de plus en plus limité, responsabilité parfois baroque… «Je suis le responsable unique de la sécurité des 26 000 m² du bâtiment, moi Thomas Jolly !» En 2019, lors de son départ du CDN de Nanterre-Amandiers, Philippe Quesne s’indignait de son côté : «Il faudrait peut-être arrêter de nommer des gens six mois avant leur prise de poste. Pour ma part, j’ai eu trois mois avant de dire bonjour à une équipe de 60 personnes !» Pour une directrice adjointe d’établissement culturel, «il faudrait a minima officialiser des candidatures mixtes : continuer de nommer des artistes à ces postes, bien sûr, mais en s’assurant qu’ils soient correctement épaulés par un intendant. A l’heure actuelle, et c’est officieux, les tutelles permettent à l’artiste d’arriver en poste avec le numéro 2 de son choix…» Mais encore faut-il savoir le choisir. Thomas Jolly, pour sa part, a confié la direction de la production du Quai d’Angers à un de ses acteurs et assistant à la mise en scène, formé au management culturel à l’université mais primo-arrivant à un tel poste. Un employé du Quai torpille : «Comment peut-on faire pareille erreur de casting ? Comment voulez-vous que cet acteur ait le réseau de coproducteurs suffisant ?» D’autres adoucissent, pointant la «jeunesse» de leur équipe de direction et une arrivée «compliquée par le Covid». La plupart en conviennent au Quai : responsabilité revient aussi aux tutelles de prendre davantage soin du système de nomination et du cahier des charges de ces maisons. Contacté par Libération à plusieurs reprises, le ministère de la Culture n’a pas donné suite à nos sollicitations. De son côté, Thomas Jolly renouvelle son «soutien absolu» à son adjoint et pointe les projets «merveilleux» que l’équipe et lui sont parvenus à mener en dépit de la crise : «[Je sais] que je ne me ferai pas des amis : L’institution va mal, elle est même mourante. Les directeurs sont cadenassés par le cahier des charges, les équipes se tendent. Pourtant, il faut absolument la faire vivre.» Eve Beauvallet Légende photo : Thomas Jolly va s’atteler à la direction artistique de cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques. (Anthony Dorfmann)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 22, 2022 6:06 AM
|
Par Sylvie Kerviel dans le Monde - 22 septembre 2022 Le metteur en scène a été choisi pour assurer la direction artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture, qui auront lieu dans la capitale. Il se dit « bouleversé d’émotion » d’avoir été choisi, mercredi 21 septembre, par le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) pour assurer la direction artistique des quatre cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) et des Jeux paralympiques (du 28 août au 8 septembre) de Paris 2024. A 40 ans, l’acteur et metteur en scène Thomas Jolly, joint au téléphone en pleine répétition de la reprise de la comédie musicale Starmania, du tandem Luc Plamondon-Michel Berger, qui sera présentée à partir de novembre à La Seine musicale de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), accueille avec « joie et fierté » cette mission. Il a été contacté au printemps par le comité, qui avait retenu les noms d’une dizaine de personnes du milieu du spectacle. Lire aussi : JO 2024 à Paris : le metteur en scène Thomas Jolly nommé directeur artistique de la cérémonie d’ouverture Remarqué pour ses spectacles marathon (vingt-quatre heures pour la tétralogie shakespearienne présentée cette année au Quai à Angers) qui laissent le spectateur épuisé mais transporté par la créativité de ses mises en scène, le quadragénaire, directeur du centre dramatique du Quai à Angers depuis 2020, se voit offrir une scène à la dimension de son imagination, en plein cœur de Paris, avec la Seine comme fil conducteur. Et pour un public de plusieurs milliards de personnes à travers le monde, au-delà des quelque 500 000 qui pourront suivre les festivités depuis les rives du fleuve. « Il y a bien sûr une pression, mais la joie apaise ma peur. Je fais du théâtre public avec l’ambition de m’adresser au plus grand nombre. Là, cela va être le monde entier ! », s’exclame-t-il, fier aussi de se voir confier cette responsabilité cent ans après les précédents Jeux olympiques parisiens de 1924. En 1992, lors des Jeux olympiques d’hiver d’Albertville, c’est le chorégraphe Philippe Decouflé qui avait mis en scène la cérémonie d’ouverture. « Casser les codes » Les dimensions de la « scène » qu’il aura à animer ne l’effraient pas davantage. La perspective d’utiliser le fleuve comme plateau lui apparaît même comme « une belle opportunité poétique. Et la possibilité de remonter le cours de l’histoire de Paris en remontant le cours de la Seine, jalonnée de monuments. Le dispositif est ambitieux, c’est la première fois que les cérémonies n’auront pas lieu dans un stade ». Lire aussi Thomas Jolly, metteur en scène : « Quand ma grand-mère est entrée pour la première fois sur le plateau, j’ai pleuré à torrents » A l’heure où le mot « sobriété » s’impose partout, comment imagine-t-il pouvoir concilier cette notion avec la flamboyance qui caractérise son travail ? « On peut être sobre et spectaculaire. Mais pour autant, on ne tombera pas dans un décorum de carton-pâte ! », répond Thomas Jolly, qui, dans ses mises en scène à la frontière du théâtre, du cinéma et de l’opéra-rock, s’efforce depuis toujours d’utiliser des décors de récupération. « Ses spectacles hors norme sont la preuve qu’il sait casser les codes de son art pour le porter au plus haut », a déclaré Tony Estanguet, patron du Comité d’organisation des JO, afin de justifier le choix de Thomas Jolly pour orchestrer ce que le comité ambitionne : « un moment de rassemblement et de fierté pour tous les Français ». « Ce sont des valeurs qui sont les miennes, appuie le dramaturge, avec l’ouverture, le partage. Surtout après la période dramatique que Paris a traversée, les attentats de 2015, l’incendie de Notre-Dame de Paris. Je veux faire de ces Jeux un “nous” ». Sylvie Kerviel Légende photo : Thomas Jolly a été nommé, mercredi 21 septembre, directeur artistique de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. ANTHONY DORFMANN

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 18, 2022 5:30 AM
|
Par Lucile Commeaux dans Libération - 17 avril 2022 Habitué des grands textes revisités sur un mode gothico-pop, le metteur en scène signe une adaptation bancale et clownesque du conte de fées satirique «Le Dragon» du dramaturge soviétique Evgueni Schwartz. On connaissait la patte Thomas Jolly sur le grand répertoire – Shakespeare, Sénèque –, on la découvre appliquée à un texte méconnu : le Dragon, œuvre d’Evgueni Schwartz écrite en 1944 pour la jeunesse, interdite dès la première par un régime soviétique qui proscrivait ce qu’on appelait alors «la nocivité du conte de fées» au nom du réalisme socialiste décrété sous Staline. Au conte, Thomas Jolly et sa compagnie la Piccola Familia apposent leur esthétique habituelle – noire, gothique et pop – sur une scène au décor alambiqué. Derrière une vaste forme surlignée de néons qui évoque un œil de dragon, se superposent des architectures asymétriques : maisonnette bancale, portes de donjons, cercueils-coffres-forts et fonds gris découpés à la Fritz Lang, le tout plongé dans une fumée quasi omniprésente et des nappes électroniques. Gros arsenal pour un texte dont l’argument est pourtant rudimentaire : un dragon à trois têtes règne d’une main de fer sur un royaume soumis, dont les sujets l’aiment autant qu’ils le haïssent, jusqu’à ce qu’un étranger, «héros professionnel» du nom de Lancelot, décide de le combattre, et ne déstabilise pour le meilleur toute la structure sociale de la contrée. La fable politique épuise vite sa substance, le temps – vingt minutes à tout casser – que les personnages révèlent leur fonction. Pas de chance, il reste deux heures et demie. Pédagogico-lourdingue Sur l’édifice fragile de la fable enfantine, la grammaire Jolly n’a jamais paru aussi régressive, avec ses maquillages Famille Addams et ses accents Disney. Appliqués à un récit aussi faible, la pantomime et le surrégime redoublent inutilement des propos ultra lisibles. Les ficelles sont énormes, le texte farci de clowneries détachables comme des sketchs – témoin ces longues minutes d’un numéro politique grotesque, discours et corps emberlificotés devant un micro à pied. Si on ajoute à cela les clins d’œil répétés à notre époque, qui appuient à gros trait sur le fameux parallèle entre les années 30 et notre temps (le fascisme-à-nos-portes, les fake news, la fin de la «bamboche»), on obtient un spectacle pédagogico-lourdingue bien peu offensif, voire d’un agaçant opportunisme. Ici pas de «nocivité du conte de fées», pas de terreur, pas de pitié non plus, mais des rigolades qui tombent souvent à plat, et une morale conciliatrice navrante. Ça défile comme à la kermesse de l’école, mais une kermesse avec des gros sous et du gros son. Car le gros spectacle, Thomas Jolly sait faire, et il démontre encore une fois malgré la faiblesse dramaturgique du texte, sa maîtrise de l’espace, des décors, et du jeu. Lumières et musique rythment le récit au cordeau dans des espaces compliqués, et les comédiens engagent toute la plasticité de leurs corps et de leurs voix, très convaincants dans le genre boulevard. Dans le système Jolly, c’est souvent l’artefact théâtral qui accroche, et sur la morne plaine de cette bien pauvre épopée, un objet parfois ravive l’attention : une tête de dragon monumentale et animée comme une marionnette, un cochon de lait servi à la noce dont la patte (la «papatte») bouge. Alors que Lancelot s’équipe pour le grand combat, on lit sur son étendard «vaincre et faire la fête». Malheureusement le spectacle ne fait ni du tout l’un ni vraiment l’autre. Le Dragon d’Evgueni Schwartz mise en scène de Thomas Jolly et la Piccola Familia à la Grande Halle de la Villette (75019), jusqu’au 17 avril. Au Théâtre du Nord de Lille du 27 au 30 avril.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 21, 2022 4:51 AM
|
Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 21 janvier 2022 Pour son premier grand spectacle en tant que directeur du Quai d’Angers, le metteur en scène s’attaque à cette pièce méconnue d’Evgueni Schwarz. Epopée politico-fantastique, elle se transforme, sous sa houlette, en show sous stéroïdes. Utiliser des figures mythiques, mythologiques, voire fantastiques, pour dire le contemporain. Le procédé n’est pas nouveau, et a même le vent en poupe, mais il est poussé chez Evgueni Schwartz à son paroxysme, dans un mélange, à première vue surprenant, entre créatures médiévales et régimes autoritaires, du XXe comme du XXIe siècle. Assez peu connu en France, son Dragon a pourtant été monté par des metteurs en scène de renom, tels Antoine Vitez et Benno Besson, mais également, plus récemment, par Christophe Rauck. Et c’est au tour de Thomas Jolly, pour sa première grosse production en tant que directeur du Quai d’Angers, de s’inscrire dans cette belle lignée, de s’emparer de ce texte plus sulfureux qu’on ne le croit a priori – assez, en tous cas, pour donner des sueurs froides au pouvoir soviétique qui l’a censuré juste après sa première représentation, en 1944, à Moscou, et ce jusqu’en 1962 –, à un moment particulier où les dragons menacent, un peu partout à travers le monde, de sortir de leur tanière. Celui décrit par Evgueni Schwartz règne en maître, depuis maintenant 400 ans, sur une ville dont le dramaturge russe se plaît, pour la rendre encore plus universelle, à taire le nom. Du haut de sa montagne, le monstre tricéphale voit tout, entend tout, contrôle tout, et asservit chacun. Gourmande en vaches, mais aussi en légumes de saison, la créature a instauré un rituel pour le moins cruel, mais accepté, avec une certaine indifférence, par la population : chaque année, il exige qu’une jeune fille de son choix lui soit remise pour l’épouiller et lui gratter les écailles, jusqu’à mourir de dégoût. Elsa, la fille de l’archiviste Charlemagne, est la prochaine sur la liste et elle s’est déjà résolue, fataliste, à son triste sort, prévu pour le lendemain. C’est alors que Lancelot, un héros professionnel, chargé de débarrasser le monde des monstres, débarque. Entiché de la jeune femme dès le premier regard, il se met en tête de défier le dragon ; ce que la créature à trois têtes accepte volontiers, certaine, dans un premier temps, de son invincibilité. Mais liquider le monstre suffira-t-il à libérer la ville du mal ? Rien n’est moins sûr. Car le dragon, et c’est là toute la subtilité du texte de Evgueni Schwartz, a des relais. À commencer par le bourgmestre, idiot utile du village, son fils, érigé en porte-parole de la créature, mais aussi les masses qui, par leur docilité, se sont sans difficulté converties à l’idéologie du monstre. Charlemagne, sa fille et quelques artisans exceptés, Lancelot n’est pas accueilli en libérateur, mais comme un traître qui va semer le chaos. Façon pour Evgueni Schwartz de souligner que les peuples ont bel et bien leur avenir entre leurs mains, et qu’ils sont en partie responsables de leur sort, duquel ils peuvent devenir des victimes consentantes. D’autant que ce conte, qui entendait, tout à la fois, dénoncer le nazisme et le stalinisme, ne verse pas dans le manichéisme. Les intentions de ce Lancelot-là sont moins vertueuses que celles du chevalier de la Table ronde, et le dragon est sans doute plus faible que ses soutiens ne le pensent. Il faut dire que, comme dans tout bon régime autoritaire, tout est organisé pour entretenir l’illusion de la toute-puissance : le culte du chef, la surveillance de tous par tous, le bourrage de crânes, la haine des étrangers – ici des « romanichels », voués aux gémonies en raison de leur nomadisme. À cette pièce d’un genre proche de l’heroic fantasy, Thomas Jolly donne les allures d’une épopée sous stéroïdes, d’un grand spectacle, voire d’un grand show. Malgré quelques embardées humoristiques appuyées qui viennent affaiblir, car alléger par trop, la noirceur et la profondeur du propos, il parvient parfaitement à exposer les enjeux du texte de Evgueni Schwartz, et notamment à montrer la versatilité, la bêtise et le comportement moutonnier des masses face à des tyrans qui, parfois, à l’image du bourgmestre, ne sont pas aussi intouchables qu’elles ne le croient. A l’avenant, son adaptation de la fin de la pièce, où le pouvoir d’agir semble davantage entre les mains de la jeune Elsa que dans celles du héros conquérant, se révèle hautement pertinente, et contemporaine, car elle lui permet d’enjamber, sans trahir le texte, ce topos du retour de l’homme fort, libérateur, à qui tous, et surtout toutes, doivent se soumettre. Constamment à la relance, capable d’imprimer un rythme d’enfer – en dépit de quelques trous d’air dus à certaines longueurs textuelles –, sa mise en scène survitaminée a, malheureusement, les défauts de ses qualités, et de son audace, et frôle le passage en force. Conçue pour en mettre plein la vue, tout est mobilisé à cet effet : la musique tonitruante, les lumières tapageuses, le décor imposant – qui l’oblige à imaginer des intermèdes façon Henry VI lors des changements majeurs. Habituelle chez Thomas Jolly, cette grammaire scénique est assumée, et efficace, mais elle frise, dans ce Dragon, à intervalles réguliers, le trop-plein, au détriment du texte, parfois étouffé, et du jeu des comédiens qui, sans ne manquer ni d’énergie, ni d’esprit de troupe, sont contraints, pour se faire entendre, de pousser le curseur, quitte à se mettre dans le rouge. A la manière de ces héros que l’impératif de flamboyance conduit, bien souvent, à l’épuisement. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Le Dragon
de Evgueni Schwartz
Texte français Benno Besson
Mise en scène Thomas Jolly
Avec Damien Avice, Bruno Bayeux, Moustafa Benaïbout, Clémence Boissé, Gilles Chabrier, Pierre Delmotte, Hiba El Aflahi, Damien Gabriac, Katja Krüger, Pier Lamandé, Damien Marquet, Théo Salemkour, Clémence Solignac, Ophélie Trichard et, en alternance, Mathis Lebreton, Adam Nefla ou Fernand Texier
Collaboration artistique Katja Krüger
Scénographie Bruno de Lavenère
Lumières Antoine Travert
Musique originale et création son Clément Mirguet
Costumes Sylvette Dequest
Accessoires Marc Barotte, Marion Pellarini
Consultante langue russe Anna Ivantchik Production Le Quai CDN Angers Pays de la Loire
Coproduction Théâtre National de Strasbourg, La Comédie – CDN de Reims, Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France, La Villette – Paris
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national Durée : 2h40 Le Quai, CDN Angers Pays de la Loire
du 18 au 25 janvier 2022 Théâtre National de Strasbourg
du 31 janvier au 8 février Palais des Beaux-Arts de Charleroi (Belgique)
les 18 et 19 février Les Salins, Scène nationale de Martigues
les 10 et 11 mars MC2: Grenoble
du 23 au 25 mars La Coursive, Scène nationale de La Rochelle
les 30 et 31 mars CDN Normandie-Rouen
les 8 et 9 avril La Villette, Paris
du 14 au 17 avril Théâtre du Nord, CDN de Lille
du 27 au 30 avril
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...