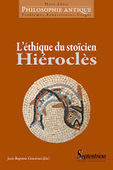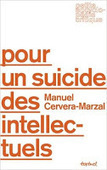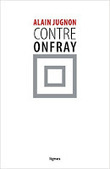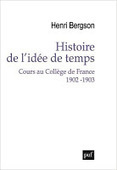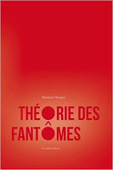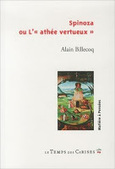Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
dm
February 14, 2016 9:57 AM
|
Le prochain livre de Georges Gastaud, en 4 tomes, « Lumières Communes. Cours laïque de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique », s’annonce comme un événement éditorial. Afin d’accompagner cette publication ambitieuse, preuve de la vitalité de la pensée marxiste et progressiste aujourd’hui, nous lançons une grande souscription. Ne tardez donc pas à envoyer votre bon de commande ci-dessous. Pour commander les 4 tomes et les recevoir à votre domicile, envoyer un chèque de 70 euros (frais de port inclus) à : Editions Delga / 38 rue Dunois / 75 013 Paris

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 12:18 PM
|
La dialectique hégélienne, en tant que négation de la négation, est souvent interprétée comme irrémédiablement téléologique, comme une froide mécanique qui rejette hors du sens toute contingence. Mérite-t-elle pour cela d'être abandonnée ? Si la dialectique est bien ce qui meut tout donné, montrant qu'il ne peut résider en repos en lui-même, abandonner la dialectique revient à se résigner à la factualité et à renoncer à la promesse d'émancipation, de dépassement de ce monde donné, dont la pensée hégélienne est porteuse. Il faudrait alors penser la dialectique sans la téléologie. Mais l'effort de Hegel n'est-il pas déjà de libérer autant qu'il est possible la dialectique de toute téléologie ? De fait, si l'on se tourne vers deux auteurs qui ont critiqué et profondément réformé la dialectique hégélienne - Giovanni Gentile et Theodor Adorno - on se rend compte à l'examen de leur tentative que leur volonté de sauver la totalité de la contingence et leur refus conjoint de toute perspective téléologique conduit la dialectique à, en quelque sorte, s'écrouler sur elle-même. Ces deux formes " d'auto-destruction " de la dialectique montrent ainsi par l'absurde que la téléologie minimale conservée par Hegel n'a pour fonction que de préserver la dialectique. On peut alors interpréter la dialectique plutôt comme principe de détermination que comme moteur d'une téléologie prise en son sens plein ; c'est peut-être ce que nous le suggère la référence à Aristote par laquelle Hegel choisit de clore son Encyclopédie des Sciences philosophiques. La dialectique hégélienne reposerait ainsi sur une téléologie minimale au-delà de laquelle on ne peut aller sans renoncer à la dialectique elle-même. Evelyne Buissière, née en 1962, agrégée de philosophie, docteur (Paris X), HDR (Nice), enseigne en classes préparatoires au Lycée Champollion de Grenoble. A publié Guido Calogero, Laïcisme et Dialogue (Septentrion, 2007), Giovanni Gentile et la Fin de l'Autoconscience, (Harmattan, 2009).

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 11:57 AM
|
Pour point de départ, cette question, cette scène, reprise en charge par Jacques Derrida : « Qu’est-ce que Dieu a dû dire à Abraham ? Que lui a-t-il nécessairement signifié au moment où il lui a donné l’ordre de monter sur le Mont Moriah accompagné d’Isaac et de son âne, en vue du pire “sacrifice” ? Qu’est-ce qu’il a pu lui dire et devoir lui signifier ? » et l’éclairage qu’il lui donne : « On peut avancer, en toute certitude, sans rien savoir d’autre, qu’il a dû lui signifier quelque chose que je résumerai ainsi : “Surtout, pas de journalistes !”. » Dans cette intervention de 1997 lors d’un colloque à l’Institut néerlandais de Paris (« Religion et Média », organisé par Hent de Vries et Samuel Weber), Jacques Derrida s’emploie à croiser les fils de la médiation et de la religion pour questionner à nouveau la « foi et le savoir » : « Pas de lien social sans promesse de vérité, sans un “je te crois”, sans un “je crois”. […] Et même pour mentir, pour tromper, pour abuser, il faut que ce “je te crois” ou “je crois à toi” ou “je crois en toi” soit à l’œuvre. Sur le sol de cette croyance nue, les media se construisent, en essayant de reconstituer sans cesse la perception nue de cette expérience du “crois-moi” ? C’est en ce lieu que les discours des religions essaient de refaire leur nid, quelquefois chacune pour sa chapelle et quelquefois dans l’œcuménisme. Qu’est-ce que les trois grands monothéismes ont en commun ? Si ce n’est pas seulement la référence à Abraham (différemment modulée entre les trois), c’est la foi partagée. »

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 11:16 AM
|
On peut lire ce livre comme un Bestiaire. Mais en sachant que ce n'est pas tout à fait un Bestiaire. S’il concerne essentiellement « les bêtes », il n’a rien d’encyclopédique ni d’alphabétique. L’ordre qui dispose les chapitres n’est calqué que sur les attitudes humaines. Un vagabondage personnel a permis à l’auteur de rassembler des textes où des écrivains, principalement poètes, disent leur émerveillement devant les animaux, en les honorant de la reconnaissance qui leur est due et en épelant les motifs et les nuances d’un enchantement toujours renouvelé. Pour étayer cette « bible poétique animalière », comme l’appelle Élisabeth de Fontenay, il fallait aussi interroger l’« état d’émerveillement ». Souhaitons que cet ouvrage soit lui-même un émerveillement pour ses lecteurs: qu’ainsi ils entrent en la présence animale. Françoise Armengaud, normalienne, agrégée et docteur en philosophie, a enseigné à l’Université de Paris X – Nanterre. Elle s’est consacrée à des questions de philosophie du langage: la pragmatique, la poésie, les titres des oeuvres d’art, ainsi qu’à l’analyse des représentations des animaux dans la culture. On lui doit Réflexions sur la condition faite aux animaux (2011), ainsi que Requiem pour les bêtes meurtries. Essai sur la poésie animalière engagée (2015). Elle travaille actuellement comme scénariste.

|
Scooped by
dm
February 10, 2016 6:07 PM
|
Hiéroclès est un philosophe stoïcien méconnu de l'époque impériale. Combinant éthique appliquée et réflexion sur les fondements naturels de la morale, les longs fragments que l'on conserve de lui offrent une image originale du stoïcisme en prise avec bien des débats contemporains. Ils sont tous analysés en profondeur dans cet ouvrage. Négligé par rapport à Sénèque, Epictète ou Marc Aurèle, Hiéroclès aborde pourtant des thèmes cruciaux du stoïcisme : les rapports de l'âme et du corps, la genèse et la spécificité des facultés animales, nos différents devoirs à l'égard des autres (les dieux, nos concitoyens, nos parents, etc.) et leur articulation. Comment les animaux connaissent-ils leurs forces et leurs faiblesses et se conservent-ils ? Devons-nous traiter tous les hommes comme s'ils faisaient partie de notre famille ? Quelle est la spécificité de la relation entre mari et femme ?

|
Scooped by
dm
February 9, 2016 4:00 PM
|
Des martyrs chrétiens à l’invention de l’anesthésie, de don Quichotte au masochisme, du théâtre de la cruauté à la chirurgie dentaire, des pénitences religieuses à la naissance d’une culture de la sensibilité, et de l’obstétrique à la prise en charge médicale de la douleur chronique, Javier Moscoso livre une étude magistrale consacrée aux transformations du rapport à la douleur en Occident. En s’appuyant sur de très nombreuses sources, philosophiques, médicales, littéraires, iconographiques ou personnelles, il reconstitue les formes à travers lesquelles cette expérience s’est articulée de la Renaissance à aujourd’hui. Javier Moscoso est directeur de recherches en histoire et philosophie des sciences à l’Institut d’histoire du CSIC (Conseil supérieur de la recherche scientifique, Madrid). Il a été chercheur au Centre Alexandre Koyré à Paris, à l’Institut Wellcome d’histoire de la médecine, au département d’histoire des sciences de l’Université de Harvard et à l’Institut Max-Planck à Berlin. Auteur de nombreux articles et d’un ouvrage sur L’Encyclopédie, il a été commissaire d’expositions, en Espagne et dans d’autres pays. La plus récente, SKIN, a attiré plus de cent mille personnes à la Wellcome Collection de Londres.

|
Scooped by
dm
February 9, 2016 3:35 PM
|
Une critique radicale des intellectuels mettant en cause la séparation entre réflexion et exécution. Les débats sur les intellectuels sont souvent vifs en France. Benda, Sartre, Aron, Foucault et Bourdieu ont tous consacré des pages fameuses à l’engagement politique des intellectuels. À partir d’une relecture critique de ces classiques, Manuel Cervera-Marzal, jeune universitaire engagé, n’hésite pas à mettre les pieds dans le plat sans se laisser aller à l’anti-intellectualisme. Provocateur, il cherche à faire réfléchir dans une direction hérétique : la redistribution radicale des tâches de réflexion et d’exécution dans nos sociétés. Ce pamphlet, en plus de proposer une critique actualisée des intellectuels, pose de manière originale les bases d’une utopie reconstructrice entre mutualisation des savoirs et construction d’une intelligence collective. Un point de vue original, associant la polémique à l’imagination utopique.
Manuel Cervera-Marzal est docteur en science politique. Il est attaché d’enseignement et de recherche à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. À 28 ans, ce jeune chercheur a déjà publié 5 ouvrages dontGandhi. Politique de la non-violence (Michalon, collection « Le bien commun », 2015) et Désobéir en démocratie. La pensée désobéissante de Thoreau à Martin Luther King (Aux forges de Vulcain, 2013).

|
Scooped by
dm
February 8, 2016 1:31 PM
|
Christian Leduc, François Pépin, Anne-Lise Rey et Mitia Rioux-Beaulne (dir.)
Ce livre s’intéresse à une rencontre : celle de deux philosophes, mais aussi celle de deux siècles et de deux régimes de pensée. Leibniz (1646-1716) et Diderot (1713-1784) appartiennent à deux traditions en apparence opposées : on associe généralement la pensée leibnizienne aux grands systèmes métaphysiques du XVIIe siècle, et celle de Diderot à la mise en pièces de ces édifices par la voie d’une philosophie expérimentale radicalement antisystématique. Pourtant, plusieurs liens entre les deux œuvres sont visibles, qu’il s’agisse d’emprunts conceptuels ou thématiques par Diderot ou de convergences plus difficiles à circonscrire. Le premier objet de ce livre est d’identifier ces liens et de faire le point sur cette sympathie entre les deux philosophies. Mais ce livre s’intéresse aussi à cette rencontre pour ses effets transformateurs, tant sur le plan des concepts, des thèses et des arguments que sur celui des méthodes. Il s’agit alors de voir comment la rencontre avec le leibnizianisme a nourri la pensée diderotienne, comment la lecture du texte leibnizien par Diderot en modifie le sens, comment elle peut parfois en être une interprétation ou un devenir possible. Pour saisir ces transformations, les auteurs ont examiné divers contextes théoriques dans lesquels les pensées de Leibniz et Diderot dialoguent : métaphysique et philosophie de la nature, épistémologie et philosophie des sciences, théorie de la perception et esthétique. À travers ce dialogue, l’ouvrage contribue à une réflexion générale sur les méthodes requises pour mettre en perspective les rapports entre des philosophies à la fois proches et éloignées.

|
Scooped by
dm
February 4, 2016 4:19 PM
|
Contre Onfray est un essai critique écrit à la première personne du singulier. Publiant Contre Onfray, le philosophe qu'est Alain Jugnon n'écrit pas contre quelqu'un. Par contre, il déconstruit un mouvement général des idées qui, à l'époque du nihilisme et de la détresse de tous, cherche à ne plus analyser, ne plus comprendre et surtout ne plus savoir. Cet essai critique prend naissance dans le commentaire suivant de Guy Debord : " Le gouvernement du spectacle, qui à présent détient tous les moyens de falsifier l'ensemble de la production aussi bien que de la perception, est maître absolu des souvenirs comme il est maître incontrôlé des projets qui façonnent le plus lointain avenir. Il règne partout seul ; il exécute ses jugements sommaires. " Contre Onfray démontre qu'il y a un homme seul au coeur du Spectacle ; ses jugements sont sommaires et grossiers, mais c'est comme toujours la pensée contemporaine qui est exécutée sur les plateaux de télévision. Dans cet essai polémique, ce qui est écrit et détaillé est fait pour refuser le personnage qui se nomme lui-même " le philosophe Michel Onfray ", pour dénoncer ce mensonge spectaculaire et cette tricherie bien intégrée. Mais ce n'est pas un livre contre un homme, car il sera d'abord fait pour que vive demain encore la philosophie et pour en finir avec ce passage à l'acte postmoderne qui veut rendre la pensée honteuse d'elle-même, et ce dans la posture maladive d'une critique bête de l'humanisme et de sa valeur juste humaine, très humaine. L'esprit du temps est à la confusion des esprits et à l'émotion des corps : Michel Onfray en oubliant qu'il fut philosophe est devenu (depuis son livre contre Freud, dans lequel il refusait à la psychanalyse le droit de savoir quoi que ce soit sur son Moi - ce fut sa thérapie) le penseur officiel et écrivain public de cette confusion générale et de cette mascarade adorée qui consiste à faire passer pour des pensées des idées multimédiatiques et d'abord idéologiquement dominantes. Onfray de fait n'est plus nietzschéen et c'est ce qu'il fallait à Alain Jugnon démontrer, ni " de gauche " comme il le croyait, ni un nietzschéen pour la droite comme il le voudrait, il est devenu le fossoyeur de la pensée critique contemporaine. C'est la démocratie et l'humanisme qui s'éclipsent ainsi avec son dernier livre, pris dans l'aspiration droitière et siphonnés avec l'eau du bain de ses mauvaises pensées d'intellectuel célèbre et à la sagesse publique : Onfray est le penseur nouveau de la future nouvelle droite française ; cette conversion se donne à voir dans Cosmos, son dernier livre, sous forme d'un jeu de rôles et de passages à l'acte de la pensée fort peu logiques mais totalement anarchiques (au sens bien sûr non politique du terme). Cet essai de généalogie de la non-pensée onfrayenne relit méthodiquement les écrits du philosophe en regardant de près le travail en négatif de cette conversion : les trahisons du lecteur Michel Onfray sont multiples et ce livre en repère la plupart. Ce sont les contresens de Michel Onfray : au sujet de Foucault, de Lacoue-Labarthe, des poètes en général et de Nietzsche, essentiellement. Ces trahisons sont à chaque occurrence un nihilisme politique à l'oeuvre, une fausse parole mise en actes de langage. Il y a au travail chez Onfray une fausse écriture philosophique (et écriture du faux en philosophie) qui renie tout en bloc, pour son propre plaisir, pour s'émouvoir de sa propre jouissance : ce qu'il nomme un hédonisme et qui a tout d'un dandysme assez pathétique. Alain Jugnon est philosophe et écrivain. Il dirige les Cahiers Artaud (éditions Les cahiers - no 2 paru en octobre 2015) et La Contre attaque, revue poétique et politique (éditions D'ores et déjà). Dernières parutions : La Trique de nos meneurs ou le nanar chrétien, éditions Dasein, 2014 ; Redrum, à la lettre contre le fascisme, collectif (coord.), éditions Les Impressions nouvelles, 2015. Ont paru chez Lignes : Artaudieu et Le Devenir Debord. A paraître : Athéologiques, Editions Dasein, 2016. Alain Jugnon est membre du comité de la revue Lignes.

|
Scooped by
dm
February 4, 2016 4:05 PM
|
Non seulement ce cours publié aujourd'hui sur "l'histoire de l'idée de temps" marque le début de "la gloire de Bergson", mais plus encore il en est la source. Il constitue, avec tous ceux donnés au Collège de France, le trait d'union entre l'oeuvre écrite à laquelle le philosophe tenait exclusivement, telle qu'elle survit à l'époque qui l'a vu naître et qui brille de son éclat propre, et l'enseignement oral dont provient la renommée de l'homme, grâce auquel ses idées se sont insérées dans le monde pour être adoptées par le plus grand nombre. Aussi ont-ils le double privilège de se concentrer comme jamais autour de la pensée de Bergson à laquelle ils apportent une lumière neuve et singulière et de rayonner plus largement encore au-delà du cercle des études spécialisées, en se rendant capable de toucher, comme jadis, un public lointain et non initié. Consacré à l'idée de temps à travers l'histoire des systèmes, ce cours nous donne de pouvoir lire, d'entendre presque la parole libre du philosophe telle qu'elle retentissait il y a plus d'un siècle dans ce haut- lieu de la pensée humaine et que nous avions crue irrémédiablement perdue. Car en le lisant, nous avons cette impression étrange de briser momentanément la loi inexorable du temps. Camille Riquier (préface) est maître de conférences à l'Institut catholique de Paris. Il a réalisé l'édition critique de Matière et mémoire (Puf, 2008) et écrit notamment Archéologie de Bergson (Puf, 2009, Prix La Bruyère 2010).

|
Scooped by
dm
February 4, 2016 3:51 PM
|
Ecrit dans le sillage de la publication récente des Cahiers noirs, ce livre dit l'urgence et la nécessité de relire aujourd'hui la philosophie de Heidegger. Dans sa préface à l'édition française, Donatella Di Cesare écrit : "J'espère que ce livre ne sera jugé qu'après avoir été véritablement lu jusqu'à la fin. Nous sommes dans une période où la complexité est mal supportée [...]. Ce livre prend en considération ce que Heidegger écrit sur les Juifs et sur le judaïsme dans les Cahiers noirs publiés jusqu'à présent, qui couvrent la période de 1931 à 1948. L'antisémitisme est la grande nouveauté de cette oeuvre [...]. Il ne peut en aucune façon être minimisé, pas plus qu'il ne peut être nié [...].Il n'a rien d'un sentiment, d'une haine qui va et vient, et qui peut être circonscrite à une seule période. Il a une provenance théologique et une intention politique. Dans le cas de Heidegger, il revêt également une dimension philosophique. L'adjectif "métaphysique" n'atténue pas l'antisémitisme. Il en indique au contraire la profondeur. Il s'agit d'un antisémitisme plus abstrait et en même temps, pour cette raison, plus dangereux qu'une simple aversion. Mais "métaphysique" renvoie aussi à la tradition de la métaphysique occidentale. Dans son antisémitisme métaphysique, Heidegger n'est pas isolé : il s'inscrit dans le sillage des philosophes, de Kant à Hegel et à Nietzsche. J'ai brièvement reconstruit une sorte d'histoire de l'antisémitisme dans la philosophie allemande qui aide à contextualiser et à comprendre quelques stéréotypes et concepts que Heidegger reprend."
Professeure de philosophie à la Sapienza à Rome, vice-présidente de l'association internationale" Martin Heidegger - Gesellschaft" entre 2011 et 2015, Donatella Di Cesare a démissionné du poste à la suite d'un différend avec Arnulf Heidegger et la direction de l'association qu'elle a également quittée.

|
Scooped by
dm
February 3, 2016 3:34 PM
|
Francis Hutcheson, professeur à l’Université de Glasgow de 1730 à 1746, est un maître de la philosophie écossaise dont les héritiers intellectuels immédiats sont David Hume, Adam Smith et Thomas Reid. Parmi les moralistes britanniques, il se distingue notamment par son style d’exposition très méthodique et argumentatif. Son approche des questions centrales de la philosophie morale et de l’esthétique théorique fait l’objet d’un regain d’intérêt depuis quelques décennies. Le Système de philosophie morale est un ouvrage posthume qui recueille l’essentiel de l’enseignement du philosophe dans l’ensemble des domaines auxquels il a contribué : l’esthétique, la morale, le droit, la politique et l’économie. Il offre ainsi au lecteur la possibilité de se former une image complète de cet acteur majeur du Scottish Enlightenment. Texte traduit, introduit et annoté par Jeanne Szpirglas, agrégée de philosophie et Inspectrice régionale en philosophie.

|
Scooped by
dm
February 2, 2016 1:52 PM
|
De l’amitié d’une vie au simple copinage en passant par les relations de solidarité, le mot « amitié « désigne des affinités différentes. Dans cet essai, Michel Erman en définit la nature faussement considérée comme banale-et ses manifestations dans nos existences. Chacun se représente aisément ce qu’est un ami. Cependant, expliciter le sentiment d’amitié n’est pas chose aisée tant celui-ci paraît, tout à la fois, évident et énigmatique, ainsi que l’exprime la fameuse phrase de Montaigne à propos de La Boétie : «Parce que c’était lui ; parce que c’était moi». L’alchimie de l’amitié illumine de l’intérieur les relations entre les individus et leur rapport à l’altérité comme s’il s’agissait du lien humain par excellence. Un lien qui recèle une véritable force d’âme et permet de revisiter des notions, aujourd’hui galvaudées, comme la générosité, le respect ou encore la fidélité.
Ecrivain et philosophe, professeur d l’université de Bourgogne, Michel Erman est l’auteur d’essais portant sur les passions. C’est aussi un spécialiste de Marcel Proust, auquel il a consacré plusieurs ouvrages.
|

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 12:25 PM
|
Leon Battista Alberti (1404-1472) fut à la fois écrivain, théoricien des arts, architecte et... surprenant athlète. Son aisance en tout fut telle que J. Burckhardt vit surgir en lui le type d'" homme universel " qu'illustrera Léonard de Vinci. Mais cet homme dissimulait un être souffrant dont les écrits contiennent aussi des pages d'un profond pessimisme. Sa naissance illégitime dans une famille patricienne en exil explique son perpétuel désir d'excellence et de reconnaissance. Ses relations difficiles avec les humanistes et les artistes florentins furent à l'origine de ces Entretiens sur la tranquillité de l'âme, rédigés en langue toscane vers 1443 et dotés d'un titre latin : Profugiorum ab aenumera libri III. Alberti y rapporte des conversations tenues en sa présence, lors d'une promenade à Florence, par Agnolo Pandolfini et Nicolas de Médicis. Agnolo s'interroge sur les moyens d'éviter les tourments intérieurs ou de s'en libérer. Nourries de lectures classiques, ces réflexions se distinguent par des notes existentielles et une grande liberté de pensée.

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 12:09 PM
|
Tout a commencé comme une enquête classique, avec l'espoir de déterminer ce que le nom " contemporain " dit de notre rapport au temps, à l'histoire, à l'espace. Mais très vite des myriades de données, parfois contradictoires, se sont imposées. Un véritable brouhaha. On aurait pu les ignorer, faire comme si elles n'existaient pas, et tenter de construire une fiction unitaire qui aurait prétendu dire la totalité de notre identité historique. C'eut été se méprendre sur la dynamique profonde que traduit le nom contemporain. Elle se déploie ainsi : la représentation moderne du monde est débordée de toutes parts par une multiplicité qu'elle ne peut plus contenir, et qui la fait apparaître pour ce qu'elle est : un imaginaire, une illusion ; imaginaire de la distinction, de la séparation, alors que le contemporain propose, lui, un imaginaire marqué par l'indistinction, la déhiérarchisation, la globalisation. Toutes les histoires documentées dans cet essai retrouvent ce mouvement. Ainsi des espaces publics de l'art qui voient la fin du dispositif institution musée d'art moderne au profit des centres d'art contemporain et évoquent par là une manière différente d'habiter le monde. Ainsi du très grand nombre qui ne se laisse plus discipliner dans les concepts politiques hérités de la modernité. D'autres émergent (multitude, publics), prenant mieux en compte la double poussée de la massification et de la différenciation. Ainsi de la production du savoir qui se décentre et s'horizontalise. Ainsi du temps vécu comme une concordance de temporalités à l'ère hypermédiatique. Ainsi de l'imaginaire littéraire, emblématique de la modernité et lié au support-livre, qui intègre un plus vaste régime de publication. Ainsi de la pensée du monde qui est désormais une pensée des mondes. En six stations qui sont autant de mots-clés du contemporain (exposition, médias, controverses, publication, institutionnalisation, archéologie), cet essai s'attache à décrire les transformations actuelles des formes culturelles et des visions de l'histoire. Né en 1975, Lionel Ruffel est professeur de littérature générale et comparée à l'université Paris-VIII et membre junior de l'Institut universitaire de France (promotion 2011). Il est l'auteur de deux essais : Le Dénouement (Verdier, 2005) et Volodine post-exotique (Cécile Defaut, 2007). Il est par ailleurs codirecteur de la collection " Chaoïd " (Verdier), ancien codirecteur de la revue du même nom, et membre fondateur du collectif " L'école de littérature ".

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 11:25 AM
|
Les fantômes sont partout: dans la littérature comme dans le cinéma, la photographie, la peinture, la philosophie, les sciences, la technologie et même dans notre vie psychique. Mais qu'est-ce qu’un fantôme? L’essai Théorie des fantômes tente d’offrir une réponse à cette question. Le fantôme est certes une figure de la peur, mais se pencher sur les formes de la revenance, c’est apprendre à penser les images et les formes artistiques. Envisager le fantôme comme mode de définition de l’image, c’est revenir aux sources culturelles de l’image (étymologies, formes artistiques, questions esthétiques et philosophiques). Qu’est-ce qu’un fantôme? Réponse qui, de Pline à Derrida, de Platon à Spinoza, de Poussin à Hippolyte Bayard, de Homère à Shakespeare, de Hitchcock à M. Night Shyamalan, de Botticelli à Mankiewicz, de Kubrick à Benjamin, d’Aristote à Boccace, de Dante à Oliveira, de Barthes à Alain Cavalier, de Mesmer à Billy Wilder, de Proust au Général Instin, donne les contours esthétiques du fantomatique et des images en s’appuyant sur de nombreuses analyses d’oeuvres littéraires, artistiques et cinématographiques. Cette hantise de la mort qui traverse les oeuvres et la pensée nous permet d’envisager un acte esthétique fondamental, le fantôme. Sébastien Rongier est romancier et essayiste, agrégé de lettres, docteur en esthétique, membre du collectif remue.net. Derniers ouvrages parus: Cinématière (2015), 78 (2015).

|
Scooped by
dm
February 13, 2016 11:07 AM
|
« Je travaille pour le XXIe siècle. » Bonne raison pour y rendre de nouveau présente cette courte initiation qu'on m'avait demandée au siècle dernier. On était alors dans ces années de l'après-guerre, où par-delà les désastres et crimes imprescriptibles, chacun se refaisait tant bien que mal une santé et un moral, et tentait de redonner un sens à l’humain. Comme tout un chacun, je cherchais des réponses, des solutions, bref, un absolu, et qui - excusez du peu - se serait traduit en mots. Des mots, on en trouvait. La mode était à l’existentialisme, au marxisme, au personnalisme et autres mots en isme. Des mots, des mots, mais d’absolu, point. Tel, du moins, que je m’en faisais l’idée - ou l’image. Jusqu’au jour où me tomba entre les mains un livre de Jankélévitch. Nous étions en 1949: c’était la première édition du Traité des vertus. Et si je ne craignais de pousser un peu loin le pastiche, je dirais que m’advint ce qui était arrivé à saint Augustin à qui l’on avait prêté des textes de Plotin et de Porphyre: ma façon de voir s’en trouvait changée du tout au tout. Je n’aurais de cesse, à mesure que passeraient les années, que je n’aie lu l’oeuvre en son entier. Mais sur le moment, comment aurais-je imaginé que onze de ces volumes me seraient offerts au cours des ans par leur auteur, avec un mot de sa main? Lucien Jerphagnon, auteur de nombreux ouvrages, a notamment dirigé l’édition des Œuvres de saint Augustin dans la Bibliothèque de la Pléiade. François Félix, qui est à l’initiative de la présente édition, enseigne la philosophie moderne et contemporaine à l’université de Lausanne.

|
Scooped by
dm
February 10, 2016 5:48 PM
|
Édité par Jean-Baptiste Gourinat, Michel Narcy, Thomas Benatouïl Le dossier de ce numéro porte sur le scepticisme antique et associe des articles de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés pour faire le point sur ce courant philosophie paradoxale, et plus particulièrement sur le néopyrrhonisme d'Enésidème et de Sextus Empiricus. Ce courant se présente comme une philosophie originale, sans doctrine. Peut-il être reconstruit à partir d'autres sources que Sextus Empiricus? Pourquoi cet acharnement à se distinguer de toutes les autres philosophies ? Le scepticisme se considère-t-il même comme une philosophie ? Les sceptiques peuvent-ils utiliser sans contradiction un "critère" pour connaître ou agir ou se réclamer de la seule vie quotidienne contre la philosophie ? Pourquoi Sextus critique-t-il les mathématiques et qu'en accepte-t-il ? Les articles hors-dossier de ce numéro abordent les rapports entre le cynisme et Platon, la nature de la réflexion antique sur l'économie chez Xénophon et Platon, la question controversée des rapports entre épicurisme et géométrie ou la réception de la notion héraclitéenne de contradiction chez Hölderlin et Heidegger.

|
Scooped by
dm
February 9, 2016 3:45 PM
|
Michel Foucault n'est pas réputé être un théoricien de l'Etat, mais un penseur du pouvoir partout où il se trouve (dans l'école, la prison, la caserne, l'usine, l'hôpital). Et pourtant, il apparaît qu'il s'était lancé dans une grande généalogie de l'Etat moderne. Cet ouvrage se propose de dissiper ce paradoxe en démontrant deux choses. Oui, il existe bel et bien une théorie foucaldienne de l'Etat : elle n'est ni systématique ni achevée, mais on peut la reconstituer tant à partir de la fabuleuse richesse des textes de Foucault qu'en le faisant dialoguer avec de grandes entreprises voisines, venues de la philosophie et des sciences sociales : le marxisme, Weber, Elias et Bourdieu, entre autres. Oui, la généalogie est compatible avec la sociologie. Les concepts de biopolitique, discipline, pastorale, gouvernementalité ne sont pas autre chose que des outils pour saisir l'étatisation des rapports de pouvoir, c'est-à-dire les processus de monopolisation politique qui, du Moyen Age à nos jours, sont au principe de nos prétendus Léviathans en Europe. L'Etat ? Non pas le plus froid de tous les monstres froids, ni seulement un grand appareil répressif, mais l'effet et l'opérateur de gouvernementalités multiples, de rationalités hétérogènes, de dispositifs variés. Ceci n'est pas un nouveau livre sur Foucault. C'est un livre sur l'Etat et la possibilité toujours vivante d'en faire une théorie, retrempée dans l'eau acide de la généalogie.

|
Scooped by
dm
February 8, 2016 1:39 PM
|
Contradictions de l’individualisme, embarras du pluralisme, antinomies du productivisme, autant de tensions morales et politiques qui installent la civilisation européenne dans un sentiment de déclin et d’impuissance. Nos héritages contradictoires causent en partie ce désarroi, mais la gestation d’un monde en formation réclame en urgence un ressourcement créateur d’une société ouverte, de l’intérieur, par sa propre puissance de sublimation symbolique. Quand la réalité devient un ensemble de signes, d’informations, de savoirs, d’images, d’arguments et de récits, les moralismes doctrinaires sont dépassés. On s’intègre dans un tel monde comme traducteur ou inventeur, herméneute, esthète, diffuseur et révélateur de sens.

|
Scooped by
dm
February 4, 2016 4:31 PM
|
Ce livre est une anthologie des entretiens philosophiques qu'Ernst Bloch a accordés. Ces interventions d'un des plus grands philosophes allemands du XXe siècle éclaircissent de nombreux aspects de sa pensée. Ernst Bloch y présente notamment, de façon didactique, le grand inventaire des réalisations de l'imagination utopique dans l'histoire de la culture, de l'architecture, de la peinture, de la littérature et de la musique. Il évoque aussi sa vie, sa jeunesse, ses souvenirs d'écoliers, ses années d'études ; il raconte ses amitiés, notamment avec Georges Lukács, Georg Simmel, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Siegfried Kracauer ou Bertolt Brecht ; il relate ses exils, en Suisse et aux Etats-Unis, sa lutte aux côtés des pacifistes contre la politique impériale de Guillaume II, son combat contre l'Allemagne nazie ; il analyse enfin son engagement pour un marxisme " ouvert " et humaniste, opposé au stalinisme et orienté vers la réalisation de " l'utopie concrète ". A travers ce choix de textes réalisé par Arno Münster, l'un des meilleurs spécialistes de Bloch, c'est tout le parcours intellectuel du philosophe qui est tracé, depuis ses premières pensées existentielles, inspirées de la philosophie de Kierkegaard, jusqu'à sa maturité, exprimée notamment dans Le Principe Espérance. Ernst Bloch (1885-1977), grand penseur de " L'Esprit de l'Utopie ", a bâti sa notoriété autour de son oeuvre-phare, Le Principe Espérance (1959), rédigée lorsqu'il était exilé aux Etats-Unis (1938-1949) et comportant une encyclopédie des concrétisations des images utopiques dans les oeuvres d'art. Il est le fondateur d'une philosophie messianique fondée sur la théorie du pré-apparaître utopique dans les figures la " conscience anticipante ".

|
Scooped by
dm
February 4, 2016 4:14 PM
|
Qu'est-ce qu'un phénomène ? La pensée moderne emploie ce terme avec une forme d'évidence. On se dispute sur ce que sont les phénomènes, mais on ne doute pas qu'il y en ait ni qu'ils constituent un point de départ sur lequel on puisse construire. Ce livre, à travers une mise en perspective historique et conceptuelle globale, remet en question cette évidence. Non pas qu'il rejette la notion de " phénomène ", mais il essaie de comprendre d'abord de quel type de décision philosophique elle est le produit et quel type de montage elle suppose. Sur cette base, il met en lumière sous quelles conditions on peut effectivement parler de "phénomènes" et dissipe la mythologie liée à un emploi inconditionné de ce terme, fréquent dans la philosophie contemporaine. Contre tout phénoménalisme, il fait valoir le lien métaphysique dans lequel le langage nous met immédiatement avec les choses. Né en 1968, professeur à l'université Paris et auteur de nombreux livres sur la phénoménologie, Jocelyn Benoist a développé depuis 2005 une recherche originale aux confins de la phénoménologie et de la philosophie analytique qui s'attache à redéfinir les concepts d'intentionalité et d'esprit.

|
Scooped by
dm
February 4, 2016 3:56 PM
|
En affirmant qu’une chose n’est pas, l’animal humain parlant fait passer la chose elle-même des limbes d’une existence vaporeuse à la consistante réalité du monde, où être et non-être se déterminent l’un l’autre. Mais l’énoncé négatif n’est pas que la contre-figure linguistique de réalités malignes ou de sentiments détestables ; il en affirme le refus et laisse entrevoir l’autre de ce qui est. Ainsi, à partir d’une réflexion sur la négation, où l’enfant qui fait l’apprentissage du langage nous en apprend autant que Le Sophiste de Platon discutant de l’être de ce qui n’est pas, Paolo Virno propose une étonnante anthropologie linguistique, où la négation, qui attribue à chaque chose sa valeur unique, peut être définie comme «l’argent du langage ». Paolo Virno (1952) enseigne la philosophie du langage à l’Université de Rome. De lui ont paru aux Éditions de l’éclat depuis 1991 : Opportunisme, cynisme et peur(1991), Miracle, virtuosité et ‘déjà vu’ (1996), Le souvenir du présent (1999),Grammaire de la multitude (2002), et plus récemment : Et ainsi de suite. la régression à l’infini et comment l’interrompre (2014) ou L’usage de la vie et autres sujets d’inquiétude (2016) qui rassemble vingt-deux essais écrits entre 1981 et 2015.

|
Scooped by
dm
February 3, 2016 4:19 PM
|
Talal ASAD Wendy BROWN Judith BUTLER Saba MAHMOOD Préface de Mathieu POTTE-BONNEVILLE Après l’affaire des « caricatures danoises » en 2005, maintes fois reprises dans la presse européenne, et notamment dans le journal français Charlie Hebdo, quatre universitaires américains, Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler et Saba Mahmood, se sont réunis pour discuter de la place, de la définition et de la perception de la religion et de la laïcité dans la pensée critique et dans nos sociétés. Parmi les questions soulevées, ils se sont demandé si toute entreprise critique ne peut se concevoir que dans un contexte laïc et, inversement, si la laïcité ne peut advenir que grâce au travail critique. Analysant les présupposés et amalgames à l’œuvre dans les discours sur un prétendu conflit des valeurs, ils questionnent ainsi les représentations occidentales de la croyance et de la rationalité et les cadres normatifs qui les prédisposent. Les interrogations et les objections successives de ces intellectuels aux horizons d’étude divers permettent de repenser les oppositions conventionnelles entre Occident et Islam, liberté d’expression et censure, jugement et violence, raison et préjugé. Dans un style dialogique devenu rare, comme le note Mathieu Potte-Bonneville dans sa préface, les contributeurs font eux-mêmes œuvre de critique et s’efforcent de s’écouter et de se répondre pour faire entendre une autre polyphonie, pour mettre en relation divers langages culturels et s’interroger sur leurs traductions réciproques.

|
Scooped by
dm
February 2, 2016 3:27 PM
|
Si l'oxymore désignant Spinoza comme " athée vertueux " est attribué à Bayle, le philosophe fait très tôt l'objet d'une singulière réputation, mélange de fascination et de répulsion. L'accusation d'athéisme, dont il se défend énergiquement, est et sera formulée de toute part : au sein de la communauté juive, chez les chrétiens et chez les philosophes, à commencer par Leibniz. Dans le même temps, les témoignages concernant la vie de Spinoza sont unanimes : même ses ennemis les plus acharnés lui reconnaissent une existence moralement exemplaire. Voilà l'énigme. Ou bien, en effet, on nie l'existence de Dieu et, par conséquent, on est immoral ; ou bien on se conduit de manière irréprochable et l'on n'est pas athée. Or beaucoup s'accordent à dire que Spinoza est athée et, en même temps, vertueux. La présente étude ambitionne de résoudre l'énigme. La première difficulté réside dans son athéisme ou prétendu tel. La seconde dans sa " doctrine de la vertu ", pour parler comme Kant. Il s'agira d'essayer de comprendre s'il y a une unité et, si oui, comment elle se conçoit, entre sa conception de l'Etre, celle de la vertu et le comportement quotidien de l'individu Baruch Spinoza. Chez un philosophe, l'écart entre la pensée et la vie ne serait-il pas insupportable ? Alain Billecoq est Inspecteur Pédagogique Régional de Philosophie honoraire, ancien professeur agrégé en classes terminales et préparatoires. Il est actuellement rédacteur en chef des Cahiers rationalistes. Outre des articles repris dans les actes de nombreux colloques et ouvrages collectifs, il a publié plusieurs études : Spinoza, 25 Lettres philosophiques, Hachette, 1982 ; Spinoza et les spectres, PUF, 1987 ; Les combats de Spinoza, Ellipses, 1998 ; Spinoza, questions politiques. Quatre études sur l'actualité du Traité politique, L'Harmattan, 2009 ; Baruch Spinoza. La politique et la liberté, SCEREN, 2013.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...