Les dommages infligés par les aléas naturels dépendent aujourd’hui du degré de préparation des sociétés. Et celui-ci est une question de ressources et de capacités d’anticipation.
Follow, research and publish the best content
Get Started for FREE
Sign up with Facebook Sign up with X
I don't have a Facebook or a X account
Already have an account: Login
Vous trouverez dans ce thème des actualités, en France et dans le monde, sur le Développement Durable en passant par les réglementations environnementales, la Responsabilité Sociétale mais également les changements climatiques et les énergies, ainsi que l"économie circulaire avec l'éco-conception et les analyses de cycle de vie.
Curated by
Stéphane NEREAU
 Your new post is loading... Your new post is loading...
 Your new post is loading... Your new post is loading...
|




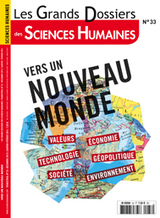






Il faut donc bien différencier trois concepts : 1) les aléas naturels (séismes, vagues de chaleur, cyclones, tempêtes…) qui peuvent être d’origine naturelle ou anthropique ; 2) les espaces du risque où les sociétés ont construit les structures qui réduisent ou éliminent les effets de la catastrophe ; 3) la catastrophe résultant de ce que les sociétés n’ont pas créé ou entretenu les espaces du risque.
Les statistiques d’ensemble permettent de dépasser la notion intuitive mais fausse de « catastrophe naturelle ». Sur 1 million d’habitants, le risque annuel de mort par séisme est de 92 en Arménie, 41 au Turkménistan, 29 en Iran et 25 au Pérou, alors qu’il n’est que de 0,6 en Californie pourtant située sur une faille très active. Un écolier a 400 fois plus de probabilités de mourir dans un tremblement de terre à Katmandou qu’à Tôkyô, où les aléas séismes sont les mêmes. « Les pays à fort risque sont tous à faible produit national brut (PNB) par habitant », souligne le géologue Denis Hatzfled du CNRS.
Ce constat vaut pour l’ensemble des catastrophes. Au cours des deux dernières décennies, les aléas naturels ont tué plus de 2 millions de personnes, et 98 % d’entre elles vivaient dans des pays à faibles niveaux de développement. Alors que les Philippines et le Japon essuient le même nombre de typhons, ceux-ci font 17 fois plus de victimes dans l’archipel philippin que dans le nippon.