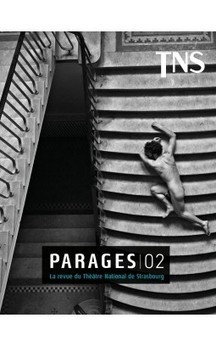Your new post is loading...
 Your new post is loading...
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 10 janvier 2023 Ce qu’il faut dire, texte de Léonora Miano (Des écrits pour la parole à L’Arche Editeur), mise en scène de Stanislas Nordey. A la MC93 de Seine-Saint-Denis de Bobigny. Née au Cameroun, Léonora Miano a suivi des études de lettres anglo-américaines en France où elle a vécu de nombreuses années avant de s’installer au Togo. Son premier roman, L’intérieur de la nuit, paraît en 2005 (Plon). Ses derniers ouvrages sont Rouge impératrice (roman, Grasset, 2019), Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste (essai, Grasset, 2020). « Lorsque tu as dit Noir / Lorsque tu as dit Blanc / Pour ne parler en fait Ni de la peau Ni de sa couleur Mais pour Prendre position Occuper une place Te donner une mission Nous murer dans la race. » (Ce qu’il faut dire) Au-delà de la réparation, de l’excuse, de la vengeance, de la rancœur, une autre voie serait possible sans doute. L’écriture lancée est musique et battements rythmiques. L’Europe conquérante a défiguré d’autres continents – l’Amérique notamment, ainsi le sort des Amérindiens, parqués dans des réserves -, et l’Afrique subsaharienne passée et présente : « N’entrons pas dans les détails de la Déportation transatlantique Laissons de côté l’esclavage que la France d’alors sut pratiquer avec talent dans ses colonies de la Caraïbe d’Amérique du Sud et de l’Océan indien Acceptons de remettre à plus tard l’étude des mécanismes mentaux de l’Europe La confusion pathologique Entre rencontre et assujettissement Entre contact et viol Entre échange et pillage. Faisons l’impasse sur l’invention de la race, l’obsession de la race… » La dernière création de Stanislas Nordey – metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg, particulièrement attentif et sensible à la réalité d’un monde d’immédiate contemporanéité en plein bouleversement – procède, entre autres, d’un constat d’échec : « Il y a, sur les plateaux de théâtre en France, une sous-représentation avérée des gens issus des différentes couches d’immigration ainsi que des personnes nées dans les Outre-mers. Comment faire pour que ça évolue ? » Que faire de la question de la nomination, de la désignation, continue-t-il : « les Blancs ont dit aux gens des populations subsahariennes qu’ils étaient Noirs. Une frontière a été créée, une distinction faite entre les êtres par la couleur de la peau. Alors peut-on repenser les choses autrement ? » « Est-ce qu’on peut se passer de la violence, surpasser l’envie de retourner à l’autre celle qu’il nous a fait subir ? » (Léonora Miano) Ce qu’il faut dire est composé de trois chants, issus de récitals donnés par l’auteure elle-même. Le premier, La question blanche, pose la question de la nomination, de l’assignation – le « tu » s’adresse alors aux personnes à la peau blanche. Le deuxième, Le fond des choses, plonge au fond de cet océan de douleur, d’incompréhension, de violence de la colonisation – ce chant est une adresse à nous tous. Et La fin des fins est une forme d’éclaircie – en tout cas c’est ce que je ressens, avance Stanislas Nordey -, un dialogue platonicien entre la narratrice et Maka, un personnage masculin d’une autre génération – ce dernier chant est un dialogue possible entre deux personnes qui ont la peau noire, en France, en Europe. Des écrits pour être entendus. « J’aime écrire pour la parole, voilà tout, dit L’auteure ; C’est l’influence de la poésie du Black Art Movement que j’ai beaucoup lue, entendue, etc. C’est la trace aussi de l’oralité subsaharienne, de la joute verbale qui est, dans bien des pays d’Afrique, une manière de marquer son intérêt pour l’autre. » Le texte musical appelle une présence instrumentale. Olivier Mellano en a composé la musique et Lucie Delmas, percussionniste, joue de ses instruments sur le plateau de la représentation, les mots portés étant comme repris en écho ou lancés dans une résonance frappante et percutante. Dans un monde où les nominations sont enjeux de domination, invitation est faite au public à prendre ses responsabilités et distances face aux assignations de la langue et récits nationaux. La parole est d’une poésie incisive pour la reconquête des mémoires – être tout simplement soi. Requiem pour une Europe des privilèges, ces chants sont un hymne à la connaissance de soi. Le projet est imaginé avec Gaël Baron, un compagnon de route de Stanislas Nordey et avec Océane Caïraty, Ysanis Padonou et Mélody Pini, trois anciennes élèves-comédiennes du Groupe 44 de l’école du TNS – promotion sortie en juin 2019. Celles-ci portent en elle « la France d’aujourd’hui, celle d’une jeunesse acharnée à faire voler en éclats les clichés, les retards d’une société qui ne sait parfois pas ouvrir les yeux sur elle-même. Elle sont Afropéennes, selon la terminologie de Léonora Miano, et éclairent la scène d’une lumière à elles – ce regard d’une génération qui porte droit le regard à la fois sur le passé et le présent – et un possible avenir. Dans le spectacle, les jeunes femmes et l’homme ont la peau noire – Afropéens ou non. L’auteure se définit elle-même comme Afropéenne et écrit en fait depuis deux endroits : du continent africain lié à ses ascendants et du continent européen – de la France – lié à sa descendance, par sa fille notamment, née et grandie en France. Léonora Miano se situe au cœur des deux continents. Les Afropéens nomment les gens qui ont grandi en Europe où ils sont minoritaires : comment vit-on dans le présent de la société française, en ne faisant pas l’impasse sur l’héritage historique ? Par « l’assimilation » ou bien en inversant la prise de pouvoir et de domination …? A méditer. Engagement, provocation, humour et vitalité, le texte agit comme un punching-ball tonique et vif . Ysanis Padonou a la grâce juvénile de qui, n’étant sûre de rien, s’interroge, prudente et sincère. Mélody Pini joue d’une aisance scénique – élan et enthousiasme -, regardant le public qu’elle invective avec délicatesse et main de fer. Quant à Océane Caïraty, longue silhouette paisible, elle dispense une parole nuancée, ouverte à l’avenir, entre distance souriante et conviction intense. Gaël Baron a la posture de qui s’interroge et propose à la salle ses questionnements, à l’écoute et dans l’expectative, tendu encore vers une destinée qui semblerait enfin acquise aux changements. « Quant aux noms que tu voudrais voir apposés sur des plaques, sache qu’ils ne valent pas pour eux-mêmes. Leur puissance réside dans l’innommé qu’ils représentent. Leur force est celle de cohortes sans nom. Légions de gueux qui vécurent, au cœur de la géhenne, dans le ventre de la mort, des vies humaines », assène la narratrice à l’homme d’expérience, Maka, dans la belle scénographie d’Emmanuel Clolus – installation plastique moderne de structures contemporaines. Une belle maîtrise de la salle – une vraie attention à l’affût -, qui guette ce qui lui échoit d’entendre. Véronique Hotte Du 13 au 22 janvier 2023, mardi 14h30, mercredi, jeudi, vendredi 20h, samedi 18h, dimanche 16h, à la MC93, Maison de la Culture de Seine – Saint-Denis de Bobigny. Tél : (0)1 41 60 72 72.
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 10 nov. 2021 Alors que Stanislas Nordey s’oriente vers la fin de ses années à la tête du Théâtre National de Strasbourg et de son école, il signe un spectacle marquant qui croise tous ses engagements : « Ce qu’il faut dire » de Léonora Miano. Depuis bientôt dix ans, Stanislas Nordey souhaitait mettre en scène la parole de Léonora Miano, née au Cameroun il y a moins d’un demi-siècle, vivant au Togo, ayant vécu longtemps en France, parlant et écrivant en français, une œuvre (romans, récits de paroles, théâtre) souvent couronnée. Nordey avait lu Écrits pour la parole paru à l’Arche en 2012 dans la collection « Scène ouverte », un texte dédié « aux cris inaudibles », « aux paroles proscrites ». A l’époque, Miano souhaitait que ses textes soient portés à la scène par des personnes ayant la peau noire. Eva Doumbia signa ainsi Afropéennes d'après Écrits pour la Parole et Blues pour Élise et remit le couvert. Quelques années plus tard, en 2018, quand Wajdi Mouawad voulut faire entendre la voix de Léonora Miano sur la scène du Théâtre de la Colline avec sa pièce Red in blue trilogie (publiée à l’Arche), il lui demanda qui elle souhaitait pour la mise en scène, Léonora Miano répondit Satoshi Miyagi. Le metteur en scène japonais monta la première partie de la trilogie (lire ici). Trois ans plus tard le moment est donc venu de la rencontre avec Nordey autour de Ce qu’il faut dire, texte publié à l’Arche en 2019 dans la collection « Des écrits pour la parole ». Trois flots de paroles s’y succèdent : -La question blanche. Extrait :« Moi Je n’ai pas eu le choix/ Les déshérités n’ont d’autre solution que de faire de la récupération/ Ausculter la Terre Plonger les mains dans la poussière Ramasser les débris/ Redonner vie/ Assembler Colmater ; Imaginer, Mélanger Transformer Recréer». -Le fond des choses. Extrait : « C’est dans ses abysses que palpite la mémoire Et elle a son utilité Pour savoir qui on est Savoir qui sont les autres Comprendre de quelle manière on est liés aux autres que les autres habitent Non seulement avec nous/ Mais en nous ». -A fin des fins. D’abord une voix d’homme, Maka, s’adressant à une « sister » : « le cri dont je te parle, celui qu’il aurait fallu faire entendre, c’est le vagissement des trépassés en ce monde revenu, le cri de notre renaissance, cette glorieuse clameur. Nous debout. / Cependant nous rampons, et à l’hilarité du monde, nous n’avons à répondre que noms perdus, langues enfuies, demeures assiégées, culture bafoué, nos existences profanées, la ferveur de notre aliénation ». Puis la femme, achevant une litanie de « c’est parce que » ainsi : « C’est parce qu’ils semèrent, dans l’air du monde, le bruit et l’odeur de leurs existences. Indélébiles puisque nous sommes là En dépit des arrachements, des sévices, de l’injure. / Nous avons tant à dire , tant à enseigner aux peuples de la terre, /Maka./ Nous les peu, nous les rien.. ».. Pour porter ces paroles Nordey a tout de suite pensé à trois anciennes élèves du groupe 44 l’école du TNS sorties en 2019 ; Ysanis Padonou (La question Blanche) , Mélody Pini (Au fond des choses) et Océane Caïraty (La fin des fins) rejointe pour Maka par un compagnon de route de Nordey et de bien d’autres : Gaël Baron. Nordey ne les dirige pas comme dans un rôle, il les aides à trouver le tempo et la gestuelle de leur texte-partition d’où jaillissent des étincelles de mots. Autant de magnifiques complicités. La transcription linéaire de quelques passages du texte ci-dessus ne rend pas compte de sa typographie qui, comme l’usage que fait ou pas Miano de la ponctuation, façonnent le souffle du texte. Tout cela se traduit scéniquement par la musique d’Olivier Mellano confiée à la percussionniste Lucie Delmas véritable partenaire des actrices. Les trois paroles ne se redoublent pas, elles s’articulent, s’écartèlent, créent des béances, des ponts, des gouffres, remplissent des pointillés. Les mots sont comme des actes visant à terme l’avènement d’une utopique fraternité, loin du registre paresseux du coup de gueule ou d’un prurit coléreux. Les dernières paroles ont presque des accents tchekhoviens : « Parce qu’à la fin des fins, Maka, nous allons vivre. Nous allons continuer. Alors concevons, il est temps, un modus vivendi. / L’urgence n’est plus de pousser notre cri/ Il s’agit d’ôter ces chaînes à la grandeur, de refuser que se poursuive l’ensauvagement du monde. / Puisqu’à la fin des fins, nous allons vivre. Ici, ailleurs, avec tous les autres, tous les nôtres... » L’une des lignes de force et de fond de l’écriture de Léonardo Miano, c’est d’ être ancrée et encrée doublement : ici et là-bas Mettant volontairement en avant des écritures contemporaines et particulièrement des écritures de femmes, se souciant constamment de valoriser la diversité dans l’ école et sur les plateaux sans pour autant tomber dans le piège des quotas, multipliant les chemins de traverses avec ce qu’il a nommé »l’autre saison » ou encore le programme « Ier acte », Nordey a fait ce qu’il a dit qu’il ferait. Ce spectacle parfait en est comme l’étendard. Ce qu’il faut dire, au TNS jusqu’au 20 nov, ts les jours 20h sf le sam2 à 16h relâche les 14 et 15. Tournée MC2 de Grenoble du 5 au 7 avril, Comédie de Clermont-Ferrand du 3 au 5 mai, en 2023 à la MC93 de Bobigny, et ailleurs espérons-le. Texte paru à l’Arche dans la collection « Des écrits pour le dire » 52p, 12€. Légende photo : Ce qu'il faut dire, la question blanche © Jean-Louis Fernandez
Publié sur le site de l'émission de Laure Adler "Lheure bleue" sur France Inter le 14 mai 2020 Faire théâtre avec Stanislas Nordey, entretien avec Laure Adler
Ecouter l'émission en ligne (53 mn) sur le site de France Inter
Metteur en scène de théâtre et d'opéra, acteur, Stanislas Nordey est à la tête du Théâtre National de Strasbourg et est depuis le début du confinement très actif artistiquement pour soutenir le milieu culturel en crise.
Stanislas Nordey est directeur du Théâtre National de Strasbourg et de son école depuis 2014. Il s'engage avec des artistes associés à diffuser le théâtre auprès de publics qui en sont généralement éloignés. Depuis le début du confinement, il propose des alternatives pour continuer de "faire théâtre" et notamment L'autre saison : une saison parallèle dont le principe est la gratuité et l'éclectisme (rencontres, lectures, petites formes).
Le théâtre comme bien d’autres secteurs culturels connaît des difficultés depuis le début de la crise sanitaire.
Quand les gens pourront ils retourner dans les salles de spectacle ? Faut il modifier de façon pérenne les propositions artistiques et théâtrales ?
L’Heure Bleue se propose ce soir de faire un état des lieux avec Stanislas Nordey qui a été entendu par le Président de la République le mercredi 6 mai dernier lors d'une visioconférence visant à trouver des mesures pour sauver la culture.
Dans la nouvelle formule de l’Heure Bleue un texte est proposé par nos invités. Stanislas Nordey a choisi "Entre les deux il n'y a rien" de Mathieu Riboulet. Lecture par François Marthouret.
Les invités
Stanislas Nordey Metteur en scène et comédien Légende photo : Portrait de Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre national de Strasbourg TNS. © Maxppp / Jean-Marc LOOS/PHOTOPQR/L'ALSACE
par Romaric Gergorin dans Postapmag
Après le TNS puis la MC 93 de Bobigny, le Théâtre National de Bretagne présente l’étonnant Récit d’un homme inconnu d’Anatoli Vassiliev, la mise en scène d’un trio de personnages désenchantés adaptée d’une nouvelle de Tchekhov. Une pièce de théâtre des profondeurs qui puise dans le tréfonds des âmes les ressorts d’une déroute spirituelle —non sans rappeler celle de mai 68, 50 ans après. L’occasion de rencontrer un maître du théâtre russe qui regarde l’Europe avec une acuité acérée.
Anatoli Vassiliev demeure un des derniers grands créateurs de formes théâtrales, loin de l’aplatissement généralisé du spectacle vivant vers le conformisme du déjà vu, distrayant et dérisoire. Après avoir marqué la scène française avec Bal masqué de Lermontov en 1992 et Amphitryon de Molière en 2002, tous deux à la Comédie-Française, Thérèse Philosophe de Boyer d’Argens au Théâtre de l’Odéon en 2007, puis plus récemment La Musica de Duras au Théâtre du Vieux-Colombier et une reprise de sa Médée-Matériau adaptée d’Heiner Muller aux Bouffes du Nord l’an dernier, ce singulier metteur en scène russe revient avec une adaptation de la nouvelle de Tchekhov Récit d’un inconnu.
Le titre français est tronqué, comme souvent dans les traductions issues du russe, oubliant l’essentiel, c’est-à-dire « l’homme ». Récit d’un homme inconnu appartient à la veine métaphysique de Tchekhov, au même titre que Le Moine noir ou L’Évêque. Cet aspect méconnu de l’auteur de La Cerisaie permet au dramaturge russe d’orienter ses recherches vers un enjeu différent de ces précédentes mises en scènes françaises qui étaient axées sur la déconstruction de la parole vivante. Ici sa démarche consiste à incarner des problèmes métaphysiques par le geste théâtral.
Trois personnages désenchantés soulèvent des questions existentielles : lutter pour des valeurs jusqu’à la violence et la destruction pour protester contre un système, ou se laisser submerger par le renoncement, ou bien encore vivre dans un hédonisme cynique, en jouissant d’une lucidité désabusée. Dans le premier acte, un inconnu, joué par Stanislas Nordey, est un terroriste qui s’est fait engager comme valet par Orlov, joué par Sava Lolov, un notable épicurien fils d’un important homme d’état, dans le but d’assassiner son père. Il y renoncera mais s’attachera à la maîtresse délaissée d’Orlov, Zinaïda, jouée par Valérie Dréville, et partira avec elle à Venise.
Quand je monte une pièce autour de Tchekhov, je commence par les éléments psychiques, pour poser une base. Mais si l’âme est endormie, l’esprit n’y entre pas.
Dans cette première phase, où l’inconnu reste muet et se contente faire le service, la relation entre Orlov et Zinaïda apparait à travers l’intensité froide et violente des acteurs qui parfois se mettent à danser silencieusement, figurant ainsi les mouvements de leurs âmes. Les retrouvailles ultimes d’Orlov et de l’inconnu permettent une confrontation d’idées, où le jeu des comédiens, leur diction, révèlent toute l’intensité de l’art de Vassiliev, dont la recherche constante s’avère de faire exister un acteur naturel et authentique dans la forme artificielle du drame.
Nous avons rencontré Anatoli Vassiliev à son hôtel, juste avant son départ pour la Russie, où il effectue son retour au théâtre pour donner un spectacle autour du Vieil Homme et la mer d’Hemingway. Extraits thématiques des propos d’un créateur insatiable qui cherche constamment à renouveler les formes du spectacle vivant.
Terrorisme et volonté
« Le terrorisme est une des formes de protestations, c’est un acte de la volonté libre. La protestation existe toujours, elle prend juste des formes diverses. Qu’est-ce qui se passe avec cette volonté humaine en train de protester, aujourd’hui ? Cette volonté peut détruire des vies, ou détruire la personne qui la porte, si cette volonté est déformée avec le temps, et cette évolution de la volonté est souvent très active.
On peut voir, chez un individu, cette volonté de révolte se détruire en 10 ans. Dans ce récit, il y a des intentions assez concrètes de chaque personnage qui se confronte avec la réalité de la vie. Mais il faut s’habituer à ce paradigme du mental russe : ce qui existe dans l’imagination pour un Occidental est pour un Russe la vraie réalité authentique. Ce qui existe dans la vie réelle par contre, sera pour lui du domaine de la vie imaginaire, quelque chose qui n’a pas d’importance. Car la réalité concrète que vivent les citoyens russes, on ne peut pas y croire. Même dans un cauchemar on ne peut pas imaginer une telle atrocité. »
Tchekhov et Dostoïevski
« Il y a quelques nouvelles de Tchekhov dans lesquelles on peut sentir un lien avec Dostoïevski. On peut diviser les nouvelles de Tchekhov en trois catégories : les nouvelles comiques, les nouvelles lyriques et les nouvelles métaphysiques. Le Tchekhov dramaturge russe et l’écrivain qui écrit des récits courts et lyriques, parfois comiques, est très connu, mais il existe aussi un Tchekhov plus rare, à portée métaphysique qui se rattache à Dostoïevski.
Cependant chez ce dernier les personnages sont vraiment l’incarnation de l’esprit pur. Tchekhov ne se reconnait pas dans cette métamorphose de l’idée. Pour lui, l’être humain reste saisi dans son aspect concret, très humain, mais avec une faculté de réflexion philosophique en partant de situations pratiques qui sont dépassées par un questionnement, mais sans abstraction, toujours dans la fusion avec la nature. Cet aspect métaphysique de Tchekhov vient de la façon qu’a Dostoïevski de présenter les idées sous une forme dialogique. Si on lit en russe tous ces textes à connotation métaphysique de Tchekhov dans lesquels les dialogues expriment le sens des idées, on reconnait la présence de Dostoïevski. »
Direction des acteurs
« Valérie Dréville sait comment diriger la parole, tout comme Stanislas Nordey et Sava Lolov. Ils savent maitriser l’action en paroles. Mais chez Tchekhov, ce n’est plus l’action dans la parole qui prime, comme cela pouvait être le cas dans Médée Matériau. C’est la dimension humaine qui devient essentielle, ce qui nécessite une autre technique du jeu de l’acteur, pour construire et exprimer le dynamisme des relations humaines. Pour le théâtre européen, dans le mental des français, le plus difficile reste de construire des relations entre les êtres humains. »
Âme
« Dans la langue russe, le mot âme implique une portée plus profonde qu’ici, où la signification de ce mot fait référence essentiellement à des éléments psychiques. On peut dire que le psychisme entre dans l’âme mais d’autres substrats y existent aussi. Dans l’âme, il y a l’élément matériel et celui qui ne l’est pas du tout. Cet élément non matériel est en lien avec l’esprit, tandis que l’élément matériel est connoté avec le psychisme. Quand je monte une pièce autour de Tchekhov, je commence par les éléments psychiques, pour poser une base. Mais si l’âme est endormie, l’esprit n’y entre pas. »
Mai 68
« Dans cette pièce que je mets en scène en français, ce n’est plus une histoire russe, elle devient une histoire inscrite dans le contexte culturel européen. Après un travail de déconstruction préparatoire, j’ai construit cette adaptation de la nouvelle de Tchekhov comme une histoire française. Les personnages ont tous dépassé la cinquantaine. Mai 68 eut lieu il y a 50 ans. Ce spectacle retrace implicitement le parcours et l’évolution de la France pendant ces 50 années qui ont suivi les événements de mai. »
© Jean-Louis Fernandez
Récit d’un homme inconnu, mise en scène par Anatoli Vassiliev, créé au Théâtre National de Strasbourg, vu par Postap à la MC 93 Bobigny, se joue jusqu’au 20 avril au Théâtre National de Bretagne à Rennes.
Anatoli Vassiliev, L'art De La (...)
par Stephane Poliakov
a l'ecole d'art dramatique, théâtre qu'il a fondé à moscou en 1987, anatoli vassiliev poursuit sa recherche autour de l'an de la mise en scène. les notions de ligne et de perspective y sont centrales : l'espace physique du plateau exprime l'espace intérieur du jeu de (...)
ÉDITEUR ACTES SUD LANGUE Français FORMAT Book NOMBRE DE PAGES 165 DATE DE PUBLICATION 28 Juin 2006
Recommandé pour vous:
PRIX UNITAIRE
12,20 €
Non disponible pour l'instant
Anatoli Vassiliev ; Au Coeur (...)
par Stephanie Lupo
Pour avoir mené une recherche sur Anatoli Vassiliev pendant plusieurs années sous le double statut d'actrice et de chercheuse, Stéphanie Lupo apporte un témoignage unique et un éclaircissement « de l'intérieur », sur la pédagogie d'une des figures majeures du théâtre russe (...)
ÉDITEUR L'ENTRETEMPS LANGUE Français FORMAT Book NOMBRE DE PAGES 276 DATE DE PUBLICATION 29 Mai 2006
Recommandé pour vous:
PRIX UNITAIRE
25,00 €
Non disponible pour l'instant
Sept Ou Huit Leçons De (...)
par Anatoli Vassiliev
" former un acteur, c'est s'effacer. Le formateur doit mourir dans l'acteur. dans la direction d'acteur, celui qui dirige doit être dans l'acteur, absolument, complètement. le difficile, c'est quand on cherche la perfection, il faut trouver une harmonie entre ces deux choses qui (...)
ÉDITEUR P.O.L LANGUE Français FORMAT Book NOMBRE DE PAGES 160 DATE DE PUBLICATION 14 Juin 1999
Recommandé pour vous:
PRIX UNITAIRE
25,35 €
Non disponible pour l'instant
© Jean-Louis Fernandez
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez
Le Récit d’un homme inconnu, texte de Anton Tchekhov, mise en scène, adaptation, scénographie et lumière de Anatoli Vassiliev
Dès que le public pénètre dans la salle de théâtre, son regard est saisi par le vaste décor scénique d’un appartement bourgeois et cossu qui baigne dans une lumière radieuse. Au-dessus, suspendue dans le lointain, la photo ancienne de la Perspective Nevski à Saint-Pétersbourg.
Sur la scène élevée, un long vestibule s’étire de jardin à cour, pièce tout en longueur fermée par des murs et leurs trois portes blanches encastrées et qui, ouvertes, laissent entrevoir ses coulisses arrière.
Le spectateur assiste en voyeur à des séances élégantes d’habillage et de déshabillage du maître de maison, livré aux mains habiles de son valet silencieux. La pièce de vie face au public surmonte une terrasse en demi-lune, accessible en contre-bas par quelques marches sur les côtés.
La scénographie est graduée, selon trois niveaux, un tapis de cirque en demi-cercle près du public, l’appartement surélevé et Saint-Pétersbourg.
Rien ne laisserait supposer dans ce Récit d’un homme inconnu de Tchékhov, créé par Anatoli Vassiliev, que sonne la fin des années 1880 en Russie, au temps troublé d’un groupe terroriste – intellectuels et étudiants poseurs de bombes -, rappel sonore d’une intelligentsia déçue.
L’homme inconnu est le valet silencieux qui fait rouler ses dessertes multiples à l’heure du thé, à l’intention des maîtres, Orlov et sa maîtresse Zinaïda. Il est le narrateur Vladimir Ivanovitch, ex-officier de la marine et de mouvance révolutionnaire, incarné par Stanislas Nordey, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre national de Strasbourg.
Vladimir Ivanovitch n’est pas le valet de chambre du comte Orlov par hasard : le père de celui-ci, homme d’Etat, est la cible des terroristes. Le valet est un politique habité d’une vie intérieure intense et inconnue.
Entre Orlov et le valet de chambre, rayonne la femme romantique et romanesque, Zinaïda – lumineuse Valérie Dréville – qui accorde sa foi à celui qu’elle aime. Passionnée par les idées politiques, elle s’embrase pour des hommes désenchantés et blessés que l’amour ne peut sauver.
Aux antipodes du valet, Orlov – Dom juan interprété par l’acteur Sava Lolov -, porte beau, protégé encore par son ironie, un Platonov de la pièce éponyme de Tchékhov. Amateur de vins, de livres, le héros fascine les femmes par sa liberté et son refus des attachements.
Le premier volet pétersbourgeois du spectacle révèle la belle Zinaïda, épouse qui a quitté son mari pour le seul amour du comte Orlov, distant et replié sur ses lectures. Déçue, désobligée et enceinte, elle le quitte.
Avant que ne s’ouvre le second volet, le valet descend sur le demi cercle de la salle près du public, narrant l’action passée et préparant l’avenir.
La seconde partie fait tomber le voilage de la vue de Saint-Pétersbourg, laquelle est remplacée par l’image des canaux d’une Venise ensoleillée. Après avoir renoncé à tuer la victime ciblée – un rêve qu’il a cru vivre en faisant éclater superbement un pantin de foire rempli de bouteilles vides -, le valet s’est enfui à Venise avec la belle à laquelle il s’est attaché.
Une caméra ancienne projette un film sur une voile blanche, comme accrochée à des mâts et rivée à des plombs – ancres marines -, où l’on voit les amants assis et se faisant face dans une gondole, lisant haut.
Ils vivent dans la Sérénissime –passions, jeux, fêtes et champagnes.
De longues rangées de bouteilles vides et scintillantes sertissent le bas des murs de l’appartement – une installation dont le drame aura usage.
Puis accouche la jeune femme, sans espoir, mais debout et consolée. Quand on a cru l’enfant mort-né, c’est sa mère qui a quitté la vie de bon gré.
L’atmosphère – esthétique, morale et sensuelle – relève de la plénitude à connotation mi sucrée, mi amère du film Mort à Venise (1971), d’après la nouvelle de Thomas Mann dont Luchino Visconti fit une œuvre mythique.
Participent à l’ambiance délicate et surannée, non seulement la création lumière de Philippe Berthommé, mais encore les costumes de Vadim Andreev et Renato, des vêtements fin de siècle de la société privilégiée à l’allure proustienne – couleurs claires, blanc cassé et beige, matières soyeuses, robes féminines épanouies et mises masculines d’allure sûre.
Canotier pour les hommes, chapeau d’Arlequin pour le carnaval vénitien de Zinaïda et dessous chic.
Et si la musique apaisante et entêtante pour le narrateur malade de la nouvelle de Tchékhov était La Sonate au clair de lune de Beethoven :
«Comme il jouait bien ! D’abord, j’eus envie de pleurer… puis, il m’apparut que ma vie n’était pas aussi mauvaise que je le pensais et qu’aujourd’hui encore il m’était possible de la recommencer intérieurement. La phtisie ne m’en empêchera pas, car on peut la guérir au Caire ou à Madère. Et il y a sur cette terre une matière si riche pour une vie joyeuse, féconde et élevée ! »
Dans la mise en scène du maître russe Anatoli Vassiliev, le contrepoint musical est assuré par les reprises lancinantes de la Cinquième Symphonie de Mahler, écho d’emblée identifiable à Mort à Venise.
Le spectacle est un enchantement scénique – un envoûtement assuré -, ne serait-ce encore que par les séances chorégraphiées, entre silences et mouvements dansés que chacun des trois interprètes accomplit – avec une prédilection de Zinaïa pour ses tournoiements gracieux, le sourire aux lèvres, qui s’ouvre manifestement au monde et à l’autre – un astre.
Les mouvements sont amples, retenus et épanouis – le virement de l’être sur lui-même, conscient de ses facultés ressaisies – esprit et corps.
Et en dépit du temps qui passe et des lassitudes physiques et morales.
Aussi ces danses traduisent-elles la face lumineuse de ces trois aventuriers de la liberté dont la femme est un symbole des plus actifs.
La face nocturne, tissée de la trivialité des jours, laisse surgir avec le temps des points de rupture à travers les convictions perdues – amour et politique, en vue d’un monde meilleur –, soit la mort de l’étincelle de vie.
Véronique Hotte
A lire également, sur son travail avec Anatoli Vassiliev, l’ouvrage de Valérie Dréville, Face à Médée – Journal de répétition paru aux Editions Actes Sud.
TNS – Théâtre national de Strasbourg, salle Koltès, du 8 au 21 mars.
MC93 à Bobigny, dans le cadre de la programmation hors les murs du Théâtre de la Ville, du 27 mars au 8 avril. Théâtre national de Bretagne à Rennes, du 12 au 20 avril.
Publicités
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello
Crédit photo : Jean-Louis Fernandez
Tarkovski, le corps du poète, texte original de Julien Gaillard, extraits de textes de Antoine de Baecque et Andreï Tarkovski, mise en scène, montage de textes et scénographie de Simon Delétang
« Le film devrait être pour l’auteur et pour le spectateur un acte moral purificateur », tel est le souhait éthique et esthétique du cinéaste Andreï Tarkovski (1932-1986), perçu en son époque soviétique de méfiance – glasnost et perestroïka comprises – comme l’héritier de la vieille culture russe, ante-révolutionnaire, spiritualiste et prophétique – un défenseur lyrique d’un enracinement profond dans la Terre-Mère.
Or son cinéma se situe, selon ses vœux, hors-temps ou relève de tous les temps.
La démarche est poétique, hors de l’unité dramatique conventionnelle ; elle s’accomplit dans la contemplation faite de dévoilements patients et mystérieux.
La mise en scène du spectacle de Simon Delétang, Tarkovski, le corps d’un poète, dresse le portrait en fragments et le paysage mosaïque d’un poète visionnaire.
Petite table et verre d’eau, une conférencière évoque l’acte de foi et d’orgueil de ce Maître solitaire qui ne supporte pas la moindre trahison intérieure et milite pour la vérité : « Pourquoi une cruche de lait explose-t-elle dans Le Sacrifice ? Que fait un chien dans la Zone de Stalker ? Comment un cheval blanc traverse-t-il l’écran dans Solaris ou Nosthalgia ?, selon les commentaires avertis d’Antoine de Baecque.
La comédienne Pauline Panassenko, qui parle un beau russe tonique, accorde toute l’intensité, la ténacité, la conviction et l’énergie attendues de la part de l’artiste génial.
Puis résonnent les basses profondes des chantres orthodoxes, et le rideau scénique s’ouvre sur la chambre d’une villa italienne aux murs blanchis à la chaux et aux fenêtres de bois sombre qui projettent une lumière solaire sur un sol à damiers.
Le décor pourrait être un intérieur de Nostalghia (1983), film tourné en Italie, non loin peut-être de de la maison que Tarkovski aurait achetée pour y vivre un jour.
L’absolu reste inaccessible, au-delà de la sentimentalité et de la mélancolie pour une terre natale forcément trop lointaine. Dès 1984, il ne plus retourne plus en URSS.
Au lointain, trône un large lit – fer forgé et drap blanc – pour un défunt sur lequel est posé une bougie fragile, lumière vivante de gisant qui tout à coup se met à parler.
Entre rêveries et souvenirs, Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg, incarne Tarkovski dont le monologue exprime la teneur existentielle d’un artiste avisé, habité par une exigence constante. Malade cloué au lit, le créateur solitaire s’auto-analyse (Le Miroir -1974), il se lève et marche.
Surgit un paysan interprété par la carrure de Jean-Yves Ruf qui à la fois interpelle et veille l’artiste, au nom de la Russie. Quelque chose lie Tarkovski à Ivan de L’Enfance d’Ivan (1962), cette souffrance qui associe le héros aux jeunes russes de la génération des années 1960 dont il exige qu’ils ne s’endorment pas spirituellement.
Les images de l’eau – thème récurrent – nourrissent les rêves, les souvenirs de Tarkovski dirigés vers la mère – femme et patrie. Un cabinet de toilette, lavabo et faïence blanche permet à l’un ou l’autre des acteurs de venir boire un verre d’eau.
Nombreux, les journalistes, critiques et reporters radio viennent interroger le Maître : Que signifient les films Andreï Roublev (1966), Stalker (1979), Nostalghia (1983) … ?
De belles énigmes dont nulle réponse objective ou concrète n’est jamais dispensée.
Le poète doit avoir l’imagination et la psychologie d’un enfant qui découvre le monde.
Seul, il affronte tous les autres – insensé, radical, intransigeant, malheureux et fou.
Stanislas Nordey, alias Tarkovski, alias Don Quichotte, alias le Prince Mychkine, joue le Stalker dans la Zone, idéaliste affrontant le tragique d’un monde désespéré.
Le comédien marche en avant, épaules relevées et rentrées, bras balancés de travailleur soviétique, se tourne, reculant, pas arrière, et observe l’imaginaire déposé.
Quelques scènes du film sont reprises qu’inaugure le lancer vif d’un tissu blanc sur le plateau. Thierry Gibault, présence chaleureuse et esprit facétieux, joue L’Ecrivain, et le paisible Jean-Yves Ruf le Professeur physicien. Ce duo beckettien médite sur l’art, la science et la conscience, déroulant une parabole morale aspirant à la beauté.
Et si la beauté doit sauver le monde – prophétie dostoïevskienne -, elle passe aussi par Andreï Roublev (1966), sa Russie du XVème siècle avec la passion de Roublev, peintre d’icônes inspiré, habité par l’immensité de la terre et du peuple russes.
La beauté advient encore avec l’apparition au lointain d’un détail démesurément agrandi de la Madonna del Parto de Piero della Francesca : « les yeux tournés/ en dedans toute/ à ce qui vit en elle/ elle voit/ ce qui l’aveugle… », écrit Julien Gaillard.
Hélène Alexandridis représente la Femme – la Fille et la Mère -, prétexte d’une Annonciation où la dame aurait été prise par le vent. Elle incarne aussi Larissa, l’épouse aimée de Tarkovski dont les paroles apaisent le poète épuisé et souffrant :
« Ainsi j’ai compris que je n’étais pas seule. Qu’au monde il existait encore une âme. … Comme toi, j’avance sans savoir où je vais. Comme toi, mon pas pèse sur la terre. Comme toi, il ne pèsera bientôt plus… La mémoire des morts est en nous… »
Des évocations encore du Sacrifice (1986) – l’incendie d’une maison et d’un arbre.
La couleur de l’or et du feu – rappel du fond doré des icônes – envahit le dessin des murs de la maison radieuse qui luit au soleil de l’amour, de la foi et de la charité. Le plateau final est jonché de cloches, d’un chien et de bottes – rappels symboliques.
Tarkovski, le corps du poète de Simon Delétang propose reflets et échos de l’œuvre du cinéaste, prenant le temps de la pause et du silence, laissant les solos, duos et trios advenir tandis que les autres figures scéniques restent immobiles et muettes.
Les musiques sacrées de Bach, entre autres, livrent à la fresque poétique sa capacité à sculpter le temps – temps de théâtre, de méditation et de contemplation.
Véronique Hotte
Théâtre National de Strasbourg, salle Grüber, du 19 septembre au 29 septembre.
Théâtre Les Célestins à Lyon, du 11 au 15 octobre.
La Manufacture Théâtre des Quartiers d’Ivry, du 2 au 6 mai 2018.
Comédie de Reims à Reims, le 11 mai 2018.
Fabienne Arvers dans Les Inrocks
Rubrique hebdomadaire des spectacles à ne pas manquer du 20 au 26 septembre
Renaud Herbin présente quatre spectacles au Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières (du 16 au 24 septembre). Concepteur du COI (Corps Objet Image), il aime surtout décloisonner les arts et “sortir la marionnette d’une problématique disciplinaire. Elle est poreuse au cirque, à la danse, aux arts visuels.” Cette nécessité à “affirmer la marionnette comme un outil au service d’une écriture contemporaine” est aussi au cœur de la démarche du théâtre d’objet d’Agnès Limbos, autre artiste “fil rouge” du festival, qui présente deux spectacles, dont une création, une exposition et une conférence .
D’autres créations sont attendues : celle des chorégraphes Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, Oscyl, des “présences dansantes” inspirées de l’entité ailée de Hans Arp, les marionnettes à taille humaine de Chambre noire de la compagnie franco-norvégienne Plexus Solaire. Ou encore After Tchekhov de la compagnie russe Samoloe , Passager clandestin de la compagnie Arketal qui est une adaptation de la pièce de Patrick Kermann, The Great Disaster. Impossible de les citer toutes… Mais signalons quand même un Focus Finlande avec 5 spectacles.
Avec Tarkovski, le corps du poète, mis en scène par Simon Delétang au TNS de Strasbourg du 19 au 29 septembre, on assiste à la “première grande tentative théâtrale de dresser un portrait et un paysage d’évocations de ce poète de l’image”. Auteur réalisateur de sept films majeurs – de Stalker à Andreï Roublev, ou de Solaris au Sacrifice –, il fut censuré en Union soviétique et dut s’exiler et s’éloigner de ses proches pour tourner ses derniers films. Le spectacle réunit des textes d’Antoine de Baecque, Serge Daney et de Julien Gaillard. Sur le plateau, Stanislas Nordey qui incarne Tarkovski entouré d’Hélène Alexandridis, Thierry Gibault, Pauline Panassenko et Jean-Yves Ruf.
Plaisir de retrouver la romancière brésilienne Clarice Lispector au théâtre avec La Pomme dans le noir mise en scène par Marie-Christine Soma à la MC93 de Bobigny du 20 septembre au 8 octobre. Dans son roman Le Bâtisseur de ruines, elle imagine “le voyage initiatique d’un héros sans héroïsme, fuyant le crime qu’il a commis”. Sa rencontre avec deux femmes va modifier sa trajectoire. “J’aime l’idée de cette renaissance des personnages par la rencontre qu’ils font, confie la metteuse en scène. En ce moment où tout est exclusion dans notre monde, je trouve extraordinaire cette idée qu’un individu qui s’exclut par le crime puisse se réinscrire dans la communauté humaine.” Autre plaisir : retrouver l’acteur Carlo Brandt dans le rôle de Martin, aux côtés de Pierre-François Garel, Dominique Reymond et Mélodie Richard.
Amateurs d’allitérations, l’ouverture du festival des Francophonies de Limoges (du 20 au 30 septembre) est pour vous : Voyage en bordure du bord du bout du monde se déroule évidemment dans la rue, on le voit mal enfermé entre quatre murs avec un titre pareil et il est signé Cie 3 points de suspension. On enchaîne avec le petit bijou de théâtre de François Gremaud et Pierre Mifsud, Conférence de choses et c’est parti pour dix jours de spectacle de danse, de théâtre, de musique et de lectures. A voir : Eddy Merckx a marché sur la Lune de Jean-Marie Piemme, mis en scène par Armel Roussel, Zvizdal (Tchernobyl, si loin, si proche) par le groupe Berlin et Cathy Blisson, L’Humanité et Les héros de et par Josse de Pauw, Narcose de Hafiz Dhaou et Aïcha M’Barek ou Kalakuta Republik de Serge Aimé Coulibaly. A découvrir : Body Revolution/Attendre de Mokhallad Rasem, , Tram 83 de Fiston Nasser Mwanza Mujila mis en scène par Julie Kretzschmar.
“Les Héros” de Josse de Pauw, (© Kurt van der Elst)
Autre incontournable : Actoral, festival des arts et des écritures contemporaines (du 26 septembre au 14 octobre). Une 17e édition qui conjugue à merveille l’art du risque, l’amour de la création et l’écoute sensible d’une époque “en prise avec sa plus grande crise morale depuis des siècles, estime son directeur Hubert Colas. Mais la foi n’est pas morte. Nos armes sont les mots et les gestes de l’art. Nous n’abandonnerons aucun navire en perdition. Nous ne nous détournerons d’aucun regard sur la misère qui croît à travers le monde. Notre responsabilité est totale. Notre vie en dépend.”
A voir notamment : les créations de Vincent Thomasset, Tommy Milliot, Simon Mayer, Dave Saint-Pierre ou Ildi ! Eldi. Outre les spectacles, Actoral propose aussi des Face à Face entre artistes, des rencontres avec des auteurs, des projections de films et des concerts. Un festival nomade qui se balade dans Marseille et son public avec lui.
Légende photo
“La Pomme dans le noir” Mise en scène de Marie-Christine Soma - d’après “Le Bâtisseur de Ruines” de Clarice Lispector (© Christophe Raynaud de lage)
Par Olivier Joyard dans les Inrocks
Dépénalisation, adoption du Pacs, mariage pour tous : trois épisodes pour relater trois moments de tension de la société française sur la question de l’homosexualité. La série est attendue sur ARTE en 2018.
La chaleur de juin a pris les corps par surprise cette année. C’est sous cette météo lascive que le tournage de la minisérie Fiertés de Philippe Faucon, consacrée aux luttes homosexuelles depuis 1981, se termine. Quelques jours avant l’heure dite, nous nous glissons sur le plateau, où l’habituelle chorégraphie des techniciens a lieu dans un concert de murmures.
L’atmosphère est aussi calme que dans une colonie de chats. La canicule n’est pas seule responsable, car le boss des lieux donne lui-même l’exemple. Entre les prises, le réalisateur s’adresse aux acteurs présents (le jeune Benjamin Voisin, Frédéric Pierrot, Emmanuelle Bercot) d’une voix douce, s’agenouille auprès d’eux pour imaginer en quelques secondes d’infimes modulations. Il assied aussi une méthode, enchaînant nonchalamment et sans transition un compliment (“Ça marchait très bien”) avec l’ombre d’un doute (“Ça allait trop vite”). De l’art de tordre les acteurs pour toucher au but.
“J’ai accepté un petit rôle en partie pour le voir travailler, avoue la réalisatrice et actrice Emmanuelle Bercot. Son style ‘invisible’ est très construit. Le travail des comédiens n’est pas facile : il faut être très ‘blanc’ dans le jeu, mais aussi se montrer naturel. J’ai dû éliminer tout ce que je cherche à apporter en tant qu’actrice et que je capte dans les films que je réalise : des gestes, des attitudes, des scories. Ici, il n’y a pas d’intention de jeu mais une forme de dépouillement. La première prise que j’ai faite, j’ai eu l’impression d’être moi-même – il paraît que j’ai un visage très expressif. Philippe m’a dit : ‘On va refaire la même, sans les mimiques’…”
Une œuvre discrète, mais toujours en prise avec la société
Comme souvent chez l’auteur de Fatima, la scène tournée ce matin-là pourrait n’avoir l’air de rien. Sur la terrasse d’une maison de ville du XXe arrondissement de Paris, deux parents et leur fils sont assis à la table du petit déjeuner. Une tension s’immisce, l’ado quitte les lieux, bientôt suivi par son père. C’est tout. Mais les gestes sont précis et les paroles pesées.
Faucon semble accorder la même importance à ce micromoment d’une vingtaine de secondes qu’il en donnerait à une grande révélation. Son sens de la hiérarchie n’est pas le sens commun et c’est probablement ce qui captive dans son travail depuis un quart de siècle.
Bercé par les films de Robert Bresson, le bientôt sexagénaire a construit une œuvre d’abord discrète (on se souvient du très beau Samia, en 2000), qui a décollé en notoriété dans les années 2010 par collusion avec les préoccupations d’une France métissée et diverse qu’il sonde depuis toujours. La Désintégration (2011) racontait la radicalisation jihadiste de jeunes hommes d’origine maghrébine, tandis que le lumineux Fatima, sur le destin d’une femme de ménage et de ses filles, lui a valu le César du meilleur film en 2016.
Le périple d’un couple en forme d’épopée
Avec Fiertés, le réalisateur opère en apparence un léger déplacement. Sur une idée des scénaristes José Caltagirone et Niels Rahou (qui ont coécrit avec Faucon après avoir rédigé un traitement), les trois épisodes racontent l’histoire d’une famille et d’un amour gay sur plus de trente ans.
Le premier volet se déroule au moment de la dépénalisation de l’homosexualité en 1981, le deuxième à l’adoption du Pacs en 1999 et le troisième en 2013, alors que le mariage pour tous entre dans la loi après les difficultés que l’on sait.
Sous cette trame historique se dessine le périple du couple que forment Victor et Serge, dont la différence d’âge de dix-huit ans n’empêche pas la construction d’une longue épopée. Il est question ici de sida, d’enfants adoptés, de discriminations au sein de la cellule familiale, avec comme moteur le passage du temps, l’évolution des corps et des mœurs.
Se démarquer d’autres fictions à l’univers proche
“Il y a une belle bande d’acteurs et des choses à défendre politiquement”, analyse le comédien et metteur en scène de théâtre Stanislas Nordey, qui n’avait plus montré son visage à une caméra depuis N’oublie pas que tu vas mourir de Xavier Beauvois, en 1995. “Ici, le militantisme est incarné par la vie, ajoute Samuel Theis, qui interprète Victor dans les épisodes 2 et 3. Il y a tant de gens qui ont des désirs simples qu’il faut les représenter.” Frédéric Pierrot, Chiara Mastroianni, Jérémie Elkaïm, Sophie Quinton et Loubna Abidar complètent le casting.
Interrogé sur l’existence d’autres fictions traitant d’un univers proche comme la récente When We Rise aux Etats-Unis, écrite par Dustin Lance Black et dont le pilote a été réalisé par Gus Van Sant – sans compter le magnifique 120 battements par minute de Robin Campillo côté cinéma –, Philippe Faucon précise son désir.
“Fiertés raconte trois périodes politiques qui sont aussi trois moments de tension et de crispation dans la société française autour de la question de l’homosexualité. La série permet de prendre un recul intéressant sur des choses dont on a perdu conscience. 1980, c’est une période que j’ai connue comme étudiant. J’avais des amis en lutte contre ces états de fait de la société.”
“Des parents, à l’époque, pouvaient demander l’internement psychiatrique de leur fils ou de leur fille. Ce sur quoi nous avons vraiment travaillé, ce sont les personnages, ce qui les lie, leurs sentiments, les raisons pour lesquelles ils agissent. Des histoires amoureuses, avec leurs difficultés, que la société ou le regard des autres compliquent. La dimension politique ici n’est pas dans le militantisme, mais dans la revendication et l’affirmation de l’intimité.”
Trouver un rythme plus rapide, celui de la série
Ces mots résonnent avec la plupart des films de Philippe Faucon, qui n’a cessé de chercher dans les interstices de vies souvent banales quelque chose d’une émancipation. “La thématique de Fiertés, je me rends compte que je l’ai déjà abordée dans deux films pour la télévision : Muriel fait le désespoir de ses parents, qui montrait l’éveil au désir lesbien d’une adolescente, et Les Etrangers, sur un jeune homosexuel qui pour fuir sa famille se portait volontaire au départ en Bosnie.”
“Ce qui lie ces personnages à ceux de Fiertés, c’est qu’ils ont à s’affirmer contre un regard qui les assigne et les enferme. Il y a peut-être aussi des points communs avec d’autres figures de ma filmographie. Sabine et Samia ont eu à défendre une part d’elles-mêmes qui n’était pas reconnue, mais au contraire entravée. C’était même le cas de Fatima.”
En tournant trois épisodes de cinquante minutes en trente-six jours, l’habitué des plateaux de cinéma a dû se faire violence, trouver un rythme plus rapide sans pour autant renoncer à sa touche. “De mon point de vue, ce sont de vrais plans, du vrai jeu”, précise l’intéressé. Et une vraie série ? La question n’est pas centrale pour Faucon, qui admet une culture très limitée du genre.
“Par goût et par manque de temps – j’ai toujours des films à rattraper –, je n’ai jamais vraiment regardé une série entièrement. Je me retrouve à pratiquer une forme qui est assez loin de moi et de mon histoire. Comme je suis toujours un peu intéressé par ce qui m’est étranger, c’est un détour que j’ai bien aimé faire.”
Au moment du scénario, il lui a fallu intégrer quelques règles dont il n’avait pas une grande connaissance. “Dans l’écriture d’une série, il se passe toujours un événement, alors que moi je fais des choses qui sont d’une certaine façon à l’opposé.” L’art de filmer les temps morts et les dramaturgies à contretemps constitue pourtant l’essentiel créatif des séries contemporaines dites d’auteur depuis près de deux décennies. Comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, Philippe Faucon pourrait revamper les séries françaises sans vraiment le vouloir. Réponse sur Arte, en 2018.
Publié dans Sceneweb
La Comédie De l’Est, CDN de Colmar, à l’initiative de son directeur Guy Pierre Couleau propose un festival du 28 au 30 septembre 2017 pour célébrer les 70 ans de la décentralisation, en compagnie des 4 autres centres dramatiques de la région Grand Est (La Comédie de Reims, le NEST de Thionville, le TJP de Strasbourg et la Manufacture à Nancy), ainsi que du Théâtre National de Strasbourg et le Théâtre du Peuple de Bussang.
Je consacre toujours du temps à essayer de répondre clairement, parce que je suis certain que, loin d’être anodine, cette question est très importante pour nos métiers. La Comédie De l’Est a acquis son statut de centre dramatique national, soixante-six ans après que fût installé à Colmar le premier centre dramatique de l’Est. On a pu parfois remettre en question ce qui devrait être communément admis comme un des plus ambitieux et des plus généreux projets de notre société : démocratiser le théâtre et le rendre accessible au plus grand nombre d’entre nos concitoyens.
Le théâtre est notre miroir, le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous faisons du monde dans lequel nous naissons et vivons. Sans le théâtre, difficile de croire que nous pouvons nous représenter qui nous sommes vraiment. C’est un art noble, simple d’accès, indispensable, qui ne se pratique que dans le partage et par le don. Ayant fait une grande partie de ma carrière d’acteur puis de metteur en scène au sein des centres dramatiques, j’en suis aujourd’hui devenu directeur et l’exercice de cette fonction me permet de comprendre mieux le projet si ambitieux de la décentralisation théâtrale.
Un centre dramatique national est un théâtre dont l’activité est centrée sur la création de spectacles. Un théâtre d’art populaire, ni moralisateur, ni stigmatisant, mais qui, au contraire, pose des questions et livre des pistes de réflexion sur de grands thèmes humains, grâce à la poésie dramatique et par le génie des auteurs. Créer des spectacles chaque année demande d’inviter des artistes dans nos murs, ce qui revient à accepter l’autre et sa singularité, respecter ce qu’il nous apporte de différent, d’inconnu, d’insoupçonné. C’est pour nous la possibilité de s’enrichir d’un univers nouveau et d’accroître notre capacité personnelle à vivre mieux les bouleversements et l’évolution du monde. Vivre en découvrant est aussi vivre en se construisant. C’est l’autre qui me construit et c’est une des raisons pour lesquelles je fais du théâtre. En cette période très difficile, nous voulons être un théâtre démocratique ouvert au plus grand nombre. Nous voulons contribuer à construire le sens de nos vies et travailler au bien commun. Nous voulons être au coeur de la société.
C’est pour cela que, loin d’être une citadelle réservée à une élite, notre théâtre travaille chaque jour avec les institutions culturelles, les écoles, les centres médicaux, les musées, les bibliothèques, les entreprises privées, les prisons, les associations … Transmettre, donner à penser, contribuer à créer une plus grande richesse de la pensée, offrir aux autres un regard ouvert sur le monde et ce qui nous environne, tels sont nos objectifs au quotidien, telles sont nos ambitions et nous nous sentons responsables de cette mission qui nous est confiée par nos tutelles pour le bien du public : démocratiser et partager l’art du théâtre. C’est ce que nous faisons chaque jour. Notre travail s’appelle « faire du théâtre ».
Il n’y a « rien de plus futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire que le théâtre » disait Louis Jouvet. Nous reprenons cette phrase à notre compte en ces temps de doute et de perdition pour beaucoup d’autres autour de nous. Oui, le théâtre est nécessaire à notre temps, à nos semblables et nous le vérifions chaque jour. Certes, le théâtre est construit d’illusions, de vanités et de magies. C’est ce qui en fait sans doute sa beauté et sa nécessité : sans magie, point de rêves, sans vanité, nulle profondeur, sans fausseté, pas de vérité.
Et la vie, notre vie a aujourd’hui grand besoin de vérité. »
Guy Pierre Couleau
Tamara
Comédie de l’Est – CDN de Colmar
Texte et mise en scène : Guy Pierre Couleau
Avec Anne Le Guernec et Kuno Schlegelmilch
« À l’invitation du musée Unterlinden, et autour de l’exposition ‹ Otto Dix – le Retable d’Issenheim ›,
j’ai imaginé une performance pour une actrice et un artiste plasticien. À partir des ‹ Leçons de peinture › écrites par Otto Dix en 1958, je me suis échappé vers l’art des acteurs et leur capacité à se métamorphoser. Inspiré par le portrait de la danseuse Tamara Danischewski et la leçon de peinture n° 20 d’Otto Dix, j’ai ainsi composé une
fantaisie sur l’actrice et son rôle, le peintre et son modèle, l’artiste et le personnage. » – Guy Pierre Couleau
Foyer du Théâtre Municipal de Colmar
Je 28.09 à 12h30
Ve 29.09 à 12h30
Cancrelat
Comédie de l’Est – CDN de Colmar
De Sam Holcroft – mise en scène : Vincent Goethals
Avec Léna Dia, Marlène Le Goff, Ruby Minard, Juliette Steiner, José-Maria Mantilla et Logan Person
Ce spectacle a été créé lors de la première édition d’« Acteurs Studio », un tremplin inédit pour jeunes
comédiens. Dans la salle de classe de Beth, les élèves crient, se battent, cassent fenêtres et portes… Mais Beth, professeur de sciences naturelles, est convaincue que c’est par le savoir que ses élèves réussiront dans la vie.
Cependant, dehors, la guerre fait rage…
Studio Delphine Seyrig – C D E
Jeudi 28.09 à 14h15
Vendredi 29.09 à 10h et à 19h
La vie des formes
TJP – CDN de Strasbourg
Conception et interprétation : Renaud Herbin et Célia Houdart
Que provoquent les rencontres ? Celle de Célia Houdart et Renaud Herbin les plongent au coeur de ce qui les trouble: la façon dont naissent les figures et les personnages des fictions qu’ils inventent. Chacun à leur manière – écrivain et marionnettiste –, ils les façonnent dans la matière. Entre ce qui est donné à voir de cette relation et les textes que Célia Houdart fait entendre, s’invente un monde inédit où les évocations se répondent. Une relation à trois s’instaure.
Studio Delphine Seyrig – C D E
Je 28.09. à 19h
Ma langue père
NEST, CDN de Thionville
Conception : Jean Boillot
Création sonore : David Jisse
Assis devant un ordinateur et des consoles, un DJ. Debout devant un pupitre,
une actrice. Elle est équipée d’une oreillette. Le DJ mixe des sons qu’on
entend, et envoie dans l’oreillette de l’actrice des extraits d’enregistrements
de discours de trois ministres de la Culture. L’actrice les redit immédiatement,
en imitant textes et intonations : totem-amplificateur d’un nouveau genre.
Entre sons et voix, pendant 30 minutes, un dialogue s’établit.
Salle Michel Saint-Denis – C D E
Je 28.09. à 20h30
Histoire de la littérature récente
Comédie de Reims
D’Olivier Cadiot
Mise en voix : Ludovic Lagarde
Avec Laurent Poitrenaux
Les écrivains sont de beaux allumeurs. Ils passent leur temps à essayer, non de mettre la main sur la littérature, qui ne se laisse pas prendre, mais de mettre le feu aux mots et à ceux qui les aiment : ils leur tournent autour. Olivier Cadiot est de ces enjôleurs magnifiques. Cette lecture au titre paisible et ironiquement rassurant se présente comme une sorte de guide pratique pour aspirant littérateur, avec conseils avisés et exercices cadrés.
Salle Michel Saint-Denis – C D E
Je 28.09. à 21h
Don Juan revient de guerre
Comédie de l’Est – CDN de Colmar
D’Ödön Von Horváth
Mise en scène : Guy Pierre Couleau
Avec Carolina Pecheny, Jessica Vedel, Nils Öhlund
Don Juan a perdu de sa superbe. Au sortir de l’horreur de la guerre de 1914 – 1918, l’homme est fatigué. Il va son chemin dans une Allemagne aux prises avec la crise, à la recherche de la fiancée qu’il a jadis abandonnée. Cette pièce exceptionnelle met en scène trente-cinq femmes pour un seul homme. Et c’est le destin de ces femmes que nous conte l’auteur, sans concessions, en témoin critique et chroniqueur fidèle de l’actualité qu’il avécue.
Salle Michel Saint-Denis – C D E
Ve 29.09. à 14h15 et 21h
La Nuit juste avant les forêts
La Manufacture, CDN de Nancy
De Bernard-Marie Koltès
Lu par Michel Didym
« La Nuit juste avant les forêts » ce sont soixante-trois pages de phrases liées l’une à l’autre pour que l’on n’ait pas le temps de respirer, soixante-trois pages pour dire la dérive, la colère, la dignité de celui qui vit « à côté », à côté d’une maison, d’un travail, d’une famille. Un solo du désespoir qui est aussi une leçon de vie.
Salle Michel Saint-Denis – C D E
Ve 29.09. à 20h30
Ce que la vie signifie pour moi
TNS
De Jack London
Lu par Stanislas Nordey
Cette brève « autobiographie », parue en 1906, est
l’un des textes politiques de Jack London les plus
marquants. Dans ce récit personnel, il retrace le
chemin qui le mena à devenir socialiste. Crieur de
journaux, pilleur d’huîtres, ouvrier dans une
conserverie, employé d’une teinturerie, électricien,
vagabond… Il nous livre ici les voies qui firent de lui
un auteur engagé.
Salle Michel Saint-Denis – C D E
Sa 30.09. à 18h30
Par Anne Diatkine
Photo Mathieu Zazzo pour Libération
Désormais plus souvent sur les planches que devant la caméra, la comédienne se sent apaisée de se consacrer désormais au théâtre.
A un moment donné, la parole s’arrête : Emmanuelle Béart n’arrive pas à qualifier ce qu’elle était encore il y a peu, et qu’elle est toujours pour des millions de gens. «Une star ?» «Quelle horreur, ce mot.» «Une actrice très en vue ?» «Ce n’est guère mieux.» «Une vedette ?» «Arrêtons.» Si bien qu’échouant à trouver le mot juste, on est bien obligée de la regarder, aujourd’hui, dans la lumière printanière de l’appartement qu’elle vient d’emménager, à moins que ce soit sa peau (transparente) et ses cheveux (très blonds) qui ensoleillent l’espace. Une (très belle) femme au visage reposé («vous plaisantez ? Il n’y a pas au monde plus insomniaque que moi») et maquillage invisible. Pas de bijoux, les cheveux tirés, un long pull crocheté gris, aucun artifice, pas même celui du naturel travaillé.
Dans quelques heures, sur le plateau du Rond-Point, elle sera «Elle», personnage anonyme, chef de quelque chose toujours pressée, avide de pouvoir, qui veut un enfant, aimerait aimer, réussir à avoir du plaisir, que ce soit avec «L’un» (Laurent Sauvage) ou «L’autre» (Thomas Gonzalez), dans Erich Von Stroheim, de Christophe Pellet, mis en scène par Stanislas Nordey. C’est elle qui a dit sa préférence pour la pièce de Pellet parmi plusieurs que Nordey lui avait proposé de lire, attirée par le mélange de trivialité et de mystère du texte de ce dramaturge quasi inconnu, et notamment par ses mots : «Un corps premier, un corps absolu, libre de toutes les images passées.»
C’est peut-être la seule réplique où le diktat du personnage coïncide avec celui de l’actrice. On entre donc chez Emmanuelle Béart, et elle commence par parler d’une seule traite de la pièce, sans laisser d’intervalle pour l’ombre d’une question. Puis : «Ce qu’elle réveillait chez moi, c’était la question : "Que reste-t-il de mon désir, et notamment celui d’être actrice de cinéma ?"» Elle dit : «Je ne demande pas un grand film. Mais une rencontre. Quand je vois pour la première fois un film que j’ai tourné, j’ai le plus souvent l’impression d’un pull passé à la machine. C’est bien ce qu’on a tourné, mais tout a rétréci. Les émotions, les sentiments, comme le reste.»
Emmanuelle Béart n’a aucune difficulté à déménager, laisser des cartons, jeter ses dossiers, s’extraire de sa vie, s’en forger une autre, tomber amoureuse, cette fille est un lézard, et c’est peut-être ainsi que depuis sept ans, elle a, en toute discrétion, abandonné les oripeaux de la star de cinéma pour apprendre un autre métier : comédienne de théâtre dans une troupe, («je n’ai pas dit troupeau»), et une communion («au lieu de la communication»), payée au cachet (215 euros brut par soir) le même montant que ses partenaires, au plus loin de la hiérarchie du cinéma, où tout fait signe et se contractualise : la hauteur des lettres qui disent le nom sur l’affiche, sa place dans le générique, la montée des marches quelles que soient les marches, et ainsi de suite. Emmanuelle Béart a aujourd’hui presque gagné cette conquête de l’anonymat, ce parcours à l’envers. «Quand on choisit le théâtre subventionné, on choisit forcément de ne pas être au centre.» Et aussi : «C’est un autre corps qu’on utilise. Parfois, je me dis que j’aurais dû ne jamais faire du cinéma. Ma vraie maison, c’est le théâtre, alors même que je n’ai aucune formation. Encore maintenant je n’en ai pas toutes les clés.» Se ravise : «Et pendant que j’affirme ceci, j’ai de nouveau très envie de tourner. On vient de me proposer un formidable projet… Je dois donner une réponse, aujourd’hui.» Avec honnêteté, elle dit «le sentiment d’abandon» qu’elle a ressenti de la part des cinéastes, et qu’elle n’a pas «su surfer sur une nouvelle vague», qu’elle a manqué de «gnaque», de «curiosité», de «ferveur». Que ces dernières années l’ont menée à l’enterrement de tous ses «pères», ceux qui l’ont «magnifiquement aidée à devenir femme et actrice», Claude Berri, Claude Chabrol, Jacques Rivette. La mort de Rivette, notamment, l’a «fracassée».
«Je suis responsable de beaucoup plus de choses que je ne veux bien l’admettre», remarque-t-elle sans tristesse ni nostalgie. Mais elle s’est sans doute d’autant moins battue pour continuer à être sur les écrans qu’elle n’a jamais eu à lutter pour être actrice. «Tout m’a été donné. J’ai eu à me battre pour beaucoup de choses, ne serait-ce que pour vivre, en avoir envie - et ce combat, je l’ai gagné - mais pas pour jouer. Je me suis jetée devant la caméra de manière très intense. C’était une fuite et je sais ce que je fuyais. Je n’ai plus besoin de cette course aujourd’hui.» Lorsqu’elle a débuté, son père était ravi, «faite pour ça et rien d’autre», et c’était le «rien d’autre» qui importait précise-t-elle avec humour. Sa mère, qui avait connu une expérience de la caméra avec Godard dans les Carabiniers, était catastrophée, «c’était le pire qui pouvait lui arriver». Quant à sa grand-mère, grecque «au sang bleu», qui lui a insufflé le désir d’être comédienne, elle exultait. «Elle a été comédienne à travers moi par procuration, car dans son milieu une femme ne pouvait pas travailler.» Mais jusqu’à son dernier jour - et Emmanuelle Béart la mime en riant avec son accent grec - son aïeule lui a répété : «Tu es une très bonne comédienne. Mais un petit peu moins bonne, quand même, que Juliette Binoche !» Sa grand-mère tant aimée a expiré son dernier souffle à 107 ans, dans les bras et la maison de sa petite-fille avec laquelle elle vivait, et avec toute sa tête. La nuit, Emmanuelle Béart passe son temps à souligner des textes, prendre des notes, découper des articles, les coller, faire des dossiers sur la correspondance de Mozart avec son père, même si elle sait qu’ils ne lui serviront pas et qu’elle les jettera plus tard, peu importe, sa démarche n’est pas utilitaire. La nuit, elle lit les quotidiens, le Monde et Libération. Mais aussi, elle écrit, «simplement pour ne pas oublier». Face au sommeil, elle a «abdiqué», tant pis pour lui s’il ne veut pas d’elle, son absence ne l’empêche pas de rêver. Depuis longtemps, Emmanuelle Béart travaille à deux documentaires : l’un sur l’adoption et l’autre sur son père, le compositeur Guy Béart, au parcours tumultueux, né en Egypte et grandi au Liban avant de devenir Français.
Bref, Emmanuelle Béart prend le temps de travailler - «mais c’est un travail qui n’est pas du même ordre que le personnage que je joue», et elle est particulièrement fière que ses trois enfants soient eux aussi «des bosseurs». Sa fille aînée, Nelly, est avocate, son fils cadet, Johan, est en master d’éco, et le petit dernier de 8 ans est lui aussi un travailleur qu’elle amène tous les matins à l’école. Elle dit son âge sans qu’on le lui demande, «53 ans», et aussi qu’elle ne s’attendait pas à ce que tout «se redéploie et s’apaise» après la cinquantaine. Elle vit depuis plusieurs années avec «l’homme de sa vie». Au cinéma, elle s’est promis de refuser tous les rôles de femmes plus jeunes.
14 août 1963 Naissance à Gassin (Var). 1989 Les Enfants du désordre (Yannick Bellon). 2017 Erich Von Stroheim (Christophe Pellet) au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 21 mai.
Anne Diatkine
Par Vincent Bouquet pour son blog Du Théâtre par gros temps
« Erich von Stroheim » / Crédit photo : Jean-Louis Fernandez.
Stanislas Nordey est un touche-à-tout. Loin de se cantonner à un seul registre, le directeur du TNS prouve, au gré des spectacles qu’il monte, qu’il est à l’aise avec tous les sujets qu’ils soient politiques (Je suis Fassbinder), métaphysiques (Affabulazione) ou intimes. Erich von Stroheim, la pièce de Christophe Pellet, dont il s’empare au Théâtre du Rond-Point, appartient à cette dernière catégorie, et Nordey démontre, une nouvelle fois, qu’il a la sensibilité nécessaire pour en faire un joli objet scénique, sur lequel peu de choses, formellement, sont à redire. Sauf, qu’en lui-même et pour lui-même, le texte de Pellet apparait pour le moins limité, prisonnier d’un triangle sexuel névrotique auquel il a donné naissance mais dont il ne sait finalement que faire.
Car, entre Elle (Emmanuelle Béart), l’Un (Victor de Oliveira) et l’Autre (Thomas Gonzalez), il n’est pas, ou peu, affaire de sentiments. Elle est une femme-maîtresse, accomplie et mûre, pour qui le travail occupe une place prépondérante ; l’Un est un acteur porno, las de passer ses soirées déguisé en militaire, en plombier ou en marin, alors qu’il anticipe son déclin physique ; l’Autre est un jeune premier, un « tigre », frais d’une insolente jeunesse mais excessivement paumé, tentant de trouver sa place au milieu, ou plutôt en périphérie, de ce couple qui semble l’utiliser pour mieux se sauver. Entre eux, tout juste est-il question d’une attirance sexuelle bilatérale, où le sexe est considéré comme un bien de consommation, à la limite de la prostitution. Le désir, la passion, toutes ces choses qui font le sel des relations, ont laissé la place à une intense névrose – ponctuée de fluctuants rapports dominant-dominé – qui les ronge, tous les trois, à petit feu.
Friable substrat
S’il proclame que « cette histoire privée est celle de l’humanité », Christophe Pellet dépeint, paradoxalement, une situation qui en manque cruellement. Les passions supputées y sont si froides que rien, ou presque, dans ce sombre tableau ne renvoie aux attributs mêmes de l’être humain, et, a fortiori, au fonctionnement du sentiment amoureux ou sexuel. Le sujet initial de la transformation, voire de la mort, du couple, vu comme un carcan sclérosant pour l’individu, peut paraître universel mais le traitement que lui inflige Pellet est d’une superficialité telle qu’il ne parvient jamais à lui conférer une dimension réflexive. Touchant du doigt d’ambitieuses thématiques dignes d’intérêt – Comment s’aimer ? Sexe et amour sont-ils liés ? Comment se construire une place dans la société ? -, il n’échappe pas aux écueils trop cuistres, attendus ou caricaturaux pour convaincre.
Malgré tout, sur ce friable substrat, Stanislas Nordey construit un bel édifice théâtral, où le trio de comédiens, particulièrement bien dirigés, donne du relief et de la chair à leurs personnages. Utilisant l’élégante scénographie d’Emmanuel Clolus et la voix de la Callas (Mon coeur s’ouvre à ta voix, extrait de Samson et Dalila de Saint-Saëns) avec une infinie délicatesse, il crée un univers d’une sensibilité palpable, qui tranche avec la raideur du texte de Pellet. Seul point négatif : l’utilisation du dispositif scénographique, aussi réussi soit-il, est trop systématique pour ne pas devenir lassante. Surtout, la pièce se voit saccadée par des interruptions trop régulières qui brisent les prémices d’un élan dans lequel, parfois, elle venait tout juste de s’embarquer. Elle n’en avait pourtant nul besoin.
Erich von Stroheim de Christophe Pellet, mis en scène par Stanislas Nordey au Théâtre du Rond-Point (Paris) jusqu’au 21 mai. Durée : 1h20. **
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :
Plus de vingt ans après la disparition de « Prospero » paraît « Parages », une revue vouée aux textes de théâtre, animée par des auteurs et qui parle d’eux mais aussi de maisons d’édition, d’écoles et de théâtres qui les concernent. Le premier numéro de « Parages » manquait de hauteur, le second n’en manque pas mais bute sur une marche glissante.
L’acteur, metteur en scène, directeur du TNS (Théâtre national de Strasbourg) et gros dévoreur de textes de théâtre qu’est Stanislas Nordey l’a voulue, l’auteur Frédéric Vossier l’a conçue, la revue Parages, après un numéro 1 (juin 2016) qui fut un tour de chauffe, prend sa vitesse de croisière (un à deux numéros l’an) avec la présente sortie de son numéro 2.
De « Prospero » à « Parages »
Parages entend être « une revue de réflexion et de création » vouée au « théâtre de texte contemporain », dans la diversité de sa « galaxie » : « auteurs, textes, inédits » bien sûr, mais aussi « institutions, écoles, maisons d’édition ».
Il y a plus de vingt ans, quelques saisons durant, Prospero fut la revue (trimestrielle) du Centre national des écritures du spectacle (la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon), avec pour rédacteur en chef un auteur, Michel Azama. Elle se voulait « une revue d’écrivains de théâtre, conçue pour donner leur point de vue sur tous les aspects de la vie théâtrale et débrouiller ce qui se passe entre écriture et plateau ». De fait, on y vit des auteurs écrire des critiques de spectacles ou de textes de confrères auteurs. Dans Prospero n°1, Jean-Luc Lagarce racontait comment il écrivait et Didier-Georges Gabily s’entretenait avec Bernard Dort. Dans Prospero n°2, Claudine Galea se penchait sur une pièce d’Hubert Colas, Visages. Seule rescapée d’une autre époque, elle figure également dans Parages /02 avec l’un de ses textes.
Une autre époque ? « Beaucoup de directeurs de structures – CDN ou Scènes nationales – avouent n’avoir pas le temps, ou la compétence, pour lire les écrivains de théâtre d’aujourd’hui », écrivait Azama. La situation a-t-elle beaucoup changé ? En revanche, pour ce qui est des comités de lecture au sein de ces établissements dont Azama déplorait l’absence, la situation a évolué. De même, le rédacteur en chef de Prospero s’insurgeait contre le fait que la notion d’« artiste associé » soit réservée aux metteurs en scène, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec Claudine Galea, Marie Ndiaye et Pascal Rambert, auteurs associés au TNS mais cela reste une exception.
« Comité de rédaction » pour Prospero ou « Ensemble éditorial » pour Parages, les auteurs sont nettement majoritaires dans le pilotage de ces revues. Quatre (Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Lancelot Hamelin, David Lescot) sur six membres pour Parages, les deux autres étant des personnes sensibles aux écritures contemporaines : la journaliste Joëlle Gayot (France-Culture) et la maîtresse de conférences en arts de la scène Bérénice Hamidi-Kim (Université Lumière-Lyon-2).
« Le Bruit du monde », revue
Cette dernière entre dans le dédale d’une passionnante jeune autrice, Pauline Peyrade dont, pour l’heure, seules deux pièces Ctrl-X et Bois impériaux sont publiées (ensemble, aux Solitaires intempestifs). La première a été mise en scène par Cyril Teste, la seconde a fait l’objet d’une mise en espace par Anne Théron. L’an dernier, Pauline Peyrade participait aux Sujets à vif du Festival d’Avignon, formant un attachant tandem avec la circassienne Justine Berthillot et l’on y entendait des extraits de Poings, son dernier texte (à paraître). En outre, Pauline Peyrade dirige une revue électronique Le Bruit du monde dont il existe une version papier. Chaque numéro est centré autour d’un axe (de « Prise de parole » pour le n°1, à « Censuré » pour le n°4, le plus récent) et est parrainé par un auteur : Philippe Malone, Sonia Chiambretto, Christophe Pellet, Magali Mougel pour les quatre premiers numéros. Des noms que l’on retrouve ou que l’on retrouvera dans Parages.
Suite du sommaire : Christophe Pellet et Eric Noël, auteur canadien, qui se sont rencontrés à Montréal lors d’une résidence d’écriture, proposent une savoureuse correspondance amoureuse fictive et par mail. C’est aussi par mail qu’Anne Théron et Alexandra Badea correspondent. Elles parlent d’amour, de politique, d’enfance, de larmes (elles ont un projet ensemble sur le rapport mère/fille) et de leurs lectures : Cynthia Fleury, W.G Sebald, Georges Didi-Huberman.
L’un des principes de la revue consiste à donner aux membres du comité la possibilité d’avoir un invité. Joëlle Gayot invite ainsi David Léon ; Claudine Galéa, Jean-René Lemoine ; David Lescot, Céline Champinot. Chaque invité apporte en cadeau un texte inédit ou un extrait d’une écriture en cours. C’est riche, souvent surprenant, toujours éclairant.
En 2003, l’auteur Enzo Corman fondait au sein de l’Ensatt, un département « écrivain dramaturge ». Magali Mougel, Pauline Peyrade et d’autres sont passés par là. Dans Parades/02, Corman raconte la genèse de ce département unique dans les écoles de théâtre françaises qu’il codirige aujourd’hui avec un ancien élève, Samuel Gallet.
De L’Arche au Rond-Point
Un focus est consacré à la maison d’édition L’Arche où sont publiés Badea et Pellet. Etude universitaire sur l’un des auteurs phares de la maison, Fabrice Melquiot ; portrait par ce dernier du directeur de la maison d’édition Rudolf Rach qui, lui, nous restitue une rencontre avec Thomas Bernhard où il est question de contrat et d’argent ; et enfin très beau portfolio de Jean-Louis Fernandez photographiant la petite équipe de L’Arche dans sa boutique-bureaux à deux pas de la place Saint-Sulpice.
Parages /02 s’achève par une incongruité qui s’étale sur 47 pages (c’est de loin l’ensemble le plus long du numéro) : un séjour « en immersion » de Lancelot Hamelin au Théâtre du Rond-Point, établissement dont Frédéric Vossier évoque sans rire « la démesure, l’aspect inclassable et hors du commun ». Il faut tout le talent de l’auteur Lancelot Hamelin pour retenir notre attention en parcourant ce lieu que l’on peut tout autant qualifier de fourre-tout, opportuniste et malin. Pourquoi parler de ce théâtre dans Partages alors que la question des auteurs et de leur traitement y est escamotée?
Comme c’était à prévoir, le directeur de l’établissement pressé et fort occupé, retarde le moment de rencontrer l’insaisissable dramaturge relooké en néo-journaliste gonzo. Hamelin en profite pour s’attarder au bar (passage obligé et prolongé de tout journaliste gonzo) dont les cocktails aussi compliqués qu’écœurants et les histoires pas tristes qu’il y entend dressent, par ricochets, un portrait en creux du théâtre assez croquignolesque. Assurément bien plus intéressant que l’entretien accordé enfin par le directeur dans son vaste bureau dont le journaliste occasionnel résume la décoration par un délicieux oxymore : « humble mégalomanie ».
Dans le numéro 7 de Prospero, Michel Azama saluait la disparition de l’auteur Heiner Müller devenu directeur d’un grand théâtre allemand. Et achevait ainsi son édito : « Nous voulons espérer qu’un jour nous verrons en France de grands auteurs à qui auront été accordés les moyens de travailler, de grandir, d’approfondir leur œuvre en dirigeant un théâtre. » Ce jour est arrivé en 2003 au Théâtre du Rond-Point et il perdure. Le directeur n’est peut-être pas un « grand auteur » mais c’est un auteur dont la « poésie » « atteint cet étrange tremblement proche du rire », si, si, c’est Lancelot Hamelin qui le dit. On a les Heiner Müller qu’on peut.
Parages /02, 190 p., 15 euros, revue distribuée par Les Solitaires intempestifs.
Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama
Il est convaincu que la culture peut résoudre beaucoup de choses. Et pourtant, faute de propositions fortes, l'homme de théâtre (et de gauche) ne s'y retrouve pas. Rencontre avec Stanislas Nordey.
Il assume déjà tous les métiers de la scène : directeur du Théâtre national de Strasbourg, metteur en scène, acteur chez les autres dès qu'il le peut… Néanmoins, Stanislas Nordey, qui appartient à cette génération de quinquas aujourd'hui au pouvoir dans l'institution, trouve du temps pour suivre de près la campagne présidentielle. Via la lecture quotidienne de la presse écrite, et à la source, sur les sites des candidats dont il a épluché par le menu tous les programmes.
Quel regard portez-vous sur la campagne ?
Elle existe, contrairement à ce que tout le monde dit, même si les grands médias mettent le paquet sur les affaires. Chacun des candidats trace des lignes auxquelles on peut s'identifier ou pas. En revanche, certains secteurs sont laissés de côté… comme la culture : le silence de tous sur ce sujet (y compris des petits candidats, car Yannick Jadot, quand il était encore en campagne, n'en faisait pas grand cas non plus), est frappant. La bonne surprise, si j'en juge par le prisme des médias car je ne suis pas immergé dans le réel des meetings, est que le thème sécuritaire n' a pas dévoré toute la place… On parle surtout social et économie.
“Si le mot ‘culture’ surgit tout à coup lors des interviews, cela ressemble à une blague !”
Comment expliquez vous une telle absence des sujets culturels ?
Absence telle que si le mot « culture » surgit tout à coup lors des interviews, cela ressemble à une blague ! Les politiques n'en sont pas les seuls responsables. Les éditorialistes et les commentateurs relèguent la culture dans un angle mort. Mais je ne devrais pas vous dire cela à vous, Télérama, qui en avez organisé Les Etats Généreux. Au vu des récents attentats et des fractures en cours dans la société, il est très dommageable, voire aberrant, d'assumer une telle impasse.
Sans être un doux utopiste, j'en suis convaincu : la culture est un terrain où l'on peut résoudre beaucoup de choses. Ce n'est pas davantage de plan vigipirate qu'il faut porter dans les territoires abandonnés, mais plus de culture et d'éducation. Les deux sont indissociables : transmission des savoirs et ouverture d'esprit passent par ce carrefour-là. Je le sais parce que je l'ai souvent expérimenté moi-même en faisant des ateliers dans les quartiers : des gamins que les profs disaient perdus, en proie à l'exclusion, à l'abandon, à l'intolérance et à la haine de l'autre se réveillent parce qu'ils rencontrent quelque chose qui les touche.
On voit pourtant dans beaucoup de programmes une volonté de renforcer la présence de l'art à l'école : chez Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, ou Emmanuel Macron par exemple…
Certes mais cela reste vague : aucun n'affiche clairement les moyens qu'il y met. Or il faut un arbitrage budgétaire, car cela coûte cher. Je ne sens pas émerger le désir d'un projet d'ampleur comme le fut le plan Lang-Tasca [en décembre 2000, ndlr]. C'est sans doute lié à l'affaiblissement, ces dernières années, du ministère de la Culture lui-même. Je n'ai rien à reprocher à François Hollande… L'une de ses grandes fautes, pourtant, est cette valse de trois ministres en cinq ans : un vrai manque de sérieux, car, pour construire, il faut du temps.
“J’aurais rêvé d’une candidature de Christiane Taubira, parce qu’elle aurait truffé ses discours de citations de poètes !”
Qu'est ce que vous attendez d'une élection présidentielle ?
Je suis un incorrigible gauchiste même si je n'ai jamais été encarté nulle part. J'ai été politisé très tôt : je défilais dans la cour d'école primaire en 1974 avec des pancartes « Mitterand Président/Giscard au placard » ! Si j'ai aimé Mitterrand, c'est parce qu'il lisait et écrivait lui-même. A l'inverse, pendant l'une des dernières mandatures, on a eu un président (Nicolas Sarkozy) qui ne finissait jamais ses phrases… Aujourd'hui, j'aurais rêvé d'une candidature de Christiane Taubira, parce qu'elle aurait truffé ses discours de citations de poètes ! Les candidats, toujours si prompts à parler de « LA » France, évoquent pourtant rarement sa langue et sa littérature…
Sur le plan politique, la présidentielle est un instant démocratique fort et j'y crois beaucoup : les citoyens se retrouvent ensemble pour parler du monde dans lequel ils vivent ou dans lequel il veulent vivre. Et des directions à prendre, en fonction de ce qui a été fait et de ce qui pourrait être fait. On attend toujours des candidats qu'ils définissent leur projet de société… Il y a bien des choses ici ou là. Mais la cohérence d'un geste fort se fait attendre.
Qu'est ce qui a changé depuis… 1974 ?
Ce qui ne change pas, c'est l'absence de femme ! Pourquoi donc, en politique, n'arrive-t-on pas à rendre effective la parité ? La diversité de la France multi-culturelle d'aujourd'hui n'est pas présente non plus ! Comme au parlement, tout cela reste très paresseux. La société civile bouge donc plus vite que nos responsables politiques. Le grand renouvellement n'est pas là : François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, sont tous en piste depuis plus de trente ans. Emmanuel Macron est le plus jeune, mais il est quand même loin du profil des Podemos ou des hommes de la société civile. Nous sommes encore encalminés dans quelque chose de très traditionnel.
“Je ne sais pas pour qui je vais voter, et vu la faiblesse des projets, ce n’est pas la culture qui déterminera mon choix”
Les querelles d'appareils, elles, sont toujours vivaces : en tant qu' homme de gauche, je ressens une colère très forte de voir que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont été incapables de fusionner. Ce sentiment est très partagé ; je l'entends beaucoup autour de moi. Visiblement, ces politiques n'ont pas compris ni écouté ce qui bouge dans la société : le rapprochement, le dépassement des barrières. On dirait qu'ils remettent des frontières partout ! Emmanuel Macron semble l'avoir senti, mais je ne sais pas s'il est capable d'incarner vraiment ces déplacements sensibles aujourd'hui dans la population… Des déserteurs du PS iront vers lui, d'autres vers Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Moi, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Au vu de la faiblesse des projets, ce n'est pas la culture qui déterminera mon choix.
Les artistes peuvent-ils prendre une place dans la campagne ?
Si la culture y avait toute sa place, cela aurait du sens, oui. Mais là, s'il s'agit de parler de l'ISF ou du terrorisme, ce n'est pas mon rôle. Soutenir tel ou tel candidat ? Ce n'est pas passionnant non plus comme position : s'agit-il de se faire plaisir ou de s'attirer les bonnes grâces de notre favori, s'il est élu ? Si d'aventures, de Fillon à Mélenchon, l'un ou l'autre parmi les principaux candidats avait besoin de mon éclairage pour bâtir son projet, je le ferais volontiers. Mais cela n'arrivera pas à l'occasion de cette présidentielle : quand les politiques cherchent à organiser des déjeuners avec les artistes, c'est surtout pour faire joli. Rarement pour engranger des idées nouvelles ou tenir compte d'expériences concrètes.
Vous êtes pessimiste…
Pas du tout ! Au fil des affaires, je vois poindre la nécessité d'un renouvellement profond de l'espace politique. La moralisation de la vie publique en est un aspect ; la façon de faire de la politique, encore un autre. La vieille manière d'exister sur ce terrain va disparaître avec la retraite des « éléphants » ! Si cela n'arrive pas dans cette présidentielle, ça sera pour la prochaine… ou pour la suivante.
|
Par Brigitte Salino (Strasbourg, envoyée spéciale du Monde) 11 nov. 2021
A Strasbourg, Stanislas Nordey met en scène trois textes citoyens de l’autrice franco-camerounaise.
Stanislas Nordey ne met en scène que des auteurs contemporains, et, sauf rares exceptions, il leur consacre toute la programmation du Théâtre national de Strasbourg (TNS). C’est un choix délibéré qu’il a fait en prenant la direction du TNS, en 2014. Certains le contestent, au motif que classiques et contemporains doivent s’allier pour satisfaire le goût et la réflexion du public. Mais il y a, dans cette radicalité, un ancrage dans l’histoire de cet endroit, qui fut un haut lieu de révolution théâtrale, au tournant des années 1970-1980, avec Jean-Pierre Vincent, et une belle volonté de s’inscrire dans un « ici et maintenant », en faisant entendre, souvent pour la première fois, ce qui s’écrit aujourd’hui. Léonora Miano est ainsi à l’affiche, jusqu’au 20 novembre, avec Ce qu’il faut dire (2019, L’Arche, collection « Des écrits pour la parole »). Ce sont trois textes, composés à partir de récitals poétiques donnés par l’autrice, née en 1973, au Cameroun, et devenue une voix importante de la littérature subsaharienne. Léonora Miano refuse d’écrire le mot « Afrique ». Sauf pour souligner, comme elle le fait dans Le Fond des choses, l’un des trois textes mis en scène par Stanislas Nordey, qu’il est une invention des Européens, totalement étrangère aux langues du sud du Sahara. De la même façon, Léonora Miano ne veut pas parler de « Noirs », parce que c’est les « murer dans la race », écrit-elle dans le premier texte, La Question blanche. Et son troisième texte, La Fin des fins, commence par « J’ai fait un rêve. Sister, j’ai fait un putain de rêve », qui renvoie à Martin Luther King, tout en s’en démarquant. Car l’autrice tient à déconstruire le langage et à le reconsidérer à l’aune de l’histoire telle qu’elle la perçoit, et, à travers elle, les Afropéens – ceux qui sont nés en Europe de parents issus du continent africain. Sans concession Sur la scène du Théâtre national de Strasbourg, il y a trois Afropéennes, Océane Caïraty, Mélody Pini et Ysanis Padonou, sorties de l’école du théâtre en 2019, et un comédien plus âgé, Gaël Baron, issu du Conservatoire, à Paris. Ils incarnent avec justesse Ce qu’il faut dire, dans une représentation courte, enlevée, mais dense. Si Léonora Miano écrit d’une manière souveraine, poétique et cadencée, elle est sans concession dans le propos de ses trois chants, qui dessinent une courbe. Il faut tendre l’oreille pour entendre le premier, murmuré. Une voix noire s’adresse à un interlocuteur blanc invisible. Elle lui demande pourquoi il a peur, pourquoi il voudrait parler de la couleur de la peau, alors que la question n’est pas la couleur, mais la peau. Elle, la voix noire, n’a que faire de la culpabilité blanche qui ne concerne que les Blancs. Le ton monte, rythmé par les percussions de Lucie Delmas, quand une autre voix dépèce les mécanismes de la colonisation et de l’esclavage – un mot écarté par Léonora Miano, au profit de « déportation transatlantique » –, au regard du leurre de l’assimilation. La peur est des deux côtés, insidieuse, et le rêve qui clôt le spectacle l’enserre dans les mots doux et tranchés de l’espoir, au conditionnel, qui mènerait sur « la route de la fraternité ». Ce mot est le dernier de Ce qu’il faut dire, un texte et une représentation qui offrent une réflexion bienvenue : citoyenne. Ce qu’il faut dire, de Léonora Miano, mise en scène de Stanislas Nordey. Théâtre national de Strasbourg. Jusqu’au 20 novembre. De 6 € à 28 €. Durée : 1 h 30. En tournée en 2022 à Grenoble, Clermont-Ferrand, Bobigny. Brigitte Salino (Strasbourg, envoyée spéciale) Légende photo : « Ce qu’il faut dire », de Léonora Miano, mis en scène par Stanislas Nordey, au Théâtre national de Strasbourg, en novembre 2021. JEAN-LOUIS FERNANDEZ
Par Fabienne Darge (Strasbourg, envoyée spéciale) dans Le Monde 2 juin 2021 La reine Monime (Jutta Johanna Weiss) et Xipharès (Thomas Jolly) dans « Mithridate », de Racine, mis en scène par Eric Vigner au TNS, à Strasbourg, en novembre 2020. JEAN-LOUIS FERNANDEZ Mise en scène de manière stylisée par Eric Vigner, la tragédie crépusculaire de Racine est présentée pour la réouverture du TNS, à Strasbourg.
Du théâtre. La voix nue des acteurs, leur présence, un grand texte, une respiration commune entre la scène et le public. Le calme d’un rituel consenti, hors l’agitation du monde. Quelle joie de les retrouver, lundi 31 mai, lors de la réouverture du Théâtre national de Strasbourg (TNS), après les longs mois d’arrêt dus au Covid-19, avec la première représentation de Mithridate, de Racine, mis en scène par Eric Vigner. Une réouverture qui a eu lieu sans encombre : le collectif qui occupait le théâtre depuis trois mois, composé d’étudiants de l’école du TNS, a lu un texte dénonçant l’« iniquité » de la réforme de l’assurance-chômage, et s’est réjoui de « laisser la place au spectacle ». Ces retrouvailles avec le théâtre sont ici d’autant plus saisissantes que Mithridate est un spectacle qui, dans cette année particulière, a été vu d’abord dans sa version filmée, réalisée par Stéphane Pinot et diffusée sur France 5 en mars. Les qualités de la mise en scène d’Eric Vigner et de l’interprétation étaient déjà patentes à la vision de cette captation réalisée avec les moyens technologiques les plus pointus, mais elles se déploient d’autant mieux dans l’espace et le présent du théâtre. Lire aussi : « Mithridate », sur France 5, une captation de plateau inventive et innovante Pour être moins connue que Phèdre ou Bérénice, Mithridate n’en est pas moins une tragédie tout aussi belle. Ecrite en 1672, juste après Bajazet, dans la période orientale de Racine, donc, il se dit d’ailleurs qu’elle était la préférée de Louis XIV. Le conflit tragique s’y noue avec autant de pureté, d’humanité et de grandeur que dans les autres chefs-d’œuvre du maître, et la pièce offre un rôle féminin magnifique, et une vision magistrale des liens entre passions privées et passions politiques. Racine s’inspire pour l’écrire de la vie de Mithridate VI, qui régna jusqu’en 63 av. J.-C. sur le royaume du Pont – l’actuelle Turquie, la Crimée et de nombreuses régions au bord de la mer Noire –, et reste célèbre pour avoir résisté à l’expansionnisme romain, mais aussi pour avoir accoutumé son corps à s’immuniser contre les poisons : c’est la fameuse mithridatisation. Le dramaturge situe l’action au dernier jour de sa vie : alors qu’il est déclaré mort, Mithridate revient en son palais pour voir ses deux fils, Xipharès et Pharnace, se déchirer pour la conquête du royaume et celle de la reine, la belle Monime. Un superbe écrin nocturne Amour, trahison, rivalité entre les fils et le père, jalousie fratricide, soumission des femmes, utilisées comme monnaie d’échange entre royaumes. Mithridate est une tragédie crépusculaire, qui voit un homme tout perdre sauf son âme, et assister impuissant à l’effondrement de son monde, de sa culture et de sa civilisation. Eric Vigner l’inscrit dans un superbe écrin nocturne, dans lequel brillent l’éclat d’un feu, la moirure du satin rouge des costumes de Mithridate et de Monime, et plus encore la somptuosité d’un rideau de perles scintillantes, qui évoque à la fois la couronne royale et les larmes versées. Les correspondances ne sont jamais appuyées, dans cette mise en scène stylisée et discrètement japonisante, qui fuit autant le réalisme qu’un formalisme trop empesé. Les corps s’effleurent, les passions sont brûlantes mais sublimées par les alexandrins raciniens, des alexandrins que les comédiens et comédiennes, magnifiques, font ruisseler comme des rivières de diamants. La mise en scène ciselée met en valeur une distribution de haut vol, où chacun et chacune brille à sa façon C’est elle, d’abord, la langue de Racine, que l’on redécouvre avec un plaisir fou. Etre baigné dans cette langue, à l’heure du langage dégradé des réseaux sociaux et de la technocratie, c’est un véritable bain de jouvence. Il permet d’apprécier à sa juste valeur la manière dont Eric Vigner décline le thème du poison dans Mithridate, qu’il voit comme une tragédie des corps empoisonnés et des âmes souffrantes. A chacun de tisser ses propres liens avec notre aujourd’hui. Cette mise en scène ciselée met en valeur une distribution de haut vol, où chacun et chacune brille à sa façon. Thomas Jolly est un Xipharès pétri d’émotions, à fleur de peau, déchiré entre sa fidélité filiale et son amour pour Monime. Stanislas Nordey sculpte chaque mot avec une précision et une clarté remarquables, pour figurer un Mithridate hanté par la fin d’un monde et par la jalousie, mais qui fera in fine le choix de la générosité et de la transmission. Mais c’est surtout Jutta Johanna Weiss qui étonne ici. Cette actrice d’origine autrichienne, qui s’est formée à New York et auprès de metteurs en scène venus d’Europe de l’Est, développe depuis quelques années un jeu singulier. Elle joue Monime à la manière des onnagatas japonais, ces acteurs de kabuki ou de nô qui incarnent des femmes, et travaillent sur l’expression corporelle de la féminité. Ce double décalage n’est pas seulement passionnant : il donne lieu à des moments d’une beauté et d’une douceur rares. Vidéo de présentation de Mithridate par Eric Vigner Mithridate, de Jean Racine. Mise en scène : Eric Vigner. Théâtre national de Strasbourg (TNS), 1, avenue de la Marseillaise, Strasbourg. Tél. : 03-88-24-88-00. Les 2, 4, 7 et 8 juin à 18 heures. Puis à la Comédie de Reims, du 22 au 25 juin, et en tournée sur la saison 2021-2022. Fabienne Darge (Strasbourg, envoyée spéciale)
Propos recueillis par Stéphane Capron dans Sceneweb 6 mai 2020 “Année blanche” pour les intermittents, fonds d’indemnisation pour les tournages annulés et exonération de cotisations pour les auteurs : Emmanuel Macron a annoncé mercredi une série de mesures de soutien à un secteur de la culture touché de plein fouet par la crise économique liée au coronavirus, appelant les artistes à être “inventifs” dans cette période d’incertitude. Des annonces faites après une réunion avec douze artistes dont la comédienne Norah Krief, la chorégraphe Mathilde Monnier et le metteur en scène Stanislas Nordey. Vous êtes l’un des artistes ayant participé à cette visio-conférence avec Emmanuel Macron, le Président de la République. Est ce que ce rendez-vous a répondu à vos attentes ? Nous les signataires de la tribune du Monde, ce que l’on attendait c’était avant toute chose de rassurer les artistes, de leur donner une perspective et que l’état anxiogène dans lequel ils se trouvent en ce moment puisse se dissiper un tout petit peu. La réponse d’Emmanuel Macron est satisfaisante. On a obtenu ce que l’on a demandé avec d’autres, avec les signataires des deux pétitions, et sans conditions. La présence de Bruno Le Maire et de Muriel Pénicaud a accentué le fait que la réponse avait été prise au sérieux à tous les niveaux de l’Etat. Est-ce qu’il a fallu le convaincre ? Quand nous sommes arrivés, ils étaient convaincus. Ce matin on a essayé d’ouvrir des perspectives pour l’après, de faire des propositions. On nous avait demandé de plancher sur un état des lieux dans chacun de nos secteurs et d’apporter des solutions. Mis à part les mesures d’urgence qui ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron n’a pas dégagé de fonds supplémentaires pour le spectacle vivant, est-ce que vous le regrettez ? Je dois avouer que je n’attendais pas plus que cette année blanche. Il reste du chemin à faire. Il y a quelques annonces intéressantes sur les commandes faites à de jeunes artistes. Sur le spectacle vivant, cela reste encore à construire. Je ne sors pas de cette réunion comme si elle n’avait servi à rien, car il y a eu des engagements de crédits sur l’enseignement artistique et culturel. On avance petit à petit. Je n’attendais pas le New Deal ! J’espérais surtout que l’on puisse rassurer les intermittents. C’est fait. On a demandé un nouveau rendez-vous dans deux mois pour voir comment nos propositions ont été prises en compte. Il a beaucoup insisté sur la réinvention des formes de créations. Y avez-vous déjà réfléchi pendant ces deux mois de confinement ? J’échange quasiment tous les jours avec Wajdi Mouawad, Thomas Jolly, Arnaud Meunier, et beaucoup d’autres de mes consœurs et confrères. On cherche des solutions pour voir comment on peut inventer cette saison “hors norme” comme l’a nommée Emmanuel Macron. On a des pistes de travail. On a insisté pour avoir une visibilité car pour le moment il est impossible de construire quelque chose d’innovant pour les mois à venir. On a insisté pour retourner dans nos lieux le plus vite possible. Répéter pour le spectacle vivant. Tourner pour le cinéma et la télévision. On a demandé l’accélération d’un calendrier de retour des publics à partir de septembre. Que l’on sache à partir de quand nous serons en mesure d’accueillir 100 personnes dès septembre, puis 300 en novembre, puis 500 en janvier. Si on avait un échéancier comme c’est le cas pour l’école – même si il est perfectible – cela nous permettrait de construire des choses dynamiques et innovantes. Emmanuel Macron a évoqué une réouverture de certains lieux dès le 11 mai, pour permettre aux artistes de poursuivre leurs répétitions. Est ce que cela va être votre cas au Théâtre National de Strasbourg ? Le TNS va rouvrir ses portes au personnel à partir de mercredi. D’ici-là avec le directeur technique, avec la sécurité et la maintenance, on visite le lieu pour baliser, regarder les sens de circulation. On va cependant favoriser au maximum le télétravail. Et à partir du 2 juin, je vais recommencer les répétitions de Berlin mon garçon, le pièce de Marie NDiaye qui aurait dû se jouer en ce moment. Pour cela avec les délégués du personnel et avec les équipes techniques, on a travaillé à des protocoles de répétition pour que l’on puisse accueillir les artistes et les techniciens en toute sécurité et recommencer à fabriquer. Quand il encourage les artistes à profiter de cette période pour renouveler les publics, pour aller chercher les gens qui ne viennent jamais au théâtre, pour donner du temps à l’école, on a eu le sentiment qu’il découvrait ce que vous les artistes vous faites au quotidien ? C’est ce qu’on lui a dit. Tout ce que vous proposez on le fait déjà ! Nous sommes déjà très inventifs. Parfois il nous manque des moyens pour faire plus. Son souci est légitime, de faire que cet été, les jeunes qui ne partent pas en vacances puissent avoir accès à des activités culturelles. Mais ce n’est pas faisable à moyen constant. Par exemple les pertes financières au TNS s’élèvent à 500 000 € avec les surcoûts liés à la crise. Nous pouvons faire ce que nous faisons d’habitude – et en faire plus – que si nous sommes accompagnés. J’espère que l’on a été entendu. Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr Légende photo : Stanislas Nordey © Jean-Louis Fernandez
Par Brigitte Salino (Strasbourg, envoyée spéciale) dans Le Monde - 26.03.2018
A la MC93 de Bobigny, le metteur en scène russe adapte de façon magistrale une nouvelle d’Anton Tchekhov.
Anatoli Vassiliev aime les nouvelles d’Anton Tchekhov, parce que, dit-il, « il y a une violence qu’on ne trouve pas dans ses pièces. » On ne s’étonnera donc pas que le maître russe du théâtre ait choisi, plutôt que Platonov, par exemple, de mettre en scène l’inouï Récit d’un homme inconnu, que l’on peut voir à la MC93 de Bobigny, après sa création au Théâtre national de Strasbourg.
Ce texte est écrit à la première personne par Stepan, valet au service d’Orlov, fonctionnaire de Saint-Pétersbourg dans les années 1880. Stepan n’est pas son vrai prénom, ni valet son vrai métier. Ancien officier de marine converti à la révolution, il s’est introduit chez Orlov pour tuer son père, qui occupe un poste au sommet de l’Etat. Ce point de départ rappelle Les Justes (1949), la pièce d’Albert Camus sur les révolutionnaires russes face à la question du terrorisme. Mais Tchekhov n’est pas Camus : il ne va pas sur le terrain des idées, il scrute l’âme d’un homme inconnu à lui-même, qui se révèle à travers l’histoire d’un trio, Stepan, Orlov, et la maîtresse de celui-ci, Zinaïda.
Dans la nouvelle, on apprend tardivement le projet d’assassinat politique de Stepan, que l’on voit observer son maître, un homme cynique et jouisseur, que Zinaïda, en femme passionnée et naïve, prend pour un être d’exception. Quand elle s’installe chez lui, après avoir quitté son mari, elle mesure peu à peu son erreur. Stepan les observe, en silence. Il abhorre la veulerie ironique d’Orlov, et compatit à la souffrance de Zinaïda, qu’il accompagne quand elle quitte son amant, enceinte.
Les sous-sols de la vie
Anatoli Vassiliev suit leur chemin, qui ramènera Stepan à Saint-Pétersbourg, seul avec la petite fille de Zinaïda, morte, sans doute suicidée. Ce qui est inouï, dans sa mise en scène, c’est la clarté qu’il donne aux sous-sols de la vie décrits par Tchekhov. Il fallait trouver la pièce dans la nouvelle. Anatoli Vassiliev a su le faire : le théâtre-récit qu’il propose est un cadeau de l’esprit pour le spectateur, invité à prospecter l’âme de chacun des personnages comme il le ferait, seul, à la lecture de la nouvelle. Il y a des moments de silence de la même nature que ceux pendant lesquels on lève les yeux d’un livre, et souvent ces moments sont accompagnés de la musique du Mépris, le film de Jean-Luc Godard, qui pourrait être une toile de fond imaginaire de la mise en scène.
Cette musique obsédante accompagne le clapotis de la lagune à Venise où Stepan et Zinaïda commencent leur voyage, les mouvements de la pensée et le chahut des sentiments qui travaillent les personnages, l’appel impérieux qui les pousse à danser sur le triste volcan de leur vie – ce qu’ils font, et alors le théâtre atteint à la beauté de l’instant.
Cela advient parce que Vassiliev a su choisir les comédiens de son Récit d’un homme inconnu. Deux ont déjà travaillé avec lui : Stanislas Nordey (Stepan), et Valérie Dréville, liée par un long compagnonnage au metteur en scène, dont elle rend compte dans un livre passionnant (Face à Médée, Actes Sud, 144 p., 19,90 euros) consacré à son travail sur Médée-Matériau, de Heiner Müller.
L’ACTEUR DEVIENT LE VIATIQUE D’UN THÉÂTRE QUI N’EXPLIQUE PAS, MAIS MONTRE UN PROCESSUS EN MARCHE, TOUT SIMPLEMENT
Sava Lolov, le troisième acteur, entre avec une telle aisance dans le trio et le rôle d’Orlov qu’il semble connaître Anatoli Vassiliev de tout temps. Tous jouent d’une manière en rupture avec ce que l’on voit d’ordinaire sur les scènes : ils projettent les mots comme si c’étaient des objets, et ces mots acquièrent une telle matérialité qu’on croit les voir, tels des cailloux lancés dans l’espace. Ainsi, l’acteur devient le viatique d’un théâtre qui n’explique pas, mais montre un processus en marche, tout simplement.
Il y a dans le décor du spectacle un parasol bleu, qui s’ouvre quand Stepan et Zinaïda quittent le froid russe pour la douceur du sud de l’Europe. Sur le parasol, il est écrit : Paradisio. « Saisissez les restes de votre vie avec ténacité, ou essayez de les sauver », dit Stepan à Zinaïda. Elle essaiera, ne pourra pas. Et on la verra crever d’un coup de couteau son ventre dont sortira une chair rouge qu’elle laissera dans une bassine. Avant, à Saint-Pétersbourg, Stepan aussi avait crevé un sac en plastique qui avait fini par prendre l’aspect d’un corps d’homme, après qu’il l’eut rempli d’objets. C’était le fantôme du père d’Orlov, qu’il aurait pu tuer, un jour où l’occasion s’était présentée. Le révolutionnaire repenti ne l’avait pas fait, parce qu’il avait compris qu’il voulait « vivre, vivre et rien d’autre ».
Le Récit d’un homme inconnu, de Tchekhov. Adaptation, mise en scène et décor : Anatoli Vassiliev. MC93, 9, boulevard Lénine, Bobigny (Seine-Saint-Denis). Tél. : 01-40-60-72-72. De 9 € à 25 €. Durée : 4 heures. Jusqu’au 8 avril. Au TNB à Rennes, du 13 au 21 avril.
Par Laurent Carpentier dans Le Monde
A Colmar, les enfants de la décentralisation dans le doute
Il y a 70 ans était créé, en Alsace, le premier de ces centres dramatiques nationaux, qui, aujourd’hui, s’inquiètent d’être les dindons du nouveau paysage théâtral.
C’est ici que tout commence. Colmar, au lendemain de la guerre. Dans la nécessité, après le nazisme, de reconstruire l’unité de la République, dans la volonté d’arrimer à la France cette Alsace que l’Allemagne nous a contestée. La culture, missile balistique des temps de paix. Strasbourg détruit, Mulhouse détruit, le théâtre de Colmar est le seul qui, à la Libération, est encore debout. C’est donc là que Jeanne Laurent, sous-directrice des spectacles à la direction générale des arts et lettres du ministère de l’éducation (la culture n’a pas encore droit à son propre maroquin), décide, depuis Paris, le 11 janvier 1947, de créer le tout premier centre dramatique national.
C’est ici que tout reprend. Pour défendre aujourd’hui, et célébrer, soixante-dix ans après, ces trois lettres emblématiques : CDN. Pendant trois jours, du 28 au 30 septembre, Guy Pierre Couleau, le directeur de la Comédie de l’Est, a réuni ses homologues de la région Grand-Est ainsi que le Théâtre national de Strasbourg pour un festival de « petites formes » théâtrales, histoire de rappeler à un ministère jugé oublieux que les 38 CDN de France restent les outils centraux d’un système que l’Europe nous envie.
On appelle cela « la décentralisation théâtrale ». « Un formidable mouvement, un maillage incroyable, qu’on a intérêt à soigner, s’enthousiasme le souriant maître des lieux. Et j’y inclus les théâtres nationaux – comme l’Odéon, Chaillot… – et les 77 scènes nationales. » Celles-ci, créées par Jack Lang, sont chargées de diffuser les œuvres quand les CDN ont une mission de création. Elles sont dirigées par des administrateurs, quand ce sont les artistes qui sont à la tête des seconds. Or, depuis cet été, la colère agite ces derniers. Réunis en conclave à Avignon, le 14 juillet, ils ont été « interloqués », pour reprendre le terme de Jean Boillot, le patron du Nest, à Thionville, par les propos de la représentante du ministère – en l’occurrence Régine Hatchondo, directrice générale de la création artistique –, sur les interactions possibles entre théâtres public et privé.
« Recherche-développement »
« J’en ai marre de nous entendre comparés à des charges notariales ou de nous voir traités d’“élitistes”, déclare Jean Boillot, agacé, qui, comme Régine Hatchondo, a fait le voyage de Colmar. Nous avons réalisé une étude sur notre territoire, le bassin mosellan. Ce mot-là ne venait plus jamais dans la bouche des gens interrogés. Le point positif de la rencontre d’Avignon, c’est qu’elle a cristallisé des énergies jusque-là éparses. La ministre [de la culture, Françoise Nyssen] s’est émue du clash, et je crois qu’il y a une volonté de reconstruire un dialogue, mais on attend toujours un vrai signe. On a besoin qu’elle parle, qu’elle annonce clairement ce qu’elle pense. »
Réponse de la Rue de Valois : le 9 octobre, Sophie Zeller, une ancienne de la Mairie de Paris, sera nommée à la direction du théâtre, dont le poste est vacant depuis des mois ; le 16, Mme Nyssen sera à l’inauguration officielle des nouveaux locaux de la Comédie de Saint-Etienne, créée en 1947 ; et le 18, elle recevra tout le monde au ministère.
Lire la tribune : « Nos théâtres publics doivent être le reflet de la belle diversité » de notre société
« Chaque CDN est une histoire singulière. On invente des prototypes. Pour moi, nous sommes les services recherche-développement du ministère de la culture. Or tout cela est fragilisé aujourd’hui », constate Renaud Herbin, le directeur du TJP de Strasbourg, dont il a gardé l’acronyme mais chassé l’intitulé « jeune public », trop réducteur pour ce champion de l’hybridation, dont la philosophie tient en trois mots, « Corps Objet Image », le nom de la revue théorique qu’il a fondée.
« L’expérience de l’art nous modifie, nous déplace. Là-dedans il y a une forme de gratuité qui est un fondamental, c’est du service public, explique-t-il. L’enjeu, c’est la République, mais la question centrale est celle du partage de l’outil de travail. Dans ces laboratoires où l’on peut fabriquer le monde, tout tient à la façon d’exercer le pouvoir. Je peux à la fois être artiste, directeur, accompagnateur, éditeur, programmateur, uniquement parce que, derrière moi, il y a une équipe. »
Privilégier l’urgence économique à la création
« Ce qui est compliqué, c’est d’être sans cesse renvoyé à l’ancien modèle, regrette Ludovic Lagarde, venu de Reims avec sa garde rapprochée – le comédien Laurent Poitrenaux et l’auteur Olivier Cadiot. Alors qu’il y a plein de choses qui changent. Cette génération n’est pas dogmatique, elle est en mouvement. Le théâtre est un art contingent – le temps, l’argent, les politiques publiques… –, où l’on doit inventer en permanence, ruser, comme disait Brecht. »
Effectivement, c’est par un étrange paradoxe, lorsque la décentralisation théâtrale rencontre la décentralisation des pouvoirs, que d’un seul coup les choses se compliquent. Car si aujourd’hui le ministère peut afficher fièrement un budget maintenu, il n’en est pas de même des collectivités locales. Submergées par les postes comptables à fournir, elles risquent bien souvent de privilégier l’urgence économique à la création. « C’est ce qui est en train de se jouer aujourd’hui, craint Michel Didym, dont le CDN de Lorraine qu’il dirige à Nancy a investi, comme à Colmar, une ancienne manufacture de tabacs. Si j’étais ministre, j’imposerais aux régions d’inscrire la culture dans leur cahier des charges. »
La question qui fâche
Fils de cheminot, « enfant du Festival mondial du théâtre » monté par Jack Lang en 1963, Michel Didym a quitté Nancy à 20 ans pour l’école du TNS, y est revenu trente ans plus tard avec une carrière internationale accrochée au veston. « Je suis un pur produit de la décentralisation, et mon bonheur est dans la décentralisation », clame-t-il en descendant de scène, où il a lu La Nuit juste avant les forêts, de Bernard-Marie Koltès. « L’ancien directeur de la création artistique, Michel Orier, voulait nous transformer en “établissements publics de coopération culturelle”, où tout est soumis à appel d’offres, à autorisation. Du délire. Au nom d’une soi-disant transparence, on perdait toute souplesse… »
N’y a-t-il donc rien à redire au système actuel ? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ? Ils sourient, ils rallument une clope, ils toussent… « Soixante-dix ans, c’est un peu la carte senior. Si on ne fait que perpétuer ce qui existe, les choses meurent, constate Stanislas Nordey, trois CDN au compteur. Quand on est arrivé à Saint-Denis, on sentait ce risque de sclérose. Les lieux ont besoin de se métamorphoser sans cesse. »
Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg : « Soixante-dix ans, c’est un peu la carte senior. Si on ne fait que perpétuer ce qui existe, les choses meurent »
Stanislas Nordey a aujourd’hui 51 ans, il en avait 27 lorsqu’il a pris les commandes du Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis. Places gratuites pour les pauvres, démocratie à tout-va… L’aventure a fini dans le mur. « Parce qu’on était gourmand, qu’on était jeune, on a fait des conneries », reconnaît-il. Un quart de siècle plus tard, et le passage par Les Amandiers de Nanterre et le Théâtre national de Bretagne à Rennes, il est aujourd’hui à Strasbourg, à la tête du TNS, seul théâtre national hors de Paris, un budget de quelque 11 millions d’euros, 98 permanents, cinq fois plus qu’un CDN moyen.
Lui pose la question qui fâche : « Faut-il vraiment avoir un artiste à la tête d’un lieu ? N’y a-t-il pas d’autres modèles possibles ? Avec Jean-François Sivadier, Eric Lacascade et Wajdi Mouawad, on était allé voir Aurélie Filippetti pour lui proposer une direction à quatre, mais ça, le ministère, il n’aime pas, il veut un seul responsable, raconte-t-il. Ce qui manque aujourd’hui c’est une projection à vingt ans. Lang a toujours dit qu’il n’aurait rien pu faire sans Mitterrand, idem pour Malraux avec de Gaulle. Mais Sarkozy, Hollande, Macron… La culture n’arrive pas en tête dans leurs priorités. »
« Pansement social »
Lieux de création qui ont tendance à être perçus aujourd’hui comme des outils d’action culturelle, les CDN s’interrogent sur leur avenir. « Nous ne sommes pas un pansement social auquel on a simplement recours pour faire ce dont les politiques ont été incapables », s’insurge, comme les autres, Michel Didym.Jeanne Laurent (cette fonctionnaire avisée qui nomma André Clavé à Colmar, Jean Dasté à Saint-Etienne, Jean Vilar au TNP) remarquait déjà, à la fin de ses jours, qu’après 1968 les administratifs et les techniciens avaient pris le pouvoir dans les théâtres publics.
« Face au risque de sclérose, il ne s’agit pas de mettre tout par terre, mais de s’interroger sur l’efficience de cette pyramide », explique Vincent Goethals, l’ancien directeur du Théâtre du peuple de Bussang, prototype avant l’heure de la décentralisation théâtrale, venu en voisin des Vosges. Tous en sont conscients qui, face au ministère, s’attellent depuis l’été à devenir collectivement force de proposition. Objectif : les 70 prochaines années. Attention, théâtres en chantier.
Malraux est de retour sur le devant de la scène
« La machine a créé le temps vide qui n’existait pas et que nous commençons à appeler le loisir… » C’est Malraux qui parle. Joué par la comédienne Isabelle Ronayette. La voix chevrotante et opiacée. Costume sobre et défait. « Le temps vide, c’est le monde moderne. Mais ce qu’on a appelé le loisir, c’est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu’il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. »
19 mars 1966. Discours donné pour l’inauguration de la Maison de la culture d’Amiens. « Bien entendu, il convient que les gens s’amusent… » Aux platines, il y a le musicien David Jisse, aux cheveux bouclés blanchis par le temps. Cela rage, rit, remue, car « le problème que notre civilisation nous pose n’est pas du tout celui de l’amusement, c’est que jusqu’alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions, et plus tard par l’espoir que la science remplacerait les grandes religions, alors qu’aujourd’hui il n’y a plus de signification de l’homme et il n’y a plus de signification du monde, et si le mot culture a un sens, il est ce qui répond au visage qu’a dans la glace un être humain quand il regarde ce qui est son visage de mort ».
Ma langue pèle, proposée à Colmar pour les 70 ans des Centres dramatiques nationaux, est signée Jean Boillot, directeur du Nest, à Thionville. Les mots rendus à leur puissance. « La culture, c’est ce qui répond à l’homme quand il se demande ce qu’il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut n’en parler qu’à d’autres moments : il y a aussi les entractes. »
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan
« Que celui qui le désire se regarde dans mes films comme dans un miroir, et il s’y verra. » Simon Delétang a placé cette phrase du cinéaste Andreï Tarkovski en exergue de son spectacle « Tarkovski, le corps du poète ». Et je m’y suis vu.
Scènde de "Tarkovski, le corps du poète" © Jean-Louis Fernandez
Un drap blanc aux plis impeccables couvre le corps d’Andréï Tarkovski allongé dans un lit, face à nous, au fond de la scène. Il est mort. Il dort. Il rêve. Il se lève. On peine à reconnaître l’acteur tant est frappante la ressemblance avec le poète-cinéaste. Il lui aura suffi de lisser ses cheveux habituellement embroussaillés et de se laisser pousser la moustache pour parachever son visage émacié et ainsi accomplir la troublante ressemblance. Cependant, la voix, la façon très particulière de frapper les mots en leur soufflant dessus et celle d’arpenter la scène à grands pas ou encore de jouer du piston avec les bras convoquent l’identité de l’acteur : Stanislas Nordey. Quelle impression doit éprouver un acteur allongé ainsi sur un lit de mort ?
Allongée à côté de Tarkovski
La scène est troublante, je suis troublé, je m’égare. Je me demande si, le lendemain, jour de la levée du corps, je vais retrouver ainsi ma mère : allongée dans un lit, recouverte d’un drap blanc, ne laissant apparaître d’elle que son visage, yeux clos, enfin apaisée. Aura-t-elle, elle aussi, une bougie sur le ventre ? Je voudrais chasser cette image, me concentrer sur le spectacle, mais non. Quand on entre dans une salle de théâtre, peut-on faire abstraction de sa vie ?
S’oublier ? C’est impossible et tant mieux.
Quelques jours plus tôt, un coup de téléphone m’a annoncé la mort de ma mère. Tout se passe comme si sa disparition – attendue et logique à un âge avancé –, lui redonnait vie : il y a longtemps que je ne l’avais sentie si présente autour de moi, en moi. Elle est là devant moi, étendue dans ce lit, sur une des scènes du Théâtre national de Strasbourg portant le nom d’un metteur en scène, Klaus Grüber, qui me fut cher. Elle est là, allongée à côté de Tarkovski, artiste venu d’un pays qui fut cher à ma mère et où elle ne s’est cependant jamais rendue, par crainte d’être déçue sans doute.
Tarkovski, le corps du poète, le spectacle du metteur en scène Simon Delétang avait commencé là-bas, en Russie alors Union soviétique, dans la beauté de la langue russe qui chante sans qu’on le lui demande. Mais c’est aussi une langue qui peut aussi avoir la sécheresse, la violence du knout. Dans le prologue ou introduction du spectacle, une femme (Pauline Panassenko) se tient assise derrière une table à l’avant-scène. Elle a l’allure d’un procureur. Les cheveux tirés, le regard froid, claquant ses phrases comme des coups de fouet, elle ressemble à ces glaciales présentatrices du journal de télévision sur ORT, la chêne nationale russe, inféodée au pouvoir encore plus que les autres. La femme martèle le texte : une fine analyse de l’œuvre de Tarkovski par Antoine de Baecque, admiratif mais nullement inconditionnel du cinéaste. Traduit en russe, le texte prend des allures de réquisitoire, de perverse oraison funèbre. Fin du prologue, lumière sur le lit du mort.
Intrusions extérieures
Tarkovski se lève donc et entre dans ses rêves, dans ses films, dans ses textes. « J’ai fait un rêve cette nuit. J’ai rêvé que j’étais mort. Mais je voyais, ou plutôt je sentais tout ce qui se passait autour de moi. », dit-il (un extrait de son Journal). Et puis il ressuscite et personne ne s’en étonne. Je me souviens que la nuit où ma mère est morte dans son sommeil, je me suis couché très tard sans pour autant réussir à trouver le sommeil. Sans le savoir, je l’ai veillée toute la nuit.
Sur scène, ce sont maintenant des spectateurs qui interpellent Tarkovski. En fait : des lettres de spectateurs, désarçonnés, mécontents ou emballés, bouleversés au sortir d’un de ses films, des lettres ou des propos que le cinéaste cite dans ses écrits. Cette intrusion de voix extérieures (spectateurs, journalistes, écrivains) ira grandissante au fil du spectacle. Des béquilles scéniques par trop grossières ; le spectacle, malgré lui, vire à une anecdotique chronique biographique.
Difficile de s’engouffrer sans filet dans la vie et l’œuvre de Tarkovski. Difficile d’être toujours à la hauteur de ce propos exprimé dans le spectacle par Tarkovski au point que l’on peut penser que son interprète (Nordey) le prend à son compte, tant sa conviction est parlante : « La grandeur de l’homme moderne est dans sa protestation. Gloire à ceux qui protestent en s’immolant devant la foule muette et stupide, gloire à ceux qui sortent sur la place publique avec des pancartes et des banderoles, affrontant l’inévitable répression. S’élever au-dessus de la simple aptitude à vivre : si l’humanité est capable de cela, c’est que tout n’est pas perdu et qu’il y a encore une chance. » J’aurais aimé partager ces mots avec ma mère, alors je le fais ici, en les lui offrant présentement, elle la Résistante, la compagne de cellule de Charlotte Delbo, la militante à gauche toute, qui ne lâchait rien.
Faut-il quand on écrit sur les spectacles des autres, laisser à la porte de la salle, le spectacle de sa propre vie ? En passant outre, ne risque-t-on pas de verser dans le voyeurisme, l’autofiction de mes deux ? Il y a des jours où l’on ne se pose pas la question. « Je dois avouer que, lorsque des critiques professionnels ont fait l’éloge de mes travaux, leurs opinions et leurs critères m’ont la plupart du temps déçu ou irrité. J’avais l’impression qu’au fond d’eux-mêmes ils étaient restés indifférents ou impuissants, et qu’ils remplaçaient leur spontanéité et leur perception directe par des clichés de cinéphiles », écrit Tarkovski dans Le Temps scellé.
Jamais oubliées, les premières images de son film Le Miroir me reviennent en boomerang dès que paraît l’actrice Hélène Alexandridis sur scène, forte de sa blondeur, de sa finesse, de sa détermination. Je revois l’actrice du film de profil, assise sur la barrière, fumant une cigarette. Le dernier des Récits de jeunesse de Tarkovski (écrits bien avant qu’il ne fasse des films et retrouvés après sa mort) évoque différentes photographies, dont plusieurs de sa mère. Il parle d’elle comme de Dieu, en majuscule. « La voilà encore. Avec Sa lourde chevelure claire, Elle est assise sur une barrière en bois. Un champ labouré apparaît derrière Elle. (…) Elle fume une cigarette. Elle est sur le point, là, maintenant, d’avaler une bouffée de tabac et Son visage n’exprime rien de plus et devient, de ce fait, réel et fantastique, comme le temps, comme un moment passé mais présent. » Cette incertitude et cette transfiguration du temps sont constitutifs de l’art de Tarkovski. Le spectacle entend s’en faire l’écho.
La femme assise sur une barrière
Dans Le Temps scellé, le cinéaste revient longuement sur cette scène. Il explique qu’il avait fait en sorte que l’actrice Margarita Terekhiva ne lise pas le scénario, si bien qu’elle ne pouvait pas savoir si le mari qu’elle attendait en fumant, assise sur la barrière, allait revenir au pas. « Ce qu’il nous fallait percevoir était l’aspect unique et singulier de cet instant précis, et non son lien avec le reste de sa vie », souligne-t-il. Ainsi doivent être les acteurs à l’heure de la représentation : sans passé, sans avenir, dans un extrême présent, dans la joie de l’être-là.
Cette scène de la femme assise sur une barrière revient vers la fin de Tarkovski, le corps du poète, racontée ou plutôt comme vue par deux acteurs, Pauline Panassenko et Thierry Gibault. Il en va de même pour l’excellent Jean-Yves Ruf qui, à son tour, voit une maison, une grange brûler comme cela arrive dans plusieurs films de Tarkovski, retour d’un autre souvenir d’enfance. La grange brûle, les corps aussi. Humaines ou végétales, toutes les cendres se ressemblent.
Simon Delétang dit avoir été bouleversé par les films et les écrits de Tarkovski. Il souhaite partager cette passion par le biais du théâtre. Son spectacle est comme une dette qu’il honore. Il déborde de reconnaissance. Ses propositions sont aussi multiples qu’inégales. Le metteur en scène a commandé à Julien Gaillard, un auteur qui lui est proche, Le Corps du poète, un texte que l’on entend dans la dernière partie. Un texte dont le style, le vocabulaire, le phrasé introduisent dans le corpus Tarkovski comme un corps étranger qui lui fait mal, tout comme l’agent des pompes funèbres, croyant bien faire le jour de la crémation de ma mère, allait parler d’elle en termes doucereux, insupportables.
Simon Delétang a cependant une idée folle et forte : poussant dans ses retranchements sa pertinente scénographie, il déploie sur toute la scène une vaste toile reproduisant un détail de La Madone del Parto, une fresque de Piero della Francesca que Tarkovski a sans doute vue quand il a décidé de ne pas revenir en URSS et de vivre en Italie où il allait réaliser ses deux derniers films. C’est un visage de femme, mais aussi d’enfant, mais encore de mère. C’est un visage d’une douceur absolue. Stanislas Nordey (Tarkovski) et Hélène Alexandridis (sa femme, sa mère) se tiennent par la main et regardent ce visage vers lequel ils marchent. De dos, ils s’éloignent de nous, se rapprochent du visage. Alors j’ai fermé les yeux.
Tarkovski, le corps du poète, Théâtre national de Strasbourg, salle Grüber, à 20h sf dimanche 24, jusqu’au 29 septembre.
Théâtre des Célestins, Lyon, du 11 au 15 octobre ;
La Manufacture, théâtre des Quartiers d’Ivry, du 2 au 6 mai 2018 ;
Comédie de Reims, le 11 mai 2018.
Légende photo : Scène de "Tarkovski, le corps du poète" © Jean-Louis Fernandez
Propos recueillis par Antoine Ponza pour ZUT Magazine
Simon Delétang © Pascal Bastien
Le metteur en scène Simon Delétang ouvre le tombeau d’une icône, Andreï Tarkovski, et exhibe Le Corps du poète pour en extraire la substantifique moelle. Rencontre.
Stanislas Nordey co-signait l’an dernier une pièce sur Fassbinder. Est-ce que le cinéma infuse le théâtre contemporain ?
Pas mal de metteurs en scène s’emparent du langage cinématographique, notamment celui de Rohmer. Tarkovski est pour moi tellement plus un poète, un peintre, quelqu’un qui a marqué l’histoire de l’art, que je mets plutôt en avant la place de l’artiste créateur avec son œuvre et son combat pour la réaliser. C’est pour ça qu’il n’y a aucune image de film ou de rapport à la vidéo dans le spectacle. Évidemment, les grands cinéastes inspirent les metteurs en scène. Je suis très sensible aux œuvres de David Lynch, David Cronenberg et Lars von Trier – une lignée avec Tarkovski que j’ai découverte au fur et à mesure –, à un cinéma d’auteur qui cherche à faire du film une œuvre d’art. Je fais souvent des montages de textes, alors forcément il y a quelque chose de cinématographique dans le travail d’écriture : comment on passe d’une scène à l’autre ? C’est quoi faire des fondus enchaînés au théâtre ? Est-ce qu’on peut faire des champs-contrechamps ? Mais je ne pense pas être influencé esthétiquement et n’ai pas le fantasme de faire moi-même des films. Parfois on a envie de dire à des camarades metteurs en scène, qui finissent par passer à la réalisation : « Vas-y, fais un film plutôt que de mettre des images partout et de ne plus savoir quoi faire avec les acteurs présents sur scène ! » Mais je trouve ça intéressant que ces deux expressions soient poreuses.
Vous mentionnez Lynch… Vos pièces précédentes étaient assez violentes, dans celle-là, comme dans les films de Tarkovski, vous êtes en quête de beauté. Cette beauté passe-t-elle par la violence ?
Il y a des textes qui m’ont fracassé et j’avais besoin de transmettre cet effroi au spectateur. Dans les films, je trouve qu’il n’y a rien de plus beau qu’un plan sur la nature ou sur un visage apaisé après une scène extrêmement dure. J’ai souvent cherché à contrebalancer la violence visuelle par une extrême douceur musicale, c’est à dire de chercher toujours ce contraste entre une musique magnifique d’Arvo Pärt et un meurtre l’instant d’après. Cette tension produit quelque chose pour le spectateur. Ce spectacle sur Tarkovski c’est un des plus intimes, une chose que pour l’instant je réservais à mon jardin secret. Une chose qui m’accompagne, mais que je ne traduisais pas dans mon travail de manière frontale. Je ne me suis pas totalement adouci, mais je pense que j’ai moins besoin d’aller secouer le spectateur. Je préfère interpeller son intelligence, son émotion, plutôt que d’aller chercher du côté du choc et de la provocation.
Entend-on Arvo Pärt dans Le Corps du poète ?
Absolument. Par rapport à l’écriture musicale, à la recherche du sacré et au goût du silence, il y a lien qui était pour moi assez évident. Arvo Pärt surgit parce que ses morceaux prennent l’âme et l’élèvent. J’ai vraiment fait attention à une identité musicale proche de l’univers de Tarkovski, tout en cherchant à ne pas uniquement utiliser les œuvres que lui a citées dans ses films.
Dans Le Temps scellé, Tarkovski affirme : « Un artiste ne peut exprimer l’idéal moral de son temps s’il ne touche pas à ses plaies les plus sanglantes (…) » Vous dites que votre spectacle réagit à l’air du temps : quel idéal tentez-vous d’exprimer ?
Le sien avant tout, dans une société de plus en plus matérialiste, en perte de repères éthiques, philosophiques ou moraux. Même spirituels, puisqu’il a ce rapport très présent à la foi. En tant qu’athée profond, je peux saisir sa manière de s’y raccrocher, en exil, pour donner un sens à son existence. J’y vois aussi simplement le fait de tout artiste qui a une foi créatrice.
L’air du temps artistique est saturé de nouvelles esthétiques : vidéo, chaos, défiance vis à vis du metteur en scène solitaire, recrudescence du collectif. On n’a eu de cesse, en répétition, de retravailler le texte [avec Julien Gaillard, l’auteur, ndlr] mais pour moi ce n’est pas de l’écriture au plateau. Il y a une tête parce qu’il y a un vrai travail de conception. J’ai l’exigence idéaliste de trouver la qualité partout. Il y a des analogies avec Tarkovski, sans avoir la prétention de m’y comparer. Tout ce qu’il a défendu lui dans son travail ou dans son Journal me touche, et je me dis qu’on est qu’à dix pour cent de son intransigeance, du sacrifice qu’il a pu s’imposer dans sa vie. Mais je ne suis pas pour la souffrance dans le travail. On peut trouver des choses dans la bienveillance, même si Tarkovski dit que si on est joyeux c’est qu’on ne comprend pas le monde. Je ne vais pas aussi loin, je suis capable d’apprécier la vie ! En tout cas, il y a une forme de retour à l’essentiel : poser des questions sur l’art. L’art, ce n’est pas la culture, c’est quelque chose de plus haut, mais qui ne doit pas être moins accessible. Là se trouve ma quête.
Comment cela se traduit quand on veut parler d’un auteur relativement complexe comme Tarkovski ?
C’est le pari du spectacle. Il y a pas mal de références tirées des films, mais les acteurs sont très vigilants avec moi. Le montage est fait de telle sorte qu’il y a des interviews de Tarkovski parlant de son travail, des scènes de film qu’il explique et problématise après. C’est un spectacle sur un artiste qui nous livre la quintessence de la pensée de son travail. Cela met la barre assez haut sur l’énonciation de cette pensée, mais en même temps elle est totalement audible, ce n’est pas quelqu’un qui s’exprime par métaphore. Le spectacle est spectaculaire. Ce n’est pas un Tarkovski dépressif à une table qui explique son cinéma à un journaliste, cela se passe dans un décor inspiré d’un de ses films et ça bouge ! Le spectacle est la mise au tombeau d’un artiste. Malgré tout, il est très vivant.
Simon Delétang © Pascal Bastien
Propos recueillis par Antoine Ponza
Tarkovski, le corps du poète, pièce de théâtre les 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 et 29 septembre à l’Espace Grüber au TNS, à Strasbourg
www.tns.fr
Ecoutez les entretiens autour de Tarkovski dans l'émission de France-Culture par Caroline Broué "La Grande Table" (27 mn)
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/tarkovski-dans-la-peau
De l'Enfance d'Ivan à Nostalghia en passant par Solaris, en à peine sept longs-métrages, Andreï Tarkovski a marqué l'histoire du cinéma du XXe. Ce cinéaste phare de la modernité européenne est à l'honneur cet été au Festival de la Rochelle et la Cinémathèque Française.
Andreï Tarkovski• Crédits : Marcello Mencarini
Né en 1932 dans la maison de campagne familiale, Andreï Tarkovski meurt en décembre 1986 en France atteint d'un cancer. Il a tenu un journal de 1970 à sa mort surnommé par lui-même "Le Martyrologe". Les affres de la création, le contexte politique en Russie qui muselle le cinéma y côtoient les réflexions sur son nouveau rôle de père ou bien encore les futurs projets de vie. Ce journal fait l'objet d'une troisième édition, publiée en février 2017, nourrit de textes inédits, réflexions et projets retrouvés par sa femme Larissa Tarkovskaïa.
Dès L’Enfance d’Ivan (Lion d’Or à Venise 1962), son premier film, le cinéaste pose les jalons d’une œuvre puissante et épurée et s’impose à l’international. Durée des plans-séquences, usage du ralenti, éclatement de la trame temporelle seront ainsi autant de recours aux possibilités plastiques du septième art pour mieux scruter l'épaisseur du temps.
Le Festival de la Rochelle, du 30 juin au 9 juillet, et la Cinémathèque Française, à partir du 28 juin lui consacrent une rétrospective. A noter également : la ressortie en salle le 5 juillet en versions restaurées de L'Enfance d'Ivan, Andreï Roublev, Solaris, Le Miroir et Stalker .
Pour en parler, La Grande Table reçoit Antoine de Baecque, historien et critique de cinéma, auteur d'une biographie sur Andreï Tarkovski publiée par Les Cahiers du Cinéma et Stanislas Nordey, qui se glisse dans la peau du cinéaste dans la pièce "Tarkovski, le corps d’un poète" mise en scène par Simon Delétang, visible au Théâtre de Lyon - Les Célestins à partir d'octobre 2017.
Stanislas Nordey : "Je retrouve chez Tarkovski une foi dans l'art."
Antoine de Baecque : "Tarkosvki a beaucoup appris d'Eisenstein et de cette poésie là."
Stanislas Nordey : "Je suis rentré dans l'esprit de Tarkovski par la poésie. Son père poète l'a beaucoup influencé."
Extrait de L'Enfance d'Ivan, d'Andreï Tarkovski (1962)
Extrait Andrei Tarkovski répond au micro de Yves Mourousi (TF1 Actualités 13H, 1978)
Extrait du Miroir, d'Andrei Tarkovski (1978)
Extrait d'Andrei Tarkovski fils interviewé dans l'émission "Création on air" (16/11/2016)
En seconde partie d'émission, retrouvez Marielle Macé et François Dubet pour questionner ce qui peut faire "nous" aujourd'hui...
Intervenants
Antoine de Baecque
Historien de la littérature, un critique de cinéma et de théâtre et un éditeur français
Stanislas Nordey
comédien et metteur en scène français
Par Stéphane Capron dans ScenewenClaudia Stavisky et Marc Lesage ont présenté ce matin la riche saison 2017/2018 du Théâtre des Célestins de Lyon. Elle débutera le 13 septembre par la création de Rabbit Hole Univers parallèles de David Lindsay-Abaire, Prix Pulitzer en 2007, qui dessine le portrait d’un couple qui tente de surmonter la mort accidentelle de leur fils. Le couple sera interprété par Julie Gayet et Patrick Catalifo. L’actrice est très rare au théâtre, la dernière fois qu’elle est montée sur scène c’était en 1996 au Théâtre Montparnasse pour Les Abîmés de Michaël Cohen. Claudia Stavisky reprendra un peu plus tard en novembre Tableau d’une exécution de Howard Barker pour quelques représentations avant une tournée.
Parmi les autres créations de la saison, Dans la peau du monstre d’après LilLI / Heiner (INTRAMUROS) de Lucie Depauw et intégral dans ma peau de Stéphanie Marchais. Un diptyque théâtral mis en scène par Cécile Auxire-Marmouget et Christian Taponard. Ainsi que Je n’ai pas encore commencé à vivre de Tatiana Frolova du théâtre knaM que l’on pourra voir dans le cadre du Festival Sens Interdit en octobre.
On attend avec beaucoup d’impatience Margot, d’après Massacre à paris de Christopher Marlowe par Laurent Brethome (en janvier 2018 – le spectacle sera créé le 9 novembre à la Scène nationale d’Albi). Il s’agit du regard critique et engagé d’un Anglais sur la France du XVIe siècle. Une pièce épique avec 16 comédiens sur scène. En mars on pourra voir Actrice de Pascal Rambert avec Marina Hands et Audrey Bonnet. Autre auteur contemporain présent dans la saison Rémi de Vos avec Botala Mindele dans une mise en scène par Frédéric Dussenne (création en septembre au Théâtre de Poche de Bruxelles). Le Théâtre des Célestins coproduit trois pièces avec le Théâtre National de Strasbourg: Tar kovski, le corps du poète (en octobre)
d’après les textes de Julien Gaillard, Antoine de Baecque et Andreï Tarkovski dans une mise en scène Simon Delétang avec Hélène Alexandridis, Thierry Gibault, Stanislas Nordey, Pauline Panassenko et Jean-Yves Ruf. Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce dans un mise en scène de Clément Hervieu-Léger avec Audrey Bonnet, Loïc Corbery de la Comédie Française, Vincent Dissez, Nada Strancar et Stanley Weber (en avril 2018). Ainsi que À la trace d’Alexandra Badea dans une mise en scène d’Anne Théron (en février 2018).
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
13 sept. → 8 oct. 2017
Rabbit Hole Univers parallèles
David Lindsay-Abaire / Claudia Stavisky
3 oct.→ 14 oct. 2017
Dans la peau du monstre
Lucie Depauw – Stéphanie Marchais /
Cécile Auxire-Marmouget – Christian Taponard
11 → 15 oct. 2017
Tarkovski, le corps du poète
Antoine de Baecque – Andreï Tarkovski – Julien Gaillard / Simon Delétang
16 → 18 oct. 2017
Ça va ?
Jean-Claude Grumberg / Daniel Benoin
Spectacles présentés dans le cadre de Sens Interdits
19 → 21 oct. 2017
Martyr
Marius von Mayenburg / Oskaras Koršunovas
19 → 22 oct. 2017
Je n’ai pas encore commencé à vivre
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM
23 → 24 oct. 2017
Body Revolution & Waiting
Mokhallad Rasem
24 → 25 oct. 2017
Bec-de-lièvre Vengeance ou pardon
Fabio Rubiano
27 → 28 oct. 2017
Nord-Est
Torsten Buchsteiner / Galina Pyanova / ARTiSHOCK theater
28 → 29 oct. 2017
La Mission, souvenir d’une révolution
Heiner Müller / Matthias Langhoff
10 → 12 nov. 2017
Tableau d’une exécution
Howard Barker / Claudia Stavisky
16 → 18 nov. 2017
Eva Perón & L’Homosexuel ou la Difficulté de s’exprimer
Copi / Marcial Di Fonzo Bo
21 → 25 nov. 2017
La vie que je t’ai donnée
Luigi Pirandello / Jean Liermier
28 nov. → 1er déc. 2017
L’Amour et les forêts
Éric Reinhardt / Laurent Bazin
5 → 9 déc. 2017
20 000 lieues sous les mers
Jules Verne / Christian Hecq – Valérie Lesort
14 → 31 déc. 2017
arturo brachetti Solo
15 → 22 déc. 2017
Ramona
Rezo Gabriadze
23 → 30 déc. 2017
Le diamant du Maréchal de Fantie
Rezo Gabriadze
9 → 13 jan. 2018
La Fuite !
Comédie en huit songes
Mikhaïl Boulgakov / Macha Makeïeff
11 → 21 jan. 2018
La Cuisine d’Elvis
Lee Hall / Pierre Maillet
17 → 24 jan. 2018
Margot
Christopher Marlowe / Laurent Brethome
26 jan. → 2 fév. 2018
Novecento
Alessandro Baricco / André Dussollier
6 → 10 fév. 2018
Petit éloge de la nuit
Ingrid Astier / Gérald Garutti
27 fév. → 10 mars 2018
Les Eaux et forêts
Marguerite Duras / Michel Didym
28 fév. → 3 mars 2018
À la trace
Alexandra Badea / Anne Théron
6 → 10 mars 2018
Actrice
Pascal Rambert
13 → 24 mars 2018
George Dandin ou le Mari confondu
Molière / Jean-Pierre Vincent
14 → 24 mars 2018
Loveless
Claude Jaget / Anne Buffet – Yann Dacosta
27 → 31 mars 2018
Tristesses
Anne-Cécile Vandalem
28 mars → 7 avr. 2018
Le Quat’sous
Annie Ernaux / Laurence Cordier
3 → 7 avr. 2018
Bluebird
Simon Stephens / Claire Devers
24 → 28 avr. 2018
Le Pays lointain
Jean-Luc Lagarce / Clément Hervieu-Léger
2 → 6 mai 2018
Professeur Bernhardi
Arthur Schnitzler / Thomas Ostermeier
15 → 22 mai 2018
Trintignant-Mille-Piazzolla
Jacques Prévert – Allain Leprest – Robert Desnos – Boris Vian… /
Jean-Louis Trintignant / Astor Piazzolla / Daniel Mille
16 → 26 mai 2018
Botala Mindele
Rémi De Vos / Frédéric Dussenne
12 → 16 juin 2018
Festen
Thomas Vinterberg – Mogens Rukov / Cyril Teste – Collectif MxM
LA SAISON 2017 / 2018
En chiffres
36 SPECTACLES
3 CRÉATIONS
10 COPRODUCTIONS
14 SPECTACLES INTERNATIONAUX
24 SPECTACLES grande salle
11 SPECTACLES célestine
5è édition de sens interdits festival international de théâtre
4è édition des utopistes , festival des arts du cirque
251 LEVERS DE RIDEAUX
153 REPRÉSENTATIONS GRANDE SALLE (SANS UTOPISTES)
95 REPRÉSENTATIONS CÉLESTINE
17 REPRÉSENTATIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL SENS INTERDITS
3 REPRÉSENTATIONS HORS LES MURS (SANS UTOPISTES)
Par Fabienne Darge dans Le Monde :
« Erich von Stroheim », la pièce du dramaturge écrite en 2005, est mise en scène par Stanislas Nordey, à Paris.
Christophe Pellet : le nom, sans doute, n’est pas connu du grand public. Bien moins, en tout cas, que celui d’Emmanuelle Béart. C’est pourtant grâce aux mots du premier que la seconde peut montrer qu’elle n’est pas uniquement la Manon des sources du cinéma français, mais aussi une excellente comédienne de théâtre.
Christophe Pellet est auteur de théâtre – une profession dont le statut est devenu bien étrange, à l’image de celui de nombre d’intellectuels. C’est lui qui signe Erich von Stroheim, la pièce, mise en scène par Stanislas Nordey, dans laquelle joue Emmanuelle Béart, aux côtés de deux autres acteurs formidables : Thomas Gonzalez et Laurent Sauvage (en alternance avec Victor de Oliveira). Le spectacle, un des plus forts de Stanislas Nordey, a été créé le 31 janvier au Théâtre national de Strasbourg. Il est présenté au Théâtre du Rond-Point, à Paris, jusqu’au 21 mai.
Lire la critique de la pièce : Entre « Elle », « l’Un » et « l’Autre », des désirs en désordre : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2017/02/02/entre-elle-l-un-et-l-autre-des-desirs-en-desordre_5073111_1654999.html
Voilà qui va mettre dans la lumière un auteur que les amateurs de théâtre connaissent, mais qui n’a pas la notoriété qu’il mérite. Christophe Pellet a 53 ans, il est l’auteur de dix-sept pièces, publiées aux éditions de L’Arche, traduites en allemand (beaucoup), en anglais, en italien, en portugais ou en arabe, et mises en scène par Jacques Lassalle ou Jean-Pierre Miquel. Il a aussi signé un essai très debordien, Pour une contemplation subversive (L’Arche, 2012), et un livre sur Le Théâtre de Tennessee Williams (aux éditions Ides et Calendes, 2015).
Il est cinéaste, auteur de six films, diffusés dans le réseau expérimental mais aussi à la Cinémathèque française à l’automne 2016. Théâtre et cinéma se mêlent chez lui de manière multiforme, comme se mêlent les présences réelles et virtuelles, les images et le corps bien concret des acteurs.
CHRISTOPHE PELLET, DRAMATURGE : « J’ÉTAIS FASCINÉ PAR LES ACTEURS, PAR LEURS VISAGES, NOTAMMENT DANS LES FILMS TIRÉS DES PIÈCES DE TENNESSEE WILLIAMS »
Lui-même est un éternel jeune homme long et mince, silhouette fragile, en général vêtue de noir. Et c’est le cinéma qui est venu à lui, « ciné-fils » de deux parents scientifiques et cinéphiles, dans son enfance dans les quartiers nord de Marseille. A 22 ans, quand il est « monté » à Paris, c’était pour faire la Fémis, l’école de cinéma, dont il a intégré la première promotion, aux côtés de Noémie Lvovsky, François Ozon ou Arnaud des Pallières. « J’avais toujours écrit : des sketchs, des scènes… J’étais fasciné par les acteurs, par leurs visages, notamment dans les films tirés des pièces de Tennessee Williams. J’ai toujours eu besoin que mes mots soient dits, joués, incarnés dans le corps des acteurs. Je n’ai jamais écrit de poèmes, de nouvelles ou de romans. Mais je n’ai pas pu entrer dans le système de production du cinéma. J’ai commencé à écrire des pièces parce que je me suis dit que si j’écrivais des scénarios, je ne pourrais pas les réaliser moi-même. J’ai commencé à refaire du cinéma quand sont apparues les petites caméras HD, grâce auxquelles vous pouvez avoir la maîtrise complète de votre production. »
Sismographe ultrasensible
Au début des années 2000, Christophe Pellet fait donc paraître ses premières pièces : Le Garçon girafe, En délicatesse, S’opposer à l’orage, Loin de Corpus Christi… Celles-ci sont de facture assez classique : « J’étais sous l’influence d’Ibsen, mais aussi du mélodrame cinématographique de Douglas Sirk, ainsi que de Fassbinder. » Mais d’emblée s’y trouvent tous les thèmes qu’il n’a cessé de tisser depuis, en une vaste cosmogonie : le sentiment et les rapports amoureux, le masculin et le féminin, l’androgynie, mais aussi le cinéma et l’image, dans ce qu’ils ont changé de fondamental dans nos vies.
Dans ces nouveaux fragments d’un discours amoureux, Christophe Pellet enregistre en sismographe ultrasensible les changements vertigineux que connaissent nos vies intimes, sous l’effet des bouleversements en cours. C’est bien le cas dans Erich von Stroheim, une pièce écrite en 2005 dans laquelle n’apparaît pas le génial cinéaste de Folies de femmes qui lui donne son titre. Mais où les rapports entre le réel et l’image courent derrière les relations entre les trois personnages, une femme et deux hommes simplement nommés Elle, L’Un et L’Autre.
LA FACTURE DE SES PIÈCES S’EST FAITE BEAUCOUP PLUS POÉTIQUE ET MODERNE, EN UN DRÔLE D’ALLER-RETOUR ENTRE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL
Et peu à peu, la forme étant du fond qui remonte à la surface, la facture de ses pièces a changé, s’est faite beaucoup plus poétique et moderne, en un drôle d’aller-retour entre matériel et immatériel, et entre les temporalités. Aphrodisia, très belle pièce écrite en 2016, dont il faut espérer qu’elle ne mettra pas des années à être portée à la scène, prend place dans un monde où les écrans ont disparu. Plus d’interface : les êtres, directement hyperconnectés, se livrent alors à de troublants jeux d’image et de séduction, à d’étranges métamorphoses, ils semblent vivre des identités multiples.
« Quand on parle jusqu’au bout du sentiment et des relations amoureuses, on en arrive au politique, constate Christophe Pellet. De même quand on parle des relations entre théâtre et cinéma. Pendant longtemps, on disait que c’était le septième art qui avait avalé l’art dramatique. Aujourd’hui, c’est plutôt l’inverse : le théâtre est redevenu vivant en vampirisant quelque chose de l’ordre de l’hypnose, du flux, venu notamment de la modernité cinématographique asiatique, et en le poussant jusqu’au bout », conclut-il. Chez Christophe Pellet, auteur qui a en lui quelque chose d’un Tennessee Williams des années 2.0, les mots sont des images, et inversement.
Emmanuelle Béart, la belle théâtreuse
Enfant chérie du cinéma français, Emmanuelle Béart est aussi une comédienne de théâtre. Elle a joué Marivaux, Molière, Musset ou Strindberg, sous la direction de Jacques Weber, Jean-Pierre Vincent ou Luc Bondy. En 2010, elle a entamé un compagnonnage avec le metteur en scène Stanislas Nordey, qu’elle connaissait, notamment parce qu’elle et lui ont milité dans les mêmes réseaux d’aide aux sans-papiers. Sous sa direction, elle a joué dans Les Justes, de Camus, Se trouver, de Pirandello, ou Par les villages, de Peter Handke. Aujourd’hui, elle a décidé de se consacrer au théâtre. Elle irradie de sa beauté blessée dans Erich von Stroheim, la pièce de Christophe Pellet, où elle, la généreuse, joue un rôle à contre-emploi de femme dure, cynique qui, après avoir fait carrière, veut un enfant et fera tout pour l’obtenir – au prix d’une forme d’instrumentalisation de l’homme qu’elle a choisi.
Erich von Stroheim, de Christophe Pellet. Mise en scène : Stanislas Nordey. Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin-Roosevelt, Paris 8e. Tél. : 01-44-95-98-21. Du mardi au samedi à 21 heures, dimanche à 15 heures, jusqu’au 21 mai. De 16 à 38 €. Durée : 1 h 35. www.theatredurondpoint.fr
Fabienne Darge
Journaliste au Monde
Photo (c) Jean-Louis Fernandez
Par Patrick Sourd dans Les Inrocks :
Epoustouflant dans le rôle de Baal, Stanislas Nordey capte tous les regards en se donnant corps et âme à la cavale du poète maudit. Et irradie de sa présence la première pièce de Bertolt Brecht.
On n’est pas sérieux quand on vient juste d’avoir 20 ans. A cet âge, Bertolt Brecht écrit sa première pièce qu’il dédie à la figure de Baal, un poète inspiré par les vies brûlées de Rimbaud, Verlaine et Villon.
Tout à son excitation, il imagine un titre lui permettant d’user d’un crescendo de points d’exclamation : Baal bouffe ! Baal danse !! Baal se transfigure !!! Une manière de frapper les trois coups pour annoncer son entrée dans le monde de la dramaturgie.
“Il est contemporain de qui montera la pièce”
L’auteur ne cessera par la suite de remettre sa pièce sur le métier, dès l’année suivante en 1919, puis en 1920 et 1926, pour finir par signer son ultime palimpseste de Baal en 1955, un an avant sa mort. C’est la seconde version de l’œuvre que monte Christine Letailleur. Dans la limpide traduction d’Eloi Recoing elle est très sobrement titrée Baal (1919).
Brecht dépeignait son héros comme un être intemporel en allant jusqu’à préciser : “Il est contemporain de qui montera la pièce.”
Christine Letailleur en fait un éternel témoin veillant sur la culture en Allemagne. Pour le costume de Baal, elle se réfère au look des années 1970, quand Volker Schlöndorff adaptait la pièce en téléfilm avec Rainer Werner Fassbinder dans le rôle-titre.
Il fallait un acteur hors pair pour incarner le poète
Dans une scénographie qu’elle cosigne avec Emmanuel Clolus, ses décors, sous des ciels mauves et bleu pétrole, se revendiquent des perspectives stylisées du cinéma expressionniste allemand. Il fallait un acteur hors pair pour incarner le poète, Stanislas Nordey endosse pour elle la défroque de Baal avec maestria.
Il s’agit de témoigner du parcours d’une vie se réclamant d’une radicalité insoluble dans le quotidien. Pour Brecht, “Baal est une nature ni particulièrement comique ni particulièrement tragique. Il a le sérieux de la bête”. Chaque étape de son existence devient une nouvelle pièce à charge qui construit sa légende.
Baal, un astre noir
Fauteur de troubles, buveur invétéré et méchant amant, rien ne sauve l’animal qui se transforme en un prédateur sexuel pour séduire les jeunes vierges tout autant que les femmes mariées. Même l’histoire d’amour qui le lie à Ekart (Vincent Dissez), son compagnon de débauche, se termine par un meurtre en coulisses.
Au travers d’une gestuelle qu’il sait rendre inséparable de son jeu, Stanislas Nordey fabrique le hors-norme d’un personnage qui commerce avec ses contemporains sans cesser d’affirmer son altérité. C’est le côté graphique de sa présence au plateau qui fascine. Elle focalise la lumière autant qu’elle l’absorbe pour honorer Baal à la manière d’un astre noir.
Baal (1919) de Bertolt Brecht, mise en scène Christine Letailleur, avec Stanislas Nordey, Vincent Dissez, Youssouf Abi-Ayad, Emma Liégeois, Karine Piveteau, Valentine Gérard, Manuel Garcie-Kilian, Clément Barthelet, Philippe Cherdel, Fanny Blondeau et Richard Sammut, du 20 avril au 20 mai, Théâtre national de la Colline, Paris XXe
Sommaire :
- Frédéric Vossier : Éditorial-Responsabilités, Variations
Ensemble éditorial
- Christophe Fiat : Miss Monde suivi de Cléopâtre. Give me some music !
- Mohamed El Khatib : Faut pas pleurer
- Joëlle Gayot : La phrase, la partouze
- David Léon : À corps perdu
- Claudine Galea : Faire l’expérience
- Jean-René Lemoine : Rite de passage
- Alexandra Badea et Anne Théron : Amour. Politique des larmes
- Éric Noël et Christophe Pellet : Amour. Membres fantômes
- Bérénice Hamidi-Kim : Pauline Peyrade, portrait(s) de femme(s). Politiques du désir
- Céline Champinot : La Bible. Vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable
- Bérénice Hamidi-Kim : Écrire ne s’apprend pas, mais écrire s’accompagne
Entretien avec Enzo Cormann et Samuel Gallet
- L’Arche éditeur – Focus : L’Éditeur absolu
- Marie-Amélie Robilliard : Incarner la mélancolie. Le Théâtre de Fabrice Melquiot
- Fabrice Melquiot : Portrait de Rudolf Rach en treize pièces détachées
- Rudolf Rach : Visite à Thomas Bernhard
- Jean-Louis Fernandez : Amor Mundi (Portfolio)
- Lancelot Hamelin : Rond-Point / Tabloïd. Un art français du théâtre. Chroniques
La revue est composée d'un Ensemble éditorial dont les membres sont :
Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Joëlle Gayot, Lancelot Hamelin, Bérénice Hamidi-Kim et David Lescot.
Parages, revue de création et de réflexion, s’est construit comme espace d’appartenance où l’on peut regarder, penser et écrire en toute liberté, et croiser autrui, à tout hasard, sans volonté idéologique.
Parages se veut être le surgissement de la pluralité, le règne improbable et titubant, mais tenace et solidaire, du «singulier pluriel». C’est donc un espace de singularités et de rôdeurs que le Théâtre National de Strasbourg, sous l’égide du locataire de la parole, Stanislas Nordey, accueille, le temps d’un numéro.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...