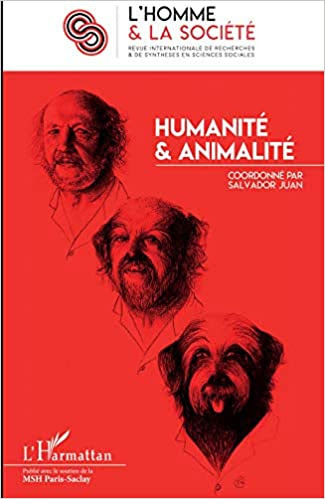"La question de l’animalité de l’Homme et des différences genre humain/animaux est traitée par la philosophie, quasiment depuis ses origines dans la Grèce antique. Mais l’avènement de l’anthropologie au xviiie siècle, puis de la sociologie au xixe, a introduit une rupture fondatrice d’un territoire académique propre à l’étude de l’humain. Cependant et dès le départ – comme en témoignent les controverses sur cette question entre Voltaire et Rousseau, puis les débats succédant à la réception du darwinisme social –, se sont exprimées avec force des perspectives souhaitant ancrer la connaissance des êtres humains et des faits sociaux dans la nature. Au xixe siècle, de nombreux travaux animalisent les humains et humanisent les animaux, aussi bien chez les libéraux insistant sur l’égoïsme et les luttes de concurrence dans la nature (Spencer, 1878), que chez les socialistes et les anarchistes, beaucoup plus sensibles à l’altruisme et à l’entraide naturels (Kropotkine, 1938) ; tant dans les sciences de la nature (Haeckel notamment) que dans les sciences humaines (par exemple Espinas, 1924). Au xxe siècle, avec l’autonomisation académique de la socio-anthropologie, s’esquisse un partage territorial entre ce qui deviendra le domaine des Sciences de la nature ou de la vie et celui des Sciences humaines et sociales (SHS). Mais les travaux de Konrad Lorenz – en particulier son fort discuté prix Nobel de médecine sur l’agression (Lorenz, 1968) – dans les années 1960, puis ceux de Edward Wilson (1975), consacrent la renaissance du naturalisme autour du concept de sociobiologie et remettent en cause cette frontière. Les mouvements actuels qui rapprochent animalité et humanité sont la résultante de cette tendance marquant le retour du naturalisme dans les SHS."
Salvador Juan
Dans L'Homme & la Société 2019/2 (n° 210), pages 25 à 39
"On assiste, depuis cinquante ans, à la conjonction d’une pensée philosophique centrée sur l’interspécisme et l’éthique de l’environnement, à des travaux en nombre croissant d’éthologues renouant avec la sociobiologie, à de nombreux textes de psychologues évolutionnistes et de paléontologues, mais aussi au travail militant de certaines fractions du mouvement de défense des animaux ainsi que du mouvement écologiste (sa fraction dite « profonde » ou deep ecology). Dans un contexte de multiplication des animaux de compagnie dénombrés en France à « trente millions d’amis » – selon le nom d’un fameux magazine –, se réanime un débat très ancien sur les relations entre humanité et animalité. De plus en plus d’auteurs mettent en cause aujourd’hui le clivage fondateur de l’humanisme et la hiérarchie des espèces, et considèrent que « l’être humain n’a pas plus de droits qu’une souris », ou encore que « l’animal est une personne ». En nombre croissant, des personnes donnent des noms humains à leurs animaux de compagnie, transgressant un vieil interdit tacite (qui tend à disparaître) et provoquant ainsi de moins en moins le malaise que Lévi-Strauss évoquait, en 1962, dans La Pensée sauvage, à propos de l’anthroponymie des animaux de compagnie (Lévi-Strauss, 1962). La prise en compte de la souffrance animale – considérée de nos jours comme de plus en plus légitime – déborde des arènes de corrida ou des enclos de combats de coqs, pour gagner les abattoirs, les exploitations de gavage des oies et les champs de courses, et atteint le bord des rivières où l’on pêche, les rues des villes, voire les foyers où des chiens agressent des êtres humains par milliers en France, selon l’Institut de veille sanitaire.
Alors qu’un sociologue français, Michel Fize, propose une candidature à l’élection présidentielle de 2017 en vue de défendre la cause animale confondue avec celle du vivant et avec le soutien de Brigitte Bardot, un philosophe médiatique et sociologue, Frédéric Lenoir, publie une Lettre ouverte aux animaux en comparant, tout comme le font de nombreux autres auteurs et militants de la cause animaliste, les abattoirs industriels à des camps d’extermination nazis (Lenoir, 2017 : 41). Tous les mangeurs de viande se conduiraient donc comme des nazis complices des crimes contre l’humanité... Aucun de ces auteurs ne relève néanmoins, outre la confusion entre l’entreprise nazie d’éradication pure et simple de catégories sociales humaines et l’usine servant à fabriquer des produits de consommation, le fait que les nazis aimaient beaucoup les animaux et proscrivaient de les traiter comme ils traitaient les humains stigmatisés. La prégnance du romantisme allemand à Auschwitz conduisait les nazis à faire des juifs, ainsi que des communistes ou des Tziganes, des cobayes avec force atrocités in vivo, alors que l’expérimentation sur l’animal était prohibée : « on infligeait à l’homme ce qui était interdit à l’égard de l’animal » (Marguenaud, 1992 : 386).
On assiste donc à un combat d’idées que divers auteurs définissent en termes d’opposition entre l’humanisme et l’animalisme, même si certains tentent de concilier les deux mouvements, non sans conflits comme en témoigne un ouvrage récent d’Alain Finkielkraut (dir., 2018). Du côté classiquement anthropocentrique, une spécificité socio-humaine assise sur une posture universaliste se libérant du biologique est défendue pour mieux souligner la construction symbolique et sociale des modèles comportementaux, des points d’appui institués et des rapports de force les modifiant, souvent par des ruptures historiques. Cet anthropocentrisme apparaît chaque jour plus décalé par rapport à la prise en compte raisonnée de la question du bien-être animal (dans les élevages et abattoirs industriels) et de certaines luttes écologiques visant la préservation des espèces en voie de disparition, mais aussi au regard des craintes de régression naturaliste qu’expriment les écoféministes (Larrère, 2012), en particulier l’interprétation biologique des différences humain/animal, des conflits, de la séduction, voire de la religion. À l’opposé, outre sa remise en cause de l’humanisme classique qualifié d’anthropocentrique, le regard biocentré veut fonder son objectif d’équivalence naturelle animaux/humains sur la science ; et c’est là que surgissent à la fois les contradictions et les rigidités du débat.
Francis Wolff termine un ouvrage de 2010 et commence une conférence plus récente à l’ENS en retournant l’énoncé « La science prouve que l’homme est un animal comme les autres » et en démontrant que « L’homme n’est pas un animal comme les autres puisqu’il a accès à des degrés de connaissance et de désir supérieurs propres à l’humanité » que lui donne, notamment et en particulier, précisément, la science (Wolff, 2010 ; 2014). Il affirme que, déjà, les humains les plus archaïques raisonnent au deuxième degré, contrairement aux animaux… Il ajoute des degrés supérieurs, un troisième puis un quatrième, à ce rapport à la connaissance, le plus élevé étant l’accès à des procédures universalisables et communiquées que l’on appelle science, celle-là même qui prétend, en se contredisant au plan logique, que « l’homme est un animal comme les autres »… Aucun animal ne se livre à l’énoncé de justifications rationnelles, n’adhère à des valeurs, n’élabore des idéologies, etc., encore moins des valeurs universalisables ou de justification. Aucun animal, ajouterons-nous, poursuivant ainsi son raisonnement, ne met en place des protocoles de mises à l’épreuve empirique d’hypothèses à l’origine des énoncés scientifiques selon lesquels l’homme serait « un animal comme les autres ». Les adeptes les plus radicaux de ce rapprochement ne peuvent qu’admettre ce constat et donc la contradiction logique à l’origine de leur point de vue ; c’est pourquoi l’avant-propos de la conférence de Wolff ajoute à la formule « Si la science prouve que l’Homme est un animal comme les autres », la contre-formule « Alors, cela prouve que l’Homme n’est pas un animal comme les autres parce que, seul, il dispose d’un moyen de connaissance infaillible : la science ».
On peut formuler à peu près la même chose, ou presque, avec un vocabulaire socio-anthropologique. La conclusion de Wolff établit une hiérarchie entre l’animal pouvant manifester des désirs à vocation pratique, voire des croyances liées à des connaissances – comme pur agent – et l’humain, à la base agent comme l’animal, puis spécifique car sujet capable de jugements, ensuite de justifications rationnelles et de valeurs, enfin d’universalité, tant dans les savoirs ordonnés que dans les idéaux moraux. Ce raisonnement philosophique identifie l’acteur et le système, alors que certaines traditions socio-anthropologiques les séparent empiriquement pour mieux les articuler analytiquement. Ainsi, les trois niveaux de spécificité humaine que Wolff établit en séparant le sujet pensant du pur agent (humain non pensant, mais aussi ce que sont certains animaux) renvoient aux formes de sédimentation tant culturelle que de l’action en artefacts et au processus d’institutionnalisation, donc de production d’une histoire non naturelle, qui caractérisent les humains par rapport aux animaux, des insectes les plus éloignés de nous aux mammifères grégaires les plus « proches » sur le plan des compétences. En résumé, si des compétences d’agents peuvent rapprocher les humains de certains animaux, aucune institution ensuite externalisée ni intériorisée ou incorporée n’a jamais été attestée chez aucun animal. C’est pourquoi on peut ajouter aux propos de Wolff que seul l’Homme dispose du recul esthétique et critique conduisant à l’art et à l’idéologie – que seul l’humain est à la fois agent et acteur (au double sens du terme, théâtral et historique) – ; mais sa formule centrée sur la science est plus intéressante car elle relève la contradiction d’un propos très à la mode de nos jours, ou l’oxymoron de la formule qu’il cite.
En dépit de cette logique assez incontournable, toute une lignée de scientifiques de différentes disciplines appartenant à la biologie, mais aussi à la physique ou à la chimie – ainsi que de journalistes vulgarisateurs des sciences, qui sont des acteurs essentiels du retour du naturalisme dans les SHS en écrivant des livres à succès – met aujourd’hui en question les fondements de la socio-anthropologie en niant toute spécificité, voire toute essence particulière, à l’humain. Leur propos est également de refuser la hiérarchie, l’idée que les humains seraient au-dessus des autres espèces animales. En plaquant les divers combats humains pour l’égalité (entre pseudo-races, entre genres, entre classes) sur le rapport au non-humain, l’animalisme consacre une égalité de droits paradoxale en cela qu’elle nie aux humains – nonobstant qualifiés d’animaux – le droit d’être carnivores, droit qu’elle reconnaît pourtant à d’autres animaux. Les humains étant omnivores, donc carnivores également, depuis l’aube des temps paléolithiques, le propos véganiste est, paradoxalement, à la fois contre-valeurs et anti-biologique car il hiérarchise finalement les animaux en cela que les carnassiers non humains auraient plus le droit d’agir conformément à leur nature que les humains à la leur."
(...)



 Your new post is loading...
Your new post is loading...