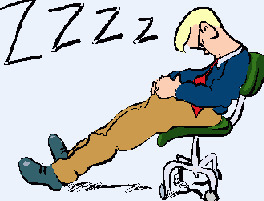
Dessin : http://jojo71.skynetblogs.be/tag/comment
Pour un droit à la paresse
Par Lise Blanmailland
Alors que le pouvoir de production de l’homme moderne est mille fois supérieur à celui de l’homme des cavernes, comment se fait-il qu’aux États-Unis il y ait des millions de gens si mal nourris et si mal logés ? demandait Jack London (Le talon de fer, 1908). La réponse est à chercher du côté des détenteurs des moyens de production. Si, aux mains d’un capitaliste, une machine signifie plus de profit et plus de chômage, aux mains des travailleurs, elle signifierait moins d’heures de travail et de meilleures conditions d’existence. Le droit à la paresse, à la lenteur, à la reconquête du temps en sont des préalables qu’il s’agit de traduire en revendications à se (ré) approprier de toute urgence.
Près de quatre siècles après l’Utopie de Thomas More qui plaidait déjà en 1516 pour une journée de travail de six heures, Paul Lafargue exhorte le prolétariat dans son pamphlet Le droit à la paresse à retourner à ses instincts naturels et contraindre à ne travailler que trois heures par jour et « fainéanter et bombancer le reste de la journée et de la nuit » [1].
« Si, déracinant de son cœur le vice qui la domine et avilit sa nature », écrit le beau-fils de Marx plus loin, « la classe ouvrière se levait dans sa force terrible, non pour réclamer les Droits de l’homme, qui ne sont que les droits de l’exploitation capitaliste, non pour réclamer le Droit au travail, qui n’est que le droit à la misère, mais pour forger une loi d’airain, défendant à tout homme de travailler plus de trois heures par jour, la Terre, la vieille Terre, frémissant d’allégresse, sentirait bondir en elle un nouvel univers... Mais comment demander à un prolétariat corrompu par la morale capitaliste une révolution virile ? »
Si la réduction du temps de travail a certes été une revendication historique du mouvement ouvrier, elle s’efface désormais devant la question de l’emploi et les propos de Lafargue gardent au 21e siècle leur pertinence et soulignent l’urgence dans laquelle demeure la question.
Sortir de la souffrance au travail
Lieu d’épanouissement et de réalisation de soi pour les uns, le travail n’en est pas moins source de souffrance et de peine pour beaucoup d’autres. Comme nous l’apprend le Larousse, le mot travail provient d’ailleurs étymologiquement du latin « trepalium » qui était un instrument de torture qui désignait plus largement le fait de faire souffrir ou d’infliger une peine, un « labeur ». Rien de bien réjouissant, il faut le dire. Si le mot a évolué avec le temps, il n’en reste pas moins intimement lié à la notion de peine et de souffrance, même dans nos contrées. Le nombre de suicides en entreprise en témoigne.
On peut notamment imputer cette souffrance au caractère aliénant du travail. Cette aliénation, nous explique Marx dans ses Manuscrits de 1844, apparait notamment au travers de l’objet créé par l’ouvrier, objet qui ne lui appartient pas. Le travail rend en ce sens l’homme étranger au produit de son travail, son activité appartient à un autre. Quelle satisfaction peut-il dès lors en tirer ? C’est un travail forcé nous explique-t-il. Il ne s’agit pas de satisfaire un besoin, il s’agit d’un moyen de satisfaire des besoins à l’extérieur du travail.
« Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste. » [2]
À l’heure actuelle, l’expression « souffrance au travail » est souvent associée aux techniques de management, aux exigences de compétitivité, de performance et de responsabilisation. Le harcèlement, la violence au travail, l’épuisement moral et les dépressions sont monnaie courante. Un Européen sur cinq déclare souffrir de troubles de santé liés au stress au travail. [3] Cependant, ce ne sont pas les seules causes de souffrance. À l’heure actuelle, à côté du moral, c’est encore le corps qui souffre. Les troubles musculo-squelettiques sont la première plainte des travailleurs quand ils parlent de leurs conditions de travail. [4]
Quoi de plus légitime dès lors que de vouloir diminuer ce temps de « peine » ? Réduire le temps de travail est en ce sens avant tout un moyen de sortir de la souffrance qu’il cause.
Travailler moins pour travailler tous et mieux
Néanmoins, l’emploi est au cœur des préoccupations sociales. À gauche, comme à droite (pour différentes raisons), la lutte contre le chômage est une des priorités principales. Même si l’on admet l’idée selon laquelle le travail peut être nuisible, il va sans dire que des taux de chômage élevés ne sont pas à envier.
L’importance de la question se situe dans la manière d’aborder la problématique. Jusqu’à l’heure actuelle, la réponse la plus répandue à la question de savoir comment résoudre le problème du chômage a toujours été d’augmenter la croissance économique. Et, partant, la productivité.
On a donc deux variables. Augmentation du volume produit (plus de richesses menant à plus d’emplois). Mais aussi diminution de la durée nécessaire pour le produire (moins de travail).
Voyons comment différents auteurs cherchent à les recombiner – en vue d’un « droit à la paresse » bien mérité. André Gorz, sartrien avant que d’être « écosocialiste », est de ceux qui y a beaucoup réfléchi. Selon lui, la mise en œuvre d’une réduction de temps de travail (RTT) ou, mieux, d’en redistribution du travail, supposerait une politique de prévision et de formation. Une politique de RTT impliquerait une redistribution continuelle de la main-d’œuvre entre les branches qui ne se ferait pas spontanément ; les secteurs où les gains de productivité sont faibles devraient donc augmenter leurs effectifs, les autres devraient les réduire. [5]
C’est dans les activités qualifiées que les gains de productivité seraient les plus lents et que par conséquent la RTT créerait le plus d’emplois supplémentaires. Elle aurait donc pour but et conséquence de démocratiser les compétences nécessaires pour les tâches professionnelles plus qualifiées, créatrices, complexes et responsables. Si l’on part du principe selon lequel la réussite professionnelle et la créativité sont fondamentalement conditionnées par l’acharnement continu au travail, la RTT ne pourrait être envisagée que pour les emplois précaires, monotones, pénibles ou insalubres.
Or l’enseignant, le scientifique ou le dirigeant d’entreprise n’a-t-il pas besoin de temps pour mettre à jour ses connaissances, se renouveler, rester ouvert et réceptif ? En travaillant moins et en gérant la réduction de son temps de travail à sa guise, ne travaillerait-il pas mieux ? L’ouvrier comme le médecin ou l’enseignant a en effet besoin pour exercer convenablement son métier de temps pour apprendre et se former ou encore créer et s’adapter.
Avec ou sans perte de salaires ?
Sur la question du salaire, les partisans de la réduction du temps de travail sont divisés. Certains sont contre une réduction des salaires, sans se mettre d’accord sur les modes de financement, d’autres sont carrément pour. Les seconds sont notamment les adeptes de la décroissance dont l’idée maîtresse est de travailler moins, gagner moins, produire moins et consommer moins, pour « vivre plus ». Autrement dit, décroître la production industrielle et marchande pour développer l’autoproduction artisanale et les échanges non marchands de services. Ils se prononcent donc pour une RTT avec réduction proportionnelle des salaires ; ils prônent ce qu’ils appellent la « simplicité volontaire » (terme repris par Gorz, notamment). Il s’agit du choix individuel de « réduire sa consommation pour travailler moins et consacrer plus de temps aux exigences spirituelles, aux relations humaines, familiales, sociales, érotiques, culturelles, religieuses » [6].
Cependant, même dans cette optique, pareille réduction pourrait plus difficilement s’envisager pour les salaires les plus faibles, permettant parfois tout juste de « s’en sortir ». Cela impliquerait par conséquent que le tiers des salariés, ceux qui gagnent le plus et qui sont donc aussi les plus influents politiquement et culturellement, acceptent de supporter seuls les « inconvénients » d’une RTT. En effet, si l’optique est de maintenir, voire même d’améliorer les revenus des salariés du bas de l’échelle et d’élever le niveau général de qualification en augmentant le nombre d’emplois qualifiés, les « riches » devraient accepter des réductions de leur pouvoir d’achat d’autant plus sensibles.
Là réside l’argument majeur de la thèse selon laquelle une RTT accompagnée d’une baisse salariale, pour une partie des travailleurs, ne serait pas faisable. « Si on veut que les « forts » se solidarisent avec les « faibles » », écrit Gorz, « si on veut que la RTT réponde à l’intérêt et aux aspirations tant des élites du travail que des chômeurs et des précaires, alors il vaut mieux dans un premier temps, que l’économie continue de croître ». [7]
Quant à l’option de la RTT sans baisse salariale, plusieurs modes de financement ont été envisagés. Gorz souligne que si l’on fait dépendre les RTT des gains de productivité réalisés à l’échelle de chaque entreprise ou de chaque branche, cela aboutirait à ce que l’on travaille deux fois plus dans un hôpital que dans une banque par exemple, et ce pour le même salaire. Il paraît donc logique que, si on la veut juste et équitable, autrement dit basée sur des principes de justice plutôt que de rationalité économique, elle doit être envisagée comme généralisée et égale pour tous.
Dans ce cas, une option est de la faire dépendre des gains de productivité dans son ensemble. Cependant, certains rétorquent que si on la fait entièrement dépendre du capital productif, la marge des bénéfices des entreprises serait immédiatement dévorée par les investissements nécessaires [8]. De plus, la RTT ferait à la longue augmenter démesurément les prix relatifs des productions et services à forte intensité de travail et faible accroissement de productivité.
L’économiste psychologue français, Guy Aznar, semble pour sa part vouloir résoudre ce problème par ce qu’il appelle le deuxième chèque. Nous toucherons tous, dans l’avenir, « suggère-t-il, » deux chèques, le premier, ou salaire direct, correspond à l’acte de travailler, qui est constitutif d’une partie de la richesse. Le second, ou salaire indirect, correspond à une richesse produite par les machines, mais on pourrait dire, plus globalement, produite par le système, avec beaucoup moins de travail. » [9]
Autrement dit, chaque fois que la durée du travail est abaissée, les salaires le sont dans la même proportion, mais la perte qui en résulte pour le salarié est compensée par une caisse de garantie. Pour le financement de ce « deuxième chèque », différentes formules ont été envisagées. Guy Aznar propose en gros trois moyens de financements. Le premier serait de, en quelque sorte, « faire payer le chômage par les robots », faire tourner plus les machines, c’est-à-dire profiter d’une meilleure rentabilité du capital.
Un autre moyen serait de répartir différemment la masse monétaire actuellement consacrée au chômage, dont le financement est principalement lié au travail. Toutefois il faudrait, selon lui, trouver un financement complémentaire pour compléter ces deux moyens. Celui-ci pourrait se faire par l’impôt sur le revenu par exemple ou encore en mettant en jeu l’ensemble des dispositifs fiscaux.
Gorz part quant à lui du principe que le financement de la RTT doit au contraire être fiscalement neutre (pour les personnes physiques comme pour les entreprises) et propose qu’il soit financé par un impôt indirect prélevé à la manière de la TVA et de la taxe sur les alcools, carburants… [10]
Le droit à la paresse : un désir de vie
La contestation de la valeur « morale » du travail ne date pas d’aujourd’hui. Lors de la révolution industrielle déjà, le philosophe libertaire américain Henri David Thoreau (1817-1862) écrivait en 1854 dans son traité « La vie sans principes » : « Si, par amour des bois, un homme s’y promène pendant la moitié de la journée, il risque fort de passer pour un fainéant. Si, au contraire, il emploie toutes ses journées à spéculer, à raser les bois et à rendre la terre chauve avant son heure, on le tiendra en haute estime, on verra en lui un homme industrieux et entreprenant. Est-ce donc qu’une ville ne porte d’intérêt à ses forêts que pour les faire abattre ? » [11] Et d’ajouter un peu plus loin « Il n’est pas d’individu plus fatalement malavisé que celui qui consume la plus grande partie de sa vie à la gagner », propos qui ne sont pas sans rappeler les slogans de mai 68.
À l’heure actuelle, dans les pays occidentaux le travail reste l’activité autour de laquelle tout tourne. Nos vies sont organisées autour de la valeur centrale du travail précédé d’études pour le travail, entrecoupé de loisirs du travail, suivi de retraite du travail. Être actif est entendu comme être un travailleur.
Le slogan de Nicolas Sarkozy « Travailler plus pour gagner plus » a pris le dessus sur ceux de mai 68.
Une RTT généralisée, égale pour tous, accompagnée d’une politique du « temps choisi » (concept lancé dans le sillage des travaux d’André Gorz qu’appuiera un Jacques Delors) pourrait faire réémerger, comme dit Gorz, la conception selon laquelle l’opportunité de gagner plus était moins intéressante que celle de travailler moins. [12] En quoi consisterait concrètement une telle politique du « temps choisi » ?
Il s’agirait, toujours selon Gorz, d’une sorte de désynchronisation des horaires et des périodes de travail, soit à l’échelle de la semaine (de quatre voire de trois jours), soit à l’échelle du mois, du trimestre ou même de l’année ou du quinquennat. [13] Attention, il ne s’agit pas de confondre avec la flexibilité à tout prix de l’ordre libéral !
L’idée est que si la RTT se faisait avec maintien d’horaires quotidiens rigides et uniformes, la libération du temps se ferait moins facilement et serait beaucoup moins efficace. Si on veut répartir un volume de travail moindre sur un nombre plus élevé de personnes, celles-ci auraient du mal à être toutes présentes à leur lieu de travail les mêmes jours, aux mêmes heures, le risque étant, bien sûr, qu’un temps de travail éclaté se traduise par une infinitude de contrats précaires mal payés.
L’avantage de cette libération du temps serait cependant de permettre, outre de pouvoir lire ou jouer de la musique, une extension des loisirs passifs et du temps consacré à faire soi-même ce qu’on pourrait donner à faire aux autres pour être en mesure de travailler plus : faire le ménage, jardiner, déménager, bricoler, coudre, etc. ou encore de pouvoir choisir de libérer plutôt quelques mois ou un an pour permettre la réalisation ou la mise en route d’un projet, qu’il soit artistique, social ou technique. Mais surtout, la RTT permettrait qui plus est de libérer du temps pour des activités constructives. À moins de pouvoir, le faire par le biais d’un travail rémunéré, s’engager politiquement et socialement prend du temps. Beaucoup de temps. Aucun militant ne dira le contraire. En réduisant le temps de travail, les travailleurs seraient plus en mesure de s’engager dans leur organisation syndicale, un parti politique ou encore un comité de quartier.
Enfin, la RTT est l’occasion de remettre en cause le culte de la vitesse d’une société fondée sur la rentabilité immédiate et de renouer avec la lenteur, la sagesse et la patience. Tant au travail qu’en dehors, nous sommes astreints à aller de plus en plus vite. L’Homme actuel est un homme pressé pour reprendre l’expression de la chanson de Noir Désir. À l’usine comme à l’hôpital, on se doit d’être rapide ; et pour cause, le temps, c’est de l’argent. Nous sommes nombreux à se demander comment nous faisions il y a vingt ans seulement sans SMS, e-mails, Internet,… Que de temps « perdu » (?) à attendre un rendez-vous, une lettre,… !
Pour conclure, il y aurait lieu de se demander si une RTT généralisée et égale pour tous dans un système dépendant de hauts niveaux de production et de consommation n’aurait pas des conséquences perverses voire dramatiques sur la population qui la « subit ». À la fin de son œuvre maîtresse, Le Capital, Marx conclut « Mais l’empire de la nécessité n’en subsiste pas moins. C’est au-delà que commence l’épanouissement de la puissance humaine qui est sa propre fin, le véritable règne de la liberté qui, cependant, ne peut fleurir qu’en se fondant sur ce règne de la nécessité. La réduction de la journée de travail est la condition fondamentale de cette libération. » [14]
Le défi se situe donc au niveau de la construction d’un nouveau paradigme ou, plus précisément, un nouveau système économique qui serait en mesure d’accueillir une RTT comme « arme de destruction » du système économique actuel.
Par Lise Blanmailland - econospheres.be – le 16 janvier 2015
Source originale : http://gresea.be/spip.php?article1316
Notes
[1] Paul Lafargue, Le droit à la paresse, Editions le passager clandestin, 2009.
[2] Karl Marx (1844), Manuscrits de 1844. Économie politique et philosophie. Paris : Éditions sociales, 1972, édition électronique, p.56
[3] Le Monde du 22 février 2011.
[4] Voir notamment le rapport de l’enquête sur les conditions de travail mené tous les cinq ans par la Fondation Dublin disponible en ligne : http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/index.htm
[5] André Gorz, Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique, Gallimard, Coll. Folio/Essais, 2004 (paru précédemment aux éditions Galilée en 1988), s.l., p.303.
[6] Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Fayard, s.l., 2006, p.215.
[7] André Gorz, Capitalisme, Socialisme, Écologie. Désorientations, Orientations, Galilée, coll.Débats, s.l., 1991, p.196.
[8]. Alain Lipietz, « La RTT n’est pas seulement une question d’emploi », Alternatives économiques, la lettre de l’association n° 5/6, 4e trimestre, 1997.
[9] Guy Aznar, Travailler moins pour travailler tous : 20 propositions, Ed. Syros, Paris, 1993, op.cit., p.103.
[10] André Gorz, Métamorphoses…, op.cit., p.321-322 et Capitalisme…, op.cit., p. 204.
[11] Henry David Thoreau, Désobéir, Ed.Herne, coll.10/18, Paris, 1994, p.128.
[12] André Gorz, Capitalisme…, op.cit.
[13] André Gorz, Métamorphoses…, op.cit., p.309-310.
[14] Karl Marx, Œuvres, EconomieII, Gallimard, La Pléiade, Paris, 1968, p. 1488.



 Your new post is loading...
Your new post is loading...






