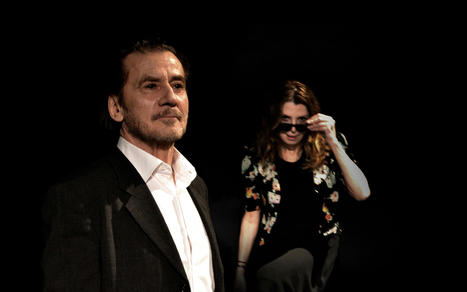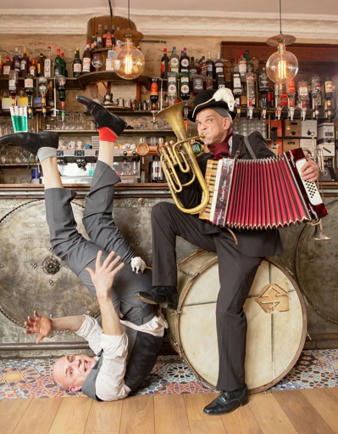Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 19, 2021 5:55 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 19 juillet 2021 Du côté des catacombes de Palerme… Photographie DR. Daniela Gusmano. Deux pièces d’une heure, différentes, mais très touchantes. Le public d’Avignon aime beaucoup Emma Dante et se bouscule au gymnase du lycée Mistral pour l’applaudir. Misericordia date de janvier 2020. La création a eu lieu au Piccolo Teatro de Milan. C’est une première en France. Une forme très dépouillée et simple. L’artiste raconte combien l’adoption… L’artiste raconte combien l’adoption d’un enfant, il y a quatre ans, l’a conduite à observer le monde autrement. On vous laisse découvrir les circonstances exactes dans la feuille de salle de Misericordia. C’est très frappant, très touchant. Elle aime la miséricorde en laquelle elle entend misère et cœur. Elle en appelle à la miséricorde pour cette étrange constellation : trois femmes et un jeune homme, Simone Zambelli qui est Arturo, qui ne parle pas mais s’exprime avec son corps, sans cesse. Il ne dira qu’un mot, tandis que les trois femmes, en dialecte des Pouilles et de Sicile, elles, disposent des mots et s’en servent parfois comme des armes. Tout n’est pas surtitré, et peu importe, car c’est le flux, des débits, les changements de régime qui comptent ici. L’émotion l’emporte et ouvre à la compréhension. Simone Zambelli, long et maigrichon, est bouleversant dans ses pas, ses tours et détours, sa grâce très particulière. L’autre volet, une heure également, Pupo di zucchero/La Festa dei morti est une création. La première a eu lieu au Teatro Grande de Pompéi, le 8 juillet. Une dizaine de comédiens, un dialecte napolitain surtitré, et une référence au Conte des contes de Giambattista Basile. Le hasard veut qu’à Paris, à la Comédie-Italienne, Attilio Magguili, s’inspire du même auteur, pour son très joli spectacle qui évoque le Guépard, spectacle actuellement à l’affiche. Le titre définit le propos : la fête des morts et ces poupées de sucre, que dans le sud de l’Italie et en Sicile, on fait pour l’occasion, les parant de bijoux de pacotille, les faisant les plus belles possibles. Une cérémonie qui en appelle à la mémoire. Sur le plateau, les morts se croisent, toutes générations confondues, tandis qu’un très vieil homme prépare sa poupée… Scènes de groupe, scènes de solitude, chorégraphies, transformations, tout ici est aussi grave que léger, aussi touchant que drôle parfois. Deux pièces où se déploie l’art, épuré, tendre, d’une femme qui semble avoir trouvé une manière apaisée, mais puissante, de nous parler, de nous éveiller aux beautés comme aux cruautés du monde, de la vie. Un charme nous enveloppe, nous grise. Gymnase du lycée Mistral, jusqu’au 23 juillet. A 15h00 et 19h00. Le 21 juillet à Utopia-Manutention, projection à 11h00 de Le Sorelle Macaluso, suivie d’une rencontre avec Emma Dante et projection de Palerme, à 14h00.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 19, 2021 12:21 PM
|
Par Thierry Jallet - Wanderer, 19 juillet 2021 Vu au Festival d'Avignon, La FabricA, le mercredi 14 juillet, 15h "Frères humains, vous qui après nous vivez..."
Fraternité, conte fantastique fait partie des spectacles très attendus pour cette édition du Festival d’Avignon. Caroline Guiela Nguyen et sa compagnie les Hommes approximatifs y reviennent après Saïgon, en 2017, présenté alors au Gymnase Aubanel. Wanderer l’avait vu à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, lors de la tournée suivante et y avait vécu un vrai moment de théâtre cathartique. Ainsi enthousiasmés, nous ne pouvions manquer cette nouvelle création à la FabricA. Inclus dans un cycle intitulé « Fraternité » progressant au fil de ses étapes, ce deuxième opus est monté à Paris, juste après Les Engloutis, un court-métrage tourné en 2020 à la maison centrale d’Arles, et juste avant L’Enfance, la nuit, une autre pièce avec des comédiens de la Schaubühne de Berlin. De fait, inscrit dans cette démarche de création longue, il apparaît que Fraternité, conte fantastique est un projet théâtral rigoureusement pensé et préparé. Dans sa note d’intention, Caroline Guiela Nguyen indique qu’après de multiples rencontres, elle a interrogé le mot « FRATERNITÉ » pour « voir comment [cette idée] pouvait s’incarner dans le monde d’aujourd’hui ». Ainsi, avec ce spectacle, elle s’ancre résolument dans une réflexion à dominante anthropologique afin de comprendre ce concept de fraternité entre les êtres humains, prenant appui ici sur une communauté ayant perdu une partie des siens, suite à des événements hors du commun. Et Wanderer a été convaincu par cette nouvelle proposition théâtrale.
Le rideau gris opacifie le plateau éteint. Le public de la FabricA attend fébrilement le début de la représentation. C’est alors que s’avance Caroline Guiela Nguyen en personne pour s’adresser à lui. Avec beaucoup de délicatesse, elle l’informe qu’une des comédiennes s’est blessée à la cheville et qu’elle s’apprête à jouer avec des béquilles, ce qui est favorablement salué par les spectateurs. Un instant après, la lumière monte déjà sur scène et le rideau laisse entrevoir ce qu’il s’y passe par translucidité. On perçoit des mouvements, une certaine agitation derrière. « Hieu, tu as besoin d’aide ? » entend-on. Le rideau s’ouvre alors pour laisser voir distinctement l’espace du plateau bien rempli. Huit comédiens d’origine et d’âge différents s’affairent et semblent préparer un buffet dans un endroit étonnant, un endroit entre le local associatif, la salle de soins et le quartier général militaire. Tout cela rendu dans des tons pastels avec une fresque vivement colorée sur le mur au lointain, face au public. Une porte dans ce mur à cour, une autre donnant accès aux coulisses. Cette scénographie – qui n’est pas sans rappeler celle de Saïgon – accumule tout un ameublement fait de tables, chaises et accessoires de couleurs. Sur le haut du panneau mural à cour, on voit ce qui semble être un écran de contrôle spatial, digne de la NASA, que l’une des comédiennes tenant une tablette (formidable Hoonaz Ghojallu, jouant Rachel, une technicienne américaine surveillant le mouvement des corps célestes) ne quitte pas des yeux. On apprend qu’un nouveau dispositif, situé côté jardin, vient d’être installé. La fonction de cette cabine consiste à laisser un message aux disparus en une minute et trente secondes tout au plus. Le brouillard se lève peu à peu sur la situation dans laquelle on se trouve alors et sera plus pleinement clarifiée par plusieurs vidéos diffusées sur un écran en surplomb à cour. Dans ces capsules en images, à côté des indications temporelles transcrites parfois, des hommes et des femmes âgés se succèdent au fil de la pièce, afin de fournir les éléments du récit nécessaires à la compréhension du public. Comme autant de narrateurs extradiégétiques omniscients, dans un lieu et un temps inconnu – le futur, peut-être ? – qui commentent les faits ou permettent des ellipses dans l’histoire racontée sous nos yeux. Nous sommes dans un « Centre de Soin et de Consolation », un espace ouvert à tous sans distinction, créé pour faire face au désastre. Lors d’une éclipse, une partie de l’humanité s’est purement volatilisée, sans explication rationnelle – clin d’œil possible à la série Leftovers. Ceux qui restent se sont alors organisés en différents collectifs pour affronter les conséquences de la catastrophe. Dans ces centres, on s’entraide – dans toutes les langues, on se réconforte – et cela va du repas livré pour ne pas s’abandonner seul au désespoir jusqu’aux séances de coaching de groupe pour supporter sa peine. On cherche des solutions – parfois sans efficacité – pour permettre aux disparus de revenir dans le présent devenu insupportable sans eux. Sébastien (Dan Artus) entre dans la cabine à messages et le film qu’il enregistre, capté par la caméra face à lui, est retransmis sur le mur au lointain, comme ce sera le cas à chaque utilisation de la machine. Il laisse un message à son épouse Elisa, disparue lors de « la Grande Eclipse ». Il lui donne des nouvelles d’Alizée, leur fille et contient son émotion à grand-peine. « Je te jure que je reviendrai te parler tous les jours ». Tandis qu’il sort dévasté par le chagrin, deux autres personnages entonnent chacun un chant aux accents désespérés, en arabe et en tamoul. Rachel vérifie alors les battements de cœur de Sébastien, comme elle le fait pour chaque utilisateur de la cabine. C’est que la tristesse qu’ils éprouvent diminue leur activité cardiaque. Et parce que chaque humain est relié à l’univers tout entier – pour une raison inconnue et extraordinaire, cela a des conséquences sur le cosmos et le mouvement des planètes. Or, si ces mouvements ralentissent, si le marche de l’univers tend vers l’immobilité, il n’y aura plus d’éclipses. Et tous fondent justement leurs espoirs dans une nouvelle éclipse, pensant que les disparitions lors de la précédente, s’annuleront alors. Malgré l’ampleur de la tâche, tous se sont donc organisés au mieux pour limiter leurs peines. Ensemble, réunis dans une fraternité rendue nécessaire au bien de tous. Arrêtons-nous justement sur le titre qui nous a questionné à ce stade, car tout aussi étrange finalement que les événements relatés. . Choisissant la précision avec le terme « conte », Caroline Guiela Nguyen fournit à ses spectateurs un élément déterminant dans la réception de sa pièce. D’emblée, elle soutient le choix d’un théâtre narratif, d’une chronologie des événements au sein d’un espace diégétique donné. C’est la qualification de « fantastique » qui surtout interpelle et suscite possiblement une certaine incompréhension. Avançons une explication : l’auteure joue sciemment sur l’ambiguïté du mot. D’abord, il ne peut s’agir d’un conte fantastique au sens premier du terme, bien qu’on puisse y déceler parfois une forme d’hésitation entre le réel et le surnaturel – la diffusion de l’ultime vidéo diffusée sur le mur, avant le noir final, par exemple. Ici, la pièce utilise bien davantage les ressorts des récits d’anticipation, mettant en avant les progrès scientifiques dans un futur plus ou moins lointain, loin du merveilleux et de tout souci de réalisme en effet. La science-fiction n’est pas le fantastique : s’en tenant là, on pourrait de fait reprocher à Caroline Guiela Nguyen le choix d’une dénomination un peu hâtive. Pourtant, on se demande ensuite si le mot « fantastique » n’est pas ici à entendre dans une autre acception. Peut-être le titre propose-t-il plutôt un avis favorable sur le conte et sur le sujet qu’il aborde par extension. Il serait donc ici un récit – un apologue ? – fabuleux, sensationnel. Associé au mot « fraternité » qui est le point de départ du travail préparatoire sur le cycle engagé en 2020 par la compagnie, on suppose que le sens de ce titre à double fond est à déplier : au-delà des cotillons et des teintes pastels, au-delà des machines futuristes, au-delà du pathétique et de toute la fable jouée devant nous, la fraternité peut être pensée « comme un élan qui lance un regard depuis le présent, vers le passé et vers l’avenir » selon les mots de l’auteure dans sa note d’intention, comme quelque chose de formidable à explorer et à encourager en somme. Pour la mémoire de ceux qui ne sont plus là autant que pour ceux qui restent puisque « nous faisons partie de la même communauté humaine ». Ainsi, la collectivité des personnages – tous remarquablement interprétés par des acteurs au jeu très organique – va au gré des événements osciller entre espérances et déceptions dans le temps qui passe inexorablement. Une nouvelle éclipse a lieu. Le plateau s’obscurcit pour ne laisser qu’un flamboiement traversant une ouverture haute à jardin – soulignons à cette occasion le très beau travail sur les lumières de Jérémie Papin et de Mathilde Chamoux. Les progrès techniques avancent aussi et on met au point « MEMO », machine froide et inquiétante qui efface la mémoire des humains à l’exception de trois souvenirs à choisir seulement, effaçant donc leur peine afin de ne pas ralentir leur cœur et par conséquent l’univers tout entier. Cela ne va pas sans débat ni réactions violentes. Ismane (absolument remarquable Boutaïna El Fekkak) refuse obstinément de perdre les souvenirs de sa fille disparue, par exemple. On est chaque fois cueilli par leurs moments de découragements, leurs colères, leurs peurs – par exemple, Dounia, interprétée par Mahia Zrouki, cachant à son père Habib joué par Saadi Bahri, la vérité sur les disparition de sa mère. Malgré tout, ils restent unis jusque dans la préparation du banquet final. Dans une fraternité finalement préservée. Ainsi, pendant près de trois heures de spectacle – et malgré la blessure de l’une d’entre eux, la pièce est véritablement portée par ce groupe de comédiens venus tous d’horizons très différents. On se réjouit de revoir Hiep Tran Nghia et Anh Tran Nghia, déjà présents dans la distribution de Saïgon. La présence des deux rappeuses Nanii et Saaphyra est également remarquable notamment par l’âpre modernité que leur chant introduit dans la pièce. Citons aussi les déambulations du chanteur lyrique Alix Petris qui font entendre avec grâce l’écho du désespoir des autres personnages. De même, les différentes langues parlées s’entremêlent, se traduisent, se passent : français, arabe, tamoul, anglais, vietnamien résonnent en un chœur harmonieux comme au sein d’une tour de Babel reconstituée – réconciliée pourrait-on presque dire. On reprochera certainement à Caroline Guiela Nguyen d’être tombée dans le piège de la mièvrerie, du trop sucré, du trop larmoyant. Chaque spectateur place sa sensibilité où il veut, principalement où il peut. Il convient cependant d’admettre que la proposition a le grand mérite d’interroger une béance, une nécessité trop souvent perdue dans notre présent où tout est à profusion, où l’individualisme l’emporte, où le manque de l’Autre n’est pas toujours pleinement ressenti. Œuvre aux accents cosmogoniques, Fraternité, conte fantastique n’apporte pas de réponse présomptueuse mais invite plutôt à la méditation sur ce que nous sommes les uns pour les autres. Et reconnaissons que ce n’est pas sans intérêt sur une scène de théâtre aujourd’hui. Thierry Jallet - Wanderersite Crédits photo : © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 18, 2021 6:25 AM
|
Par Thierry Jallet dans Wanderer - 16 Juillet 2021 Festival d'Avignon, Vedène, L'autre scène du Grand Avignon, le 8 juillet à 15h Une création de Christiane Jatahy attise la curiosité. Dans sa démarche d’abolition des frontières entre le théâtre et le cinéma notamment, elle s’est rapidement fait connaître avec des créations comme Julia, adaptée de Mademoiselle Julie de Strindberg qui la révèle au public français en 2013 ; What if they went to Moscow ?à partir des Trois Sœurs de Tchekhov ou encore La Forêt qui marche en 2016, librement adaptée de Macbeth. En 2019, elle laisse une empreinte forte au Festival d’Avignon avec Le Présent qui déborde d’après l’Odyssée, liant étroitement la fable homérique et l’histoire d’artistes réfugiés de nos jours. Il va de soi que l’annonce d’un nouveau projet pour le théâtre à partir de Dogville, le film impitoyable de Lars von Trier, créé de surcroît à Avignon cette année, a donc tout naturellement suscité l’intérêt du public. Entrecroisant continuellement fiction et réalité, la metteure en scène d’origine brésilienne propose une œuvre originale, prenant pour point de départ le scénario du film et l’actualité de son pays, interrogeant le basculement dans le fascisme – tout en se gardant d’apporter une réponse franche. A travers des procédés narratifs jouant sur la rupture, l’illusion et la multiplication des points de vue, elle met à profit les ressorts cinématographiques pour les fondre dans sa propre dramaturgie. Les avis sont partagés et Wanderer a voulu voir par soi-même ce singulier objet théâtral. C’est à Vedène, à « L’Autre Scène du Grand Avignon » que l’on se rend, conduit par un bus affrété pour l’occasion. L’entrée en salle ne manque pas de retenir l’attention : le plateau est plein, surchargé même, avec divers meubles, des plantes, des étagères pleines, un aquarium par ici, des jouets par là… S’agit-il d’un intérieur domestique ? De la fragmentation de plusieurs espaces domestiques ? On remarque aussi la présence d’au moins une caméra, annonciatrice des images retransmises à venir. Les comédiens sur scène vont et viennent du plateau à ses extérieurs qui pourraient être des coulisses à vue. Ils plaisantent entre eux ou bien fixent attentivement le public tandis qu’il s’installe, levant toute hésitation sur la présence d’un éventuel quatrième mur – « tombé depuis longtemps » selon les mots de la metteure en scène elle-même – écartant toute tentation vers un réalisme trop lénifiant sans doute. Des néons à cour et à jardin, des projecteurs également. Un grand écran surtout, en surplomb. Rien de bien neuf ? Pas si sûr… Plus la salle se remplit, plus les comédiens entrent et prennent place sur le plateau avec de multiples marquages au sol apparents. « On attend encore des gens » lance l’un d’entre eux déclenchant l’hilarité des spectateurs. Comme un rendez-vous, une convention sociale ordinaire ou presque. L’un d’entre eux s’avance alors et salue aimablement la salle. Il dit s’appeler Tom. Pourtant, c’est bien le comédien Matthieu Sampeur qui parle. D’emblée, on floute l’image, le réel s’estompe par endroits fictifs. Il fait les présentations avec Jacques, Virginie, Charles… tous présents, tous personnages de fiction car ces noms ne correspondent pas non plus à leur véritable identité. Dans un souci de clarté, Tom prend l’initiative d’expliquer « ce qu’on fait là ». Parce que « l’Autre est devenu une menace », ils ont travaillé « à partir d’un film : Dogville ». Le spectateur est renvoyé à ses souvenirs de… spectateur. Une connivence s’établit ainsi autour de l’œuvre de Lars von Trier ayant fait grand bruit en 2003, débutant une série qui se proposait alors de livrer une description acerbe de la société américaine, série qui n’a jamais été achevée du reste. On se souvient de Grace, campée par Nicole Kidman, arrivant dans un village pour trouver refuge alors qu’elle est poursuivie. Les habitants la reçoivent avec méfiance car ils vivent tous reclus, dans une autarcie totale. L’un d’entre eux prénommé Tom – le rapport avec ce qu’il se passe dans la salle est net – va essayer de démontrer à toute la communauté qu’elle se fonde sur des valeurs qui nie toute altérité. Et, Grace deviendra effectivement leur esclave, victime de tous les abus de cette collectivité aveugle et cruelle. Une meute inhumaine. Entre chien et loup déjà. A l’avant-scène, Tom poursuit ses explications. Le choix du film est rapidement présenté. Sans doute peut-il être un exemple possible utilisé « pour essayer de changer », « pour ne pas se laisser emporter vers la même fin ». « Pour écrire une autre histoire » ajoute-t-il. Le projet – singulier s’il en est – se dessine plus nettement : Dogville est un point de départ possible et ce qui va se dérouler sous nos yeux relève de l’expérimentation – les personnages en étant seulement « au plan théorique pour l’instant ». Expérimentation humaine par les questions anthropologiques qu’elle va soulever. Expérimentation théâtrale par la réflexion dramaturgique qu’elle sous-tend et la réception diffractée du public qu’elle va engendrer. La communauté des personnages sur scène n’est cependant pas aussi unie qu’il pouvait sembler : Tom est déjà gentiment recadré par ses camarades et il finit par leur reprocher de refuser de voir ce qu’il considère comme un problème. En grand ordonnateur auto-proclamé de cet exercice de laboratoire, il déclare qu’il veut « illustrer » son idée avec « la pièce manquante » usant lui-même d’un vocabulaire déjà atrocement déshumanisant. C’est alors que Graça – extraordinaire Julia Bernat ! – se lève dans le public. Tom l’interpelle, elle s’approche. Elle est poursuivie par la milice dans son pays – le Brésil ? – mais elle ne veut pas « poser de problème ». Charles – Valerio Scamuffa, extraordinaire tant il est glaçant de sauvagerie – est déjà réticent. Tom insiste : « C’est le film, c’est Grace ». Cependant, nous savons bien qu’il n’en est rien, que le réel est déjà fragmenté, laissant surgir la fiction ça et là, contenant elle-même d’autres surgissements fictionnels. Vertigineuses mises en abyme qui troublent tous les repères. Et on peut penser que c’est à dessein. Où sommes-nous ? Qui sont ces êtres ? Qui sommes-nous devenus, assemblés dans cette salle à cet instant précis, au cœur de ce dispositif expérimental ? Les doutes sont désormais nombreux. Ainsi, Jacques – joué par Philippe Duclos – se déclare aveugle, Tirésias d’aujourd’hui, vrai faux devin qui prétend facétieusement « déambuler dans la Cité des Papes » mais qui ne devine très probablement rien – « Y’a rien à voir ici » clame-t-il d’ailleurs – manifestement incapable d’infléchir le cours des choses. Graça est quand même acceptée, après un vote à l’unanimité car les valeurs humanistes l’emportent en apparence. Dans un premier temps, du moins. Elle agit pour son intégration au groupe. On la fête, dans une ambiance chaleureuse, après avoir réagencé l’espace pour faire apparaître une longue table, face au public. On trinque, on mange de la tarte aux pommes – bio sans doute, la nourriture saine n’étant pas la panacée pour développer le « concept d’acceptation » pour autant. Virginie lui a d’ailleurs déjà dit qu’on n’a « besoin de personne ». Et c’est un grondement plus sourd qui se fait peu à peu entendre, encore contenu. Dans cet endroit, « y’a rien de bon ». Notons dès lors que les comédiens, eux, le sont à tous égards. Ils avancent avec une grande maîtrise dans ce dédale narratif parsemé de chausse-trappes. Le vertige se poursuit pour mieux nous perdre au-delà des frontières qui délimitent le contour de ce qui nous est familier. Parce que l’inévitable va se produire – n’est-ce pas le propre de toute tragédie ? – l’ère du soupçon va entrer en vigueur. Et là aussi, la communauté des personnages, des comédiens, des humains rassemblés sur ce carré de linoléum brillant va s’ensauvager, se déchaîner dans une ivresse de domination sur Graça qui ne serait pas celle qu’elle dit. Elise – très juste Viviane Pavillon – dévorée de jalousie en raison de l’attirance réciproque entre la jeune fille et Tom, la dénonce, utilise le réseau social pour cela. Et le poison de la haine se diffuse sous nos yeux, très vite. Les caméras filment, diffractent les points de vue sur ce qui se joue. Le petit Achille est d’ailleurs utilisé « comme un cheval de Troie » suivant les indications de Tom au début. Cette nouvelle allusion à l’épopée homérique est également l’occasion d’offrir un autre regard. L’enfant est sous son lit, en fond de scène, à jardin. Graça qui s’en occupe veut le faire sortir de sa cachette. Il refuse obstinément, réclamant qu’elle lui fasse du mal, la menaçant de dire à ses parents qu’elle l’a fait si elle ne lui obéit pas. Achille – le jeune Harry Blätter Bordas qui n’est pas présent sur le plateau – est à l’image sur l’écran en surplomb. La perversité de ses mots dans la spontanéité de l’enfance heurte. « Y’a rien de bon » ni personne manifestement. La caméra qui filme en direct s’interrompt régulièrement pour laisser voir des scènes tournées avant. Le processus n’est certes pas nouveau – Milo Rau l’utilise volontiers lui aussi – mais il a le mérite de faire voler le réel en éclats et de multiplier les possibles. Qu’est-ce que cela change, au fond ? Graça subira les pires outrages, sera abusée sur scène et à l’image sans que cela ne modifie quoi que ce soit au déroulement des événements, sans que le résultat de l’expérience ne varie. Dans la scène filmée pendant le transport de pommes, Ben qui la viole lui recommande même de ne pas faire de bruit car « il y a du monde dehors », nous qui regardons en silence. Homo homini lupus toujours sans doute. Si c’était nécessaire, la fin marque bien l’écart avec Dogville, ne montrant aucun massacre vengeur. C’est plutôt le temps de l’analyse des résultats. « Nous avons réagi aux événements » se justifie l’un d’entre eux. Et Tom de se questionner encore : « Comment faire pour ne pas répéter inévitablement la même histoire ? » Opérant un retour au présent, au réel – ou pas ? On doute encore – Graça évoque son Brésil natal dans sa langue maternelle et conclut que « quand le fascisme devient réel (…) il n’y a plus rien ». Sauf peut-être la musique et l’étincelle de l’art qui persiste, qui sait ? Peut-être peut-on reprocher à Christiane Jatahy d’épuiser un filon mais elle relève tout de même ce qui semble être son pari. L’abolition des frontières, l’inconfort dans la réception pour le spectateur, le film de Lars von Trier, tout semble être un prétexte pour une autre histoire qui s’écrit hic et nunc, avec ses incertitudes, ses impasses et ses opportunités. Quelque chose authentiquement « entre chien et loup », dans une semi-obscurité. Œuvre labyrinthique dans laquelle il convient de rappeler une fois de plus l’engagement exceptionnel des acteurs, la dernière création de Christiane Jatahy, loin de tout dogmatisme, peut déconcerter par sa vitesse, par certaines facilités dans les dialogues, mais elle ouvre une nouvelle brèche à un moment où notre présent peut en avoir besoin. Sylviane Dupuis écrit « À quoi sert le théâtre ? Sinon, justement, à présenter chaque soir à nouveau (…) ce miroir à nos pauvres illusions, à démasquer la réalité vivante sous nos mensonges ou sous nos peurs ? ». Et de ce point de vue, ce pari de Christiane Jatahy semble bien gagné. Thierry Jallet / Wanderer Entre chien et loup
D’après le film Dogville de Lars Von Trier Adaptation, mise en scène et réalisation filmique : Christiane Jatahy Avec Véronique Alain (Virginie), Julia Bernat (Graça), Elodie Bordas (Vera), Paulo Camacho (technicien son et caméra plateau), Azelyne Cartigny (Martha), Philippe Duclos (Jacques), Vincent Fontannaz (Ben), Viviane Pavillon (Elise), Matthieu Sampeur (Tom), Valerio Scamuffa (Charles) Collaboration artistique, scénographie et lumière : Thomas Walgrave
Direction de la photographie: Paulo Camacho
Musique : Vitor Araujo
Costumes : Anna Van Brée
Vidéo : Julio Parente, Charlélie Chauvel
Son : Jean Kerauden Collaboration et assistanat : Henrique Mariano
Assistanat à la mise en scène : Stella Rabello Avec la participation de Harry Blättler Bordas Remerciements : Martine Bornoz, Adèle Lista, Arthur Lista Régie générale : Frédérico Ramos Lopes
Régie lumière : Serge Levi
Régie son : Jean Kerauden
Régie vidéo : Charlélie Chauvel
Direction de production : Julie Bordez
Chargé de production : Gautier Fournier
Diffusion : Emmanuelle Ossena (EPOC Productions) Production : Comédie de Genève
Coproduction : Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris), Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa (Italie), Théâtre national de Bretagne (Rennes), Le Maillon Théâtre de Strasbourg Scène européenne
Avec le soutien de Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture Constructions décors Ateliers de la Comédie de Genève Lars von Trier est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire en accord avec Nordiska ApS ; Christiane Jatahy est artiste associée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe (Paris), au Centquatre-Paris, au Schauspielhaus Zürich, au Arts Emerson – Boston et au Piccolo Teatro di Milano Création le 5 juillet 2021 au Festival d’Avignon

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 17, 2021 5:44 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 17 juillet 2021 Photo de Christophe Raynaud de Lage. Après Het land Nod (Le Pays de Nod), il y a déjà cinq ans, le groupe anversois revient avec un spectacle en forme de cauchemar à couleurs médiévales, The Sheep Song.
Au parc des expositions, leur première apparition au festival d’Avignon, il y a cinq ans, avait fait sensation. Par la démesure –réinvention de la salle Rubens du musée des Beaux-Arts d’Anvers, déménagement d’un tableau monumental- et par l’esprit, l’humour, le rire. Changement de ton, changement de registre, avec The Sheep Song. Même si la peinture est sans doute encore plus présente, ici. Mais l’on ne peut pas vraiment rire si l’on prend au sérieux ce travail extrêmement sophistiqué plastiquement, extrêmement complexe intellectuellement et profondément dérangeant. Après le travail de Milo Rau sur L’Agneau mystique, retable des frères Jean et Hubert van Eyck qui date de 1432 et a bénéficié récemment d’une campagne de restauration de plusieurs années, trésor de la cathédrale Saint Bavon de Gand, voici donc les Anversois de FC Bergman qui travaillent au Toneelhuis, qui, eux, se sont perdus dans les salles de la collection Fritz Mayer van den Berg. Ils ont contemplé Margot la folle de Pieter Brueghel l’Ancien, tableau qui date de 1563 et laisse affleurer des monstres que l’on pourrait penser sortis de chez Jheronimus Bosch (1450-1516). Ce tableau de Brueghel, comme d’autres, inspirent The Sheep Song (Le Chant du mouton). Sheep,pas Lamb. Le rideau se lève sur un groupe, une masse d’une dizaine d’animaux. Plongés dans la pénombre. Leurs sabots martèlent le plancher. Ils sont collés les uns aux autres. Ils sont petits. Peut-être de jeunes agneaux, justement. Derrière eux, on distingue un animal plus grand. Un bélier ? Non. C’est un homme dans un costume troublant par sa vérité. Ce grand mouton possède un visage très beau. Il n’a pas les grands yeux bons et profonds de l’agneau de Gand, mais il y a en lui une tendresse, un abandon qui bouleversent. Un profil noble de penseur. Mais oui ! Le comédien se nomme Jonas Vermeulen. Un jour ce grand mouton aristocratique va vouloir devenir un homme… Il est l’agneau de Dieu devenu adulte. Dieu apparaît, chenu, barbu, échevelé et grotesque, dans un castelet. Des hommes et femme, visage écrasé par un masque, vont et viennent, dansent, courent. Bientôt ils seront les chirurgiens de l’opération de métamorphose. Un être moitié nu manipule une énorme cloche qui surplombe le public. Ne racontons-pas tout. Mais on peut dire qu’il y a beaucoup de sexe, un accouchement, des bocaux, des scènes très dures. Un cauchemar. Une fuite perpétuelle, comme dans un cauchemar, justement, où nous échappe ce que l’on croit pouvoir saisir. On ne sort pas de là indemne. Mais l’ensemble est d’une beauté envoutante. C’est un grand travail. Et si l’on ne comprend pas tout, si tout ce que l’on croit comprendre, se dérobe, on est happé, bousculé, dérangé. Il s’agit bien d’un grand théâtre qui veut la dissolution des différences : règne animal, temporalité, le Moyen Age fond dans le pur présent et nous projette… L’Autre Scène, Vedène, jusqu’au 25 juillet à 15h00. Durée : 1h30. Puis en tournée jusqu’en mai 2022. Relâche le 20. Spectacle sans paroles, avec quelques bouffées d’italien non traduites mais compréhensibles.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 15, 2021 4:57 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 15 juillet 2021 Festival d’Avignon OFF au Théâtre des Gémeaux - Camus Casarès, une géographie amoureuse, d’après la Correspondance Albert Camus et Maria Casarès 1944-1959 (édit. Gallimard), un spectacle de Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio, mise en scène d’Elisabeth Chailloux. Ce texte est une adaptation, destinée à la scène, de la correspondance échangée entre Albert Camus et Maria Casarès entre 1944 et 1959, parue en 2017 aux Éditions Gallimard. L’interprète Jean-Marie Galey – alias Albert Camus – expose ainsi la raison de ce projet dont il est l’instigateur, l’acteur et le comédien inspiré, aux côtés de Teresa Ovidio et Elisabeth Chailloux. Le montage minutieux de cette relation hors-norme est intitulé Camus-Casarès – une géographie amoureuse qui reflète la « carte de Tendre » imaginée au XVIIe siècle, portant, tracée, la carte topographique et allégorique des étapes de la vie amoureuse, selon les Précieuses de l’époque. « Une carte de géographie, avec ses sentiers sinueux, ses impasses, ses vallons paisibles, ses clairières enchantées, ses marécages, ses rudes rochers, ses cols réputés infranchissables… Autant de chemins vers l’extase. Il en est ainsi des grandes rencontres amoureuses. » D’abord, 172 lettres ont été rassemblées sur les quelques 865 que compte cette correspondance. Choix arbitraire mais cohérent qui veille à conserver la vivacité et le mouvement de la partition. Ont été adjoints à cette matière brute des extraits d’interviews, des souvenirs de Maria Casarès, accompagnés de fragments des Carnets II et III d’Albert Camus, écrits dans ces mêmes années. Casarès et Camus se rencontrent le 6 juin 1944 à Paris, jour du débarquement de Normandie. Elle a 21 ans, lui 30. Ils vivent une passion éphémère jusqu’en octobre, moment où l’épouse de Camus, Francine, revient d’Algérie. Casarès met alors fin à leur relation. Le 6 juin 1948, ils se croisent par hasard boulevard Saint Germain, se retrouvent et ne se quitteront plus, jusqu’à la disparition d’Albert Camus dans un accident de voiture, le 4 janvier 1960. Ils auront vécu quinze années dans une passion solidaire, éloignés souvent l’un de l’autre, mais ensemble toujours, partageant les mêmes enthousiasmes, les mêmes tourments, le même regard sur une époque particulièrement agitée où l’un et l’autre se construisent. Camus dans son métier d’écrivain, sa passion pour le théâtre, ses doutes, le travail acharné de l’écriture, malgré la tuberculose. Casarès dans sa carrière de jeune comédienne, déjà riche de quelques grands chefs-d’œuvre cinématographiques comme Les enfants du paradis ou La Chartreuse de Parme, et aussi de son passage éclair à la Comédie française, suivi des années les plus belles du Théâtre National Populaire de Jean Vilar, à la naissance du Festival d’Avignon. Ces échanges amoureux magnifiques, d’une grande richesse lyrique et émotionnelle ont aussi la particularité de révéler un Camus surprenant : tourmenté, instable, fragile, capricieux, au comportement parfois machiste, éloigné de l’écrivain profond et grave que nous connaissons. Les lettres de Casarès sont une révélation. Elles témoignent d’un humour ravageur qui brocarde ses contemporains, auteurs, metteurs en scènes, comédiens, politiques, avec allégresse et sans retenue. Fille de la Galice, elle manifeste de la vitalité, vivant intensément le bonheur et le malheur. La publication de cette correspondance a été rendue possible par Catherine Camus qui prit l’initiative de rencontrer Casarès sur la fin de sa vie dans une chambre d’hôtel où toutes deux partagèrent une tablette de chocolat, et de lui demander les lettres écrites par son père. Cette relation « cachée » fut le tourment et le poison de sa mère, on imagine que ce ne lui fut pas facile. « D’où l’importance du témoignage a posteriori de Casarès, qui nous fait partager ses impressions saisissantes sur leur histoire d’amour, la douleur qu’elle éprouva à la disparition de Camus, le deuil qu’elle ne put jamais faire car privée de tout contact avec la mémoire affective, mais aussi sociale du grand écrivain disparu. Un gouffre dont elle ne se remettra jamais. Ces réflexions insérées par petites touches au fur et à mesure des fluctuations de leur amour, y apportent une humanité poignante, qui renforce encore le sentiment de solitude du personnage privé de l’amour de sa vie, laissé à lui-même, dans une lucidité inquiète qu’accompagne un insondable désarroi. » Albert Camus et Maria Casarès sont les enfants de leur siècle, commente Jean-Marie Galey : il précise ainsi sa démarche qu’il accomplit en compagnie de Teresa Ovidio qui interprète Casarès : « Nous racontons l’histoire de deux êtres qui se sont rencontrés, reconnus et abandonnés l’un à l’autre dans une époque particulièrement agitée qui, au lieu de les désunir, a renforcé la passion qui les unissait. Nous ferons appel à la mémoire vive de ces années-là… archives sonores témoignant du contexte politique et social tourmenté de l’après-guerre, fragments de spectacles dans la cour du Palais des Papes d’Avignon, avec le timbre vocal si particulier de ses interprètes, chansons, traités comme un écho à peine perceptible des remuements d’une époque disparue, mais dont les conséquences prévisibles pèsent encore sur le monde d’aujourd’hui. » Le contexte précis de l’époque est rendu par les effets sonores et la radio, le quotidien des Français de la Seconde Guerre mondiale, de l’après-guerre, de la Guerre d’Algérie, de la naissance du Gaullisme, du communisme, de l’existentialisme, le prix Nobel, le festival d’Avignon… » Un certain nombre de postes TSF sur scène, allant du poste à galène des années 40, au be-bop des caves de Saint Germain des Près, aux gros postes en bakélite des années de la reconstruction, puis des premiers juke-boxes, des premiers transistors… Thomas Gauder assure le son du spectacle, et Franck Thévenon, la lumière. La scénographie se résume à un danse-floor central sur un plateau nu, hormis les quelques radios, un plateau assez vaste pour permettre les rencontres, les étreintes, les courses rapides de nos deux personnages l’un vers l’autre, et la danse pour exprimer les tourments de la passion. Pour l’incarnation des personnages – la direction d’acteurs -, il fallait au duo de comédiens le regard de la metteuse en scène Elisabeth Chailloux, ex-directrice artistique du Théâtre des Quartiers d’Ivry, sensible au lyrisme, à l’émotion, à la qualité littéraire de ces textes magnifiques – acuité et modernité d’un regard sur le théâtre contemporain. Un beau trio d’accomplisse-ment. Catherine Camus s’interroge encore et toujours: « Comment ces deux passants ont-ils pu traverser tant d’années, dans la tension exténuante qu’exige une vie libre et tempérée par le respect des autres, dans laquelle il avait fallu apprendre à s’avancer dans le fil tendu d’un amour dénué de tout orgueil sans se quitter, sans jamais douter l’un de l’autre, avec la même exigence de clarté ? La réponse est dans cette correspondance… Merci à eux deux. Leurs lettres font que la terre est plus vaste, l’espace plus lumineux, l’air plus léger simplement parce qu’ils ont existé ». Un spectacle attachant qui accorde à la passion amoureuse, inscrite dans une même époque d’engagements partagés et de convictions politiques communes, sa dimension universelle. Véronique Hotte Du 7 au 31 juillet 2021 à 19h30, relâche le mardi, au Théâtre des Gémeaux, 10 rue du Vieux-Sextier à Avignon.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 15, 2021 1:16 PM
|
Par Anaïs Héluin dans Sceneweb le 15 juillet 2021 Photo Christophe Raynaud de Lage
Sous la forme d’un rituel mêlant la cuisine au théâtre, la danse à la vidéo, Eva Doumbia interroge dans Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat) les dominations qui se cachent dans nos assiettes. À déguster, à partager, sans modération. C’est par une odeur ronde, généreuse, que l’on est accueilli au Complexe socio-culturel de La Barbière, situé à une poignée de kilomètres des remparts d’Avignon. Derrière des fourneaux aménagés sur une grande table, le chef Alexandre Bella Ola, qui officie d’habitude à la tête de son Bistrot afropéen à Paris, est en poste. Il coupe, il touille, il surveille. Avec le mafé qu’il prépare en direct, il sera l’un des fils rouge d’Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat) d’Eva Doumbia, qui fait sortir le Festival In des remparts pour l’emmener dans les quartiers d’Avignon. Avant même que de pouvoir être goûtée, sa cuisine relie. Installés tout autour d’un espace de jeu carré, les spectateurs sont animés d’un même appétit que l’auteure et metteure en scène va se charger avec ses interprètes de déplacer au fur et à mesure de sa pièce. Une « eucharistie documentaire » dont les nourritures terrestres sont décortiquées par les moyens du théâtre, de la musique (composée et interprétée par Lionel Elian), de la danse et de la vidéo. Pour Eva Doumbia, mêler la cuisine des aliments à celle des mots est une manière parmi d’autres de créer le théâtre hybride qui lui ressemble. Un théâtre où dialoguent les cultures, où se croisent les disciplines dans une joie qui n’est pas sans confrontations, sans luttes. Adaptation des Écrits pour la parole de Léonora Miano, qui popularise en France le terme « afropéenne » personne née en Europe de parents africains ou antillais –, sa pièce Afropéennes (2012) se déroulait dans la salle d’un restaurant où Gagny Sissoko préparait aux comédiennes et au public de quoi se régaler ensemble. De quoi dépasser, ou du moins surmonter, les difficultés quotidiennes rencontrées par les femmes noires et françaises que les personnages de la pièce mettent sur la table. Avec Autophagies, Eva Doumbia mène sa compagnie La Part du Pauvre/Nana Triban plus loin dans l’exploration de la cuisine comme ingrédient dramaturgique. Comme lien entre les sens et la pensée, qui exprime, à la fois, les violences et les dominations au centre du théâtre de la metteure en scène et permet d’aller au-delà, de dessiner des carrefours, des réconciliations. Avec cette nouvelle création, Eva Doumbia poursuit aussi une recherche menée dans une autre de ses créations : le cabaret capillaire Moi et mon cheveu (2011), où les mêmes disciplines que dans Autophagies sont mises au service de l’histoire du cheveu crépu, moins anodine sur le plan politique qu’il y paraît. En maîtresse de cérémonie d’un rituel culinaire qui vise à régler les troubles ou les étrangetés alimentaires des participantes – les comédiennes Olga Mouak et Angelica-Kiyomo Tisseyre et sans doute du public qui, sans avoir à y participer activement, est pleinement immergé dans le dispositif –, la metteure en scène s’implique beaucoup plus personnellement qu’elle ne le faisait dans son cabaret précédent. Son intérêt pour la cuisine, nous apprendra-t-elle au cours du spectacle, vient en effet en partie de son père : arrivé en France en 1963, il fut l’un des premiers à ouvrir en France un restaurant africain. Spécialité : mafé. Parmi les nombreuses histoires politico-culinaires dont regorge Autophagies, il y a celle de ce plat à base d’arachide dont on apprend qu’il n’est pas du tout le plat traditionnel que l’on croit : il n’apparaît que dans les années 1950, lorsque les Grands Moulins de Strasbourg commercialisent la « Dakatine », contraction de Dakar et tartine. La couleur des aliments, nous enseigne ainsi le spectacle d’une manière aussi ludique, inventive, que pédagogique, n’est pas toujours celle que l’on croit. En représentant des aliments liés à son histoire personnelle – Eva partage, par exemple, son passif avec la banane, Olga avec le sucre et Angelica avec le riz –, chaque membre du quatuor féminin assume les clichés qui y sont associés pour mieux les dépasser. Très vite, l’aliment de l’une devient aussi celui de l’autre, à la fois identique et différent. Le riz cuit d’Angelica, qui doit contenir la mémoire de « l’effort accompli par le paysan qui la cultive dans les rizières », n’a en effet pas grand-chose de commun avec le « riz pluvial » africain – « ‘’Masa Doum’’ : ‘’la nourriture des dieux’’ » – qu’évoque Olga, remplacé aujourd’hui par « le bon riz de Thaïlande parfumé au jasmin ou le riz long grain du Vietnam ». Toutes porteuses d’une double, voire d’une triple culture, les quatre artistes naviguent entre les grains et autres nourritures comme elles se promènent parmi les récits de leurs ancêtres et les écritures d’Eva et de l’écrivain ivoirien Armand Gauz : avec un bonheur évident, qui se traduit aussi bien sous forme de témoignages intimes que de paroles plus documentaires. Ou même par de petites chorégraphies qu’accompagne le danseur Bamoussa Diomande, également garçon de cuisine, et donc pont entre la partie cuisine de la scène et sa partie plateau. Tout communique dans Autophagies. Tout communie dans un présent partagé, au goût d’un mafé dont la générosité l’emporte sur les violences dont il est né, sans les effacer. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr Autophagies (histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat)
Texte Eva Doumbia, Armand Gauz
Mise en scène Eva Doumbia
Avec Alexandre Bella Ola, Bamoussa Diomande, Lionel Élian, Angelica-Kiyomi Tisseyre, Olga Mouak
Cuisine Alexandre Bella Ola
Musique Stéphane Babi Aubert
Chorégraphie Massidi Adiatou
Lumière Stéphane Babi Aubert
Scénographie, costumes, accessoires Sylvain Wavrant
Vidéo Sandrine Reisdorffer
Images Charles Ouitin et Lionel Elian
Son Cédric Moglia
Regard extérieur Fabien Aïssa Busetta
Assistanat à la mise en scène et dramaturgie Karima El Kharraze Production La Part du Pauvre/Nana Triban
Coproduction Théâtre du Nord, Théâtre du Point du jour (Lyon)
Avec le soutien de la Drac Normandie, Ville d’Elbeuf, les Grandes Tables (Friche la Belle de Mai – Marseille), Fonds d’insertion pour jeunes artistes dramatiques, Consulat de France à la Nouvelle Orléans, LSU (département Francophonie à Bâton-Rouge, États-Unis), Ambassade de France aux États-Unis, Commission internationale du Théâtre Francophone, FACE fondation
Avec l’aide de Anis Gras-Le Lieu de l’autre (Arcueil), Fundamental Monodrama Festival (Luxembourg), Kumaso (Bamako), N’Soleh (Abidjan), Centre Social de la Savine (Marseille), Ateliers Médicis (Clichy-Montfermeil) Durée : 1h30 Festival d’Avignon 2021
Complexe socio-culturel de La Barbière
du 14 au 20 juillet puis au Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing-Hauts de France et Théâtre du Point du Jour (Lyon) lors de la saison 2022/2023

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2021 9:23 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 7 juillet 2021 Légende photo : Sébastien Benedetto au Théâtre des Carmes, à Avignon, en 2017. THOMAS O'BRIEN Cet été, le nouveau président de l’association du Festival « off » d’Avignon, et fils de son fondateur, a la lourde tâche de relancer l’événement après la crise du Covid-19. Plus de 1 000 spectacles sont déjà annoncés pour cette édition. Sébastien Benedetto ne se serait jamais imaginé à la tête d’un théâtre, et encore moins président de l’association qui coordonne le « off » d’Avignon, ce vaste marché du spectacle vivant. Et pourtant, cet homme calme et discret, musicien de formation, dirige depuis 2009 l’historique théâtre avignonnais des Carmes et, depuis le 11 janvier, l’association Avignon Festival & Compagnies (AF&C). « Ce n’était ni un souhait ni une ambition », résume-t-il. Mais la volonté de rester fidèle à un héritage familial. A chacune de ces nouvelles étapes, ce batteur, qui a débuté sa vie professionnelle comme DJ, a accepté de marcher dans les pas dans son père, André Benedetto. Le nom de cet auteur et metteur en scène de théâtre est indissociable de l’histoire du Festival « off ». Fondateur en 1963 du Théâtre des Carmes, lieu engagé installé au cœur des remparts, c’est lui qui, dans un geste de révolte contre « l’institution », lança, en 1967, l’aventure du « off ». C’est encore lui qui, en 2007, le réorganisera en créant l’AF&C. « Quand mon père est mort brutalement, en 2009, nous avons voulu, avec ma demi-sœur, continuer à faire vivre le Théâtre des Carmes, l’une des cinq scènes permanentes d’Avignon. J’en ai pris seul la direction en 2014. J’ai découvert un métier et je m’y suis épanoui », raconte cet enfant de la balle. Sébastien Benedetto est né et a grandi dans la cité des Papes, baigné dans le milieu du théâtre. En mémoire de son père et de son « esprit d’engagement », il a repris le flambeau en conservant l’âme du lieu : un théâtre politique, axé sur le texte, et un accueil respectueux des artistes. Aux Carmes, pas de location à prix d’or, mais que des coproductions ou des coréalisations, essentiellement de créations contemporaines. Cet été, Sébastien Benedetto codirigera la lecture de La Vie des bord(e)s, de Sandrine Roche, dans le cadre du nouveau cycle Le Souffle d’Avignon. Il programmera aussi une journée d’hommage aux textes de son père. Du courage ou de la folie Cet été, surtout, signera la relance d’un « off » mis en l’arrêt en 2020 par la crise du Covid-19. Il y a quelques mois, le producteur Pierre Beffeyte, démissionnaire de la présidence d’AF&C, a proposé à Sébastien Benedetto, 41 ans, de prendre sa relève. Le directeur des Carmes a été élu sans difficulté à la tête de l’association. « J’y suis allé un peu tête baissée, là encore par héritage et aussi pour continuer le travail de professionnalisation du Festival initié par Pierre. Cela me tient à cœur que ce rendez-vous soit plus respectueux vis-à-vis des artistes et plus vertueux dans son fonctionnement », défend le nouveau président. « C’est la bonne personne au bon moment, il a une vraie légitimité », considère Pierre Beffeyte. « Est-ce du courage ou de la folie de sa part d’y être allé ? Je ne sais pas. Il est plein de bonnes intentions mais son champ d’action reste limité », constate Julien Gelas, directeur du théâtre avignonnais du Chêne noir. Depuis son élection, en plein confinement, dans une ville sonnée par l’annulation du festival en 2020, Sébastien Benedetto s’est accroché à l’idée de « faire à tout prix une édition 2021, même en mode dégradé ». Il se souvient de « l’angoisse vécue par les compagnies et les lieux du “off” » face à la mise à l’arrêt du spectacle vivant. Mais aussi du quotidien professionnel vécu par sa femme, infirmière aux urgences. « Cela m’a permis de relativiser », confie-t-il. Il a découvert en formation accélérée les réunions institutionnelles, avec la préfecture, les collectivités locales, le ministère de la culture, pour parler protocole sanitaire et finances. « Mais je ne suis pas du genre à taper du poing sur la table », reconnaît cet homme mesuré et souriant. « Il est d’une affabilité rare dans notre milieu », témoigne Alain Timár, directeur du Théâtre des Halles, à Avignon. Si son indépendance et son ouverture d’esprit sont saluées, sa presque timidité et son manque de sens politique font craindre à certains qu’il ne se laisse déborder par les différents courants qui s’affrontent au sein de ce Festival devenu tentaculaire. Entre les « libéraux » qui se satisfont de ce marché privé du spectacle vivant, les tenants d’une « régulation » qui plaident pour un système plus collectif et les partisans, notamment au sein des scènes permanentes, d’une « troisième voie » entre le « in » et le « off » pour sauver l’identité artistique du rendez-vous, Sébastien Benedetto va devoir faire preuve de beaucoup de flegme et de pédagogie. Un Festival plus « solidaire » « Chacun a sa légitimité, j’essaie d’être le plus à l’écoute possible. » Lui plaide pour un Festival plus « solidaire », pour des pratiques plus « vertueuses » des lieux à l’égard des conditions d’accueil des compagnies et pour le développement de résidences d’artistes tout au long de l’année. « Il faut mettre un curseur dans les pratiques », reconnaît-il. Mais « je défendrai toujours la diversité, qui est au cœur de notre identité. Nous ne sommes pas à l’endroit de la régulation artistique, sinon ce ne serait plus un “off” », ajoute-t-il d’une voix douce. Contre toute attente, au regard de l’incertitude qui a longtemps plané sur la tenue d’une édition 2021, plus de 1 000 spectacles sont annoncés cet été dans la cité des Papes. Certes, c’est moins qu’en 2019, mais ce chiffre reste impressionnant. Comment rendre le « off » plus « raisonnable » en termes d’offre, comment éviter qu’il ne soit un gouffre financier pour certaines compagnies ? Ces questions se posent depuis plusieurs années. Le « off » ne cesse de vouloir se réinventer, sans y parvenir. « On tourne en rond, reconnaît Sébastien Benedetto. Avant de mourir, mon père commençait déjà à s’interroger sur ce foisonnement. Aujourd’hui, on est tous un peu dépassés par cette inflation. » Le seul aspect positif de la crise du Covid aura été d’accélérer les échanges entre le ministère de la culture et les responsables du « off » . Alors que ce Festival est devenu incontournable pour la visibilité des compagnies et la diffusion de leurs spectacles, la Rue de Valois s’était, jusqu’à présent, accommodée de la jungle avignonnaise. Y aura-t-il un « monde d’après » pour le « off » ? « Le ministère a fait un pas vers nous. La direction générale de la création artistique a reconnu que notre Festival était capital pour le spectacle vivant », constate Sébastien Benedetto. « Rien ne pourra changer sans le soutien du ministère, prévient-il. Néanmoins, nous sommes sur une ligne de crête. Il ne faut pas se refermer mais entraîner davantage de lieux dans des pratiques irréprochables. » Pour l’instant, il jure ne « pas regretter » de s’être lancé dans cette aventure. Du 7 au 31 juillet, le Festival « off » d’Avignon accueillera 1 070 spectacles. Tout le programme est disponible sur Festivaloffavignon.com Sandrine Blanchard

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2021 5:52 AM
|
Par Yves Kafka dans la Revue du spectacle - 7 juillet 2021 Photo : Nikolaus et Denis Lavant, © Nigentz Gumuschian. Ces deux-là empruntent à leurs acteurs porte-voix le diminutif de leurs prénoms… à moins que ce ne soit l'inverse, tant ici la consanguinité entre les personnages et les comédiens censés les faire vivre est criante. Niko (alias Nikolaus Holz, fabuleux), fébrile serveur de café pétri d'impératifs moraux introjectés, et Dan (alias Denis Lavant, libertaire explosif), incarnation d'un Christ débauché chargé de la rédemption des vices cachés des établis, vont se livrer cash à un jeu monumental. Leur rencontre improbable dans ce bar de nulle part, convoquera toutes les ressources de "l'art vivant" pour tenter de ressusciter notre part d'humanité manquante. La première représentation a élu refuge sous le préau d'un collège populaire situé à l'extérieur des remparts comme, si pour aller à la rencontre de son public, il allait de soi de s'affranchir des barrières de l'entre-soi de l'intra-muros. Un "estanco" (bar en argot) fait de bric et de broc accueille le public disposé sur trois de ses flancs. S'entasse là une cargaison de chaises et tabourets juchés sur un chariot branlant. Un vieux piano flanque le bar ringardisé à souhait par un trophée tête de cerf affublé d'une couronne des rois et d'une pancarte "passage interdit". Le décor planté, la messe iconoclaste va pouvoir être dite.
Les clowns comme les bouffons du roi sont dotés de ce pouvoir extraterrestre de révéler à la société bien-pensante les monstruosités qu'elle tente de dissimuler sous le manteau prêt-à-porter des convenances d'usage. Surgi d'une couverture informe comme un diable de sa boîte, le premier à nous déloger de notre zone de confort frappe avec vigueur sur les touches du piano tout en laissant échapper le flux d'écholalies qui le traverse. Se faisant l'écho irrépressible des injonctions sociétales l'assignant à sa place de serveur, il n'a de cesse de les répéter convulsivement et - afin de ne pas commettre le crime d'oubli - des post-it innombrables sont là pour les lui rappeler : "un très bon serveur doit être irréprochable…".
Quand le second vêtu d'un manteau noir trainant derrière lui une kyrielle de grelots et précédé d'une grosse caisse en bandoulière fera son entrée fracassante, le serveur, délogé du territoire sans âme où sa vie s'est retirée, en éprouvera une gêne apocalyptique. S'ensuivra une série d'évitements et de rencontres fortuites autour des prouesses acrobatiques du circassien redoublées par les pitreries musicales du philosophe en colère éructant ses invectives contre une société ayant fait de lui le monstre rédempteur de sa propre ignominie (la scène se passe à Hamelin, faut-il le préciser, et lui aussi joue de la flûte avec tout ce qui lui tombe sous la main, pierres, coquillages dans lesquels il s'époumone pour leur faire rendre le son parfait…). Et comme "toute chose court inévitablement vers sa chute", les cascades en série se précipitent. Jets de verres, boules en lévitation, chaises catapultées, chariot fou, mât chinois improvisé, la folie bat son plein sur un plateau transformé en aire de jeu… de massacres. De ce "dé-lire" d'une communauté gangrénée par ses démons inavoués, ressortent deux êtres qui, après s'être opposés (victimes du même traumatisme, l'un recherchait sa survie dans l'oubli névrotique, l'autre son viatique dans la révolte à fleur de peau) vont se "con-fondre" l'un dans l'autre échangeant jusqu'aux trainées noire et blanche qui barraient leur tenue.
Spectacle de saltimbanques - aux visages illuminés de couleurs vives et aux tenues abracadabrantesques - destiné à migrer au cours du Festival dans pas moins de seize lieux atypiques, ce numéro tragi-comique de deux exclus apparemment aux antipodes rivalise de folies salutaires. Tels l'Auguste et le clown blanc (sauf que là ce sont deux augustes compères), les failles de l'un et de l'autre s'étayent pour les confondre dans la même quête insensée : retrouver un lien avec une humanité disqualifiée pour avoir fauté grave, avoir accepté les yeux fermés le sacrifice programmé de ses enfants…
La colère poétique sert de carburant à la vérité en marche. Son acidité corrosive met à nu l'hypocrisie crasse des paroles mielleuses des établis macérant dans leurs turpitudes de nantis. "En regardant les adultes je ne vois qu'un ossuaire, un charnier", éructera l'homme-orchestre, aussi n'est-il pas si surprenant de voir in fine deux rats, eux bien vivants, prendre le dessus sur cette humanité en voie d'obsolescence programmée. On pense alors à la petite souris de "L'écume des jours" de Boris Vian qui, elle aussi, aimait danser dans la lumière, s'échappant à la dernière seconde de la maison qui s'écroule…
Virtuosités circassiennes de haut vol, virtuosités interprétatives époustouflantes, profondeurs des propos enchâssés dans une langue poétique ciselée, mise en jeu étourdissante de libertés sans frontières, c'est à une "fête des sens" que nous sommes conviés ce soir. Un spectacle total nous transportant sur les chemins d'une joie insoupçonnée : celle d'aller à nouveau à la rencontre du vivant, frappant aux portes de nos existences à recolorer de toute urgence.
Vu le 6 juillet au Collège Anselme Mathieu d'Avignon.
"Mister Tambourine Man" Création IN. Texte : Eugène Durif. Mise en scène : Karelle Prugnaud. Avec : Nikolaus Holz, Denis Lavant. collaboration artistique, Nikolaus Holz. scénographie, Éric Benoit, Emmanuel Pestre. lumière, Emmanuel Pestre. création sonore, Guillaume Mika. conseil musical, Pierre-Jules Billon. costumes, Antonin Boyot-Gellibert. Durée : 1 h 20. •Avignon In 2021•Du 6 au 24 juillet 2021.À 20 h, relâche les 11 et 18 juillet. Spectacle en itinérance :6 juillet : Collège Anselme Mathieu, Avignon. 7 juillet : Espace Baron de Chabert, Barbentane. 8 juillet : Centre départemental, Rasteau. 9 juillet : La Cigalière, Bollène. 10 juillet : L'Alpilium, Saint-Rémy-de-Provence. 13 juillet : Salle des fêtes Roger Orlando, Caumont-sur-Durance. 14 juillet : Arènes Robert Garlando, Roquemaure. 15 juillet : Salle de L'Arbousière, Châteauneuf-de-Gadagne. 16 juillet : Parc Chico Mendes, Avignon (en entrée libre). 17 juillet : Salle des fêtes La Pastourelle, Saint-Saturnin-lès-Avignon. 19 juillet : Cour du Château, Aramon. 20 juillet : Cour du Château, Vacqueyras. 21 juillet : Complexe sportif Jean Galia, Rochefort-du-Gard. 22 juillet : Salle polyvalente, Saze. 23 juillet : Salle polyvalente, Courthézon. 24 juillet : Pôle culturel Camille Claudel, Sorgues. >> festival-avignon.comRéservations : 04 90 14 14 14 .

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2021 9:58 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 5 juillet 2021 Photo : Christophe Raynaud de Lage Dans "Le cabaret des absents" , l’auteur et metteur en scène François Cervantes installé à Marseille raconte et imagine par petits bouts des fragments de vie que son bon plaisir et le destin ont fait que ces vie se sont retrouvées un jour sur la scène ou dans la salle du théâtre du Gymnase. Une succession de numéros, d’entrées et de sorties, de l’enfant Tagada au clown Arletti. Mais comment s'appelait la jeune femme (caissière ? Ouvreuse ? Administratrice ? Directrice?) qui , un soir de 1897, alors qu’un couple d’étrangers s‘était abrité de l’orage au haut des marches du théâtre, le fit entrer pour se réchauffer en assistant au spectacle ? Ce couple devait sembler un peu perdu. L’homme et la femme venaient de Russie, des exilés volontaires, ayant sans doute embarqué à Odessa sur un navire qui les emmènerait aux États-Unis . Le navire avait dû s'arrêter à Marseille pour réparer quelque avarie. Ce soir-là, ils se réchauffèrent en voyant La dame aux Camélias. Après le spectacle, revenus dans leur cabine sur le navire, ils firent l’amour. Neuf mois plus tard sur le sol américain naquit un enfant, un garçon que le couple prénomma Armand en souvenir de cette soirée mémorable. Presque qu’un siècle plus tard, Armand Hammer, raconte cette histoire à Gaston Defferre le maire de Marseille de l'époque . L’ Américain mérite quelque considération, il est milliardaire et veut construire un site pétrolier dans la région. Et puis, il fait part à "Gaston" d' une demande un peu particulièr: il veut visiter un théâtre , mais pas n’importe lequel, le Gymnase. Gêne des autorités. On lui propose un autre théâtre, il insiste. Devenu trop vétuste, le théâtre du Gymnase est fermé depuis quelques années et l’argent manque pour les travaux de rénovation. On entrouvre le théâtre pour monsieur Hammer. Forte a dû être l’ émotion de cet homme seul dans le théâtre. A peine sorti, peut-être à l’endroit même où ses parents s’étaient réfugiés pendant l’orage, sa décision est prise : il financera la rénovation complète du théâtre. Et c’est ainsi que le théâtre du Gymnase reprit vie. Armand Hammer avait aussi émis un autre : que le théâtre soit ouvert tous les soirs, et que tous le soirs, orage ou pas, on puisse y entrer pour trouver un peu de chaleur, à boire et à manger. Le soir de sa réouverture était à l’affiche une mise en scène de La dame aux camélias. Cette histoire, c’est la seule que raconte d’un seul tenant le spectacle Le cabaret des absents écrit et mis en scène par François Cervantès. Tout le reste, c’est à dire presque tout, est fait de bribes, de moments d’histoires, il arrivera à leurs fils de se croiser. Tôt ou tard, les personnages de ces multiples histoires se retrouvent au théâtre, non dans la salle, mais sur la scène. Ce couplequi a gagné un repas gratuit et dîne devant les spectateurs, et dont la femme fourre les restes du dîner dans son sac à mains, ce travelo qui chante sa vie sur l’air de « J’habite seul avec maman » d'Aznavour, ce numéro où un prestidigitateur refait le monde avec trois bouts de ficelle Autant de moments ausssi craquants que charmants. Il faudrait tout citer. Il y a un nain, une géante, une fermière qui vient vendre ses œufs en ville et prend un petit noir au comptoir d’un café où un homme, à chaque fois, lui propose d’aller au théâtre mais elle a trop à faire . En face, au théâtre, il y a Tagada, l’enfant Tagada, il y est tout le temps fourré, c’est là qu’il grandit, c’est ce qu’on nous raconte. Quand les acteurs et les actrices ne chantent pas, quand ils ne dansent pas avec des plumes ou quand ils ne dînent pas , ils ne font que ça, raconter. Ça n’arrête pas. On passe d’un début d’histoire à une autre, parfois elles reviennent, se croisent, font un bout de chemin ensemble. Elles ressemblent aux oiseaux qui habiter le théâtre et qui , bientôt, vont nous offrir un ballet enchanteur. Ça pépie, ça part et ça revient, ça entre et ça sort. Cela rappelle les attractions d’antan auxquelles Federico Fellini et Alberto Lattuada ont rendu hommage dans leur film Luci del Varieta. François Cervantès qui voue sa vie au théâtre n’a de cesse de parler de ceux qui sont dans la salle et plus encore de ceux qui n’osent pas venir ou ne songent pas à entrer. Et les voici sur scène comme Clothilde, le jeune homme qji saigne, le chauffeur de taxi , le vieux couple, l’homme qui écrit dans le café. . « Je fais quoi dans cette histoire ? » demande l’une . « On verra » répond l’autre. L’histoire commence, sans commencement ni fin. Le cabaret des absents distille ainsi un charme continuel, avec juste ce qu’il faut de pincement à cause de la fragilité de tout Aucun spectacle de François Cervantès ressemble à un autre. Rien de commun factuellement entre Le rouge éternel des coquelicots (lire ici) , Face à Médée (lire ici) ou Prison-Possession (lire ici) par exemple , mais tous débordent d’humanité et respirent l’air du temps qui passe à pleins poumons pour mieux saisir le théâtre dans son éternelle jouvence. Il arrive que d’un spectacle à l’autre on se fasse des signes. C’est le cas entre L’épopée du Grand nord ( entendez les quartiers nord de Marseille, spectacle créé au Merlan avec Catherine Germain, complice de longue date, et une trentaine d’amateurs du quartier, lire ici) et Le cabaret des absents , créée lui au centre de Marseille, au théâtre du Gymnase. « Dans les quartiers Nord il y a des personnages sans histoires, des paysans sans terre, des Chinois sans Chine, des marins sans bateaux, des citoyens sans papiers... » On retrouve cela dans Le cabaret des absents tout comme l’histoire de l’homme qui monte son cheval jusqu’à son appartement. Comme un jeu d’échos et d’amicaux clins d’yeux. Au Conservatoire National supérieur d’Art Dramatique de Paris, mettant en scène les élèves sortants, François Cervantès avait signé Claire, Anton et eux , un bijou qui devait ensuite aller au Festival d’Avignon 2017. Théo Chédevile, Louise Chevillotte, Sipan Mouradian et Selin Zahrani faisaient partie de la distribution. François Cervantès les a choisis pour jouer dans Le cabaret des absents.Ils sont bien entourés. D’un côté par Emmanuel Dariès, co-fondateur du Cirque Désacordé, magicien, illusionniste (son clown Octo figurait dans Carnages,un spectacle de Cervantes en 2013). De l’autre par, l’irremplaçable Catherine Germain, qui travaille avec Cervantès depuis qu’il a créé sa compagnie l’Entreprise en 1986. C’est à ses côtés qu’elle a inventé son clown, Arletti lequel, ô bonheur, vient faire un tour de piste , et quel tour, dans Le cabaret des absents. Que demande le peuple devant tant d’amicales merveilles portées par les acteurs vifs et avides ?. Que Le cabaret des absents retrouve ceux qui l’ont nourri. Spectacle vu en janvier au Théâtre du Gymnase à Marseille devant un public restreint de professionnels et journalistes. le spectacle devait y être à l’affiche au Théâtre de Grasse, au Carré de Château-Gontier, au théâtre Edwige Feuillère à Vesoul, à la MC2 de Grenoble, à la Scène nationale de Cavaillon. Autant de représentations annulées. Du 7 au 29 juillet Le cabaret des absents se donne à22h30 au Onze, l’un des bons lieux du off avignonnais.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2021 8:47 AM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 6 juillet 2021 Légende photo Adama Diop, implacable dans le rôle de Lopakhine. (Christophe Raynaud de Lage/Festival d'Avignon) Dans la cour d’honneur, Tiago Rodrigues déçoit avec une mise en scène curieusement classique du texte de Tchekhov. Avignon, Jour 2, gueule de bois. Le visage froissé comme du papier mâché, le sang qui tambourine dans les tempes, et la sensation désagréable de s’être trompé de lit. On l’aimait d’un amour ardent, pourtant, lundi midi, lorsque la ministre de la Culture a confirmé que l’artiste programmé cette année en ouverture du Festival avec un Tchekhov serait bientôt l’artisan d’un nouveau monde en qualité de prochain directeur de la manifestation. Bien avant cela, déjà, Tiago Rodrigues a souvent ravi notre cœur en tant qu’auteur et metteur en scène. Une fois, la première, il l’avait même empoigné à pleine main et l’avait extrait, sanguinolent, de notre thorax pour le brandir à bout de bras vers les cieux sacrés de la poésie. C’était ici même en 2015 avec une réécriture aberrante d’Antoine et Cléopâtre, du Shakespeare en quasi spoken word qui faisait de l’amour indéfectible une histoire de pur tempo. Torrent de larmes dès la quatrième minute du spectacle, mais aussi à la vingtième et à la soixantième. Brutes de jeu Depuis, on a tout vu, tout lu, tout écouté de lui. Que s’est-il passé lundi soir alors, dans la cour d’honneur du palais des Papes, cet hôtel 5 étoiles grand luxe du théâtre censé être l’écrin d’une nuit de noces ? Que s’est-il passé pour que l’on mesure, mortifiée, l’indifférence ressentie devant sa Cerisaie ? Celui qui panique de ne plus aimer liste souvent tous les points positifs, comme si la magie était un agrégat de bonnes cases à cocher. Mais si, allez, les acteurs sont formidables ! Isabelle Huppert, magistrale, avec sa frivolité au bord du gouffre pour interpréter Lioubov, cette «tragique prisonnière d’un monde disparu», «agent du changement autant qu’elle en est la victime» (selon les très beaux mots de Rodrigues) ! Adama Diop, implacable dans le rôle de Lopakhine, déployant dans l’espace évidé de la cour sa vengeance de classe après le rachat du domaine ! Et regardez l’envergure de Grégoire Monsaingeon et de David Geselson – quelles brutes de jeu, non ? Tiago Rodrigues a trop voulu expérimenter Il y a aussi toutes ces métaphores que Tiago Rodrigues sait glisser sans trop les appuyer : la cerisaie, la maison de l’enfance, du passé, cet édifice majestueux d’antan qu’on se refuse de vendre, n’est-ce pas quelque part la cour d’honneur du palais des Papes ? La «comédie» de Tchekhov parle de la force inexorable du changement, de l’incertitude de l’avenir, de la nécessité de solder les comptes, et ne parlerait-elle pas aussi, en ces lieux, du rêve de permanence du théâtre, et de l’injonction qui lui est aujourd’hui faite de s’adapter aux préceptes d’un monde nouveau ? C’est vrai, il y a souvent de la beauté et du panache dans le déni – comme lorsque Isabelle Huppert s’écrie «les datchas, les estivants, c’est d’un vulgaire !» Mais il faut en convenir : voici exactement où en est notre cœur lorsqu’on entend la fille de Lioubov prononcer sur le grand plateau : «Que s’est-il passé ? Je l’aimais si fort. Il me semblait qu’il n’y avait pas d’endroit plus beau que notre cerisaie !» Il s’est passé, sans doute, que Tiago Rodrigues a trop voulu expérimenter. La plupart du temps, le chemin est le suivant : pour un metteur en scène académique, prendre des risques, ça veut dire s’éloigner des conventions. Ici, c’est le chemin inverse. Habituellement auteur de formidables réécritures et de montages de textes, metteur en scène laborantin, il choisit pour la première fois un classique sans rien toucher à la partition. On ne retrouvera donc pas sa façon de tricoter les mots entre récit et incarnation, mais pas non plus son art de flouter les frontières entre acteurs, narrateurs et personnages. A la place, une mise en scène de bon goût, réaliste mais avec ce qu’il faut d’ingrédients scénographiques évocateurs à interpréter (les rails pour figurer la salle de bal, les chaises de jardin vides qui disent la fin d’un monde), une pièce un peu interchangeable, calibrée pour une certaine conception de ce que doit être la grande pièce élégante de la cour d’honneur d’Avignon, là où les précédentes œuvres de Tiago Rodrigues – Antoine et Cléopâtre mais aussi By Heart, Sopro, Bovary – ne ressemblaient qu’à lui. On ne s’y attendait pas, à cette sensation mélancolique, celle du devoir conjugal accompli.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2021 6:53 AM
|
Propos recueillis par Anne Diatkine - Libération du 5 juillet 2021 Acteurs, metteurs en scène, régisseur… Rencontre avec des professionnels primo-invités au Festival ou débarquant avec une nouvelle casquette. «Jeune acteur, j’ai visité la cour d’honneur avec mes parents. Mon père achète la médaille de la cour. Il me la tend : «Tu me la rendras le jour où tu y joueras.» Il faut que je la retrouve, je ne sais pas du tout ce que j’en ai fait ! C’est ma première fois dans le in d’Avignon et a fortiori dans la cour d’honneur. Ce qui est merveilleux, c’est d’y être invité par un metteur en scène que j’aime et admire, que cela poursuivre notre travail. C’est très réjouissant. En tant que spectateur, j’y ai raté beaucoup de spectacles faute de trouver une place. Mais j’ai un souvenir extraordinaire du Platonov qu’avait monté Eric Lacascade. Ce soir-là, il pleuvait des trombes d’eau, qui occasionnaient de très longues coupures techniques si bien que 1 500 spectateurs se sont barrés. On devenait un tout petit groupe qui se rapprochait du plateau au fur et à mesure. A 3 heures du matin, au moment des applaudissements, il ne devait rester que 400 personnes, transies et trempées, sous des couvertures inondées. L’expérience était tellement folle que je n’ai pas eu envie de revoir le spectacle en salle. La cour d’honneur est impitoyable. On n’y pardonne rien. On y a joué tant de spectacles qui ont marqué l’histoire du théâtre qu’on demande toujours aux acteurs d’y faire date. Nous, on a juste une joie folle à défendre le texte d’un immense auteur.» A.D. Photo © Christophe Raynaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2021 4:24 AM
|
par Anne Diatkine Témoignages
Festival d’Avignon : leur toute première fois Metteuse en scène, autrice de Ceux-qui-vont-contre-le-vent : «C’est comme une sortie magnifique d’un long tunnel» (Photo C. Bellaiche) «On a vécu tellement de frustrations, d’empêchements, d’annulations depuis mars 2020 que rejouer pour la première fois dans le in où on ne s’est jamais produit, survient comme une sortie magnifique d’un long tunnel. On voit soudainement de la lumière. Les répétitions sont encore plus intenses que d’habitude. Le plus difficile, en dehors des dates annulées, a été la dissolution des liens au sein de la compagnie. On n’a pas pu répéter pendant le premier confinement parce que personne ne le pouvait, et pas plus durant le deuxième car les lieux étaient déjà pris ou fermés. J’espère que les grandes retrouvailles avec le public vont agir comme un catalyseur. Longtemps avant la pandémie, mon travail parlait déjà de l’empêchement, du manque, de l’absence. Aujourd’hui, ces thèmes se frottent à l’actualité, et il y a un risque qu’on perçoive tous les spectacles à Avignon sous ce prisme. Plusieurs sujets peuvent être abordés, travaillés pendant les répétitions. Comme les mots n’interviennent pas beaucoup dans mon travail et que je procède de manière très organique ou physique, je n’ai pas immédiatement conscience des thèmes qui passent au plateau. La création de Ceux-qui-vont-contre-le-vent a été faite sur onze semaines étalées sur plus d’un an. On a commencé à répéter le spectacle en février 2020 et aujourd’hui, à quelques jours de la première, on ne l’a pas terminé mais on est très confiants. La compagnie est nomade, en résidence un peu partout en France entre Strasbourg, Saint-Nazaire, Angers et Clermont-Ferrand. Traverser autant de paysages m’inspire. «J’étais allée à Avignon dans le off en 2003, et on n’avait pas joué, c’était l’année de l’annulation de tous les spectacles pour défendre le régime de l’intermittence. Au sein de l’équipe, cela avait provoqué un cataclysme relationnel, affectif, et notre groupe n’avait pas résisté à la crise. Je suis très heureuse qu’on joue au cloître des Carmes, en extérieur. Comme je ne viens pas du théâtre, je ne sacralise pas les salles. Ce qui me touche, ce sont tous les artistes qui sont passés sur ses planches. Bien sûr que cela m’importe d’être dans le in et qu’il soit un festival international. Pour une compagnie qui produit une forme hybride, où le texte n’est pas mis en avant, c’est une chance formidable de pouvoir être vu par des programmateurs de tous les pays. A Avignon, j’ai adoré découvrir Inferno de Romeo Castellucci mais aussi Un ennemi du peuple qu’avait mis en scène Thomas Ostermeier.» A.D

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2021 3:43 AM
|
par Ève Beauvallet, publié dans Libération le 5 juillet 2021 Guide de survie dans les méandres du in et du off.
Légende photo : Pierre Mifsud présente un travail archéologique sur le vélomoteur et le téléphone à cadran dans "la Collection". (© Anouk Schneider)
La programmation du Festival in est cette année la plus palpitante – ou disons la moins lénifiante – de l’ère Olivier Py. Chouette ! Enfin pas pour vous, lecteurs, puisque la quasi-totalité des spectacles sont déjà complets. Heureusement, Libé est toujours là pour vous guider vers les programmations parallèles du in et enclaves engagées du off où il fera bon de flâner sans s’entretuer pour obtenir un billet.
Le programme de la Sélection suisse C’est pour nous la plus alléchante sélection parallèle, en tout cas depuis que la petite délégation helvète est chaque année constituée par Laurence Perez, de l’ancienne équipe du Festival période Archambault-Baudriller, programmatrice qui nourrit une passion visible pour les laborantins bien crétins et les petites formes expérimentales joyeuses. A moins que ce ne soit la Suisse qui, moins engoncée dans une culture déclamatoire qu’en France, produise de toute façon à la pelle des artistes aussi malins que François Gremaud (il a explosé en France grâce à cette sélection suisse, avec son Phèdre ! ou ses Conférences de choses), ou son copain Pierre Mifsud, qui présente cette année un travail archéologique sur le vélomoteur et le téléphone à cadran dans la Collection. Leur compatriote bien siphonné, Foofwa d’Imobilité, ancien interprète de Cunningham qui virevolte depuis des années dans le milieu de la danse comme une planète à part, revient dans Retroperspectives sur les cinq années qu’il a passées à développer ses «marathons dansés» de par le monde. Du 7 au 26 juillet www.selectionsuisse.ch --- Le programme de la Belle Scène Saint-Denis Les programmateurs internationaux de danse se ruent généralement le matin dans cet îlot verduré qu’est la Parenthèse, fief de la jolie programmation de pièces courtes (de vingt à trente minutes) proposée chaque année par le théâtre Louis-Aragon de Tremblay-en-France. Pour découvrir cette année la figure montante du hip-hop Mellina Boubetra, le nouveau duo du passionné d’histoire de l’art Herman Diephuis ou les énormes baigneurs du tandem de plasticiens chorégraphes Clédat & Petitpierre. Du 7 au 16 juillet labellescenesaintdenis.com --- Thomas Hirschhorn fête l’anniversaire de son Deleuze monument En 2000, Avignon est capitale européenne de la culture. Thomas Hirschhorn est invité à créer une œuvre pour l’exposition «la Beauté» au palais des Papes, auprès de Bill Viola et Jeff Koons, notamment. Dans une ville où 90 000 habitants en périphérie ne seront pas concernés par cette expo, Hirschhorn leur propose avec le budget alloué de créer une œuvre en périphérie avec les habitants de Champfleury, le «Deleuze Monument». Une expérience qui restera fondatrice de son parcours en art urbain, et dont il fête l’anniversaire avec une expo exceptionnelle sur 160m2, dans les locaux associatifs partagés par le très bon théâtre la Manufacture à Saint-Chamand, et montée avec les étudiants de l’Ecole d’art. Jusqu’au 30 septembre au Pôle associatif culturel de Saint-Chamand lamanufacture.org --- Théo Mercier à la Collection Lambert Dans Radio Vinci Park, Théo Mercier explorait déjà la poésie des mondes «du dessous», en créant dans un parking souterrain une corrida-cul entre François Chaignaud et une moto. Avec «Outremonde», il choisit une fois encore les sous-sols, en investissant ceux de la Collection Lambert pour une exposition à lire en miroir d’un spectacle – malheureusement déjà complet – présenté dans le in. On nous annonce un «bunker survivaliste», un «paysage de sable» poursuivant les préoccupations plastiques des dernières œuvres du plasticien, celles des équilibres précaires, des rapports de forces impossibles entre objets et effondrement. Jusqu’au 26 septembre à la Collection Lambert collectionlambert.com
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 19, 2021 2:16 PM
|
Par Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) dans le Monde le 19 juillet 2021 « Une femme en pièces », de Kata Wéber, mise en scène par Kornel Mundruczo au Festival d’Avignon, en juillet 2021. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE La « Femme en pièces » du metteur en scène hongrois, objet hybride, boursouflé mais non dénué de talent, secoue et divise le public festivalier. Choc ou pas choc ? On met la question sur le ring, à propos d’Une femme en pièces, version remastérisée théâtre du film du même nom, présentée à Avignon par le cinéaste hongrois Kornel Mundruczo. A ma gauche, un public qui, dans sa grande majorité, a acclamé le spectacle lors de la première avignonnaise, samedi 17 juillet. A ma droite, quelques critiques, dont nous sommes, qui sont restés dubitatifs devant cet objet hybride, boursouflé mais non dénué de talent. Pourquoi Kornel Mundruczo a-t-il souhaité adapter au théâtre, avec des acteurs polonais, son dernier film, qui aurait dû sortir au temps du Covid-19 et qui a fini par être diffusé sur Netflix en janvier ? Peut-être simplement parce qu’Une femme en pièces est, à l’origine, une pièce, écrite par Kata Wéber. Mais le rapport entre cinéma et théâtre est au cœur des questions que pose cette création. D’abord parce qu’il s’agit d’une forme mixte cinéma-théâtre, comme on en voit désormais beaucoup sur les plateaux. Les spectateurs qui ont vu le film savent que l’histoire commence avec une longue scène d’accouchement, qui se solde par un bébé mort-né. Kornel Mundruczo a souhaité représenter cette scène de manière réaliste, ce qui est évidemment impossible au théâtre. Il choisit donc de la filmer, en un long plan-séquence de vingt-sept minutes, tourné en live tous les soirs derrière la façade du décor, sur laquelle le film est projeté en direct. Jusque-là, tout va bien. On assiste à une séance de cinéma d’où le théâtre est absent, mais la performance est d’une intensité indéniable, voire insoutenable pour certains spectateurs. Après, tout se gâte. Le théâtre entre en scène, un théâtre familial lourdement réaliste et daté, qui se dévoile après que les façades du décor ont été – laborieusement – démontées en direct. Actrice absolument magnifique On est six mois après le drame et Maja, la jeune femme qui a perdu son bébé, se retrouve confrontée aux membres de sa famille. Sa mère, notamment, s’est mis en tête que sa fille devait traduire en justice la sage-femme qui a mené son accouchement à domicile. Ce que Maja refuse, catégoriquement. Le plus beau, dans Une femme en pièces, c’est ce personnage de jeune mère qui choisit de vivre son chagrin comme elle l’entend, sans le nier ni le contourner, ni le mettre en scène selon les convenances. Le deuil lui appartient, qu’elle ne veut rentabiliser d’aucune sorte. Le dialogue entre cinéma et théâtre apparaît ici bien manichéen L’actrice qui joue cette jeune femme est absolument magnifique. Justyna Wasilewska, avec sa grâce et sa force intérieure, porte le spectacle. Mais son jeu tranche avec celui de la plupart de ses camarades, qui ont tendance à en faire des tonnes dans le style Actors Studio. Quant au dialogue entre cinéma et théâtre, il apparaît ici bien manichéen, au regard des formes sophistiquées qui se sont développées ces dernières années, avec des metteurs en scène comme Frank Castorf, Christiane Jatahy, Cyril Teste ou Ivo van Hove. Kornel Mundruczo a un talent certain pour porter l’émotion jusqu’à son paroxysme, y compris à coups de procédés un peu éculés (musique dramatique, etc.), mais il donne l’impression d’un artiste qui se cherche, entre un désir de radicalité et les restes d’académisme d’un théâtre bourgeois et sans mystère. Le bon vieux théâtre, qui est l’endroit par excellence de la tragédie familiale depuis plus de deux mille ans, ne ressortira pas franchement secoué de cette Femme en pièces. Une femme en pièces, de Kata Wéber. Mise en scène : Kornel Mundruczo. Festival d’Avignon, gymnase du lycée Aubanel, jusqu’au 25 juillet, à 18 heures. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 18, 2021 10:04 AM
|
Sur le site de France 24 - le 18 juillet 2021 L'auteure et metteuse en scène franco-ivoiro-malienne Eva Doumbia, le 15 juillet 2021 au Festival d'Avignon Nicolas TUCAT AFP
Avignon (AFP)
Un spectacle qui se termine par la dégustation d'un mafé, mais pas seulement pour le plaisir des papilles: au Festival d'Avignon, riz, banane ou chocolat sont racontés à travers des histoires de colonisation et d'exploitation.
En entrant dans la salle, une odeur de nourriture titille les narines: le public, assis des deux côtés de la scène, peut voir le chef-comédien Alexandre Bella Ola découper sur une grande table carottes, courgettes et autres légumes qu'il fera mijoter dans une grande casserole fumante, où il ajoutera du soumbala (condiment très utilisé dans la cuisine africaine) et surtout la sauce arachide, communément appelée mafé.
Pourquoi le mafé?
Pour l'autrice et metteuse en scène franco-ivoiro-malienne Eva Doumbia, le projet est parti d'une histoire personnelle.
Dans les années 80, "mon père immigré a ouvert sans doute l'un des premiers restaurants africains (au Havre, Normandie) avec un associé tunisien qui faisait du couscous. Lui préparait le mafé et j'ai longtemps pensé que ce plat était traditionnel. Or c'est récent et lié au colonialisme: le riz ne poussait pas en Afrique, la pâte arachide a été importée par le colon des Etats-Unis", explique-t-elle à l'AFP.
"Cette nourriture s'est imposée sur le continent, notamment en Afrique de l'Est, et les habitudes alimentaires ont été modifiées", ajoute-t-elle.
- "Pas pour accuser" -
"Autophagies. Histoires de bananes, riz, tomates, cacahuètes, palmiers. Et puis des fruits, du sucre et du chocolat": voici le titre du spectacle, ou plutôt de cette "eucharistie documentaire" comme elle préfère l'appeler.
"On se réunit pour se nourrir ensemble, pour se remémorer" ces histoires "d'exploitation qui continuent jusqu'à aujourd'hui", précise Eva Doumbia.
La performance mélange danse, musique, chants mais aussi des images filmées en Afrique et diffusées sur un écran où l'on peut voir un planteur de cacao en Côte-d'ivoire qui gagne à peine pour subvenir aux besoins de sa famille.
Dans la salle, chaque spectateur reçoit un morceau de chocolat "équitable" fabriqué en Côte d'Ivoire. Présente sur le plateau aux côtés du chef, de deux autres comédiennes et d'un danseur, Eva Doumbia demande au public de remercier ceux qui ont "semé, planté, nourri, arrosé, transporté" cet aliment.
Ce voyage historico-culinaire, qui évoque également le sort oublié des Indochinois réquisitionnés en 1939 pour relancer la riziculture en Camargue, "n'est pas pour accuser" qui que ce soit, tient-elle à souligner.
"Il souhaite être un début de réflexion, on pose un constat, pas une solution, en espérant que les gens auront plus conscience que la plupart de ce qu'on mange au quotidien provient de l'exploitation d'êtres humains sous-payés sur d'autres continents ou de migrants qui travaillent dans des conditions déplorables. +On mange des gens+, d'où le mot +autophagies+ (se manger soi-même)", dit-elle.
La question des origines culinaires a pris de l'ampleur ces dernières années, comme en témoigne le succès du documentaire diffusé ce printemps sur Netflix, "High on the Hog", qui retrace l'influence des traditions alimentaires et culinaires africaines dans la gastronomie américaine, en évoquant notamment l'apport des esclaves aux Etats-Unis.
- Qui raconte les récits -
"La prise de conscience est encore limitée à des gens informés", estime Eva Doumbia, qui a effectué plusieurs voyages culinaires en Afrique et à la Nouvelle-Orléans.
L'artiste, qui se définit comme "afropéenne", est cofondatrice du collectif d'artistes "Décoloniser les arts" qui appelle à repenser les narrations dans le spectacle vivant et les arts en général.
Dans ses spectacles, elle interroge sans cesse la manière dont les rapports raciaux hérités du colonialisme s'expriment encore en société. Il y a dix ans, dans "Mon cheveu et moi", un spectacle-cabaret sur l'histoire du traitement du cheveu crépu, elle racontait une histoire d'aliénation au modèle occidental, avec des femmes noires voulant se lisser à tout prix leurs cheveux.
Elle préfère ne pas commenter sur la "crispation" en France entre universalistes et racialistes.
"Les choses ont bougé ces cinq dernières années grâce à beaucoup de volontarisme, mais il faut faire un effort au niveau des récits et (de) ceux qui les racontent", déclare l'artiste.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 18, 2021 5:40 AM
|
Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 15 juillet 2021 Aux commandes du Mister Tambourine Man d’Eugène Durif et sous la direction mi-circassienne, mi-théâtrale de Karelle Prugnaud, l’iconoclaste tandem prouve qu’il faut bel et bien avoir du chaos en soi pour accoucher d’une étoile qui danse. Ces dernières années, on avait surtout pu apprécier Denis Lavant en mode « petite robe noire ». De Henry Miller à Eugène Ionesco, en passant par Samuel Beckett, dont il est devenu, sous la houlette de Jacques Osinski, l’un des plus ténébreux porte-voix, le comédien s’est fait une spécialité des seuls en scène aux textes copieux, aux rôles ardus, fondés, bien souvent, sur le mystère et la gravité. Dans Mister Tambourine Man, qui se joue en itinérance durant toute la durée de cette 75e édition du Festival d’Avignon, on le retrouve dans une peau radicalement différente, celle d’un bateleur furieux et déjanté comme on n’en voit plus. Et l’acteur de prouver, si cela s’avérait nécessaire, qu’il est aussi à l’aise dans cet exercice que dans le précédent, voire qu’il y prend un plaisir, loin, très loin, d’être dissimulé. En compagnie du circassien Nikolaus Holz, ils forment un tandem physique et dramatique empreint, à la fois, de la profondeur des beckettiens Hamm et Clov et de la curiosité de Laurel et Hardy. Aussi grand et flegmatique que Dan est petit et nerveux, Niko est le dernier survivant d’un bistrot au bord de l’apoplexie. Serveur un brin psychorigide, il tient l’établissement dont il a la charge à bout de bras alors que tout y est en déséquilibre. Le piano tangue, les chaises sont plus entassées qu’empilées, les tables totalement à la renverse et l’on doute même qu’il puisse encore y être servi autre chose qu’un modeste verre d’eau. Ne reste que ces deux couples « d’habitués » – soit quatre spectateurs dûment sélectionnés et installés sur scène – pour qui l’employé, trop occupé à faire la chasse aux rongeurs de tout poil, a bien peu d’égard. C’est alors que, du fin fond du toril de l’arène de Roquemaure – où le spectacle avait pris place le soir du 14 juillet –, surgit Denis Lavant, ou plutôt Mister Tambourine Man. Fourrure de grand seigneur sur le dos, grosse caisse entre les mains, conque entre les lèvres, guirlande de clochettes à sa suite, il déboule toute sirène hurlante. Sauf que, derrière ce masque de fanfaron, se cache une blessure intime : l’homme est las, désespérément las, de son métier de bateleur. Tandis que, sur les routes, les gens qu’il croise lui demandent de jouer, de jouer, et de jouer encore, son chapeau reste tristement vide « quand le moment vient de passer à la caisse ». A la manière du Joueur de flûte de Hamelin, ce conte des frères Grimm dont Eugène Durif et Karelle Prugnaud se sont inspiré, Dan trouve alors, dans ce bar un rien miteux, un précieux refuge, et surtout un endroit où il pourra, en compagnie des rats et des enfants qui le suivent, répandre le désordre, comme vibrant levier de transformation du monde. Car, et c’est là toute la beauté du geste de ce Mister Tambourine Man, le désordre n’y est pas de ceux qui détruisent, mais bien de ceux qui fertilisent, les coeurs comme les esprits. Jusque dans leur maquillage, yeux cerclés de rouge et visage grimé de blanc, Nikolaus Holz et Denis Lavant s’y imposent comme un duo clownesque, dans la droite ligne, et c’est la troisième référence évidente, du clown blanc et de son Auguste. A mi-chemin entre le cirque, que le premier pratique depuis plusieurs décennies, et le théâtre, que le second maîtrise sur le bout des doigts, Karelle Prugnaud a trouvé la clef pour unir et équilibrer ce tandem, et lui donner l’envie de déployer une énergie folle pour arriver à ses fins. Avec une double dextérité, tant physique qu’intellectuelle, le circassien et le comédien, savamment canalisé, enchaînent tirades et numéros qui, sous leurs dehors de joyeux délire, sont, en réalité, sous-tendus par une précision millimétrée. Les chaises valsent alors autant que les tables, les boules rouges – si chères au coeur de Nikolaus Holz – sont non moins domptées que les verres au format pinte de bière, jusqu’à faire émerger une ambiance follement burlesque comme creuset du rire pour tous. Mais il y a plus. Car, loin de se contenter de cette atmosphère électrique, dont d’aucuns auraient pu se satisfaire, le trio tient à mettre en valeur les mots d’Eugène Durif. Jamais noyé sous ce boisseau forain, son texte se fait même percutant, et politique, lorsque, dans ses dernières encablures, il transforme Mister Tambourine Man en leader d’une voie nouvelle, capable de sortir le quidam de son quotidien un peu trop terne. Vu comme un vecteur de transformation, le déséquilibre et la prise de risques qu’il prône, et c’est là toute la subtilité, n’en font pour autant ni un messie, ni un homme providentiel. Lui est, simplement et uniquement, un aiguillon, mais ne se substituera à personne, et surtout pas à la volonté individuelle. Façon de dire que si, comme l’écrivait Nieztsche dans le prologue de Ainsi parlait Zarathoustra, « il faut encore avoir du chaos en soi pour enfanter d’une étoile qui danse », il revient à chacun de s’en emparer. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Mister Tambourine Man
Texte Eugène Durif
Mise en scène Karelle Prugnaud
Avec Nikolaus Holz, Denis Lavant
Collaboration artistique Nikolaus Holz
Scénographie Éric Benoit, Emmanuel Pestre
Lumière Emmanuel Pestre
Création sonore Guillaume Mika
Conseil musical Pierre-Jules Billon
Costumes Antonin Boyot-Gellibert Production Compagnie L’envers du décor
Coproduction OARA Office artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, Théâtre de l’Union Centre dramatique national du Limousin (Limoges), Festival d’Avignon, l’Agora Pôle national cirque de Boulazac, Les Scènes du Jura Scène nationale, DSN Dieppe Scène nationale, les Ateliers Frappaz Centre national des arts de la rue et de l’espace public – Villeurbanne, l’Espace des Arts Scène nationale de Chalon-sur-Saône, l’ARC Scène nationale du Creusot, Scène nationale d’Aubusson, l’Horizon – Recherche et création (La Rochelle), Compagnie Pré O Coupé / Nikolaus.
Avec le soutien du Ministère de la Culture Drac Nouvelle-Aquitaine et de la Région Nouvelle-Aquitaine
Durée : 1h20 Festival d’Avignon 2021
En itinérance
du 6 au 24 juillet Le Petit Festival, Banyuls
le 27 août Les Invites, Villeurbanne
le 17 septembre L’Horizon, La Rochelle
le 8 octobre Le Préau CDN de Normandie, Vire
le 27 décembre Théâtre de l’Union CDN du Limousin, Limoges
du 1er au 4 mars 2022 Le Rive Gauche, Saint-Etienne-du-Rouvray
le 11 mars L’Agora Pôle national cirque de Boulazac
du 16 au 19 mars L’ARC Scène nationale du Creusot
le 14 avril La Nef, Saint-Dié-des-Vosges
du 20 au 23 avril DSN Dieppe Scène nationale
les 7, 14 et 21 mai Espace des Arts Scène nationale, Châlon-sur-Saône
les 24 et 25 mai Les Scènes du Jura Scène nationale
du 30 mai au 3 juin La Maline, Île-de-Ré
le 1er juillet Festival L’Horizon fait le mur, La Rochelle
du 29 au 31 juillet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 16, 2021 7:08 AM
|
Par Fabienne Darge dans le supplément du Monde spécial Festival d'Avignon - 6 juillet 2021 Vasanth Selvam, Boutaïna El Fekkak et Saaphyra, le 15 juin, au Théâtre de Liège. JEAN-LOUIS FERNANDEZ Dans sa nouvelle création, « Fraternité, conte fantastique », présentée à Avignon cet été, l’autrice et metteuse en scène française réunit des comédiens de tous horizons. Rencontre avec trois de ces fortes personnalités.
L’une vient du rap marseillais, l’autre de Pondichéry, en Inde, la troisième est une Marocaine de France. Saaphyra, Vasanth Selvam et Boutaïna El Fekkak avaient peu de chances de se rencontrer. Sauf chez Caroline Guiela Nguyen. L’autrice et metteuse en scène n’a pas sa pareille pour réunir des comédien(ne)s dont les visages, les corps et les histoires transportent d’autres imaginaires, d’autres images, d’autres récits que ceux, uniformes et univoques, qui ont longtemps prévalu dans le théâtre français. La troupe réunie pour Fraternité, conte fantastique, la nouvelle création qu’elle présente au Festival d’Avignon, est à elle seule un voyage dans des identités nomades, multiples et mêlées. Une troupe où se mélangent comédiens professionnels et amateurs, où se parlent diverses langues et où s’expriment de fortes personnalités, à l’image de ces trois acteurs. La fibre sociale La première à débouler sur le plateau, avec son tempérament de tornade, c’est Saaphyra, 30 ans, et toute l’énergie de Marseille dans les veines. Dans la vraie vie, elle s’appelle Ludivine Portalier, et elle vient d’une famille tranquille de Vitrolles (Bouches-du-Rhône), qu’elle a quittée très vite. « J’avais une colère en moi, j’étais bagarreuse, je n’étais pas conforme à l’image que la société modèle pour les filles. J’ai commencé à écrire très tôt, vers 15 ans, pour sortir toute cette rage, et cela m’a menée vers le rap. Parallèlement, comme j’ai toujours eu la fibre sociale, je suis devenue éducatrice. » Plus de dix ans à tourner dans les rues des quartiers nord de Marseille ou à gérer les urgences d’un foyer d’accueil pour enfants surnommé « la poubelle des Bouches-du-Rhône » ont contribué à lui tremper le caractère et à lui donner une idée précise de l’état dans lequel se trouve la société française. Parallèlement, elle a essayé de faire son chemin dans le rap marseillais, milieu qui, pour être rebelle, n’en est pas moins aussi macho que d’autres. Son pseudonyme, Saaphyra, elle l’a choisi en référence à la rappeuse Diam’s, dont elle est « une fan inconditionnelle ». « Le rap, c’est un milieu d’hommes, parce qu’il part de la rue et parle de la violence, constate-t-elle. On pense que seuls les hommes peuvent avoir la rage, et la sortir de manière crue, alors que les femmes ont aussi des colères à exprimer, notamment face aux violences sexuelles et aux féminicides. » Alors les rappeuses de Marseille, Saaphyra en tête, ont décidé de frapper un grand coup en novembre 2020 et de remixer en version féministe Bande organisée, le single rap le plus streamé de l’année 2020, créé par Jul. Le clip a fait 500 000 vues sur YouTube et a donné une visibilité à Saaphyra, que son agent a envoyée passer l’audition sous les ors du Théâtre de l’Odéon, à Paris, quand elle a appris que Caroline Guiela Nguyen cherchait une rappeuse pour sa nouvelle création. Saaphyra a été prise illico, et on comprend pourquoi, au vu de sa présence scénique, lestée d’un vécu qui irradie sur le plateau, et de son aisance dans l’improvisation. Usine à rêves bollywoodienne Vasanth Selvam, lui, vient de bien plus loin que Marseille, ville qu’il a choisie comme campement provisoire, et sa vie ressemble à un conte. Un conte indien, où un petit garçon né au fin fond du Tamil Nadu il y a trente-six ans rencontrerait Jacques Audiard, Ariane Mnouchkine et Peter Brook. Comme tant d’autres, il a été nourri à l’usine à rêves qu’est le cinéma dans son pays et a toujours obscurément rêvé d’être acteur, tout en se disant que c’était totalement inaccessible et en gagnant sa vie dans l’informatique. Mais, un jour de 2007, à Madras, Vasanth Selvam a croisé la route de Koumarane Valavane, un auteur et metteur en scène qui rentrait de France, où il s’était formé auprès d’Ariane Mnouchkine, pour fonder son propre théâtre, le Théâtre Indianostrum. Koumarane Valavane a engagé ce jeune homme aux yeux brillants de rêves, et Vasanth Selvam s’est mis à « tout faire dans la compagnie, aussi bien jouer que nettoyer le théâtre. J’y ai même vécu pendant deux ans quand, en 2010, nous avons récupéré à Pondichéry l’ancien cinéma Jeanne d’Arc, bâti par les Français au début du XXe siècle », s’amuse-t-il. En 2014, il a été catapulté à Paris après une audition passée à Madras, à l’issue de laquelle il devait jouer le rôle principal de Dheepan, de Jacques Audiard. Le réalisateur ayant décidé de changer d’acteur, Vasanth Selvam s’est retrouvé seul et désœuvré dans la capitale française, où il a « mangé du théâtre » tous les soirs et travaillé dans les cuisines du Théâtre du Soleil, pour voir et revoir le Macbeth mis en scène par Ariane Mnouchkine. Puis il est retourné à Pondichéry et a commencé à faire des allers-retours entre l’Inde et la France. Les milieux indiens de Paris l’ont recommandé à Peter Brook, qui cherchait un acteur pour la reprise de son spectacle The Prisoner, en 2019. La rencontre avec le maître a, dit-il, « changé [sa] vie de comédien ». « C’est comme si vous franchissiez un cercle spirituel », conclut ce bel acteur solaire et intense, dont la présence chez Caroline Guiela Nguyen apparaît comme une évidence. Registre émotionnel « [Le théâtre] est un espace d’expression que je n’avais pas dans la vie, d’une force incroyable. » Boutaïna El Fekkak, elle, a en apparence un parcours plus classique dans le théâtre français. Elle a joué avec Alain Ollivier, Bruno Bayen, Jean Bellorini, Stéphane Braunschweig ou le tg STAN. Pourtant, elle aussi vient d’un autre monde. Du Maroc, où elle a vécu jusqu’à ses 18 ans, dans une famille qui n’avait aucune relation avec l’art, mais qui l’avait inscrite au lycée français de Rabat, où elle a découvert le théâtre, où elle s’est « tout de suite sentie dans [son] élément. C’était un espace d’expression que je n’avais pas dans la vie, d’une force incroyable ». Elle est ensuite partie étudier la philosophie à Montréal, avant de braver l’interdit de sa famille et de venir à Paris pour se lancer dans le théâtre. Elle rêve alors de jouer les grands rôles du répertoire, mais se rend rapidement compte que, dans la France des années 2000, c’est encore largement impossible pour une actrice d’origine maghrébine. « Les emplois étaient très marqués, surtout ceux de jeune première », constate-t-elle. Alors elle est partie compléter sa formation à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS), qui avait la réputation d’être moins classique que le Conservatoire, et où elle a rencontré Caroline Guiela Nguyen. Les deux jeunes femmes se sont retrouvées sur un désir, profond, de renouer avec un registre émotionnel qui avait été largement disqualifié dans le théâtre français. Un registre dans lequel Boutaïna El Fekkak excelle, ainsi qu’elle l’a montré dans un autre spectacle de Caroline Guiela Nguyen, Elle brûle, inspiré de l’Emma Bovary de Flaubert. Lire l’entretien (en 2019) : Caroline Guiela Nguyen : « Il est urgent de remettre l’imaginaire en marche » « La confrontation au regard de l’autre qui vous désigne comme étranger, elle n’est jamais anodine », analyse Boutaïna El Fekkak, que ses origines ont poussée, avec bonheur, vers un théâtre plus contemporain, qui sollicite largement la créativité de l’acteur et sa capacité à improviser. Elle continue pourtant à rêver de théâtre classique, de jouer les grandes héroïnes raciniennes ou claudéliennes. Tout en revenant sur ses origines dans Comme la mer, mon amour, un spectacle écrit et mis en scène avec son ami l’écrivain Abdellah Taïa, où tous deux se penchent sur leur jeunesse d’immigrés dans le Paris des années 2000. Ses camarades de Fraternité disent d’elle que « même quand elle ne joue pas, elle joue ». Et, quand elle joue, c’est comme si elle ne jouait pas, a-t-on envie d’ajouter. Elle habite ses personnages avec une grâce singulière, sans avoir l’air d’y toucher, et vous cueille au cœur, sans coup férir. « Fraternité, conte fantastique », par Caroline Guiela Nguyen. La FabricA, du 6 au 14 juillet (relâche le 10), à 14 heures. Durée : 3 h 45. Fabienne Darge

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 15, 2021 4:32 PM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama - 11 juillet 2021 Sa trilogie “Des Territoires” est inspirée, en partie de son enfance avignonnaise, vécue “extra muros”. Son retour au pays, sous les feux du Festival, révèle aussi la ferveur d’une sacrée troupe d’acteurs…
Pendant sept ans la bande d’acteurs a tissé, ressassé, remâché la grande saga Des territoires telle que la rêvait leur capitaine auteur et metteur en scène, Baptiste Amann. Sept années de création par étapes, épisode après épisode, pour suivre les trois jours d’une vie fraternelle mouvementée au moment où leurs parents disparaissent brutalement : la grande sœur et les trois frères tentent de les enterrer, pendant qu’autour d’eux, la cité, dont leur pavillon jouxte la lisière, prend feu… À chaque fois, l’histoire des révolutions françaises (1789, La Commune, la guerre d’indépendance algérienne) ressurgit sous leurs pas par des biais inattendus. Pour ce quintette d’acteurs formés ensemble, avec Amann, à l’école supérieure d’acteurs de Cannes (Lyn Thibault, Olivier Veillon, Samuel Réhault, Yohann Pisiou, et Solal Bouloudnine), l’invitation à Avignon représente la récompense d’une endurance tenace et fidèle. Car la cohésion du groupe est totale qui prend la scène en y vivant le moindre instant, en y incarnant chaque souffle, chaque mot – qu’il soit grave ou drôle tant l’écriture du dramaturge ne se complait pas dans la démonstration, même si elle marque parfois la pause en méditant sur le sens de nos existences (attention à ne pas en faire trop, quand même…). Tous ont réussi à préserver la fougue des débuts en 2013, quand la mise en scène, elle, a gommé le désordre un peu foutraque – mais pas sans charme – de la première pièce (Nous sifflerons la Marseillaise) et élagué le trop-plein de la deuxième (…D’une prison l’autre…) en y renforçant aussi le personnage de Nailia, jeune sortie de prison. La troisième partie (… et tout sera pardonné ?), en forme de réconciliation possible, est celle qui, sans doute, a le moins bougé : le projet avait mûri. Mesurer nos tensions contemporaines Dans un décor unique, bordé au fond par un espace vitré figurant, au fil des journées, la cuisine du pavillon familial, un studio de radio ou un couloir d’hôpital, les trois épisodes résonnent encore mieux entre eux pour ausculter ce qui tisse ou sépare les composantes de la société française. Des individus issus de cultures différentes qui ne connaissent pas l’épaisseur de l’histoire enfouie dans le sol sur lequel ils marchent (la Révolution, la Commune) ou la regarde d’un point de vue différent (l’Algérie). Dans le théâtre d’Amann, on a droit l’air de rien à quelques cours historiques car il compte sur le savoir pour mesurer nos tensions contemporaines avec plus de lucidité. Les situations sont toujours complexes : la méfiance et la peur de l’autre existent là où on ne l’attend pas, et la compromission avec les fondamentalistes aussi. Il décrit tout, les exactions policières comme cette rage des jeunes à qui les mots manquent et qui les perd parfois. Des Territoires, de Baptiste Amann Christophe Raynaud de Lage / Festival d'Avignon Désormais, si les personnages historiques ne surgissent plus tels quels de la nuit des temps, ils sont toujours bien là : Condorcet, l’apôtre visionnaire de la tolérance sous la Révolution est désormais actualisé via une hilarante reconstitution d’Apostrophes avec le couple Elizabeth et Robert Badinter, auteurs, en 1990, d’une biographie. Les Communards ne sont plus des fantômes mais des noms repris par des activistes qui veulent «faire la jonction » entre les mondes de la cité et ceux des pavillons. On y retrouve quand même les tensions entre Gustave Courbet, Louise Michel et Théophile Ferré, délégué à la Sûreté générale de La Commune et partisan de l’exécution des otages. La saisissante reconstitution du procès de Djamila Bouhired, militante du FLN défendue par l’avocat Jacques Vergès est toujours aussi efficace. Personnage ambigu – héroïne de la libération de l’Algérie mais cheffe des poseuses de bombe du Milk-bar –, condamnée à mort en 1957 puis libérée en 1962 dans le cadre des accords d’Evian, elle est défendue par la lumineuse Nailia Harzoune, autre comédienne dont on repère l’évolution dans la saga. A Avignon, la nuit dernière (on en sort à deux heures du matin !), dans le Gymnase du Lycée Mistral où cette épopée a cours jusqu’à demain avant une belle tournée, la ferveur était grande et le public, peut-être plus mélangé que d’habitude… Car Baptiste Amann fut lui-même, il y a 17 ans, un jeune lycéen de cet établissement venu depuis l’autre côté des remparts, des zones pavillonnaires de la banlieue. Et quand l’acteur Yohann Pisiou, interprétant le personnage du copain des quartiers, évoque la topographie avignonnaise comme une cartographie sociale, depuis les faubourgs jusqu’à ce Palais des papes surplombant la ville où il n’est jamais entré, chacun, dans le public sait immédiatement de quel côté des murs il se situe. Vertige supplémentaire. Des territoires, trilogie, de Baptiste Amann, jusqu’au 12 juillet, au Gymnase du lycée Mistral. Durée : 7h avec deux entractes. Tournée : du 15 au 25 septembre, à Théâtre Ouvert, Paris 19ème ; du 6 au 9 octobre à La Comédie de Béthune, les 17 et 17 octobre au Théâtre Sorano de Toulouse ; le 21 octobre au Méta, à Poitiers ; du 10 au 13 novembre, à L’empreinte, à Brive ; le 20 novembre, au Zef, à Marseille ; le 27 novembre, à La Garance, à Cavaillon ; le 4 décembre, à La Passerelle de Saint-Brieuc ; le 21 mai à Châteauvallon-Le Liberté ; du 3 au 5 juin aux Célestins, à Lyon.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2021 9:46 AM
|
Par Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde 6 juillet 2021 Entre chien et loup », mis en scène par Christiane Jatahy, en juillet 2021, au Festival d’Avignon. MAGALI DOUGADOS La metteuse en scène brésilienne s’empare du film « Dogville », du réalisateur danois, dans une parabole surlignée de la situation de son pays. Refaire Dogville, à tous les sens du terme « refaire ». Non seulement porter au théâtre le film de Lars von Trier, lui-même nourri de théâtre, mais en réécrire l’histoire. Le projet de la metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy est aussi ambitieux artistiquement que politiquement. Il est nourri, très directement, par l’horreur qu’inspire à l’artiste le retour de l’extrême droite dans son pays. Christiane Jatahy est une femme brillante, passée maîtresse, ces dernières années, dans le dialogue entre cinéma et théâtre. Lire aussi : Christiane Jatahy, « Je m’approche du cinéma pour faire mon théâtre » Mais là, le constat est clair. Avec cet Entre chien et loup qui a ouvert, lundi 5 juillet, le Festival d’Avignon, le spectacle de Christiane Jatahy supporte difficilement la comparaison avec le chef-d’œuvre unique et dérangeant du cinéaste danois, sorti en 2003. Comme à son habitude, la metteuse en scène a pourtant conçu un dispositif sophistiqué, supposé mettre en abîme l’histoire du film, que rejouerait une troupe de comédiens. On aurait donc affaire à des acteurs qui joueraient des acteurs en train de rejouer Dogville. Cet emboîtement n’est pourtant guère visible sur le plateau, où l’on assiste plus simplement, à quelques décalages près, à une adaptation théâtrale de la parabole cruelle imaginée par Lars von Trier. Grace, le personnage incarné au cinéma par Nicole Kidman, est devenue Graça, une jeune femme qui a fui un pays qui est évidemment le Brésil, où elle était poursuivie par la milice. Elle se retrouve dans une communauté repliée sur elle-même, qui va d’abord la rejeter, puis l’adopter progressivement, avant de l’exclure à nouveau et de l’utiliser, la maltraiter et abuser d’elle sur tous les plans. Manque de rythme Quels sont les mécanismes du rejet ou de l’acceptation de l’autre, se demande Christiane Jatahy. Le passage au théâtre pouvait clairement apporter une dimension intéressante, en termes d’expérience charnelle et concrète, à l’expérimentation stylisée, d’inspiration brechtienne, de Lars von Trier. Mais, à quelques rares exceptions près, tout semble ici surligné à gros traits, là où les mécanismes de l’exploitation chez le cinéaste étaient aussi implacables que non illustratifs. Cela tient à l’écriture des dialogues, notamment. Même le dispositif formel, qui est en général le point fort de Christiane Jatahy, suscite ici la déception. Comme si la metteuse en scène avait eu du mal à se démarquer de celui du cinéaste danois, les espaces des différents personnages sont marqués par quelques accessoires et éléments d’ameublement, qui se recomposent suivant les scènes. Comme on est dans le temps du théâtre, en direct, et pas dans celui, recomposé et monté, du cinéma, ce dispositif alourdit l’ensemble du spectacle, qui manque de nerf et de rythme. Même le dispositif formel, qui est en général le point fort de Christiane Jatahy, suscite ici la déception L’autre point fort de la metteuse en scène, c’est sa manière, différente à chaque création, d’utiliser le cinéma pour semer le trouble dans la représentation théâtrale, mais sur ce point, Entre chien et loup déçoit aussi. Les images se contentent la plupart du temps d’offrir un contrepoint à ce qui se joue sur scène, sauf à certains moments où Christiane Jatahy introduit des perturbations. On voit par là que c’est bien la répétition des comportements, et les manières éventuelles d’en sortir, qui intéressent la metteuse en scène. Le principal apport du spectacle est d’ailleurs d’arrêter l’histoire avant l’ultime horreur imaginée par Lars von Trier et sa vengeance finale, et de lui donner un autre cours. Comme pour affirmer que l’on peut toujours dire stop. Ce choix apparaît là encore lourdement didactique. C’est d’autant plus dommage que Christiane Jatahy travaille, comme toujours, avec des comédiennes et des comédiens qui savent jouer avec leurs personnages comme personne, Julia Bernat, Matthieu Sampeur et Philippe Duclos en tête. Mais rien n’y fait : le spectacle ne décolle pas, et les allusions à la situation politique brésilienne apparaissent naïves et simplistes, ce qui est tout de même ennuyeux, au regard de la gravité de ce qui se passe dans le pays de Christiane Jatahy et de Jair Bolsonaro. Entre chien et loup, d’après Dogville, de Lars von Trier, par Christiane Jatahy. Festival d’Avignon, L’Autre Scène du Grand Avignon, Vedène. A 15 heures, jusqu’au 12 juillet. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2021 8:42 AM
|
Par Fabienne Darge envoyée spéciale à Avignon pour Le Monde - 7 juillet 2021 Légende photo : Mahia Zrouki , Saaphyra, Hoonaz Ghojallu et Saadi Bahri, lors d’unen répétition du spectacle « Fraternité, conte fantastique », de Caroline Guiela Nguyen, le 13 mai 2021. JEAN-LOUIS FERNANDEZ A 39 ans, la metteuse en scène et autrice confirme, avec sa nouvelle pièce, un conte fantastique sur le deuil, sa foi absolue dans la fiction.
Imaginons. On serait en 2021, dans un monde qui ressemblerait au nôtre. Dans ce monde-là, la moitié de l’humanité disparaîtrait, emportée par un cataclysme aussi mystérieux qu’inattendu. Que deviendraient les survivants, quelles seraient les traces de la douleur et de la perte, les moyens d’y survivre ? Caroline Guiela Nguyen, qui ne cesse de confirmer à quel point elle trace un chemin singulier dans le théâtre français, a rêvé et écrit sa nouvelle création, Fraternité, conte fantastique, présentée au Festival d’Avignon jusqu’au 14 juillet, bien avant que le Covid-19 ne vienne nous rappeler que nous sommes des êtres mortels, et pas des demi-dieux échappant aux lois de la finitude humaine. Présentée aujourd’hui, après les mois que nous venons de vivre, elle résonne étrangement, cette création qui n’a pas peur de s’aventurer sur les terres, peu fréquentées par le théâtre français, du fantastique et de l’art de la consolation. Sans qu’il retrouve totalement la magie et la grâce de Saïgon, le précédent spectacle de l’autrice et metteuse en scène âgée de 39 ans, qui a connu un immense succès, Fraternité étonne et séduit par sa foi absolue en la fiction, par sa maîtrise des éléments scéniques et par son originalité dans le choix et la direction des acteurs. Survie quotidienne Nous voilà donc dans un monde à la fois familier et parallèle, où une étrange éclipse a fait disparaître comme par enchantement la moitié des êtres humains. Tous les survivants ont perdu un parent, un enfant, un conjoint, un proche, quel qu’il soit. Pour faire face collectivement à leur détresse, ils ont créé des « centres de soin et de consolation », où s’organisent la survie quotidienne, l’entraide et le travail scientifique nécessaire à la compréhension de l’événement advenu. C’est dans un de ces centres qu’emmène Fraternité. Un peu trop ténue dans la première partie du spectacle, l’histoire, sous forme de conte donc, prend, dans la seconde partie, une dimension et une force étonnantes, quand entrent en jeu les questions de la mémoire et du souvenir, et leur importance dans la constitution de l’être humain. Dans le centre officie en effet une scientifique, Rachel, dont les découvertes vont mener vers des pistes de plus en plus inattendues, et déboucher sur le constat que le cœur des humains et le cœur de l’Univers battent à l’unisson. Or, dans les deux cas, ce cœur s’est ralenti, introduisant un trouble dans le temps. Lire aussi : Au Festival d’Avignon, Tiago Rodrigues présente une « Cerisaie » déroutante De quel poids du passé faut-il se délester pour s’inventer un avenir ? Comment « faire son deuil », comme on le dit communément aujourd’hui, sans pour autant tomber dans le déni et l’oubli ? Comment communique-t-on avec ses disparus ? A toutes ces questions, le spectacle de Caroline Guilea Nguyen répond par des propositions à la fois concrètes et poétiques, sans avoir peur de partir, par moments, dans des dimensions un rien délirantes, en s’autorisant toutes les libertés de la fiction. Fidèles collaborateurs La jeune autrice et metteuse en scène peut d’autant plus se le permettre qu’elle affirme son univers scénique, désormais bien reconnaissable et peaufiné avec ses fidèles collaborateurs. Le décor hyperréaliste d’Alice Duchange, aux couleurs pastel, la fresque aux accents d’enfance, la musique hypnotique de Teddy Gauliat-Pitois et Antoine Richard… Elle peut se le permettre, aussi, parce qu’elle réunit des acteurs capables de pousser loin les curseurs de l’émotion. Trop, parfois, dans la première partie, où cette émotion peut tourner à vide. Mais, là aussi, dans la deuxième partie du spectacle, cette dimension émotionnelle devient beaucoup plus dense et bouleversante. Dan Artus, Boutaïna El Fekkak, Hoonaz Ghojallu, Elios Noël, Vasanth Selvam, les rappeuses Saaphyra et Nanii, qui offrent deux des moments les plus intenses du spectacle… Cette troupe diverse, qui représente une mini-humanité à elle seule, est l’atout maître de Caroline Guiela Nguyen. Fraternité, conte fantastique, de et par Caroline Guiela Nguyen. Festival d’Avignon, La Fabrica, à 15 heures, jusqu’au 14 juillet. Fabienne Darge (Avignon - envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2021 7:00 PM
|
Par Philippe Noisette dans Paris Match | Publié le 05/07/2021
Photo Claire Delfino/Paris Match
Dans les coulisses de "Fraternité"
Après le triomphe de « Saigon », Caroline Guiela Nguyen prépare pour Avignon une fable futuriste. Nous sommes allés suivre les répétitions à Liège.
Caroline Guiela Nguyen et sa troupe ont trouvé refuge au Théâtre de Liège avant le grand saut au Festival d’Avignon. La metteuse en scène ne le sait peut-être pas, mais les places pour sa nouvelle création, « Fraternité. Conte fantastique », se sont arrachées en quelques heures. En 2018, pourtant forte d’une demi-douzaine de spectacles, Caroline Guiela Nguyen s’était retrouvée en pleine lumière avec « Saigon », une remarquable fresque sur les vétérans d’Indochine, ces expatriés nostalgiques de leur pays dans une France d’aujourd’hui. Deux ans de tournée, des salles pleines, l’aventure aurait pu l’épuiser. « Au contraire, ça m’a donné une force incroyable pour préparer la suite. »
Surtout, cela lui a ouvert les portes de lieux prestigieux, comme la Schaubühne de Berlin, dirigée par Thomas Ostermeier, coproducteur de « Fraternité ». Et le cinéma n’a pas manqué de lui faire les yeux doux. « Chaque soir, il y avait des producteurs durant les représentations de “Saigon” à Paris », s’amuse Caroline. Mais le grand écran attendra pour l’instant : le théâtre, rien que le théâtre, même si elle a déjà signé deux courts-métrages. Sur scène, une fiction futuriste Pour ce nouveau spectacle, c’est le futur qui l’intéresse. Un cataclysme ayant entraîné la disparition de la moitié de l’humanité, des centres de soins et de consolation viennent en aide aux survivants. On y soigne l’absence des êtres aimés, on lutte contre l’effacement des souvenirs. « Lorsque je suis arrivée sur le plateau le premier jour, je n’avais qu’une trame narrative, un paysage esthétique. Mais pas un seul mot du spectacle. » Au cours de longues séances de répétitions, la pièce va s’écrire avec tous les acteurs, les contours se préciser. « Fraternité » mêle professionnels et amateurs de toutes origines, certains castés dans la rue ou dans des centres sociaux. « Mais je ne travaille pas avec la biographie de chacun. Je suis libre d’inventer avec eux, je construis à partir de ce qu’ils proposent comme fiction. » Ne parlez surtout pas à Caroline Guiela Nguyen de théâtre documentaire. « J’ai du respect pour ceux qui en font mais il est important d’offrir de la fiction aux spectateurs. » Surtout, elle réunit sur le plateau une troupe plurielle : « Il faut inviter d’autres visages, affronter une multiplicité de récits, donner à entendre d’autres langues. Car la France c’est déjà le monde. » Pour nourrir « Fraternité », elle a rencontré des personnes engagées sur tous les fronts Son « Conte fantastique » aura donc des accents indiens, vietnamiens, iraniens, anglais, français… « Je crois que nous devons penser ensemble la question de la diversité, sur la scène comme dans la salle. Il en va de la santé artistique de ce que l’on produit. Ces questions, le jour où j’arrêterai de me les poser, il faudra que l’on me retire mes subventions. Ce n’est pas simple tous les jours, mais c’est un peu mon sacerdoce. » La créatrice semble plus que jamais déterminée à faire du théâtre un lieu d’expérimentation autant que d’émancipation. Pour nourrir « Fraternité », elle a rencontré des personnes engagées sur tous les fronts. Comme Cristina Cattaneo, médecin légiste italienne qui lutte pour l’identification des corps de migrants en Méditerranée. « Ou le bureau de rétablissement des liens familiaux, à la Croix-Rouge, proposant de retrouver la trace d’une personne disparue. Les dossiers ne sont jamais fermés, on dit qu’ils sont “suspendus”. Comme celui de deux sœurs séparées pendant la Seconde Guerre mondiale. Soixante ans plus tard, ce bureau a permis qu’elles se retrouvent. Elles avaient 80 ans. » On devine en écoutant ces témoignages de quoi la « Fraternité », selon Caroline Guiela Nguyen, sera faite. « J’aime ce mot complexe, lié à la notion du temps. » La communauté d’acteurs réunis va incarner ce futur immédiat. Lire aussi.In the mood for Caroline Guiela Nguyen Comme beaucoup de productions, « Fraternité » a été pris dans la tourmente de la pandémie. « Nous avons subi un retard considérable. À Rennes, où la troupe répétait, il a fallu faire une croix sur les moments de convivialité après le travail. Rentrer à l’hôtel, manger seul. » En Belgique, les contraintes étaient allégées. Mais le jour de notre passage, une actrice avait de la fièvre : ni une ni deux, tous masqués. Il faut protéger l’équipe, composée de très jeunes comme du couple de vétérans Anh et Hiep Tran Nghia, déjà de l’aventure « Saigon ». Lire aussi.Avec "Saigon" le théâtre français fait le tour du monde « Fraternité » va partir sur les routes au moins deux ans. Pour Caroline Guiela Nguyen, « la première fonction du théâtre, c’est de représenter. Et qui sait, créer du mouvement dans la société ». Dans la continuité de ce cycle de créations entamé avec le court-métrage « Les engloutis », puis « Fraternité », elle s’attelle déjà à la suite : « L’enfance, la nuit », avec des enfants. Sa fille n’a que 2 ans. Presque l’âge des contes. À sa façon, Caroline Guiela Nguyen met en scène notre monde. C’est après tout la plus belle des fictions. 
« Fraternité. Conte fantastique », au Festival d’Avignon du 6 au 14 juillet, puis à Paris (théâtre de l’Odéon-Berthier) du 18 septembre au 17 octobre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 6, 2021 8:53 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 6 juillet 2021 Légende photo : « La Cerisaie », de Tchekhov, mise en scène par Tiago Rodrigues, le 1er juillet lors d’une répétition, à Avignon. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE Le metteur en scène portugais, futur directeur du festival, adapte librement la pièce de Tchekhov dans la Cour d’honneur. Une première en mal d’élan collectif. Le public a applaudi quand ont retenti les trompettes de Jarre annonçant le début de La Cerisaie, de Tchekhov, lundi 5 juillet, en ouverture du festival, dans la Cour d’honneur du Palais des papes : il était 22 h 40, le spectacle aurait dû commencer à 22 heures, mais les contrôles à l’entrée se sont éternisés à cause des mesures sanitaires – il fallait présenter un certificat de vaccination ou les résultats d’un test – et d’un groupe d’intermittents qui bloquaient l’entrée principale. Tout s’est finalement arrangé, et les spectateurs (pas loin de 2 000) ont pu prendre place dans la nouvelle cour, la sixième depuis le début du festival. Une cour élégante, avec des sièges en bois confortables, et un plateau refait à neuf. Du bel ouvrage, à porter au crédit du mandat d’Olivier Py. Deux heures et demie plus tard, le public a applaudi à nouveau, mais sans enthousiasme débordant, à la fin de La Cerisaie mise en scène par Tiago Rodrigues, le futur directeur du Festival d’Avignon, avec Isabelle Huppert en tête de distribution. Inutile de préciser que le spectacle était attendu. Ni que la fébrilité était au rendez-vous : comme toujours lors d’une première dans la Cour d’honneur, tout se passe comme si l’on mettait un bateau à la mer. Quelle direction prendra-t-il ? Quel vent le portera ? On ne saurait trop le dire pour cette Cerisaie, qui est à la fois, libre, généreuse, et déroutante. Libre, parce que Tiago Rodrigues prend ses aises avec Anton Tchekhov (1860-1904). L’homme de théâtre portugais n’est pas un adepte de la religion du répertoire. Si les quatre actes sont là, le texte n’est pas suivi à la lettre, mais dans l’esprit de la mise en scène, qui offre une grande liberté aux comédiens. C’est en cela que La Cerisaie est généreuse. Mais elle est déroutante dans sa volonté de s’éloigner à tous crins du naturalisme, et de nous mener à Tchekhov par d’autres chemins. Elément d’un puzzle La grande et belle maison, on ne la verra pas. Les cerisiers sans fin dans la campagne russe, non plus. Pour tout décor, il y a sur le plateau 150 des anciens sièges de la Cour, qui semblent regarder la nouvelle. Un pont, en somme, entre l’ancien et le nouveau monde, qui s’enlacent et se déchirent dans La Cerisaie. A ces sièges s’ajoutent trois lampadaires modernes auxquels sont accrochés des lustres anciens. Ils éclairent le passage du temps, inexorable, entre le moment où Lioubov (Isabelle Huppert) revient dans sa maison d’enfance, et celui où elle la quitte, après la vente de la cerisaie, rachetée par Lopakhine (Adama Diop), le riche marchand, fils de moujik. On est ébloui par Adama Diop, un Lopakhine somptueux de rage et d’humanité contenue Entre elle et lui, il y a un monde, qui s’incarne dans leurs gestes : il agite les bras, en homme qui abat du travail comme on abat les arbres ; ses bras à elle laissent tomber de l’argent de son porte-monnaie, ils ne peuvent s’en empêcher, et l’argent file, file, comme s’il ne comptait pas. Quand elle apprend que la cerisaie est perdue, Lioubov reste sidérée, assise au pied d’un lampadaire, puis elle pleure en silence, ses épaules tressaillent. L’argent était une chimère, il devient un destin qu’elle n’a pas choisi – par frivolité, inaptitude ou atavisme –, alors qu’il représente pour Lopakhine le sceau d’un destin voulu : sortir de sa condition de « petit-fils et fils d’esclaves », comme il le crie, en tapant du pied et mimant les coups de fouet autrefois réservés aux moujiks. On peut parler sans fin de La Cerisaie, parce qu’elle est sans fin : une époque meurt, quarante ans après l’abolition du servage en Russie (en 1861), une autre naît, qui voit arriver les estivants dans les campagnes, où la cerisaie sera détruite pour leur construire des datchas. Tiago Rodrigues fait entendre haut et fort cette rupture politique, ce désir tiraillé d’un lendemain autre. Mais surtout, il porte un regard singulier sur ce paysage du grand bouleversement : il rompt avec la tradition qui entraîne tous les personnages de La Cerisaie dans un même mouvement, comme une compagnie soudée. Dans la Cour, chaque personnage apparaît tel une pièce de marqueterie, ou l’élément d’un puzzle qui peine à se dessiner. Grâce lunaire Est-ce la rançon de la liberté que Tiago Rodrigues leur accorde ? Les comédiens manquent d’un geste de mise en scène apte à donner un élan collectif, sauf à de rares moments : quand, par exemple, ils dansent tous, très lentement, sur la musique jouée en direct par Manuela Azevedo et Hélder Gonçalvès, une sensualité se dégage – celle de corps séparés et habités par la même douleur d’exister mais de ne pas vivre. On aimerait retrouver cette sensualité indéfinissable, doucereuse, mouvante et bouleversante qui traverse La Cerisaie. Elle fait défaut à la représentation de la Cour d’honneur. Dommage, car la distribution est intéressante, métissée de styles de jeu différents. Beaucoup de comédiens font leur entrée dans la Cour. On se réjouit de voir Alex Descas en Gaev, le frère inconséquent de Lioubov ; Marcel Bozonnet en Firs, portant un frac et son vieil âge avec une grâce lunaire ; David Geselson en Trofimov, l’éternel étudiant bardé de sacs et de certitudes ; Océane Caïraty en Varia, la fille adoptive de Lioubov et Alison Valence en Ania, sa fille naturelle ; Nadim Ahmed en Iacha et Suzanne Aubert en Douniacha, tous deux domestiques ; Grégoire Monsaigeon en Simeonov-Pichtchik, le pique-assiette sans vergogne, et Isabel Abreu en Charlotta, la gouvernante aux tours de magie. On saute de joie en regardant l’irrésistible Tom Adjibi, qui a toujours des malheurs mais ne s’en plaint pas. Et on est ébloui par Adama Diop, un Lopakhine somptueux de rage et d’humanité contenue. Il forme avec Isabelle Huppert un couple de scène dont on se souviendra. Lui dans son costume trois pièces lie-de-vin, elle avec son pantalon d’un vert éclatant. Une silhouette de brindille et une force prodigieuse. Un visage comme un papyrus, sur lequel les sentiments changent à la vitesse de la lumière. Huppert for ever. La Cerisaie, de Tchekhov. Mise en scène Tiago Rodrigues. Cour d’honneur du Palais des papes, à 22 heures. De 10 à 40 euros. Durée : 2 h 30. Jusqu’au 17 (relâche le 13). Le spectacle est surtitré en anglais Brigitte Salino (Avignon - envoyée spéciale)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2021 9:06 AM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 5 juillet 2021 Légende photo : Tiago Rodrigues, lors d'une répétition de «la Cerisaie» à Avignon, dimanche. (Christophe Raynaud de Lage) Le metteur en scène portugais, nommé ce lundi à la tête du Festival, revient sur son parcours, de sa rencontre avec la scène et le collectif TG Stan, à son travail à la tête du théâtre national de Lisbonne. Il défend un accès démocratique à l’art, aussi exigeant soit-il. La rumeur était insistante depuis plusieurs semaines, elle a cessé d’en être une, ce lundi à 10 h 30. Tiago Rodrigues, metteur en scène, acteur, écrivain, poète et dramaturge portugais, sera bien le prochain directeur du Festival d’Avignon à l’issue de l’édition 2022, et c’est la première fois depuis sa fondation en 1947 par Jean Vilar, qu’un metteur en scène de nationalité non française, et à la stature internationale, prend la tête du prestigieux festival. Le conseil d’administration de l’association de gestion du Festival vient d’officialiser la nouvelle et c’est peu dire qu’un vent d’enthousiasme s’engouffre dans les rues déjà caniculaires, secoue les affiches, les tracts, les branches des arbres, les feuilles – et l’on sait que les plateaux de Tiago Rodrigues sont souvent parsemés de feuilles volantes –, bref, tout ce qui est doué de mouvement. Tiago Rodrigues ? Il n’a que 44 ans, il dirige depuis sept ans le théâtre national Dona-Maria-II de Lisbonne (l’équivalent de la Comédie-Française au Portugal) dont il a profondément modifié le répertoire et qu’il a ouvert à des metteurs en scène de tout horizon, et les publics, nouveaux et anciens, l’ont suivi. En France, c’est le (petit) théâtre de la Bastille qui fut sa première maison et son précieux soutien, avec le théâtre Garonne à Toulouse, et qui nous permit de découvrir, entre autres merveilles, By Heart, une réflexion sur ce que signifie «apprendre par cœur» à travers une pièce hommage à sa grand-mère devenue aveugle. Ou encore Bovary, autre pièce passion sur les pouvoirs de la littérature et d’un personnage à travers le procès qu’encourut Flaubert pour son roman. Ou encore, autre création sur la force du romanesque, The Way She Dies («Sa manière de mourir»), à propos de la mort d’Anna Karénine et la manière dont les mots de Tolstoï s’inoculent dans le corps de ceux qui le lisent. Mais Tiago Rodrigues, c’est l’antithèse d’un théâtre conçu pour ceux qui y vont déjà. «Entrez donc», semblait-il dire en 2016 lorsque le théâtre de la Bastille lui proposa d’occuper tous les mètres carrés du lieu pendant soixante-huit jours, afin de comprendre un peu mieux le public, car c’est bien le spectateur «qui est premier et qui déclenche le spectacle en entrant dans la salle, et en choisissant de traverser la ville pour le voir» expliquait-il à Libération en 2016. Un metteur en scène franchement à gauche qui croit au théâtre comme «antichambre de l’action politique». Sur France Culture, à Marie Richeux, il expliquait : «L’une des grandes raisons de faire du théâtre est qu’on ne sait pas comment ça va se passer.» Il parle très vite, même en français. Rencontre juste avant une dernière répétition de la Cerisaie en juin. On dit que vous êtes un metteur en scène européen. Qu’est-ce que cela signifie ? J’ai appris à être metteur en scène, j’ai pu progresser dans mon travail, grâce à une idée de l’Europe. Mon premier spectacle était au Portugal et le deuxième était en Belgique avec les TG Stan. Je pense souvent à cette phrase de George Steiner qui disait : «Tant qu’il y aura des cafés, il y aura une idée de l’Europe.» Les cafés perçus comme des espaces où les hiérarchies disparaissent, et où soudainement tout le monde parle sans en tenir compte. C’est très proche de ce qui peut se passer au théâtre, comme l’avait très bien compris Jean-Jacques Rousseau, qui n’aimait pas du tout le théâtre mais qui disait : «Malgré tous ses défauts, le théâtre a une qualité : c’est une fête civique.» L’Europe est un continent carrefour, ce qui est une richesse énorme. Mais c’est aussi un continent constitué de pays colonisateurs. Ce qui nous donne très clairement une responsabilité. Et c’est déjà un privilège parce qu’on peut se mettre au travail. Vous souvenez-vous de votre première fois au Festival d’Avignon ? La première fois, c’était en 2015, pour montrer Antoine et Cléopâtre qu’Agnès Troly, la programmatrice qui travaille avec Olivier Py, avait vu à Lisbonne. La deuxième fois, c’était pour créer Sopro, que le Festival avait coproduit. Et la troisième fois, c’est aujourd’hui, à la cour d’honneur, avec la Cerisaie. Ici, le public est animé par l’idée de découverte et je pense que le mélange, pas seulement des disciplines mais des propositions esthétiques, est une exigence du public qui contribue à faire du Festival le lieu de l’inattendu. On éprouve très fortement cette ouverture du public qui nous dit : «On sera là pour prendre le risque avec vous d’un festival qui a énormément de créations.» Quand je parle de prise de risque, je ne veux pas dire que le Festival doit être constitué de nouveaux venus. Je parle aussi des noms familiers de la grande bibliothèque vivante de la danse et du théâtre. Le risque que prend un artiste de 70 ans n’est pas nécessairement moindre que celui d’un artiste de 23 ans. Savez-vous programmer des spectacles que vous n’aimez pas ? D’après ma petite expérience au théâtre national de Lisbonne, ce sont parfois ces artistes pour lesquels je n’ai pas de passion mais que je programme qui finalement vont marquer la saison. Il arrive qu’on propose des spectacles qui haussent le niveau d’exigence envers le public. Le service public de la culture sert en premier lieu à garantir l’accès démocratique à des œuvres que le marché n’aurait pas laissé survivre. Il consiste à préserver un niveau d’exigence qui peut effrayer l’industrie. On présente Bajazet de Frank Castorf à Lisbonne : énorme succès ! Avec des débats. Les gens qui avaient des problèmes avec ce spectacle avaient d’énormes problèmes ! Mais «énorme» est un qualificatif qui est toujours attaché à Castorf : énormes débats, énorme succès, énormes critiques ! «Etudiant au conservatoire, j’ai commencé à tout voir par pure curiosité. J’ai maintenu cette attitude boulimique envers le théâtre et la danse jusqu’à maintenant. Même l’expérience de ne pas aimer m’enseigne énormément.» — Tiago Rodrigues Saviez-vous, plus jeune, que vous deviendrez metteur en scène ? Je n’allais pas beaucoup au théâtre enfant. J’ai commencé à faire du théâtre amateur au lycée, par amour de ces gens-là un peu fous qui avaient ouvert un atelier. C’était une bande d’amis avec un professeur de sociologie mozambicain émigré au Portugal. Il faisait partie de ces professeurs qui vont tous les jours au-delà de leur devoir en essayant de bâtir une idée d’école et de communauté. C’est grâce à lui que j’ai commencé à faire du théâtre. Je lisais, j’aimais la littérature, mais je n’avais aucune idée de ce qu’était le théâtre. J’avoue, quand je me suis inscrit au conservatoire, j’avais vu quelques pièces, mais je n’étais pas un habitué des salles. J’avais un peu de culture générale grâce à la lecture et le privilège d’avoir grandi dans une maison habitée par des gens cultivés – mes quatre grands-parents tenaient des cafés dans des villages, mon père était journaliste et ma mère médecin. Etudiant au conservatoire, j’ai commencé à tout voir par pure curiosité. J’ai maintenu cette attitude boulimique envers le théâtre et la danse jusqu’à maintenant. Même l’expérience de ne pas aimer m’enseigne énormément. De spectateur «boulimique» à acteur metteur en scène, le pas fut-il facilement franchi ? J’étais en première année du conservatoire à Lisbonne et sur les conseils de mes profs, je pensais le quitter. Pendant l’été, je voyais tout ce que je pouvais. Je faisais des workshops. Et c’est en voyant un spectacle de TG Stan à Lisbonne, et grâce à un atelier avec eux au Portugal pendant l’été 1997, que j’ai pensé : «Ils existent ? OK, je n’abandonne pas. Je vais continuer à faire du théâtre.» A chaque fois que j’invite une compagnie internationale au théâtre national de Lisbonne, je pense à ce petit épisode autobiographique. S’il n’y avait pas eu un spectacle venu de l’étranger à Lisbonne, je n’aurais sans doute pas eu envie de continuer à faire du théâtre. Cette rencontre avec TG Stan a été déterminante pour moi, car elle m’a nourri d’une pensée et d’une pratique du théâtre à laquelle je n’avais pas accès. Très vite, j’ai commencé à travailler avec eux. Mais aussi, elle m’a permis de voyager en tant qu’artiste et spectateur un peu partout en Europe et voir des spectacles que je n’imaginais pas. Cela rendait tangible le fait que l’art n’a pas de frontière administrative et que les idées et les personnes doivent pouvoir circuler, et pas seulement les marchandises.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2021 4:28 AM
|
Acteurs, metteurs en scène, régisseur… Rencontre avec des professionnels primo-invités au Festival ou débarquant avec une nouvelle casquette. Eva Doumbia Metteuse en scène, autrice de Autophagies (Histoires de bananes, fruits, cacahuètes, palmiers. Et puis, des fruits, du sucre, du chocolat): «Je suis heureuse que cela arrive tardivement dans mon parcours» (Photo : Lionel Grelat) «Je fais du théâtre depuis quatorze ans et c’est la première fois que je suis programmée dans le in. Je suis heureuse que cela arrive assez tardivement dans mon parcours, à un moment où le milieu du théâtre et la société française sont prêts à entendre avec un peu de tranquillité les questions que pose l’histoire coloniale. Ne serait-ce qu’il y a dix ans, on ne pouvait pas concevoir un spectacle qui évoquait la responsabilité de chacun dans la colonisation sans que ça ne soit pris pour une agression. Les premières discussions avec le in ont débuté avec la précédente direction du Festival, Vincent Baudriller et Hortense Archambault, en 2007. Mais elles ont commencé à prendre forme il y a quatre ans, sur Autophagies, qu’on va donc créer cette année. Pourquoi tant de temps ? Il fallait notamment trouver la salle adéquate. Je voulais que ce spectacle qui questionne le mafé, ce plat traditionnel d’Afrique de l’Ouest à base de poulet et de pâte d’arachide, soit présenté dans une cité accessible en transport en commun. On va jouer au château de la Barbièrepile au moment où le tramway arrive enfin jusque-là. J’ai bien sûr l’espoir que les habitants de la cité viennent nous voir. On mangera mais le repas n’est pas compris comme une récompense, il fait partie du spectacle. J’avais envie que les gens puissent partager quelque chose ensemble, et initialement, ils devaient se mélanger et se servir. Le Covid a changé la donne. Le gros paradoxe est qu’on est beaucoup moins soutenu sur ce projet qu’on ne l’a été sur d’autres. Le Festival d’Avignon a acheté le spectacle mais ne l’a pas coproduit. Il devait y avoir pas mal d’actions autour en amont mais j’ai eu un grave accident qui m’a maintenue hospitalisée pendant deux mois. On fera donc un crash-test vendredi à Elbeuf, quelques jours avant notre arrivée à Avignon. Comme on l’a commencé en 2017, en plusieurs étapes, le projet a eu le temps de mûrir. «J’ai un certain âge. Le grand choc, selon moi, reste le Sacre du printemps de Pina Bausch, qui fit l’ouverture de la cour d’honneur en 1995. Et tous les spectacles de Krystian Lupa. Chaque année, il y a au moins un spectacle inoubliable. En faire partie, en être, c’est assez impressionnant. J’espère que la présence de ma compagnie – on est tous très métissés – envoie le signe qu’il est possible et désirable d’être là quand on est issu d’un quartier populaire de la diversité de l’émigration postcoloniale.» A.D

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 5, 2021 3:51 AM
|
Publié dans le journal La Terrasse - Juillet 2021 Propos recueillis par Agnès Santi Passeurs de langues, de poèmes, traducteurs de l’œuvre de Tchekhov, dont La Cerisaie qui inaugure le Festival d’Avignon 2021, André Markowicz et Françoise Morvan sont des auteurs de référence dans le monde du théâtre et de la littérature.
Vous avez traduit l’intégralité du théâtre de Tchekhov. Comment avez-vous œuvré ensemble ? Est-ce facile ou difficile de traduire à deux ? André Markowicz : C’est lorsque Georges Lavaudant m’a demandé la traduction de Platonov que nous nous sommes rendu compte ensemble en écoutant les acteurs commencer à jouer que nous étions passés à côté de l’essentiel, à savoir le comique très particulier de Tchekhov. Nous nous sommes mis à corriger dans l’urgence, puis à refaire le texte pour l’édition (mais l’éditeur se moquait complètement d’avoir un texte amélioré et nous avons dû interrompre nos recherches). Bizarrement, par la suite, c’est encore par hasard que nous avons appris que Platonov était mis au programme des classes A3 et que notre traduction était épuisée. Nous avons alors saisi l’occasion d’en finir avec ce vieux remords et de donner une vraie traduction de Platonov, le texte intégral qui n’avait jamais été traduit, et que nous avons pu restituer grâce à l’extraordinaire édition des Œuvres complètes de l’Académie des sciences de l’URSS. Ainsi avons-nous commencé et terminé par la première pièce de Tchekhov en parcourant entre-temps l’ensemble de son théâtre à deux, selon la même méthode, l’un (moi) faisant un mot à mot très rapide, comme si j’entendais le texte russe et le transcrivais d’oreille ; l’autre (Françoise) faisant le travail d’investigation et de ciselure jusqu’à la phase finale, de travail avec les acteurs, phase décisive, qui s’est d’ailleurs prolongée au fil des mises en scène. Françoise Morvan : On ne peut pas vraiment dire que nous avons travaillé à deux si l’on tient compte des améliorations apportées grâce au travail avec des metteurs en scène (notamment Alain Françon) et des comédiens ou des étudiants… C’était à chaque fois passionnant. Nous n’avons pas du tout trouvé difficile de travailler à deux. La lenteur introduite nous a permis d’être plus précis et surtout de prendre conscience que nous préférions de loin les versions originales des pièces, telles que pensées par Tchekhov, aux versions publiées après avoir été modifiées à la demande de ses metteurs en scène. Ne nous donnant pas le droit d’imposer nos préférences, nous avons publié les deux versions et c’est généralement la version originale qui est jouée à présent. Ainsi Tiago Rodriguez joue-t-il la version originale de La Cerisaie, avec l’acte II inversé, tel que nous l’avions découvert quand Stéphane Braunschweig nous avait demandé la traduction de la pièce. Quelles sont vos conceptions respectives du travail de traduction ? Est-ce trahir, comme on a l’habitude de le dire ? Est-ce partager ? Est-ce comme vous l’avez dit, André, « un exercice de reconnaissance, de gratitude envers l’autre que nous rendons accessible à nous-mêmes » ? A.M. : J’ai commencé à traduire quand j’étais au lycée grâce à un éminent professeur qui avait été chassé d’URSS et qui avait créé un groupe de traducteurs : Efim Etkind adoptait naturellement la méthode de traduction en vigueur en Russie qui avait donné des chefs-d’œuvre du genre, permettant à des écrivains de vivre alors même qu’ils étaient interdits de publier. Cette méthode repose sur un respect scrupuleux de la forme, le texte étant considéré comme un ensemble organique, ce qui est à l’opposé de la méthode française, si toutefois c’est une méthode, disons plutôt la pratique habituelle en France, qui consiste à ignorer la forme pour transposer le sens. Ainsi les poèmes à la métrique la plus stricte sont-ils traduits en prose. Je m’efforce précisément de ne pas trahir. F.M. : Au début, j’étais vaguement adepte de la méthode française mais, à dire vrai, pas vraiment non plus car j’avais inauguré ma carrière en classe de sixième en traduisant une comptine anglaise de manière à ce qu’elle se chante aussi bien en français qu’en anglais. J’étais donc adepte sans le savoir de la méthode russe. Par la suite, j’ai traduit l’anglo-irlandais de Synge en franco-breton, ce qui est aussi tout à fait contraire à la tradition française qui vise à la normalisation, mais c’était encore une façon de ne pas trahir. Il s’agit bien de partager l’étranger en ce qu’il a d’étrange sans le réduire à soi et l’on peut dire que, oui, c’est un exercice de reconnaissance. « IL S’AGIT BIEN DE PARTAGER L’ÉTRANGER EN CE QU’IL A D’ÉTRANGE SANS LE RÉDUIRE À SOI. » FRANÇOISE MORVAN « TCHEKHOV EST UN AUTEUR D’UNE INTELLIGENCE VERTIGINEUSE. » ANDRÉ MARKOWICZ Vos traductions ont souvent été portées à la scène. Qu’est-ce que cela fait de voir ces mots dans la bouche des acteurs ? Quelle est votre relation au théâtre ? F.M. : Si nos traductions hérétiques, objets, à l’origine, de tant de vindicte (dans le cas d’André surtout), ont pu circuler naturellement, c’est surtout grâce au théâtre. Quand les universitaires s’acharnaient à dénoncer les traductions « vulgaires » de Dostoïevski, ou les « vers de mirliton » d’Eugène Onéguine, un metteur en scène s’emparant du texte lui donnait vie, et, dans le cas de Tchekhov, par chance, les metteurs en scène qui ont été à l’origine de nos traductions étaient très respectueux du texte. Non seulement ils nous ont amenés à améliorer la traduction mais à affiner notre perception du texte en situation. Comprendre qu’il faut traduire simultanément ce qui se dit et ce qui ne se dit pas est essentiel pour Tchekhov, et les répliques palimpseste ne peuvent se traduire qu’en fonction de la situation et du jeu. A.M. : Nous avons d’ailleurs assez vite pris la décision de ne plus jamais publier un texte qui n’ait pas été joué. Un texte de théâtre ne peut pas se dispenser de la voix et de l’épreuve du plateau. Lors du travail à la table avec Tiago Rodriguez, nous avons encore découvert des facettes de la pièce dont nous n’avions pas pris conscience. Tchekhov est un auteur d’une intelligence vertigineuse. En quoi l’acte de traduire est-il perméable au contexte culturel, politique, social, moral du moment de la traduction ? Traduire, n’est-ce pas dépasser ce qui est contemporain ? S’opposer à toute forme de censure ? A.M. : L’acte de traduire est éminemment politique. En témoigne la récente polémique au sujet de la traduction du poème d’Amanda Gorman, qu’elle a lu lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden, et qui, à en croire une critique, ne pouvait être traduit que par une noire du fait qu’elle était noire. C’est bien en tant que traducteur que j’ai protesté contre cette nouvelle forme de racisme. F.M. : Et c’est bien, à l’origine, mon refus de falsifier les carnets d’un folkloriste breton qui m’a valu d’être honnie par les nationalistes bretons, au point d’être depuis objet de menaces et d’invectives. Les carnets de ce folkloriste, que j’ai traduits, sont à présent introuvables, et il m’est impossible d’intervenir publiquement, quel que soit le sujet, sans voir surgir des hordes de militants. Traduire, c’est résister à la censure, j’en suis l’exemple (encore) vivant… Propos recueillis par Agnès Santi Site à consulter francoisemorvan.com La Cerisaie de Anton Tchekhov
du Lundi 5 juillet 2021 au Samedi 17 juillet 2021
Cour d’honneur du Palais des Papes
à 22h. Relâche le 7 et 13 juillet. traduction André Markowicz et Françoise Morvan, mise en scène Tiago Rodrigues.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...