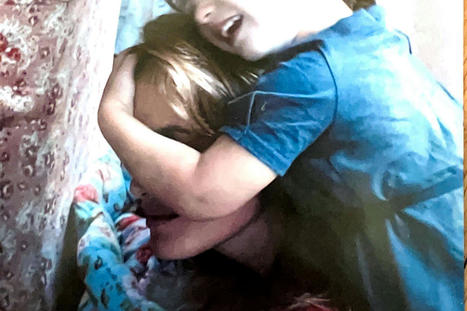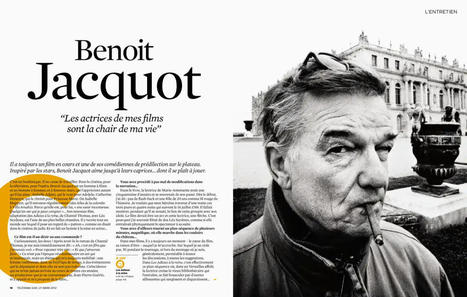Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 17, 2024 7:12 AM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 1er janvier 2024 Entre création, tourisme et cohésion sociale, l’association aveyronnaise Derrière le hublot invente un projet culturel en zone rurale des plus inspirants, à l’heure où le secteur cherche à «réenchanter l’institution». Mais qu’est-ce qu’ils ont tous avec Capdenac-Gare, ville de 4500 habitants nichée sur les rives du Lot ? Qu’est-ce qu’ils ont tous, dans le milieu de la culture mais aussi celui de la transition écologique ou du social, à scruter autant les expériences que mènent dans le grand Figeac, sur les chemins de Compostelle, ou dans les petits bars de l’Aveyron, l’association culturelle Derrière le hublot ? Qui ça, «tous» ? Tous ! Des artistes contemporains comme Abraham Poincheval, des architectes comme Manuelle Gautrand ou le collectif Encore heureux, des photographes comme Nelly Monnier et Eric Tabuchi (Atlas des régions naturelles), des directeurs de théâtre ou de musées soucieux de «réinventer les liens aux spectateurs», des metteurs en scène et plasticiens curieux des projets originaux, sans lieu fixe, qui s’y développent : autour de l’imaginaire de l’autoroute l’A75, autour de celui des refuges pour randonneurs, autour des «services d’art à domicile» pour personnes isolées, autour de banquets funéraires alternatifs… Début octobre, 120 professionnels du secteur fédérés par la Direction générale de la création artistique affluaient sur le causse, curieux d’écouter entre autres les projets interlopes qu’un «enfant du pays», Fred Sancère, 45 ans, mène depuis 1996 sur un périmètre rural d’une centaine de kilomètres. Il y a quelques jours encore, le fondateur et directeur artistique de Derrière le hublot était même reçu au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. A croire que sur ce microterritoire se cache une potion précieuse. Peut-être un des remèdes aux maux dont souffrent les institutions culturelles classiques, cherchant toutes la route vers une nouvelle ère de la démocratisation culturelle. Sans doute aussi, le meilleur des contre-exemples à opposer à Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui taclait au printemps cette prétendue gauche de snobs indifférente aux «déserts culturels». «Cette œuvre m’a maintenu en vie» On comprend mieux l’enthousiasme en remontant le cours du Lot pour atterrir, ici, un soir de pluie au bar de l’Hôtel de Paris à Capdenac. Sur la table, un demi d’ambrée et le récit de Jo, 75 ans, ancien cheminot et aujourd’hui «veilleur» à vie. «Veilleur», ça vient du titre donné à un projet artistique hors normes mené l’an passé par Derrière le hublot et qui a impliqué pendant trois cent soixante-cinq jours des habitants du coin, des touristes, des agriculteurs, la pharmacienne, le curé, des élus. Tous les âges, différents milieux socioculturels, quasi aucun profil de spectateur habituel. En haut de la falaise, en surplomb du village, était installé un abri en bois vitré dans lequel une seule personne, chacune son tour, venait «veiller» une heure sur le paysage à chaque lever et à chaque coucher de soleil. Autrement dit : le genre de concept poético-paysager incongru sur lesquels les chiens de garde de la droite dure adorent taper. Délires de bobo, vraiment ? Ce serait un plaisir de laisser Jo leur répondre : amenuisé par un cancer sévère au début du projet, coupé de la vie militante et syndicale qui occupait jusqu’alors sa vie, l’ex-conducteur de train n’ira pas par quatre chemins. «Je dis pas ça pour les flatter, mais cette œuvre, moi, elle m’a maintenu en vie.» Jo habite la maison en surplomb du village, en haut de la falaise, juste à côté de l’abri. Autant dire que ce paysage, il le connaît. «Ça paraît bête, hein, mais je ne l’avais jamais regardé.» En contrebas gît la trace de sa vie professionnelle. Sur la rive gauche du Lot, un entrelacs de rails de trains jouxte des entreprises agroalimentaire et aéronautique. On dit que la petite ville offre une «synthèse exceptionnelle de la révolution des transports». Démarché par l’équipe de Derrière le hublot un jour de marché, Jo a d’abord froncé les sourcils devant le truc de l’abri. Aujourd’hui il sait donner la date de sa première veille – «10 juillet 2022» –, il en fait cinq autres et a accompagné environ 70 autres veilleurs dans l’abri sur toute l’année. «Ici, ce genre d’expériences communes, ça se termine souvent par un apéro ou un resto tous ensemble en bas», se souvient Fred Sancère. Chaque fois, il y avait Jo. Evidemment, admet une autre ancienne veilleuse, certains «se sont emmerdés» dans l’abri : allez, deux d’entre eux ont manqué de chance en se retrouvant face à une vue bouchée par le brouillard matinal. Mais tous les autres, assure-t-elle, ont «adoré». C’est qu’à partir de cette boîte en nid d’aigle est né un curieux réseau de sociabilité, quelque chose qui n’était pas prévu sur le papier. Une petite grappe d’anciens veilleurs continue de se retrouver tous les mois, participe à l’écriture d’un livre sur la petite sentinelle de Capdenac, ont pris contact avec d’autres veilleurs de France. «Faire partie d’une grande chaîne humaine» Le Cycle des veilleurs, initialement conçu par l’artiste Joanne Leighton, a en effet été décliné de Rennes à Montreuil. Toujours en milieu urbain. Capdenac est l’exception, à laquelle la conceptrice elle-même croyait peu au départ. C’est qu’il fallait convaincre 730 riverains de se lever pour certains à 4 heures du matin pour ne rien faire d’autre qu’observer un paysage qu’ils connaissent pour la plupart déjà, d’accepter de se faire prendre en photo à la sortie, d’écrire un petit mot sur le carnet commun. Ça aurait pu être un flop, c’est devenu «leur» abri. «La petite lumière qui s’allumait matin et soir pour indiquer qu’un veilleur entrait me manque, même !» sourit Nadine, attablée à côté de Jo à l’Hôtel de Paris. Comme d’autres habitants, la retraitée avait choisi une date symbolique pour son jour de veille, celle du jour d’anniversaire de la mort de son compagnon. D’autres ont choisi la date d’une rencontre amoureuse, d’une naissance, d’un solstice, d’une pleine lune. Ce qu’Edith, elle, a trouvé émouvant dans l’abri, ce n’était pas uniquement la contemplation, c’était d’«avoir conscience de faire partie d’une grande chaîne humaine, longue d’une année, qui connectait autant de gens. On était à la fois seuls et liés». Fred Sancère a voulu inviter le Cycle des veilleurs chez lui à Capdenac à la sortie du Covid, lorsqu’il cherchait un projet artistique qui puisse parler humblement de solidarité et d’attention collective. L’attachement des riverains à «leur» abri l’a conforté dans le virage qu’il était en train d’entamer : diminuer encore davantage la part de diffusion artistique classique (les spectacles en salle) pour favoriser plutôt les œuvres et aventures fabriquées à partir des données locales (son paysage, ses modes de vies, ses habitants). Elles peuvent prendre la forme de gestes simples, «hors radars», dit Fred Sancère, comme ces balades touristiques alternatives réalisées par des riverains comme Jacques, qui nous raconte le long des étangs l’histoire ouvrière du coin, la mobilisation à laquelle il a pris part contre un projet d’enfouissement des déchets prévu pile sur une incroyable réserve de biodiversité, la tentative de sauvegarde du patrimoine industriel avec les copains. Fred Sancère, lui, balade qui veut dans les arrière-boutiques des boulangeries et charcuterie de son village. Refuge féerique en coquilles Saint-Jacques Une expérience, plus que les autres, a médiatisé la démarche du Hublot : la création depuis 2018 de plusieurs refuges alternatifs sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, menée en complicité avec des architectes, des artistes, les maires des petites communes avoisinantes ou l’énergique présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy, Catherine Marlas, qui vante la façon qu’ont eue tous ces créateurs de «retravailler les savoir-faire locaux, en concertation avec les artisans et les habitants». Dans le refuge féerique tout en coquilles Saint-Jacques où elle nous reçoit dans le froid glaçant de décembre, un livre d’or attend les promeneurs. Dedans, non pas deux ou trois messages, mais plus d’une centaine, souvent émerveillés, sont griffonnés sur les pages. Le dernier date du début du mois. Nicolas, de Bayonne : «Arrivé tard sous une pluie battante, seul, trempé jusqu’au slip, je n’ai pu admirer votre œuvre à la tombée de la nuit. Au lever du soleil, je regarde, je me dis quelle chance d’avoir eu un si bel abri pour dormir.» Le maire de Limogne-en-Quercy nous en lit fièrement une dizaine d’autres en guettant chaque lueur d’admiration sur le visage de la journaliste. Appelons ça «art in situ» si l’on veut, ou «œuvres contextuelles». Elles nécessitent en tout cas de bien connaître le coin. Fred Sancère, lui, ne l’a jamais quitté, à part pour quelques années d’études en anthropologie à Bordeaux. Fils du projectionniste du cinéma local et d’une secrétaire, ce «pur produit de l’éducation populaire» investi depuis enfant dans le milieu associatif, montait dans son bled, à 20 ans à peine, des concerts de punk rock avec ses copains de maternelle. Aujourd’hui, il joue joyeusement son rôle d’anomalie totale dans un secteur culturel où les carrières se font habituellement loin des «trous paumés». Il s’enthousiasme de voir que sa success story du terroir inspire à l’échelle nationale. Il n’aimerait pas le terme «success story» et calmerait sans doute la romantisation. Attention, Derrière le hublot demeure une petite équipe (7 personnes), sans moyens délirants, même si l’obtention en 2020 du label «Scène conventionnée d’intérêt national art en territoire» a donné un coup de pouce. Aussi, «j’aurais beau jeu de dire qu’on est les seuls à expérimenter comme on le fait : Francis Peduzzi au Channel à Calais a ouvert la voie, et aujourd’hui des structures comme Scènes croisées en Lozère ou Pronomades – même s’ils sont uniquement axés sur du spectacle vivant – font aussi un super boulot sur les espaces ruraux». Face à la morosité du secteur culturel (multiplication des conflits sociaux au sein des établissements, flambée du coût de fonctionnement des équipements), lui a l’air de s’éclater au volant de sa vieille Merco propulsée sur les lacets de routes aveyronnaises, occupé à faire ce qu’il préfère : «inventer des manières de faire se rencontrer les gens», développer l’agilité suffisante pour frapper à différents guichets de financements (côté culture, mais aussi côté tourisme, social, territoire). Et transmettre un peu de sa frénésie à inventer son métier sur-mesure. Parce que la mission classique d’un programmateur «c’est un peu chiant, non ?» En tout cas, parfois, «décourageant». Disons que la fameuse «crise des vocations» pour diriger les institutions culturelles, pointée il y a quelques semaines par la ministre de la Culture, tout cela n’a rien d’étonnant. Il l’a d’ailleurs signifié à Rima Abdul-Malak, précise-t-il, en accélérant bien les virages au volant. «C’est bien de former des jeunes gens de la diversité à prendre les rênes des institutions culturelles loin de chez eux. Mais ce serait super de les aider parfois à rester à proximité pour inventer des prototypes.» Légende photo : Un refuge alternatif du collectif Encore heureux, en 2020. (cyrus cornut)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 16, 2024 5:46 AM
|
Par Clarisse Fabre (Berlin, envoyée spéciale) dans Le Monde - le 16 février 2024 La guerre en Ukraine ou à Gaza, la montée de l’extrême droite en Allemagne ont plané sur le premier jour du festival de cinéma allemand, le 15 février. Lire l'article sur le site du "Monde' :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/16/a-la-berlinale-la-politique-s-invite-a-la-ceremonie-d-ouverture_6216883_3246.html
On n’avait jamais vu ça à la Berlinale. Jeudi 15 février, deux heures avant l’ouverture de la 74e édition, qui se tient jusqu’au dimanche 25 février, une action antifasciste prend place non loin du Berlinale Palast, l’équivalent du Palais des festivals, à Cannes, sur la Gabriele-Tergit Promenade. Une vingtaine d’artistes, alignés, brandissent un panneau en carton portant une seule lettre, écrite en capitale, le tout formant ce slogan : « No Seats for Fascists Anywhere » (« pas de sièges pour les fascistes, nulle part »). Ce mot d’ordre vise l’équipe de la Berlinale, alors que les deux directeurs du festival, Carlo Chatrian et Mariette Rissenbeek, ont « désinvité », sous la pression du personnel, cinq élus de l’extrême droite allemande (AfD) qui avaient prévu d’assister à la cérémonie d’ouverture, à l’instar de représentants d’autres partis. La montée de l’extrême droite dans le pays, conjuguée à la réunion de membres de l’AfD dans un hôtel de Potsdam, le 25 novembre 2023, en vue de discuter d’un projet d’expulsion à grande échelle d’Allemands d’origine étrangère, ont fortement inquiété une partie de la population, laquelle s’est mobilisée lors de manifestations de grande ampleur, ces dernières semaines. « La Berlinale n’a aucune place pour la haine. La haine n’est pas sur notre liste d’invités », a martelé Mariette Rissenbeek, qui partira à la retraite à l’issue de cette édition. Carlo Chatrian quittera lui aussi ses fonctions et le duo sera remplacé par l’Américaine Tricia Tuttle, responsable du département de réalisation de longs-métrages à la National Film and Television School, à Beaconsfield, au nord-ouest de Londres. Le tapis rouge n’aura pas été seulement une scène glamour. Pendant le cocktail de la cérémonie d’ouverture, une beauté rousse en robe bustier portait un sautoir en strass avec le message « Fuck AfD », tandis qu’un jeune homme noir arborait une cape blanche sur laquelle on pouvait lire : « More Empathy » (« plus d’empathie »). La couleur de la peau a son importance, a souligné la présidente du jury berlinois, la Mexicano-Kényane Lupita Nyong’o, une actrice oscarisée en 2014 pour son rôle dans 12 Years a Slave, de Steve McQueen : « Je suis la première femme noire à présider le jury de la Berlinale », a-t-elle déclaré avec fierté. A ses côtés, la poétesse ukrainienne et membre du jury de la compétition Oksana Zaboujko a raconté sur scène le grand écart de sa journée : le matin même, elle était en ligne avec des proches qui lui racontaient les derniers bombardements russes et leurs nouvelles victimes, avant de se retrouver quelques minutes plus tard à prendre la pose devant un photographe de la Berlinale… La guerre ne se laisse pas oublier : le deuxième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie aura lieu pendant le festival, samedi 24 février, tandis que le conflit mené par Israël dans la bande de Gaza fait rage, en réponse au massacre perpétré par le Hamas, le 7 octobre 2023. Un Ours d’or d’honneur pour Scorsese Il restait quand même encore un peu de place pour le cinéma. L’acteur irlandais Cillian Murphy, dans la course aux Oscars pour son rôle dans Oppenheimer, de Christopher Nolan, est venu présenter le film d’ouverture, jeudi soir, Small Things Like These, de Tim Mielants, un drame un brin psychologisant sur l’exploitation de filles mères dans une institution catholique. Quelques stars américaines sont attendues, comme le réalisateur Martin Scorsese, qui recevra un Ours d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, mais aussi l’actrice Kristen Stewart, qui tient le rôle principal dans un thriller musclé, Love Lies Bleeding, de Rose Glass, présenté en séance spéciale. Côté compétition, Olivier Assayas dévoilera, samedi 17 février, Hors du temps, un film à la veine autobiographique, qui évoque le confinement à la campagne de deux frères avec leurs nouvelles compagnes. Parmi les autres longs-métrages concourant à l’Ours d’or, citons Langue étrangère, de Claire Burger ; Dahomey, de la Franco-Sénégalaise Mati Diop ; Black Tea, du Mauritanien Abderrahmane Sissako ; L’Empire, de Bruno Dumont ; ou encore A Traveler’s Needs, du Sud-Coréen Hong Sang-soo, avec Isabelle Huppert, dont la venue à Berlin est annoncée. Inévitablement, les conflits seront au cœur de plusieurs longs-métrages. Abel Ferrara, aperçu jeudi soir en train de signer des autographes, présentera, les 17 et 18 février, Turn in the Wound, en séance spéciale, un documentaire filmé sur le front en Ukraine, tandis qu’Amos Gitai a choisi une forme performative pour dénoncer, dans Shikun, tourné avant le 7 octobre 2023, la politique d’Israël à l’égard des Palestiniens, à travers la voix, entre autres, de l’actrice Irène Jacob. Clarisse Fabre (Berlin, envoyée spéciale) / LE MONDE Légende photo : Le mannequin sénégalais Papis Loveday tient une pancarte, avec l’inscription « Pas de racisme ! Pas d’AfD ! », sur le tapis rouge devant le Berlinale Palast lors de l’ouverture de la 74e Berlinale, à Berlin, le 15 février 2024. EBRAHIM NOROOZI/AP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 15, 2024 10:23 AM
|
La compagnie havraise s’installe pour deux mois au théâtre de l’Atelier à Paris avec un spectacle qui mêle danse et théâtre autour de la futilité de certaines conversations. Créé en juin 2021, au Havre, ce spectacle au titre déroutant – Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable) – s’installe jusqu’au 10 mars 2024 sur la scène du théâtre de l’Atelier à Paris. "Une expérience très nouvelle" pour la compagnie havraise PJPP. " Rester deux mois au même endroit, c’est assez rare", souligne le chorégraphe et interprète, Nicolas Chaigneau. L’originalité du spectacle tient d’abord au choix du thème, à savoir la bêtise humaine, à travers ces situations de la vie courante où les échanges se résument à une succession de banalités dont on a parfois du mal à sortir. L’autre particularité, c’est d’aborder chaque scène tant du point de vue théâtral que chorégraphique. Avec, pour seul décor, dix chaises déplacées au gré des scènes, le spectacle laisse aussi une large part à l’improvisation au niveau du texte. Cela donne lieu à des échanges à la fois totalement plats et décalés sur la différence entre une assiette plate et une assiette creuse... La compagnie PJPP s'installe au théâtre de l'Atelier, à Paris, avec un spectacle original autour de la bêtise humaine. - (FRANCE 3 NORMANDIE / I. Ganne / N. Berthier / C. Lefèvre) Les Galets au Tilleul... est la première partie d’un diptyque baptisé Le Vide(dont le deuxième volet est intitulé Dernière). Derrière ce titre un peu surréaliste,il y a une histoire, racontée en juin 2022 par la chorégraphe et interprète Claire Laureau à nos confrères du journal La Terrasse : "Les Tilleuls, c’est un village près d’Étretat. Nous étions en voiture et Nicolas a affirmé que la plage des Tilleuls était vraiment agréable, les galets étant plus petits… et notre régisseur a dit : 'Non, ils ne sont pas plus petits qu’au Havre'. Ça a généré un débat d’un quart d’heure sans aucun intérêt. Moi, j’étais derrière et ça m’a fait sourire." Travail d'improvisation Cet échange anodin a ensuite donné lieu à un travail durant lequel la troupe a répertorié des personnages et des situations caricaturales évoquant chacun à sa manière une certaine forme de bêtise. Chaque jour, les interprètes se sont entraînés à improviser différentes situations, que nous avons tous vécues, comme : "Parler sans interruption en rebondissant sur son propre discours, être retenu par quelqu’un qui ne cesse de parler et ne mesure pas notre désir de partir ou encore tenter de comprendre quelqu’un qui ne parvient pas à s’expliquer". Mais pas question pour Claire Laureau et Nicolas Chaigneau de "fairele procès de la bêtise, bien au contraire. Ce spectacle en serait plutôt une tendre célébration, car la bêtise n’épargne personne. Et finalement, eux, c’est nous !" Si Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre se focalise sur la bêtise, Dernière, le deuxième volet, est davantage centré sur l'échec à travers l'histoire de deux artistes et de leurs tentatives désespérées pour rendre convaincant un spectacle qui ne l'est pas. Dernière est actuellement en tournée. "Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre" jusqu'au 10mars2024 au théâtre de l'Atelier à Paris-vendredi et samedi à19h/dimanche à15h-durée: 1h-Tarif: à partir de 22euros. "Dernière" en tournée : le 14 mars 2024 à Petit-Couronne (76) et les 16 et 17 mai 2024 à Saint-André-lez-Lille (59). Légende photo : Nicolas Chaigneau, Claire Laureau, Julien Athonady et Marie Rual, les quatre danseurs interprètes de "Les Galets au Tilleul sont plus petits qu’au Havre". (FRANCE 3 NORMANDIE)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 14, 2024 8:34 AM
|
Article publié par Mediapart le 12/02/24 Depardieu, Jacquot, Doillon... Le cinéma français est secoué par les affaires de violences sexuelles. Cette nouvelle onde de choc interroge l’imaginaire d’une industrie tout entière et toute la société. Notre émission en accès libre, avec notamment Judith Godrèche, Anna Mouglalis, Charlotte Arnould et Anouk Grinberg. Judith Godrèche, Adèle Haenel, affaires Depardieu, Polanski, Caubère, Bedos, Brisseau, Doillon, Jacquot, etc. : depuis six ans, l’industrie cinématographique est en première ligne des soubresauts du mouvement #MeToo.
Elle est aussi au centre des résistances et des polémiques. Avec, encore dans de nombreux discours, la figure sacralisée de l’artiste et une culture de l’impunité très française. La dernière séquence, à nouveau portée par le cinéma, marquera-t-elle enfin un tournant ?
Sur Mediapart, Mathieu Magnaudeix et Marine Turchi reçoivent Judith Godrèche, actrice et réalisatrice, les actrices Anna Mouglalis, Charlotte Arnould et Anouk Grinberg, Manda Touré et Marie Lemarchand, actrices et membres de l’Association des acteur.ices (ADA), Noémie Kocher, autrice, actrice et membre de la commission AAFA-Soutiens, et Iris Brey, autrice, réalisatrice et ancienne critique de cinéma. Voir la vidéo (1h52)
Pour cette émission, Mediapart a sollicité, par l'intermédiaire de leurs avocat·es, Gérard Depardieu, Benoît Jacquot, Jacques Doillon, Philippe Garrel. « Pas de réaction ni commentaire », nous a répondu l’avocate de Benoît Jacquot, Me Julia Minkowski. Concernant MM. Depardieu, Jacquot, Doillon, des procédures judiciaires sont en cours et ils bénéficient donc de la présomption d’innocence.
Retrouvez toutes nos émissions en accès libre.
Boîte noire

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2024 6:34 AM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération - 9 février 2024 Le metteur en scène fait retentir la verve de «l’Arbre à sang» et «Qui a besoin du ciel», portraits crus de femmes insoumises dans des dispositifs minimalistes. Pas de grands gestes de mise en scène, pas de vidéo, pas de micro, Tommy Milliot, nouveau directeur du Centre dramatique national (CDN) Besançon Franche-Comté jette sur le plateau deux textes contemporains, littéralement coup sur coup. En un, l’Arbre à sang, de l’Australien Angus Cerini, en deux Qui a besoin du ciel de l’Américaine Naomi Wallace. Point commun : portrait de femmes au-delà des larmes. Jouir du massacre D’abord l’Arbre à sang, dispositif trifrontal pour trois chaises et trois femmes, une mère et ses filles, dans une ferme perdue quelque part en Australie, qui exposent par le menu l’assassinat de leur salaud de père. C’est leur récit de Théramène à elles : Ida lui pète les genoux, Ada la gueule et M’man l’achève à coup de calibre 12 dans la nuque «avec une balle dans le cou ta tête de crétin a l’air bien mieux qu’avant», avant de découper et filer tout ça à bouffer aux poules, et s’il en reste on en fera une soupe. C’est réglé, le calvaire a pris fin, dernier acte après des années de terreur familiale, quand «tout ce temps vous saviez, vous faites quoi vous et les autres hommes ? Vous laissez faire, vous laissez faire ce qu’il fait». Alors ce sont les femmes qui se cognent le sale boulot, trois femmes entre elles qui se racontent avec le sadisme jubilatoire du conte l’histoire de leur revanche. Comment ? en y allant direct, à cru, l’auteur a supprimé les pronoms ; ces femmes n’ont pas le temps de la grammaire. Ça n’a rien à voir avec leur condition de péquenaudes white trash, mais avec la nécessité sauvage de cracher une langue primitive, où dire «je» n’a plus de sens. Est-ce que les bêtes disent «je» ? «Me demande juste si qu’on va aller en enfer», s’interroge Ida. «Si qu’en enfer on va alors c’est quoi qu’on vivait avant ?» assène la mère. Des phrases courtes, sans sujet, mais avec des verbes – pour passer à l’acte – et pas mal de compléments – pour jouir du massacre –, le tout bourré d’assonances qui créent du sens et du bruit, le texte travaille un rudimentaire poétique, comme la mise en scène qui compte sur ses trois comédiennes Lena Garrel, Dominique Hollier et Aude Rouanet pour faire le boulot. Et elles le font. Jusqu’à nous servir de la soupe en fin de partie. De la soupe populaire ? OUI. Pause et c’est reparti pour une heure vingt avec Qui a besoin du ciel de Naomi Wallace. Cette fois il y a un décor, enfin, limité à deux murs ocre et une chaise sur laquelle est attachée Wilda Spurlock encore pour quelques jours histoire de décrocher. Wilda est complètement addicte aux opiacés que lui refile depuis des années son docteur. Une fois clean, elle ira faire chanter le patron de l’usine Kentucky Aluminium, elle sait des choses qui pourraient lui rapporter pas mal de fric et peser dans sa décision de fermer l’usine – ce qui plongerait la petite ville ouvrière du Kentucky dans une catastrophe sociale. Arrive sa locataire. C’est Annette Patterson, guide – mais pour combien de temps ? – dans les grottes du parc national de Mammoth Cave, une femme possédée par son sujet dont elle connaît l’histoire invisibilisée : «Ils t’ont appris que le vieux Jules [Verne] avait pas assez d’imagination pour inclure les esclaves qui trimaient tout au fond des grottes pour en extraire les salpêtres du sol ? […] que les premiers guides étaient des esclaves ? C’est eux qui ont ouvert l’âge d’or de la spéléologie !» Et de rappeler les noms de «Stephen Bishop, cet esclave métis qui fut l’un des plus grands explorateurs que Mammoth Cave ait jamais connus […] Will Garvin, Ed Hawkins ! Nick, Matt et Henry Brantford.» Faire acte de résistance Qui a besoin du ciel est l’émancipation de ces deux femmes fragilisées mais combattantes des classes populaires qui dévient du «tracé officiel», et embarquent dans leur colère les sept autres personnages tout aussi cassés. Le texte absolument formidable de Noami Wallace travaille à plein régime la métaphore des grottes – ou comment explorer des voies souterraines pour faire acte de résistance – sans jamais céder au kitsch. Mais côté mise en scène, Tommy Milliot pèche par son application, et trouve, une fois encore, sa force dans ses deux actrices impressionnantes Catherine Vinatier et Marie-Sohna Condé, bien au-dessus du reste d’une distribution malheureusement inégale. Laurent Goumarre / Libération L’Arbre à sang d’Angus Cerini. Qui a besoin du ciel de Naomi Wallace. Mises en scène de Tommy Milliot, jusqu’au 10 février au festival Les Singulier-es au Centquatre. Du 3 au 6 avril et du 10 au 12 avril à La Criée Théâtre national de Marseille.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2024 5:58 AM
|
Tribune d'Hélène Frappat publiée par Le Monde - 13/02/24 Saluant le témoignage de Judith Godrèche, enfin entendue, l’autrice et critique de cinéma dénonce, dans une tribune au « Monde », « l’arnaque du romantisme » qui a engendré le modèle du créateur transgresseur et de sa « muse ». Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/02/13/helene-frappat-ecrivaine-toutes-les-femmes-sur-l-ecran-du-cinema-qui-est-la-vraie-vie-agrandie-sont-des-survivantes_6216262_3232.html
Un vent de révolte souffle sur la France. En donnant voix à la petite fille qu’elle a été, Judith Godrèche a brisé le sortilège par lequel chaque femme, qui n’est « rien d’autre qu’une petite fille qui a grandi », écrivait Henry James (1843-1916), doit vivre en composant avec cette créature encombrante, parfois bavarde, souvent muette, ce petit fantôme effrayé contraint, dès la naissance, à s’armer pour survivre. C’est la révolte des petites filles ! Il semble que notre pays culturellement réactionnaire, cette fois-là, ne pourra pas les museler. C’est quoi le problème de la France ?, me demandait récemment un journaliste du New York Times. Il peinait à comprendre pourquoi la nation autoproclamée des droits de l’homme demeurait la dernière à soutenir (financer, louanger, défendre) des cinéastes bannis des Etats-Unis pour des crimes sexuels, tels Woody Allen ou Roman Polanski. J’ai réfléchi. Peu à peu, des armées de jeunes filles mortes me sont revenues en mémoire, des processions de revenantes ont défilé devant mes yeux, me soulevant le cœur. Le problème français, ai-je répondu, c’est l’arnaque du romantisme. Je parle du mouvement artistique produit par notre XIXe siècle ultrabourgeois et réactionnaire. Ce siècle qui a sanctifié la propriété et l’autorité du père de famille sur sa femme, justifié le meurtre de l’épouse infidèle en qualifiant de « crime passionnel » ce que des historiennes nomment désormais « féminicide », a simultanément engendré notre modèle du créateur transgresseur et de sa « muse ». Corps virginal et bouche muette – un silence évoquant les planches anatomiques de la Grèce antique, où les deux bouches de la femme, utérus et bouche parlante, sont muselées par un même verrou –, « éternel féminin », « morte amoureuse » : la muse est un cadavre de femme, un cadavre de petite fille. La violence et la domination des forts Vous voulez savoir pourquoi la condition féminine existe, qu’on le veuille ou non ? Parce qu’en chaque femme, jeune ou vieille, une petite fille subsiste. Tel le Petit Chaperon rouge auquel Judith Godrèche a comparé, sur France Inter, le 8 février, l’enfant qu’elle a été – une enfant qui a commencé à gagner sa vie à 8 ans en tournant dans des publicités, avant d’être choisie à 14 ans par un loup fier de son « syndrome de Barbe-Bleue », le cinéaste Benoît Jacquot – chaque femme apprend, dès la naissance, que sa vie sera, aussi, une survie. « Le chant du loup est le bruit du tourment qu’il vous faudra souffrir ; en lui-même, c’est déjà un meurtre », écrit Angela Carter dans La Compagnie des loups (Points, 1997). L’écrivaine anglaise, disparue prématurément en 1992, avait entrepris de réécrire Barbe-Bleue, La Belle et la Bête, Blanche-Neige… en adoptant le point de vue de l’héroïne, qui, dans la version traditionnelle, est systématiquement mutique, pétrifiée, opprimée, horrifiée, dégoûtée, épousée, massacrée. Et le cinéma dans tout ça ? Est-ce, comme certains se hâtent déjà de le dire, le méchant épouvantail de nos craintes de (bons ou mauvais) parents ? Eh bien non. Bien sûr, « le cinéma » est notre regard agrandi : il est la loupe qui révèle avec une précision clinique, sur les tournages « donc » sur les écrans, la domination des forts, la violence de la lutte des classes ou, comme le cinéaste Jacques Rivette (1928-2016) était le seul à le dire, « la crapulerie » du pouvoir et de l’argent, du pouvoir que donne l’argent. Jacques Rivette, qui respectait les actrices donc les femmes, faisait des films pour sauver les petites filles des mâchoires des loups qui se referment sur elles, y compris dans la maison de leur enfance, car « les loups possèdent des moyens d’arriver jusqu’au cœur de votre foyer » (Angela Carter, La Compagnie des loups). Les mauvais films de Benoît Jacquot ou Jacques Doillon ont été sanctifiés par le bon goût français, c’est-à-dire par le système d’évaluation esthétique de notre bourgeoisie éclairée. Sa vision du monde repose sur l’arnaque romantique. Une arnaque pour les femmes, pas pour les « grands créateurs », qui s’en réclament en expliquant que dans la France de la Nouvelle Vague, un cinéaste « doit » coucher avec sa muse pour trouver son inspiration. (L’inspiration, encore une trouvaille romantique. N’importe quelle femme artiste sait qu’elle n’a matériellement pas le temps d’attendre l’inspiration.) Cette criminelle idiotie, confondant harcèlement et mise en scène, c’est le (grand) cinéaste Philippe Garrel [mis en cause par cinq comédiennes pour des baisers non consentis] qui l’a dite. Le harcèlement est l’une des formes concrètes de notre romantisme. La théorie de l’« évaporation » Avant d’être enfin « entendue », c’est-à-dire que sa parole se change en vérité, Judith Godrèche avait déjà parlé. A certains éminents représentants de notre bourgeoisie cultivée, hommes et femmes de savoir et de pouvoir (confondant savoir et pouvoir), elle avait raconté les violences morales et physiques que Barbe-Bleue lui faisait subir. Tous ont fait « comme si elle n’avait rien dit ». Pschitt ! La parole, c’est-à-dire la personne de Judith Godrèche, a été « évaporée ». « Evaporation » est la traduction que je propose du terme américain gaslighting. Il nous vient du film de George Cukor Gaslight (Hantise, 1944), où ce génie visionnaire met en scène la continuité qui relie la violence de la norme conjugale et le système de destruction et de négation du nazisme. Ce qui se passe dans la maison de Barbe-Bleue ne peut être isolé de la guerre qui fait rage à l’extérieur. Il n’est pas étonnant que nombre de cinéastes et d’acteurs, actuellement accusés de violences sexuelles et d’abus de pouvoir sur des femmes, continuent de se défendre en dissociant leur vie privée de leur art, souvent politique, souvent « de gauche ». Les petites filles, qui n’ont pas le droit de vote, n’ont plus de temps à perdre à subir ce genre de gaslight. Depuis le temps qu’elles écoutent, bien sages, les grands hommes leur expliquer la vie, et l’amour, et le savoir, et la politique, et le sexe, et l’art, elles s’ennuient. Ces discours pompeux, arrogants, stupides leur donnent envie de dormir. Attention ! Il est risqué de fermer les yeux quand on s’appelle Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. Alors les petites filles se passent un film, un vrai film hollywoodien, avec plein de filles sublimes à poil, de minirobes sexy, de talons aiguilles, de faux cils, et aussi des loups terrifiants qui violent en bande, qui mentent, qui massacrent. Ce film, c’est Showgirls, de Paul Verhoeven (1995). Dès la première séquence, l’héroïne qui débarque en stop à Las Vegas (Nevada) est contrainte de sortir un couteau. Le manifeste de Verhoeven appelle une chatte, une chatte : les danseuses de Las Vegas – doubles explicites des actrices d’Hollywood – s’y font maltraiter comme des « putes ». « Toutes » les femmes, sur l’écran du cinéma qui est la vraie vie agrandie, sont des survivantes. Parce que c’est ça qu’on fait : survivre à notre enfance, et à nos loups. « C’est en vivant bien que nous tenons les loups en lisière », écrit Angela Carter. Son Petit Chaperon rouge éclate de rire quand elle comprend qu’elle n’est « la viande de personne ». « Elle ferma la fenêtre sur le chant funèbre des loups et ôta son châle écarlate, de la couleur des coquelicots, de la couleur de ses menstrues et, puisque sa peur ne lui servait à rien, elle cessa d’avoir peur. » Hélène Frappat est écrivaine, critique de cinéma et traductrice. Dernier livre paru « Le Gaslighting ou l’art de faire taire les femmes » (Editions de l’Observatoire, 2023). Hélène Frappat (Ecrivaine) Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2024 5:05 AM
|
Par Jérôme Lefilliâtre et Lorraine de Foucher dans Le Monde - 8 février 2024
« Le Monde » a recueilli trois témoignages visant le réalisateur de « La Fille de 15 ans ». L’avocate de M. Doillon dit vouloir réserver ses explications à la justice.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/02/08/jacques-doillon-accuse-de-viol-d-agression-sexuelle-et-de-harcelement-par-judith-godreche-anna-mouglalis-et-isild-le-besco_6215477_3225.html
Ce jeudi 8 février sur France Inter, Judith Godrèche a accusé le réalisateur Jacques Doillon d’agressions sexuelles sur le tournage du film La Fille de 15 ans, qui a eu lieu au printemps 1987. Il voulait, a-t-elle affirmé, « la même chose » que Benoît Jacquot, contre lequel la comédienne de 51 ans a déposé plainte mardi pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans » commis par personne ayant autorité. « Sur le tournage, c’était hallucinant. Il a engagé un acteur (…), il l’a viré et il s’est mis à la place. Tout à coup, il décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe entre lui et moi. On fait quarante-cinq prises. J’enlève mon pull, je suis torse nu, il me pelote et il me roule des pelles. » Tout cela se déroule sous les yeux de Jane Birkin, alors compagne du réalisateur, qui l’a engagée comme assistante sur le film. « Il embrassait vingt fois de suite Judith Godrèche en me demandant quelle était la meilleure prise. Une vraie agonie ! », a raconté Birkin dans son journal intime paru en 2018, Munkey Diaries. Le film La Fille de 15 ans est sorti en salle en 1989. Lors de son interview sur France Inter, Judith Godrèche a aussi évoqué de façon sibylline, et sans entrer dans les détails, d’autres faits qui se seraient déroulés avant ce tournage, au domicile de Jacques Doillon. Dans sa plainte contre Benoît Jacquot, enregistrée le 6 février par la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris et consultée par Le Monde, elle décrit précisément les agissements de Jacques Doillon. En l’occurrence, il s’agirait d’un viol qu’aurait commis le cinéaste sur elle, alors qu’elle avait 14 ans. Les faits auraient eu lieu rue de la Tour, à Paris, dans la maison de Jane Birkin. Sollicité par Le Monde, Jacques Doillon, 79 ans aujourd’hui, n’avait pas répondu jeudi après-midi. De même que son avocate, Marie Dosé. « Jacques Doillon découvre ces accusations ce matin par voie de presse, a déclaré cette dernière à l’AFP plus tôt dans la journée. Il les réfute avec force et a hâte de s’expliquer devant la justice. » L’enquête préliminaire, ouverte mercredi par le parquet de Paris, portera sur les faits de Benoît Jacquot et Jacques Doillon dénoncés par Judith Godrèche. Des séances dans le bureau du réalisateur Selon le récit de la comédienne, Jacques Doillon l’a reçue plusieurs fois à cette adresse pour des essais, qui ont finalement débouché sur La Fille de 15 ans – l’histoire d’une adolescente amoureuse d’un garçon de son âge (joué par Melvil Poupaud), et dont le père de ce dernier (Jacques Doillon) va s’éprendre. C’est son agente de l’époque, Isabelle de La Patellière, qui lui aurait fait rencontrer le cinéaste, alors à la recherche d’une jeune actrice pour un film qu’il envisageait de réaliser. « Je crois que c’est un film qui devait s’appeler La Petite Magicienne, dit-elle dans cette plainte. Je le rencontre et je lui dis que j’ai écrit un livre (…). Cela raconte l’histoire d’une fille et d’un frère, et le père essaie de la voler au frère. Je parle à Doillon de mon livre et il me dit de lui déposer mon manuscrit. Quelque temps après, il me rappelle et il me dit qu’il ne va pas faire le film qui devait se faire mais plutôt un film sur moi. Pour ce faire, je devais venir chez lui. » Lors de ces séances préparatoires dans le bureau du réalisateur, « il me fait parler pendant des heures, il prend des notes et il m’enregistre. Il me fait parler de Benoît [Jacquot], il me pose beaucoup de questions sur Benoît », a relaté Judith Godrèche devant les enquêteurs. « Doillon me demande un jour de m’allonger sur le lit et il me dit que pour la respiration il faut qu’il se rapproche de moi pour pouvoir vraiment écrire ce personnage. Il m’embrasse, la pièce est fermée, je ne sais pas si Charlotte [Gainsbourg] ou Jane [Birkin] sont là. Il me met les doigts dans la culotte et il me fait allonger sur le lit, et avec son jean, en portant toujours son jean, il se met à se frotter sur moi pour se faire jouir. » Dans les archives personnelles de Judith Godrèche, il subsiste deux lettres qu’elle assure avoir reçues de Jacques Doillon à la même époque. Si elles ne sont pas datées, la comédienne a conservé une enveloppe où l’on reconnaît l’écriture du cinéaste. Elle a été affranchie le 26 octobre 1987 dans le 16e arrondissement de Paris, là où étaient domiciliés Jacques Doillon et Jane Birkin à l’époque. Cette enveloppe a été envoyée à Judith Godrèche rue Rambuteau, à Paris, là où l’adolescente vivait alors avec son père. Deux lettres signées « Jacques » Sur l’une de ces deux lettres figure le dessin d’un gros cochon avachi, sous le regard de plusieurs personnages. En dessous, un texte manuscrit parfois difficilement lisible, signé par « Jacques », dont voici des extraits : « Voici un cochon (femelle), mérité ou non. (…) J’aimerais être ainsi attaché avec ce timide sourire sur mon [mot illisible] beau visage. (…) Je n’aimerais pas être comme ce paisible animal avec ton ombre derrière moi. Ne te laisse pas engloutir par Venise. » En juillet 1987, Judith Godrèche a passé quelques jours dans la cité italienne avec Benoît Jacquot. Dans l’autre, au verso d’une gravure en noir et blanc représentant une transaction entre un marchand ambulant et un habitant, il a griffonné : « Pardon de ne pas dessiner mais Rembrandt fait ça très bien (pour moi). C’est un vendeur de mort-aux-rats, on imagine donc que tu vis dans cette aimable demeure et que le bonhomme achète le bon produit pour se débarrasser de toi, mais il ne s’est pas aperçu que tu es partie à Venise et qu’il peut donc dormir tranquille. (…) J’espère qu’il pleut sur Venise, que tu passes ton temps à faire la gueule et que tu es donc invivable. Baiser sur ton front juvénile. Jacques. » En 1987, Benoît Jacquot et Jacques Doillon, par ailleurs proches amicalement et artistiquement, semblaient se disputer Judith Godrèche comme actrice et comme « partenaire ». Le premier, au cours d’une rencontre avec Le Monde, se souvient du tournage de La Fille de 15 ans qui s’est mal passé : « Judith se plaignait de lui. A ce compte-là, lui aussi il va avoir sa ration. » « Il m’a embrassée de force » D’autres comédiennes portent des accusations contre le réalisateur. C’est le cas d’Anna Mouglalis, qui détaille au Monde une agression sexuelle dont elle raconte avoir été victime de sa part. « C’était à l’été 2011, se souvient l’actrice de 45 ans. Jacques Doillon venait de faire tourner mon compagnon de l’époque, Samuel Benchetrit, avec sa fille, Lou Doillon, pour le film Un enfant de toi. Samuel a invité Doillon à nous rejoindre dans ma maison de famille, près d’Uzès. Il est arrivé avec un bébé, son enfant, qui n’avait que quelques mois, et qu’il s’amusait à faire manger solide alors qu’il était beaucoup trop petit. Cela m’avait choquée. Il m’avait aussi offert la biographie de Sophie Tolstoï et m’avait dit vouloir monter la pièce La Jalousie au théâtre avec moi. » « Un soir après le dîner, nous n’étions plus que deux dans la pièce. C’était dans la cage d’escalier sur le palier qui donnait sur la chambre de ma fille et la mienne dans laquelle j’allais rejoindre Samuel qui s’était couché plus tôt. Il m’a embrassée de force et je l’ai repoussé. C’est sidérant de tenter un truc pareil, dans ces conditions-là. Il y a un tel sentiment d’impunité, une telle réification. » Anna Mouglalis dit ne plus se souvenir si elle avait raconté à l’époque cette scène à Samuel Benchetrit. « Je n’ai plus jamais revu Jacques Doillon après cela », ajoute-t-elle. Contacté par Le Monde, Samuel Benchetrit n’a pas souhaité répondre. De son côté, Isild Le Besco, qui a dénoncé des « violences psychologiques ou physiques » de Benoît Jacquot, relate au Monde avoir travaillé « quatre ou cinq semaines » avec Jacques Doillon sur la préparation d’un film sorti en 2001, Carrément à l’ouest. Des séances se sont déroulées selon elle au printemps 2000 au domicile du réalisateur, près du quartier Saint-Paul à Paris, et auraient inspiré une partie du scénario. « On improvisait. Je me souviens que lui parlait d’un ton monolithique pendant des heures, c’était d’un ennui monstrueux. » « Mais, lorsque j’ai refusé de coucher avec lui, il m’a retirée du projet et a donné le rôle à sa fille », affirme Isild Le Besco. De fait, au casting de Carrément à l’ouest, on trouve Lou Doillon, la fille que le cinéaste a eue avec Jane Birkin. Comment la proposition a-t-elle été formulée ? « Mes souvenirs sont vagues, reconnaît la comédienne. C’était assez subtil, dans le non-dit. Juste après mon refus, il m’a dit qu’il allait donner le rôle à Lou. A l’époque, ce que j’avais surtout trouvé injuste et abusif était de ne pas avoir été payée pour ce travail. Alors qu’il avait pris mes mots. » Le prochain film de Jacques Doillon, CE2, doit sortir en salle le 27 mars. Il raconte l’histoire d’une fillette harcelée à l’école par des camarades de classe. Jérôme Lefilliâtre et Lorraine de Foucher Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 11:55 AM
|
Enquête de Marine Turchi dans Mediapart - 8 février 2024 Judith Godrèche, Adèle Haenel, affaires Depardieu, Polanski, Bedos : depuis six ans, l’industrie cinématographique est en première ligne des soubresauts du mouvement #MeToo. Au centre des débats, la figure sacralisée de l’artiste et une culture de l’impunité très française.
C’est encore par la porte du cinéma que #MeToo ressurgit en France. Dans Le Monde et sur France Inter, l’actrice Judith Godrèche accuse deux figures du cinéma d’auteur français, Benoît Jacquot et Jacques Doillon, de violences sexuelles lorsqu’elle était mineure. Elle a déposé plainte mardi 6 février pour « viols sur mineure ». Alors qu’elle avait 14-15 ans, la comédienne affirme que les deux réalisateurs, âgés eux d’une quarantaine d’années à l’époque, auraient successivement abusé de leur pouvoir pour avoir des relations sexuelles avec elle. Elle dénonce en particulier une relation d’« emprise » de six années avec Benoît Jacquot – des faits que conteste le cinéaste de 77 ans, évoquant une relation amoureuse. Sept ans plus tôt, Judith Godrèche avait été l’une des nombreuses femmes à témoigner dans l’affaire Weinstein, qui a lancé l’onde de choc #MeToo depuis Hollywood. En France, le mouvement, plus taiseux, est « relancé » par la prise de parole, en 2019, dans Mediapart, de l’actrice Adèle Haenel, « une date historique ». Cinq ans plus tard, c’est à nouveau un scandale dans l’industrie cinématographique qui provoque un séisme : l’affaire Gérard Depardieu. Entre-temps, le #MeToo français a été alimenté par des accusations visant d’autres personnalités du monde du spectacle : les cinéastes Roman Polanski, Luc Besson (qui a bénéficié d’un non-lieu), Nicolas Bedos et Philippe Garrel ; le metteur en scène Michel Didym, les comédiens Philippe Caubère, Ary Abittan, Sofiane Bennacer, etc. C’est aussi de cette industrie que sont venues les résistances les plus retentissantes : la « tribune Deneuve » qui, en 2018, dénonçait le mouvement #MeToo (une « campagne de délations » ; une « justice expéditive ») et défendait « une liberté d’importuner » ; et, plus récemment, le texte de 56 personnalités prenant la défense de Gérard Depardieu, au motif qu’il est « le dernier monstre sacré du cinéma » et qu’en le mettant en cause, « c’est l’art que l’on attaque ». Comment expliquer ce rôle central de l’industrie cinématographique dans le mouvement #MeToo, alors que les violences sexuelles touchent tous les milieux ? Le principal vecteur de la culture du viol Le cinéma n’est pas un secteur comme un autre : il tient une place centrale dans la culture populaire. C’est par lui que sont véhiculées un grand nombre de représentations, parmi lesquelles des stéréotypes sexistes et des images relevant de la culture du viol. Les violences y sont souvent banalisées, érotisées ou pas nommées comme telles. « Si le cinéma est un endroit qui fabrique des stéréotypes, qui déploie une culture du viol et de l’inceste, c’est parce qu’il montre le plus souvent les agressions sexuelles du point de vue des hommes, et les dépeint comme des moments de plaisir pour les hommes, explique Iris Brey, docteure en théorie du cinéma, autrice et réalisatrice. Cette culture de l’agression comme moment érotique participe de transformer le public, qui ne va pas savoir reconnaître l’agression et l’agresseur. » Cet effet est renforcé par un autre, selon l’autrice : l’« effet de projection », « encore plus fort dans le cinéma que dans d’autres secteurs comme la politique ». « Par l’aspect star-system, beaucoup de gens s’identifient aux comédiens. Beaucoup d’hommes ont voulu être Depardieu, et c’est très troublant de penser que la personne qu’on a fantasmée ou à laquelle on s’est identifié peut aussi être un agresseur. » Un lieu où se déploie le pouvoir Comme tout milieu où se côtoient pouvoir et précarité, l’industrie du cinéma est aussi propice aux violences sexuelles et sexistes, et surtout à l’omerta. Car ces violences sont avant tout des abus de pouvoir. Entre, d’un côté, des producteurs, réalisateurs ou comédiens influents, et de l’autre, des actrices désireuses d’obtenir des rôles dans un milieu très concurrentiel, et des intermittent·es contraint·es d’atteindre leur quota d’heures, la relation est forcément asymétrique. La croyance dans le génie et le pouvoir absolu du créateur est plus forte que la conviction qu’il faut protéger des adolescentes. Delphine Chedaleux, historienne « Que cette industrie soit peuplée de prédateurs, c’est le cas de n’importe quelle autre industrie. Mais elle montre bien comment le pouvoir peut se déployer, insiste Iris Brey. Un producteur, un réalisateur ont tous les pouvoirs : ils peuvent décider si le film se fait ou non, et avec qui. L’actrice sait qu’elle peut se faire éjecter à chaque moment, donc elle se tait souvent. » « Ce système autorise à exercer un pouvoir discrétionnaire et à généraliser les abus de pouvoir. Dans une entreprise classique, l’abus de pouvoir du patron est dénoncé. Pas dans le cinéma », relève Geneviève Sellier, professeure émérite en études cinématographiques à l’université Bordeaux-Montaigne et animatrice du site collectif de critique féministe « Le genre et l’écran ». Mythe du génie créateur et alibi artistique À ce constat universel s’ajoute une spécificité française, liée à la fois au rapport particulier au cinéma en France, à la configuration spécifique du champ cinématographique hexagonal et à une forme d’« exception culturelle » : la sacralisation de la figure du grand réalisateur ou acteur. Pour comprendre cette particularité, il faut plonger dans l’héritage du cinéma d’auteur français. « Il y a un lien étroit entre la façon dont s’est constitué le champ cinématographique en France depuis les années 1960 et le système de prédation qu’il constitue », analyse l’historienne du cinéma Delphine Chedaleux, maîtresse de conférences à l’université de technologie de Compiègne. La « politique des auteurs », inventée dans les années 1950 par de jeunes critiques masculins (François Truffaut, Jean-Luc Godard…) qui deviendront les réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, a consacré « la puissance du réalisateur », explique l’universitaire. Finie la position prédominante des scénaristes et des techniciens, les réalisateurs prennent le pouvoir : la valeur d’un film ne se mesure plus « à sa qualité technique ou à son succès », mais « au geste artistique du réalisateur, désormais considéré comme un créateur solitaire, à la manière des peintres ou des écrivains ». En conséquence, estime Delphine Chedaleux, l’histoire du cinéma repose « sur les “grands hommes” et leurs œuvres », permettant un « redoutable dispositif de pouvoir » et de « protection des prédateurs ». À LIRE AUSSI Dans le cinéma, des violences sexuelles systémiques 3 novembre 2019 Les violences, le harcèlement ou la maltraitance sont ainsi souvent masqués ou justifiés par la liberté artistique ou l’intérêt supérieur de l’œuvre. Sur le tournage du Dernier Tango à Paris (1972), le réalisateur Bernardo Bertolucci et l’acteur Marlon Brando avaient piégé l’actrice Maria Schneider en simulant par surprise une scène de viol avec du beurre qui a traumatisé à vie la comédienne. « Est-ce que ce n’est pas le prix à payer pour les chefs-d’œuvre ? », avait justifié en 2018 le critique de cinéma Éric Neuhoff dans l’émission « Le Masque et la Plume », sur France Inter. Cet alibi artistique va de pair avec la prétendue « séduction à la française », une « exception culturelle » souvent brandie par les voix hostiles à #MeToo et au « puritanisme américain ». « En France, il y a les trois G : galanterie, grivoiserie, goujaterie », avait dénoncé Isabelle Adjani au moment de l’affaire Weinstein, expliquant que « glisser de l’une à l’autre jusqu’à la violence en prétextant le jeu de la séduction est une des armes de l’arsenal de défense des prédateurs et des harceleurs ». « C’est le droit de cuissage légitimé par la puissance de l’art », résume Geneviève Sellier, pour qui « le mythe du génie créateur sert à masquer le fait que la domination masculine continue à s’exercer ». Ce mythe est alimenté par des critiques de cinéma comme des metteurs en scène, qui théorisent la « relation particulière » qu’ils devraient entretenir avec « leurs » comédien·nes. Ainsi, le cinéaste Philippe Garrel, dont cinq femmes ont dénoncé dans Mediapart des propositions sexuelles lors de rendez-vous pour des rôles, avait expliqué : « Comme beaucoup de réalisateurs de la Nouvelle Vague, j’aimais tourner avec la femme dont j’étais amoureux et la filmer. » À LIRE AUSSI Des faveurs sexuelles contre un rôle dans un film : plusieurs femmes incriminent Philippe Garrel 30 août 2023 Le réalisateur et producteur Luc Besson, accusé de violences sexuelles par neuf femmes, avait lui aussi insisté, lors de son audition par la police en 2018, sur la relation pleine d’« affect » avec les actrices et expliqué qu’il avait besoin d’être amoureux de ses comédien·nes pour travailler. « Pour en tirer le meilleur, il faut avoir une relation intime au plan émotionnel. [...] Je reconnais être tactile avec les gens et être dans l’affectif. [...] Une actrice peut s’asseoir sur mes genoux au cours d’un tournage. » Sept ans plus tôt, le cinéaste Benoît Jacquot avait revendiqué, dans un documentaire réalisé par Gérard Miller (lui-même visé depuis par des accusations de violences sexuelles), cette « relation d’ordre amoureux » qui doit « nécessairement » exister avec ses comédiennes. Mais il était allé plus loin, en expliquant que « faire du cinéma » était « une sorte de couverture » pour certaines « mœurs », de la même manière qu’il existe des couvertures « pour tel ou tel trafic illicite ». Évoquant sa relation avec Judith Godrèche, il parlait alors de « transgression » et se disait bien conscient « qu’au regard de la loi », « on n’a pas le droit en principe ». « Mais ça, j’en avais rien à foutre », souriait-il, en ajoutant d’ailleurs que cette pratique suscitait, « dans le landerneau cinématographique », « une certaine estime » et « admiration ». Voici le passage (à 6 min 38 s) : Lien vers la vidéo Totem et tabous © Vidéo Totems et tabous « Ces pratiques de prédation, connues de tous, sont euphémisées, voire applaudies comme des marques de transgression, souligne Delphine Chedaleux. La croyance dans le génie et le pouvoir absolu du créateur est plus forte que la conviction qu’il faut protéger des adolescentes, voire des petites filles. » L’historienne se souvient que, étudiante en fac de cinéma, il y a vingt ans, ses professeurs « les plus antiféministes étaient les plus ardents défenseurs de la transgression artistique » et criaient, pour certains d’entre eux, « à la cancel culture, avant que le mot ne soit inventé, à propos de ce qui se passait dans les facs américaines, déjà très mobilisées contre la culture du viol et le sexisme ». Encore aujourd’hui, cette « orthodoxie auteuriste » structure très profondément le cinéma en France, et plus largement les mondes de l’art. Pour l’universitaire, « ce culte du génie créateur est un masculinisme, un système de protection de la domination masculine et d’anéantissement des voix contestataires qui menacent ce système – que ces voix proviennent des rangs intellectuels (critiques, universitaires) ou du milieu professionnel lui-même (les victimes) ». Geneviève Sellier ajoute qu’alors que le cinéma d’auteur « se présente comme subversif », il est « en fait le milieu le plus réactionnaire et le plus archaïque dans son fonctionnement ». Une « culture de l’impunité » française Dans ce contexte, faire émerger la question des violences sexuelles, a fortiori dans leur dimension systémique, est forcément difficile. Lors de notre enquête au sein du monde du cinéma, en 2019, des productrices, réalisatrices, actrices déploraient que « la déflagration #MeToo » n’ait pas réellement traversé l’Atlantique, que « le #MeToo français ait été plus taiseux et petit », que « les noms ne soient pas sortis » alors que « tout le monde les connaît ». « Dans les épisodes précédents de #MeToo en France, le milieu du cinéma avait globalement échappé à la reddition des comptes, aussi bien dans le cinéma commercial et populaire que dans le cinéma d’auteur », abonde Geneviève Sellier. De fait, le nombre de personnalités accusées de violences sexuelles depuis l’éclosion de #MeToo est nettement plus important aux États-Unis qu’en France, où la culture de l’impunité est plus forte, estiment les universitaires interrogées. C’est parce que les affaires sont peu nombreuses que, lorsqu’elles sont révélées, elles n’en finissent pas de retentir. À l’image du témoignage d’Adèle Haenel, et de son geste, devenu iconique, lors de sa sortie de la cérémonie des César en 2020, pour protester contre les trois trophées récompensant Roman Polanski. Mais la sociologue Laure Bereni a noté à quel point l’écho exceptionnel rencontré par la prise de parole de la comédienne était dû à des conditions sociales « improbables » : celles d’une actrice devenue plus puissante que le réalisateur qu’elle accuse – un renversement des rapports de pouvoir extrêmement rare. Mais quatre ans après sa prise de parole, force est de constater qu’Adèle Haenel a dû quitter le monde du cinéma. Gérard Depardieu a lui profité de cette complaisance très française, alors qu’une partie des agissements étaient sous nos yeux. Ce qui s’explique aussi par « sa position de go-between entre cinéma d’auteur et cinéma grand public », selon Delphine Chedaleux. « D’un côté, il a manifestement bénéficié d’une énorme impunité artistique : c’est un “monstre sacré” qui prête son corps hors norme et sa voix à la “grande” culture française [en interprétant des chansons de Barbara – ndlr]. De l’autre, les agressions dont il est accusé semblent associées, dans un certain nombre de discours médiatiques, à sa vulgarité toute “populaire” et aux excès qui la caractérisent. » À LIRE AUSSI Gérard Depardieu, une complaisance française 11 avril 2023 Ainsi, l’actrice Emmanuelle Devos, questionnée dans l’émission « 28 minutes », sur Arte, a associé le comportement de Depardieu à sa vulgarité et au cinéma grand public où les enjeux financiers sont importants, lui opposant le cinéma d’auteur, qu’elle dépeint comme un lieu protégé de tels agissements (« des gens très bien élevés », qui « ne sont pas du genre à vous coincer entre deux portes »). Certaines voix – encore rares – fustigent cette complaisance très propre au cinéma. « Cette protection, ce spectacle de l’impunité, ça suffit », a réagi l’actrice Anna Mouglalis dans l’émission « C l’hebdo », sur France 5, le 20 janvier. Pour la comédienne, qui avait dénoncé dans Mediapart le comportement de Philippe Garrel, il subsiste « une érotisation de la domination » dans cette industrie, où les producteurs ne protègent pas toujours les employé·es sur les tournages, comme dans le cas de Depardieu. Marine Turchi / MEDIAPART Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma" Légende photo : Charlotte Arnould, Judith Godrèche, Adèle Haenel et Anna Mouglalis. © Photomontage Mediapart avec AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 11:21 AM
|
Par Guillaume Lasserre dans son blog de Mediapart - 10/02/24 Au Théâtre de la Bastille, Gurshad Shaheman plonge les spectateurs dans cinquante ans d’histoire iranienne à travers les monologues entrelacés de trois sœurs qui sont aussi sa mère et ses tantes. Elles partagent la scène avec trois comédiennes contant leur existence. Autour de tables dressées, les « Forteresses » invitent au banquet de la vie. « Je me souviens de vastes palmeraies intégralement brûlées Le soleil se couchait De part et d’autre de la route Il y avait ces immenses palmiers calcinés (…) »
Un banquet. Sur scène, c’est à un banquet que sont littéralement conviés les spectateurs, un banquet donné en l’honneur de trois femmes, qui sont aussi trois sœurs, un banquet au décor feutré et aux allures persanes qui, passant de l’intime au politique, déroule le récit de leurs vies et avec lui cinquante ans de l’histoire récente iranienne. Des protestations contre le pouvoir du Shah à la Révolution de 1979, de désillusion en répression, de divorces en exil, l’histoire familiale se meut en fresque historique et politique sur l’Iran. Jeyran, Shady et Hominaz partagent la scène avec trois comédiennes qui incarnent leur histoire, leur enfance, leurs études, leur mariage, les naissances, leur divorce, une distanciation qui, renforcée par leurs présences parfois spectrales, donne à la pièce une tonalité étrange, comme si le corps et la voix étaient disjoints, comme si les fantômes du passé venaient troubler la fête, comme si le récit de ces vies douloureuses était nécessaire pour briser la « forteresse des larmes » et revenir à la vie. Il sera question des violences subies qu’elles soient d’État ou conjugales, de la négation du corps féminin, impur, privé de tous ses droits, de l’Allemagne et de la France comme destin pour deux d’entre elles, et de l’Iran pour la troisième, demeurée à Téhéran. Mêlant la musique aux mots – interprétant notamment des chansons azéries dans une langue interdite par le pouvoir islamique –, le metteur en scène retrace les destins de sa mère et ses tantes, trois sœurs nées au début des années soixante à Mianeh, une petite ville des montagnes de l’Azerbaïdjan iranien qui, par leur courage et leur dignité, mais aussi par la joie d’être là, le plaisir de danser et chanter, emportent tout sur leur passage.
« Comme un mirage au soleil » C’est en 2018 que le Gurshad Shaheman, à la fois acteur, performeur, metteur en scène et auteur, a eu l’idée de la pièce. Il présente alors au Festival d’Avignon son spectacle « Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète » qui porte sur scène les histoires d’amours interdites et les récits de guerre de jeunes exilés originaires du Moyen-Orient. L’occasion pour sa mère, qui vit à Lille, de venir découvrir la pièce, ainsi que pour sa tante, installée depuis près de vingt ans à Francfort en Allemagne. Elles sont rejointes par leur sœur cadette restée à Téhéran. C’est la première fois depuis onze ans que les trois sœurs se retrouvent, séparées depuis la Révolution par trois pays et deux continents. « J’étais touché de les voir ensemble après toutes ces années, de constater combien leur lien restait solide malgré les revers du destin, les années de séparation et malgré des choix de vie parfois radicalement opposés » explique Gurshad Shaheman dans sa note d’intention. « Je les regardais dans les rues d’Avignon, au milieu de cette grande fête du théâtre dans laquelle elles se fondaient parfaitement et je les trouvais vraiment romanesques, pour ne pas dire théâtrales ». Après l’exil, les trois sœurs ont vécu éloignées les unes des autres, dans des langues et des cultures distinctes qui suscitent trois visions différentes des évènements vécus. Il y a d’abord sa mère, arrivée en France en 1990, puis sa sœur cadette qui, deux ans plus tard et avec ses deux enfants, entame un long et âpre parcours de migration jusqu’à Leipzig en Allemagne. Lorsqu’elles se retrouvent à Avignon en 2018, Gurshad Shaheman les écoute faire le bilan de leur vie, de leurs réussites et de leurs échecs, leurs joies et leurs peines. « Je me disais que je tenais là le sujet de ma prochaine pièce » explique-t-il. Il écrit le spectacle à partir des entretiens qu’il mène auprès de sa mère et de ses tantes, préférant à l’aspect documentaire la puissance poétique que ces récits peuvent susciter. Il entremêle ainsi trois monologues racontant trois existences à l’âge des bilans, trois voix qui se succèdent et se complètent, trois voyages intérieurs, à chaque fois l’inventaire d’une vie. Lorsqu’il invite sa mère et ses tantes à jouer sur scène dans une pièce qui fait le récit de leurs vies, Gurshad Shaheman doit faire face à leur désir de théâtre qui les réjouit autant qu’il les paralyse, d’autant que seule sa mère parle le français. « Je suis présent sur scène aux côtés de ma mère et ses sœurs. Nous sommes les hôtes de cette réception. Nous accueillons les spectateurs, les guidons à leurs places et leur proposons gâteaux et bonbons » explique-t-il. Pour la scénographie, il s’inspire des restaurants en plein air du nord de Téhéran où l’on mange assis sur des lits recouverts de tapis et installés sur des cours d’eau. Sur scène, c’est une partie des spectateurs qui est invitée à s’y poser, brisant ainsi le quatrième mur qui sépare la scène de la salle. « Ne jamais faner et mourir » Chaque récit est pris en charge par une comédienne franco-iranienne qui vient en quelque sorte doubler l’une des trois sœurs, engendrant une dissociation entre le corps et la voix, la mère et les tantes réalisant les actions théâtrales. Chaque protagoniste est donc scindé en deux. Entre réalisme, burlesque et abstraction, les interprètes expérimentent le plateau pour la première fois. Portées par une musique électro-acoustique, les voix des actrices inscrivent le texte dans une bande son originale qui englobe la totalité de la pièce, seulement rompue au moment où se termine l’un des trois chapitres qui la composent, chacun étant clos par une chanson azérie interprétée en direct par Gurshad Shaheman. « C’est ma seule contribution vocale au plateau, le reste du temps je ne suis qu’une oreille dans laquelle les trois femmes déversent le récit de leurs tourments » précise-t-il. Le choix de l’azéri, la langue maternelle, est aussi un choix politique puisqu’il s’agit d’une langue réduite au silence par la culture dominante perse. « Les récits intimes seraient incomplets si je ne faisais pas résonner cette langue interdite haut et fort dans le théâtre » confie-t-il encore. Dans son premier spectacle, « Pourama Pourama », Gurshad Shaheman parlait de lui, racontait sa vie, revenant sur son enfance en Iran pendant la guerre avec l’Irak, son adolescence vécue seul avec sa mère dans l’exil et les débuts de son apprentissage du français, et ses premiers émois amoureux, les peurs, les peines, les combats intimes, les moments heureux aussi. Ses tantes et sa mère y étaient déjà présentes en tant que personnages secondaires. Avec « Les Forteresses », il renverse le point focal pour les placer au centre, devenant, lui, la personne qui écoute. Durant trois heures, chacune correspondant à vingt ans de vie, la petite histoire se mêle à la grande, des destins individuels construisent une histoire collective. Frères, mari ou père, il est beaucoup question du rapport aux hommes. Comment vit-on dans une société où il est extrêmement compliqué de décider pour soi quand on est une femme ? Pourquoi décider de partir ? pourquoi décider de rester ? On est submergé par l’immense tendresse qui émane de cette saga familiale traversant plus d’un demi-siècle, le récit de trois femmes hors du commun, militantes de gauche ayant fait la révolution de 1979 et connu les désillusions de la république islamique, traversé une guerre de huit ans, trois femmes confrontées aux fracas du monde, dont la seule présence sur scène irradie la pièce. En transcendant le réel, Gurshad Shaheman la teinte d’une incandescence poétique bouleversante. LES FORTERESSES - Texte et mise en scène Gurshad Shaheman. Avec Guilda Chahverdi, Mina Kavani, Shady Nafar, Gurshad Shaheman et les femmes de sa famille. Assistant à la mise en scène Saeed Mirzaei. Dramaturgie Youness Anzane. Création sonore Lucien Gaudion. Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy. Lumière Jérémie Papin. Régie générale et régie lumière Pierre-Éric Vives. Costumes Nina Langhammer. Régie plateau et accessoires Jérémy Meysen. Maquillage Sophie Allégatière. Coaching vocal Jean Fürst. Coordination et diffusion Anouk Peytavin - La Ligne d’Ombre. Production et administration Emma Garzaro - La Ligne d’Ombre. Direction de production Julie Kretzschmar - Les Rencontres à l’échelle - B/P. Production La Ligne d’Ombre et les Rencontres à l’échelle - B/P Coproduction Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes, TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Pôle arts de la scène - Friche la Belle de Mai, Centre culturel André Malraux - Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l’Est Mosellan, Le Théâtre d’Arles - Scène conventionnée d’intérêt national art et création - nouvelles écritures, la Maison de la Culture d’Amiens et Les Tanneurs (Bruxelles). Accueil en résidence Le Manège (Maubeuge), Les Rencontres à l’échelle - B/P structure résidente de la Friche la Belle de Mai et Les Tanneurs (Bruxelles). Avec le soutien de la DRAC Hauts-de- France, la région Hauts-de-France, du fonds SACD Théâtre, la Spedidam et de l’Onda - Office national de diffusion artistique. Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association SACD - Beaumarchais (2019) et de l’aide à la création ARTCENA. Remerciements à Sophie Claret, Camille Louis, Judith Depaule et Aude Desigaux. Les Forteresses sont parues aux éditions Les Solitaires Intempestifs en septembre 2021. Spectacle vu au Théâtre national de Bretagne à Rennes le 23 novembre 2023. Théâtre de la Bastille du 5 au 11 février 2024. Légende photo : Les Forteresses, Gurshad Shaheman © Agnès Mellon

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 7:21 AM
|
Par Anaïs Héluin dans Sceneweb - 08/01/24 En ce début d’année 2024, la marionnettiste et metteure en scène Bérangère Vantusso succède à Jacques Vincey à la direction du Théâtre Olympia, Centre Dramatique National de Tours. Elle entend y défendre une programmation théâtrale hybride, structurée autour des quatre saisons de manière à donner le temps de la rencontre. Après la compagnie Les Anges au Plafond, nommée à la tête du Centre Dramatique National de Normandie-Rouen en 2021, c’est une autre marionnettiste qui est nommée au Théâtre Olympia, Centre Dramatique National (CDN) de Tours : Bérangère Vantusso. Directrice de la compagnie trois-six-trente qu’elle fonde en 1999 après une formation en tant que comédienne au Centre Dramatique de Nancy, ainsi que depuis sept ans du Théâtre-Studio de Vitry, l’artiste voit sa nomination et celle de Camille Trouvé et Brice Berthoud des Anges comme « le signe que la marionnette gagne du terrain, que le plafond de verre qui a longtemps empêché la reconnaissance et le développement de cette discipline est en train de casser. J’ai craint que la création du label Centre National de la Marionnette (CNMa) replie les marionnettistes sur leur réseau, mais ce n’est heureusement pas le cas », observe l’artiste. Bérangère Vantusso a elle-même toujours veillé à ne pas cantonner son travail et celui de sa compagnie au réseau de la marionnette : elle s’appuie sur des lieux dédiés à cette discipline qu’elle découvre en 1998 à la Sorbonne nouvelle, mais développe aussi des relations fortes à des lieux généralistes. Elle est désignée artiste associée de plusieurs Centres Dramatiques Nationaux : celui de Toulouse, de Lille, de Sartrouville et de Tours (de 2016 à 2018). C’est ainsi, sous la direction de Jacques Vincey, qu’elle rencontre l’équipe du Théâtre Olympia. En dix ans, elle y présente six créations qui sont à l’image de la ligne artistique qu’elle va défendre à la tête de ce Centre Dramatique National : « théâtraux mais hybrides, faisant toujours appel à d’autres pratiques que je le jeu, comme la danse, le cirque, les arts plastiques… ». Pour un théâtre au cœur des disciplines « On dit souvent que les artistes prenant la direction d’un CDN ne choisissent pas leur équipe. Ce n’est pas mon cas. J’ai beaucoup apprécié travailler avec celle du Théâtre Olympia, pour des projets aussi divers que L’Institut Benjamenta que j’ai créé à Avignon en 2016 – le soutien du CDN de Tours a alors été très précieux car il s’agissait là pour moi d’un tournant – et ma création jeune public et tout-terrains Longueur d’ondes ». « Pour mon travail, la taille de l’équipement du CDN de Tours est idéale, de même que pour ce que j’ai envie de développer avec les artistes. En la matière je commençais à ressentir les limites du Théâtre-Studio de Vitry, où j’ai beaucoup appris ». À travers sa programmation, qu’elle structure autour des quatre saisons avec des temps forts lors des équinoxes et des solstices – « un pour la rentrée en septembre, un sur l’envie de rester au chaud en décembre, au printemps le festival WET qui avait déjà lieu à cette période et en juillet un rendez-vous hors-les-murs dans tous types de lieux –, Bérangère Vantusso fait découvrir des artistes aux théâtres aussi hybrides que le sien. Ses six artistes associés disent beaucoup de l’identité plurielle que la nouvelle directrice souhaite donner au Théâtre Olympia. Pendant quatre ans, Vimala Pons, Frédérique Aït-Touati, Youssouf Abi Ayad, le collectif régional Machine Molle et les auteurs Nicolas Doutey et Béatrice Bienville déploieront leurs univers très différents les uns des autres, mais toujours au carrefour de plusieurs disciplines. « En quatre ans, nous aurons le temps d’inventer avec les artistes des manières de travailler ensemble, selon leurs envies. Car je veux éviter autant que possible d’avoir recours à des procédés clé en main, aussi bien en matière de programmation que de relation avec les publics ». Ralentir, pour rencontrer Au Studio-Théâtre de Vitry, Bérangère Vantusso a essentiellement travaillé sur la recherche, proposant à des artistes des espaces de rencontre, des ateliers indépendants de tout projet de création. Cette notion de durée, l’artiste va cette fois l’éprouver sous la forme d’une programmation : « tous les artistes invités viendront présenter non pas une, mais au moins deux créations, parmi lesquelles si possible une destinée au jeune public, à qui je souhaite proposer davantage de spectacles. Par exemple, le public pourra découvrir la nouvelle création d’Alice Laloy, Le ring de Katharsy que nous coproduisons, ainsi que sa pièce pour la jeunesse À poil. Même chose pour Samuel Achache : en plus de Sans tambour créé en 2022 au Festival d’Avignon, il viendra jouer Chewing gum silence, sa pièce musicale à partir de 6 ans, coproduite par Banlieue Bleue. Je souhaite ainsi permettre aux spectateurs de vraiment approcher l’univers des artistes, de ne pas simplement consommer des spectacles ». C’est aussi dans cette optique que Bérangère Vantusso a pensé avec son équipe un projet au long cours avec les publics, qu’elle nomme « Confluences ». « L’idée est de relier chacun des artistes associés à un groupe de spectateurs constitué lui aussi pour quatre ans. Chaque groupe aura son rythme de rencontre, adapté aux possibilités des artistes. Je tiens aussi à laisser libres les formes sur lesquelles pourront déboucher ces rencontres : texte, promenade, podcast, pièce de théâtre… ». Le Jeune Théâtre en Région Centre, jeune troupe qui se renouvelle régulièrement et contribue à la permanence artistique du lieu – « son existence a été pour moi une grande motivation dans ma candidature », dit notre interlocutrice –, sera elle aussi impliquée dans ce dispositif. Elle sera également sollicitée par les artistes associés, certainement par Bérangère Vantusso elle-même, et continuera à programmer le WET créé par Jacques Vincey. Ce festival dédié à la jeune création théâtrale a su s’imposer comme un rendez-vous majeur pour les professionnels autant que pour le public. Il allait donc de soi pour la nouvelle directrice de le faire perdurer, avec quelques modifications lui permettant de faire au mieux écho avec l’ensemble du projet. Dialoguer en Région, avec l’Europe « Si Tours et plus largement la région Centre m’intéressent, c’est qu’on y trouve toutes les structures nécessaires pour développer un projet autour des écritures théâtrales hybrides. Nous allons par exemple travailler avec L’Hectare, Centre National des Arts de la Marionnette de Vendôme, le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) à Tours ou encore le Centre Chorégraphique National de Tours. Nous co-programmerons des spectacles et mettrons en place des rencontres entre artistes de champs disciplinaires différents ». Au-delà de ce vertueux réseau régional, le Théâtre Olympia s’ouvre à l’Europe avec la création d’un nouveau temps fort. Non pas un festival, « même le contraire » dit Bérangère Vantusso. Chaque saison, il s’agira pour le CDN de se mettre à l’écoute d’un pays en invitant un artiste emblématique de sa scène, en orientant son comité de lecture vers ses écritures contemporaines, en organisant avec l’Université de Tours des rencontres sur l’organisation de la création là-bas, en programmant lors du WET le spectacle d’une jeune compagnie du cru… « Pour la première année, ce sera l’Italie. La situation politique y est très critique et les artistes y sont en grande difficulté, ce qui peut nous faire craindre le pire car ce qui arrive en Italie ne tarde souvent pas à arriver en France… ». Cette réflexion à l’échelle européenne peut encore se lire à travers la prochaine pièce de Bérangère Vantusso, une adaptation par Nicolas Doutey du Rhinocéros de Ionesco qu’elle jouera au Théâtre Olympia. « L’auteur écrit cette pièce en 1959, en pleine construction de l’Europe qui est aujourd’hui en bonne voie de déconstruction. Je suis une Européenne convaincue mais je vois que cela est difficile à mettre en œuvre. Il me semble que l’art peut être un moyen de fédérer les énergies, de garder des liens. Il est important d’affirmer que les replis sur soi sont dangereux ». Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 11, 2024 4:23 AM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 9 février 2024 Bernard Sobel reprend, jusqu’au 18 février, sa mise en scène crépusculaire d’une élégance irradiante de la tragédie d’Hölderlin.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/09/la-mort-d-empedocle-fragments-un-vertigineux-face-a-face-avec-l-ultime-au-theatre-de-l-epee-de-bois_6215576_3246.html
« Cette terre, je ne dois pas, sans joie, la quitter. » Certaines phrases de La Mort d’Empédocle mériteraient d’être gravées dans le marbre de nos mémoires. Lorsqu’il vole en altitude, le théâtre incite à l’exaltation : on en voudrait toujours davantage. Un an après avoir créé la tragédie inachevée du poète Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843), Bernard Sobel reprend, à la Cartoucherie de Vincennes, un spectacle dont les ténèbres étincelantes avaient fendu l’opacité hivernale, appelant à elles, en grand nombre, un public intrigué qui se passait le mot : quelque chose de rare avait lieu au Théâtre de l’Epée de bois (Paris 12e). Quatre saisons plus tard, bis repetita. Réitéré à l’identique, le geste de Sobel n’a rien perdu de son évidence ni de sa nécessité. Tranchant de la mise en scène, acuité de la pensée, noblesse des comédiens et beauté du poème : La Mort d’Empédocle n’est pas un événement de plus dans un agenda. C’est un rendez-vous essentiel. Avec l’art, avec soi, avec ce qui se tend en chacun lorsque l’échéance de la mort cesse d’être une hypothèse pour devenir une réalité. A 88 ans, Bernard Sobel signe peut-être sa dernière mise en scène. Elle a beau être crépusculaire, elle est d’une élégance irradiante et d’une humilité exemplaire. Le héros fatigué d’Hölderlin est donc de retour dans un lieu singulier qui lui va comme un gant. Aux marges de l’ordinaire et en dehors des modes, les salles de l’Epée de bois jouxtent, depuis 1972, celles du Théâtre du Soleil. Les portes s’ouvrent sur un hall exotique de bois sombre ajouré et de moquette rouge. Un peu plus loin, dans l’épure d’une salle minérale (arches et sol de pierres dorées), Empédocle (émouvant Matthieu Marie) va au pas titubant d’un homme revenu de tout et qui marche vers sa mort. Spectacle abyssal « Je suis tari », soupire celui que la cité d’Agrigente a banni de ses rangs, avec l’ingratitude des troupeaux effrayés qui suivent ceux qui leur parlent le plus fort, quitte à foncer tête baissée dans le mur. Hier pourtant, Empédocle était encore vénéré, une sorte de demi-dieu qui conseillait, guidait, élevait et inspirait les citoyens. Un artiste créatif qui se serait brûlé les ailes à force d’exercer son génie. Son aura s’est fanée, sa légende agonise. La fatigue de l’idole précipite son déclin. L’heure de sa chute a sonné. Le héros va mourir une fois qu’il aura soldé, avec méthode, ses souvenirs, ses sentiments, ses espoirs ; une fois qu’il aura épuisé, pour de bon, le restant de son désir de vivre. Ce chemin de renoncement et de séparation, Empédocle l’accomplit, mais il n’est pas le seul. Le public lui aussi médite sur les deuils à faire, de son vivant, lorsque la fin approche. Qu’elle est inoubliable cette méditation que proposent Hölderlin et Sobel. Qu’il est précieux, ce spectacle abyssal qui demanderait à revenir, encore et encore, s’humaniser et se réchauffer à l’écoute de ses énigmes, de ses métaphores, de ses vérités et de ses doutes. Sur le plateau nu, les acteurs sont les joueurs d’un échiquier où les paroles donnent forme au combat des choix existentiels, éthiques, philosophiques ou politiques. Avec une clairvoyance implacable, Hölderlin écrit le délitement programmé d’une société sans empathie, indifférente à la nature et maltraitante avec ses poètes. Une « plèbe », s’indigne Empédocle, qui prophétise : « En un temps pauvre en héros, les jeunes se consumeront. » Mais le peuple (incarné par des élèves comédiens) ne l’écoute plus. Il a cédé à la peur. Il ne veut plus de ceux qui l’aident à penser. Il ne veut plus penser. Du fond des gradins parvient au public l’odeur légère d’une cigarette qui se consume. Celle que fume sans doute, dans l’obscurité, le metteur en scène. Droit devant, le plateau menace de s’embraser. Une lumière de feu incendie les arches de pierre. Les mots crépitent. Pas un propos dans lequel on ne s’engouffre en quête de réponse. Pas un vers qui n’attise la vigilance. Le spectacle qui se donne au Théâtre de l’Epée de bois est un face-à-face avec l’ultime ou le définitif : de la naissance à la mort, quel être humain aurons-nous choisi d’être ? La Mort d’Empédocle ne répond pas à la question. Mais Sobel nous la pose, et c’est vertigineux. La Mort d’Empédocle (Fragments), de Johann Christian Friedrich Hölderlin. Au Théâtre de l’Epée de bois, Paris 12e. Mise en scène de Bernard Sobel. Avec Julie Brochen, Marc Berman, Valentine Catzéflis, Laurent Charpentier, Claude Guyonnet, Matthieu Marie, Gilles Masson, Asil Raïs et des élèves de la Thélème Théâtre Ecole. Jusqu’au 18 février. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Matthieu Marie, Laurent Charpentier, Claude Guyonnet et le Chœur dans « La Mort d’Empédocle (Fragments) », de Johann-Christian-Friedrich Hölderlin, au Théâtre de l’Épée de bois, en janvier 2023. HERVé BELLAMY

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 5:55 PM
|
Par Mathilde Blottière, avec Lucas Armati dans Télérama Publié le 06 janvier 2024 à 10h34 Mis à jour le 10 janvier 2024 à 18h51 Le cinéaste (“Party girl”) et acteur (“Anatomie d’une chute”) est visé par une enquête préliminaire pour viol sur un technicien. Lui évoque un “rapport sexuel oral consenti”. Les faits sont survenus sur le tournage de son troisième film. Un cas emblématique des difficultés à gérer ces situations sur un plateau.
Lire l'article sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/cinema/le-realisateur-samuel-theis-accuse-de-viol-enquete-sur-un-tournage-devenu-invivable-7018759.php
Réservé aux abonnés Saint Omer, Le Procès Goldman, Anatomie d’une chute… Le film de procès est à la mode dans le cinéma français. Mais il en est un qui pourrait conduire son réalisateur devant une cour de justice, une vraie. L’été dernier, pendant le tournage du long métrage Je le jure, qui raconte l’histoire d’un homme tiré au sort pour devenir juré d’assises, un technicien, Antoine (1), a quitté le plateau avant la fin de son contrat après avoir accusé le réalisateur Samuel Theis, 45 ans, de l’avoir violé. Selon son témoignage, le cinéaste lui aurait imposé un rapport sexuel alors qu’Antoine se trouvait dans un état second, dans l’incapacité d’exprimer son consentement ou son refus de consentement. Selon nos informations, le jeune homme de 27 ans a depuis porté plainte auprès du procureur de la République de Metz. Contacté, celui-ci n’a pas souhaité s’exprimer sur l’affaire. Quant à Samuel Theis, il a refusé de répondre à nos questions, disant ne pas savoir au moment où nous l’avons contacté si l’affaire faisait « l’objet d’une enquête pénale ». Mais il tient à « affirmer qu’[il] conteste cette accusation de toutes [ses] forces ». Il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Les faits rapportés par Antoine se seraient déroulés dans la nuit du 30 juin 2023, à Metz, dans l’appartement loué pour le cinéaste et une membre de l’équipe. Cela fait alors déjà un mois que le tournage a commencé en Moselle. D’abord à L’Hôpital, non loin de Forbach, la ville où Samuel Theis a grandi, puis à Metz, où doivent se tourner des scènes d’extérieur, aux abords du tribunal. L’ambiance est bonne, les rushes sont enthousiasmants. Un pot de fin de semaine s’improvise. En proie aux émeutes qui embrasent la France en ce début d’été, Metz ressemble à une ville morte ce soir-là. Les bars sont fermés. Une grosse vingtaine de personnes trouvent donc refuge dans ce T4 proche du tribunal. De l’alcool, un peu de musique, une atmosphère bon enfant. “Le tournage qu’on est content de faire” Antoine boit de la bière et un verre de vin. Sans comprendre ce qui lui arrive, il fait « un black out ». Des témoins le retrouvent endormi sur les toilettes, avant que le cinéaste ne le transporte dans la chambre d’amis, inoccupée. C’est là, selon Antoine, que le viol aurait eu lieu, une fois les derniers convives partis. « Je n’étais pas dans mon état normal, j’ai l’impression d’avoir été drogué », dit-il. « Des allégations fantaisistes », selon Marie Dosé, l’avocate de Samuel Theis, qui évoque la présence d’une témoin qui contredirait cette version des faits. Contactée, cette collaboratrice du cinéaste, décrite par plusieurs personnes comme une de ses « amies » proches, et qui partageait le même appartement à Metz, raconte : « Au réveil, je suis entrée dans la chambre, qui donnait sur ma salle de bain. J’y ai été témoin malgré moi d’un moment intime entre Samuel et [Antoine]. Ce que j’ai vu ne m’a pas alertée. J’étais surtout gênée de déranger un instant d’intimité qui semblait partagé. » Elle affirme : « Je n’ai rien vu, ni pendant la soirée ni au réveil, qui donnerait le sentiment qu’[Antoine] ait été drogué par un tiers. » Mais durant le week-end, alors que toute l’équipe se déplace à Reims pour la suite du tournage, Antoine est prostré : « Je n’osais plus sortir de ma chambre d’hôtel, j’étais seul, je gambergeais. J’ai très rapidement compris qu’il s’agissait d’un viol, que ce n’était pas moi qui m’étais dit que j’avais envie de coucher avec lui. » Il se confie à sa petite amie, qui le rejoint le mardi. Mise à jour du 10 janvier : Le procureur de la République de Metz a confirmé à Agence France Presse (AFP) qu’une plainte a été déposée fin de juillet et qu’une enquête préliminaire est en cours. Une plainte avec constitution de partie civile a également été déposée à la mi-novembre. Sollicité par l’AFP, Samuel Theis estime dans un communiqué avoir « eu un rapport sexuel oral consenti » avec le plaignant, le lendemain de la fête. Quant au dispositif d’isolement du réalisateur mis en place sur son tournage, le communiqué dit : « Au vu des circonstances et des réactions de certains, [ce protocole était] un moindre mal, même s’il a été difficilement supportable pour le réalisateur, qui s’est senti nécessairement exclu de son propre tournage ». L’équipe, qui apprend progressivement les accusations d’Antoine dans la semaine, tombe de haut. « C’était LE tournage qu’on est content de faire », se souvient Jacques (1), un technicien. Tout comme les autres collaborateurs qui ont accepté de nous parler, il tient à préserver son anonymat. Dans ce milieu où l’emploi repose majoritairement sur la cooptation, la crainte de passer pour un fauteur de troubles l’emporte. Décrit comme quelqu’un de très sympathique, charmant même, Samuel Theis, grand gaillard aux yeux clairs de près de 1,90 mètre, fait l’unanimité. « J’avais vu son premier film Party Girl, raconte Antoine. Je trouvais que c’était un bon réalisateur, accessible, pas colérique, qui avait l’air sympa. » Selon Jacques, « on voyait que Samuel aimait faire la fête et s’amuser mais il n’avait jamais eu de gestes ou de mots déplacés ». À lire aussi : Six ans après #MeToo, les plateaux de tournage sont-ils plus sûrs ? Quelques jours avant le premier clap de Je le jure, Samuel Theis était au Festival de Cannes aux côtés des vainqueurs de la Palme d’or, l’équipe d’Anatomie d’une chute. Il y joue le rôle de Samuel, le mari d’une écrivaine allemande dont Justine Triet retrace le procès pour meurtre. Du tapis rouge de la Croisette aux centrales à charbon du bassin houiller, le Lorrain enchaîne. Pour ce troisième film ambitieux – un film de procès, avec beaucoup de figurants, des comédiens à la fois professionnels (Marina Foïs et Louise Bourgoin notamment) et amateurs, et un budget plus confortable que pour ses précédents films (4 millions d’euros) –, il est une fois encore soutenu par Caroline Bonmarchand (Avenue B Productions), la productrice de Petite Nature, son précédent film. L’enfant du pays l’a dit au Républicain lorrain : Je le jure tournera « autour de la question du jugement, de la complexité des personnes ». L’histoire d’un trentenaire un peu largué qui va devoir décider de la peine d’un jeune pyromane accusé d’homicide involontaire.
Le lundi 3 juillet, sur le tournage, tout le monde a oublié la soirée du vendredi. Sauf Antoine. Deux collègues proches nous confirment avoir perçu son mal-être. « Il était au radar, restait au camion et évitait la face [l’environnement immédiat de la caméra, ndlr], raconte l’un deux. Il portait des lunettes de soleil pour dissimuler son malaise. » Antoine se confie à son chef, qui lui conseille de demander une entrevue avec Samuel Theis. Laquelle a lieu le lendemain, en présence d’une tierce personne qui a assisté à la fête du vendredi soir. « Cette confrontation me paraissait inévitable pour avoir sa version, explique Antoine. Et peut-être qu’au fond, pour moi, c’était une façon de lui faire comprendre la gravité de son acte. » À l’issue de l’entretien, Antoine décide de quitter le tournage. Le soir même, la productrice Caroline Bonmarchand, arrivée dans la journée, est alertée par le réalisateur. « Samuel m’a expliqué qu’un des membres de l’équipe se considérait victime d’une agression de sa part. Lui n’avait pas du tout vécu les choses de cette manière-là. » La productrice, membre depuis sa création du collectif 50/50, qui lutte pour une meilleure prise en compte des violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le milieu du cinéma, comprend vite que la situation est sérieuse. « J’ai passé la nuit à éplucher les guides à l’usage des professionnels du cinéma confrontés aux VSS, le livre blanc du CNC, les écrits du collectif 50 /50… » Pour elle, et sa maison de production fondée en 2002, le défi est de taille. En tant qu’employeur, elle est responsable légale de tous les incidents qui surviennent sur le tournage, même et y compris lors d’une petite fête une veille de week-end. « À ce stade, ma priorité est évidemment de protéger la présumée victime, en l’écoutant et en l’accompagnant », dit-elle. Deux jours après son arrivée, Caroline Bonmarchand s’entretient avec Antoine, en présence de l’assistante de production, qui est l’une des deux « référents harcèlement » du plateau, afin de recueillir sa version des faits. « Le jour même, nous lui avons envoyé les coordonnées d’associations d’aide aux victimes et le contact de la cellule d’écoute d’Audiens. Je lui ai conseillé de se faire accompagner par un psychologue, et proposé une assistance juridique prise en charge par la production, notamment s’il souhaitait porter plainte. Il m’a dit qu’il allait y réfléchir mais qu’à ce moment-là il voulait surtout se reposer. » Dans l’après-midi, en accord avec la production, Antoine quitte Reims et retourne dans le sud de la France, où il vit. Le voyage se fait à ses frais. Il ne remettra plus les pieds sur le plateau. Les personnes qui ne souhaitaient pas être en présence du réalisateur devaient pouvoir continuer à travailler dans des conditions acceptables. Caroline Bonmarchand, productrice Pour tous ceux qui restent, les secousses ne font que commencer. Soucieuse d’éviter l’omerta et pressée par certains chefs de poste, la production organise des réunions de crise destinées à informer et à réfléchir collectivement aux mesures à prendre. Les enjeux s’avèrent complexes. « Il fallait protéger l’équipe et faire en sorte que le tournage puisse se poursuivre dans des conditions admissibles par tous, y compris par Samuel, qui devait rester fonctionnel », décrit Caroline Bonmarchand. La production décide de confier une enquête interne à un cabinet d’avocats spécialisés en droit social. Mais, tout le monde le sait, le tournage sera terminé bien avant que l’enquête ne soit bouclée… En attendant, un protocole d’isolement très strict de Samuel Theis est décidé pour finir le film, et mis en œuvre dès le lundi 10 juillet. À lire aussi : Depuis #MeToo, les scènes de sexe au cœur des débats « Les personnes qui ne souhaitaient pas être en présence du réalisateur devaient pouvoir continuer à travailler dans des conditions acceptables, explique Caroline Bonmarchand. Samuel a donc été installé dans une pièce séparée du plateau de tournage. » À ce moment-là, l’équipe a pris ses quartiers dans la grande cour d’appel de Reims. « On savait que Samuel était là mais on ne le voyait pas… C’était très étrange. », raconte Clément (1), un opérateur. Quand les acteurs arrivent le matin sur le plateau, le cinéaste procède à une mise en place avec eux puis se retire avec sa scripte dans une petite pièce où il dispose d’un retour vidéo et d’un talkie-walkie pour donner les instructions à son premier assistant. Ne pénètrent dans cette pièce que les collaborateurs qui le souhaitent. « Ceux qui allaient le voir de temps en temps étaient le premier assistant, le chef opérateur, parfois les acteurs, poursuit le jeune homme. J’ai dû y aller moi-même deux ou trois fois pour lui poser des questions très précises car c’était plus simple… » Samuel Theis ne peut pas prendre ses repas à la cantine avec tout le monde. Il est changé d’hôtel pour ne pas avoir à croiser ses collaborateurs. Sur le plateau, personne ne parle de l’éléphant dans la pièce, l’ambiance est pesante. Malgré les tentatives répétées de la production, le protocole ne sera jamais assoupli pendant la dernière quinzaine de tournage. Le tout dernier jour, l’équipe filme dans une prison et le réalisateur est contraint de superviser le travail depuis l’une des cellules d’incarcération. Au sein de l’équipe, deux camps se dessinent peu à peu. Celles et ceux qui jugent trop cruel et contraignant ce dispositif de mise en quarantaine, et les autres, pour qui la présence du cinéaste est devenue incompatible avec une pratique sereine de leur métier. Une souffrance au travail à laquelle « ce protocole était censé répondre […] et à la nécessité pour eux de se sentir protégés. De quoi exactement ? Je n’ai pas très bien compris… » glisse Marie Dosé. Consultante sur le film – elle a participé à l’écriture des séquences judiciaires et était présente sur la partie du tournage dédiée au procès –, la célèbre avocate (défenseuse entre autres de Philippe Caubère, Julien Bayou ou encore Riadh B., accusé de viol par Édouard Louis) est devenue entre-temps le conseil de Samuel Theis. Selon elle, « de nombreux techniciens et comédiens jugeaient [le protocole] disproportionné ». Clément évoque une situation très difficile. « Cette fin de tournage a tué la passion en nous. Il y a vraiment eu un avant et après. » Marc (1), l’un de ses collègues, regrette que cette disposition « absurde » ait « compliqué les conditions de travail sans rien changer au fond du problème ». Un autre salarié, Yves (1), indique que cet arrangement a pu apporter à certains un « soulagement », un sentiment de protection « réparateur ». Pour le comédien Emmanuel Salinger, qui joue le rôle de l’un des jurés du procès d’assises au cœur du film, « ce protocole exceptionnel, imaginé et mis en place dans un moment de crise par un collectif sous le coup de l’émotion », a au moins « permis de poursuivre le travail tout en protégeant et en ménageant la sensibilité de celles et ceux qui se sont sentis insécurisés après la mise en cause de Samuel et la démission [d’Antoine] ». Une production “exemplaire” ? Entendre le plaignant, rassurer les salariés, diligenter une enquête interne… Dans un secteur où le réflexe dominant a longtemps été d’étouffer ce genre d’affaires, beaucoup louent une production « exemplaire ». Mais d’autres refusent de la laisser se donner le beau rôle, à commencer par Antoine. « Au début, elle semblait bienveillante, dit-il. Mais j’ai progressivement eu le sentiment qu’elle cherchait avant tout à protéger ses intérêts. » Un événement en particulier heurte le jeune homme : lorsqu’il souhaite déclarer ce qui lui est arrivé comme un accident du travail, son employeur conteste cette qualification auprès de la Sécurité sociale. Motif ? Les faits ont eu lieu un vendredi soir, hors des horaires de tournage. Pour Caroline Bonmarchand, « c’était une question de principe : en quoi serais-je responsable de ce qui a pu se passer à 7 heures ou 8 heures du matin dans une chambre ? Mais j’ai compris qu’il existait une jurisprudence et qu’Antoine était sous contrat et dans le cadre d’une mission ». À lire aussi : Sur les tournages, tout le monde devra avoir suivi une formation contre les violences sexistes et sexuelles Autre grief soulevé par l’équipe : non seulement Caroline Bonmarchand ne propose pas à Antoine de voir la médecine du travail, mais elle lui explique d’abord que continuer à le payer en son absence pourrait être vu comme une volonté d’« acheter son silence ». Plusieurs techniciens le vivent comme une « double peine » infligée à leur collègue. L’un deux, Paul (1), se dit convaincu que « sans l’intervention de chefs de poste, la production s’en serait tenue à ne plus verser de salaire au plaignant ». Antoine a pu finalement bénéficier d’une dispense de travail rémunérée. « Je souhaitais pouvoir le payer jusqu’au bout, assure la productrice, mais je devais trouver le moyen de le faire pour ne pas que ce soit mal interprété et que cela se fasse dans un cadre juridique clair. Nous avons mis vingt-quatre heures à le trouver. » Au fil des jours, les techniciens sont de plus en convaincus que la production n’a qu’un seul but : terminer le film à tout prix. Caroline Bonmarchand met quelques jours à informer les comédiens par « respect pour l’intimité d’Antoine » ? Jacques, Paul et les autres y voient surtout la volonté de laisser l’affaire de côté pour ne pas les déconcentrer. Un peu plus tard, ils découvrent que l’unique journée de tournage suspendue pour cause d’équipe sous le choc ne leur a pas été payée. « On a trouvé ça dégueulasse, les chefs de poste sont montés au créneau, la prod a cédé. Mais c’était une façon de faire pression sur nous pour qu’on continue à faire le film », estime Paul. La production, de son côté, plaide l’erreur vite réparée. Une spécificité française En réalité, l’impression que certaines options ont été d’emblée exclues crispe une partie des techniciens. Suspendre le tournage le temps de réfléchir à la marche à suivre ? Impossible : la clause d’assurance, qui permet désormais aux producteurs confrontés à une situation de VSS d’être indemnisés jusqu’à 500 000 euros pour la suspension de cinq jours de tournage, ne peut être activée en l’absence d’un dépôt de plainte par la victime et d’un signalement au procureur de la République par l’employeur. Or, à ce moment-là, il n’y avait pas encore de plainte. Quant à l’éventualité de mettre à pied Samuel Theis à titre conservatoire, elle est rejetée. « Les contre-arguments tournaient principalement autour de l’argent », indique Clément. Réponse de la production : « Un film de Samuel Theis doit être réalisé par Samuel Theis, sinon ce n’est pas le contrat passé avec les partenaires du film. La question du droit d’auteur est aussi centrale dans ce cadre. Le temps que la justice tranche ce qui s’est passé, le protocole permettait de conjuguer ces exigences. » Le décor unique de Je le jure devient ainsi celui d’une lutte des classes à échelle réduite… Entre des techniciens vus comme des empêcheurs de tourner en rond et des patrons et artistes majoritairement soucieux de pouvoir finir le film. « On passait pour des gens qui n’avaient pas envie de faire leur boulot ! regrette Paul. Samuel était victimisé par la production, qui utilisait sa souffrance pour nous inciter à ne plus faire de vagues. » De son côté, Caroline Bonmarchand reconnaît « des erreurs » mais estime avoir fait « au mieux » et en accord avec ses convictions. Le problème, ce sont les agresseurs sexuels, pas celles et ceux qui essaient de traiter au mieux les conséquences de leurs actes. Sophie Lainé-Diodovic, directrice de casting L’histoire en dit long sur une certaine spécificité française. Au pays de la politique des auteurs, l’idée d’écarter, en attendant d’en savoir plus, un cinéaste mis en cause se heurte au sacro-saint statut du réalisateur-auteur et au pouvoir que l’on prête à l’artiste. Un pouvoir qui s’exerce largement, y compris sur ses employeurs. « A l’étranger, sur un tournage où j’ai travaillé, une situation bien moins grave n’avait pas reçu du tout le même type de réponses, raconte Yves. Là-bas, c’était arrêt du tournage, séances avec des psychologues, des médiateurs : dès lors que des salariés étaient en souffrance, le projet est devenu secondaire. » Le tournage raconte aussi un agrégat de solitudes. Solitude d’un plaignant qui décide de partir et voit son agresseur présumé rester. Solitude d’une production face à des responsabilités et des enjeux écrasants… « Nous ne sommes pas assez outillés ni accompagnés pour faire face à ce type de situations. On se retrouve seul pour construire des solutions par essence imparfaites », confirme Caroline Bonmarchand. Pour la directrice de casting Sophie Lainé-Diodovic, membre du collectif 50/50, « les producteurs ne sont pas des super héros, ils peuvent commettre des erreurs mais s’ils agissent et arrêtent de demander aux équipes de serrer les dents jusqu’à la fin du tournage, c’est déjà une avancée ». Il ne faut pas se tromper de cible, ajoute-t-elle : « Le problème, ce sont les agresseurs sexuels, pas celles et ceux qui essaient de traiter au mieux les conséquences de leurs actes. » D’autant que les problèmes ne font que commencer pour Avenue B Productions, mais aussi pour le distributeur du film, Ad Vitam, qui pourrait se retrouver avec un long métrage mort-né sur les bras. Il est urgent d’élaborer un protocole indiscutable qui soit le même pour tous et prenne en compte les spécificités d’un plateau de cinéma. Marina Foïs, actrice Alors que le ministère de la Culture vient d’annoncer vouloir à terme former tous les métiers du cinéma à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ce tournage hors norme illustre la difficulté persistante à gérer ces situations, malgré les dispositifs déjà mis en place. « Ce qui s’est passé sur ce tournage nous a permis d’identifier les limites des plans de lutte contre les VSS dans le cinéma, positive Sophie Lainé-Diodovic. Il faut par exemple absolument extérioriser les enquêtes menées sur les plateaux ! » Comprendre : la production ne peut pas être à la fois juge et partie, décider elle-même du sort du tournage dont elle a la charge. La directrice de casting indique que des discussions transversales sur le sujet sont en cours entre le collectif 50/50, les syndicats et le CNC. Marina Foïs, l’une des principales interprètes du film (elle incarne la présidente de la cour d’assises), appelle de ses vœux une vraie ligne directrice. « Aujourd’hui, on peut être mis en examen pour agression sexuelle et poursuivre sa carrière tranquille, ou se faire virer à cause d’une rumeur infondée. En l’absence de règles, on improvise des dispositifs forcément bancals, dans l’urgence et sous le coup de l’émotion. Personne n’est formé ni compétent, et tout le monde prend des décisions. Il est urgent d’élaborer un protocole indiscutable qui soit le même pour tous et prenne en compte les spécificités d’un plateau de cinéma. » À l’heure où nous écrivons ces lignes, Samuel Theis se concentre sur le montage de son film, qui, selon son avocate, « dit tellement sur la difficulté de juger et le sens de la peine… ». Les conclusions de l’enquête interne ont été rendues à Caroline Bonmarchand. « Elles m’ont conduite à sanctionner Samuel Theis sur le fondement des conséquences de cette soirée sur le collectif de travail, mais pas à rompre son contrat », indique la productrice, qui refuse d’en dire plus. De son côté, Antoine dit redouter la sortie de Je le jure. « Déjà, celle d’Anatomie d’une chute avait été un peu dure à vivre. Les affiches partout, les potes qui en parlent… Dans l’idéal, je voudrais que le film sorte, mais sans le nom de Samuel Theis au générique. » Le jeune homme souhaite surtout faire passer le message qu’« un viol, ça peut arriver à tout le monde, pas seulement à des femmes qui se font violenter. Ça peut être plus insidieux. Moi, je ne comprends toujours pas comment cela a pu m’arriver ». Mathilde Blottière et Lucas Armati / TELERAMA (1) Les prénoms ont été modifiés. Légende photo : L’acteur et réalisateur Samuel Theis. Photo Stéphane Stifter/PhotoPQR/Le Républicain Lorrain/MaxPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 8, 2024 3:39 AM
|
Par Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre dans Le Monde - 8 février 2024 A la suite de Judith Godrèche, plusieurs comédiennes prennent la parole dans « Le Monde » pour dénoncer des violences et du harcèlement sexuel de la part du réalisateur. Le cinéaste reconnaît certains faits.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/02/08/benoit-jacquot-un-systeme-de-predation-sous-couvert-de-cinema_6215357_3224.html?lmd_medium=al&lmd_campaign=envoye-par-appli&lmd_creation=ios&lmd_source=twitter
Dans l’amphithéâtre de Sciences Po à Paris, Julia Roy s’assoit au fond de la salle. L’étudiante de 23 ans vient écouter, ce 29 janvier 2013, la conférence d’un réalisateur qu’elle ne connaît pas, Benoît Jacquot, invité à parler de « politique de l’intime ». « Il me fixe pendant toute la séance, ça m’étonne un peu », raconte-t-elle au Monde onze ans plus tard. A la fin, elle s’approche pour saluer l’animateur de la rencontre. « Benoît Jacquot me saute dessus pour me remettre un papier avec son numéro, et me demande plusieurs fois de l’appeler. » Depuis son enfance autrichienne à Vienne, Julia Roy, qui n’a alors joué qu’un petit rôle dans une série télévisée, nourrit une cinéphilie précoce. Elle décide de rappeler ce cinéaste : peut-être peut-il la conseiller, elle qui rêve de faire des films ? Au restaurant Le Hangar, dans le Marais, où ils se retrouvent, « il me regarde comme un miracle ». D’après son récit, il lui fait immédiatement de grandes déclarations : « Il m’annonce qu’il va faire tous ses films avec moi, qu’il m’aidera à écrire les miens, qu’il veut m’avoir tout le temps avec lui et devant lui. » Tout juste est-il déçu en apprenant son âge : il la pensait plus jeune. Six ans après, en 2019, c’est une jeune femme traumatisée par la relation nouée avec le réalisateur qui s’enfuit en Autriche. « J’ai été diagnostiquée comme atteinte d’un syndrome de stress post-traumatique. » En janvier 2024, elle découvre les accusations de Judith Godrèche sur sa relation passée avec Benoît Jacquot qui ont motivé l’ouverture d’une enquête préliminaire, mercredi 7 février. Elle décide à son tour d’évoquer publiquement son vécu avec le réalisateur, composé de manipulation, de domination, de violences physiques et de harcèlement sexuel. Certains des faits qu’elle dénonce pourraient ne pas être couverts par la prescription. Au début, leur rapport prend la forme d’une amitié professionnelle, une sorte de mentorat, par lequel le réalisateur veut aider l’étudiante à faire des films. Il l’invite à Venise en 2013, comme Judith Godrèche en 1987. « Dans le train couchette, il m’approche physiquement. Je suis mal à l’aise, je trouve ça étrange vu notre différence d’âge. » En 2015, sur le tournage d’A jamais, un film dont Julia Roy est la scénariste et dans lequel elle tient le rôle principal face à Mathieu Amalric, elle vit un premier épisode traumatique. « Dans une chambre d’hôtel dans l’Algarve au Portugal, il se met à m’insulter, à me traiter de pute et de salope », explique-t-elle. Il y aura trois autres films ensuite, jusqu’à la fuite en 2019. Dans la presse de l’époque, Julia Roy est alors décrite comme la « nouvelle muse » ou « égérie » de Benoît Jacquot. « Tu seras morte en France » Entre l’actrice et le réalisateur, la relation se dégrade progressivement au point qu’elle reçoit une gifle si puissante qu’elle tombe par terre. Les brimades se poursuivent : il contrôle sa nourriture, la longueur de ses cheveux, sa façon de s’habiller et de parler, et la dissuade de reprendre des études. « Il voulait contrôler tout ce que je faisais. Quand je le confrontais sur ses violences verbales et physiques, il détournait tout, prétendait que rien de tout cela n’était arrivé, et son discours était souvent contradictoire. Je commençais à douter sur mon propre ressenti, à perdre mon libre arbitre et mon esprit critique. Je n’avais plus confiance en moi. » Elle craint d’aller au restaurant avec lui, de peur que cela dégénère. Il lui lance des verres d’eau au visage. Au festival de Lisbonne & Estoril, en 2017, lors d’un repas avec d’autres invités du festival, juste avant de s’asseoir, il recule sa chaise pour qu’elle tombe par terre. « Il avait des crises de rage fréquentes, au cours desquelles il jetait des chaises (comme lors du Festival de Venise, à l’Hôtel Excelsior en 2017), des assiettes et des verres, et donnait des coups de pied, qui me laissaient stupéfaite. » Photo : Benoît Jacquot et Julia Roy, lors de la 73ᵉ Mostra de Venise, en Italie, le 9 septembre 2016. PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES VIA AFP Benoît Jacquot profère des menaces : si elle arrête de le voir, il ternira sa réputation dans le cinéma et elle ne pourra plus jamais travailler nulle part. « Tu seras morte en France », lui dit-il. A table en 2018, lors des Ciné Rencontres de Prades (Pyrénées-Orientales), il lui répète : « T’es morte pour moi, t’es comme morte. » Quand elle l’accuse et se défend, il essaye d’acheter son silence en voulant lui offrir sa maison en Grèce. « Si nous restons amis, elle sera à toi. » « Il ne supportait pas l’image de la vieillesse que je lui renvoyais, il se haïssait de ne pas être jeune, me répétait qu’il était un éternel adolescent. Il ne voulait pas que je lui rappelle son âge », analyse aujourd’hui la comédienne et scénariste. « Il me disait que j’étais une femme-enfant. Je le voyais lire Sade et Nabokov, et il me disait que je lui faisais penser à une peinture de Balthus. » Comme à Judith Godrèche deux décennies plus tôt. Un marché formulé aux comédiennes Pour se reconstruire, Julia s’est tournée vers sa première passion : l’écriture, à travers laquelle elle a pu mieux comprendre ce qu’elle a vécu. Elle vient de finir le scénario d’un long-métrage sur le mouvement #metoo en France et compte prochainement passer à la réalisation de son premier court métrage. « Il me fait de la peine parce qu’en fait il est terrifié – son sadisme est à la mesure de sa peur », conclut-elle. Interrogé par Le Monde, Benoît Jacquot nie plusieurs de ces faits, mais en reconnaît certains. « Je lui ai donné un coup de pied au cul, lors d’un dîner à Florence, dans un hôtel où nous étions. Mais ce n’était pas un coup de poing dans le ventre. C’était comme un truc qu’on fait à un enfant pour le calmer. Je ne culpabilise pas à propos de cela aujourd’hui. » Il admet également lui avoir jeté le contenu d’un verre d’eau au visage et avoir eu avec elle « des discussions assez violentes, fortes », « des engueulades éventuellement vigoureuses ». Les insultes ? « C’est très possible. » Le cinéaste ajoute : « Il y a une violence dans les rapports amoureux. Je ne suis pas particulier ou exceptionnel. Mais comme je fais du cinéma, cela prend des proportions exceptionnelles. » Et de regretter l’importation depuis les Etats-Unis d’un « néopuritanisme assez effrayant ». Le réalisateur, 77 ans aujourd’hui et auteur d’une trentaine de films, a toujours revendiqué une conviction artistique : il faut être « amoureux » de ses actrices pour éprouver le désir de les mettre en scène. Avec pour conséquence, dans sa vie personnelle, que les films et les femmes se mêlent. Ce dont il ne s’est jamais caché. A l’écouter, il s’agirait même d’un contrat qu’il passe avec ses comédiennes. En 2006, dans Les Inrockuptibles, il évoque sa collaboration avec Judith Godrèche sur La Désenchantée en ces termes : « Je dirais que le film est fait sur mon désir de son désir. (…) Je lui donne le film. Avec tout de même un pacte à la clé : si je lui donne le film, elle, en retour, se donne complètement. Ce qui est à entendre dans tous les sens qu’on voudra. » Le marché est explicitement formulé : le réalisateur de films d’auteur célébré offre un beau rôle à une comédienne, souvent en devenir, et attend en échange qu’elle s’offre à lui. En 2015 dans Libération, Benoît Jacquot redit la même chose, mais pour la généraliser à l’ensemble de son œuvre : « Mon travail de cinéaste consiste à pousser une actrice à passer un seuil. La rencontrer, lui parler, la mettre en scène, la diriger, m’en séparer, la retrouver : le mieux, pour faire tout ça, c’est encore d’être dans le même lit. » « Un voleur d’enfance » Ce contrat, plus ou moins tacite, Vahina Giocante dit l’avoir refusé. La comédienne a 17 ans lorsqu’elle rejoint le tournage de Pas de scandale, film de Benoît Jacquot diffusé en salle en 1999. A l’époque, celle qui se destinait à une carrière de danseuse mais a été repérée sur une plage par une directrice de casting a déjà joué dans trois longs-métrages. Avec ce nouveau projet, elle décroche un rôle de premier plan, partageant l’affiche avec Fabrice Luchini, Isabelle Huppert et Vincent Lindon, trois des comédiens fétiches du réalisateur. Vahina Giocante incarne Stéphanie, une jeune coiffeuse entretenant une relation ambiguë avec le personnage plus âgé interprété par Luchini. Au bar d’un hôtel parisien, Vahina Giocante, 42 ans désormais, accepte de replonger dans ses souvenirs, dans le but de soutenir Judith Godrèche. « Avant le tournage de Pas de scandale, raconte-t-elle, on me prévient que Benoît Jacquot aime beaucoup les jeunes femmes. Je ne sais plus qui m’a mise en garde. Très vite, je dois manœuvrer, j’évite des situations, comme lorsqu’il veut faire des lectures dans l’hôtel où il loge. Sur le plateau, il est d’abord dans un jeu de séduction, assez subtil. Mais cela bascule au moment d’une scène, celle du lit. » C’est le premier plan de Pas de scandale dans lequel apparaît l’actrice. On la voit s’extraire d’un lit où elle a passé la nuit avec un homme plus âgé, attraper un long T-shirt vert qui traîne au sol et commencer à s’habiller, le vêtement récupéré par terre sur le corps. « Je fais la scène une première fois. Puis Benoît Jacquot vient me voir et me demande de la refaire sans porter de culotte en dessous du T-shirt. Cela n’a aucun sens scénaristique, puisqu’il couvre ma culotte. Mais il me fait comprendre que je n’ai pas le choix. Je vais voir l’habilleuse et lui demande de me donner une culotte couleur chair ou un string. Elle panique un peu, car elle a peur de se faire virer, mais elle finit par dire oui. Je refais la scène avec cet accessoire, sans rien dire. Benoît Jacquot me regarde d’en bas, avec ce petit sourire narquois et me dit : “Tu vois, ce n’était pas si difficile.” » C’était seulement pour lui une question de pouvoir, un fantasme personnel. Photo : L’actrice Vahina Giocante, le 12 mars 2005, à Deauville, lors du 7ᵉ Festival du film asiatique. JEAN-PIERRE MULLER / AFP Un autre épisode sur ce tournage, dont elle a gardé des souvenirs précis, a marqué Vahina Giocante. « Quelques jours après la scène du lit, Benoît Jacquot me demande : “Est-ce que tu comprends bien que, si tu es gentille avec moi, tu feras le prochain ?” » Pour l’actrice, l’allusion est limpide : si elle couche avec le réalisateur, elle obtiendra un rôle dans son film suivant, en l’occurrence Sade, pour lequel le cinéaste a finalement engagé Isild Le Besco. Vahina Giocante refuse les avances du metteur en scène. « Je lui ai répondu : “Je ne suis pas une gentille fille.” Après cela, son attitude a changé, il a été froid, distant, odieux. Il me parlait à peine et préférait passer par le premier assistant réalisateur. » Interrogé sur ces éléments, qui pourraient relever du délit de harcèlement sexuel, Benoît Jacquot dément. Vahina Giocante n’a plus jamais tourné avec le cinéaste. « Je le méprise, dit-elle. Il bénéficie d’une réputation d’intellectuel, mais il y a tellement de cynisme, d’arrogance, de sentiment de supériorité que cela ne mérite que le mépris. Je le vois comme un voleur d’enfance, émoustillé par le désir de pureté. Benoît Jacquot est dans une confusion telle qu’il recherche une histoire d’amour en même temps. Il se met en position de créateur, de demi-dieu, il façonne une femme, et cela ne l’intéresse plus quand la jeune fille devient une femme. Il cherche une dimension d’innocence, de malléabilité, pour que l’emprise puisse s’exercer. » « La question de l’emprise » au cœur de ses films Sur les photos d’archives, qui datent d’août 1999, Isild Le Besco a les airs de la fillette qu’elle était encore : corps minuscule, visage frêle, tresse et regard tendre. Lors du tournage de Sade, film sorti en 2000, elle a 16 ans. C’est à ce moment qu’elle fait la rencontre de Benoît Jacquot, 52 ans à l’époque, et qu’elle entame avec lui une relation qui durera plusieurs années, jusqu’au film L’Intouchable (2006). La comédienne, 41 ans aujourd’hui, voit-elle dans l’histoire de Judith Godrèche des similarités avec la sienne ? Au Monde, elle répond qu’elle ne sent pas « pas prête à évoquer cette histoire dans la presse ». Elle réserve sa parole à une éventuelle convocation « devant un tribunal » et pour un récit écrit sur lequel elle travaille depuis des mois. Elle nous a toutefois transmis un texte dans lequel elle reconnaît avoir subi des « violences psychologiques ou physiques » de la part de Benoît Jacquot. « Comme toutes ces comédiennes qui parlent aujourd’hui, j’ai mis du temps à comprendre où mes limites avaient été franchies, comment, par qui, écrit-elle. Comme pour beaucoup d’entre elles, mon histoire personnelle me prédisposait à être utilisée, objectifiée. Comme elles, mon image, mon corps ont nourri des fantasmes alors que, tout juste adolescente, je n’avais même pas conscience d’être sexualisée. En devenant réalisatrice, je suis devenue celle qui impose ses propres limites et sa propre vision du monde. Mon combat aujourd’hui consiste à ne pas reproduire ce système de domination avec les personnes avec lesquelles je travaille, femmes et hommes. Si toutes celles et ceux qui ont subi ces violences psychologiques ou physiques parviennent à faire face, à trouver la force de les nommer et surtout, arrêtent de les reproduire, on peut espérer que les nouvelles générations du cinéma et des arts fonctionneront désormais sur des bases plus saines. Et au-delà, pour le bien de la création, que la dénonciation de ces actes servira à renouveler nos imaginaires des femmes, des hommes, et de ce qui les lie. » Confronté à ce propos, Benoît Jacquot nie toute violence physique à l’égard d’Isild Le Besco. Sur d’éventuelles violences psychologiques, il avance une hypothèse. D’après lui, la comédienne lui reprocherait de n’avoir pas voulu faire d’enfants avec elle. « Elle l’a très mal vécu », dit-il. Au moment de ce qu’il décrit comme sa « vie amoureuse » avec Isild Le Besco, Benoît Jacquot explique qu’il habitait avec l’actrice Anne Consigny, la mère de ses deux fils. Isild Le Besco a participé à six films de Benoît Jacquot, dont Au fond des bois (2010). Ce film relate l’histoire d’une jeune bourgeoise qui suit un vagabond sans que l’on sache si elle le fait de son plein gré. Au moment de sa sortie, le réalisateur en parlait dans Le Journal du dimanche de la manière suivante, qui résonne étrangement aujourd’hui : « La question de l’emprise et du consentement, de ce qu’on veut ou pas, de ce qu’on ne veut pas malgré ce qu’on veut, m’a intéressé de film en film. Avec cette histoire, je voulais que ces ambivalences soient tressées jusqu’au vertige. » Un homme en plein délire Présente en 2004 sur le tournage du film A tout de suite avec Isild Le Besco, la comédienne Laurence Cordier se souvient d’une jeune femme séparée des autres acteurs de son âge : « Benoît Jacquot surveille ce que mange Isild, la reprend, lui parle mal. On dirait un père malsain. Isild est tout le temps terrifiée et semble transformée en accessoire. » La même Laurence Cordier a, elle aussi, connu une expérience étrange avec Benoît Jacquot. C’était en 2009, peu avant l’avant-première de Villa Amalia, l’un des plus grands succès du cinéaste. Au restaurant, ce dernier lui fait une déclaration : « Il faut qu’on vive une histoire ensemble, tu vas être mon égérie. » Il explique qu’il a besoin d’être amoureux de son actrice, comme un peintre et son modèle. Il lui promet comme aux autres de l’emmener en Italie, de lui faire découvrir Venise. Lorsque, d’après son récit, Laurence Cordier tente de l’éconduire, il lui demande de se taire et insiste : « Je sais qu’au fond de toi tu en as envie, ça va être merveilleux. » Au bout d’une heure, pendant laquelle elle a l’impression de se trouver face à un homme en plein délire, il sort des clés de chez lui. « C’est pour quand tu vas venir chez moi », l’informe-t-il. Face au refus de la comédienne de prendre la clé, Benoît Jacquot finit par la lui glisser dans la poche de son manteau. Désarçonnée, elle court après lui pour lui rendre l’objet. Il se retourne, furieux : « Tu ne me touches pas et tu gardes cette clé. » Le soir même, Laurence Cordier reçoit un message vocal sur son répondeur. C’est Benoît Jacquot qui lui donne son adresse et ses codes et l’invite à venir quand elle veut. La comédienne ne sait pas comment réagir. Elle doit retrouver quelques semaines plus tard le réalisateur pour le téléfilm Les Faux-Monnayeurs, sur lequel elle a décroché un rôle. Va-t-elle le perdre si elle ne se rend pas chez Benoît Jacquot ? Elle n’est finalement pas virée et participe au projet. Mais à la fin du tournage, le cinéaste vient la voir pour lui signifier qu’elle « ne veu[t] pas vraiment être actrice car je me sabotais moi-même ». Elle a gardé la clé des années dans son bureau ne sachant pas quoi en faire, pour finalement la jeter. Aujourd’hui, Laurence Cordier a délaissé le cinéma pour devenir metteuse en scène de théâtre. Auprès du Monde, Benoît Jacquot confirme l’histoire : « Je lui ai mis une clé dans la poche. C’est un crime ? Elle me plaisait beaucoup, j’avais l’impression que je lui plaisais aussi. » « Cette foutue notion d’auteur » Entre le cinéaste et Virginie Ledoyen, la rencontre a lieu en 1994, alors que la comédienne n’a pas encore 18 ans – lui en a 47. C’est à l’occasion d’essais pour un téléfilm diffusé un an plus tard sur Arte, La Vie de Marianne. Inspiré du roman de Marivaux, ce récit d’initiation, genre chéri par le cinéaste, narre le destin d’une jeune héroïne sur laquelle s’exerce le désir des hommes, dont l’un beaucoup plus âgé qu’elle, en même temps que leur chantage. Soit l’assurance de leur protection contre le cadeau de la chair. Comme un rappel fictionnel du « pacte » évoqué par Benoît Jacquot à propos de Judith Godrèche dans La Désenchantée. Ces essais, lectures filmées en très gros plan sur le visage de Virginie Ledoyen, figurent dans les bonus d’un double DVD édité par les Cahiers du cinéma, où l’on trouve aussi un entretien avec le réalisateur. Interrogé sur la façon dont il a découvert la comédienne, le réalisateur explique l’avoir vue pour la première fois dans un film d’Olivier Assayas, L’Eau froide, sorti en 1994. « C’est amusant ces échanges de chair fraîche qu’il peut y avoir entre cinéastes amis », commente au passage Benoît Jacquot. Contactée par Le Monde par le biais de son agent, Virginie Ledoyen n’a pas répondu à nos sollicitations. Directrice de la photographie réputée, Caroline Champetier a travaillé sur une dizaine de films avec Benoît Jacquot. Lorsqu’elle a vu la série sur Arte de Judith Godrèche, Icon of French Cinema, elle a été admirative et rattrapée par ses souvenirs. « Ce qu’elle appelle emprise, moi je l’appelle séparation. Benoît Jacquot a une façon de travailler, sur les tournages, qui sépare les gens les uns des autres, et notamment les femmes. J’ai vécu ce mécanisme de séparation avec d’autres actrices parfois plus âgées. » Et celle qui a débuté avec Jean-Luc Godard de poursuivre : « C’est aussi cette foutue notion d’auteur : le film appartiendrait à un seul, auquel tout est dû, auquel on doit tout, auquel on passe tout. Et avec une certaine désinvolture, plus les dépassements se manifestent, plus on les salue. Mais quand il y a violence ou prédation, c’est quelque chose que tout le monde questionne aujourd’hui. » Une manière d’esthétiser ses pratiques Toutes les jeunes actrices n’ont pas vécu la même pression. Roxane Mesquida a joué dans L’Ecole de la chair, film datant de 1998. « Je n’ai pas du tout la même histoire que Judith Godrèche, assure la comédienne franco-américaine, 15 ans à l’époque, 42 ans aujourd’hui. Benoît Jacquot m’a donné ma chance, le film est allé à Cannes, j’ai donné la réplique à Isabelle Huppert… Cela a été une super expérience pour moi, et le tournage le plus professionnel que j’ai connu. » Et de préciser tout de suite : « J’étais accompagnée par ma mère, qui est toujours venue avec moi sur les plateaux. Et, aujourd’hui, je ne laisserais jamais ma fille aller seule sur un tournage. » Benoît Jacquot confond-il « désir créatif et désir sexuel », comme l’analyse par ailleurs Vahina Giocante ? Dans le café où il a accepté de rencontrer Le Monde, le cinéaste admet sans peine qu’il associe les deux élans. « C’est l’histoire de l’art et du cinéma. Je ne suis pas le seul. C’est aussi le cas de Chaplin, Bresson, Pialat, Kechiche. » Il ne voit pas ses liaisons avec des actrices qu’il fait tourner comme des « abus de pouvoir » : « cela désérotiserait ces histoires », argue-t-il. « Dans le cinéma, il y a le début, la naissance de quelqu’un, d’un acteur ou d’une actrice, par la façon dont ils apparaissent dans un film. Cela m’intéresse beaucoup. » Les inclinations assumées de Benoît Jacquot pour ses comédiennes, souvent mineures, ont suscité très peu d’émoi dans le monde culturel. Toute sa carrière, le cinéaste a produit un discours théorique cherchant à esthétiser ces pratiques, à les transformer en geste subversif et artistique. Avec un succès certain. « Pour moi, l’indice de vérité quant au monde, c’est la jeune fille, disait-il ainsi dans Les Inrocks en 2006. On a tous des fenêtres qui nous permettent d’envisager la réalité, sinon d’y accéder. Moi, c’est vrai que ce sont les femmes à ce moment-là de leur existence. » Son œuvre cinématographique est traversée par un motif récurrent : celui de la jeune fille objet d’un désir amoureux agressif, émanant souvent d’hommes plus âgés. L’un de ses films les plus récents, Dernier Amour (2019) avec Vincent Lindon, s’intéresse à l’histoire d’un échec amoureux de Casanova auprès d’une jeune prostituée. Dans Journal d’une femme de chambre (2015), la domestique incarnée par Léa Seydoux doit se défendre des agressions sexuelles du maître de maison (joué par Hervé Pierre) et faire avec la brutalité sexuelle du jardinier (Lindon, encore). « Dans ses interviews, il répète qu’il est féministe parce qu’il filme les femmes, relève Julia Roy. En réalité, les femmes sont souvent maltraitées dans ses films et il aime voir ça. » De Léa Seydoux, le cinéaste racontait, dans une interview filmée pour AlloCiné en 2012, l’avoir découverte dans La Belle Personne, de Christophe Honoré : « J’ai eu l’impression de voir une sorte de résurrection, un remake d’Anna Karina. (…) Et en plus, elle avait une façon de se dépoitrailler, de montrer ses seins comme ça rapidement… Je m’y attendais pas, cela m’a beaucoup suffoqué. » « Fixé à l’adolescence » Pendant sa carrière, le cinéaste a été souvent soutenu par des médias influents, dont Le Monde, Télérama, Libération, Radio France, etc. En 2007, il a fait l’objet d’une rétrospective à la Cinémathèque, le temple français des cinéphiles. Dans son texte de présentation de l’événement, l’ex-directeur de l’établissement, Serge Toubiana, par ailleurs ancien patron des Cahiers du cinéma et proche de Jacquot, saluait un artiste pour lequel « le réel n’est pas seulement régi par des règles sociales ou des jeux de pouvoir, mais qu’il est aussi truffé par le désir, la jouissance, le manque, etc.» Sollicité, Serge Toubiana n’a pas répondu au Monde. Cette conception du cinéma de Benoît Jacquot est partagée par le réalisateur lui-même. En 2011, dans une conversation publiée par La Vie avec le psychanalyste Gérard Miller (par ailleurs accusé de viols et agressions sexuelles, dans des enquêtes de Elle et Mediapart), il faisait cette réflexion sur lui-même : « Le désir est nécessairement hors la loi, et aujourd’hui encore, rien ne m’intéresse vraiment qui ne soit transgressif. En fait, je suis resté voyou et comme fixé névrotiquement à l’adolescence. Je pense d’ailleurs que mon symptôme est à chercher de ce côté-là. » Lorraine de Foucher et Jérôme Lefilliâtre Légende photo : L’actrice Isild Le Besco et le réalisateur Benoît Jacquot au 57ᵉ Festival de Cannes, le 14 mai 2004. BRUNO VINCENT / GETTY IMAGES VIA AFP ___________________________________ Sur le même sujet : Article paru dans Libération du 8/02/24 Judith Godrèche accuse aussi Jacques Doillon de violences sexuelles quand elle avait 15 ans Au lendemain de l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris pour «viol sur mineur» à l’encontre de Benoît Jacquot, faisant suite au dépôt de plainte de Judith Godrèche, l’actrice raconte avoir été victime, au même âge, de faits relevant de l’agression sexuelle de la part du réalisateur Jacques Doillon devant les caméras. C’est «une histoire de violence, de contrôle». Interrogée sur France Inter, l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche est revenue, ce jeudi 8 février, sur le témoignage qu’elle porte contre le réalisateur Benoît Jacquot, qu’elle accuse de violences sexuelles commises alors qu’elle était mineure, dans les années 1990. Nouvelle déflagration sur les ondes de la radio publique : la comédienne est revenue sur une scène traumatique survenue alors qu’elle tournait un film avec Jacques Doillon, la Fille de 15 ans, sorti en 1989. Alors qu’elle entretient une relation avec Benoît Jacquot, de 25 ans son aîné, elle devient «l’objet d’un autre réalisateur», la lance la journaliste, Sonia Devillers. «Oui, il est flatté parce que je lui appartiens, il est envié, il se sent envié par Doillon. […] C’est une forme de truc narcissique où il a un truc que les autres veulent», répond-elle, visiblement très émue. «Mais qu’est-ce qu’il veut de vous Doillon ? Votre talent d’actrice ?», poursuit l’intervieweuse. «La même chose. — Votre corps ? — Donc il abuse de vous ? — Hum.» La scène se passe lors d’un tournage. L’acteur qui devait partager l’affiche avec Judith Godrèche vient d’être viré par le réalisateur du film, Jacques Doillon, qui décide de se mettre à sa place. «D’un coup, il décide qu’il y a une scène d’amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j’enlève mon pull, et je suis torse nue, et il me pelote, et il me roule des pelles», raconte-t-elle. Jane Birkin, à l’époque femme du réalisateur, est présente, assure-t-elle. «C’est une situation extrêmement douloureuse pour elle.» L’actrice mentionne par ailleurs, sans en dire plus, un autre évènement, survenu «dans la maison de Jane, dans le bureau de Doillon». «Mais ça, personne ne l’a vu, et je n’en ai parlé à personne.» Le parquet de Paris a ouvert mercredi 7 février une enquête au lendemain de la plainte déposée par l’actrice Judith Godrèche pour viols sur mineure contre le réalisateur Benoît Jacquot, qui l’a dirigée et a entretenu plusieurs années une relation avec elle à partir de ses 14 ans. Confiée à la brigade pour mineurs, elle porte «sur les infractions de viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violences par concubin, et agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité». Selon le Monde, Benoît Jacquot, 77 ans et un film attendu prochainement, «nie fermement les allégations et accusations». Sollicité par l’AFP, il a fait savoir mercredi qu’il ne souhaitait pas réagir davantage, s’en tenant à ces déclarations. Voir les extraits vidéo de l'entretien sur France Inter :
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 16, 2024 5:26 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 16 février 2024 La caméra de Duccio Bellugi-Vannuccini et Thomas Briat suit la centaine de comédiens venus de toute l’Ukraine pour se frotter à l’art de l’improvisation avec la metteuse en scène et sa troupe.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/16/au-bord-de-la-guerre-ariane-mnouchkine-et-le-theatre-du-soleil-a-kyiv-sur-france-5-la-cartoucherie-de-vincennes-livre-ses-munitions-culturelles_6216980_3246.html
FRANCE 5 – VENDREDI 16 FÉVRIER À 22 H 50 – DOCUMENTAIRE Voir le dossier de presse France.tv C’est un documentaire tourné dans la neige et le froid, avec, pour décor, une ville assiégée, pour horizon, un ciel strié de drones russes, pour bande-son, le rugissement des alarmes. Au bord de la guerre se déroule à Kyiv (Kiev), en Ukraine. Là où Ariane Mnouchkine a décidé de se rendre, dès mars 2023, pour y mener une école nomade avec des membres volontaires de sa troupe. Douze jours de stage intensif regroupant une centaine de comédiens ukrainiens (amateurs, élèves, professionnels) venus de tout le pays pour se frotter à ce qui constitue l’ADN du Théâtre du Soleil : l’improvisation. Sur place, ils ont trouvé une salle de répétition et son rideau jaune en fond de scène, quelques costumes et des accessoires. Il n’en fallait pas plus à la metteuse en scène pour faire naître une « île » (le mot est d’elle) de paix et d’espoir au cœur du marasme. Suivie par la caméra de Duccio Bellugi-Vannuccini et Thomas Briat, cette aventure relève de l’urgence et de la nécessité. « Nous ne partons pas en colonie de vacances », rappelle Ariane Mnouchkine avant de quitter la Cartoucherie de Vincennes. Elle n’a pas l’ombre d’un doute : si les Ukrainiens perdent, répète-t-elle, « nous perdons ». Son périple artistique est un soutien politique. Un concentré de paradoxes Mais à quoi sert l’art en temps de guerre ? Cette question hante un documentaire qui tricote ses fils maille à maille entre séances de répétition et apartés des réalisateurs avec des Ukrainiens dont les propos convoquent le réel sous l’objectif de la caméra : le mari d’une actrice combat sur le front. Un acteur, pasteur protestant, a obtenu une permission pour suivre l’école nomade. Une jeune fille confie : « C’est la première fois qu’on nous parle d’amour depuis l’invasion totale du pays. » Ce film, d’une grande tendresse, est un concentré de paradoxes qui cohabitent dans la joie. D’un côté, la dévastation du pays, de l’autre, les exigences du théâtre. Assise dans les gradins, micro en main, Ariane Mnouchkine sculpte les scènes qui naissent devant le rideau jaune. Le spectacle est sur le plateau. Il est aussi dans les rangs du public. Sur le visage de la metteuse en scène défile une infinité d’émotions. Orageuse, enthousiaste, hilare, concentrée, elle lance les musiques et donne le top départ à de fulgurantes improvisations. Elle observe tout le monde, ne passe rien à personne, elle s’impatiente et s’enthousiasme. Son dynamisme est contagieux, son énergie inouïe. « Est-ce qu’on a vraiment besoin de théâtre ? », s’interroge, douze jours plus tard, au moment des adieux, un participant à l’école nomade. Il laisse passer quelques minutes. Puis ajoute : « Nos soldats défendent l’Ukraine les armes à la main. Nous, on bâtit la nouvelle Ukraine. Et pour cela, nous avons besoin des munitions culturelles que vous nous apportez. » Lorsque la troupe du Soleil repart pour la France, elle laisse derrière elle une arme de théâtre qui est tout aussi utile à la vie : apprendre à redresser la tête pour incarner un personnage, c’est apprendre à ne plus la courber devant l’ennemi. Message reçu cinq sur cinq par des élèves conquis qu’Ariane Mnouchkine quitte sur une dernière et belle injonction : « Vous devez être convaincus que vous avez choisi un art, le théâtre, qui est indestructible. » Au bord de la guerre. Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil à Kyiv, documentaire de Duccio Bellugi-Vannuccini et Thomas Briat (Fr., 2023, 59 min). Diffusé sur France 5 dans le cadre de la collection « Aux arts et cætera ». Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Ariane Mnouchkine dans le documentaire « Au bord de la guerre. Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil à Kyiv », réalisé par Duccio Bellugi-Vannuccini et Thomas Briat. ZADIG PR Lien vers le documentaire en replay (59 mn) (inscription nécessaire sur france.tv)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 15, 2024 5:31 PM
|
Article d'Anne Chépeau - Radio France - 15 février 2024 Le comédien de 79 ans revient au théâtre mardi avec des lectures à La Pépinière, à Paris.
Une table sur laquelle sont posés un verre d'eau et une paire de lunettes, une chaise et la servante, cette lumière qui continue de briller dans les théâtres quand le spectacle est terminé. C'est dans ce décor que Pierre Arditi fait son retour sur scène. Un retour sobre et forcément chargé d'émotion, mardi 13 février, après des malaises sur scène ces derniers mois. Le comédien avait été contraint d'annuler des représentations de la pièce Lapin avec Muriel Robin. Cette fois-ci, à 79 ans, Pierre Arditi revient seul sur la scène du théâtre de La Pépinière, à Paris. "Ce qui était agréable, c'était de retrouver le public qui, lui, a été absolument épatant. Je l'ai vécu comme quelqu'un qui revient à la vie, explique le comédien. Je l'ai vécu magnifiquement, avec une toute petite appréhension parce que je me suis dit 'j'espère qu'il n'y aura rien', mais bon, j'ai été très bien soigné et tout ça est un mauvais souvenir qui est derrière moi", ajoute-t-il. Deux auteurs complémentaires Pour ce spectacle, La Pépinière de Pierre Arditi, l'acteur lit des extraits de texte de Jean-Michel Ribes et de Yasmina Reza, deux auteurs dont il incarne les mots avec ce qu'il faut d'humour et de distance. "C'est un bon choix, d'ailleurs, parce que c'est ludique, souligne Pierre Arditi. Les deux textes, chacun à leur manière. Ribes, comme un dadaïste qui prend les aventures, il les tord, il regarde sous ses jupes", poursuit-il. Et le comédien d'ajouter : "Yasmina, elle, dépeint ce que nous sommes ou ce que nous serons et ce que nous avons été avec une causticité tchékhovienne, elle est élégante et ça reste absolument drôle, et par moments d'ailleurs pathétique." Deux auteurs et des textes "qui se complètent parfaitement", d'après lui. "Le meilleur des médicaments du monde" Les rires des spectateurs, à l'écoute notamment des histoires désopilantes que Jean-Michel Ribes a vécues et racontées dans son livre Mille et un morceaux, gagnent parfois Pierre Arditi, qui savoure ces moments de complicité avec le public qui, pour lui, est "un ami depuis très longtemps maintenant, depuis 60 ans". Des spectateurs auxquels le comédien se confie aussi, avant et après les lectures, parce qu'il en avait "besoin". "Avant, j'ai raconté pourquoi, au fond, je choisissais de lire, cette discipline qui est encore une fois l'essence même de mon métier au départ, de raconter des histoires", explique-t-il. "Ensuite, je fais une boutade en ce qui a concerné mon état de santé, mais c'est une boutade quand je dis que je vais mieux et que normalement cette fois-ci devrais arriver au bout, ça les fait rire." Pierre Arditi, comédien à franceinfo À la fin des lectures, "je leur dis à quel point ils sont chers pour moi, à quel point ils sont le meilleur des médicaments du monde et que tant qu'ils seront là, j'existerai", s'émeut Pierre Arditi. Le comédien montera sur la scène du théâtre de la Pépinière tous les mardis et mercredis jusqu'au 24 avril. Ces lectures vont donc l'accompagner quelques mois, mais il a déjà prévu de jouer deux pièces la saison prochaine car, rappelle-t-il "le théâtre, c'est ma vie".

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 15, 2024 3:29 AM
|
Murielle Joudet dans Le Monde - 14 février 2024 Pour son passage derrière la caméra, le metteur en scène confond virtuosité et agitation, flamboyance et académisme.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/02/14/le-moliere-imaginaire-olivier-py-filme-un-etouffant-huis-clos-eclaire-a-la-bougie_6216475_3246.html
L’AVIS DU « MONDE » – ON PEUT ÉVITER Metteur en scène et ancien directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py passe derrière la caméra, sans trop s’éloigner de son premier amour : Le Molière imaginaire se veut un portrait libre et néanmoins documenté de l’homme de théâtre. S’écartant du biopic en bonne et due forme, Olivier Py préfère se focaliser sur les derniers instants de son héros (incarné par Laurent Lafitte, de la Comédie-Française) : selon la légende, Jean-Baptiste Poquelin serait mort le 17 février 1673 sur la scène du Théâtre du Palais-Royal, en pleine quatrième représentation du Malade imaginaire. Ce soir-là, l’artiste, très affaibli, continue pourtant de jouer, offrant au public le spectacle de sa lente agonie. Entre les coulisses et la scène, ce sont toutes les strates de son existence qui sont mobilisées : sa vie amoureuse ; son rapport au pouvoir et à la religion ; sa liaison supposée avec Michel Baron, grand comédien de l’époque, laquelle permet au metteur en scène d’évoquer un Molière bisexuel – fait accrédité par plusieurs biographes. Un grand tableau numérique On ne pourra pas dire, néanmoins, que le film contribue à revitaliser un monument national, qui n’en avait pas forcément besoin, c’est même plutôt un sentiment fort de claustration qui se dégage de ce huis clos éclairé à la bougie, aux couleurs saturées ocre et rouge, filmé à grand renfort de plans-séquences – le résultat ressemble à un vaste tableau numérique aux couleurs baveuses, particulièrement laid. La caméra gesticule en tous sens, les acteurs déclament et fatiguent. Au lieu de libérer l’émotion et le sens, ces partis pris esthétiques les enferment dans un dispositif qui prend son agitation pour de la virtuosité, son académisme pour de la flamboyance. Ce qui marche peut-être au théâtre épuise rapidement dans une salle obscure. Voir la bande-annonce du film Film français d’Olivier Py. Avec Laurent Lafitte, Stacy Martin, Bertrand de Roffignac (1 h 34). Murielle Joudet

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2024 8:19 AM
|
L' enfance de l’art
Les masterclasses de la Comédie, CDN de Reims
Episode 1 avec Laurent Poitrenaux ET les élèves de la Classe de la Comédie
Les élèves de la Classe de la Comédie vous convient à un entretien privilégié avec le comédien Laurent Poitrenaux.
Un dialogue entre deux générations explorant les débuts dans le monde du théâtre et le cheminement d’un.e comédien.ne.
AVEC
Laurent Poitrenaux, comédien
ET Kaito Berhart, Amélie Dupuis et Félix Hugue Ecouter le podcast en ligne
Enregistré en public à la Comédie, CDN de Reims le vendredi 19 janvier 2024.
Episode réalisé par la Comédie, CDN de Reims avec Martin Quénéhen, Sur le vif studio, sur une idée d’Anne-Lise Heimburger, artiste associée à la Comédie.
Lien vers un article de Joëlle Gayot sur Laurent Poitrenaux, article du Monde : https://sco.lt/8kw8mW

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2024 6:20 AM
|
Dans un texte rédigé pour sa fille Tess, âgée de 18 ans, Judith Godrèche évoque sa relation avec le réalisateur Benoît Jacquot, qui a commencé alors que l’actrice n’avait que 14 ans, et la nécessité, aujourd’hui, d’en parler. [En parallèle d’une enquête du Monde sur la relation d’emprise exercée par le réalisateur Benoît Jacquot sur Judith Godrèche, alors âgée de 14 ans, pour laquelle elle a porté plainte, mardi 6 février, pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans » commis par personne ayant autorité, l’actrice et réalisatrice écrit une lettre pour sa fille.] Lire l'article sur le site du "Monde"
https://www.lemonde.fr/societe/article/2024/02/07/lettre-de-judith-godreche-a-sa-fille-je-viens-de-comprendre-ce-truc-le-consentement-je-ne-l-ai-jamais-donne-non-jamais-au-grand-jamais_6215157_3224.html
Ma chérie, Je te regarde vivre, danser, t’exprimer avec fougue et ardeur.
Je me souviens de cette même ardeur, cette même fougue, mise à l’épreuve d’une solitude imposée. Une solitude à plusieurs visages. Tu viens d’avoir dix-huit ans.
Tu es mon enfant. Même si bien entendu cette désignation te ferait rire, ou sourire, dans sa tendresse.
Il n’y a pas si longtemps, tu avais quinze ans.
Il n’y a pas si longtemps, je taisais mon histoire. A cet âge-là, je naviguais dans un monde d’adultes.
Il n’y avait pas de limites à enfreindre, pas de murs à abattre, juste l’écho d’une solitude, l’absence de structure. L’un d’eux décidait pour moi.
Lui, Il, n’était pas mes parents. Depuis toutes ces années, la peur des mots, pas jolis, pas doux, pas métaphoreux, me fait contourner la réalité. Depuis toute petite, le désir d’un ailleurs m’a poussé à lire, écrire, être une autre. Cette autre n’est plus. Elle s’est éteinte en moi.
Je ne peux plus incarner sa « couverture », sa carapace ondulante. J’ai longtemps ancré ma souffrance dans l’histoire d’un départ, un abandon, celui de ma mère.
Même si cet accident de parcours fut déterminant, j’identifie aujourd’hui la place que cette douleur occupe, comme l’arbre qui cache la forêt. Vois-tu, la forêt, c’est bien d’elle dont il s’agit.
Elle qui dictera le silence, les secrets, les trous noirs qui parcourent ma vie.
C’est une forêt masculine. De conte de fées aux mains qui gouttent. Une forêt de Maldoror. Quand j’étais petite je répétais,
Vivre sa vie ça veut rien dire.
Ça parle de quoi.
Sa vie.
Ça commence quand ? Quelle que soit la cruelle absurdité de ce vécu que je vais exposer au monde, quelles que soient les conséquences, le sordide du réel, la vérité qui éclate au grand jour, comme on dit – quels que soient ces éléments-là et leur retentissement.
Ce que je sais – depuis toujours – c’est mon amour pour vous.
Noé et toi.
Cet amour-là me lance un défi.
Et j’ai décidé d’être à la hauteur.
Il y a bientôt quatre ans, mon amie Caroline m’a envoyé un livre, à Los Angeles.
Tu te souviens de Caroline, mon amie d’enfance. Nous avons passé des vacances avec elle à Porquerolles. Tu vendais des bijoux sur la place du village.
Ce livre s’appelle Le Consentement. Son enveloppe est froissée, sa tête à l’envers dans notre boîte aux lettres en fer verte. Le Consentement.
C’est drôle.
Le Consentement.
C’est un mot que je ne connais pas.
Ça veut dire quoi ? Je décide de le lire.
Page après page. Je me noie.
Une armure embrumée m’engloutit tout entière.
Je sombre.
Le referme. Des mois ont passé.
Le Consentement est dorénavant dans la bibliothèque, domestiqué. Sage.
Je passe devant, le regarde, c’est assez. C’est curieux, comme un cri peut s’amadouer, le cri de Vanessa, couché sur les pages. Contenu, poli, élégant, coincé entre The Story of the Jews et Regarding the Pain of Others, dans notre maison aux Amériques.
Comme une chemise bien repassée, une petite fille qui se tiendrait bien à table. Le Consentement. Depuis quelques années, il m’arrive de vous parler de mon enfance, la plupart du temps en tournant les choses en dérision, comme un clown, une acrobate.
Rien n’est grave rien ne marque rien ne bat. On rit ensemble, vous vous moquez.
Tout sourit quand on est tous les trois. Tout est plus drôle que la drôlerie, plus léger. Vous êtes la preuve vivante que j’ai survécu, vous êtes la preuve que c’est du passé, que c’est inscrit dans un livre fermé. Il s’intitulerait
Ça fait pas mal. A l’époque, je vous raconte à demi-mot l’histoire du Consentement, j’effleure le récit. Le peu que j’en ai lu. Je tais ma tachycardie, mon envie de vomir, la température qui baisse.
Après tout, notre caverne n’a pas besoin de ça, masser la vérité, fouiller dans les archives de mon cœur.
Notre maison remplie d’animaux adoptés, résonante de vous. Elle s’en fout de mon enfance et de l’homme à la fossette. Rien à foutre. Ça fait pas mal. Tu me demandes souvent pourquoi je refuse de te montrer mes films. Tu as raison. C’est une question qui devrait amener une réponse, une question que j’esquive maladroitement, balaie dans un petit rire.
Parce qu’on vit notre vie ? Parce que je suis une autre ? Parce que je suis nue dedans ? Et tes livres, me demande Noé, tu ne lis plus jamais.
Dire tout ça à Noé, cette histoire-là.
C’est encore plus dur, semble-t-il. Je ne lis plus jamais. Oui.
Mais je pense souvent à la possibilité de la violence.
Comme une lecture de mes propres pensées.
Celles que je tais.
A ces gestes souverains. S’il devait t’arriver quelque chose. Tuer un homme qui ferait de toi sa maîtresse, à quatorze ans. Tuer un homme qui abuserait ton frère. Le Consentement. Ce silence sur le passé, ce Minotaure écrasant.
Je croyais l’avoir amadoué.
Refouler. Refouler, dit-elle.
Un été, puis un autre ont passé.
Je vous ai vus grandir.
J’ai écrit une série pour Arte.
Nous voici de retour dans la ville de mon enfance. La ville où vous êtes nés.
C’est ici, au moment où cet objet cinématographique qui m’appartient voit le jour, que la vie décide de me jouer un tour.
Vois-tu, ici rien n’a changé.
Pire encore. Le système qui s’appropria mon enfance se complaît dans son narcissisme pervers.
Et, comme si ma fuite me faisait un pied de nez, comme si la série que j’aime tant, Icon of French Cinema, avait pris la forme d’une amie, l’amie de la fille de 14 ans,
tout doucement, comme une fée réparatrice, cette amie me prend ma main. Nous avons le droit d’être sentimentales toi et moi, me dit-elle.
Pour rattraper le temps perdu.
Nous pouvons pleurer autant qu’on veut.
Et raconter ce qui ne se dit pas, aussi. Me confie-t-elle.
Ouvrir les portes, donner des coups de pied au destin, nous sommes fortes et voulons que les choses changent, non ? Le Consentement. Je la regarde du haut de mes quatorze ans, elle sourit.
Et, comme si de rien n’était, je comprends.
Je comprends qu’il est temps de raconter mon histoire.
Pour vous, pour toutes celles et ceux qui vivent encore dans un silence imposé. Dans la peur.
Il est temps.
Il faut que vous sachiez.
Il faudra se cacher les yeux, par moments.
J’espère que vous me pardonnerez. Je sais, il se fait tard, mais
je viens de comprendre.
Ce truc – le consentement – je ne l’ai jamais donné.
Non.
Jamais au grand jamais.
Alors, il est temps.
Le désespoir de ma faiblesse passée, le désespoir de mon enfance volée, a trouvé sa voix, C’est l’histoire d’une fille de quatorze ans à Paris dans les années 90. Judith Le Monde Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 13, 2024 5:24 AM
|
Par Caroline Besse dans Télérama - 16 janvier 2024 Leur point commun ? Ils sont mis en cause pour violences sexuelles. Plus d’un an après la publication de son livre choc sur Patrick Poivre d’Arvor, la journaliste poursuit son combat en réagissant aux accusations contre Philippe Caubère et Benoît Jacquot. Lire l'article sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/debats-reportages/caubere-depardieu-jacquot-ppda-la-lutte-sans-relache-d-helene-devynck-contre-l-impunite-7018891.php Elle refuse d’être assimilée à une « lanceuse d’alerte » et préfère le terme de « contre-pouvoir ». Pourtant, la journaliste, autrice et scénariste Hélène Devynck relaie sans relâche sur son compte X les réactions, prises de parole, articles d’analyse, entretiens et rebonds liés notamment aux affaires Gérard Depardieu, Patrick Poivre d’Arvor, ou plus récemment Benoît Jacquot. Le 6 janvier, elle diffuse l’extrait d’un documentaire réalisé en 2011 par Gérard Miller dans lequel le psychanalyste recueille avec une complaisance gênante la parole du cinéaste au sujet de sa relation avec la comédienne Judith Godrèche, âgée de 14 ans alors qu’il en avait 40. Cette vidéo fait l’effet d’une bombe. Quelques jours après, Hélène Devynck en publie une nouvelle dans laquelle, cette fois, l’acteur et metteur en scène Philippe Caubère parle de l’accès facile à la pornographie aujourd’hui alors que lui devait se contenter des publicités du Elle ou… des photos d’Auschwitz lorsqu’il était adolescent. Sidération. Nous avons demandé à Hélène Devynck de nous expliquer sa démarche et son combat, un an après la publication de son livre Impunité, où elle dissèque la toute-puissance des auteurs de violences sexistes et sexuelles et du système de protection dont ils bénéficient. À lire aussi : “Impunité”, le livre coup de poing d’Hélène Devynck sur l’affaire Patrick Poivre d’Arvor Pourquoi exhumer et publier ces vidéos aujourd’hui ?
Je ne me rends pas bien compte de leur impact. Pour moi, elles sont d’abord adressées aux victimes. C’est quelque chose de l’ordre de la sororité. Je sais par quoi ces femmes passent, j’ai une expérience, je les aide, même si je ne les connais pas. Quand j’ai travaillé sur mon livre, j’ai découvert la vidéo hallucinante de Philippe Caubère. Elle était facile à trouver : je l’avais dénichée sur son site personnel. Solveig Halloin, son accusatrice, a été condamnée pour diffamation. J’ai décidé de republier cette vidéo quand une enquête préliminaire contre le comédien et metteur en scène a été ouverte pour « atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité », début janvier. J’ai moi-même été aidée lorsque j’ai pris la parole. Un cercle de femmes victimes elles aussi de violences sexistes et sexuelles m’a entourée, et cela m’a fait énormément de bien. Lire la critique Gérard Depardieu dans le viseur de “Complément d’enquête” : des images inédites et choquantes Que pouvez-vous nous dire aujourd’hui de l’impunité dont vous parlez dans votre livre ?
Je la connais très bien, pour l’avoir vécue et étudiée. J’ai fini par comprendre comment elle se construit. Je suis dans une sorte de contre-pouvoir. L’impunité des agresseurs fait partie des privilèges des hommes disposant d’un capital social et culturel énorme. Dans le documentaire de Gérard Miller, c’est ce système que Benoît Jacquot décrit. Il explique que « c’est contre la loi mais les hommes [l]’envient de faire ça ». Autant d’éléments dont la justice devrait se saisir et aurait dû se servir en 2011, quand le film a été diffusé. Si un auteur de cambriolage révélait ses méfaits ainsi, il serait immédiatement arrêté ! Quand Macron a défendu Depardieu de façon si excessive, j’ai eu l’impression d’être dans Un jour sans fin, d’être Bill Murray qui revit en permanence « le jour de la marmotte ». Nous [les nombreuses femmes s’étant déclarées publiquement victimes de violences sexuelles et de viols commis par Patrick Poivre d’Arvor, ndlr] avons eu notre lot d’amis puissants du violeur, de vieilles stars, d’ex-compagnes, de plateaux de Cyril Hanouna, pour dire que c’était un homme admirable, charmant, qu’il aimait trop les femmes… Déjà, au moment des révélations sur Nicolas Hulot, Emmanuel Macron avait parlé de risque de « société de l’Inquisition ». Pour mon livre, j’ai enquêté sur les accusations de viol contre des hommes célèbres, et là encore j’ai découvert combien la réaction médiatique et institutionnelle était une éternelle répétition. Quand Marie-Christine Vo a porté plainte contre Johnny Hallyday, au début des années 2000, Bernadette Chirac a déclaré : « Les Français n’aiment pas que l’on touche à Johnny Hallyday, c’est une très mauvaise opération de s’attaquer à lui. » Elle garantissait son impunité. Aujourd’hui, Macron a pris le rôle de Bernadette Chirac. Ces hommes-là ne se cachent pas vraiment… Nous, quand on parle, on devient éternellement victimes. Avez-vous le sentiment qu’une vraie prise de conscience sur les violences sexistes et sexuelles est en train de se produire en France ?
C’est compliqué. Est-ce que ça avance ? Est-ce qu’il y a un backlash ? Je pense que ça avance, et que ça recule en même temps. Emmanuel Macron a politisé l’histoire en défendant Depardieu, et en virant sa ministre qui avait pris la position inverse [l’ancienne ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, évincée du gouvernement au profit de Rachida Dati, avait qualifié les propos de Gérard Depardieu dévoilés dans le Complément d’enquête du 6 décembre de « violence terrible, contraire à la dignité même de l’être humain et des femmes, des enfants », ndlr.] Il rejoint la position des partisans de Donald Trump qui croient que les hommes puissants sont attaqués uniquement parce qu’ils sont privilégiés. C’est la thèse de la tribune de soutien à Depardieu [publiée dans Le Figaro le 26 décembre, ndlr]. En le glorifiant de cette façon, et en nous liant, nous toutes qui dénonçons, il parle comme si l’impunité était un privilège accordé aux hommes au sommet de la pyramide sociale, comme dans l’Ancien Régime. Il faut combien de dizaines de femmes pour qu’on nous croie ? Ces hommes-là ne se cachent pas vraiment… Nous, quand on parle, on devient éternellement victimes. Quand on parle de moi dans certains articles, on me cite comme « victime de PPDA », comme si je n’avais pas écrit de livre. Je me retrouve réduite à ce statut de victime, réduite à un viol, comme si je ne pouvais pas penser, ni créer. C’est violent. Judith Godrèche est une artiste avant d’être une victime. Sa série Icon of French Cinema dit non seulement ce qui lui est arrivé mais aussi comment elle a vécu avec ça. Elle ne se plaint pas. C’est gonflé et intelligent. On ne peut pas prouver les viols, mais on peut prouver l’impunité. L’impunité est visible, elle laisse des traces. Croyez-vous à une évolution positive, notamment dans le cinéma français ?
Benoît Jacquot n’a jamais changé d’agente. C’est la même que quand Judith Godrèche avait 14 ans. Il vient de tourner un film avec Charlotte Gainsbourg et Guillaume Canet. C’est ça, l’impunité ! De ce que j’ai vu à TF1, rien n’a changé. Depuis l’affaire PPDA, ils n’ont rien fait. Ils ont fait comme si nous n’existions pas. TF1 a une responsabilité comme personne morale dans cette histoire, or il n’y a eu aucune conséquence. La justice doit se saisir mieux de ces affaires. Et le contrôle social doit changer. Aujourd’hui, il ne s’exerce pas contre les prédateurs, mais contre les victimes. Quand on parle, on ne veut pas être cantonnées à ce rôle. On est diminuées, rabougries, mises dans une petite case. Quand, en 2011, Benoît Jacquot dit « je suis un criminel », Gérard Miller ne réagit pas. Dans son documentaire, il mélange pédocriminalité et adultère bourgeois. On est dans quelque chose d’idéologique, et il est très difficile d’attaquer les complicités. Nous [les femmes qui accusons PPDA, ndlr], nous n’avons pas réussi. Peut-on parler de nouvelle ère ?
Je l’espère, je le souhaite, mais il faudrait des condamnations. #Metoo, c’est un mille-feuille. Il faut toujours en remettre une couche. On ne peut pas prouver les viols, mais on peut prouver l’impunité. L’impunité est visible, elle laisse des traces. Les agresseurs s’en font des manteaux. Ils paradent. L’impunité s’exhibe comme un signe de virilité. Comme dans la vidéo de Caubère. Cette histoire d’Auschwitz, il la raconte depuis longtemps. Écorner l’impunité de Jacquot, c’est compliqué, car Paris est tout petit. Le milieu de ce cinéma d’auteur est minuscule, très masculin. L’artiste à succès vieillissant au bras d’une femme de l’âge de sa fille est un modèle valorisé. Moi, d’une certaine façon, j’ai déjà payé ma prise de parole. Ça fait longtemps que des gens qui ne sont pas d’accord m’ont tourné le dos. Ça a changé la physionomie de plusieurs de mes relations personnelles. Il y a eu pas mal de casse autour de moi. À lire aussi : “Backlash”, quand le patriarcat contre-attaque Comment imaginez-vous la suite dans l’affaire Depardieu ?
Le dossier me semble hyper solide, et je ne vois pas comment la justice peut ne pas organiser un procès. Un procès, ça permet à la présomption d’innocence de s’exprimer, au tribunal de ne pas être médiatique. Dans l’affaire PPDA, une cinquantaine de femmes ont témoigné devant la police. J’ai demandé à un copain astrophysicien d’y réfléchir. Considérons qu’entre 2 et 8 % des femmes qui témoignent mentent, alors que PPDA assure que nous sommes toutes des menteuses : la probabilité pour qu’il soit innocent et que nous mentions toutes équivaut à gagner six fois de suite les bons numéros du loto. Il y a une espèce de mythe social autour des témoignages mensongers. On a l’impression que ça ne suffit jamais. Il n’y a pas encore de procès prévu contre PPDA. Là, il est mis en examen pour viol dans l’affaire Florence Porcel, elle-même est toujours attaquée pour dénonciation calomnieuse, comme seize d’entre nous. Légende photo : La journaliste Hélène Devynck. Photo Sébastien Calvet/Mediapart

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 7:15 PM
|
Par Valérie Hurier, directrice de la rédaction de Télérama, le 9 février 2024 ÉDITO — Notre enquête sur la mécanique d’emprise de certains cinéastes français à l’égard de jeunes actrices le montre, les médias ont leur part de responsabilité. L’époque a changé, nous aussi. Lire l'article sur le site de Télérama : https://www.telerama.fr/cinema/affaire-jacquot-un-systeme-dont-les-medias-ont-parfois-ete-complices-par-leurs-eloges-telerama-compris-7019213.php Six ans après #MeToo, le mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur. Des actrices, chaque jour plus nombreuses, prennent la parole pour dévoiler violences et abus dans le monde du cinéma. Judith Godrèche, d’abord dans sa série Icon of French Cinema, puis publiquement, dénonce la relation sous emprise avec un cinéaste de renom, Benoît Jacquot, alors qu’elle était mineure. Un réalisateur dont nous avons célébré le talent, comme nous avons admiré celui de Gérard Depardieu ou d’autres artistes aujourd’hui mis en cause pour leurs comportements prédateurs. Nous ignorions la nature et la gravité de ces faits supposés mais qu’avions-nous sous les yeux que nous n’avons pas su voir, que nous étions alors incapables de voir ? C’est tout un système, celui de la production cinématographique, qu’il convient aujourd’hui de réexaminer à la lumière de ces témoignages. Un système dont les médias, Télérama compris, se sont parfois faits les complices par leurs éloges. Au nom de l’art et de la toute-puissante liberté des créateurs, des jeunes femmes ont été contraintes de subir l’inacceptable. L’époque a changé, nous aussi. Notre regard sur les œuvres n’est plus dissocié des conditions de leur production. La fabrique du rêve ne doit plus être une machine à broyer. Valérie Hurier, directrice de la rédaction de Télérama ---------------------------------------------------------------------------- Jacquot, Doillon… Cinéastes tout-puissants et actrices sous emprise : enquête sur un système de prédation Par Mathilde Blottière, Hélène Marzolf dans Télérama - 8 février 2024 Judith Godrèche, l’ex-« muse silencieuse », comme elle se définit elle-même, a fini par appeler les choses par leur nom. D’abord en transformant son passé d’actrice adolescente sous l’emprise d’un cinéaste quadragénaire en matière à série (Icon of French Cinema, en ligne sur arte.tv), puis en désignant Benoît Jacquot, 77 ans, comme ledit cinéaste. Elle a franchi une nouvelle étape début février en déposant plainte pour « viols avec violences sur mineur de moins de 15 ans » – le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. L’égérie et l’artiste ont vécu six ans ensemble, tourné deux films : Les Mendiants (1988) et La Désenchantée (1990). Selon la comédienne, aujourd’hui âgée de 51 ans, leur relation a débuté alors qu’elle en avait 14 et lui, 39. Contacté, le réalisateur nie toute emprise, « toute violence physique ou psychologique » et évoque « une histoire d’amour consentie ». « J’ai grandi dans une société complice où l’art était un passe-droit absolu », dénonçait Judith Godrèche dans Le Figaro en décembre. Quelques semaines auparavant, elle lâchait : « On peut faire des films sublimes sans aller jusqu’à coucher avec une actrice mineure. » Une phrase qui semble incontestable, et pourtant… En 1985, quand, à 13 ans, elle tourne son premier film, une telle affirmation ne va pas de soi. Deux ans plus tard, la comédienne est La fille de quinze ans pour le réalisateur Jacques Doillon, contre qui elle a aussi décidé de porter plainte pour viol — l’enquête préliminaire le vise également (le réalisateur a depuis publié une déclaration dans laquelle il dénonce des « mensonges » et dit se tenir à la disposition de la justice). Le mythe du metteur en scène pygmalion est alors un modèle particulièrement en vogue dans le cinéma français. Au détriment de jeunes actrices, parfois mineures, d’autant plus inspirantes qu’elles sont soumises au génie du créateur et à ses assauts. Lire notre édito Affaire Jacquot : un système dont les médias ont parfois été complices par leurs éloges, “Télérama” compris Plus de six ans après #MeToo et dans la foulée d’autres voix décisives (comme Anouk Grinberg ou Sophie Marceau), le témoignage de Judith Godrèche fait vaciller le cinéma. D’autres actrices ont trouvé la force de témoigner de ce que Benoît Jacquot leur aurait fait subir et, plus largement, d’un véritable système de prédation. Au journal Le Monde, la comédienne Isild le Besco, dont la première collaboration avec Jacquot remonte au film Sade (elle avait alors 16 ans), a affirmé n’être pas « prête à évoquer cette histoire dans la presse » mais a esquissé un premier pas, en écrivant une lettre : « Comme toutes ces comédiennes qui parlent aujourd’hui, j’ai mis du temps à comprendre où mes limites avaient été franchies, comment, par qui. […] Comme elles, mon image, mon corps ont nourri des fantasmes alors que, tout juste adolescente, je n’avais même pas conscience d’être sexualisée. » Elle a depuis, dans un autre article du Monde, accusé Jacques Doillon de l’avoir retirée d’un projet de film après son refus de coucher avec lui. La prise de conscience est à la mesure de l’aveuglement général : à l’écran, de La Petite Voleuse (Claude Miller) à Noce blanche (Jean-Claude Brisseau), les lolitas ont façonné nos imaginaires. En coulisses, le septième art a aussi servi de décor, voire de prétexte, à des abus. Au nom de l’art, les femmes ont été vampirisées, abusées, manipulées. Comment ce système a-t-il pu prospérer au vu et au su de tous ? Dès les années 1970, dans leur essai filmé Sois belle et tais-toi, les Insoumuses – du nom de ce collectif formé par l’actrice Delphine Seyrig avec la vidéaste Carole Roussopoulos, notamment – cherchaient déjà à dégommer cette figure éthérée de l’égérie, pur objet d’emprise patriarcale. Snobée par de gros producteurs, la féministe Seyrig en a payé le prix. « On a été élevées dans l’idée qu’on ne pouvait exister que dans le regard masculin », regrette aujourd’hui Clotilde Hesme (Les Chansons d’amour, HPI, Lupin). De son côté, Tatiana Vialle, ancienne actrice devenue directrice de casting, constate encore les ravages du mythe de Pygmalion : « Il a poussé beaucoup de réalisateurs à s’enivrer de ce pouvoir spécial qui consiste à fabriquer des stars. À chercher de la chair fraîche pour y imprimer leur marque. » Au risque de transformer leurs « révélations » en objets. Étiquetée « sex-symbol » de la décennie 1980, Mathilda May en sait quelque chose. Premier prix de danse classique du Conservatoire de Paris, elle est repérée, à peine majeure, par une agente qui l’envoie passer des essais après l’avoir convaincue « à l’usure », estime aujourd’hui l’actrice. « Elle avait décidé que j’étais faite pour le cinéma. Ni elle, ni mes proches ne m’ont demandé ce que je voulais. La question de mon désir ne s’est pas posée non plus lorsqu’un producteur de cinéma a proposé en ma présence à mes parents de changer mon nom, Haïm, pour May. » La comédienne Laurence Cordier (À tout de suite, Gamines) a compris à ses dépens qu’« inspirer » un réalisateur comme Philippe Garrel, aujourd’hui mis en cause par des actrices pour baisers non consentis et propositions sexuelles dans le cadre professionnel, avait un prix. Lorsqu’elle le rencontre, à l’orée des années 2000, la jeune femme raconte que, sous couvert de lui parler d’un rôle, il essaie de l’embrasser et lui propose un tour à l’hôtel. « J’ai refusé, il ne m’a jamais rappelée. J’ai eu honte en pensant aux films que je m’étais faits dans ma tête. Cet épisode reste une blessure dans mon parcours de comédienne. » Philippe Garrel n’a pas répondu à nos sollicitations. S’insurger contre ces comportements de prédateurs, c’était prendre le risque de passer pour prude et ennuyeuse. Dans le cinéma, l’excès était une valeur en soi. Tatiana Vialle, ancienne actrice devenue directrice de casting Laurence Cordier croise aussi la route de Benoît Jacquot, qui la dirige dans À tout de suite (2004). Il veut tout savoir de sa vie privée. « Ses questions intrusives me mettaient mal à l’aise. On aurait dit un vampire. » Quelques années plus tard, elle le revoit alors qu’il prépare Les Faux-Monnayeurs. Déclaration d’amour : « À l’entendre, j’étais la nouvelle égérie du cinéma français. Il m’explique avoir besoin d’être amoureux de ses actrices sur un plateau comme dans la vie, qu’il sait mieux que moi ce que je désire. » Elle raconte que le réalisateur insiste alors pour qu’elle vienne chez lui à toute heure du jour ou de la nuit. Qu’importe son refus, il la force à prendre la clé de son appartement : « Pour moi, c’était la clé de Barbe Bleue. » Laurence Cordier ne s’en servira jamais. « À la fin de notre dernier tournage ensemble, il m’a dit : “Tu ne veux pas tourner, tu te sabotes”. » Contacté, Benoît Jacquot nie lui avoir tenu de tels propos et ne voit dans cet épisode qu’une « opération de séduction malheureuse ». Désir de coucher une actrice sur pellicule, désir de la coucher dans son lit… Cet amalgame, Claire Devers le qualifie de « droit de cuissage ». Véhémente sur la phallocratie du cinéma français, la réalisatrice de Noir et blanc (Caméra d’or 1986) considère ce milieu comme « totalement sadien. Dans cette sphère-là, dès qu’il y a pouvoir, il y a volonté de possession ». Laquelle peut prendre des formes plus ou moins perverses. Ainsi, l’actrice Clotilde Hesme affirme que, sur le tournage des Amants réguliers (2005), Philippe Garrel l’avait affublée d’un curieux surnom : « l’Inceste ». « Sous prétexte que cela nous aiderait à mieux incarner nos personnages, il m’avait glissé à l’oreille : “Fais en sorte que mon fils tombe amoureux de toi [Louis Garrel était le partenaire de l’actrice dans le film, ndlr], je le récupérerai à la fin”. » Malheur aux rebelles qui n’acceptent pas le système… Encore adolescente devant la caméra de Jean-Luc Godard (Détective) ou de Leos Carax (Mauvais Sang), Julie Delpy, elle, a fini par s’exiler. « Je détestais ma condition de jeune fille actrice, ce rôle de muse, de nymphe », racontait-elle en 2021 à Télérama. Et d’évoquer les missives enflammées reçues de la part de réalisateurs beaucoup plus âgés… « Des journalistes m’ont traitée de moralisatrice parce que j’avais osé dire que c’était dégueulasse que des mecs de 50 ans se tapent des gamines de 14. » A lire aussi : À 23 ans, Judith Godrèche avait déjà tout dit, lui restait à le crier dans la vraie vie C’est un autre effet de ce #MeToo tardif du cinéma français : nous ouvrir les yeux sur l’obligeance avec laquelle les médias, dont Télérama, ont trop longtemps célébré des artistes aux comportements douteux ou maltraitants. « La glorification des metteurs en scène les plus “problématiques” était dure à accepter quand on connaissait l’envers du décor, se souvient une actrice révélée par le cinéma d’auteur des années 1980. Il y avait une grande violence psychique exercée par des réalisateurs comme Jacquot, Doillon, Pialat, Zulawski… Celles qui ont parlé à l’époque – Sophie Marceau, Isabelle Adjani – n’ont pas été entendues. » Double héritage perverti de la Nouvelle Vague et de Mai 68 Derrière la caméra, l’autocritique commence à peine. « Je suis complètement revenu de cette mythologie de la muse », déclarait Leos Carax lors d’une récente master class au festival de la Villa Médicis. Dans Mauvais Sang (1986) et Les Amants du Pont-Neuf (1991), il avait dirigé sa compagne de l’époque, Juliette Binoche. « La construction marche dans les deux sens. Et Juliette m’a peut-être plus formé que je ne l’ai formée. » Pour d’autres, la remise en question est plus douloureuse. Selon Marc Missonnier, producteur du Consentement de Vanessa Filho, adaptation du livre de Vanessa Springora sur l’emprise de Gabriel Matzneff, « l’introspection est d’autant plus difficile au sein du cinéma d’auteur que celui-ci s’est longtemps prévalu d’être avant-gardiste artistiquement et progressiste politiquement ». En France, le statut hors norme de l’artiste est issu d’un double héritage perverti : celui de la Nouvelle Vague et de Mai 68. Pour Tatiana Vialle, les relations de réalisateurs avec de très jeunes filles passaient pour une transgression de l’ordre moral et bourgeois. « S’insurger contre ces comportements de prédateurs, c’était prendre le risque de passer pour prude et ennuyeuse. Dans le cinéma, l’excès était une valeur en soi. » Au pays de la politique des auteurs, des réalisateurs ont pu dominer sans entraves. La critique et réalisatrice Axelle Ropert remonte encore plus loin en pointant la violence d’un Henri-Georges Clouzot. « Sur le tournage de La Vérité, il se vantait de diriger Brigitte Bardot à coups de gifles ! » Et de citer aussi la figure ombrageuse de Maurice Pialat : « Dans les années 90, toute ma génération le portait aux nues, avec cette idée que la tyrannie était un mode légitime d’expression artistique. » Caroline Champetier, la directrice de la photographie la plus célèbre du cinéma d’auteur (Godard, Doillon, Jacquot, Garrel, Akerman, Fontaine…), distingue, elle, les « jeunes Turcs » de leurs successeurs. « Godard, Truffaut et consorts ont révolutionné la façon de faire des films. Ceux qui sont arrivés juste après n’ont eu qu’à régner. Mais c’est en train de se retourner contre eux. » Présente sur le tournage de La Reine Margot (1994), une actrice qui souhaite rester anonyme se souvient de la manière dont Patrice Chéreau érotisait le rapport de domination. « Le soir, il était comme un animal séducteur entouré de sa cour de jeunes acteurs. Certains en sont ressortis terriblement abîmés. » Face aux réalisateurs démiurges, aucun contre-pouvoir, ou si peu. « Entre comédiennes, on ne se disait rien. Nous étions mises en compétition, parler serait passé pour de la faiblesse ! » explique Élizabeth Bourgine, actrice phare des années 80 (La 7ᵉ Cible, Cours privé). Une absence de sororité qui questionne aussi la place des autres femmes sur les plateaux. Ainsi Caroline Champetier revisite-t-elle aujourd’hui ses dix films avec Benoît Jacquot : « Sur le tournage de La Désenchantée, je ne pouvais jamais m’adresser directement à Judith Godrèche, qui était à la fois l’actrice principale et la compagne de Benoît. Tout devait passer par lui ! » Aujourd’hui, elle s’estime à la fois complice et victime. « J’ai accepté de sa part une forme d’humiliation, de violence. Pour m’en sortir, je me suis retrouvée scindée, séparée des autres femmes. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir su protéger les plus fragiles, dont Judith. » Tatiana Vialle, elle aussi, s’est sentie démunie en travaillant avec un autre réalisateur au comportement problématique : « Pendant les castings, lui seul pouvait parler aux actrices, il avait des gestes déplacés avec elles. J’étais un témoin impuissant. » Le mythe muse-pygmalion ne sert qu’à masquer la perception très XIXᵉ siècle de l’actrice comme courtisane ! Clotilde Hesme Cette relation vampirique aux actrices se façonne au sein d’un système de domination plus vaste. « C’est avec des producteurs, et plus largement les financiers, que j’ai vécu les situations les plus malsaines !, témoigne Élizabeth Bourgine. Ils me faisaient miroiter de beaux rôles, mais insistaient toujours pour qu’on approfondisse le sujet, de préférence le soir, en privé. » Parce qu’elle a résisté aux avances, des films lui sont passés sous le nez, dit-elle. Elle aurait même écopé au passage d’une réputation particulière : « Des années après, j’ai appris qu’on m’avait appelée “l’Intouchable”. » Si des alliances officielles, et fructueuses, ont pu se nouer entre actrices et producteurs – Isabelle Huppert et Daniel Toscan du Plantier dans les années 1980 –, beaucoup de comédiennes estiment avoir été victimes de représentations d’un autre temps. « Le mythe muse-pygmalion ne sert qu’à masquer la perception très XIXᵉ siècle de l’actrice comme courtisane ! » déplore ainsi Clotilde Hesme. Elle-même a découvert avoir participé à un faux casting, organisé par un producteur star. « Il a convoqué toutes les actrices de Paris pour faire des essais à moitié à poil, alors que le rôle était déjà attribué. Le but ? Enrichir en chair fraîche son catalogue de contacts, et harceler les filles derrière. » La sœur de Clotilde, Annelise Hesme, a raconté sur Instagram qu’un producteur lui avait proposé de « faire [s] on métier sans caméra », en louant sa compagnie à des acteurs, réalisateurs, producteurs… Quant aux agents, certains fermaient parfois les yeux. Élizabeth Bourgine en témoigne : « Quand je racontais ce que j’avais vécu, je voyais bien qu’ils ne voulaient pas entendre. Ils me répondaient : “Tu es une grande fille quand même, tu peux te défendre !” » À lire aussi : Caubère, Depardieu, Jacquot, PPDA : la lutte sans relâche d’Hélène Devynck contre “l’impunité” C’est en créant sa série pour Arte que Judith Godrèche, à l’instar de Vanessa Springora avec son livre, a pu sortir de son statut de victime et se réapproprier son histoire. « Tout a changé le jour où je suis devenue autrice et metteuse en scène, explique de son côté Mathilda May. Aujourd’hui, c’est moi qui choisis les interprètes, et je peux établir entre nous des rapports plus égalitaires. Je suis passée d’objet à sujet. » Même sentiment pour Laurence Cordier qui, en passant à la mise en scène, a eu le sentiment de « [s]’affranchir des regards malsains ». Le #MeToo du cinéma a beau n’en être qu’à ses débuts, les choses évoluent « notamment grâce à l’arrivée de plus de réalisatrices, note Axelle Ropert. Elles ne sont pas toutes vertueuses, mais elles contribuent à façonner d’autres récits et à modifier les rapports de pouvoir ». De la même manière, des collectifs comme 50 / 50 ou l’ADA (association des acteur.ices) participent d’une libération de la parole et d’une réflexion sur l’encadrement des plateaux. Pour la première fois, l’UPC (Union des producteurs de cinéma) a publiquement soutenu les actrices qui avaient accusé Philippe Garrel. Surtout, les nouvelles générations commencent à porter un autre regard sur le métier et ses diktats. « On est nombreux et nombreuses à vouloir repenser la toute puissance d’un.e cinéaste sur un plateau, explique l’actrice de 33 ans Alice de Lencquesaing (Le Père de mes enfants, L’Enlèvement), membre de l’ADA. Dans une industrie où sortent plusieurs centaines de films par an, on commence à envisager le travail de manière plus collégiale, et les responsabilités sont mieux réparties. J’ai aussi l’impression que les réalisateurs de ma génération voient plus clairement la différence entre façonner un personnage et posséder un.e interprète. » Rien à voir avec un retour à l’ordre moral. Régulièrement accusées de vouloir aseptiser le cinéma, les actrices qui osent dénoncer les abus revendiquent au contraire leur audace. À l’instar de Clotilde Hesme : « On est prêtes à faire les films les plus subversifs et amoraux, mais dans le respect de notre intégrité physique et psychique sur le plateau. En un mot, avec notre consentement. » Mathilde Blottière / Hélène Marzolf - Télérama 8/02/24 Cet article fait partie d’une enquête qui sera publiée dans notre magazine du 14 février.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 4:01 PM
|
Par Lola Uguen dans Elle, avec AFP - 9 février 2024 Le comédien Philippe Caubère, interprète de Molière ou de Dom Juan au théâtre, a été mis en examen jeudi 8 février pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur de plus de 15 ans. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Le comédien et metteur en scène Philippe Caubère a été mis en examen jeudi 8 février pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur, a indiqué le parquet de Créteil, confirmant une information du « Parisien ». Les faits présumés concernent trois mineures. Philippe Caubère était visé par une enquête préliminaire pour « atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité » depuis début janvier. Cette enquête faisait suite à la plainte d’une jeune comédienne contre le metteur en scène, l’accusant d' « atteintes sexuelles » en 2012 alors qu’elle avait 16 ans et lui 61 ans. Le comédien avait été placé en garde à vue mardi 6 février et auditionné par les enquêteurs de la sûreté territoriale du Val-de-Marne, a précisé le parquet, qui a requalifié les faits en viols et agressions sexuelles. DES FAITS ALLANT DE 2010 À 2021 Philippe Caubère est mis en examen pour des faits présumés qui se sont déroulés en 2012 pour une première victime, et entre 2010 et 2019 pour une deuxième, a détaillé le ministère public auprès de l’AFP. Il est aussi mis en examen pour corruption de mineur de plus de 15 ans sur une troisième victime, des faits qui se sont déroulés entre 2019 et 2021, selon cette même source. Philippe Caubère avait reconnu en janvier dans un communiqué transmis à l’AFP avoir eu une relation intime pendant quatre mois en 2012 avec une mineure âgée de 16 ans, une relation selon lui consentie. Figure de la scène théâtrale, l’acteur avait déjà fait l’objet d’une plainte pour viol, classée sans suite en 2019. Son accusatrice avait dénoncé en mars 2018 des faits de viols commis huit ans auparavant, en 2010. Le parquet de Créteil avait classé la plainte sans suite, « aucun élément » ne permettant « de corroborer les déclarations de la plaignante sur l’absence de consentement ». Cette dernière avait été condamnée en septembre 2021 pour diffamation. Par Lola Uguen (Elle) avec AFP Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma" Légende photo : Le comédien Philippe Caubère est mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur. - ©IBO/SIPA

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 12, 2024 10:49 AM
|
Par LIBERATION et AFP publié le 9 février 2024 Le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnelle du réalisateur Christophe Ruggia jeudi 8 février pour des agressions sexuelles sur mineure sur l’actrice Adèle Haenel au début des années 2000. Le dossier qui a catalysé #MeToo dans le cinéma français devrait avoir son procès. Ouverte en 2019 suite aux accusations d’attouchements et de harcèlement sexuel contre le réalisateur Christophe Ruggia et après le dépôt de la plainte de l’actrice Adèle Haenel, l’enquête pourrait finalement aboutir. Jeudi 8 février, le parquet de Paris a requis un procès et renvoyé en correctionnelle le réalisateur âgé de 59 ans. La décision finale sur la tenue ou non d’un procès revient désormais à la juge d’instruction. Auprès de Mediapart, Adèle Haenel a réagi : «Lire dans ce réquisitoire que les faits sont suffisamment caractérisés, corroborés par des témoignages et que mes déclarations sont constantes, précises et crues me touche beaucoup. C’est une étape du processus judiciaire mais, à l’évidence, elle est importante.» Les avocats des deux protagonistes, Fanny Colin et Orly Rezlan pour le réalisateur, Yann Le Bras et Anouck Michelin pour la comédienne, n’ont pas souhaité commenter. Selon les sources proches du dossier, deux circonstances aggravantes ont été retenues par le ministère public : la minorité d’Adèle Haenel au moment des faits reprochés (dès ses 12 ans), et la position d’autorité de Christophe Ruggia, qui est le premier réalisateur à l’avoir fait tourner dans le film «Les Diables» (2002). «Attitude déplacée» et témoignages «Il résulte des déclarations circonstanciées, constantes, précises et datées d’Adèle Haenel […] et des éléments recueillis au terme de l’instruction que Christophe Ruggia lui a imposé des agressions sexuelles, nonobstant les dénégations de celui-ci», écrit le parquet dans ses réquisitions datées de mardi 6 février. A l’appui des déclarations d’Adèle Haenel, le parquet évoque des lettres de l’intéressée, cinq «confidents», deux témoins visuels de «l’attitude déplacée» de Christophe Ruggia, ainsi que le témoignage de la mère de la plaignante. Alors âgé de 36 à 39 ans, il l’a reçue tous les samedis après-midi entre septembre 2001 et février 2004. Les réquisitions évoquent un «caractère systématique» des attouchements lors de ces «visites». «Il commençait à me caresser les cuisses en remontant vers mon sexe, comme ça, l’air de rien. Il touchait alors aussi mon sexe, il m’embrassait dans le cou […] et il touchait ma poitrine», a raconté l’intéressée devant les enquêteurs. Le parquet souligne aussi des «épisodes de chantage affectif lors de festivals à Marrakech et Yokohama». Dans une longue enquête et interview de Mediapart, l’actrice avait dénoncé fin 2019 l’«emprise» du réalisateur, peu connu du grand public, pendant la préparation et le tournage du film «Les diables». L’interview-choc d’Adèle Haenel avait alors provoqué un séisme dans le cinéma français, resté jusque-là relativement imperméable au mouvement #MeToo. Après les accusations, Christophe Ruggia s’était décrit comme «sans doute le premier admirateur d’Adèle Haenel» et avait réfuté «les gestes physiques et le comportement de harcèlement sexuel dont elle (l)’accuse». Il avait reconnu avoir «commis l’erreur de jouer les pygmalions […]. Emprise du metteur en scène à l’égard de l’actrice qu’il avait dirigée et avec laquelle il rêvait de tourner à nouveau», avait-il écrit. Refusant dans un premier temps de saisir la justice, Adèle Haenel, récompensée par deux César en 2014 et 2015, avait finalement porté plainte quelques jours après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Paris le 6 novembre 2019. Christophe Ruggia avait été mis en examen le 16 janvier 2020 pour «agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité sur la victime», et placé sous contrôle judiciaire, puis en garde à vue en 2020. En octobre 2021, il avait obtenu l’annulation de son interpellation et de sa garde à vue. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait annulé ces deux points de procédure, estimant que l’interpellation par les forces de l’ordre «n’était pas strictement nécessaire». «Bouleversée» Cette annonce d’un possible procès intervient après que l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche ait dénoncé publiquement mardi 6 février des abus sexuels entre 1986 et 1992 de la part des réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon, qui contestent les accusations. Une enquête a depuis été ouverte. Jointe par Mediapart, Adèle Haenel s’est notamment dite «bouleversée» par le récit de l’actrice. Ces derniers mois, d’autres figures du cinéma, comme Gérard Depardieu ou Nicolas Bedos, ont été mises en cause dans ce #MeToo français. Adèle Haenel a plusieurs fois dénoncé «la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels», y compris lors d’une sortie fracassante contre Roman Polanski lors de la cérémonie 2020 des César. Celle qui s’est produite au théâtre fin 2023 avait acté en mai sa rupture avec le cinéma dans une lettre à Télérama.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 11, 2024 5:04 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération le 8/02/24 La plainte de Judith Godrèche déposée mardi contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour «viol sur mineur» met en lumière l’appétence malsaine des cinéastes des années 80 pour les jeunes filles. Une érotisation qui a broyé de nombreuses actrices. En 1986, l’agente Isabelle de la Patellière (1) s’inquiète : «Tous les jours, je reçois des coups de téléphone de metteurs en scène qui systématiquement me demandent de leur présenter, une très jeune fille, le plus souvent inconnue. Jusqu’ici, leur âge tournait autour de 17, 18 ans, mais depuis le succès de l’Effrontée, nous sommes descendus à 14, 15.» Elle s’exprime dans les colonnes de la revue Cinématographe qui consacre un (petit) dossier adéquatement intitulé «le cinéma misogyne» sur un phénomène alors nouveau : la ruée de cinéastes reconnus vers ce que Benoît Jacquot nommera une poignée d’années plus tard la «chair fraîche» dans certaines de ses interviews – cinéaste sous le coup d’une plainte pour viol sur mineure déposée par l’actrice et réalisatrice Judith Godrèche – et qui ira s’amplifiant dans les années 90. Et la disparition difficile à concevoir et avec peu de contre-exemple des personnages féminins centraux, dès lors que l’actrice dépasse les 22 ans – dans ces années-là, même Catherine Deneuve traverse un creux dans sa carrière. Cette disparition sera durable, visible, souvent énoncée par les comédiennes elles-mêmes, et pourtant, c’est comme si elles parlaient dans le désert. Bien sûr, il y a toujours des noms d’actrices au générique des films. Mais elles sont à côté des acteurs, au mieux, elles servent le thé, jouent les utilités. Les films à succès misent alors sur des couples d’hommes, – Gérard Depardieu-Pierre Richard, Gérard Lanvin-Michel Blanc, Jean Paul Belmondo-Alain Delon, Richard Anconina-Christophe Lambert. Exit Annie Girardot, spécialisée dans les rôles de femmes dynamiques prises dans une tourmente sociétale (Docteur Françoise Gailland) dans les années 70. Miou-Miou, tout aussi populaire, traverse elle aussi un tunnel, alors que lui était échu ce même type de rôle dans une version rajeunie. Dans un autre registre, Romy Schneider qui pourrait symboliser la possibilité d’exister sur les écrans après 40 ans, n’est plus. Certes, il y a Isabelle Adjani. Mais qui, nécessité ou choix, joue de sa rareté en attendant Camille Claudel. Et Isabelle Huppert demeure l’exception qui confirme la règle, avec notamment Une affaire de femmes de Claude Chabrol. Que se passe-t-il donc, dans les années 80, 90, pour que la moitié de l’humanité disparaisse des écrans ? Toujours dans ce dossier pourtant léger, Cinématographe constate «qu’à côté de cette virilisation outrancière a surgi une excroissance monstrueuse : la nubile». Besoin de «chair fraîche» Effectivement, toute une corporation recherche assidûment à reproduire le succès planétaire de la Boum de Claude Pinoteau, qui consacre la préado Sophie Marceau et n’en finit pas d’être une machine à cash en se déclinant en épisodes (la Boum 2, l’Etudiante). Ou encore, le carton Diabolo menthe de Diane Kurys (plus de 3 millions d’entrées en 1977) qui a propulsé la comète Eléonore Klarwein, 13 ans au moment du tournage, laquelle, essorée par la gloire et l’isolement, ne poursuivra pas sa carrière. Mais surtout, le grand écran n’en revient pas d’avoir découvert, coup sur coup, deux actrices adolescentes qui émerveillent le public, la critique, leurs pairs, une trilogie rarissime : Sandrine Bonnaire dans A nos amours de Maurice Pialat en 1983 (elle a tout juste 16 ans quand elle reçoit le césar du meilleur espoir féminin), et Charlotte Gainsbourg, 14 ans, dans l’Effrontée de Claude Miller deux ans plus tard. Dans les deux cas, les cinéastes expliquent qu’il s’agit de saisir un moment de bascule, un corps en transformation, la puberté – «Tu as perdu ta fossette», constate le père face à sa fille jouée par Sandrine Bonnaire dans une séquence mémorable à la toute fin de A nos Amours. Charlotte Gainsbourg, qui obtient un césar pour l’Effrontée, devient le modèle de toutes les adolescentes de sa génération, mais aussi des jeunes actrices qui l’invoquent toutes dans leurs interviews. La chanteuse déjà vedette Vanessa Paradis, a 17 ans, quand elle incarne une lycéenne qui a une aventure amoureuse avec son professeur interprété par Bruno Cremer, 60 ans, dans Noces blanches (1989) de Jean-Claude Brisseau. L’Effrontée et A nos Amours ne sont évidemment pas responsables de cette quête effrénée d’un nouveau graal – une jeune découverte, un visage inconnu – par un cinéaste qui s’enorgueillit ensuite de la paternité. Mais c’est dans cette brèche que s’engouffrent les cinéastes français les plus en vue qui profitent ensuite de l’occasion pour théoriser leur besoin de «chair fraîche» sous couvert de filmer une «vraie jeune fille», titre d’un premier film de Catherine Breillat qui s’inscrit, elle aussi, dans cette recherche avec 36 Fillette. Dans ce même entretien, Isabelle de la Patellière analyse lucidement la situation qui met tout de même au chômage le neuf dixième des actrices et pas des moindres. Au journaliste qui constate «qu’entre Charlotte Gainsbourg et Denise Grey [âgée à l’époque de 90 ans ndlr], des mailles ont sauté et que Catherine Deneuve en est réduite à «dénouer son chignon dans Fort Saganne ou à aider Christophe Lambert et Richard Anconina à traverser une rue dans Paroles et Musiques», l’agent acquiesce : «C’est vrai que l’on écrit de moins en moins pour les femmes, des catégories d’âge ont sauté.» Pourquoi ? Et bien peut-être parce que François Truffaut est mort, estime l’agente. Ou encore, parce que des cinéastes tel notamment Rohmer, qui a toujours revendiqué la chasteté entre ses comédiennes et lui, et d’une autre manière Doillon «se nourrissent aujourd’hui de la substance de leurs actrices plus qu’ils n’inventent des personnages». L’agente ajoute : «Ce sont des sortes de vampires qui ont un souci quasi documentaire de les filmer, de saisir sur le vif les instants de vie.» Elle poursuit joliment l’analyse : «Je crois que cette “crise”, cette pénurie de beaux personnages de femmes passent par la disparition des rôles de composition. On ne réclame plus d’une actrice qu’elle compose et on s’attache davantage à surprendre sa réalité.» «Une entreprise d’écrasement» Que se passe-t-il pour la jeune comédienne, soudain en haut de l’affiche, dont la réalité fut ainsi «surprise» ? Comment vit-elle la confrontation avec ces cinéastes vampires, qui ont la prétention tout à fait avouée de les révéler au monde par la magie de leur caméra ? Contactée par Libération, Marianne Denicourt, qui vient du théâtre, qui a travaillé avec Antoine Vitez, était alors une élève à l’école des Amandiers que dirigeait Patrice Chéreau et Pierre Romans. Elle a tourné avec Jacques Doillon, Benoît Jacquot, Arnaud Desplechin. Si elle prend la parole aujourd’hui, elle précise que c’est «pour ne pas laisser seules les autres actrices qui s’expriment» dont elle mesure le courage. Elle parle de certains films à cette époque comme d’«une entreprise d’écrasement qui provoque des ruptures de solidarité entre les femmes bien qu’on se serrait les coudes». L’un de ses premiers tournages est l’Amoureuse de Jacques Doillon, conçu avec neuf très jeunes actrices des Amandiers. Le scénario s’établissait fur et à mesure du tournage, et chacune disparaissait du film sans pouvoir le prévoir. «Doillon souhaitait créer une compétition pour asseoir son pouvoir», analyse l’actrice. Les comédiennes, logées dans le même hôtel en Normandie, entendaient tous les soirs le cinéaste taper à la porte des unes et des autres. «Ses intentions étaient parfaitement claires. On s’en parlait entre nous. On avait peur en entendant ses pas dans le couloir. De temps en temps le prétexte était qu’il venait nous parler d’une scène et on s’était mis d’accord pour ne jamais le recevoir seule dans sa chambre.» A la fin du film, seules trois actrices demeurent. «C’était harassant. Et le week-end, il y avait Jane Birkin, sublime, qui venait nous voir et qui était tellement adorable avec tout le monde, magnifique. C’était très gênant.» Marianne Denicourt ne narre pas ce souvenir pour accabler particulièrement Doillon (par ailleurs désormais accusé de viol, d’agression sexuelle et de harcèlement par les comédiennes Judith Godrèche, Anna Mouglalis et Isild le Besco) mais pour montrer à quel point la rivalité était organisée et tout était à vue, et ne posait aucun problème à certains cinéastes mis en cause. Elle cite Oscar Wilde : «Tout est question de sexe sauf le sexe qui est une question de pouvoir.» Jeune comédienne, elle est appelée par un grand producteur qui lui promet un rôle aussi grand que lui, dans le prochain Godard. «Je suis surprise, j’arrive dans son bureau où il y avait des canapés, il se jette sur moi. J’ai pu partir.» Evidemment, il n’y a pas eu de film. L’actrice pense qu’il y a toujours eu des gens épouvantables. «Mais qu’ils ont bénéficié dans ces années-là d’une impunité totale qui commence à se briser seulement maintenant.» En contre-exemple, elle cite le bonheur d’avoir travaillé dans deux films de Jacques Rivette – qui lui aussi ne filmait quasiment que des jeunes femmes. «J’avais peur de prendre rendez-vous» Les actrices détestent à juste titre qu’on dise qu’elles ont disparu ou subissent une traversée du désert qui paraît sans limite. Mais force est de constater que le cinéma a englouti et broyé, particulièrement dans ces années-là de très jeunes actrices, sans leur permettre de continuer de vivre, travailler, se renouveler. Une mise en retrait parfois décidée. «A une époque, j’avais peur de prendre rendez-vous avec les metteurs en scène dont j’aimais le travail. Je ne savais pas comment gérer ces relations entre metteurs en scène et actrices», dit encore Marianne Denicourt. Quand sont réapparus des rôles centraux, de femmes, destinées à des actrices de tout âge, et qui ne sont pas forcément des stars ? Outre les films que tourne Isabelle Huppert et où elle est toujours au cœur, un changement s’opère avec l’arrivée de cinéastes femmes telles que Tonie Marshall avec son film Pas très catholique, avec Anémone, puis Vénus beauté avec Bulle Ogier et Nathalie Baye (premier rôle pour une comédienne qui a alors 50 ans). Dans la même période, deux films emblématiques d’une jeune cinéaste, Laurence Ferreira Barbosa, Les gens normaux n’ont rien d’extraordinaire et J’ai horreur de l’amour, respectivement porté par Valeria Bruni-Tedeschi et Jeanne Balibar, participent d’un changement de registre, d’une écriture pour des rôles de femme qui tranche avec la fascination-érotisation qui a prévalu dans les décennies précédentes. Les révélations successives sur des réalisateurs estimant passer un pacte sexuel avec leurs actrices, y compris mineures, en gage d’une révélation et sublimation par l’art, le cinéma et la lumière de la célébrité s’effondre un peu plus chaque jour comme le cliché sexiste qu’il eut mieux valu révéler et savoir combattre plus tôt. Le cinéma se retrouve pris en France à son tour dans la tourmente qui a frappé Hollywood avec le séisme Weinstein en 2017, les révélations en cascade publiées dans le Monde accablant à la fois Benoit Jacquot et Jacques Doillon, deux cinéastes post-Nouvelle Vague, longtemps célébrés, paraissent de nature à faire voler en éclats les dernières stratégies d’évitement des problèmes, après le déjà terrifiant épisode Gérard Depardieu. Anne Diatkine / Libération (1) Isabelle de la Patellière est devenue l’agente de Benoît Jacquot en 1996, soit six ans après la sortie de la Désenchantée. Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 9, 2024 11:04 AM
|
Par Hélène Kuttner dans Artistik Rezo - 6 février 2024 Au fil d’une expérience théâtrale saisissante, Guillaume Poix, auteur, et Lorraine de Sagazan, metteure en scène, se sont inspiré du cinéma organique et silencieux d’Antonioni pour recréer sur le plateau du Théâtre du Vieux Colombier un événement mystérieusement tragique qui plonge les personnages dans le silence. Un spectacle d’une originalité et d’une puissance vibrantes, donnant au silence le poids d’une parole anéantie, aux corps le langage sensuel des émotions. Le pari est largement gagné. Le cinéaste italien Michelangelo Antonioni (1912-2007), dont les films ont été couronnés de prestigieux prix à Cannes, Berlin et Venise, se distingue par un traitement dramatique des émotions qui dépasse radicalement la norme d’une narration ordinaire. L’Avventura (1960), La Notte (1961) ou Blow Up (1966) bouleversent les codes de la représentation cinématographique : les intrigues ne sont pas linéaires ni résolues, les plans sont souvent fixes, les acteurs silencieux, les personnages difficiles à saisir, la sensation de durée est maximale, ce qui rend la compréhension de l’histoire souvent ardue pour le spectateur. La comédienne et autrice Lorraine de Sagazan souhaitait travailler sur la trace sensible de l’existence, hors de la communication par le langage. Faire un spectacle de théâtre sans le langage, c’est provoquer, faire exploser de manière insolente l’outil primordial du dialogue, la parole, quitte à la supprimer radicalement. À Guillaume Poix, auteur, de concevoir des monologues intérieurs, des silences habités et des rêves éveillés, chez des personnages traumatisés par un fait divers. Sur le plateau, un couple, dénommé par les prénoms des interprètes, Marina (Hands) et Noam (Morgensztern), rejoint ensuite par Julie (Sicard), la soeur de Noam, et Stéphane (Varupenne), l’ami, se tient devant nous. Fixe comme un guetteur, Baptiste Chabauty observe la scène en nous observant, témoin comme un chœur antique. Un bi-frontal saisissant L’intelligence des concepteurs du spectacle est d’avoir placé la scène au cœur d’un dispositif bi-frontal, qui permet aux spectateurs, de chaque côté du plateau, d’être les témoins de chacun des mouvements des acteurs en trois dimensions, pénétrant leur intimité de manière quasi impudique. On est d’emblée totalement déboussolé par le fait de voir évoluer les personnages, mutiques, sans véritable cohérence narrative connue. L’appartement est jonché d’objets disparates, jouets d’enfants, photographies, cartons de livres, disques. La simplicité du design ne semble pas particulièrement recherchée, le couple est encore jeune. Marina déboule, la mine chiffonnée et le regard sombre, un pantalon de jogging passé sans réfléchir. Marina Hands l’incarne avec une puissance inédite, grand corps animal ligoté par l’anesthésie de la parole, habité de tressaillements et de peurs récurrentes. Qui est-elle, cette femme belle et détruite qui s’enfile de manière provocante des verres de scotch ? Elle semble absente à elle-même, démente solitaire et fracassée de douleurs, sauf avec son chien Miki. Son homme, Noam, débarque avec un sac rempli de provisions, le visage crispé et le front comme terni de souffrances. Il lui jette un regard, l’épie, puis cherche une action pratique pour conjurer le drame. Trop tôt pour s’approcher du corps désaxé de Marina, qui se bat avec elle-même. Un silence lourd de sens « Qu’est-ce qui se passe quand tout a été dit ? » interroge le cinéaste Antonioni. Très peu de paroles, quelques unes, seront prononcées durant les quarante minutes d’une représentation très dense. Des photographies et des vidéos en noir et blanc, d’une grande beauté, créées par Jérémie Bernaert, défilent sur un écran suspendu. Un poste de secours sur une plage normande, des ruissellements d’eau, une carafe renversée, une bouée … la musique de Lucas Lelièvre suspend, heurte le fil de notre imaginaire qui cherche, travaille à trouver des indices, des pistes, des raisons de comprendre. Devant nous de déroule un rituel où l’amour se conjugue avec la mort, les genêts jaunes des falaises normandes avec les sacs de vêtements d’enfant mouillés par les vagues. Stéphane, l’ami amant qui réconforte Marina, maintenant vêtue dans une somptueuse robe en dentelle noire, apporte cette touche de vitalité et de réel, tout comme Julie qui offre à Noam un soutien fraternel. Pas d’effets scéniques, pas d’esbroufe, mais juste la radicalité d’émotions, de pulsations charnelles, de non-dits éloquents que le spectateur, transi et perdu, doit déchiffrer à sa manière. On finit par comprendre, mais l’expérience d’un tel spectacle, il faut le dire, dominé par la prestation exceptionnelle de Marina Hands, laisse les spectateurs sans voix, hébétés, surpris, dans leur fauteuil, quelques minutes après la fin de la pièce. Un vrai geste artistique. Hélène Kuttner / Artistik Rezo photo ®Jean-Louis-Fernandez_Coll.CF

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 9, 2024 5:02 AM
|
Par Eve Beauvallet dans Libération - 9 février 2024 Le préfet de Côte-d’Or a rendu deux années de suite une décision défavorable concernant l’emploi de sept fillettes comme figurantes dans une pièce de la metteuse en scène belge Agnès Limbos sur les violences sexuelles. Deux conceptions de «l’intérêt supérieur de l’enfant» s’affrontent. Rachida Dati l’a expliqué au micro de Sonia Mabrouk le 6 février : elle ne sera «pas du côté des censeurs» et veillera à «la liberté de création». La ministre de la Culture s’intéressera donc sûrement au sort de l’artiste bruxelloise Agnès Limbos, s’estimant victime d’une «forme de censure» de la part non pas des «wokistes» (qu’évoquait Rachida Dati sur Europe 1), mais du préfet de Côte-d’Or, M. Franck Robine, ancien chef de cabinet de François Fillon. Mi-décembre, la préfecture s’est en effet opposée à l’emploi de sept petites filles âgées de 9 à 12 ans comme figurantes dans le spectacle Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis moche intérieurement, initialement programmé au Théâtre des Feuillants à Dijon fin décembre et finalement annulé. «La violence n’est jamais directe» Il s’agit d’une œuvre sur les violences sexuelles et les féminicides dont la trame a été jugée «particulièrement mortifère» et l’atmosphère «volontairement sinistre» par la commission départementale chargée d’apprécier la conformité de la demande avec le code du travail et l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette dernière est composée de plusieurs instances, dont un juge pour enfant, un médecin ou un représentant de l’Education nationale. La préfecture précise par courrier que la décision «porte uniquement sur l’emploi d’enfants mineurs au titre de code du travail, et non pas sur la tenue de la représentation elle-même». Suffisant, selon l’artiste, pour porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Créée en 2021, déjà jouée dans vingt villes de sept pays (France, Belgique, Suisse, Allemagne, Luxembourg, République tchèque, Canada) avec chaque fois des mineurs sur le plateau, la pièce d’Agnès Limbos est présentée comme un «rébus», un «jeu de pistes» dans lequel une femme est «tour à tour victime, la main du bourreau, l’enquêtrice, l’agent orchestrant une reconstitution et, même, une héroïne de conte», peut-on lire sur le site Théâtre Mouffetard où le spectacle s’est donné. «Quiconque l’a vue sait que ces objections sont sans fondement, plaide de son côté l’Observatoire de la liberté de création, qui s’est, depuis, saisi du dossier. La violence n’est jamais directe, toujours suggérée. […] Des doigts agités dans une baignoire de poupée font comprendre un meurtre domestique. Le viol est mimé d’une manière qui n’a rien de réaliste», développe cette instance de veille rattachée à la Ligue des droits de l’homme dans une lettre adressée au préfet début janvier. «Elles incarnent poétiquement les femmes en devenir» L’interprète et metteuse Agnès Limbos, à la tête d’une compagnie dont le répertoire relève depuis plusieurs années du théâtre pour la jeunesse, parle au téléphone d’une pièce essentiellement «tragicomique : je me tue sept fois au cours de la représentation, d’une façon qui fait d’ailleurs souvent rire les gamines, avec qui nous discutons beaucoup. Dans la pièce, elles incarnent poétiquement les femmes en devenir». Suite au rejet de sa première demande d’autorisation en 2022, Agnès Limbos avait été reçue en janvier 2023 par le secrétaire général du préfet de Côte-d’Or, Frédéric Carre. A l’issue de l’heure d’entretien, assure la metteuse en scène, le représentant de l’Etat l’aurait invitée à déposer une nouvelle demande l’année suivante, estimant qu’elle serait cette fois jugée favorablement, et lançant «de façon assez humiliante je dois dire», souligne l’artiste : «Si j’avais su que vous étiez célèbre, j’aurais fait autrement.» La préfecture n’a pas souhaité répondre sur ce point. Accusant la commission d’abuser du recours à la protection de l’enfance, rappelant que la prévention des violences sexuelles est justement une cause majeure du quinquennat, l’Observatoire de la liberté de création rappelle à quel point la représentation métaphorisée de la violence structure un large pan du patrimoine artistique pour la jeunesse. Si l’on condamne la pièce de Mme Limbos, poursuit leur courrier, «alors il est urgent d’interdire les contes de Perrault, Grimm et Andersen, ainsi que la plus grande partie de l’œuvre de Walt Disney, à commencer par Bambi, et toute la littérature et le cinéma d’apprentissage qui, en présentant des histoires souvent horrifiques, permettent aux enfants de grandir en étant capables d’appréhender le monde». Un bienfait auquel semble souscrire la fondatrice du Salon du livre de jeunesse de Montreuil Henriette Zoughebi, récemment chargée par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) de faire des préconisations en littérature jeunesse sur le sujet. Par exemple, précisait-elle au dernier Salon de Montreuil achevé début décembre, «l’étude de la mythologie en 6e pourrait être l’occasion de sensibiliser aux enjeux de la lutte contre les violences sexuelles, [en développant] la capacité des élèves à [les] définir et [les] reconnaître [ainsi qu’en] analyser les représentations de façon critique». Encadrement jugé insuffisant Seulement, le spectacle d’Agnès Limbos n’est pas une œuvre adressée au jeune public. Si bien que la commission a également jugé «incohérent» que des mineures âgées de 9 à 12 ans soient employées dans un spectacle «tout public, à partir de 14 ans», «sans occasionner de traumatisme». Mais c’est alors tout un pan du cinéma, lequel emploie régulièrement des enfants dans des films interdits aux mineurs, qu’il faudrait censurer, s’indigne Agnès Limbos. Dans sa pièce existe bien une scène de viol simulé sur le personnage qu’elle incarne, mais à laquelle «les enfants tournent le dos en criant sur le plateau», assure l’artiste qui certifie que «les mineurs sont accompagnés, à la fois par [elle]-même, par deux autres collaborateurs et toujours une personne du théâtre d’accueil. Des zooms sont très souvent organisés avec les parents, qui sont tenus au courant scène par scène du contenu du spectacle». Un encadrement jugé insuffisant par les services de la préfecture, en dépit de l’avis de la professeure de théâtre des fillettes qui adressait ce mot à Agnès Limbos, suite à leur première déconvenue : «Madame, les petites sont très déçues et leurs parents très en colère. Je veux vous dire que nous sommes bien tristes d’être privées de votre spectacle, de votre univers, de vous. Et derrière cette peur de “traumatiser” les petites. Eh bien, c’est réussi. Elles le sont bel et bien. Merci monsieur le préfet.» Ève Beauvallet / Libération
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...