 Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 3:26 AM
|
Par Mariette Navarro dans son blog : "Petit oiseau de révolution"
En parallèle des Etats singuliers de l'écriture dramatique, qui viennent de s'achever au théâtre de l'Echangeur, la revue Frictions, dirigée par Jean-Pierre Han, a proposé aux sept auteurs réunis dans cette affaire une carte blanche dans son dernier numéro. L'occasion de développer chacun un texte personnel, mais aussi de proposer un texte commun, né de nos discussions sur notre travail, un état des lieux de la place des écrivains de théâtre dans notre milieu professionnel (et non, surprise, ce n'est pas très à la mode d'écrire des textes de nos jours). Des pistes pour une réflexion à poursuivre, à élargir, à partager. Sans aigreur. Pour comprendre. De quoi le règne des images aujourd'hui est-il le nom?
Extraits de ce texte, intitulé Ceux qui vont mourir vous saluent:
" Les metteurs en scène, si frileux pour beaucoup à s'emparer des textes d'aujourd'hui, ne sont-ils pas en réalité les premières victimes d'une censure qui ne dit pas son nom? Ne leur a-t-on pas inculqué qu'ils doivent absolument imposer leur propre lecture, leur propre discours critique, afin de déployer leur style et leur intelligence. Combien de dossiers de présentation sont inutilement truffés de citations savantes pour bien faire comprendre que la lecture du metteur en scène dépasse l'oeuvre elle-même, autrement dit que le texte choisi, brandi, est tout simplement un prétexte. Qui oserait dire qu'il veut tout simplement faire entendre une pièce dans la complexité et la densité de ses strates? Qui oserait dire qu'il fait pleinement confiance au texte?"
(Frictions n°26, p.50)
De manière générale, je t'encourage fortement à te découvrir Frictions si tu ne connais pas encore. C'est une revue très riche, avec toujours de très beaux dossiers photos, et à la fois profondément politique et littéraire (le dernier numéro était consacré à Hélène Bessette, c'est dire...). Moi, c'est toujours une lecture qui me remet en mouvement, me redonne des forces. * Le texte que j'y signe s'appelle Zones à étendre, j'y tricote quelques parallèles entre les Nuits debout et la nécessité de réinventer aussi quelque chose dans nos métiers de théâtre, dans nos écritures. Avec quelques extraits d'un travail en cours. Bonne lecture.
Mariette Navarro

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 6:46 PM
|
Par Emmanuel Tibloux, Directeur de l’ Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon* — 26 juin 2016
Musées, écoles, centres d’art… Il est urgent de mener une politique ambitieuse pour sauver la création. Formation, recherche ou diffusion doivent être reconsidérées tant sur le plan national que territorial.
Ne jamais perdre de vue les arts visuels
Traditionnels parents pauvres des politiques culturelles et éducatives publiques, les arts visuels sont aujourd’hui plus malmenés que jamais. Point aveugle d’un système éducatif entièrement modelé par le primat de l’intelligible sur le sensible et de politiques culturelles encore structurées autour des deux piliers du patrimoine et du spectacle vivant, le domaine est la cible de coupes budgétaires de plus en plus drastiques. Du centre d’art le Quartier à Quimper à l’école d’art de Perpignan, dont la fermeture est annoncée pour cet été, en passant par le musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône et les écoles d’art de Chalon et d’Avignon, dont la survie est menacée, la liste des établissements artistiques en voie de disparition, ou en cours de précarisation, ne cesse de s’allonger. Alors que les premiers documents d’orientation culturelle de précampagne présidentielle voient le jour ou sont en cours de finalisation et qu’aucune nouvelle donne ne semble, à gauche comme à droite, se profiler, il est urgent de rappeler les enjeux décisifs des arts visuels et d’alerter sur l’aveuglement paradoxal des politiques à leur endroit.
Le premier enjeu est cognitif. Des sciences humaines aux sciences cognitives, les avis sont unanimes : en tant que systèmes symboliques spécifiques, les œuvres d’art contribuent à l’accroissement de nos capacités de perception et de connaissance. Une qualité supplémentaire vient en outre distinguer les arts visuels : leur aptitude à développer nos capacités de visualisation et de schématisation. Celle-ci est d’autant plus précieuse que nous vivons sous un régime de connaissance largement visuel. C’est, en effet, un lieu commun de le souligner : l’image modèle notre environnement et concurrence désormais l’écrit dans notre rapport au savoir et à la culture. A ce premier tournant, visuel, s’en ajoute un second, qui conditionne les grands défis des temps présents : le tournant créatif. C’est là un autre trait d’époque : la créativité et l’innovation sont devenues les clés d’une économie compétitive et d’une société solidaire. Du fonctionnement en mode projet à l’abolition de la frontière entre le travail et le non-travail, en passant par la valorisation de l’imagination, de l’expérimentation et de l’autonomie, c’est plus largement tout un ensemble de valeurs et de processus issus du monde artistique qui sont mobilisés dans les champs économique et social. On aperçoit alors le paradoxe de la situation : d’un côté, on prend acte de l’importance décisive du visuel et de la créativité ; de l’autre, on ferme et on fragilise les lieux de formation, de recherche et de diffusion dédiés à la création visuelle.
Cette situation, il est urgent de la renverser en élaborant, au plan national comme au plan territorial, une politique ambitieuse en matière de formation, de recherche, de création, de diffusion, de médiation et d’éducation aux arts visuels. Ce qui suppose un investissement fort, non pas tant dans la culture comme facteur de cohésion sociale, que dans l’art comme vecteur d’éducation au regard et à la création. Sans quoi, c’est rien moins que le monde d’aujourd’hui que nous nous condamnons à perdre de vue.
* Et président de l'association nationale des écoles supérieures d'art (Andéa)
Emmanuel Tibloux Directeur de l’ E cole nationale supérieure des beaux-arts de Lyon*

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 3:36 PM
|
Par Patrick Sourd dans Le Monde :
Le Libano-Québécois met en scène « L’Enlèvement au sérail », dont il a gommé les clichés sur le monde oriental.
Le Libano-Québécois met en scène L’Enlèvement au sérail, de Mozart, actuellement programmé à l’Opéra de Lyon. Un monument lyrique dont le nouveau directeur du Théâtre national de la Colline, à Paris, a osé récrire les dialogues, en gommant les clichés sur le monde oriental.
Pourquoi avoir choisi « L’Enlèvement au sérail » pour votre première mise en scène d’un opéra classique ?
En premier lieu, en raison du thème orientaliste de l’opéra. C’est pour moi l’occasion de m’interroger sur les rapports entre l’Orient et l’Occident. Le Liban, d’où je viens, a été pendant cinq siècles sous domination ottomane. Je vis maintenant en France, je suis un enfant des deux cultures. En ce moment, le débat devient vite inflammable dès qu’on aborde ces questions… Se les poser à travers un opéra de Mozart permet de prendre du recul.
En quoi le livret original de Johann Gottlieb Stephanie vous dérange ?
Si je vous raconte cette histoire comme je le ferais à un ami, vous allez comprendre que dans le contexte d’aujourd’hui cette aventure est la porte ouverte aux jugements à l’emporte-pièce. Deux Européennes sont enlevées par de méchants Arabes. Konstanze et sa servante sont enfermées dans un sérail. Son petit ami vient les sauver, mais lui aussi se fait prendre. Les jeunes gens doivent leur délivrance à la mansuétude du pacha… mais parce que celui-ci a vécu en Europe et qu’il le fait au nom des valeurs occidentales des philosophes des Lumières.
D’où cette décision de récrire les récitatifs ?
Cette comédie lyrique multiplie les clichés sur le monde oriental, je ne voulais pas mettre en scène des dialogues que je n’aurais pas supporté d’entendre. J’ai posé comme première condition de récrire le livret. L’Enlèvement au sérail est un des rares opéras classiques où la parole dispose d’autant de place ; le rôle du pacha est même entièrement parlé. Sans intervenir sur le rythme du séquençage entre les récitatifs et les parties chantées, je savais qu’il me serait possible de m’exprimer.
Quel changement de point de vue proposez-vous ?
L’Orient et l’Occident ont un même désir, aduler les femmes et les contrôler. Là où les deux cultures s’opposent, c’est dans la manière de faire. Ces femmes ont été prises en otage pendant deux années. Je me suis demandé comment leur retour s’était passé. A l’époque de Mozart, les femmes ont le choix entre le sérail et le corset. Ma première idée a été d’écrire un prologue pour raconter la fête donnée en l’honneur de leur libération. Konstanze est invitée à participer à un jeu consistant à taper avec un bâton sur une grosse tête de turc. Elle en est incapable et doit s’expliquer. Justifier son refus me permet d’inscrire l’ensemble de cette histoire dans un présent, les parties chantées de l’opéra deviennent des flash-back
rappelant sa mésaventure.
Comment travaillez-vous avec le chef d’orchestre Stefano Montanari ?
Il connaît sa partition sur le bout des doigts. Il m’aide beaucoup, notre entente est parfaite. Et je trouve enthousiasmant d’avoir pour autre collègue un jeune compositeur amoureux en la personne de Mozart. Il a 26 ans et donne à son héroïne le prénom de la femme qu’il rêve d’épouser. Sa joyeuse énergie nous porte tout du long sans préjuger de la manière dont Konstanze revendique son désir d’être une femme libre.
Qu’espérez-vous de cette actualisation ?
Aujourd’hui chacun se raccroche à sa propre identité en créant les conditions de son enfermement. Il faut abandonner l’idée que l’enfer, c’est forcément les autres. Je rêve
de contrarier cette tendance en montrant que Konstanze se construit à travers le surgissement d’une autre culture dans sa vie. Qu’une comédie légère y contribue est une raison de s’en réjouir.
L’Enlèvement au sérail, de Mozart. Direction musicale, Stefano Montanari, mise en scène et réécriture des dialogues, Wajdi Mouawad. Opéra de Lyon, place de la Comédie, Lyon. Tél. : 04-69-85-54-54. Jusqu’au 15 juillet. www.opera-lyon.com
Patrick Sourd

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 1:02 PM
|
Par Amélie Blaustein Niddam pour toutelaculture.com Dans son bureau qui donne vue sur le campus, Marc Le Glatin ne peut pas oublier que le théâtre dont il a la direction depuis le 1er juin suite à sa nomination du 26 mai est situé au cœur d’un campus, le plus international de Paris : 12000 étudiants et chercheurs de 140 nationalités différentes, 40 maisons. Le grand bonhomme aux grandes lunettes voit clair sur la place que le TCI doit occuper, dans cet endroit et un contexte très particulier.
En politique il y a eu la Belgique, et en culture le TCI. Le théâtre est resté 20 mois sans direction. Marc Le Glatin qui a été à la tête du Théâtre de Chelles pendant seize ans arrive donc dans une situation étrange. Comment les choses se sont-elles organisées pendant ces deux ans ? Il raconte : « cela a plutôt bien fonctionné » et temporise « mais ce n’est pas idyllique ». Il l’affirme : « mon arrivée n’a pas suscité de défiance ». Pendant deux ans, le théâtre, suite au départ de Pascale Henrot était donc géré par ses salariés. Honnêtement, le public n’a jamais été sanctionné de ce manque tant la programmation choisie est juste. Si ce n’étaient les pétitions et les prises de paroles avant les spectacles, il était impossible de savoir. Et pour cause, cette vacance du pouvoir a permis des prises de décisions collégiales avec lesquelles Marc Le Glatin devra composer.
Si il a été choisi parmi une liste de cinq autres concurrents c’est pour son projet pluriel qui a deux axes : « les résidences » d’artistes et « la jeune création ». L’idée simple est d’utiliser les « ressources humaines » du lieu, composé d’étudiants, au minimum de niveau master de chercheurs. Dans ce sens, l’École Supérieure d’Art Dramatique « met un pied, mais pas les deux » au TCI. Il s’agit d’offrir aux apprentis comédiens un plateau pour créer et répéter. La programmation qu’il mettra en place la saison prochaine sera composée de »40 % théâtre et 60 % danse, cirque, musique », il précise « jazz, musiques improvisées et musique du monde pour parler à tout le monde ». Sa volonté, est de « donner le plateau et la visibilité à ceux qui ne l’ont pas «
Il faudrait être fou pour faire du TCI uniquement un lieu dédié à la jeune création et Marc Le Glatin semble avoir la tête bien vissée sur ses larges épaules. Avec intelligence il prévoit ( et « souhaite ») la pérennité de partenariats précieux comme celui avec le Festival d’Automne qui permet la co-production de grands spectacles. Les grands noms croiseront donc ceux à découvrir.
Mais Marc Le Glatin doit faire face, et il semble serein, à une lourde crise. Entre 2016 et 2018, la CiuP va opérer une « baisse sensible » de ses financements. Marc Le Glatin a l’élégance de la mesure mais il s’agit de diviser par deux cet apport qui était de de 880 000 euros en 2016 et qui tombera à 400 000 en 2018. « La baisse de financement ne peux pas se répercuter uniquement sur le budget artistique. Ce sont les artistes qui nous font vivre. » Alors, cinq salariés bénéficient d’un plan de départ volontaire. Cela veut dire qu’il faudra penser et faire avec moins de personnel.
« Il va y avoir moins de lever de rideaux ». La solution est nette, jouer moins. C’est déjà le cas, on est aujourd’hui à 170 représentations par saison. Un mal pour un bien évident puisque ce changement permettra aux artistes de passer plus de temps en création, au plateau.
Il insiste sur un changement de paradigme très lié à cette décision « un changement anthropologique de génération ». Il parle de « génération hypertexte », faisant référence à une pensée en arborescence. Les temps ont changé et l’idée est ici de relier tous les acteurs : les universitaires, les étudiants, les artistes, les publics habitués et en devenir pour appréhender le théâtre comme un laboratoire politique.
Du côté de la politique, cette fois culturelle, Marc Le Glatin a du créer des armes administratives pour répondre au manque de budget. Le théâtre public qu’est le TCI prendra le statut d’association, « le statut le plus naturel pour un théâtre » auquel se sera associé, dans une entité juridique séparée un bureau de production dirigé par Claire Dupont qui viendra aider et accompagner les compagnies en création.
Il le dit avec humour face aux incompréhensions devant cette structure à deux têtes : « Le Théâtre de la Cité Internationale ne deviendra pas un théâtre du Off d’Avignon ». La formule est efficace, le TCI reste un théâtre public, qui désormais possède à sa tête un homme lucide, armé d’un projet ambitieux pour redonner du lien entre le théâtre, la cité et les environs. Plus que jamais, ce théâtre qui a fait l’expérience folle d’une démocratie horizontale, se réinstalle dans le champ cultuel en ayant les yeux tournés vers le futur.
Visuel : ©Mathilde Delahaye

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 6:53 PM
|
Par Bruno Paternot pour Mag/Maa :
Après les gloires théâtrales du XXe siècle (Strehler, Brook, Lavaudant), le Printemps des comédiens accueillait en deuxième partie de festival les nouvelles idoles de la scène française. Voici donc Joël Pommerat, Guillaume Vincent, James Thierrée. C’est trois-là ont déjà leurs adeptes, leur public, leur fan-club.
Pour la première fois, le spectacle Ca ira, fin de Louis (1) été présenté en extérieur. L’amphithéâtre du Domaine d’O était un magique écrin pour accueillir cette représentation. Si les superbes lumières d’Éric Soyer se noient un peu dans cette espace-ci (la lune lui faisait une sacrée concurrence), l’agora, l’hémicycle sur lequel était assis les spectateurs entrait en totale correspondance avec le propos du spectacle dont la majeur partie se déroule dans l’hémicycle de la toute fraîche Assemblée Nationale. Passé un temps où l’étrangeté de la pièce (un subtil mixe entre la révolution française et 2016), le public entre dans l’histoire (et l’Histoire) comme il entre en résistance et se plonge dans les stratégies politiques de la Révolution. Comme d’habitude chez cet auteur de spectacle, tout tient sur le jeu des acteurs. Les décors, les costumes, les perruques sont de plus en plus accessoires. Cette austérité tient presque de la posture et elle amoindrit le spectacle. Dans ses pièces « pour enfants » le metteur en scène français le plus en vue réussit à mêler fable, réécriture, esthétique magnifique et justesse du propos. Il est rare que 4h30 de représentation passent comme une lettre à la poste, mais les spectateurs, vers deux heures du matin et malgré un vent glacial, sont tous debout. Le spectacle secoue par la force de l’interprétation des acteurs et des actrices tout autant que par les propos révolutionnaires de la première Assemblée Nationale.
Beaucoup de force aussi pour le metteur en scène Guillaume Vincent qui présente un extrait de son prochain spectacle fleuve lui aussi autour des Métamorphoses d’Ovide. Sur les quatre heures prévues, il en présentait ici les 35 premières minutes. En partant du principe éculé et simple des élèves de l’atelier théâtre qui montre a leur professeur ce qu’ils vont faire et les scènes qu’ils ont préparé, arrive évidemment un maillage entre réel et fiction, entre fiction et histoire. De ce processus simple sort un spectacle troublant, écrasant, tout le temps juste. Là aussi, point d’artifices, tout repose sur le jeu des acteurs et la force métaphorique du texte. Le duo d’actrice, Elsa Agnès et Elsa Guedj est absolument phénoménal. Elles réussissent à être à la fois drôles et glaçantes, tendres et puissantes, mythiques et quotidiennes. Elisa Agnès a des airs de Françoise Gillard : sa diction impeccable, son ombre assurée et fuyante à la fois, Son regard profond font d’elle une actrice trouble, multiple, fascinante (au sens premier du terme, elle attire et repousse tout autant). Le spectacle, qui traite de l’inceste de façon extrêmement déroutante se révèle à la fois léger et profondément choquant. On est étonné de la capacité du texte à troubler encore au XXIe siècle. Bien évidemment, la réécriture joue, mais le mythe est là. Le texte se veut tout à la fois lyrique et violent, les mots sont dits avec simplicité et douceur et ses oppositions créent toute une série de rupture entre la fiction et la fiction dans la fiction, entre la fiction dans la fiction de la fiction et la réalité. Ces multiples mises en abyme nous plongent dans les incertitudes : incertitude du théâtre, incertitude du genre humain, incertitude de nos propres réactions. Tous les personnages sont doubles, à la fois faible et fort, à la fois dégueulasse et brûlant.
On peut souvent évaluer la qualité de réception d’un spectacle au silence chargé entre la dernière réplique et le début des applaudissements. Ici le silence après au vide encore et toujours d’Ovide.
Après ses deux réussites, le spectacle de James Thierrée (qui vient pour la troisième fois quasiment dans la foulée présenter un spectacle au Printemps) est assez désespérant. L’esthétique générale du spectacle est assez semblable à celle de Tabac rouge, le précédent opus, on n’y retrouve aucune évolution. Un petit air de déjà-vu commence à se faire sentir le renfermé. Cette fois-ci, les tissus sont moins beaux, les rideaux font plus cheap, le propos est plus flou. L’interprétation des danseuses et outré et explicative, donne à la pièce un caractère grossier qui soit montre qu’il n’y a pas grand chose à dire, soit une volonté que tout soit très compréhensible. Contrairement aux premiers spectacles où la poésie transcende la fable, ici, on cherche à comprendre et c’est de toute façon un souci. Les relations interhumaines sont compliquées : tout s’emmêle. Alors les gens s’emmêlent et très grossièrement, ils s’accrochent les ans aux autres… littéralement. Au milieu de grands effets, de grands décors, de grandes machineries, un petit jeu de mains ou de pieds explose de poésie et nous faire regretter que tout le spectacle ne soit pas à cette image-là. Qu’il est triste de voir des pieds dont l’expression est plus juste que les visages. Un spectacle qui manque cruellement de tête et de souffle là où il y a des pieds et des mains. Et le cœur dans tout ça ?

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 4:47 PM
|
Par Pascal pour le blog Tv news
Vingt-trois ans que la Comédie-Française ne s’était pas produite au Festival d’Avignon.
À l’occasion de sa 70ème édition, ce mois de juillet, la Troupe y fait son retour avec Les Damnés par le metteur en scène belge Ivo van Hove.
Diffusion sur France 2 le dimanche 10 juillet à 22h50. Virginie Guilhaume présentera aux téléspectateurs ce spectacle .
En deux décennies, le directeur artistique du Toneelgroep d’Amsterdam, dont le champ d’exploration embrasse le monde du théâtre, du cinéma et de l’opéra, a parcouru un vaste répertoire d’ œuvres, de Sophocle à Shakespeare, Molière, Koltès, Cassavetes ou Arthur Miller la saison dernière avec Vu du pont. Pour cette production qui ouvrira la saison de la Comédie-Française salle Richelieu, Ivo van Hove précise : « Il ne s’agit pas pour moi d’adapter le film. Ma démarche consiste à revenir au scénario pour le mettre en scène au théâtre. »
Les Damnés, chronique au scalpel d’une famille d’industriels pendant la prise du pouvoir des nazis en 1933 en Allemagne, ils mettent en exergue la débauche idéologique d’une société prête aux alliances les plus venimeuses au profit de ses seuls intérêts économiques. « Pour moi, c’est la célébration du Mal » ajoute le metteur en scène dont le travail « lie toujours une grande théâtralité à l’exploration de zones psychologiques complexes et d’émotions raffinées ».
Sur fond de musiques dites « dégénérées » (Stravinski, École de Vienne) ou revendiquées par les nazis (Beethoven, Wagner), l’alliage d’images d’archives et de captations sur le vif décuple les tensions en scène où les relations humaines sont troubles, le désir plus que jamais perverti.
Un spectacle de la Comédie-Française. D’après le scénario de Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli. Mise en scène Ivo van Hove. Réalisation Don Kent.
Avec La troupe de la Comédie-Française : Sylvia Bergé, Éric Génovèse, Denis Podalydès, Alexandre Pavloff, Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre, Loïc Corbery, Adeline d'Hermy, Clément Hervieu-Léger, Jennifer Decker, Didier Sandre, Christophe Montenez. Et Sébastien Baulain, Basile Alaïmalaïs, Thomas Gendronneau, Ghislain Grellier, Oscar Lesage, Stephen Tordo, Tom Wozniczka.
Crédit photo © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 4:27 PM
|
Par Sabine pour le blog pianopanier
« Peut-on rire du malheur des autres ? Ca dépend… Si le malheur des autres est rigolo, oui. » – Philippe Geluck, Le Succulent du chat.
Le sort semble s’acharner sur Monsieur de Pourceaugnac – quelle idée, déjà, d’arborer un tel patronyme ! À peine débarqué de son Limousin natal – c’est qu’il revendique haut et fort ses origines, le bougre de chauvin – pour épouser la jeune Julie, il tombe dans le premier d’une série de guets-apens qui construiront sa longue descente aux enfers. Grâce à l’imagination débridée d’Ersatz, l’amant de Julie, et à la complicité cruelle de ses deux acolytes Sbrigani et Nérine, notre Limousin va effectivement passer quelques sales quarts d’heure en compagnie d’une truculente galerie de personnages.
Un matador créancier succède à un médecin tendance psychopathe, des archers brutaux croisent des avocats lyriques, tandis que des épouses revanchardes s’en viennent régler leur compte à notre pauvre bougre. Sans compter le père de sa promise qui ne semble plus voir d’un très bon œil cette union antérieurement scellée.
Tous les thèmes chers à Molière se trouvent concentrés dans cette comédie-ballet (trop) rarement montée : la critique acerbe des médecins et apothicaires, la dénonciation des mariages arrangés, les dégâts causés par l’argent…
« Monsieur de Pourceaugnac est sans doute l’une des pièces les plus sombres et les plus cruelles que Molière ait écrites. » – Clément Hervieux-Léger
Il ne fallait sans doute pas moins que le talent de Clément Hervieu-Léger pour nous faire découvrir ou redécouvrir les aventures de Pourceaugnac. D’abord parce qu’il ne s’agit pas d’une pièce mais de l’une des comédies-ballets (écrite un an avant le Bourgeois Gentilhomme) de ce cher Jean-Baptiste et que le pensionnaire de la Comédie-Française ne s’y est pas trompé en conviant William Christie et les musiciens des Arts Florissants. Ensuite parce qu’il réunit et dirige une équipe de comédiens ébouriffante, autour d’un Gilles Privat sincèrement irrésistible. Enfin parce que la scénographie subtile et délicate alliée à ce cadre éternellement magique des Bouffes du Nord nous transporte, au gré de notre imagination, de la Cour du Roi Soleil à des paysages de campagne toscane, aux bas-fonds new-yorkais ou même à un épisode de Docteur House.
Alors forcément, on rit. Enormément, follement, copieusement. On rit crescendo à mesure que Pourceaugnac dépérit sous nos yeux. Plus il sombre, plus on s’esclaffe. Aucune compassion pour le Limousin. On aime se réjouir du malheur des autres. Molière le savait et Clément Hervieu-Léger est un formidable « passeur »…

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 4:19 PM
|
Par Guillaume Tion pour Libération le 26 juin 2016
«C’est un coup de semonce et en même temps un sentiment de régression par rapport à l’idéal européen. On savait l’idée européenne en crise depuis pas mal de temps. La difficulté des différents pays à se mettre d’accord sur les questions migratoires, de frontières, sur la sécurité, sur l’économie, montre bien qu’aujourd’hui l’UE est plus diverse qu’unie.
«Dans ce contexte, on assiste à un repli identitaire, qui s’impose au Royaume-Uni mais menace dans plein d’autres pays, dont la France. La première chose à laquelle j’ai pensé vendredi matin, c’est que la question allait être au centre de la campagne présidentielle. C’est assez inquiétant.
«Au niveau culturel, l’Europe des artistes, elle, existe au-delà des institutions, c’est un fait. Ce n’est pas parce que les Anglais sortent de l’UE qu’on va arrêter d’accueillir des artistes anglais. Et nous continuerons toujours à jouer Shakespeare, évidemment ! Il est intouchable ! Ce qui est angoissant, c’est cette idée de repli, chacun pense pouvoir être plus fort en étant seul. Mon sentiment en tant qu’Européen fervent, c’est qu’on est plus fort à plusieurs : on s’enrichit avec la culture et les façons de réfléchir des autres.
«Ça veut dire aussi que les artistes doivent jouer un rôle dans la défense d’une image positive de l’Union européenne. Car elle est devenue une idée repoussoir. Il ne s’agit pas de faire de la politique, mais de montrer que l’Europe dépasse les questions d’économie ou de nation : il y a une idée philosophique derrière, qui affirme la liberté de croire et de penser, des idéaux inspirés de la Révoluton française et des Lumières. Ces idéaux, on en a besoin. Nous avons tous une responsabilité à défendre cette idée-là.
«C’est peu près la même question que de convaincre les gens de ne pas voter FN. Il faut montrer que nos institutions sont ouvertes, sur les cultures des autres mais aussi sur toutes les strates de la société. On ne peut pas complètement couper cette question de l’Europe de celles qui traversent la société française. Tout est lié. Samedi, du coup, on a commencé à organiser un débat à l’Odéon sur les frontières et les limites de l’Europe, pour la rentrée. J’étais arrivé à l’Odéon avec l’idée qu’il fallait mettre l’accent sur ces problématiques. Mais là, il y a le feu au lac.»
Guillaume Tion

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 1:27 PM
|
Par Véronique Hotte pour son blog Hottello
Comédies barbares, texte de Ramon del Valle-Inclan, traduction de Armando Llamas (Actes Sud – Papiers), mise en scène de Catherine Marnas, avec les élèves-comédiens de troisième année de l’École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine (éstba)
Ramon del Valle-Inclan (1866-1936) évoque, à travers L’Aigle du blason (1907), Romance des loups (1908) et Visage d’argent (1922) – trois drames réalistes en prose des Comédies barbares -, un paysage de l’époque historique contemporaine.
La trilogie ancrée dans le XIX é accorde la priorité au dernier drame Visage d’argent.
Et c’est bien le personnage Visage d’argent qui apparaît le premier dans la mise en scène de Catherine Marnas, le plus jeune et le plus beau des enfants de Don Juan Manuel Montenegro, héros de la « série » et hobereau galicien fantasque qui règne historiquement dans sa région à la façon vétuste d’un seigneur médiéval – despote et hidalgo coureur de jupons, portrait en pied poussiéreux mais encore vivant d’un suzerain en armure sur ses terres féodales héréditaires, soumises et appauvries.
Le maître a interdit le passage sur son territoire, une décision arbitraire qui provoque la colère immédiate des paysans. Pour se libérer de cet interdit – oppression inique -, le peuple fait appel au curé, figure de notable à la fois pittoresque et fort douteuse.
La douce Isabel, filleule de Montenegro qui en fait sa concubine, provoque l’affrontement du chevalier gentilhomme avec le curé qui veut l’arracher à l’emprise de son parrain, et avec Visage d’argent, le cadet de ses fils, amoureux d’Isabel.
La scène offre dès lors au public un précipité d’épisodes violents et passionnés, entre fureur, luxure, ambition, orgueil et sacrilège. Les hommes au panache viril sont vaillants tandis que leur résistent les femmes, des séductrices judicieuses, quand elles ne sont pas dévotes : épouse, sœur, concubine, exprimant leur engagement.
La Magicienne, la Rouge, le Fuseau noir – bouffon comique et céleste -, sont réinventés avec humour.
La moquerie ironique et sarcastique propose une lecture caricaturale de l’œuvre : sont dénoncés la dévotion religieuse, la crédulité populaire, l’appât du gain, chacun se réduisant à n’être qu’un type de bandit plus ou moins violent ou sympathique.
Les scènes pathétiques et cruelles se succèdent à un rythme endiablé : l’argent est le moteur des agissements des fils de Montenegro, sauf un qui part à la guerre pour défendre son pays. Ces enfants de famille sans foi ni loi vont piller dans l’impudeur l’héritage parental au domicile de leur mère défunte, restée fidèle au mari indigne.
Le spectacle de Catherine Marnas conçu avec les élèves comédiens de troisième année de l’École supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine (éstba) s’amuse de cette trame annonciatrice de la fin d’un monde dont il ne reste qu’à faire le deuil.
Sous la résonance de la traduction crue et persifleuse d’Armando Llamas, ces drames égrènent le bruit et la fureur d’un monde d’instincts non encore révolu.
La dimension physique et corporelle de la prestation des jeunes gens sur le plateau est particulièrement soignée, esquisses réussies de chœurs et de chorégraphies dansées, gestuelles libres et envols singuliers des corps, pirouettes et acrobaties.
La vie désordonnée s’installe sur la scène au milieu des vociférations des uns et des vitupérations des autres ; plus rarement se fait entendre la sonorité du rire ou du plaisir d’être, simplement ou amoureusement, dans l’intimité des couples dessinés.
L’existence est confinée à la guerre, une lutte sans merci où l’homme est un loup. Les acteurs jouent pleinement leur partition théâtrale et spectaculaire au milieu de la violence des injures et des images scéniques pittoresques. Sous les yeux du public, défilent les tempêtes sous une bâche de plastique, les courses effrénées du chien du chevalier, l’Enfant-Jésus à la couronne de petites lumières qui s’exprime facétieusement et les pardons typiques de campagne avec rappels picturaux du port de la croix, grenouilles rurales de bénitiers et chapelains en chasuble blanc.
La dénonciation d’un monde trop étriqué se donne dans un beau débridement.
La musique traditionnelle gasconne et landaise sur le plateau insuffle à la fresque une grâce bienfaisante, avec Xabi Etcheverry au violon traditionnel basque, Valentin Laborde à la vielle à roue, Martin Lassouque à la cornemuse landaise et Jordan Tisné à la flûte à trois trous.
Un ouragan enfiévré de théâtre brut et rageur, entre désordre et folie dé-coiffante.
Véronique Hotte
Théâtre de l’Aquarium, du 23 au 26 juin. Tél : 01 43 74 99 61
Festival des Écoles du Théâtre public, du 30 juin au 3 juillet à la Cartoucherie.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 25, 2016 6:03 PM
|
LE MONDE | 25.06.2016 |
Propos recueillis par Christine Rousseau
La directrice de France Culture, nommée en août 2015, dresse le bilan de sa première année à la tête de la station et détaille les grandes lignes des programmes de rentrée.
Après cette première saison, quels sont vos motifs de satisfaction ?
La double identité de la station – la création et les idées – a été renforcée à travers de nouvelles écritures et de nouveaux formats comme « Raconter le monde moderne », qui revient à la rentrée avec une grande journée consacrée aux Etats-Unis. Il y a aussi la capacité à se mettre au service d’un public plus large. Ce qui a été le sens d’Imagine, un week-end de rencontres, de débats et de création organisé avec le Centre Pompidou les 4 et 5 juin. A travers cet événement, nous désirions nous confronter à des publics qui ne nous connaissent pas ou peu, afin de leur montrer que l’on est capable de faire rimer la réflexion avec le plaisir.
En construisant la grille de rentrée, quels sont les points que vous avez cherché à faire évoluer ?
La première chose concerne – et c’est notre richesse – les émissions centrées autour des savoirs et des connaissances, qui ont été lancées sous la direction de Laure Adler (1999-2005). Il convenait de les rénover afin de continuer à surprendre, tout en restant clair sur les offres. La clarté de la grille a été un des axes majeurs de notre travail, avec la volonté d’induire plus de plaisir dans la réflexion et la culture, à travers l’habillage et le choix des voix à l’antenne.
De quelle manière avez-vous pris en compte l’événement majeur de 2017, l’élection présidentielle ?
Cette année a été marquée par un climat de crispation du débat public, de discrédit de la parole politique, qui va se durcir plus encore dans les mois à venir. Cela nous a conduits à réfléchir à la manière dont on organise le débat sur l’antenne. C’est ainsi qu’il a été décidé de ne plus retrouver, sur des formats où ils s’exprimaient de manière unilatérale, « Le Monde selon… » Caroline Fourest, Brice Couturier ou Philippe Manière dans les « Matins ». Ces billets seront remplacés par des chroniques quotidiennes sur la vie des idées en France et à l’étranger. En revanche, vous retrouverez ces grandes voix dans une formule du vendredi du « Grain à moudre », où ils débattront. L’idée étant de faire s’exprimer d’un côté les savoirs et, de l’autre, de mettre en débat les opinions dans le « Grain à moudre » et dans « Répliques ». Et, bien sûr, en vue de cette échéance électorale, la rédaction prépare un vaste dispositif avec, notamment, dès la rentrée, un journal tous les jours à 8 h 15, qui couvrira les primaires puis la campagne.
Comment se manifeste cette volonté de clarification de la grille ?
A travers la matinale, qui désormais sera découpée en deux parties avec le « 6 h/7 h », produit par Emilie Chaudet, qui a pour ambition d’être une vraie vitrine de station, avec de la culture à travers un grand entretien mené par Tewfik Hakem, de la vie des idées avec Jacques Munier et de l’international avec Thierry Garcin. Il sera suivi du « 7 h/9 h » de Guillaume Erner, dans lequel les rendez-vous seront quotidiens et non plus hebdomadaires. Il y aura deux nouvelles séquences : les « Eclaireurs », où chaque jour, de 7 h 15 à 7 h 30, Guillaume Erner interrogera un expert sur une question d’actualité ; et un journal de la culture, à 8 h 45, conduit par Zoé Sfez, qui viendra conclure les « Matins ». Enfin, Nicolas Martin quitte la matinale pour animer une grande émission quotidienne consacrée à la science, de 16 heures à 17 heures, qui s’intitule « La Méthode scientifique ».
D’autres nouveautés sont-elles à attendre ?
Oui, en particulier le samedi, avec l’apparition d’un « 7 h/9 h » présenté par Caroline Broué, qui cesse d’animer « La Grande Table », reprise par Olivia Gesbert. Il sera très centré sur la culture, les idées et prendra en charge le traitement de l’info dans les médias. Le journal de 8 heures sera plus long le samedi. Toujours dans un souci de clarté et de simplification, avec Frédéric Barreyre, le directeur de l’information, nous avons repensé la présence de l’information sur l’ensemble de la grille afin qu’elle soit présente de manière régulière à l’antenne. Tous les journaux gardent la même durée, mais ils seront précédés, une demi-heure avant, par des appels de titres. En remplacement d’Olivia Gesbert, Raphaël Bourgois, coproducteur de « La Grande Table », va reprendre « Dimanche et après ». Enfin, Antoine Guillot va avoir une émission de cinéma le week-end àlaquelle Michel Ciment restera associé.
Philippe Meyer a été amené à quitter France Inter pour se concentrer sur France Culture. Allez-vous lui proposer d’autres rendez-vous ?
En plus de « L’Esprit public » qu’il continuera d’animer, nous travaillons sur une proposition qu’il m’avait faite l’an passé, axée sur le spectacle, qui sera produite en public et diffusée en été.
Slate vient de lancer des séries en podcast. Afin d’enrichir votre offre, allez-vous en proposer sur votre site ?
Nous n’en ressentons pas le besoin. Avant de produire davantage, il faut rendre plus accessible la richesse de notre proposition, très pérenne. Ainsi, après avoir rééditorialisé le fond, nous allons rééditorialiser la grille, au jour le jour.
Christine Rousseau
Journaliste au Monde

|
Rescooped by
Le spectateur de Belleville
from OperaMania
June 25, 2016 1:54 AM
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 24, 2016 7:58 AM
|
Communiqué de presse
En plein accord avec les responsables de la ville d’Aix-en-Provence, de la métropole Aix-Marseille-Provence, du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et avec le Conseil d’Administration du Festival d’Aix-en-Provence, réuni ce jour, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a donné son agrément à la nomination de Pierre Audi comme directeur général du festival.
Pierre Audi succèdera à Bernard Foccroulle à compter du 1er septembre 2018, pour un mandat de 5 ans. Dans cette perspective, il est nommé directeur délégué dès le 1er septembre 2016 pour préparer la programmation des éditions 2019 et suivantes.
Il poursuivra le travail important mené par Bernard Foccroulle, tant en termes de diversité et d’excellence de la programmation, que d’action culturelle et de coopération euro-méditerranéenne.
Fondateur du Almeida Theatre à Londres, devenu une référence en matière de productions dramaturgiques contemporaines, Pierre Audi était, depuis 1988, directeur artistique de l'Opéra national néerlandais d’Amsterdam, dont il a fait l’une des maisons les plus prestigieuses au monde. Pendant 10 ans, il a dirigé le Holland Festival, l’un des plus importants festivals pluridisciplinaires en Europe. Il est également, depuis 2015, directeur artistique du Park Avenue Armory à New York.
Audrey Azoulay tient à rendre un chaleureux hommage à Bernard Foccroulle et aux équipes du festival pour l’action décisive menée depuis 10 ans.
Le Festival d’Aix-en-Provence est une manifestation artistique de premier plan et un vecteur d’innovation culturelle et d’éducation, porteur d’ouverture sur la diversité des œuvres, des formes et des publics. Par un engagement collectif avec les artistes et de multiples acteurs, par ses commandes et créations contemporaines, par l’interprétation d’œuvres du répertoire qui résonnent avec l’actualité, par ses coopérations internationales et ses projets dans le bassin méditerranéen, le festival démontre que l’art lyrique est en prise avec notre temps.
Biographie de Pierre Audi : http://www.olyrix.com/artistes/453/pierre-audi/biographie

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 23, 2016 5:11 PM
|
Par Dominique Darzacq dans Webtheatre
Avec "Vu de Pont" meilleur spectacle de l’année et Kings of wars meilleur spectacle étranger le metteur en scène Ivo Van Hove rafle la mise
:
Comme chaque année à cette date, l’Association professionnelle de la critique remet ses Grands Prix qui distinguent les spectacles et les personnalités artistiques qui ont marqués la saison dans le domaine du théâtre de la musique et de la danse.
Les Grands Prix qui couronnent les meilleurs spectacle de l’année sont revenus pour la musique à : « ORFEO », tragicomédie lyrique en trois actes, de Luigi Rossi dans la direction musicale de Raphaël Pichon avec l’Ensemble et le chœur de l’Ensemble Pygmalion et la mise en scène de Jetske Mijnssen. Créé à l’Opéra de Nancy.
Pour le théâtre à : « VU DU PONT », d’Arthur Miller , dans la mise en scène de Ivo van Hove créé à l’Odéon, Théâtre de l’Europe – Ateliers Berthier
Pour la danse c’est « TRISTAN ET ISOLDE : « SALUE POUR MOI LE MONDE » , chorégraphie de Joëlle Bouvier qui a été distingué (Ballet du Grand Théâtre de Genève).
Les Prix qui couronnent les meilleurs spectacles créés en province sont revenus pour le Prix Georges Lerminier (théâtre) à FIGARO DIVORCE de Ödön von Horváth, mise en scène Christophe Rauck (Théâtre du Nord, Lille / Le Monfort) et le Prix Claude Rostand (musique) à : LADY MACBETH DE MZENSK, Opéra de Dimitri Chostakovitch, Opéra National de Lyon en coproduction avec l’English National Opéra. Direction musicale Kazuchi Ono, mise en scène Dmitri Tcherniakov
Ont été également distingués pour la musique
MEILLEURE CRÉATION MUSICALE : MARIA REPUBLICA, Opéra de François Paris, livret de Jean-Claude Fall . Direction musicale Daniel Kawka à la tête de l’Ensemble Orchestral Contemporain, mise en scène Gilles Rico (Théâtre Graslin Angers/ Nantes Opéra)
MEILLEUR CRÉATEUR D’ÉLÉMENTS SCÉNIQUES : Louise MOATI avec la collaboration de Benoît Labourdette pour la mise en scène et la réalisation vidéo de la version de chambre de l’opéra La Petite Renarde Rusée de Leos Janacek. Production de l’Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical dirigé par Catherine Kollen et de TM + ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui dirigé par Laurent Cuniot
PERSONNALITÉ MUSICALE DE L’ANNÉE : Paavo JÄRVI , directeur musical de l’Orchestre de Paris de 2010 à 2016, pour l’ensemble de son action à la tête de cet orchestre
REVELATION MUSICALE DE L’ANNÉE : LE CHŒUR AEDES fondé et dirigé par Mathieu Romano
MEILLEURS LIVRES SUR LA MUSIQUE :
Essai : LA MUSIQUE AU PAS / ÊTRE MUSICIEN SOUS L’OCCUPATION par Karine Le Bail (CNRS Éditions)
Monographie : RALF VAUGHAN WILLIAMS par Marc Vignal (Éditions Bleu Nuit Collection horizons)
PRIX DE L’EUROPE FRANCOPHONE : POWDER HER FACE, Opéra de chambre de Thomas Adès, Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles. Nouvelle Production. Direction musicale Alejo Pérez Mise en scène Mariusz
Pour le Théâtre
MEILLEURE CRÉATION D’UNE PIÈCE EN LANGUE FRANÇAISE : BOVARY de Tiago Rodrigues, mise en scène de l’auteur (Théâtre de la Bastille)
MEILLEUR SPECTACLE ÉTRANGER : KINGS OF WAR, d’après Shakespeare, mise en scène Ivo van Hove (Théâtre national de Chaillot)
PRIX LAURENT-TERZIEFF (meilleur spectacle présenté dans un théâtre privé) : QUI A PEUR DE VIRGINIA WOOLF ? d’Edward Albee, mise en scène Alain Françon (Théâtre de l’Œuvre)
MEILLEURE COMÉDIENNE : Dominique VALADIÉ dans Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee, mise en scène Alain Françon (Théâtre de l’Œuvre)
MEILLEUR COMÉDIEN : Charles BERLING dans Vu du pont d’Arthur Miller, mise en scène Ivo van Hove (Odéon Théâtre de l’Europe – Ateliers Berthier)
PRIX JEAN-JACQUES-LERRANT (révélation théâtrale de l’année) : Maëlle POESY pour les mises en scène de Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, de Kevin Keiss d’après Voltaire (Théâtre de la Cité Internationale) – et Le Chant du cygne/L’Ours de Tchekhov (Comédie-Française - Studio Théâtre)
MEILLEURES CRÉATIONS D’ÉLÉMENTS SCÉNIQUES : Éric RUF, Valérie LESORT, Carole ALLEMAND pour 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, mise en scène Christian Hecq (Comédie-Française – Vieux-Colombier)
MEILLEUR COMPOSITEUR DE MUSIQUE DE SCÈNE : Alexandre MEYER pour Und de Howard Barker, mise en scène Jacques Vincey (CDR Tours, Théâtre Olympia / Théâtre de la Ville - Les Abbesses)
MEILLEUR LIVRE SUR LE THÉÂTRE : LE THÉÂTRE ET LA PEUR, par Thomas Ostermeier (Actes Sud)
Pour la danse
MEILLEURS INTERPRÈTES : Ex-aequo : :LES BALLETS DE MONTE-CARLO et Rainer BEHR
PERSONNALITE CHOREGRAPHIQUE DE L’ANNEE : Didier DESCHAMPS, directeur du Théâtre national de la danse, Chaillot
MEILLEUR FILM SUR LA DANSE : Mr. GAGA, sur les pas d’Ohad Naharin de Tomer Heymann (Sophie Dulac Distribution)
MEILLEUR LIVRE SUR LA DANSE : DANSER LA PEINTURE, de Philippe Verrièle et Laurent Paillier (Ed. Scala)
Photos Orfeo © Opéra de Lorraine, Vu du Pont ©Thierry Depagne
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 6:51 PM
|
Propos recueillis par Stéphane Capron pour Sceneweb :
photo Ruth Walz
Peter Sellars est l’invité d’honneur du 21ème Festival de Marseille. Un festival qui prend un tournant cette année avec l’arrivée de Jan Goossens, son nouveau directeur artistique. L’ancien patron du KVS de Bruxelles a de l’ambition pour Marseille. Il souhaite donner une dimension internationale à son festival. Pour l’ouverture, il a programmé Flexn à la Criée. Un spectacle détonnant et joyeux de Reggie ( Regg Roc ) Gray et Peter Sellars où l’on découvre une troupe de danseurs de Brooklyn, tous adeptes du flexing, un nouveau phénomène de danse à la croisée du R’n’B et du hip-hop, inspiré par le bruk-up jamaïcain et le son des clubs reggae.
Ce spectacle est aussi un engagement pour Peter Sellars en réponse aux injustices subies par la communauté Afro-Américaine. Ces jeunes racontent leur vie sur scène au rythme d’une bande son inouïe de Eminen à James Blake en passant par Justin Timberlake. Le public de la Criée, très mélangé, a réservé une ovation à ces danseurs très touchants, à la technique invraisemblable.
Peter Sellars, arrivé tout droit de New-York est présent à Marseille, avant de partir à Aix pour sa mise en scène de l’Opéra Œdipus Rex, opéra-oratorio d’après Sophocle sur une musique de Stravinski (les 15 et 17 juillet). Rencontre avec un metteur en scène généreux et bouillonnant !
Vous les avez rencontrés par hasard alors que vous répétiez un opéra à New-York.
Oui j’étais au Park Avenue Armory pour répéter La passion selon Saint Mathieu et ces jeunes étaient dans le bâtiment. Ils m’ont présenté leur travail. J’ai tout de suite été étonné par leur technique, par leur intensité et par leur générosité. C’est très rare dans toute l’histoire de la danse d’observer qu’elle n’est pas simplement décorative ou géométrique. Ici elle est capable de franchir des émotions subtiles et complexes. Au milieu du 19ème il y a eu le Gisèle d’Adolf Adam où la danse était capable d’exprimer la vie des paysans déprimés. Et avec le Flexn on découvre un nouveau vocabulaire capable d’exprimer la vie des quartiers. C’est drôle, rigolo, étonnant, tendre, profond et touchant.
Ces danseurs ont la particularité de posséder une très grande technique mais aussi d’avoir vécu des émotions très fortes dans leur vie personnelle.
Oh oui, dans la distribution il y a un danseur qui s’appelle Cal. C’est pour moi le nouveau Barychnikov. Il possède une grâce et une intensité. Avec un seul petit mouvement d’épaule il parvient à vous électriser. C’est le nouveau Micha, mais il ne vient pas de Riga, il vient de Brooklyn ! C’est un ancien militaire qui a combattu en Irak. Il danse avec son expérience. On l’imagine sauter avec son parachute, c’est incroyable ! Tous ces danseurs possèdent une vie intérieure très riche que l’on sent sur le plateau. Et du coup le spectacle est différent chaque soir. On ne peut pas arriver à cela avec les ballets classiques ou les créations contemporaines.
A travers les expériences de vie des uns et des autres, vous avez conçu une dramaturgie. Le spectacle raconte l’histoire des Afro-Américains, de l’esclavage aux récentes fusillades contre la communauté noire.
Il fallait dans cette période très trouble aux États-Unis, alors que les coupables des tueries sont exonérés ; dénoncer le déséquilibre du système judiciaire américain. Les jeunes noirs sont confrontés chaque jour à ce système. Alors on y met de l’humour et de la distance. On ne fait pas que se plaindre car il faut être plus intelligent que l’ennemi. On a placé le spectacle en dehors de la rhétorique sur le racisme pour ne pas se faire piéger. La danse permet de dépasser les clichés. On montre des êtres humains splendides.
Si ces jeunes n’avaient pas fait de la danse dans la rue, ils auraient pu sombrer dans la délinquance.
Oui et tout ce qui est dansé sur scène raconte leur vécu dans la rue. Au départ du projet je leur ai demandé de me livrer des anecdotes sur leur vie au travail, leur rapport avec les flics ou la justice…Tous les récits viennent d’eux. Je n’ai rien inventé. C’est un « vulcano ». C’est incroyable et ça vient des quartiers là où l’on imagine qu’il ne se passe rien.
L’Europe est en crise, crise identitaire, crise politique avec le Brexit des Anglais, l’Europe est attaquée par le fanatisme, comment de New-York vivez-vous ces évènements ?
C’est horrible ! L’Europe ce n’est pas le passé. L’Europe est déjà africaine, elle est déjà marocaine ! C’est ça votre futur ! C’est triste avec la tuerie du Bataclan de voir que quelques jeunes français ne se sentent pas d’ici. Tous ces jeunes de banlieue ne vivent pas dans le désert. Leur culture est florissante, il faut les écouter en imaginant un nouveau système éducatif en partant de leur expérience et de leur propre langage. On est capable de vivre ensemble, c’est la preuve ici à Marseille ! Votre culture est composite depuis le 12ème siècle. C’est la richesse de la Méditerranée.
Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 3:39 PM
|
Une volée de coussins jaunes filant comme des soucoupes volantes pour atterrir sur scène. Hallu ou berlue ? Réalité. Tous les ans, depuis 1990, dans les deux théâtres antiques des Nuits de Fourvière, les spectateurs jouent au frisbee avec les coussins distribués pour leur confort. Les sites gallo-romains ont la pierre dure. Un petit matelas ne fait pas de mal. Vérification opérée encore une fois, jeudi 23 juin, pour le spectacle à hululer de rire La stratégie d’Alice, de Serge Valletti. Et hop ! Le lancer de coussins souligne au moins deux choses : on est content de sa soirée et pas mécontent de se lever.
Cette localisation in situ et en plein air, avec vue magique sur Lyon depuis les hauteurs de la colline de Fourvière, signe l’identité de cette manifestation estivale, généreuse et festive, créée en 1949, et qui est sous la direction de Dominique Delorme depuis 2003.
Si le menu remplit l’assiette avec des poids lourds de la chanson et de la musique (Radiohead, PJ Harvey, Polnareff…), il reste une place dans l’estomac pour le théâtre, la danse et le cirque.
« Il n’y a qu’une trentaine de dates sur 178 représentations pour la musique, car ce sont souvent des concerts one shot, précise Dominique Delorme. Notre plus gros investissement porte sur le théâtre, qui reflète l’histoire de la manifestation. Les chanteurs et les groupes ont commencé à être programmés à partir de 1978. Quant au cirque, il a fait son apparition en 2011. »
Un écrin éphémère pour « Garrincha »
Depuis 2015, le festival a élargi son périmètre d’attaque au gré d’un réseau de lieux qui mettent en valeur son affiche pluridisciplinaire. « Nous sommes passés de 35 spectacles à 58 pendant cinquante-cinq jours, poursuit Dominique Delorme. Nous cherchons à trouver le meilleur cadre pour chaque événement. Tous ne peuvent pas se produire en plein air. Par ailleurs, l’arrivée de la Métropole de Lyon a facilité cette ouverture. »
Dix théâtres sont aujourd’hui partenaires des Nuits, dont celui des Célestins, la Maison de la danse, le Radiant-Bellevue à Caluire… Quant au cirque, il s’offre cette année un « village » rien qu’à lui dans le parc du Domaine de Lacroix-Laval. Trois chapiteaux, une guinguette et un parquet de bal sont en voie d’installation pour vivre les arts de la piste à fond, du 1er au 15 juillet.
Le désir de mettre chaque spectacle en adéquation avec un espace a fait germer une merveilleuse idée. Pour la première fois, un écrin éphémère a été spécialement conçu et construit pour le remontage de la pièce Garrincha, de Serge Valletti. Créé en 2001, à Paris, avec Eric Elmosnino, mis en scène par Patrick Pineau, ce monologue dédié au mythique footballeur brésilien Garrincha a repris du cuir.
Fiction malicieuse
Sur une idée d’Isabelle Lapierre, directrice technique des Nuits, et de son équipe qui a fabriqué l’espace, le beau préau à l’ancienne du collège Jean-Moulin a été transformé en théâtre : grosses planches de bois pour jouer l’intimité et recueillir les élucubrations arrosées au Fanta (ou prétendu tel !) de Monsieur Armand, dit Garrincha (Elmosnino).
Pour cette spéciale dédicace pleine de tendresse à tous les vrais footeux, Valletti a croisé ses mythologies familiales avec la grande histoire et c’est un régal. Il a imaginé la rencontre d’Armand Dedarride, le frère de sa mère, jeune espoir de 18 ans de l’Olympique de Marseille (OM) – il mit un but mémorable en 1938 au stade Vélodrome –, avec l’ailier droit boiteux mais ailé (l’une de ses jambes était plus courte que l’autre) du Botafogo Rio. La guerre mit fin au rêve d’Armand, l’alcoolisme à la carrière de Garrincha en 1983. Serge Valletti les réunit dans une fiction malicieuse, profondément salvatrice. Et le ballon file dans la lucarne. Et zut ! Pas de coussins à jeter : la salle a tapé des pieds sur les gradins.
Tendance épurée avec « Letter to a Man »
Toujours au rayon sportif, la patinoire Charlemagne a été investie par le spectacle Vertical Influences, de la troupe canadienne le Patin Libre fondée en 2005 par Alexandre Hamel. Si la glisse, dans sa pureté de diamant, les entrelacs et les huit de l’infini sur glace magnétisent le spectateur, les deux chorégraphies au programme restent un peu trop sages au regard du potentiel des cinq patineurs.
Tendance toujours épurée avec Letter to a Man, à l’affiche de la Maison de la danse, vendredi 24 juin. Ce monologue, tiré des journaux écrits en 1919 par le danseur russe Vaslav Nijinski (1889-1950) en train de sombrer dans la démence, interprété en solo par la star Mikhail Baryshnikov, dans la mise en scène de Robert Wilson, joue de la machine à illusions de la boîte noire.
Plus proche d’un « théâtre physique », selon l’expression de Baryshnikov, que de la danse, cette vision plastique refroidit le magma brûlant de la folie de Nijinski. Sur fond de rectangles blancs ou d’écrans colorés, la silhouette noire de l’interprète se découpe, masque et gestuelle de marionnette supra-savante pour quelques décrochages nerveux.
SERGE VALLETTI A INVENTÉ UNE LANGUE D’AUJOURD’HUI, POPULAIRE ET FAMILIÈRE, CRURE ET GOUAILLEUSE
La vitesse d’apparition et de disparition des tableaux, proche de la magie, colle aux courts-circuits mentaux du danseur russe. Quant à la bande-son sophistiquée, entre refrains populaires du début du XXe siècle et coups de griffes métalliques, trafics de voix en anglais et en russe, elle est sans doute la part la plus inconfortable de ce spectacle, exacerbant les voltes de l’esprit en déroute de Nijinski.
A l’opposé, la gonflette gourmande et hyperdrôle – et c’est encore Serge Valletti aux commandes – du spectacle La Stratégie d’Alice, écrit d’après Lysistrata d’Aristophane, dans la mise en scène d’Emmanuel Daumas, frappe fort. Sur le thème de la « grève du sexe », les femmes, qui veulent faire cesser les guerres de leurs hommes – un thème toujours d’actualité que cette fine lame de Valletti brique avec malice –, se liguent contre eux.
Pour cette farce planétaire, l’auteur a inventé une langue d’aujourd’hui, populaire et familière, gouailleuse, merveilleusement crue dans sa façon de prendre la vie la main dans le slip. Et il y en a dans la culotte de nos héroïnes et de nos héros de cette énorme saga d’amour, de sexe et de guerre.
Entre punch line en dessous de la ceinture et bordées de coups de gueule, cette équipée se révèle aussi surdimensionnée que les braquemarts en caoutchouc. Une bite est une bite, une chatte est une chatte. La stratégie d’Alice est gratinée, outrancière, burlesque, férocement juste et ne tombe jamais comme un poil sur la soupe. Et là, salves de coussins !
Nuits de Fourvière, jusqu’au 31 juillet. Sur le web : www.nuitsdefourviere.com
Monsieur Armand dit Garrincha. Jusqu’au 30 juin, 19 heures.
En tournée : Vertical Influences de Patin Libre. Patinoire Vegapolis, Montpellier Danse. 27 juin, 17 heures et 19 h 45.
Letter to a Man/Nijinski/ Baryshnikov/Wilson. Du 30 juin au 3 juillet, Opéra de Monte-Carlo.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 1:07 PM
|
Après le prix Emile Augier décerné par L'Académie Française pour "Répétition" en 2015, le prix du Théâtre 2016 lui a été remis pour l'ensemble de son œuvre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 12:05 PM
|
Communiqué de presse :
Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, en plein accord avec Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers et Patrick Devedjian, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, a donné son agrément à la nomination de Daniel Jeanneteau à la direction du Centre dramatique national de Gennevilliers.
Metteur en scène et scénographe, Daniel Jeanneteau dirige le Studio-Théâtre de Vitry depuis 2008. Formé à l'Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg et au Théâtre national de Strasbourg, il a été le scénographe de Claude Régy avant de devenir artiste associé au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, au Théâtre national de la Colline puis à la Maison de la Culture d'Amiens.
Daniel Jeanneteau a pour ambition de faire du Théâtre de Gennevilliers un lieu ouvert sur la ville, où la rencontre entre les artistes, les publics et le théâtre sera au cœur de la création.
Il travaillera avec des artistes singuliers tels que Lazare et Adrien Béal, qui seront impliqués dans l’ensemble des actions menées. Parmi ses projets, des ateliers de théâtre ouverts et gratuits, un comité de lecture animé par la comédienne Stéphanie Béghain, et Îlots, porté par Yoann Thommerel et Sonia Chiambretto, laboratoire de création et de recherche sur les mécanismes d'exclusion et de repli, rassemblant des habitants, des artistes et des chercheurs.
Il entend faire du Théâtre de Gennevilliers un lieu fertile de création, dont le rayonnement à l'international s’appuiera sur le jumelage avec le Shizuoka Performing Arts Center (Japon)
Daniel Jeanneteau succèdera le 1er janvier 2017 à Pascal Rambert, dont la ministre tient à saluer l’action exemplaire menée a la tête du Théâtre de Gennevilliers, et qui continuera, quant à lui, son parcours artistique en compagnie.
Infos pratiques
Délégation à l'information et à la communication
01 40 15 80 20
service-presse[at]culture.gouv.fr

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 6:45 PM
|
Rencontre avec Julien Gosselin, qui poursuit son adaptation de l’œuvre de Michel Houellebecq.
Par Hervé Pons pour Les Inrocks
Révélé au Festival d’Avignon en 2013 par sa mise en scène des Particules élémentaires, le metteur en scène Julien Gosselin présentera à l’automne prochain, au Kammerspiele de Munich, une nouvelle création d’après les œuvres de Michel Houellebecq Plateforme et Soumission.
“On a l’impression que Plateforme est le livre du tourisme sexuel et Soumission celui du combat entre l’islam et l’Occident, dit-il, alors que Plateforme est le livre qui questionne ce que l’on appelle salement le choc des civilisations, entre le libéralisme occidental poussé à l’extrême et les valeurs les plus traditionalistes poussées à l’extrême, celles de l’Orient. Plateforme se termine par un attentat islamiste dans un centre de tourisme sexuel.
“Aller au plus loin dans la parabole”
“Le spectacle que j’imagine commencerait par cette chose-là, la vision qui au début des années 2000 questionne une sorte de combat potentiel entre l’Occident libéral et l’islam, pour finir en 2022, vingt ans plus tard, avec l’élection d’un président musulman et un islam complètement apaisé qui gouverne la France. Il ne s’agit pas de prendre les choses à contrepied mais d’aller dans le sens de Soumission, au plus loin dans la parabole possible d’un monde où l’islam serait à la tête d’un Etat occidental. Ne pas jouer la provocation même si évidemment la matière fait réagir.”
Julien Gosselin compte traverser l’œuvre houellebecquienne en dépit de sa sulfureuse actualité, au plus proche de la matière littéraire. “Mon idée est de présenter ces deux ouvrages en trois parties et de placer le spectateur, comme je le faisais dans Les Particules élémentaires, dans la position du public de 2022 qui vit dans un pays islamique.
“Terre libérale impie et non islamisée”
“Il y a un terme arabe qui veut dire ‘terre d’impiété’ : c’est la matière de Plateforme, qui parle de la terre libérale impie et non islamisée. Il y a un autre terme qui signifie ‘terre de combat’, c’est le moment du choc et à la fin, il y a la ‘terre islamique’ pacifiée.
“Je pense qu’il faut absolument prendre Houellebecq au premier degré, véritablement. Au théâtre en tout cas. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’ironie à une ironie supposée, du cynisme à un cynisme supposé. Si l’on cherche la provocation ou le clin d’œil permanent, on passe à côté de la matière littéraire. Il faut croire Houellebecq quand il propose des paraboles complètement folles, même si celle-là est peut être la moins folle de toutes.”

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 4:43 PM
|
Une tribune d'Aiat Fayez, publiée dans Libération du 27 juin 2016
Mais où sont les comédiens d’origine minoritaire ? Une question qui dérange, d’autant plus qu’elle est posée par un dramaturge joué et reconnu, lui-même étranger.
Le théâtre français me permet de manger. Le théâtre français me permet de m’habiller. Le théâtre français me permet de me loger. Le théâtre français me permet d’acheter des livres. Le théâtre français me permet de rencontrer des gens. Le théâtre français me permet de prendre des verres avec de jolies filles. Le théâtre français me permet de trinquer avec les metteurs en scène à la victoire de la gauche, si bien que je me sens plus chez moi dans un théâtre français que lorsque je suis chez moi. On m’y accueille. On m’y applaudit. On m’y félicite. Et je serre les mains. Je fais la bise. Je salue. Je remercie. J’écoute. Je suis si gentil quand je suis aimé. Le théâtre français est ma maison. Et j’ai fini par le voir sans le voir - comme les photos encadrées que nous accrochons à nos murs et que l’on ne remarque plus. Parfois, il m’arrive de constater qu’il y a très peu de comédiens d’origine minoritaire sur la scène théâtrale française. Mais j’oublie aussi vite le constat en me regardant : après tout, ne suis-je pas moi-même d’origine minoritaire, pourtant accepté par le théâtre français ? Et quand je vois Othello joué par un acteur blanc grimé en noir, quand je découvre un comédien blanc sur scène censé interpréter un personnage arabe, quand je fais face aux dix acteurs blancs qui lisent ma pièce Naissance d’un pays alors qu’elle est explicitement destinée à dix acteurs noirs, je fais comme si de rien n’était, comme si je n’avais rien vu, comme si je n’avais pas remarqué que mon personnage noir est devenu blanc sur le plateau. Tout au plus une question, innocente : «Ce n’était pas possible de faire jouer des comédiens noirs ?» Et on me répond sur le ton de l’évidence : «J’aimerais tellement en avoir mais il n’y en a pas !» J’acquiesce alors de la tête, comme un élève abruti et docile. On en reste là.
Je pose la question des minorités dans le théâtre moins pour obtenir une réponse satisfaisante que pour sentir dans la réaction du metteur en scène la confiance qu’il m’accorde : je veux me persuader que je fais partie intégrante du système. Qu’on me considère digne d’une réponse confidentielle. J’ai sans cesse besoin d’être rassuré, d’où la question en forme de trompe-l’œil. Mais force est de constater que les metteurs en scène sont systématiquement sur la défensive en me répondant à ce sujet. Je suis disposé à entendre toutes les explications possibles et imaginables, du moment qu’ils me considèrent comme un allié. Je peux même leur donner des pistes pour répliquer de façon plus convaincante face aux tiers. Je pars d’un sentiment constructif. Je suis du côté du théâtre français. Je veille sur ma maison. Je n’y fais pas entrer l’étranger. J’ai envie de tapoter sur l’épaule des metteurs en scène, leur sourire, les appeler en ami, leur dire de rester cool : il ne faut pas prendre ma question à la lettre, ce n’est qu’un prétexte pour créer une intimité avec vous - intimité qui me permettrait de me déprendre de mon statut d’auteur étranger. De me sentir inclus et accepté par les théâtres. Mais ils ne sont pas du tout à l’aise devant mon interrogation, ces metteurs en scène. Ils ne me donnent jamais une réponse personnelle, secrète, profonde. Pour eux, la question que je pose sur les autres renvoie à moi-même : ce qui saute à leurs yeux, c’est le point commun entre les sujets de la question (les comédiens) et le sujet questionnant (l’auteur) : tous d’origine minoritaire. Ils me placent soudain contre eux, alors que je ne demande qu’à sauter dans leurs bras. Je percevais la controverse sur la place des comédiens d’origine minoritaire dans le théâtre français comme un chapitre qui m’était extérieur. Par la manière dont on réagit vis-à-vis de mes questions, je réalise qu’on range le dramaturge minoritaire que je suis dans le même sac que les comédiens minoritaires. Je suis rattrapé par une problématique que je ne demandais qu’à fuir : sans doute n’aurais-je pas dû me mettre à courir pour m’en éloigner. J’aurais mieux fait de passer mon chemin tranquillement. Elle ne m’aurait pas atteint. Dès que j’ai bougé, elle m’a eu.
Je suis des vôtres, oui ou non ? Je fais vraiment partie de la famille du théâtre français ? Ou suis-je un étranger parmi vous - un étranger agréé dont vous attendez d’enregistrer l’étrangéité de sa qualité d’étranger ? Suis-je dans vos théâtres un étranger ni totalement étranger ni vraiment intime, un étrange étranger, un étranger familier ? Etranger dans son habitus, sa façon d’être, son allure générale, sa disposition d’esprit - devenu familier par la force du temps, à force d’avoir toqué à vos portes ?
Livres parus : les Corps étrangers, l’Arche Editeur, 2011. Un autre, P.O.L., 2014
Aiat Fayez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 4:21 PM
|
Par Marie Reverdy pour offshore
Que pourrions-nous dire de plus que le « ça ira » que Louis XVI, sûr de sa stratégie politique, prononçait, dans un optimisme béat à la fin de la pièce de Joël Pommerat. Ainsi en allait-t-il du titre d’ailleurs, qui prend, une fois n’est pas coutume, le mot « fin » dans son sens propre et auto-réflexif : « Ça ira (1) fin de Louis ». Car il n’y avait pas d’erreur possible, nous étions au théâtre, face à une fiction documentée, assis dans le public lui-même fictionnalisé en membre de l’Assemblée nationale. L’emphase utopique nous portait, nourrit que nous sommes au lait de la révolution française, mère de la démocratie et de la République. Seulement voilà, la pièce rappelle bien vite à notre bon souvenir que la révolution portait également en germe un empire à venir, comme réponse à la terreur. Les positions se durcissent, se sclérosent, on retourne sa veste ou son bonnet phrygien. La dimension fictionnelle peut, en effet, nous faire éprouver l’Histoire ; non pas nous l’expliquer par les dates marquantes, mais bien nous aider à la comprendre par l’univers axiologique qui animait nos ancêtres, nous permettre de nous approprier et de vivre les contradictions, les difficultés, les paradoxes, l’espoir et la peur.
C’est à Wilhem Dilthey que l’on doit la distinction entre « comprendre » et « expliquer ». Si l’Histoire ne saurait se contenter d’une explication par des causes, c’est que le fait humain échappe aux lois déterministes. L’imprévisibilité inhérente à la l’action humaine nous interdirait, en effet, de penser l’Histoire selon les termes de la cause et de la conséquence, au risque que son exercice soit idéologique, car construit sur un présupposé quant à la nature de l’action humaine et à la prévisibilité des faits. Le fait humain n’est pas pour autant toujours intentionnel. Il est également affectif, bourré d’adrénaline qui peut forcer la rage combattive où la fine stratégie de la fuite.
Le système de représentation peut alors nous donner à voir les émotions qui pouvaient, éventuellement, faire agir les actants de la révolution. Confinant néanmoins ceux-ci dans les arcanes du passé, malgré les ressemblances notables avec notre situation présente. Le roman ou le cinéma historique fonctionnent nécessairement ainsi. Le théâtre, art de la présence par excellence, peut proposer une dimension supplémentaire.
Imaginons que nous nous soyons mis à applaudir, dans l’assistance, les discours des membres de l’Assemblée, ainsi que la répartition des comédiens et figurants dans les gradins semblait nous inviter à le faire : que ce serait-il passé de plus ? Au début nous aurions applaudi, rondement même, à toutes interventions ou presque. Puis nous aurions commencé à douter, certains intervenants se déclarant plus ou moins de droite, plus ou moins de gauche, plus ou moins enclin à la terreur, plus ou moins capables de justifier les moyens par les fins, ou exerçant plus ou moins, in fine, le débat démocratique de manière politicienne, voire politicarde. Nous aurions alors, effrayés par nous-même, applaudi à ce que l’on ne saurait, rétrospectivement, cautionner. Nous aurions eu du mal à applaudir certaines interventions que certains de nos voisins auraient applaudi, nous nous serions regardés chiens de faïence, nous abstenir d’applaudir serait devenu un acte de contestation. Nous aurions quitté la place du spectateur traditionnel qui, loin d’être passif, se croit toujours « invisible ».
Nous serions alors devenus, pour paraphraser Merleau-Ponty, des « voyants visibles », légèrement mal à l’aise, légèrement coincés dans les couloirs de l’Histoire et des évènements, légèrement enclins à vouloir déserter l’Assemblée pour boire un vin chaud, puis revenir, refuser qu’il puisse y avoir deux entractes pour favoriser l’esthétique de la fuite au détriment de celle de la pause. L’inaction serait devenue, tout comme l’action, le résultat d’un choix que nous aurions peu ou prou maîtrisé par l’exercice de la raison. Nous n’aurions pas débattu, certes, mais la présence de notre corps se serait faite pesante, nous ramenant, chacun, à nous souvenir que nous existons et que nous sommes, qu’on le veuille ou non, embarqués dans le torrent du temps. Torrent dont le lit remplit de cailloux n’est pas fait pour nous conduire vers une destination certaine, mais dont la force du courant se pense en fonction des évènements qui le constituent, nous ordonnant de choisir entre nager jusqu’à épuisement ou nous laisser emporter jusqu’à l’accident.
Marie Reverdy
Ça ira (1) fin de Louis de Joël Pommerat
donné au Printemps des Comédiens, Montpellier les 19 et 20 juin 2016

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 26, 2016 1:31 PM
|
Par Géraldine Pigault pour Mag Maa
Achevant la trilogie commencée avec D’après une histoire vraie et Ad Noctum, Christian Rizzo a créé Le Syndrome Ian à l’Opéra Comédie le 24 juin, dans le cadre du festival Montpellier Danse. Le projet lauréat du prix Fedora, s’articule comme une pièce hybride, entre le tableau et le concert, portée par neuf danseurs, explorant un autre pan des pratiques de danses anonymes chères à l’actuel directeur du Centre Chorégraphique de Montpellier: le clubbing.
Avec pour postulat de départ le souvenir d’une première sortie en discothèque en 1979 à Londres, Christian Rizzo immerge ses danseurs dans une atmosphère nocturne dont le coeur bat dans l’underground, le flow de fréquences progressant de la new wave vers le dubstep et les vapeurs d’une fumée mystérieuse comme le fog londonien à l’aube. La scène d’ouverture dissémine des paires de danseurs évoluant dans une langueur poétique, quand les néons de la scénographie dépouillée s’éclairent en motifs psychédéliques, pour un ensemble un temps mesuré, sous contrôle.
Rizzo charge l’ouverture du Syndrome Ian d’une bande son incluant des bruits entrechoquements de verres, bribes de conversations s’évanouissant dans le brouahaha d’un établissement de nuit. Cette nuit apparaît, sous les pas, déhanchés ondulatoires et placements des danseurs, glissant géographiquement dans l’espace circonscrit, entre le comptoir, la piste et caissons de basse imaginaires. Manchester, apparaît aussi. La mère patrie de Ian Curtis, la post industrielle et désoeuvrée Manchester, s’infiltre sur scène où le large balancier des bras évoque, par bribes subtiles, la gestuelle signature du leader de Joy Division. Les mouvements de groupe, de plus en plus cadencés au fil d’une musique dont les pulsations oscillent entre drum’n bass et accents dubstep, montrent cette danse fédératrice, presque sociale, où chacun trouve sa place, entre nappes de synthé et vapeurs d’ivresse. La fluidité contemplative de l’ensemble, véritable scène frontale, trouve ses lignes de rupture dans des drops, emblématiques de la culture clubbing que Rizzo parvient à rendre visible par un travail minitieux, envolé, au crescendo évoquant partiellement la progression dramatique et nostalgique de Corbjin pour la réalisation de Control.
La progressive perte de contrôle de cette danse, menée par un glissement tout aussi collectif qu’instinctif, tisse une chorégraphie de la jouissance immédiate du groupe à la fête. Mécanisme interne, distribué par un abandon de l’invidu au clan, agissant par contagion, Le Syndrome Ian construit un véritable langage poétique. Mais il est tout autant l’expression d’un état éphémère, dont le charme peut se rompre sous la menace de plusieurs facteurs, naturels ou relevant du fait de l’homme, comme le simple levé du jour ou la gentrification reléguant les clubs hors de la ville. Les créatures sombres qui surgissent l’une après l’autre, encerclant les danseurs pour finalement occuper l’ensemble du plateau, incarnent avec une ironie géniale le caractère forcément evanescent du clubbing, avec sa cartographie et ses pas perdus. Dans sa construction d’une mémoire chorégraphique, voire sociale, Christian Rizzo réveille le souvenir d’une nuit à la fin des années 70 et restitue la magie opérant uniquement, paradoxalement, en club: où c’est en y dansant seul que l’on est ensemble.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 25, 2016 6:46 PM
|
Par Fabienne Arvers pour Les Inrocks :
Metteur en scène des Particules élémentaires en 2013, Julien Gosselin est au Phénix de Valenciennes pour préparer et créer, avec les acteurs de son collectif Si vous pouviez lécher mon cœur, l’adaptation du roman de Roberto Bolaño, 2666. Répétitions marathon pour spectacle fleuve.
Plonger dans les 1 016 pages de l’ultime roman de Roberto Bolaño, 2666, ou s’immerger dans les répétitions du spectacle de douze heures que Julien Gosselin prépare avec ses acteurs en adaptant le livre a ceci de comparable qu’on ne peut plus décrocher.
Mais si l’on peut toujours interrompre la lecture quelques heures sans en perdre le fil, assister au travail de l’équipe artistique et technique soudée autour de son metteur en scène consiste à laisser filer le temps et à s’abandonner au plaisir inouï de voir s’incarner ce texte magistral.
Tout le monde a son mot à dire sur tout
Si Julien Gosselin est bien le metteur en scène et l’adaptateur du roman, le terme de “collectif” désignant le groupe qu’il a fondé avec ses acteurs n’est pas usurpé. Ici, tout le monde a son mot à dire sur tout – le jeu, la scénographie, la musique, la lumière, la vidéo – et la mise au point d’une séquence, qui nécessite un nombre impressionnant d’essais et de reprises, les intègre à mesure.
Composé de cinq blocs narratifs autonomes, 2666 gravite autour d’un point central, la ville de Santa Teresa, située à la frontière du Mexique et des Etats-Unis. Double littéraire de Ciudad Juárez, sinistrement célèbre pour ses centaines de meurtres de femmes dans les années 2000, elle aspire en un tourbillon ténébreux la succession des histoires et des personnages qu’on suit dans chaque partie et qui ne coïncident que rarement. Pour ne pas dire accidentellement.
Enquête littéraire, policière ou journalistique
Et quand cela advient, c’est moins sous la forme d’une passerelle qui donnerait l’apparence d’unifier le réel décrit par Bolaño qu’en empruntant une porte dérobée qui creuse un peu plus l’atmosphère de mystère qui baigne tout le livre. Car le motif récurrent de 2666, c’est celui de l’enquête : littéraire, policière ou journalistique.
Le 25 et le 26 mai, la troupe répète le début du spectacle qui suit le déroulé du livre. C’est la partie des critiques, ou les tribulations d’un quatuor d’universitaires unis d’abord par leur passion pour un obscur écrivain allemand, Archimboldi, puis par une relation amoureuse. Partis à la recherche de leur auteur fétiche, ils feront le voyage jusqu’à Santa Teresa.
Comme dans Les Particules élémentaires, adapté par Gosselin en 2013, il est fascinant de retrouver, quasi intacte, la substance du récit, l’ironie de Bolaño face à la noirceur du monde, en assistant à sa métamorphose dans le champ théâtral. Incarnée, sonorisée, spatialisée, la langue de Bolaño résonne avec toute sa force, son irréductible désir de se battre même si le combat est perdu d’avance. Pour redonner vie au mot de dignité que le réel s’échine à dénigrer.
2666 de Roberto Bolaño, mise en scène Julien Gosselin, le 25 juin au Phénix de Valenciennes, du 8 au 16 juillet au Festival d’Avignon et du 10 septembre au 16 octobre au Festival d’Automne à Paris

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 25, 2016 4:22 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour Balagan, son blog de Mediapart : Après des années de dur et jubilatoire labeur, Serge Valletti achève une belle histoire : la traduction de toutes les pièces d’Aristophane en Valletti moderne, soit une oralité théâtrale saucée à l’aioli. Une aventure accompagnée de bout en bout par « les Nuits de Fourvière » producteur du premier spectacle sorti de ce chapeau : « La stratégie d’Alice ".d'après "Lysistrata".
Jamais la colline de Fourvière et ses théâtres en pierres millénaires n’avaient vu autant de bites. Y avait-on, au demeurant, entendu déjà le mot bite ? On en a vu et entendu à satiété. Des vraies (une fois, en batterie), et surtout des bien turgescentes fabriquées comme des marionnettes et gonflées comme la bosse de Guignol. Certains spectateurs et spectatrices s’en sont émus.
La vulgarité comme vertu
On n’avait jamais vu et entendu ça sur les hauteurs de Lyon depuis les farces de foire du Moyen âge où le rire était et reste le meilleur allié du grotesque. Serge Valletti, qui a commis "La stratégie d'Alice", en est l’héritier via une escale chez sa grand mère (qui habite dans le vieux port de Marseille) et un arrêt pipi chez Rabelais.
Nous sommes donc en Grèce, c’est à dire nulle part. Un pays bordé par l’Afrique, le Japon et tout le Moyen Orient, autant dire que nous sommes à Marseille, seule ville du monde où la vulgarité (langagière, vestimentaire) est une vertu. Les hommes font la guerre, les femmes font la vaisselle. Entre les deux se situe le mal nommé « repos du guerrier », moment actif, voire expéditif, où l’on voit le braquemard du mari avoir ses entrées dans son épouse (dite « grosse pute ») par tous les orifices qu’il y trouve.
Depuis Aristophane et bien avant, les hommes n’arrêtent pas de faire la guerre car il y des ennemis partout. Les uns veulent envahir le pays, les autres veulent leur indépendance, les troisièmes oscillent entre la haine et l'exploitation des étrangers. Guerre du Péloponnèse, d’Algérie, du Biafra, du Viet Nam, d’Irak, d’Afghanistan, de Syrie, même combat. Les hommes tuent et trafiquent. Les familles fuient, cherchent un refuge. A la fin, mort ou vivant, le guerrier reçoit des médailles sur son plastron. Sa femme ou sa veuve n’a qu’à bien se tenir.
C’est alors qu’Aristophane, premier homme au devenir femme, rêve d'une révolte des femmes. Leurs bonhommes de maris ne sont jamais là, toujours à se bagarrer, à s’attarder au bistrot, à oublier les gosses et le pain, à regarder les matchs à la télé et à faire la guerre pour un oui, pour un non. Trop c’est trop. Elles manifestent pour la paix comme l’ont fait récemment des femmes en Amérique du sud . Ni Femens, ni féministes mais finaudes, elles organisent la grève des sexes.
Traduire pour la scène
Aristophane inaugure là une veine et un motif qui conduiront aussi bien à la « Penthésilée » de Kleist qu’à l’univers de Fellini (auquel Valletti rend hommage sans le nommer dans « La Stratégie d’Alice ») et, en poussant le bouchon, jusqu’aux Pussy riot.
Valletti reprend l’argument, traduit la pièce d’Aristophane sans s’enfermer dans une assommante traduction littérale, mais en lui offrant son verbe en rut, galopant dans la garrigue avec une faconde théâtrale qui, après près de quarante ans de service, tourne comme un moulin bien huilé. Il en sort une farine dont la qualité n’est plus à louer. Dans un article, j’ai déjà exposé les enjeux d’une telle écriture à l’œuvre dans « Toutaristophane » (dont le sixième et dernier volume vient de paraître), allant jusqu’à établir un tableau comparatif. Bref, le boulot, côté texte,ayant été fait, je vous y renvoie (lire ici). Passons au spectacle.
La pièce tourne autour du personnage central d’Alice, femme qui semble divorcée et sans enfants. N’ayant pas d’enfants à torcher et de mari à nourrir, cela lui laisse le temps de fomenter un plan pour en finir avec des guerres incessantes qui ruinent le pays, créent de la misère, des veuves et des orphelins et laissent les femmes dans l’insondable solitude de celle qui se maquille, se fait belle, devant son miroir espérant que toute cette quincaillerie, ayant achevé d’exciter l’entre jambes du conjoint , sera très vite explosée. Elle a son idée, Alice devant son miroir. Et va l’exposer à ses copines quand elles seront toutes là. C’est le début de la pièce, elles arrivent une à une, sans se presser, en mâchouillant du chwing, en traînant des savates, en jean déchiré. Beau début, bien mis en scène par Emmanuel Daumas.
Dans le rôle d’Alice, Olivia Côte. La pièce repose beaucoup sur cette actrice qui ne manque pas de ressort, de corps et de voix. Elle en impose. Ses copines, Judith Siboni (Victorine), Anne Suarez (Mireille) et Magali Levèque (Aïchina) l’accompagnent vigoureusement dans son combat que les hommes tardent à prendre au sérieux à commencer par le commissaire de police (excellent Nazareth Agopian).
Le monde des hommes à l'envers
Toute la force de la pièce tient dans son renversement. Même en matière d’injures les femmes clouent le bec aux mecs. Quand le metteur en scène Emmanuel Daumas, pousse la pièce dans le grotesque et la farce, il touche juste. Quand il la « boulevardise » ou veut faire « actu » (femme en tchador), il fait fausse route. C’est le cas de la fin du spectacle, mi tchekhovienne, mi veillée au bivouac, là, on tombe dans le contresens.
Valletti est un babil énergétique qui met les corps en fête. Pour preuve ce moment de bascule au milieu de la pièce où les femmes, du haut de leur piédestal, se déshabillent et où les hommes, en bas, en font autant. Les hommes ont la nudité flasque, les femmes l’ont orgueilleuse. Alice et ses copines dominent la situation : « c’est sans rien que nous sommes les plus fortes ».
Le dernier volume de « Toutaristophane, rassemble « Sacré Bonhomme » d’après « Les Acharniens », première pièce connue d’Aristophane qui en aurait écrit une quarantaine. La second pièce « On entend des flûtes au loin » est composée à partir des fragments, parfois très courts, qu’il nous reste des pièces perdues de l’auteur grec. Bien entendu Valletti y ajoute son grain de sel, son aioli, d’ailleurs il est question de bouffe et de théâtre. Au beau milieu de la pièce entre en scène l’adaptateur qui va longtemps tenir le crachoir devant le public pour expliquer sa démarche. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas « adapté » mais bel et bien « inadapté » le théâtre d’Aristophane. Jolie formule.
Toute cette aventure avait commencé sur les bans du collège où l’on imposait aux petiots l’étude des « Plaideurs », seule comédie de Racine, zig bien mieux calé en tragédie. Le fait que cette pièce soit adaptée d’une pièce d’Aristophane attisa bientôt la curiosité de Valletti , et après avoir domestiqué sur le papier l’oralité de son écriture au fil d’une tripotée de pièces, il se pencha sur le cas Aristophane. Comme c’était un puits sans fond, il tomba dedans. Rien d’étonnant à ce que la dernière pièce retrouve, in fine, l’enfance avec la chèvre et monsieur Seguin, peut être en écho au marseillais "degun". L’oeuvre de Valletti revient toujours au Vieux port.
« La stratégie d’Alice » au théâtre, Nuits de Fourvière (Lyon) 21h30, jusqu’au 26 juin.
Re-création de « Monsieur Armand dit Garrincha » de Serge Valletti par Eric Elmosnino, mise en scène de Patrick Pineau, au Préau Jean Moulin, Nuits de Fourvière (Lyon) , 19h, jusqu’au 30 (sf le 28)
Le riche programme des Nuits de Fourvière continue jusqu’à la fin juillet
« Sacré Bonhomme » suivi de « On entend des flûtes au loin », sixième et dernier volume de « Toutaristophane » par Serge Valletti, Editions l’Atalante, 238p., 14,50 euros
Photo : Scène de "La stratégie d'Alice" © Loll Willems

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 24, 2016 8:09 AM
|
LE MONDE | 24.06.2016 | Propos recueillis par Aureliano Tonet, Clarisse Fabre et Laurent Carpentier
Audrey Azoulay parle d’une voix posée, le regard concentré, appuyant ses propos de ses longs doigts fins. Plus discrète que ses prédécesseurs rue de Valois, cette énarque de 43 ans, passée par le Centre national du cinéma (CNC) puis l’Elysée, nommée ministre de la culture et de la communication le 11 février, n’a qu’une petite année pour réconcilier le monde de la culture avec une gauche en déroute. C’est court.
Lire aussi : Audrey Azoulay, la ministre du président
Qu’est-ce qui vous a fait accepter ce poste, à un an de la présidentielle ?
C’est la plus belle mission qui soit. La France serait différente sans la politique culturelle qui a été menée depuis soixante ans. C’est notre force, notre colonne vertébrale – même si elle a sa fragilité.
A son arrivée, chaque ministre répète le même discours : la culture rapporte de l’argent et protège contre la barbarie. Est-ce aussi le vôtre ?
Economie et culture ne s’opposent pas, elles se nourrissent : c’est là ce qui fait la finesse de notre politique culturelle. Quand on met en place un crédit d’impôt sur le cinéma, on pérennise toute une industrie, qui va ensuite servir la création.
Mais l’impact sur l’économie ne doit pas être la justification première de notre politique culturelle, sinon on la traiterait au ministère de l’industrie. La culture, c’est ce qui nous lie, ce qui fonde notre humanité. On a trop pris l’habitude de tout justifier en termes économiques, de marché unique, y compris notre politique culturelle.
Lire aussi : Création, architecture, patrimoine : trois ministres pour une loi
Un quinquennat, trois ministres, une même politique. Pourquoi dans ce cas avoir changé le titulaire du poste ?
Ce n’est pas à moi qu’il faut poser la question. Il y a une continuité de fond – je la revendique –, même si chaque ministre apporte sa spécificité. Prenez la loi « liberté de création, architecture et patrimoine » : elle était dans le projet du candidat Hollande, elle a germé avec Aurélie Filippetti, elle a été défendue au Parlement par Fleur Pellerin, puis je l’ai reprise jusqu’à son adoption il y a quelques jours.
J’ai tenu à ce qu’on y apporte deux modifications. Tout d’abord, sur le patrimoine : nous sommes arrivés à un texte à la fois protecteur et modernisateur, qui réaffirme le rôle de l’Etat. Ensuite, sur la diversité musicale à la radio, en rendant les quotas de chansons francophones plus contraignants.
La culture, c’est ce qui nous lie, ce qui fonde notre humanité. On a trop pris l’habitude de tout justifier en termes économiques
N’est-il pas plus urgent d’intervenir sur les plates-formes de streaming ?
Les radios continuent de jouer un rôle prescripteur majeur. Et la plupart des applications, de Spotify à Deezer, ont compris tout l’intérêt de proposer une diversité. Reste une question plus générale sur les plates-formes qui font de la recommandation automatique : comment amener de la diversité alors que l’algorithme vous ramène toujours au même ? « Vous avez aimé ça, donc vous aimerez ça… » C’est vrai pour le cinéma, la musique…
On a mis des années à convaincre Bruxelles qu’il fallait encadrer ce sujet. On vient de remporter une victoire au dernier Conseil européen des ministres : la Commission a annoncé une directive nouvelle sur les « services de médias audiovisuels », dans laquelle elle va fixer un objectif d’exposition minimum des œuvres européennes à tous les services à la demande.
Ne faudrait-il pas être plus offensif ?
En matière de respect du droit d’auteur et de financement de la création, la France est aux avant-postes, en Europe et ailleurs. On travaille aussi sur l’adaptation de la Convention sur la diversité de l’Unesco de 2005 à l’ère numérique. Le débat sur les quotas et la diversité, c’est un combat moderne.
Audrey Azoulay, ministre de la culture, le 9 juin.
Quelles sont les priorités qui figuraient en tête de votre lettre de mission ?
La jeunesse et les territoires. Il faut rendre nos équipements culturels plus accessibles aux jeunes. C’est pourquoi nous allons accompagner financièrement les municipalités qui ouvrent leurs bibliothèques le dimanche, afin que les familles puissent les fréquenter. C’est une première.
L’éducation artistique était déjà une priorité en 2012...
On a encore beaucoup à faire, même si les crédits du ministère de la culture, en la matière, ont augmenté de 80 %. Il y a encore trop de zones oubliées. A la rentrée, nous lancerons une grande opération avec [la ministre de l’éducation nationale] Najat Vallaud-Belkacem : nous allons installer une centaine de résidences d’artistes dans des écoles situées dans les territoires les plus fragiles.
La culture nécessite une pédagogie, une ambition, que les élus doivent porter
Une centaine, c’est peu…
C’est complémentaire aux initiatives qui existent déjà. Travailler sur l’enfance, l’adolescence, c’est une responsabilité première.
L’Etat s’engage, dites-vous, mais des élus locaux réduisent les budgets, comme à Quimper ou à Grenoble, et fragilisent ce maillage territorial…
Ce désengagement, je le rattache à la tentation populiste ambiante, qui nivelle les discours par le bas. La culture nécessite une pédagogie, une ambition, que les élus doivent porter. L’Etat peut réparer et accompagner, par endroits. Mais il ne peut pas se substituer complètement. Il y a encore des élus qui font le choix de la culture : les pactes culturels initiés par Fleur Pellerin, dans les villes qui s’engagent à maintenir leurs crédits pendant trois ans, nous les maintenons. Et nous les étendons aux régions qui voudraient s’engager sur une politique ambitieuse. A Quimper, nous discutons actuellement avec la région pour soutenir un projet similaire ailleurs en Bretagne.
Les mots « verrue », « élus irresponsables » ont été tagués sur le théâtre du château d’Hardelot, dans le Pas-de-Calais. La France est-elle fâchée avec sa culture ?
Partout dans le monde, la culture a été visée. En Irak, en Syrie, à Orlando (Floride) d’une certaine façon… Justement parce qu’elle est puissante et porte des valeurs. Ceux qui nous attaquent savent que c’est là qu’il faut frapper. Attention à la tentation populiste, qui gagne du terrain. Ces jugements hâtifs finissent par se traduire en actes.
L’accord sur l’intermittence sera mis en œuvre dès juillet par décret
Vous visez Nicolas Sarkozy, qui défend une culture « vecteur d’identité commune »?
Oui… Je pense aussi à Quimper. Ces élus ont un rapport à la culture différent du nôtre. Le dénigrement de l’art contemporain, ce n’est pas nouveau. On parlait déjà comme cela du temps de Picasso.
En vous nommant, François Hollande et Manuel Valls ont-ils choisi la diplomate ?
Détrompez-vous, je ne suis pas faite que de douceur… Mais, sans dialogue, nous n’aurions pu aboutir à l’accord signé sur l’intermittence, par exemple.
Ce dossier est donc clos ?
Il l’est. Et l’accord sera mis en œuvre dès juillet par décret. Je veux saluer les syndicats de salariés et d’employeurs du spectacle qui ont conclu un accord historique. Il sécurise le régime de chômage des artistes et des techniciens et produit des économies substantielles. Nous travaillons également sur la création d’un fonds, qui permettra de créer des emplois durables dans le spectacle.
Un fossé s’est creusé entre le gouvernement et les milieux culturels, qui ont mal digéré les atermoiements sur les migrants, la déchéance de nationalité, etc. Comment remédier à ce désamour ?
L’engagement est consubstantiel à la fonction des artistes. Ils ne sont pas là pour défendre un consensus. Par nature, ils dérangent, s’opposent, et montrent aussi leur générosité, comme ce fut le cas lors du Mariage pour tous ou de la COP21.
A un an des élections, n’est-il pas stratégique de les ramener sous la bannière du Parti socialiste ?
Ce serait une erreur de les instrumentaliser ainsi. Personne ne m’a donné cette mission, je vous l’assure, et je ne l’aurais pas acceptée, parce qu’elle n’aurait pas de sens. L’utilitarisme, en matière culturelle, est un très mauvais calcul.
Aureliano Tonet
Journaliste au Monde
Laurent Carpentier
Reporter culture
Clarisse Fabre
Reporter culture et cinéma

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 23, 2016 5:34 PM
|
Par Clarisse Fabre dans le Monde :
Voir l'article sur le site du Monde avec le reportage photographique : http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/06/22/la-villette-cultive-ses-jardins_4955619_3246.html#dSDSVzuiRsa8TmRq.99
Pour réussir un beau jardin, il faut parfois ressortir les vieux outils. A La Villette, la grelinette, inventée par André Grelin en 1963, redevient à la mode. On découvre ce large râteau à deux manches dans la cabane des Jardins passagers, merveilleux endroit consacré à la pratique du jardinage. Et l’on apprend que la grelinette permet de travailler la terre en douceur, sans perturber l’écosystème…
Voilà une belle métaphore pour résumer la mission de Didier Fusillier, nommé en juin 2015 à la tête de l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La Villette : l’ancien directeur artistique de Lille3000 fourmille d’idées pour faire rayonner ce parc urbain et culturel, situé dans le 19e arrondissement de Paris, mais il ne doit pas trop brusquer la « culture maison ». Un an après son arrivée, les équipes de La Villette – 200 permanents, plus des salariés intermittents et autres employés ponctuels – saluent son projet mais, certains l’avouent, le personnel est sur les rotules. « Je préfère voir grand au début, quitte à devoir réduire la voilure ensuite », avait annoncé Didier Fusillier au Monde, en juin 2015, au lendemain de sa nomination.
La liste des nouveaux projets est longue : bientôt une miellerie pour les apiculteurs parisiens, et tant d’autres choses… Dès son arrivée, Didier Fusillier rêvait d’une grande fête autour du foot, avec l’actualité de l’Euro 2016. Voici donc Foot Foraine, un événement inauguré le 5 juin, à la Grande Halle, combiné avec l’arrivée de manèges, autos tamponneuses et tirs à la carabine. C’est le retour de la Grande Halle comme lieu d’exposition et de vie – l’espace est par ailleurs loué et privatisé.
Sous la circulation, l'espace périphérique
Dans ce quartier populaire, où vivent beaucoup de familles, le patron de La Villette avait une autre priorité : développer son offre « jeune public ». Et Little Villette a vu le jour : ce lieu consacré à l’enfance, qui a ouvert le 21 mai, est situé dans un bel espace modulable aménagé dans le pavillon Paul-Delouvrier. Une multitude d’activités gratuites ou payantes y sont proposées, depuis l’historique atelier de fabrique du pain (créé il y a quinze ans) jusqu’aux plus récentes (cirque, photo, projection de courts-métrages, etc). L’énergique Jasmine Francq, qui pilote Little Villette, s’attend à accueillir plus de 30 000 enfants par an et prépare le prochain Little festival du livre. Ce nouvel axe rejoint – ou télescope, l’avenir le dira – la programmation du théâtre tout proche, le Paris-Villette. « Tant que Fusillier ne nous mange pas, tout va bien ! », souligne avec humour Valérie Dassonville, qui dirige le Paris-Villette avec Adrien de Van. « Nous travaillons en bonne intelligence. Didier nous a aidés pour que le Paris-Villette soit mieux identifié dans le parc. L’an prochain, on monte un projet avec Joris Lacoste, en partenariat avec La Villette et le Festival d’automne », ajoute-t-elle.
« De nouveaux axes »
Le directeur de la programmation de La Villette, Frédéric Mazelly, résume le tournant opéré par le nouveau directeur : « On n’est pas en train de tout réinventer, mais on travaille sur de nouveaux axes. Par ailleurs, Didier Fusillier a souhaité mettre fin aux expositions monographiques, du type de celle qui avait été présentée autourde l’artiste suisse Felice Varini, en 2015, pour inviter des collectifs », explique-t-il. Une politique d’abonnements a été instituée à la rentrée 2015 – La Villette compterait à présent 2 600 abonnés. C’est comment qu’on freine ?, ont demandé les instances représentatives du personnel. En accord avec la direction, un cabinet de conseil – qui n’a pas encore été choisi – sera chargé de réfléchir à de nouvelles méthodes de travail, « pour accompagner le projet dans la durée », confirme la directrice générale de La Villette, Marie Villette.
Cette effervescence vise aussi à garder l’esprit du lieu : comment préserver l’utopie de ce parc dessiné par l’architecte Bernard Tschumi sur le site des anciens abattoirs et ouvert au public en 1986 ? La Villette est l’incarnation d’une certaine diversité sociale, ethnique et culturelle. Des populations variées partagent le même tapis d’herbe. Le pari était de faire cohabiter tous les arts, du plus officiel au plus spontané, dans un espace conçu pour les loisirs. De fait, les 55 hectares du parc servent d’écrin au Zénith (ouvert en 1984), au Théâtre Paris-Villette (1986), à la Cité des sciences et de l’industrie (1986), au Cabaret sauvage (1997), à la Philharmonie (2015), etc. Au total, ces lieux attirent 9 millions de visiteurs par an, sans compter les usagers du parc.
L’univers cru des anciens abattoirs de La Villette, fermés en 1974 et immortalisés dans Le Sang des bêtes (1949), de Georges Franju, a cédé la place au végétal. Combien de jardins, de prairies, de pelouses ? Les fleurs se mêlent au verbe des artistes. « Jonquilles, ça rime avec filles », a lancé un adolescent, lors d’un atelier sur les « Chansons fleuries », raconte Nicolas Boehm, responsable des Jardins passagers. Un autre jour, un slameur : « Grelinette, ça sonne bien, je prends ! » A l’extrémité est du parc, de l’autre côté du périphérique, la Halle aux cuirs, où l’on travaillait jadis les peaux des bestiaux, est devenue un lieu de fabrique artistique. Un appel à projets a été lancé et sera clos fin juin.
Le millefeuille de La Villette
Nul autre parc ne concentre une telle présence artistique. A La Villette, les rêves sont infinis, mais comment les réaliser en 2016, dans un contexte post-attentats, de surcroît contraint économiquement ? Didier Fusillier fonctionne sur le mode « do it yourself »– fais les choses par toi-même. Devant la Grande Halle, un Superman à moitié fondu – œuvre de Mojoko et d’Eric Fœnander – porte ce titre : No One Can Save Us Now (2012). Personne ne peut nous sauver à présent. Alors on y va !
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...

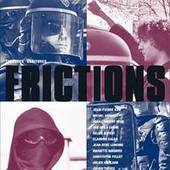

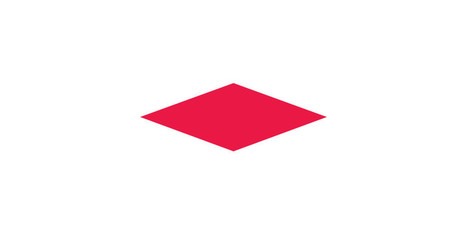

![[Interview] Marc Le Glatin, tête pensante du Théâtre de la Cité Internationale | Revue de presse théâtre | Scoop.it](https://img.scoop.it/2_zoyFxeRaQaru1LPRdrJTl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9)
























