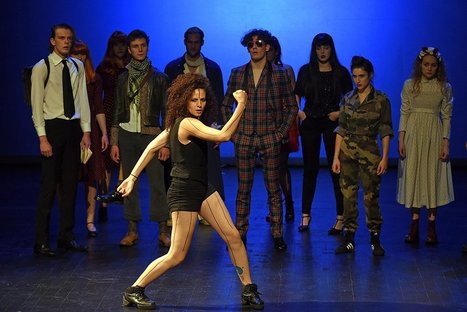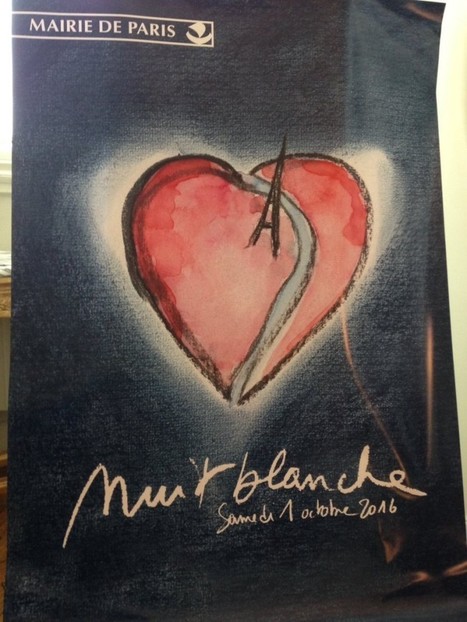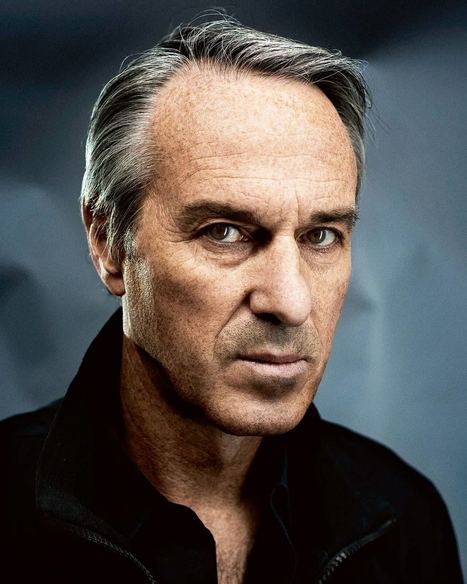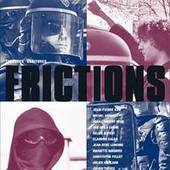Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 7:30 PM
|
Par Alain Piffaretti dans Les Echos
« Le mois Molière », festival de théâtre et de musique qui se déroule chaque année à Versailles en juin, est le fer de lance de la politique culturelle de la ville. Une politique considérée comme vitale par la cité.
Faire rayonner Versailles autrement que par son château est une gageure pour son maire. Ce mois-ci, comme tous les ans, la ville organise un festival de théâtre et de musique baptisé « Le mois Molière ». Le fer de lance d'une politique culturelle propre à la ville, qui s'émancipe volontiers des thématiques du château. « Pour la ville, le château constitue une chance. Mais il y a toujours le risque d'être éclipsé, d'autant que les moyens de communication ne sont pas de même niveau », analyse François de Mazières, député-maire de Versailles, ancien conseiller culturel de Jean-Pierre Raffarin et ancien patron de la Cité de l'architecture. Selon la municipalité, l'enjeu n'est pas seulement symbolique ! Pas de dynamisme économique sans vie culturelle à offrir aux habitants et aux salariés des entreprises que la ville aimerait séduire. Pour François de Mazières, les sociétés qui s'installent dans l'agglomération sont aussi attirées par son image de créativité et de culture. Blizzard Entertainment, l'un des leaders mondiaux des jeux vidéo (World of Warcraft, Starcraft...), a par exemple déménagé son siège européen dans la cité historique en 2011. La qualité de l'offre culturelle à Versailles (théâtre, musique, danse) a joué dans la décision du patron du groupe. Avec plus de 500 salariés, Blizzard est aujourd'hui l'un des plus importants employeurs privés de la ville.
Concurrence
Les enjeux autour du Grand Paris renforcent les ambitions de Versailles. « Le maire nourrit des espoirs culturels à l'échelle du Grand Paris. Même s'il ne fait pas de déclarations tonitruantes sur le sujet, il compte imposer la ville comme l'une des capitales culturelles du département, voire de la région », soutient l'un de ses proches. Une volonté de faire de Versailles un « Oxford français », renforcée par la concurrence de Saint-Quentin-en Yvelines. La « ville nouvelle » qui possède depuis le début des années 1990 un théâtre au statut de scène nationale, se voit bien aussi incarner le renouveau culturel dans le département. En face, Versailles, qui comptait déjà un conservatoire régional, une école d'architecture, une école du paysage, des chorales réputées, etc., mise donc sur son festival qui attire désormais plus de 100.000 spectateurs chaque année. Organisé dans une multitude de lieux (jardins municipaux, parcs, cours, salles de spectacle et... grandes écuries du château), il met en scène les troupes de la ville (8 compagnies sont en résidence à l'année) et celle du théâtre Montansier, à côté d'autres talents. Certaines troupes ont été repérées au Festival d'Avignon par le maire lui-même, qui, fait rare, endosse le costume de directeur artistique, entouré d'une équipe de bénévoles. « Le Festival s'adresse au plus grand nombre et participe ainsi à la grande vitalité culturelle de la ville », insiste François de Mazières. Dans ce domaine, comme dans d'autres, Versailles est loin de se cantonner au répertoire classique. On connaît le succès planétaire des groupes Air et Phoenix. Et, cette année, le groupe d'électro-pop Saint-Michel, en résidence musicale à Versailles, s'est d'ailleurs produit dans le cadre du mois Molière.
À NOTER
La grande majorité des 350 représentations du mois Molière sont gratuites. Le budget consacré à l'achat des spectacles représente environ 200.000 euros.
Alain Piffaretti

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 6:26 PM
|
Une exception grenobloise ? par Elise Colin-Madan, publié dans Les Antennes
Monsieur le Maire de Grenoble, Je ne peux plus faire autrement que de vous écrire.
Grenobloise, je le suis. Je proviens d’une espèce bien particulière qu’on appelle les « chauvins ». J’ai grandi à Grenoble, ma famille et mes amis sont à Grenoble, j’ai fait ma scolarité et étudié à Grenoble. Mon parcours s’est poursuivi à Paris pour des raisons professionnelles et universitaires, mais la ligne TGV Paris-Grenoble reste ma meilleure amie, dans l’attente d’un retour rapide dans la capitale des Alpes.
Grenobloise chauvine certes, pourtant je ne fais pas de ski, je n’aime pas la neige, je n’ai jamais apprécié faire de la montagne hormis la Bastille et, d’accord, j’aime quand même les noix et les gratins dauphinois. Vous me direz alors : pourquoi cet amour de Grenoble ? Et je répondrais, précisément parce que je l’estime être « une ville émancipatrice », que vous semblez vous aussi porter de votre vœu.
Grenoble épanouit car elle est proche de l’équilibre parfait : une ville grande mais pas trop, une ville avec un accès facile à la nature mais aussi avec un vrai centre-ville, une ville où l’on se déplace facilement, une ville étudiante mais pas que, une ville à la fois scientifique et culturelle, une ville avec quatre saisons bien marquées, une ville géographiquement bien située à distance raisonnable de la mer, de l’Italie, de la Suisse et de Paris, en d’autres termes, une ville riche de sa diversité, de sa pluridisciplinarité et de sa mixité.
Grenoble historique, c’est aussi ainsi que j’aime ma ville. En l’occurrence, dans le cas de Grenoble, l’histoire ne se voit pas, elle se porte, car c’est avant tout une histoire culturelle et récente dont elle est le symbole : frémissement révolutionnaire, écrivain romantique, terre de Résistance, berceau du planning familial, innovation urbaine, et j’en passe. C’est aussi son histoire imbriquée, d’abord dans celle de la décentralisation culturelle, puis de la démocratisation culturelle et de l’utopie urbaine, qui a permis une application concrète d’une culture émancipatrice à l’échelle d’une ville, notamment à partir de l’élection d’Hubert Dubedout à la Mairie en 1965. Notons à cet égard le rôle clef qu’a pu jouer la ville dans la théorisation des politiques culturelles, et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui encore l’Observatoire des Politiques Culturelles se trouve précisément à Grenoble. Son fondateur, René Rizzardo, fervent défenseur de la démocratie participative et militant à Peuple et Culture, n’a jamais envisagé les arts et la culture autrement que comme des espaces de vie démocratique et d’expression citoyenne. D’après lui, l’évaluation des politiques culturelles ne devrait jamais « [être] détournée de sa finalité démocratique », permettant ainsi de « [guetter] ce qui bouge pour sans cesse faire aussi bouger les lignes » 1 . Les exemples d’innovations dans le domaine culturel grenoblois ne manquent pas, mais quelle fierté, d’un temps que je n’ai pourtant pas connu, le 13 février 1968, de savoir qu’André Malraux, Ministre de la Culture, inaugure la Maison de la Culture avec ces mots : « la première raison d'être de cette Maison de la Culture, c'est que tout ce qui se passe d'essentiel à Paris doive se passer aussi à Grenoble ». Une Maison de la Culture intimement liée à une vision culturelle ambitieuse et porteuse d’un idéal démocratique : Catherine Tasca, directrice de 1973 à 1977 deviendra Ministre de la Culture et Michel Orier, directeur de 2002 à 2012, sera nommé Directeur général de la Création artistique au Ministère de la Culture. Vous admettez que, « fondamentalement, […] la décentralisation a dû bon » 2 . Grenoble est une ville qui a toujours pensé la culture, et qui s’est donnée les moyens de porter ses idées au sommet de l’Etat pour les mettre en application.
Evoluant dans ce bouillon-grenoblois-socio-culturelle-favorable, entre MJC, sorties scolaires et évènements plein air, c’est ainsi que je découvre Joël Pommerat, il y a 10 ans, grâce à l’option théâtre du lycée Stendhal. Cette même année s’éveille en moi le goût du débat, de l’échange, de la politique, m’amenant à m’investir dans le club UNESCO de ce lycée et ce principalement par la voie théâtrale. Me voici aujourd’hui, 10 ans après, au moment même où mes idéaux sont profondément ébranlés par une dérive chronique des organes politiques, les yeux bien écarquillés, à lire dans le journal Libération : « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle » 3 . Quelques vents glacés m’étaient déjà parvenus, mais là, ce fut une douche vraiment très froide.
Vous préconisez souvent le débat : commençons-le.
« Culture » est un des mots de la langue française les plus polyphoniques. A la municipalité de Grenoble, on parle de « cultures » au pluriel. Je n’ai rien contre, au contraire, je pense que l’utilisation du pluriel est toujours plus juste au regard de la multiplicité des usages. Plusieurs sens cohabitent : la culture comme altérité, comme interculturalité et la culture comme valeur artistique, avec l’idée d’ouvrir l’expression, la créativité. C’est principalement sur ce deuxième sens que je souhaite vous interpeller, car il m’apparaît indispensable et fondamental pour le bien être d’une ville, de sa population et de sa démocratie locale, de bien s’entendre sur les définitions culturelles et d’envisager les arts et la culture comme structurellement capables de donner à voir pour laisser à penser.
A la municipalité, une commission présidée par l’« Adjointe Cultures » est nommée : « Commission Temps libre et Savoirs : Culture, Sport, Education, Jeunesse, International ». Comme le disait le socialiste Michel Durafour en 1961, à l’époque Adjoint au Maire de SaintEtienne : « Nous posons, nous, le problème du "loisir supérieur", c’est-à-dire le loisir qui a pour but non seulement le divertissement de l’homme, mais son enrichissement, le développement de toutes ses facultés et en particulier son jugement, seul garant de sa liberté » 4 . Il faut donc bien s’entendre sur la définition de « loisir », il ne s’agit pas là simplement d’un luxe, mais bien d’un des aspects garants de la vitalité démocratique. Votre commission a choisi d’associer la culture au « temps libre » et aux « savoirs ». La démonstration précédente aura, je l’espère, démontré que la culture, tout comme les savoirs, ne peut pas être associée uniquement au temps libre, car elle doit être structurante et non périphérique. C’est du moins une vision qui a historiquement été défendue par la gauche et plus encore par l’extrême gauche. Cette vision n’est pas infondée, car où peuvent réellement se dérouler les débats si ce n’est au cœur des espaces culturels ? Quels meilleurs endroits que ces derniers pour développer la ville émancipatrice ? Ces espaces culturels sont des lieux de rencontres, de propositions, d’échanges, de bouillonnement d’idées, de mixités. En dehors des transports publics et des espaces commerciaux, il existe peu de lieux où tout un chacun se rencontre, peu de lieux aussi favorables et propices que les espaces culturels pour porter le débat citoyen que vous désirez : la culture étant par essence socialisation. Vous l’admettez d’ailleurs vous-même : « La culture est un formidable espace public » 5
Dans cette logique, comme l’explique Jean-Claude Richez : « l’éducation populaire procède d’une double démarche qui favorise l’accès du plus grand nombre à la culture (à la culture comme condition d’exercice de la citoyenneté), en même temps qu’elle met en commun des savoirs et des compétences (la notion d’enseignements mutuels et d’éducation active est consubstantielle au programme et à la démarche d’éducation populaire) »6 . Michel Durafour, fervent défenseur de l’éducation populaire, estimait d’ailleurs que, étant donné que « la culture est le complément naturel de l’école », les subventions à l’éducation et à la culture devraient être identiques7 . Jamais aucune collectivité n’a réussi un tel pari, et encore moins l’Etat, et l’on s’extasie lorsque la part réservée à la culture dépasse 1% de son budget. Pourquoi un tel décalage ? Sans doute parce que le plus souvent le terme « loisir » renvoie la culture à quelque chose de non prioritaire, un amusement superficiel à l’heure où la priorité est aux crises. Ainsi la vision fondamentale de la culture comme garante du bon fonctionnement démocratique est biaisée. Et vous semblez tomber vous-même dans le piège : « je prône un modèle de sobriété et de frugalité, notre objectif, c’est d’avoir des activités économiques correspondant à nos besoins fondamentaux (mobilité, sécurité, éducation, alimentation) »8 , ou encore, « la culture avoisine 1% du budget de l’Etat, voilà qui relativise l’idée d’un modèle "dispendieux" » 9 , allant même parfois jusqu’à une forme de chantage et une mise en concurrence des priorités : « on n’est pas avec des acteurs culturels qui vont nous dire, sanctuarisons la culture, et tant pis, les 20 millions [d’économie] faites-les sur le social ou faites-les sur l’éducation ». Et pourquoi la culture serait-elle toujours la première à trinquer ? Monsieur le Maire, permettez-moi de reprendre vos termes : la culture est un « besoin fondamental ».
Pourtant, votre municipalité n’a pas fait exception et a indéniablement attaqué le secteur culturel financièrement, ce qui est aussi, de fait, une attaque politique. Vous refusez d’admettre ces baisses de subventions comme un signe politique et répétez10, comme un argument d’autorité, que votre contrainte est d’ordre économique, l’endettement de Grenoble étant fort. Seriez-vous donc en train de nous dire que vous appliquez une politique d’austérité ? Vous dénonciez pourtant dans le préambule de vos 120 engagements les « logiques austéritaires qui visent à restreindre toujours plus l’intervention publique » 11 . Vous dénonciez encore cette politique austéritaire sur France Culture tout récemment : « nous vivons je crois une glissade dangereuse, que ce soit avec l’Etat d’urgence, que ce soit avec les politiques d’austérités » 12 . Vous pourriez me rétorquer que le principe de réalité est plus fort que la volonté politique, et je vous répondrais « mais alors, que garantit votre politique plutôt qu’une autre ? Quel est même l’intérêt d’un débat politique ? ». Êtes-vous en train de nous faire l’aveu que la puissance monétaire a vaincu le pouvoir politique ? Ou alors distinguez-vous la politique nationale de la politique locale ? Quel est le sens de « Grenoble, une ville pour tous » dans ce contexte délétère ? Sans vouloir vous accabler de questions, je garde toutefois à l’esprit, qu’en 1983, quand François Mitterrand met en place la rigueur, le Ministère de la Culture n’est pas impacté. Il s’agissait là d’un signe, d’un signe lié à des valeurs, des valeurs dites « de gauche ». Sans doute est-ce ce manque de signes clairs dans votre municipalité qui brouille les cartes en laissant le sentiment d’une politique de plus en plus illisible. Car de quel bord politique est cette municipalité ? La question se pose quand vous semblez sous-entendre que la politique culturelle ambitieuse de ces dernières années est responsable de cet endettement : « La présence finalement extrêmement forte de scènes labellisées, elle n’est pas que le fruit du miracle et de la décentralisation culturelle, elle est aussi le fait d’une réalité aujourd’hui économique de la ville de Grenoble qui a la fiscalité la plus élevé de France, le 5e endettement de France pour les villes de plus de 100 000 habitants, et qui a une épargne nette négative, donc qui doit en l’espace de 3 ans trouver 20 millions d’euros d’économie » 13 . Sans commentaire…
Vous parlez alors de coopération, de mutualisation, comme si ces pratiques économiques, de même que les pluri-financements, n’existaient pas déjà depuis longtemps dans le milieu culturel. Il n’y a rien de révolutionnaire dans ces fonctionnements que vous suggérez et ils ne sont pas parvenus jusque-là à compenser les désengagements de l’intervention publique. A vous lire ou vous écouter, il semblerait que pour vous la culture soit avant tout un coût : vous justifiez les baisses de subventions à la MC2 en considérant que la ville est déjà bien gentille de mettre « le bâtiment à disposition de la structure, pour un montant non facturé de 1,7 million d’euros » 14 ; vous vous scandalisez des précédentes gestions des espaces culturelles, notamment au Théâtre de la Ville où « la réalité [à votre arrivée était de] 100 euros de subvention par ticket vendu ! Voilà pourquoi [vous avez] voulu changer le mode de gestion » ; et vous continuez en expliquant, qu’« à Paris par exemple, le théâtre privé n’est pas autant subventionné » 15 . Peut-être défendez-vous alors le mécénat privé ? Mais jusqu’à quel point ? Car si la culture s’envisage réciproquement comme une offre qui s’adapte constamment à la demande, l’art ne sera plus effectivement qu’un outil au service d’un monde auquel j’espère vous n’aspirez pas : un monde marchand, dicté par la politique du chiffre et du rendement. Il faudrait aussi avoir à l’esprit qu’un investissement de mécénat donne lieu à des déductions d’impôts, c’est-à-dire très concrètement à de l’argent en moins dans les caisses de l’Etat. Peuton donc y voir un déguisement du désengagement de l’Etat ? Et ne serait-ce pas un pouvoir supplémentaire donné aux entreprises, en termes d’affichages d’une part (dommage pour une municipalité qui souhaite supprimer la publicité), mais aussi en termes d’autorité créative, car il reste en effet plus facile d’obtenir du mécénat pour des arts ou des structures dites « légitimes » que pour des projets expérimentaux et exigeants. Pourtant, sans expériences ni échecs, la création est anesthésiée. C’est précisément ce que Frédéric Martel a reproché à Nicolas Sarkozy : « en valorisant le divertissement contre l’art, en défendant le mainstream au nom du peuple, et en érigeant en règle ses préférences spontanées (j’aime / j’aime pas), il a minoré les dimensions d’exigence, d’effort intellectuel, d’émancipation, d’authenticité et tout simplement d’étonnement de la culture. Ainsi, tout en prétendant le contraire, il a participé à la perte des repères et à la privatisation rampante des pratiques culturelles » 16 . Alors oui, une vision culturelle ambitieuse nécessite des financements publics à moins que votre vision culturelle soit totalement étrangère à l’idée d’une culture service public ? Il me semble pourtant que vous seriez contre la présence d’immenses panneaux publicitaires, à l’effigie de grandes marques, sur les façades de la mairie ou des écoles. Où placez-vous donc la culture pour la déconsidérer à ce point ?
Que l’on se rassure, si l’on se réfère aux couleurs politiques des élus de votre municipalité, on retrouve facilement les grandes valeurs fondatrices dites de « gauche » en matière culturelle. Chez Europe Ecologie Les Verts, aucune ambiguïté ne semble apparaître, la culture s’imbrique dans la vie sociétale : « La sensibilisation aux pratiques artistiques et à la culture depuis le plus jeune âge et l’accès à une éducation de qualité pour tous sont des pré-requis pour tout changement de société » 17 . De même au Partie de Gauche, Jean-Luc Mélenchon explique que « nous devons mettre la culture à l’école, partout » 18. La relecture de vos « 120 engagements pour Grenoble » est rassurante, elle-aussi, quant au projet politique de la municipalité, entre égalité, démocratisation et éducation populaire : « nous donnerons plus à ceux qui ont moins » (préambule), la Journée des Tuiles sera « une fête pour la démocratie du monde entier » (engagement 18), nous « [ferons] de la culture pour tous et partout » (engagement 107), « L’art et la création n’ont rien du supplément d’âme » (engagement 107), nous « [lierons] la politique culturelle et l’éducation populaire » (engagement 108), nous « [soutiendrons] fortement les pratiques artistiques et culturelles. La culture, la création sont des leviers d’émancipation, de découverte et de remobilisation. Elles peuvent concourir à la lutte contre les inégalités, l’isolement, l’échec scolaire » (engagement 109). Comment expliquer alors cette sensation de fausse note ?
A travers vos interventions, vous semblez sans cesse remettre en question la politique de démocratisation de la culture, notamment lorsque vous dites : « il y a matière à travailler, […] la démocratisation de la culture qui a porté beaucoup de chose en termes de médiation, mais il y a eu aussi, du coup, une séparation entre la culture, l’art, l’éducation, l’éducation populaire, et que nous devons travailler aussi ces questions et parler de solidarité, de coopération » 19. Pensez-vous sincèrement que les structures culturelles, en particulier grenobloises, ne travaillent pas déjà en coopération et dans une dynamique d’élargissement des publics ? Qu’elles ne s’appuient pas sur un réseau solide et historique déjà constitué ? Je ne crois pas que l’on puisse totalement dissocier les ressentis, les émotions et les motivations des spectateurs, du travail des institutions. Les deux sont très souvent liés, considérant aussi qu’il existe une émotion attachée aux institutions. Au lieu de valoriser les institutions en place, vous souhaitez une « culture pour tous » dans la rue et l’espace public, où chacun est artiste. L’intention n’est pas inintéressante, cependant la culture ce n’est pas que de l’évènementiel, ce n’est pas que de l’éphémère. De même qu’on ne devient pas citoyen sans apprentissages, l’appréhension de la culture nécessite un processus, comme la lecture, le calcul ou la gestion municipale. Il ne suffit pas de dire qu’on va favoriser la culture partout, il faut l’accompagner. Il ne s’agit pas non plus de placer la culture sur un piédestal, mais d’admettre qu’elle favorise la mise en mouvement et la réflexion. Vous semblez vouloir remettre à sa place la culture en expliquant qu’elle « ne peut pas se dire qu’elle est le rempart unique et ultime contre l’émergence du Front National » 20. Pensez-vous un instant que les acteurs culturels aient cette arrogance ? Il s’agit simplement de reconnaître pleinement le rôle qu’a aussi la culture dans l’ouverture des esprits, de l’esprit critique, et donc dans la possibilité de lutter contre les pensées totalitaires et dogmatiques. « La culture pour tous » ne peut donc pas être envisagé comme un déni de l’individu au profit de l’unique collectif, au risque de dérives idéologiques. C’est pourquoi, dans un autre temps, pas si lointain, Frédéric Mitterrand lui opposait « la culture pour chacun », une vision qu’il souhaitait développer principalement autour de l’individu. De votre côté, vous optez pour une formulation mixte et ambigüe : « la culture est affaire d’individuation collective » 21. Ambigüe car quelle est la part de l’individuation et du collectif lorsque votre emploi du « tous » sert le plus souvent des discours à charge contre les politiques culturelles institutionnelles ? Pour ne prendre qu’un exemple, vous affirmez régulièrement que les structures culturelles ne sont pas fréquentées par « tous » alors que vous reconnaissez volontiers « l’existence de cultures élitaires, [qu’]il serait malhonnête [d’]écarter entièrement » 22 . Que faut-il donc comprendre ? Pensez-vous réellement que les professionnels, les amateurs, voire les espaces culturels eux-mêmes soient excluant ? A l’annonce de la fermeture de trois bibliothèques, notamment dans les quartiers les plus sensibles de Grenoble, d’autres ne font pas la même analyse : « la bibliothèque fait partie d’un ensemble nécessaire et utile. Sans cela le quartier pète ! », ou encore, « on est en train de tuer le [quartier], le seul cœur qui bat c’est la MJC, la Maison des habitants et la bibliothèque. […] Si les gamins ne vont plus à la piscine ou à la bibliothèque, on ne pourra plus les tenir ! » 23 .
Joël Pommerat vous reproche un certain mépris vis-à-vis des élites et, dans le même temps, rapporte des propos que vous auriez tenus sur un « logiciel de pensée Malraux-Lang » périmé. Fondées ou non, ces deux idées semblent incompatibles, car si le « logiciel de pensée MalrauxLang » renvoie à la démocratisation de la culture, il est de fait conçu pour donner accès au plus grand nombre à la culture, et donc pas seulement aux élites. D’autre part, parler d’« élite » au sujet des institutions culturelles c’est précisément cibler une élite dite « intellectuelle ». Une chose reste très gênante, car n’est-ce pas le savoir et la connaissance qui permettent de bien vivre sa citoyenneté ? Une des missions de l’éducation populaire a toujours été d’« éduquer le peuple au suffrage universel [pour] garantir la démocratie »24. Cet idéal n’est pas nouveau, Les Lumières parlaient déjà d’« instruire et plaire » et historiquement, pour Gérard Noiriel, « la philosophie et le théâtre visent les mêmes objectifs : [faire triompher la raison éclairée] » 25. Il n’y a pas d’entre-soi lorsqu’une réelle politique de démocratisation de la culture est en place, précisément pour pallier à ces phénomènes. De même, si l’intervention sur Pina Bausch de votre Adjointe Cultures se vérifiait, à savoir d’être « fière » de ne pas connaître cette immense chorégraphe allemande, il y a de quoi être profondément dérangé. Ne pas être condescendant et naïf certes, mais de là à revendiquer l’ignorance de ce pourquoi l’on est en fonction, admettez la faute. Que diriez-vous si un Ministre de l’Ecologie revendiquait ne pas connaître l’énergie solaire ou éolienne ? Le choix de Pina Bausch est de plus très mal choisi, cette chorégraphe ayant su soulever de vrais phénomènes populaires et transporter des générations entières de spectateurs par la beauté et la puissance de ses gestes chorégraphiés. Venter une culture populaire n’est pas forcément synonyme de rejet et de mépris des projets exigeants : Antoine Vitez défendait par exemple l’objectif d’un théâtre « élitaire pour tous ». Je repense alors au préambule de vos 120 engagement, « nous donnerons plus à ceux qui ont moins », et commence à m’inquiéter : que souhaitez-vous donner ?
En parlant de « privilégiés », de « nantis » ou d’« élite », vous reprenez également les arguments les plus fréquents de la droite et de l’extrême droite, tout comme ceux de Nicolas Sarkozy et de François Fillon : « Notre politique culturelle est l’une des moins redistributive de notre pays. Financée par l’argent de tous, elle ne bénéficie qu’à un tout petit nombre » 26 . Dans une logique presque identique, vous auriez développé l’idée qu’il serait nécessaire d’arrêter de « dire que la culture, c’est cher mais [de dire davantage] que c’est du développement économique […] et que peut-être les gens pourraient venir en tourisme à Grenoble pour la culture ». Nous l’avons déjà évoqué, la culture ne devrait pas être envisagée comme un domaine rentable, au même titre que l’éducation : ces retombées sont davantage sociales qu’économiques. La loi de Baumol va d’ailleurs plus loin en ce sens expliquant bien que, pour le spectacle vivant notamment, certains coûts sont irrépressibles. En effet, il faudra toujours quatre musiciens pour interpréter un quatuor de Mozart, quel que soit le coût de la vie. Comment éviter que le coût d’un concert ne soit pas épongé par des prix élevés pour les spectateurs ? Comment permettre à tous l’accès à la beauté ? La réduction des coûts doit-elle alors se faire auprès des professionnels capables de nous transporter ? Soyons honnêtes, les personnes qui font le choix de vivre d’un art ne peuvent pas survivre en jouant « à recette ou au chapeau » 27 comme vous semblez étrangement le proposer. Plus surprenant encore, vous évoquez vous-même la précarité des artistes : « je comprends que le monde de la culture en général [soit] inquiet […], de fait, la situation de précarité économique et puis les attaques parfois violentes portées par la droite, ou parfois même par les gouvernements de gauche sur les statuts des intermittents, etc. » 28 . D’autre part, miser sur l’attractivité touristique de la culture ne résout pas non plus la problématique de l’accès à la culture. Il s’agit de flux financiers qui se déplacent d’un territoire pour entrer sur un autre, sans que la population locale soit prioritairement concernée. Concevoir une politique culturelle d’abord touristiquement, c’est s’intéresser davantage à son image et à l’impact économique qu’à la profondeur de l’évènement culturelle et à l’intérêt direct en termes de citoyenneté locale. De plus, la subvention des Musiciens du Louvre a été sévèrement amputée et vous auriez reproché à Marc Minkoswki « d’être trois fois par an à Grenoble » 29. Toutefois, la renommée internationale de ces musiciens favorise indéniablement l’attractivité touristique, ne serait-ce qu’au niveau de la région. Pourquoi alors multiplier ces confusions politiques ? Quelle vision défendez-vous réellement ?
Dans cette même optique, on ne peut que s’étonner des propos rapportés par votre Adjointe Cultures, « quand on parle de Grenoble à l’extérieur, on n’entend jamais dire que c’est une capitale culturelle », alors même que la page « Chantier de la Culture » du site de la Mairie indique l’inverse : « La ville de Grenoble a traditionnellement une implication forte dans le domaine culturel » 30. Il suffit de consulter les chiffres du Ministère de la Culture pour s’apercevoir que Grenoble est une ville extrêmement en pointe dans le domaine culturel. Qu’il s’agisse des musées, dont le très grand Musée de Grenoble (sa collection fait partie des plus importantes de France), des arts vivants avec la MC2 et les nombreux théâtres grenoblois, des musiques, qu’elles soient actuelles ou classiques (Musiciens du Louvre ont une renommée internationale), des cinémas avec un réseau équilibré y compris en « art et essai », sans oublier bien sur le réseau des bibliothèques, l’Observatoire des Politiques Culturelles et les nombreuses formations proposées dans ce domaine. La comparaison avec d’autres villes, même en Rhône-Alpes, redonne vite la place que mérite Grenoble en matière culturelle. De votre côté, vous ne niez pas cette place particulière de Grenoble, au contraire, vous la transformez en défaut, en désavantage : « quelle autre ville de même dimension accueille autant d’institutions relevant d’un label ministériel ? […] Cette densité n’est pas le fruit du miracle »31, ou encore, au sujet de la fermeture de trois bibliothèques, « je suis conscient qu’il y a des symboles plus ou moins difficile à dépasser, mais il faut avoir le courage politique de se dire que les choses ne sont pas figées. Il peut il y avoir des héritages, une tradition pour une ville, mais la vie bouge, les choses changent »32, et d’ajouter, « je suis d’accord que le symbole est difficile, mais est-ce qu’on regarde vraiment les faits ? Est-ce qu’on se rend compte que la densité des bibliothèques à Grenoble est cinq fois supérieure à celle de nombreuses autres grandes villes ? » 33 . Plus d’excuses possibles : nous sommes bien face à vos choix politiques.
Je voulais vous écrire car vous vous êtes dit surpris d’une telle tribune par Joël Pommerat. J’imagine que votre surprise est dû à l’effet qu’à produit sur vous son dernier spectacle, Ça ira (1) fin de Louis. Surpris car vous avez vu comme moi un spectacle qui vous a ému et transporté, qui a su créer en vous un envoûtement citoyen le temps d’une représentation, un envoûtement qui ne vous a pas lâché de la soirée, et que vous avez voulu partager, qui vous a amené à discuter, échanger, un envoûtement qui vous a fait penser, réfléchir, débattre, qui vous a stimulé, qui a confirmé votre foi dans l’humain et dans la pensée collective. Tout simplement : vous avez vécu un réveil démocratique alors même que vous étiez particulièrement sensibilisé sur ce sujet par votre fonction. Imaginez maintenant l’impact chez d’autres, inconscients de leur puissance collective et citoyenne. Voilà 10 ans que Joël Pommerat a déclenché un électrochoc en moi, aidé par d’autres metteurs en scène découverts à la MC2, au Théâtre de la Ville, au Théâtre Sainte Marie d’en Bas, par d’autres artistes, découverts au Musée de Grenoble, au Musée Dauphinois, au Magasin, par d’autres musiciens, découverts au Ciel, à l’Ampérage, à l’Auditorium, dans la rue, par d’autres acteurs culturels, notamment des professeurs, des responsables publics, des animateurs en MJC, et je pourrais continuer presque indéfiniment cette liste.
Vous invitez « les gens qui partagent le même espace [à débattre] ensemble plutôt [qu’à s’étriper] », la grenobloise en moi vous dit oui de tout son cœur, avec et par les arts, avec et par l’éducation : pas de débat sans culture !
Grenoble a été un modèle de ville culturelle, une ville émancipatrice par la culture, une ville qui a participé et contribué au façonnement de l’exception des politiques culturelles françaises. Ce modèle est aujourd’hui déconstruit et vous l’assumez : « on est dans une logique précise à Grenoble. Il faut faire des choix, des choix politiques qui ne font pas abstraction de la réalité. On ne subit pas, on prépare l’avenir » 34 .
Grenoble a été une ville d’expérimentation culturelle, une ville de rêve politique et poétique, une utopie collective. La réalité que vous exposez aujourd‘hui semble contraindre voire empêcher l’imagination, l’alternative, l’invention. Vous expliquez que cette réalité unique vous amène à avoir « du courage, le courage politique d’avancer. Car aujourd’hui, c’est ce qui manque à la vie politique, le courage ! » 35 . Sans doute en faut-il pour faire le choix de la négation du passé ? Grenoble restera ainsi une future exception culturelle : une exception de destitution de la culture.
Cordialement, Elise COLIN-MADAN
1 BELAËN Florence, « Entretien avec René Rizzardo », La Lettre de l’OCIM, 126 | 2009, 24-27.
2 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.
3 POMMERAT Joël, « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle », Libération, 2 juin 2016.
4 Discours de clôture du Congrès de Paris, 1961.
5 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.
6 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. « Préface. Jeunesse, éducation populaire et politiques publiques. Jean-Claude Richez », p. 20.
7 Intervention à l’Assemblée nationale, novembre 1963.
8 POMMERAT Joël, « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle », Libération, 2 juin 2016.
9 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.
10 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.
11 Préambule, 120 engagements pour Grenoble. http://unevillepourtous.fr/wp-content/blogs.dir/839/files/2014/02/Projet...
12 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.
13 Ibid.
14 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.
15 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.
16 MARTEL Frédéric, J’aime pas le sarkozysme culturel, Flammarion, Paris, 2012. p. 220.
17 http://culture.eelv.fr/2014/04/24/de-la-culture-pour-leurope/
18 https://www.lepartidegauche.fr/actualite/front-gauche-la-culture-une-rev...
19 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.
20 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.
21 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.
22 Ibid.
23 GAUD Garionn, « "Grosse déception" à la MJC Prémol sur le projet de reconstruction du théâtre », Dauphiné Libéré, 12 juin 2016.
24 Ouvrage collectif, L’éducation populaire : pour un engagement solidaire, Editions du Temps, Nantes, 2009. « Eduquer les jeunes à devenir des citoyens solidaires », p. 32.
25 NOIRIEL G., Histoire Théâtre politique, Agone, 2009, Marseille. « I. La construction d’un art autonome », « Le théâtre des Lumières », p. 20.
26 Lettre de mission du Président de la République Nicolas Sarkozy à sa Ministre de la Culture, 1/08/2007, cosignée par François Fillon, Premier Ministre.
27 POMMERT Joël, « Grenoble, la déception de l’écologie culturelle », Libération, 2 juin 2016.
28 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.
29 France Culture, Le Journal de la Culture, 3 juin 2016.
30 http://www.grenoble.fr/55-chantier-des-cultures.htm, consulté le 11/06/2016
31 BERNARD Corine et PIOLLE Eric, « A Grenoble, une culture ni populiste ni libérale, Libération, 12 juin 2016.
32 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.
33 Ibid.
34 ESTRANGIN Matthieu, MOULINIER Eve, « On ne subit pas, on prépare l’avenir », Dauphiné Libéré, 14 juin 2016.
35 Ibid.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 6:08 PM
|
Publié dans le journal "Le Pays Malouin"
L’incontournable trompettiste et musicien Ibrahim Maalouf a écrit ce jeudi 30 juin 2016 une très longue lettre, précise et documentée, à l’attention du maire de Saint-Malo, « Monsieur Claude Renoult », sur son mur Facebook. Il s’insurge contre la décision radicale de couper les vivres à l’EMCE.
Postée en fin de matinée, sa missive résonne sur les réseaux, et risque bien de résonner longtemps, au-delà des réseaux sociaux.
Dans cette lettre, largement circonstanciée, précise, le musicien de talent fustige la décision prise par le maire de Saint-Malo
« NON, monsieur le Maire, vous n’avez pas le droit de « sucrer » cette école, juste parce que vous n’avez pas apprécié la manière avec laquelle les négociations se sont passées ! »
Vous avez dit, suite à cette réunion : « C’est fini, je retire l’échelle à l’EMCE ». Mais quelle phrase abjecte !!! L’échelle c’est eux qui vous la font, c’est le citoyen qui a vôté pour vous qui vous tient cette échelle !! Si quelqu’un doit partir c’est vous pas eux !!
Les professeurs se battent comme des fous pour préserver un minimum de culture dans une ville qui semble de plus en plus ressembler à une station touristique qu’à une ville riche culturellement. Ils apportent du bonheur, un petit bonheur, (très modeste, face à vos grands plans de restructuration, c’est sûr), mais méritent-ils qu’on les jette ainsi ???… »
Ibrahim Maalouf rappelle ensuite les fondamentaux d’une république.
« Nous travaillons d’arrache-pied pour que la culture subsiste un minimum un peu partout »
Tel un cri du cœur, il rappelle le dur combat pour la culture, aujourd’hui.
Sans oublier de remettre en perspective les événements, n’oubliant pas que, certes, il se passe dans le monde, plein de choses terribles.
Mais il fait entendre sa voix, et elle porte, vu le nombre de partages enregistrés en moins d’une heure (3 600 likes et plus de 1 300 partages).
« J’espère que ce post obtiendra un MAXIMUM de likes car telle une « pétition », j’aimerais que cela arrive aux oreilles de ceux qui peuvent changer les choses. Et surtout, que les Maires des villes qui m’accueillent parfois pour des concerts, ou même ailleurs, réfléchissent à deux fois avant de prendre ce genre de décisions, car concert ou pas concert, s’ils prennent ce genre de décision, ils peuvent être certains que sur mon Facebook, qui je l’espère sera relayé, On N’AIMERA PAS ça. On REFUSERA. Et on SIGNERA CONTRE. PS : je penserai à vous aujourd’hui à 17h30 pour le conseil municipal ».
Il rappelle encore qu’il a :
« eu la chance de rencontrer 45 élèves de trompette de cette école lors de mon passage à Dol-de-Bretagne, et j’avais été très touché par l’engagement des professeurs et par l’engouement des élèves ».
Ibrahim Maalouf était également le 25 mars dernier à La Nouvelle Vague, pour un concert qui était complet depuis Noël dernier.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 3:31 AM
|
Par Brigitte Salino dans Le MondeP
Les grands yeux bleus d’Anne-Cécile Vandalem regardent vers le nord. C’est là que cette jeune femme blonde aime aller, toujours plus loin, toujours plus haut. Tristesses, la pièce sur la montée de l’extrême droite qu’elle présente à Avignon, se passe sur une île du Danemark. La prochaine se passera au Groenland. Elle n’est pas encore écrite, mais Anne-Cécile Vandalem sait qu’elle parlera de la route maritime qui s’ouvre, avec la fonte de la banquise, et attise les convoitises des grands Etats riverains, la Russie et le Canada.
Cet été, la nouvelle venue belge dans le festival « in » passera du temps là-haut, à observer et à parler avec les gens, comme elle l’a fait sur l’île de Samsø, dans le Jutland, pour Tristesses. Elle en tirera une histoire, des personnages, une ambiance. Elle écrira à son retour à Bruxelles, où elle vit. C’est une Wallonne, née à Liège en 1979. Enfant, elle voulait devenir curée.
« Oui, je voulais être la première femme curé, dit-elle avec son joli accent rugueux. J’allais beaucoup à la messe, mais comme ma famille pratiquait un catholicisme plutôt moderne, c’étaient des messes avec du spectacle. J’ai perdu mon père très jeune, j’ai dû vivre des choses qui m’ont très fortement marquée, à travers les célébrations. »
Force et apaisement du rituel : Anne-Cécile Vandalem y a puisé le goût de retrouver, dans un théâtre, « ce dépassement, cette étincelle » qui peuvent jaillir dans une église. C’est un viatique comme un autre pour entrer dans l’art. Comme le fut l’observation des clients dans le café de ses parents pour Pina Bausch. Peu importe l’origine, reste le désir.
Besoin de mettre en scène des histoires
Anne-Cécile Vandalem décide donc qu’elle sera comédienne. Elle se forme au conservatoire, commence à jouer. Mais, très vite, cela ne lui suffit pas. Elle a besoin de concevoir et de mettre en scène des histoires. Sa grand-mère lui en racontait beaucoup, elle aurait aimé en faire son métier, mais « ce n’était pas possible, pour une femme de son époque », dit Anne-Cécile Vandalem, qui crée sa première compagnie en 2003, avec un ami.
Cinq ans plus tard, ils se séparent, et elle reprend seule la direction de la compagnie, qu’elle renomme Das Fräulein [la jeune fille, en allemand] (Kompanie). Pourquoi ce drôle de nom ? « Je ne sais pas vraiment. Mais ce choix renvoie en partie au fait que, dès mes débuts, je voulais garder le contrôle sur la production des spectacles, et que j’étais plutôt en relation avec des hommes d’une cinquantaine d’années, qui étaient dans un rapport systématiquement paternaliste. »
Tristesses est le huitième spectacle de la compagnie, qui a créé les deux premiers en Flandre. « A l’époque, il y avait une volonté des producteurs avec qui je travaillais de créer des ponts. Ça n’a pas du tout fonctionné. Pour les Flamands, on était trop francophones, et pour les francophones, trop flamands. Maintenant, cette difficulté à se croiser existe toujours, mais la situation s’améliore. »
Anne-Cécile Vandalem ne se plaint pas de son sort : ce n’est pas dans sa nature, énergique ; et, avec ses 150 000 euros, sa compagnie est une des mieux dotées de Wallonie. Elle est déjà venue jouer à Avignon, dans le « off », avec Michel Dupont : « Un spectacle qui se passait dans le noir complet et mettait en parallèle la tragédie de petites filles enfermées dans une cave par leur père et l’imagerie de la princesse enfermée dans sa tour. »
Tête froide
C’était en 2012, mais ce n’était pas le premier Avignon d’Anne-Cécile Vandalem. A 20 ans, elle est venue avec une amie, elles chantaient dans la rue pour payer leurs places de théâtre. Puis, en 2007, avec sa première compagnie, elle a présenté Hansel et Gretel. Passer du « off » au « in » : beaucoup en rêvent, mais il y a très peu d’élus. Aumoment de franchir ce cap, Anne-Cécile Vandalem veut garder la tête froide : « J’essaye de faire en sorte que ce ne soit pas un enjeu important. J’ai la chance d’avoir déjà vécu une belle chute dans mon parcours, quand un festival belge a refusé un de mes spectacles. Mais j’ai toujours pu aller là où je voulais. Et, aujourd’hui, je voulais sortir de Belgique. »
Anne-Cécile Vandalem a toujours puisé ses références à l’international : Forced Entertainment, Christoph Marthaler ou Angélica Liddell. Et elle tient, depuis ses débuts, à s’investir totalement dans ses créations. Quand on lui demande si écrire, mettre en scène et jouer, ce n’est pas trop, elle rit : « C’est du masochisme d’être dans la salle et de regarder un spectacle, avec le public, sans rien pouvoir faire ! »
Dans Tristesses, Anne-Cécile Vandalem joue Martha, une femme qui dirige le Parti du réveil populaire, à Copenhague, et se rend sur l’île où sa mère vient d’être retrouvée pendue. Une île en plein déclin depuis la fermeture de ses abattoirs. Il reste huit habitants, liés par un secret que Martha manipule…
Les pièces policières sont rares, au théâtre. Tristesses en est une. Son titre doit beaucoup à Gilles Deleuze, pour qui la tristesse, c’est « la diminution de la puissance d’agir », explique Anne-Cécile Vandalem, en précisant : « Je crois que la politique peut, structurellement ou par stratégie, mettre les gens dans une situation où ils ont l’impression de ne pas pouvoir agir. Comment faire pour l’empêcher, dans le contexte de l’Europe d’aujourd’hui ? C’est toute la question. »
Dates
1979 Naît à Liège (Belgique).
2000 Chante dans les rues d’Avignon.
2008 Crée sa compagnie, à Bruxelles.
2016 Présente sa pièce, Tristesses, dans le « in ».
Tristesses : conception, écriture et mise en scène d’Anne-Cécile Vandalem. Gymnase du lycée Aubanel. Du 8 au 14 juillet (relâche le 11), à 18 heures. Durée : 2 h 15.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 6:31 PM
|
L'espace public en état d'urgence culturelle
28 juin 2016 - par Fédération Nationale des Arts de la Rue
800 000 euros annoncés pour les arts de la rue : de nouvelles mesures en-deçà des attentes du secteur
Alors que l'état d'urgence est renouvelé et que des manifestations dans l'espace public sont menacées d'interdiction, ordre public et espace public connaissent un amalgame croissant. Le repli sur soi et les discours radicaux contaminent le débat public. Les baisses des dotations aux collectivités territoriales induisent des politiques d'austérités qui concernent particulièrement le secteur des arts de la rue. Dans ce contexte, il y a urgence à réaffirmer les libertés d'expression, de création et de circulation dans l'espace public.
Le 14 juin dernier, la ministre de culture Audrey Azoulay a officiellement reçu le rapport de la Mission nationale pour l'Art et la Culture dans l'espace public lancée en 2014. Durant deux ans, cette Mission a réuni l'ensemble des acteurs œuvrant pour la culture dans l'espace public : arts de la rue, arts plastiques, Etat, collectivités territoriales et organismes professionnels.
Ce rapport contient un grand nombre des préconisations émises par la Fédération nationale des arts de la rue, parmi lesquelles :
- la mise en place du 1% travaux publics pour une plus-value culturelle dans l'aménagement et la vie de la cité
- la mise en place de processus territoriaux de co-construction réunissant les élus, les acteurs professionnels et publics pour le développement de la création artistique dans l'espace public
La profession reste dans l'attente de leur mise en œuvre.
Par ailleurs, Audrey Azoulay a annoncé à cette occasion huit cents mille euros de mesures nouvelles en faveur des arts de la rue. Ce montant est fortement en-deçà des attentes : ces huit cents mille euros ne vont apporter qu'un léger souffle à un secteur exsangue et à des compagnies fragilisées qui portent aujourd'hui l'intégralité des risques de production.
Cette date du 14 juin est une première étape vers une nouvelle politique culturelle, qui doit être ambitieuse et porteuse d'une vision à long terme. « La création dans l'espace public est un enjeu démocratique majeur » déclare le Ministère.
En France, l'art dans l'espace public doit s'épanouir en rue libre.
Signataires
Fédération nationale des arts de la rue

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 6:16 PM
|
Par Delphine Baffour pour Danse avec la plume - 29 juin 2016
Maintes fois invité au festival Montpellier Danse dont il est aujourd'hui chorégraphe associé, Emanuel Gat a présenté pour ouvrir l'édition 2016 du festival, dans le cadre enchanteur du Théâtre de l'Agora, sa nouvelle création, SUNNY. Une superbe pièce, mise en musique live par Awir Leon et pour dix interprètes, dont cinq ont rejoint la compagnie récemment, qui a embrasé la nuit montpelliéraine.
Chorégraphe israélien, Emanuel Gat étudie la musique dans le but de diriger des orchestres avant de découvrir la danse, à 23 ans. Il fonde sa compagnie à Tel Aviv en 2004, s'installe à Istres, dans le sud de la France, trois ans plus tard. Awir Leon, alias François Przybylski, devient l'un de ses interprètes dès 2008. Dans un mouvement contraire, lui qui passa du hip hop au modern jazz avant de devenir danseur contemporain, se consacre depuis 2009, de façon croissante, à son activité d'auteur compositeur de musique électronique. Si Emanuel Gat en fut l'instigateur, travailler ensemble pour ce nouvel opus s'est présenté pour l'un comme pour l'autre comme une évidence. Ils se connaissent si bien, sont dans une totale confiance, partagent la même flexibilité, la même volonté de rendre leur travail dynamique, évolutif, de ne rien figer.
Cet alignement favorable des astres, dont le résultat brille sur le plateau, se poursuit au moment d'entamer la création. Alors que, comme à son habitude, Emanuel Gat demande à ses danseurs et danseuses de choisir un texte qui sera ensuite traduit en mouvements et que leur dévolu se porte sur les paroles de Sunny, la même chanson trotte dans la tête d'Awir Leon, qui est en train d'en réaliser un "cover". Le titre de la pièce est alors tout trouvé, et tous deux peuvent commencer à travailler de leur côté, musicien et compagnie se retrouvant une à deux fois par semaine pour unir leurs productions.
SUNNY d'Emanuel Gat et Awir Leon
Creusant, approfondissant un même chemin, une même méthode de pièces en pièces, Emanuel Gat construit à partir d'improvisations de ses danseurs ou danseuses et de contraintes qu'il leur donne, des compositions chorégraphiques complexes, à la manière d'une Trisha Brown. Il tient à rendre visible le processus de création sur scène. Awir Leon quant à lui, se donne pour consigne de sortir du côté aseptisé, sans prise de risques, qu'a souvent la musique électronique live. Il revendique sa bande son comme une matière vivante, qui évoluera à chacune des représentations. D'ailleurs, dans les dix premières minutes de SUNNY, musique comme danse sont totalement improvisées, et donc amenées à varier chaque soir.
Du concert ou de la chorégraphie, tous deux totalement imbriqués, difficile de dire lequel envoute le plus dans cette pièce. Les yeux passent avec un plaisir constant de la vibrante performance du chanteur et musicien aux mouvements fluides, délicats et intenses des magnifiques danseurs et danseuses. Milena Twiehaus comme le nouvellement arrivé Tom Weinberger, dont la présence et les lignes sont remarquables, fascinent particulièrement. Qu'ils et elles se déploient seul.e.s, en grappes, en lignes, s'étreignent, tombent, tremblent, ou débutent maintes fois le même mouvement, la profondeur de leurs regards comme leurs sourires et leurs gestes happent. D'une composition complexe, que l'on se plait à tenter de décrypter, Emanuel Gat et ses interprètes extraient une danse vivante, sensuelle, éminemment sensible.
Même si le chorégraphe déclare ne pas aimer, le plus souvent, donner ses pièces en plein air, découvrir SUNNY dans l'écrin du Théâtre de l'Agora offre un moment d'autant plus précieux. Le vent qui gonfle la cape dorée d'une danseuse, ou balaie les plumes noires qu'une autre arbore un moment sur sa tête, ajoute à la magie de la pièce. Nul doute cependant que celle-ci saura aussi très bien s'épanouir dans le cocon d'un théâtre, et la savoir évolutive ajoute à l'envie de la revoir sans tarder dans un nouveau cadre.
SUNNY d'Emanuel Gat et Awir Leon au Théâtre de l'Agora dans le cadre du festival Montpellier Danse. Avec Annie Hanauer, Anastasia Ivanova, Pansun Kim, Michael Löhr, Geneviève Osborne, Milena Twiehaus, Tom Weinberger, Sara Wilhelmsson, Ashley Wright, Daniela Zaghini. Samedi 25 juin 2016.
Emanuel Gat est soutenu depuis 2008 par la Fondation BNP Paribas.
SUNNY sera en tournée à Berlin au mois d'août puis en France la saison prochaine (Albi, Aix-en-Provence, Istres et Saint-Quentin-en-Yvelines) et visible sur Culturebox à partir du 30 juin.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 5:19 PM
|
Article de Richard Magaldi-Trichet pour theatractu.com
Quinze personnages en quête de vie…
Quinze jeunes comédiens sur la piste d’une boîte de nuit se croisent, s’interrogent, s’ignorent, se désirent. Peu à peu les personnages se mettent en place et prennent forme sous nos yeux. Ils ont les questions de leur âge sur le monde et sur eux-même.
Dans un joyeux mais sérieux mélange, on croise Rimbaud et Narcisse, on chante Carmen et Chris Issak…Emportés dans leurs danses par un « didji » sensuel et puissant, ces comédiens qui prennent le théâtre à pleines dents déroulent devant nous leurs scènes de vies multiples et oniriques. Mais dans notre inconscient collectif quelques dates surgissent soudain, à jamais incrustées malgré nous dans notre mémoire : 11 septembre, 13 novembre… À la violence répond la dérision. Tout doit continuer…
© Tristan Jeanne-Valès
Nathalie Fillion avait écrit ce texte en 2005 avec des adolescents, elle le représente aujourd’hui avec des acteurs dix ans plus vieux, pourtant les résonances sont les mêmes. Les élèves comédiens de la Séquence 8 de l’Académie de l’Union nous proposent un travail abouti et complet. Charles Pommel se détache particulièrement dans son rôle du DJ sexy, Lara Boric est également très émouvante dans l’histoire de la grand-mère de Srebeniça, mais si on ne peut citer tous les noms, on retrouvera certainement leurs visages très prochainement sur les scènes de spectacles à venir.
Must go on
texte et mise en scène Nathalie Fillion
Avec les élèves-comédiens de la Séquence 8 de l’Académie de l’Union, Ecole Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin : Hélène Bertrand, Lara Boric, Jeanne Frémy, Robin Gros, Antoine Guyomarc’h, Marie Jarnoux, Ali Lounis Wallace, Florence Martinez, Raphaël Mena, Erwann Mozet, Pélagie Papillon, Charles Pommel, Lorine Wolff, Catherine Beauchemin et Marilou Martineau
Scénographie, costumes, coiffures, maquillages Charlotte Villermet
Son et arrangements musicaux Nourel Boucherk
Lumière Claire Debar
Chorégraphie Jean-Marc Hoolbecq
Festival des Ecoles du Théâtre Public-7e Edition à la Cartoucherie jusqu’au 3 juillet
Théâtre de l’Aquarium
La cartoucherie
route du Champ de Manœuvre
75012 Paris
Photo © Tristan Jeanne-Valès

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 9:30 AM
|
Par Sophie Jouve pour Culturebox.fr
Après 23 ans d'absence, la Comédie-Française ouvre ce 70e Festival d'Avignon avec "Les Damnés", inspiré du film de Visconti. Le maître d'œuvre est un des grands du théâtre européen, le Belge Ivo van Hove. Nous avons retrouvé la troupe en répétition au 104, dans le 19e arrondissement, loin des ors du Palais Royal. Une troupe enthousiaste et galvanisée par le travail déjà réalisé.
Dans l'espace de répétition tout est en place : un grand écran vidéo occupe le fond de la scène. De part et d'autre d'un vaste espace de jeu, des canapé-lits, des tables de maquillages éclairées, un gong. Changement de décors, habillage, tout se passe à vue.
Le metteur en scène, Ivo van Hove ne dispose que d’un mois de travail à Paris et de 10 jours à Avignon : "Le moment crucial dans mon rapport aux acteurs, celui où tout se joue est celui des répétitions", affirme-t-il.
Ce jour là on commence l'acte II : images de propagandes et musique Métal sont interrompues par l’entrée d’un groupe de SS, en uniforme et coupes de champagne à la main.
Ils trinquent à un prototype de mitrailleuse, en compagnie de l’ambitieux Friedrich Bruckmann incarné par Guillaume Gallienne, homme de confiance de la riche famille d’industriels allemands, von Essenbeck, mais prêt en même temps à retourner sa veste.
"Il faut que tu montres le fusil, comme... (il cherche le mot)… comme un trophée qui va changer le monde", indique Van Hove à l’ouvrier qui porte l’arme. "Il faut être plus conscient de l’importance de ce moment, il faut être plus agile ça se dit comme ça ? plus tonique. Oui c’est ça."
"Lorsque tu brandis le fusil tu fais peur, alors du coup tout le monde lève son verre. Je veux essayer ça." "Au prototype, avec l’espoir d’entendre bientôt sa musique", reprend l’un des comédiens-officier.
Ivo van Hove insiste sur le rythme, prête une attention toute particulière à la position des corps
Se dessinent en quelques secondes les rapports de forces. Ceux qui prêtent allégeance aux nazis tel Eric Génovèse (Wolf von Aschenbach), manipulateur, ambigu et menaçant, ceux qui hésitent encore et ceux dont l’avenir est déjà menacé. C’est le cas de Denis Podalydès (Konstantin von Essenbeck), fils de la grande maison et membre des SA dont le sort est déjà scellé. Lorsque qu'il entre, l’assemblée se fige, l’ignore, se détourne.
"On ne comprends pas tout de suite pourquoi on ignore Konstantin von Essenbeck", constate Podalydès. "Il découvre qu’il y a une conspiration contre lui, c’est un bloc contre lui", dit van Hove.
La scène est rejouée 7 fois. Ivo van Hove distille ses conseils à la fin de chaque scène, sobre, concret, insistant sur le rythme, prêtant une attention toute particulière à la position des corps.
"C'est quelqu'un de très pudique, qui ne dirige pas énormément, et qui est très clair quand il demande quelque chose. Il cible, il n'y a pas de gras. Il travaille très rapidement, il va à l'essentiel, très vite. C'est très agréable", sourit Elsa Lepoivre (Baronne Sophie von Essenbeck).
"Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais"
La scène suivante voit Eric Génovèse faire pression sur Galllienne pour obtenir des subsides conséquents de la famille Eisenbeck : "Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais", argumente-t-il, glaçant.
"La pression sur lui doit être extrême, indique van Hove à Génovèse. Bruckmann (Gallienne) pensait être entouré d’amis, il n’a plus que des ennemis. C’est ça qui le pousse à bout, à la colère. Donc tu avances vers lui."
"Il y a zéro psychologie chez van Hove, analyse Gallienne. Il est très conscient, très ouvert par rapport au temps du spectacle, qui ne nous appartient pas et en même temps on peut prendre des temps qu'on ne soupçonne pas. 'Prends plus de temps là', dit-il en imitant de manière irresistible l'accent flamand du metteur en scène. Et en même temps, il a une telle énergie, ça avance tellement vite." Et pour détendre l'atmosphère Gallienne prend van Hove par le cou en riant : "Il déteste ça, il n'est pas du tout tactile !"
"On donne corps à cette violence.
Et pourtant justement,"Le corps dans les spectacles d'Ivo que j'ai pu voir à une place centrale, constate Loic Corbery (Herbert Thallman). La violence est très sourde dans le scénario, mais avec Ivo on donne corps à cette violence sur le plateau."
"Il est fascinant, il peut dire juste trois ou quatre mots, donner une description physique, dire : "Voilà il saute sur la table". Juste en disant ça, il sait où ça va mener l'acteur et il ne l'embète pas plus. C'est ça qui est chouette, c'est efficace, tu comprends très vite et du coup ton corps sait ce qu'il doit faire", confie admiratif Christophe Montenez. Le jeune sociétaire embauché pour Tartuffe n’en revient pas d’avoir décroché le rôle de Martin, central selon van Hove : "Un caméléon capable de s’adapter à toutes les situations, même les plus oppressantes, un nihiliste sans ambitions qui ne pense qu’à sa survie". Ce rôle là avait été confié par Visconti à Helmut Berger qui était aussi jeune et sans grande expérience, comme Montenez aujourd'hui.
Dans la scène suivante, très sensuelle, on découvre Martin avec son amie puis violant une petite fille. C'est en tout cas ce que l'on comprend, car van Hove a un sens imparable de la suggestion et aussi une autre qualité : faire démarrer chaque scène à son point culminant, à son maximum d'intensité. Pas de préambule, on est tout de suite au cœur des choses.
"Dur mais jouissif à jouer"
"Il est complètement fêlé ce jeune homme, reprend Montenez, mais c'est à cause de ce que sa mère a fait de lui, du système… On se reconnait un peu tous dans ce désir d'amour inassouvi. C'est dur mais c'est jouissif à jouer".
Face à la scène tout le bataillon de la production : le dramaturge (Bart Van den Eynde), le scénographe lumière (Jan Versweyveld), le responsable vidéo (Tal Yarden), le compositeur (Eric Sleichim)… Tous extrêmement concentrés, susurant en anglais, allemand ou flamand.
"Le spectacle va être violent. Il y a le relais de la vidéo qui est intéressant et qui crée une distance. Même sur les scènes assez dures d'incestes… Mais ce qu'on vit sur le plateau nous secoue nous-même. Mais quand on parle de ça (le nazisme), on ne peut pas le faire avec du coton", remarque Elsa Lepoivre.
"Faire ce spectacle en 2016, avec la mémoire des 70 années passées, c'est tellement théâtral et concret qu'on sent que ça peut finalement se reproduire demain, conclut Gallienne. Il y a des phrases très marquantes, il y en a une que j'adore dire : Et ceux qui cherchent refuge dans la neutralité seront les perdants de la partie".
Avignon du 6 au 16 juillet
Comédie-Française, salle Richelieu du 24 septembre au 13 janvier 2017
Infos pratiques
"Les Damnés" d'après Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove
Cour d'honneur du Palais des Papes
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 juillet à 22H/ 14 juillet à 23H
Voir l'article sur son site d'origine : http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/les-damnes-de-visconti-dans-les-coulisses-des-repetitions-avant-avignon-242113

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 6:08 PM
|
Publié par Hélène Girard dans La Gazette des communes
Le rapport Cohen sur les festivals, prêt depuis avril, est finalement sorti sans avoir été officiellement reçu par la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Ses préconisations ne sont pourtant pas dénuées de bon sens et pointent la difficulté des services de l’Etat à se positionner.
Lassé d’attendre. Pierre Cohen a finalement diffusé son rapport sur les festivals sans avoir pu le remettre à la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. « Depuis deux mois, le rapport est à la disposition de la nouvelle Ministre Audrey Azoulay. A ce jour, je n’ai pas encore de réponse de son cabinet. Je le regrette, mais je souhaite tout de même aujourd’hui faire un retour aux acteurs qui ont accepté de participer à cette mission et qui ont contribué à cette réflexion collective », indiquait-il le 22 juin en envoyant son rapport à quelques médias dont La Gazette.
Le rapport de l’ancien maire (PS) de Toulouse constate que les festivals sont des « OCNI » (objets culturels non identifiés) que tout le monde connaît, mais que personne n’arrive à définir :
Si le foisonnement, la diversité des formes festivalières et des relations avec les lieux font échec aux volontés de définition uniformisée, force est de constater que cette absence de définition n’est pas un frein, bien au contraire, à la vitalité et au développement des festivals.
Un foisonnement qui a grandi au rythme des décentralisations et du renforcement des collectivités locales, tant ces moments festifs et collectifs représentent pour les territoires un rayonnement à enjeux multiples : économique et culturel, mais aussi citoyen et de lien social.
Commandé l’été dernier, à un moment où la baisse annoncée des dotations faisait planer de sombres orages sur les festivals, le rapport constate qu’il y a plus de créations que de disparitions, et que les seules subventions n’en sont pas le facteur principal.
Préconisations
« Les festivals sont plus que jamais des dispositifs essentiels des politiques publiques et appellent un travail collectif de co-construction qui permette de renforcer leur légitimité », assure le rapport Cohen qui préconise notamment « une meilleure observation et une contractualisation plus large, visant à la pérennisation des festivals ».
Pour cela, il conseille la mise en place d’une méthode commune d’observation et évaluation, pour laquelle il est important « d’entendre le désir des acteurs d’être associés » (en gras dans le rapport). Il écarte clairement l’intérêt de créer un label et recommande une méthode de coopération plus approfondie.
Après de nombreuses auditions et entretiens, l’ancien maire de Toulouse préconise que l’intervention de l’Etat se décline en quatre modalités :
l’accompagnement des acteurs dans un ajustement de la reconnaissance,
un soutien financier ciblé, avec des conventions pluriannuelles et pluripartites pour sécuriser les festivals
l’apport de l’expertise juridique pour favoriser l’équité (une réponse est attendue concernant les difficultés qu’entraine la nouvelle réglementation sur les stagiaires, par exemple),
une coordination des enjeux au sein des différentes instances de l’Etat.
Une place dans la CTAP
« La coordination au sein des instances du ministère de la culture, aurait besoin d’être structurée », souligne le rapport, qui pointe les entrées disciplinaires et professionnelles à la direction générale de la création artistique (DGCA) ou la collaboration nécessaire avec la direction générale des médias et de l’industrie culturelle (DGMIC).
En revanche, le rapport note également que dans les Conférences territoriales de l’action publique (CTAP) l’Etat n’est plus « qu’un éventuel invité en fonction de la volonté du président », alors que cette instance prévoit l’installation d’une commission culture et l’inscription une fois par an à l’ordre du jour.
Par ailleurs, le rapport souligne que le fonds d’urgence mis en place à la suite des attentats de novembre, confié au Centre national des variétés, ne concerne que les entreprises de spectacle vivant privé et les entreprises subventionnées entrant dans le champ de la taxe sur les spectacles.
Si bien que les festivals se situant en dehors du périmètre de la taxe sont exclus du fonds d’urgence, alors qu’il est largement abondé par l’Etat. Or le centre national des variétés lui même « a observé que pour les festivals, l’augmentation des coûts de technique et de sécurité est plus forte que l’augmentation des coûts artistiques. »
Autant de questions qui méritent encore que le ministère réfléchisse à des réponses.
A lire aussi « Les difficultés des festivals ne sont pas que financières » – Pierre Cohen : http://www.lagazettedescommunes.com/375366/les-difficultes-des-festivals-ne-sont-pas-que-financieres-pierre-cohen/

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 4:28 PM
|
Un des lieux du off d'Avignon
ÉDITO 2016
Oui, j'assume aujourd'hui et sans complexe, le fait de construire une programmation du OFF comme une signature, une envie de dire notre monde, un geste politique en somme.
Bien sûr nous ne sommes pas les seuls à envisager de la sorte cette aventure du OFF, d'illustres prédécesseurs nous ont montré le chemin...
Le fait qu'un lieu du OFF soit une plateforme privée, que « Le OFF » même soit une des manifestations du libéralisme le plus sauvage et le plus débridé, ne doit pas dissuader les artistes d'en prendre la responsabilité et la gestion.
Nous en avons besoin, tous, pour montrer notre travail, le roder, pour le diffuser enfin, donc oui, mettons-y de l'exigence, faisons des lieux à notre image. Notre image ?
Oui ! Artistes ancrés dans les réalités contemporaines
Notre programmation 2016 a pour ambition d'interroger la figure de l'Homme/Monstre ! Nous quoi...
Mais comment raconter une réalité qui à chaque instant dépasse toute imagination ?
Seuls l'art et la poésie en sont capables !
Avons-nous donc le droit de nous coucher, de fermer les yeux et de glisser vers notre mort ? Aujourd'hui, la tentation en est très grande ; Ou bien tenter de rester debout, sachant que la bataille est perdue mais tenir tant qu'il y a le souffle.
Il en va de notre responsabilité dans ces temps de troubles et de sang...
Être conscient d'une fatalité et vouloir à tout prix lui opposer des rêves !?
Fida Mohissen
Voir le programme du Festival 2016 : http://www.theatregilgamesh.com/cms/fr/programmation-2016

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 4:19 PM
|
"Entretien par Igor Hansen-Love pour l'Express
A Avignon, nous allons nous mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe", estime Éric Ruf.
L'administrateur général de la Comédie-Française a fait revenir sa troupe à Avignon, où elle n'avait pas joué depuis vingt-trois ans. Volubile, il évoque la place de la politique au théâtre, l'avenir du spectacle vivant et la pièce Les Damnés, événement du Festival.
Pourquoi a-t-il fallu attendre vingt-trois ans pour que la Comédie-Française revienne au Festival d'Avignon?
Avignon est le plus beau festival de théâtre au monde. Les possibilités de programmation sont extrêmes et les places peu nombreuses. Depuis sa création, tous ses directeurs font des choix personnels pour mettre en valeur un certain style de théâtre. Les derniers en date, Vincent Baudriller et Hortense Archambault, étaient tournés vers des écritures contemporaines, à mille lieues du répertoire de textes et de sens de la Comédie-Française. Il n'y a eu aucune fâcherie, nous n'étions simplement pas dans leur angle de vision. Avec l'arrivée en 2014 du directeur actuel, Olivier Py, l'éventualité de notre retour a été de nouveau envisagée.
Qu'avez-vous à y gagner?
En France, tout nous distingue: la Comédie-Française est le seul théâtre avec une troupe permanente, elle bénéficie de la subvention la plus importante, ses conventions collectives et modes de rémunération sont uniques... Et cette configuration, si particulière, peut nous couper du monde. Au Festival d'Avignon, nous allons nous mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe. Nous aurons aussi la possibilité de toucher un public qui n'est pas le nôtre. Et, si le spectacle est réussi, il incitera sûrement de nouveaux metteurs en scène à venir créer des pièces chez nous. Notre maison doit revenir dans le concert des nations théâtrales. D'ailleurs, j'avais évoqué l'idée de ce retour à Olivier Py avant même de devenir administrateur général. L'enjeu est très important.
La pièce que vous jouerez, Les Damnés, est l'adaptation d'un film de Luchino Visconti réalisé en 1969. La Comédie-Française n'a pas l'habitude de puiser dans le répertoire du cinéma...
Au dernier Festival de Cannes, le jeune réalisateur Xavier Dolan a remporté le grand prix avec Juste la fin du monde, l'adaptation d'une pièce de Jean-Luc Lagarce. Pourquoi, en retour, le théâtre ne pourrait-il pas s'inspirer du cinéma? C'est de bonne guerre! En France, nous avons tendance à sacraliser certaines oeuvres. A l'étranger, les grands metteurs en scène n'hésitent pas à couper, à recoller, à mélanger les textes et bousculer les genres. Et ainsi, souvent, je trouve qu'ils accèdent mieux à la substantifique moelle de l'oeuvre. Par ailleurs, Ivo van Hove, l'artiste belge qui a choisi de mettre en scène Les Damnés, ne se contentera pas de reproduire le film sur un plateau; il ne l'a pas vu depuis vingt ans.
"Au sein de la nouvelle génération, les femmes sont bien meilleures que les hommes. A la mise en scène comme au jeu", soutient Éric Ruf.
Dans ce film, il est question de la montée du nazisme. Aujourd'hui, les partis d'extrême droite s'imposent en Europe. Le choix de ce texte est-il aussi politique?
Bien sûr.
Par le passé, la maison de Molière n'avait pas pour vocation de s'engager. Faut-il y voir un changement?
Attention, si cette pièce traite de politique, son choix n'est pas un acte militant. Les Damnés est un spectacle politique au même titre que Britannicus de Racine, que nous jouons actuellement salle Richelieu. La Comédie-Française n'a pas à apporter de solutions toutes faites; elle doit faire réfléchir. En l'occurrence, ce texte pose la question suivante: comment un peuple entier a-t-il pu être fasciné par le nazisme ? Visconti y répond en faisant appel à Shakespeare... Tandis que Shakespeare, lui, faisait appel aux tragédiens antiques. Le temps du théâtre n'est pas celui de l'actualité; c'est sa force. Son histoire et sa culture montrent qu'il y a plusieurs siècles, les mêmes problèmes existaient déjà.
Ce constat n'est-il pas désolant?
Je ne trouve pas. Il rend philosophe.
Tout de même ! On peut réfléchir et prendre position.
Vous voulez me faire dire que je suis contre l'extrême droite? Ce n'est pas évident? Si je résiste à cette question, c'est parce que je refuse d'être un militant à la petite semaine. Premièrement, le choix des Damnés n'est pas le mien, mais celui d'Ivo van Hove. Ensuite, je ne conçois pas un plateau de théâtre comme une agora mais comme le fruit du travail d'une administration, des comédiens, des costumiers, des accessoiristes, des metteurs en scène... Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des politiciens qui nous assènent des solutions prétendument simples pour sauver la France. Le rôle du théâtre, à mon sens, consiste à rendre compte de l'état du monde de façon moins didactique, plus complexe et plus contradictoire que ce que l'on voit tous les jours sur BFM TV.
Faudra-t-il continuer à défendre le régime spécifique d'assurance-chômage des intermittents?
Bien sûr ! L'intermittence est juste. S'il est nécessaire de lutter contre certains abus, l'équation fondamentale reste simple : sans ce régime, pas de spectacle vivant. Les périodes où les artistes ne se produisent pas revêtent un caractère aussi important que leur activité visible. Il me paraît logique que l'exception culturelle française s'accompagne d'une organisation exceptionnelle.
L'économie et la pratique des arts ont été mises sens dessus dessous par la révolution numérique. Le théâtre restera-t-il toujours imperméable aux mutations technologiques?
Internet a modifié la façon de réserver nos places de spectacle, mais, au fond, cet art n'a pas vraiment changé depuis plus de deux mille ans. L'invariant est là: les gens auront toujours besoin d'aller voir des acteurs, sur scène, dans le plus grand dénuement. Et voilà pourquoi: un comédien a beau apprendre son texte au rasoir, moduler délicatement sa voix ou enregistrer ses déplacements au millimètre, le public n'est jamais aussi captivé que lorsque l'acteur oublie ses répliques, déraille, et se met à rire. La possibilité même de cet événement met le spectateur dans une disposition d'esprit unique. Elle engendre des émotions d'une puissance inégalable. Le théâtre est organisé pour que l'éclat de la vie surgisse sur scène. C'est ce qui le rend imperméable à la technologie.
Vous avez programmé une majorité de femmes metteurs en scène la saison prochaine. Pratiquez-vous une politique de discrimination positive?
Absolument pas. Je me suis appuyé uniquement sur des critères artistiques. Je ne suis pas le héros d'une cause, mais le simple témoin d'une évolution. Ma prédécesseur, Murielle Mayette-Holtz, cherchait la parité, mais ce fut difficile car certaines artistes souffraient encore d'un souci de légitimité. Les temps ont changé; j'en suis ravi. Je constate même qu'au sein de la nouvelle génération les femmes sont bien meilleures que les hommes. A la mise en scène comme au jeu.
Pouvez-vous l'expliquer?
Un exemple. Denis Podalydès, qui a récemment mis en scène Lucrèce Borgia de Victor Hugo, a confié le rôle de Gennaro à la comédienne Suliane Brahim. Ce personnage, je le connais par coeur car je l'ai joué il y a vingt ans à la Comédie-Française. De toute évidence, elle s'en sortait bien mieux que moi. Longuement, je l'ai observée et j'en suis venu à la conclusion que les femmes sont plus polysémiques que les hommes. Sur scène, les enjeux liés à notre virilité peuvent poser problème. Jamais je n'aurais réussi à jouer la stupé faction comme elle l'a fait.
Votre mandat se termine dans trois ans. Que reste-t-il à faire?
Le grand chantier, c'est l'acquisition d'une nouvelle salle modulable qui permettrait d'accueillir des spectacles contemporains. Ainsi, la Comédie-Française pourrait véritablement se tourner vers l'avenir. Nous espérons nous installer sur le site des Ateliers Berthier, porte de Clichy. Il s'agit d'un dossier politique, très compliqué, qu'il faut absolument mener à bon port.
Jean-Pierre Vincent, qui a dirigé le Français de 1983 à 1986, a dit: "Le poste d'administrateur de la Comédie-Française est le plus difficile de France, avec Matignon." Qu'en pensez-vous?
Qu'il devait avoir l'ambition de devenir Premier ministre! Jean-Pierre Vincent a eu une expérience très douloureuse à la tête de la Comédie-Française. Il a voulu faire la révolution trop rapidement. Je ne suis absolument pas dans ce cas de figure. Je suis entré dans cette maison en 1993, j'en connais chaque recoin, je sais comment décoincer une situation intuitivement, les comédiens me font confiance... C'est l'un des avantages de venir de l'intérieur.
Jouer sur scène vous manque-t-il?
La seule chose qui me manque réellement, c'est la possibilité de faire le con. Aujourd'hui, lorsqu'il m'arrive de blaguer dans les couloirs avec mes anciens camarades de jeu, immanquablement, dix minutes plus tard, je les retrouve dans mon bureau. Angoissés, ils me demandent si je plaisantais, comment ils doivent interpréter ce que je viens de leur dire... Je suis systématiquement suspect de vouloir faire passer une idée. Au sujet de la comédie maintenant, c'est paradoxal. Evidemment, j'aurais adoré jouer sous la direction d'Arnaud Desplechin ou d'Ivo van Hove. Mais je n'aurais pu les programmer si j'étais resté comédien!
"L'invariant est là: les gens auront toujours besoin d'aller voir des acteurs, sur scène, dans le plus grand dénuement", lance Éric Ruf.
Mini bio Eric Ruf
1969 Naissance à Belfort (Territoire de Belfort).
De 1992 à 1994 Etudes au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.
1993 Entre à la Comédie-Française.
2003 Joue Phèdre, de Racine, mis en scène par Patrice Chéreau.
2012 Met en scène Peer Gynt, de Henrik Ibsen.
2014 Devient administrateur de la Comédie-Française.
LES DAMNÉS, d'après Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove. Cour d'honneur du palais des Papes. Avignon (Vaucluse), du 6 au 16 juillet.
Photo (c) MARC CHAUMEIL POUR L'EXPRESS

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 3:33 AM
|
Le 3 octobre prochain, le Théâtre National accueillera la cérémonie de remise des Prix de la Critique : théâtre, danse et (une première!) cirque. Autre particularité, rare, un "Prix Spécial du jury" attribué au Suisse Milo Rau pour "Five Easy pieces", plaçant au centre, avec délicatesse, "l’affaire Dutroux". Enfin une rareté, le Prix Abraté (à l’ensemble d’une œuvre) est attribué à un duo, Jean-Louis Colinet et Jan Goossens pour leur travail artistique et politique commun sur Bruxelles. Voici donc les 42 "nominations" (14 catégories de 3 nominés) et, déjà, 3 lauréats, dès le premier tour, Milo Rau, Jean-Louis Colinet et Jan Goossens comme autant d’hommages. Ces 42 " élus ", ont été choisis par un jury de journalistes de différents médias. Vous pouvez dès à présent retrouver tous nos commentaires et portraits 2016 sur le site www.lesprixdelacritique.be. Les " élus " y retrouveront nos hommages. Et le grand public pourra comprendre les raisons de nos choix. De cette année et des précédentes, jusqu’à …1952 (création des Eves du Théâtre). Voici dont les nominés et 3 lauréats " d’office " 2015/16.
http://www.rtbf.be/culture/scene/detail_prix-de-la-critique-theatre-et-danse-2016-42-nomines-dont-3-artistes-du-cirque-et-3-hommages-a-milo-rau-jean-louis-colinet-et-jan-goossens-christian-jade?id=9339124&utm_source=rtbfculture&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 27, 2016 6:51 PM
|
Propos recueillis par Stéphane Capron pour Sceneweb :
photo Ruth Walz
Peter Sellars est l’invité d’honneur du 21ème Festival de Marseille. Un festival qui prend un tournant cette année avec l’arrivée de Jan Goossens, son nouveau directeur artistique. L’ancien patron du KVS de Bruxelles a de l’ambition pour Marseille. Il souhaite donner une dimension internationale à son festival. Pour l’ouverture, il a programmé Flexn à la Criée. Un spectacle détonnant et joyeux de Reggie ( Regg Roc ) Gray et Peter Sellars où l’on découvre une troupe de danseurs de Brooklyn, tous adeptes du flexing, un nouveau phénomène de danse à la croisée du R’n’B et du hip-hop, inspiré par le bruk-up jamaïcain et le son des clubs reggae.
Ce spectacle est aussi un engagement pour Peter Sellars en réponse aux injustices subies par la communauté Afro-Américaine. Ces jeunes racontent leur vie sur scène au rythme d’une bande son inouïe de Eminen à James Blake en passant par Justin Timberlake. Le public de la Criée, très mélangé, a réservé une ovation à ces danseurs très touchants, à la technique invraisemblable.
Peter Sellars, arrivé tout droit de New-York est présent à Marseille, avant de partir à Aix pour sa mise en scène de l’Opéra Œdipus Rex, opéra-oratorio d’après Sophocle sur une musique de Stravinski (les 15 et 17 juillet). Rencontre avec un metteur en scène généreux et bouillonnant !
Vous les avez rencontrés par hasard alors que vous répétiez un opéra à New-York.
Oui j’étais au Park Avenue Armory pour répéter La passion selon Saint Mathieu et ces jeunes étaient dans le bâtiment. Ils m’ont présenté leur travail. J’ai tout de suite été étonné par leur technique, par leur intensité et par leur générosité. C’est très rare dans toute l’histoire de la danse d’observer qu’elle n’est pas simplement décorative ou géométrique. Ici elle est capable de franchir des émotions subtiles et complexes. Au milieu du 19ème il y a eu le Gisèle d’Adolf Adam où la danse était capable d’exprimer la vie des paysans déprimés. Et avec le Flexn on découvre un nouveau vocabulaire capable d’exprimer la vie des quartiers. C’est drôle, rigolo, étonnant, tendre, profond et touchant.
Ces danseurs ont la particularité de posséder une très grande technique mais aussi d’avoir vécu des émotions très fortes dans leur vie personnelle.
Oh oui, dans la distribution il y a un danseur qui s’appelle Cal. C’est pour moi le nouveau Barychnikov. Il possède une grâce et une intensité. Avec un seul petit mouvement d’épaule il parvient à vous électriser. C’est le nouveau Micha, mais il ne vient pas de Riga, il vient de Brooklyn ! C’est un ancien militaire qui a combattu en Irak. Il danse avec son expérience. On l’imagine sauter avec son parachute, c’est incroyable ! Tous ces danseurs possèdent une vie intérieure très riche que l’on sent sur le plateau. Et du coup le spectacle est différent chaque soir. On ne peut pas arriver à cela avec les ballets classiques ou les créations contemporaines.
A travers les expériences de vie des uns et des autres, vous avez conçu une dramaturgie. Le spectacle raconte l’histoire des Afro-Américains, de l’esclavage aux récentes fusillades contre la communauté noire.
Il fallait dans cette période très trouble aux États-Unis, alors que les coupables des tueries sont exonérés ; dénoncer le déséquilibre du système judiciaire américain. Les jeunes noirs sont confrontés chaque jour à ce système. Alors on y met de l’humour et de la distance. On ne fait pas que se plaindre car il faut être plus intelligent que l’ennemi. On a placé le spectacle en dehors de la rhétorique sur le racisme pour ne pas se faire piéger. La danse permet de dépasser les clichés. On montre des êtres humains splendides.
Si ces jeunes n’avaient pas fait de la danse dans la rue, ils auraient pu sombrer dans la délinquance.
Oui et tout ce qui est dansé sur scène raconte leur vécu dans la rue. Au départ du projet je leur ai demandé de me livrer des anecdotes sur leur vie au travail, leur rapport avec les flics ou la justice…Tous les récits viennent d’eux. Je n’ai rien inventé. C’est un « vulcano ». C’est incroyable et ça vient des quartiers là où l’on imagine qu’il ne se passe rien.
L’Europe est en crise, crise identitaire, crise politique avec le Brexit des Anglais, l’Europe est attaquée par le fanatisme, comment de New-York vivez-vous ces évènements ?
C’est horrible ! L’Europe ce n’est pas le passé. L’Europe est déjà africaine, elle est déjà marocaine ! C’est ça votre futur ! C’est triste avec la tuerie du Bataclan de voir que quelques jeunes français ne se sentent pas d’ici. Tous ces jeunes de banlieue ne vivent pas dans le désert. Leur culture est florissante, il faut les écouter en imaginant un nouveau système éducatif en partant de leur expérience et de leur propre langage. On est capable de vivre ensemble, c’est la preuve ici à Marseille ! Votre culture est composite depuis le 12ème siècle. C’est la richesse de la Méditerranée.
Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 6:28 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde :
Prenons le programme d’Avignon : sur les vingt-quatre pièces présentées, six sont estampillées « d’après ». Le Flamand Ivo van Hove ouvre le festival, jeudi 6, avec Les Damnés, d’après le film de Luchino Visconti. Puis arrivent deux jeunes Français, Julien Gosselin avec 2666, d’après le roman de Roberto Bolaño, et Jean Bellorini avec Karamazov, d’après Les Frères Karamazov, de Dostoïevski. D’autres suivent, qui viennent conforter une tendance lourde : on ne compte plus les « d’après » dans la liste des pièces programmées en cours de saison, particulièrement en 2015-2016. Il ne s’agit pas seulement de spectacles écrits et mis en scène en s’inspirant d’un roman ou d’un scénario, mais de pièces écrites d’après d’autres pièces. C’est le cas de Phèdre(s), créé par Krzysztof Warlikowski à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, avec Isabelle Huppert, ou de What if They Went to Moscow ?, d’après Les Trois Sœurs, de Tchekhov, mis en scène par Christiane Jatahy au Théâtre national de la Colline – deux productions marquantes de la saison.
Ces « d’après » fleurissent à un moment où la question du répertoire et de son approche se pose d’une manière nouvelle. D’un côté, les auteurs classiques tiennent bien la route, même si ce sont souvent les mêmes qui reviennent : Shakespeare, Molière et Tchekhov sont particulièrement présents sur les scènes. D’un autre côté, il y a de plus en plus d’auteurs qui écrivent du théâtre et sont publiés. Mais très peu sont joués. Paresse des metteurs en scène ? Faiblesse des textes ? Frilosité des directeurs de théâtre ? Quoi qu’il en soit, à part quelques exceptions comme Michel Vinaver ou Edward Bond, tous d’eux d’âge respectable, les dramaturges contemporains plus jeunes sont souvent les propres créateurs de leurs pièces : Joël Pommerat, Wajdi Mouawad, Angélica Liddell, Pascal Rambert, Rodrigo Garcia… Rares sont ceux qui mènent un vrai compagnonnage avec un metteur en scène, comme Fabrice Melquiot avec Emmanuel Demarcy-Mota ou Falk Richter avec Stanislas Nordey.
Faire le spectacle
Ce dernier, fervent défenseur des pièces contemporaines, qu’il monte à la virgule près, se demande, avec son ironie cinglante, si la vogue des « d’après » ne s’explique pas par le fait que « les metteurs en scène ont peur de perdre leur pouvoir ». Il est vrai que, au cours des dix dernières années, leur fonction a sensiblement évolué. Le temps est loin où ils étaient considérés comme des monarques absolus, et vilipendés pour cette raison. L’éclosion des collectifs, souvent auteurs de leurs spectacles de A à Z, et celle du théâtre documentaire ont modifié le paysage et le répertoire au sens large, tel qu’on l’entend aujourd’hui. L’acteur a repris une place de choix sur les scènes, et l’évolution de la technique a ouvert la voie à de nouvelles perspectives artistiques.
« Impossible de voir une pièce sans vidéo ! », entend-on dire, souvent pour s’en plaindre, parfois pour s’en réjouir. La maîtrise de l’image filmée jointe aux progrès en matière de lumière et de son permettent de fabriquer des spectacles qui, comme ceux de Romeo Castellucci, font rimer arts plastiques et théâtre. L’écriture, au sens large, est donc aujourd’hui protéiforme. Julien Gosselin, 29 ans et benjamin d’Avignon, est né dans ce bain. Depuis ses débuts, il a fait le choix d’un répertoire contemporain : après Fausto Paravidino et Anja Hilling, pour les auteurs de théâtre, Michel Houellebecq et Roberto Bolaño, pour les romanciers. Sa mise en scène des Particules élémentaires, en 2013, a été une révélation dans la Cité des papes, où il propose cette année un marathon qui s’annonce comme l’événement du festival : douze heures pour rendre compte des 1 352 pages (dans l’édition Folio) du fantastique 2666, qui explore le mal au tournant du XXIe siècle.
« Il faut monter du contemporain, dit Julien Gosselin. Sur ce point, je rejoins Stanislas [Nordey]. Certains ne doutent pas qu’on puisse le faire en mettant en scène des pièces classiques. Je suis d’accord, jusqu’à un certain point. On peut dire que le bourgeois de Feydeau parle du trader. Mais je pense que c’est faux. Tout n’est pas dans tout. Il y a des sentiments contemporains qu’on ne peut pas aborder autrement qu’en montant des auteurs contemporains, comme la solitude et la compétition sexuelles dont parle Houellebecq dans Les Particules élémentaires. » Julien Gosselin n’a pas non plus envie d’entendre qu’il ôterait le pain de la bouche des auteurs dramatiques quand il s’attaque à des romans. Seul compte l’intérêt du sujet, et que celui-ci soit résolument d’aujourd’hui.
Lire aussi : Julien Gosselin : « J’aime les auteurs qui osent des sujets plus grands qu’eux »
Qu’il mette en scène des romans n’a rien de nouveau, en soi. Il y a belle lurette que le répertoire n’est plus uniquement dramatique, et que des monuments de la littérature sont portés au théâtre. Dès 1874, deux ans après la parution des Démons, Dostoïevski fut sollicité, et il donna son accord, en précisant : « Je ne saurais me priver de faire remarquer que ces tentatives sont généralement vouées à l’échec ou, tout du moins, ne réussissent que partiellement. L’art recèle quelque chose de mystérieux qui empêche une forme dramatique. » L’avenir a donné tort à Dostoïevski, que des metteurs en scène, comme l’Allemand Frank Castorf, ont porté à son incandescence. Et l’auteur de L’Idiot reste à ce jour l’indépassable numéro un des romanciers élus par le théâtre, même s’il a été talonné par Kafka au tournant des années 2000, et si Thomas Bernhard est très bien placé depuis plusieurs années.
Jean Bellorini a voulu faire entendre Les Frères Karamazov pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il voit la fonction du metteur en scène avant tout comme celle d’un « passeur de texte », quel qu’il soit. Ensuite parce qu’il travaille depuis ses débuts avec les mêmes comédiens, et que sa troupe était prête à aborder Dostoïevski. Enfin, parce que, dit-il, il voulait « faire un spectacle sur une question essentielle d’aujourd’hui : le chaos du monde et sa possible reconstruction. Ce sont Les Frères Karamazov qui en parlent le mieux ». Ce faisant, Jean Bellorini reste fidèle à sa démarche, qui l’a mené à mettre en scène aussi bien Hugo (Tempête sous un crâne, d’après Les Misérables) et Rabelais (Paroles gelées, d’après Le Quart Livre) que des pièces, La Bonne Ame du Se-Tchouan, de Bertolt Brecht, ou Liliom, de Ferenc Molnar. Le jeune (35 ans) directeur du Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis aime se frotter au côté « structurant » du répertoire et s’engouffrer dans des œuvres romanesques immenses. « J’ai besoin de monstres qui m’offrent une richesse d’âme, de personnages, de sujets », reconnaît-il.
Le goût du récit revient en force
S’il ne tenait qu’à lui, Jean Bellorini n’indiquerait pas Karamazov, d’après Les Frères Karamazov, mais plutôt « Karamazov, morceaux choisis des Frères Karamazov ». Julien Gosselin est sur la même ligne, mais il est beaucoup moins conciliant. Pour dire les choses comme elles sont, ça l’énerve que les programmateurs et directeurs de théâtre accolent un « d’après » aux crédits de ses spectacles. « Quand je monte 2666, c’est 2666, de Roberto Bolaño, point. Je n’ai aucun problème avec les questions de la trahison ou du respect de l’auteur. Pour moi, ces questions ne se posent même pas. Mon travail consiste à donner ma vision des Particules élémentaires de Houellebecq ou de 2666 de Roberto Bolaño. Si ensuite des gens ont envie de dire : “C’est une trahison”, ils ont le droit. Reste que la liberté du metteur en scène est fondamentale et totalement normale. »
Cette liberté s’inscrit dans un contexte où le goût du récit est revenu en force dans le théâtre. Dans Ivo van Hove (Actes Sud, 2014), un livre d’entretiens avec Frédéric Maurin, le metteur en scène flamand confie que « rien ne [l]’intéresse tant que de raconter des histoires ». Serait-ce parce que, en ce début de XXIe siècle particulièrement troublé, notre désir de consolation serait particulièrement insatiable ? Ou alors parce que l’actualité s’accompagne, jour après jour, d’un vacillement de la vérité ? Krystian Lupa va dans ce sens. Le maître polonais présent à Avignon avec Place des héros, de Thomas Bernhard, puis en majesté au Festival d’automne, qui lui consacre un portrait, avec trois mises en scène puisées dans l’œuvre dramatique et romanesque de Bernhard, pense que le metteur en scène dit aujourd’hui « je » pour mieux mettre le spectateur face à un questionnement du monde et de soi dans ce monde.
Krzysztof Warlikowski, qui fut son élève, exprime la même pensée, à sa façon. « J’ai commencé à faire du théâtre après la chute du mur de Berlin, raconte le metteur en scène polonais. Tout a changé, le monde n’est plus bipolaire. Mon théâtre est né dans et de ce bouleversement. » C’est peut-être à cette aune qu’il faut reconsidérer les « d’après ». Et se demander si, finalement, ils ne témoignent pas moins d’une réécriture « d’après » que d’un temps d’après : le nôtre, qui génère un répertoire reconsidéré. Un répertoire sans fin, avec des questions sans fin.
Brigitte Salino
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 6:17 PM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama :
Quelle mouche a donc piqué Jean-Paul Montanari, directeur de Montpellier Danse ? En quelques déclarations fracassantes, il vient de bousculer le milieu chorégraphique et les équilibres culturels montpelliérains. Son idée : fusionner Montpellier Danse, Le printemps des comédiens, et le Festival de Radio France. Rien que ça.
Très chagrin, Jean-Paul Montanari ? A 68 ans, le directeur du Festival Montpellier Danse dont il assume la responsabilité depuis 1983 (avec puis sans son fondateur Dominique Bagouet), porte sur la danse un regard désormais teinté de mélancolie... Au début de cette 36e édition, il vient de jeter un pavé dans le marigot, en annonçant, lors d'une interview parue le 23 juin, dans l'hebdo local La Gazette de Montpellier, la mort de la danse contemporaine ; et en préconisant surtout la création d'un seul gros festival pour porter les ambitions de Montpellier dans la course à la reconnaissance culturelle.
En clair, il s'agirait de fusionner avec ceux de Montpellier Danse, les projets et les moyens du Printemps des Comédiens (consacré au théâtre et soutenu par le département), et ceux du Festival de Radio France, créé en 1985, aujourd'hui financé en majorité par la région. Soit deux festivals qui se portent très bien, tant du point de vue artistique que de celui de la fréquentation.
Dans la capitale de l'ex-Languedoc-Roussillon, l'idée de perdre des festivals plébiscités est le plus souvent accueillie avec tristesse. Avec lassitude aussi, car cette vision de l'avenir est surtout symptomatique d'une guerre souterraine que se mènent dans cette région les collectivités territoriales qui, dans le cadre de la nouvelle loi NOTRE, devront se partager leurs compétences d'intervention (le social, l'éducation, la culture...) d'ici fin 2017. Le maire Philippe Saurel, président de la Métropole, veut la culture et toute la culture... D'où l'importance politique d'une telle déclaration de Jean-Paul Montanari peu avant que ne commence (plutôt très bien), le week-end dernier, son festival, et que ne finisse, pile au même moment (lui aussi très joliment), Le Printemps des Comédiens. On a voulu en savoir plus…
En déclarant que la danse contemporaine est morte, vous sonnez la fin de l'histoire...
Il s'agit davantage d'un cycle qui s'achève, celui de la forme artistique née avec « la jeune danse française » au milieu des années 70, – les Dominique Bagouet, Maguy Marin, Régine Chopinot, Karine Saporta, Jean-Claude Gallotta... –, directement inspirée de la danse américaine mais que l'on a aussitôt appelée « danse contemporaine » parce qu'elle inventait son langage par opposition politique et formelle au ballet classique. La génération qui l'a portée – la mienne – est en train de s'en aller. Quelque chose d'autre va naître. Pour autant, regrouper aujourd'hui toutes les formes artistiques sous le même chapeau « danse contemporaine » ne me convainc pas. Les critères auxquels s'est référé cette danse contemporaine, comme l'écriture chorégraphique, le mouvement, ou la réflexion sur l'espace, ne sont plus le centre pour les nouvelles générations. Le mouvement de la « Non Danse » des années 90 en était déjà le signe. On est entrain de passer à une autre histoire.
Prenons l'exemple de William Forsythe, cet Américain installé en Europe : il vient de la danse classique, il traverse et explore la danse contemporaine, puis en sort. Les dernières chose que j'ai vues de lui à Francfort quand il y était encore, ce sont des installations d'art plastique ! On peut continuer à mettre tout et n'importe quoi sous cet intulé « danse contemporaine » en cours depuis cinquante ans, mais cela me gêne...
Les artistes d'aujourd'hui n'abandonnent ni le mouvement ni son écriture. A Montpellier Danse, cette année, vous programmez Emmanuel Gat et Christian Rizzo, chorégraphes qui soignent la forme...
Oui, bien sûr, il y a un certain nombre de gens qui ont du talent, mais attendons la suite. Comment vous expliquer... J'ai été l'un des personnages de cette histoire des années 80. Je me souviens du premier programme de Montpellier Danse, alors conçu avec Dominique Bagouet, par Robert Berthier, directeur général des JMF et administrateur de la compagnie. On y trouvait les solistes venus de l'Opéra de Paris ou de chez Béjart, mais aussi cette jeune danse qui arrivait en force : Susan Buirge, Régine Chopinot, Bouvier et Obadia, Saporta. Tous étaient là, tout de suite ! Et bien, cette histoire-là est finie, je le sens, je le vis de l'intérieur. Cet art mettant au centre le corps et le désir qui fut porté par la génération post-68 n'intéresse selon moi plus personne. Aux historiens de la danse de juger si j'ai raison.
Que faites-vous de tous ces jeunes habités par un tel désir de danser, formés dans les conservatoires ou les pôles de formation supérieurs répartis dans toute la France ?
Ce sont des queues de comètes, la fin d'un dispositif mis en route il y a longtemps. Cela arrive jusqu'à nous mais ne correspond plus au sens de l'histoire.
Mais il y a toujours des femmes et des hommes qui dansent et qui sont nos « contemporains » ! Qui programmez vous donc dans votre festival ?
Je cherche des artistes qui ont quelque chose à dire. Par exemple, cette 36e édition, se tourne vers la Méditerranée. Le fait qu'ils soient libanais, tunisiens, ou marocains, est le critère du choix. A condition qu'ils aient du talent, bien sûr. J'ai aussi rêvé sur le temps qui passe en invitant de grandes compagnies qui ont représenté cette danse contemporaine justement... Celle de Jacopo Godani, née après le travail de William Forsythe à Francfort, ou le Ballet Cullberg de Stockholm [dirigé par le chorégraphe Mats EK jusqu'en 2003, NDLR]. Inviter de telles troupes est indispensable à Montpellier Danse. Car il y a un « syndrome Béjart » dans les festivals : si l'on n'y offre pas de grandes formes populaires, la danse regagnera les catacombes. Pour fédérer le public et continuer à me battre pour que la danse soit un art à part entière – il fut soumis à la musique et trop longtemps déconsidéré et désargenté – il me faut remplir les 1800 places de la grande salle du Corum !
Mais c'est une contrainte terrible ! Cette salle correspond aux années 80 et surtout à l'ambition d'un maire, Georges Frêche, qui voulait faire un geste architectural démonstratif...
Oui, vous avez tout compris.
Cette salle est inhumaine pour le public, trop imposante !
C'en est fini de la danse si vous pensez ça ! Jacopo Godani, qui vient d'y présenter sa création, l'adore. C'est cette salle à Montpellier qui donne sa légitimité populaire à la danse. Si on ne la remplit pas, le festival disparaît ! Montpellier n'a que 400 000 habitants, et malgré ses difficultés, la métropole consacre pourtant 1,5 million d'euros par an à la danse. Alors je ne peux pas programmer seulement la recherche expérimentale d'une Nacera Bellaza au studio Bagouet ! C'est une question autant politique qu'économique, propre à tous les festivals : à Avignon, quand on rate la Cour d'honneur, le reste du festival s'en ressent. Il joue sa légitimité à cet endroit. J'ai de plus en plus de mal à trouver des troupes qui relèvent le défi. Toutes les grandes compagnies américaines sont en voie de disparition (T. Brown, Bill T Jones), d'autres grands chorégraphes se sont éloignés de la scène comme Jiri Kylian ou William Forsythe, et je ne peux pas m'offrir le New York City Ballet [comme le Châtelet, à Paris, NDLR] ! Le Ballet de L'Opéra de Paris était venu du temps de Brigitte Lefèvre, et avait convaincu le public...
Au fond, c'est dans les maisons d'opéra que l'on trouve les seules compagnies avec de nombreux danseurs quand les centres chorégraphiques nationaux sont encore sont sous-dotés par rapport aux centres dramatiques nationaux. Les ballets invitent d'ailleurs de plus en plus les chorégraphes à venir créer chez eux. Ils ont gagné.
Pourquoi lancez-vous l'idée pour Montpellier d'un énorme et unique festival à partir des trois grands – dont le vôtre – qui font pourtant leurs preuves ?
Je participe depuis trente-cinq ans à l'histoire du premier né d'entre eux, dont l'image s'est vite associée à celle de la ville. Aujourd'hui, dans la mesure où les compétences culturelles du département vont revenir en grande partie à la métropole, le moment est venu de revisiter leur histoire et de réfléchir à quelque chose comme « Le Festival de Montpellier » à l'identique du « Festival d'Avignon » ou du « Festival d'Aix-en-Provence », avec des moyens de production renforcés. On y présenterait de la danse, mais aussi du théâtre, du cirque et même du lyrique. Voilà une manière de contrer l'éparpillement des forces, c'est tout ce que je dis. Cela fait sourire Philippe Saurel, le maire de Montpellier. Il a les cartes en mains, je ne suis pas décideur.
Ces trois festivals réussissent à conjuguer ambition artistique et succès public... Ce qui surprend dans votre hypothèse – dont le sens politique n'est pas anodin quand les équilibres des pouvoirs sur le territoire sont remodelés – c'est qu'elle détruit des rendez-vous à l'identité très forte, la chose pourtant la plus difficile à construire !
Il ne s'agit pas de destruction mais d'évolution. D'abord, d'un point de vue artistique : aujourd'hui, les salles qui programment du théâtre diffusent aussi de la danse ou de la performance, il faut s'adapter ! Ensuite, parce que sur le plan de la communication, Montpellier mérite un vrai grand festival ! De toutes façons, la loi n'est pas de notre fait. Elle est écrite ainsi et attribue à la Métropole la possibilité de choisir un certain nombre de compétences, comme celle de la culture, qui appartenaient jusque là au département, par exemple. C'est comme ça, c'est la vie.
La loi préconise un accord entre les collectivités territoriales...
Les négociations entre Philippe Saurel, président de la Métropole et Kléber Mesquida, président du département de l'Hérault, n'ont pas abouti. Le préfet décidera...
Vous prenez un risque à désirer une telle fusion, vous allez créer un monstre aux pieds d'argile, car, plus les sources de financement publiques sont variées, plus les projets sont protégés en cas d'alternance politique radicale.
C'est au maire qu'il faut poser cette question. Moi, je n'ai aucun pouvoir, j'observe et je dis ce que je pense en tant que fabriquant de festival depuis trente ans...
Vous concevez donc cela comme une évolution souhaitable pour Montpellier Danse ? Même si son héritage serait, à la fin, dilué dans un grand tout... N'est-ce pas le signe d'une amertume de votre part ?
C'est une manière de répondre à la question qu'on me pose sur la suite, le jour où je partirai..
.
C'est mieux que de transmettre ?
Il n'y a pas de legs possible. Le festival n'est tout de même pas une affaire de famille et je ne suis pas Louis XIV non plus ! Pendant trente-six ans, j'ai largement eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire et envie de faire. Il n'y a rien à transmettre, personne ne peut le comprendre. C'est intraduisible. Le président du conseil d'administration du festival décidera après mon départ. Vous ne pensez tout de même pas que je vais m'occuper de cela.
Montpellier Danse en tant que tel s'est épanoui grâce à vous ; il peut exister sans vous d'une autre manière... Mais que vous l'imaginiez, à cet instant précis, avalé par un autre, c'est cela qui est troublant...
C'est peut-être la garantie et la certitude de sa pérennité au contraire. Malgré les craintes que je nourris à propos de la danse contemporaine dont je reste persuadé, comme je vous l'ai dit, que c'est l'art d'une génération qui va finir en même temps que moi.
L'histoire s'achève avec vous, comme celle du PS, à la fin, dans l'esprit de Mitterrand ?
Cette hypothèse n'est pas exclue.
Tout ça pour ça ! Vous qui vous êtes tellement battu pour les artistes !
Ma conception de la mort est particulière. L'artiste dont je me sens le plus proche est Merce Cunningham. Or, il a écrit qu'après lui, il n'y avait plus de compagnie, plus rien. Voilà. La danse, c'est ça. Après l'instant, il n'y a plus rien, pas de trace. Pas comme pour la littérature, la peinture ou la musique. Il faut arrêter de penser que l'on peut retenir la danse. Elle s'en va pour toujours. Cela me va très bien !
Mais pour un festival, ce n'est pas la même chose. C'est une institution avec un public – qui attend, à chaque saison, le retour du même rendez-vous. Et cela serait paradoxal qu'une nouvelle étape de la décentralisation aboutisse à un regroupement, une sorte de centralisme au niveau local !
J'essaye de penser ; je ne dis pas que j'ai raison.
A voir
Festival Montpellier Danse, jusqu'au 9 juillet 2016. Montpellierdanse.com

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 5:41 PM
|
Par Aurélien Ferenczi dans Télérama :
A 32 ans, la jeune metteuse en scène présente “Ceux qui errent ne se trompent pas”, sur fond de déluge et d'abstention généralisée. Sous son influence, le Festival va-t-il déborder de son lit ?
Elle jure qu'elle n'est pas devin. Pourtant, les répétitions et la création de Ceux qui errent ne se trompent pas — qui imagine une révolution citoyenne par un massif vote blanc à un scrutin national — ont accompagné le phénomène Nuit debout. Mieux, cette pièce, noyée sous des trombes d'eau, « parce que la pluie apporte une dimension fantastique et poétique et qu'elle me permet d'associer crise écologique et crise politique », s'est trouvée raccord avec les pluies diluviennes qui s'abattaient sur la France. « Quand on pense qu'un spectacle se conçoit deux ans à l'avance, c'est dingue ! On a cumulé les prophéties », s'exclame-t-elle en souriant.
Actrice et metteuse en scène, Maëlle Poésy, 32 ans, rayonne. Elle s'émerveille encore du parcours accompli et de l'année en cours : une mise en scène à la Comédie-Française (deux pièces courtes de Tchekhov en janvier), puis une invitation dans le « In » d'Avignon. Son nom et son (joli) visage vous disent quelque chose ? Normal, elle est la sœur cadette de Clémence Poésy, actrice de cinéma révélée il y a dix ans par un Harry Potter, remarquée dernièrement dans Le Grand Jeu, de Nicolas Pariser, et dans la série Tunnel.
Funérailles d'hiver
Les deux sœurs se ressemblent : même blondeur, même destin... ou presque. Elles ont grandi dans les Hauts-de-Seine, une mère prof de français, un père théâtreux. Avant de créer sa compagnie, Etienne Guichard (elles ont choisi le nom de leur mère, parce qu'il est... « très beau ») était de l'aventure du Campagnol, dont les créations enflammèrent le théâtre français des années 1970. « Le Bal, c'était deux ans avant ma naissance, mais j'ai vu le film et j'ai des souvenirs de La Piscine, à Châtenay-Malabry, le lieu où résidait la compagnie. Ma sœur et moi avons énormément joué dans notre chambre, souvent avec des costumes récupérés de divers spectacles. Et notre mère nous lisait beaucoup d'histoires. L'envie de faire ses propres images à partir des mots vient peut-être de là... »
Alors que sa sœur est happée par le cinéma, Maëlle entre comme élève comédienne à l'école réputée du Théâtre national de Strasbourg. « Parce qu'on y forme aussi des dramaturges et des scénographes, et que c'était une façon de rencontrer plein de métiers de théâtre. » Elle y propose vite une mise en scène : Funérailles d'hiver, de Hanokh Levin. Surtout, elle y rencontre Kevin Keiss, deux « promos » au-dessus d'elle, qui va devenir son dramaturge et auteur attitré.
Candide
Ensemble, ils adaptent en 2014 Candide, de Voltaire, transformé en conte moderne, remarqué par Eric Ruf, l'administrateur de la Comédie-Française, et Olivier Py, le patron du Festival d'Avignon. Puis, en lisant La Lucidité, roman du Prix Nobel portugais José Saramago et en appréciant « ce qu'il dit de la démocratie », elle a l'idée de Ceux qui errent ne se trompent jamais, écrit à nouveau par Kevin Keiss. Du théâtre politique, alors ? « Je me méfie des étiquettes, mais ce qui me plaît, c'est quand une fiction a vocation à interroger le rapport au pouvoir. »
Si les spectacles d'Ariane Mnouchkine ou de Joël Pommerat l'ont marquée, Maëlle Poésy dit s'inspirer du cinéma, « pour le montage, les fondus enchaînés, l'illusion de passer d'un plan large à un plan serré... » Et celle qui a étudié en fac les créations de Sidi Larbi Cherkaoui avoue « chorégraphier énormément son travail ». Elle s'accompagnera d'ailleurs d'un chorégraphe pour monter Orphée et Eurydice, de Gluck, en décembre à l'Opéra de Dijon. « Jouer ne me manque pas trop, parce que mon quotidien est très dense, mais c'est quelque chose dont il ne faut pas trop se couper quand on est metteur en scène. » Une joyeuse (jeune) femme-orchestre, en quelque sorte.
A voir Ceux qui errent ne se trompent jamais, de Kevin Keiss. Mise en scène : Maëlle Poésy. Du 6 au 10 juillet, à 15h, Théâtre Benoît-XII, Avignon. En tournée à partir du 5 novembre, notamment du 5 au 16 décembre au Théâtre de la Cité internationale, Paris 14e
AVIGNON 2016 : UNE ÉDITION ENGAGÉE
Engagé et politique comme jamais ce soixante-dixième Festival ! Il invite les grands auteurs qui ont pensé le chaos du monde au mitan du XXe siècle (Thomas Bernhard réglant ses comptes avec l'Autriche nazie, mis en scène par Krystian Lupa ; Visconti et son scénario des Damnés monté par Ivo van Hove...) comme les Russes du XIXe observant avec ténacité la folie des hommes (Les Frères Karamazov, de Dostoïevski, revus par Jean Bellorini, ou Les Ames mortes, de Gogol, adapté par la tellurique équipe moscovite de Kirill Serebrennikov)… Il compte aussi sur le regard porté par de plus jeunes équipes (Maëlle Poésy, le Raoul Collectif, Sofia Jupither) sur la démocratie comme elle va... Et fait écho au Moyen-Orient grâce au Syrien Omar Abusaada ou à l'Iranien Amir Reza Koohestani. De quoi penser avant de refaire le monde en mieux.
Du 6 au 24 juillet, à Avignon (84), festival-avignon.com, 0-49 €.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 3:17 AM
|
Par Marie-Pierre Ferey pour AFP TV5Monde :
C'est un maître du théâtre et un fan absolu de cinéma. Ivo van Hove va piloter le grand retour de la Comédie-Française après 23 ans d'absence au Festival d'Avignon, avec l'adaptation du scénario des "Damnés" de Visconti.
"Pour un metteur en scène, la Cour d'honneur est un grand défi. Ne pas s'y confronter, ce serait un peu comme refuser de monter Shakespeare, autant changer de métier!" lance-t-il.
Ivo van Hove fait partie de la poignée de metteurs en scène d'envergure mondiale que les grandes scènes s'arrachent. Ses pièces sont parfois données en plusieurs langues, comme "Vu du pont", donnée en Français au théâtre de l'Odéon et en anglais à Londres puis New York. Il est aussi un des derniers à avoir travaillé avec David Bowie, sur la mise en scène de la pièce musicale "Lazarus", peu avant sa mort.
Lorsque Eric Ruf, le patron de la Comédie-Française, l'a sollicité pour la Cour d'honneur il n'a pas hésité une seconde. "On ne savait pas quelle serait la pièce, mais j'ai dit oui immédiatement. On a beaucoup discuté, de textes classiques ou modernes du XXe siècle, et j'ai demandé à Eric Ruf si on pouvait faire quelque chose qui ne se fait pas tellement à la Comédie-Française par exemple une adaptation d'un film, et là c'est lui qui a dit oui immédiatement."
Eric Ruf cherchait depuis des mois un maître du théâtre pour frotter la troupe à d'autres esthétiques, d'autres méthodes, la "bousculer".
Il ne pouvait mieux trouver: Ivo van Hove a mis au point une esthétique unique, qui mélange subtilement le théâtre et le cinéma. Il aime s'emparer de films pour les adapter au plateau. Certaines scènes sont filmées "live" en coulisses, offrant un contrechamp au jeu des acteurs. "Les Damnés" sont son troisième emprunt à Visconti, après "Rocco et ses frères" et "Ludwig".
"J'ai vu beaucoup de films, je suis un film freak", avoue-t-il. "A 57 ans, j'ai fait beaucoup de théâtre et pour un metteur en scène c'est un défi d'inventer un monde théâtral à partir d'une matière qui n'avait pas été pensée pour ça, Visconti n'a jamais eu l'intention de faire une pièce de théâtre des Damnés".
- Montée des populismes en Europe -
Le spectacle s'ouvre sur des images d'archives de l'incendie du Reichstag. Les flammes en noir et blanc dévorent l'écran tandis que les comédiens prennent position sur scène. On est dans la maison familiale des Essenbeck, une dynastie allemande à la tête d'aciéries vitales pour le Reich. La pièce raconte le basculement de la famille dans la barbarie nazie et dans la haine.
Pour Ivo van Hove, "il y a beaucoup de raisons sur le plan politique de faire ce spectacle aujourd'hui. On voit partout en Europe mais aussi dans le monde, en Amérique, une montée des populismes et de l'extrême droite - et je ne vais pas comparer ces partis avec le nazisme - mais il y a quelque chose qui donne à réfléchir: quand un chef d'Etat, un politicien nous dit de suivre nos sentiments profonds, nos pulsions, c'est dangereux".
"Un autre thème très important dans ce spectacle est la liaison dangereuse entre le monde économique et le monde politique, pour des raisons purement opportunistes, là il s'agit de sidérurgie mais aujourd'hui on pourrait penser au pétrole ou au commerce des armes".
"Le troisième thème important pour moi, c'est le basculement des valeurs, en un temps très court. Le jeune Martin (l'héritier des aciéries) finit par devenir nazi, non pas par idéologie, mais parce qu'il est utilisé par les vrais idéologues. Martin est frustré parce qu'il ne reçoit pas l'amour de sa mère qu'il désire tellement, et il devient un fasciste pour se venger d'elle".
Pour Ivo van Hove, "on peut comparer cela au jihadisme: ce sont toujours des jeunes hommes qui sont frustrés dans la société, qui n'ont pas de boulot, ce n'est jamais pour des raisons idéologiques, ce sont les religieux radicaux qui utilisent ces jeunes gens, qui ont rarement plus de 30 ans".

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 6:29 PM
|
Par Agathe Charnet dans Le Monde
Qu’il semble loin le temps où Jean Vilar créait bon gré mal gré à l’automne 1947 « Une semaine d’Art en Avignon », refusant dans un premier temps d’investir la Cour d’honneur du Palais des papes, jugée « trop informe ». L’époque où les artistes de tous bords investissaient la Cité des papes dans les années 70, coiffant « les classiques au poteau » et « la culture à l’égout » sous la houlette d’André Benedetto et Bertrand Hurault, qui donnèrent naissance au Festival « off ».
En 2016, le Festival « in » d’Avignon, dirigé par Olivier Py et subventionné par des institutions publiques, célèbre sa 70e édition. De son côté, le Festival « off » d’Avignon, orchestré par l’association Avignon Festival & Compagnies sous la houlette de Raymond Yana, fête ses 50 ans de création, avec près de 1 400 spectacles présentés par des compagnies venues du monde entier. Du 6 au 30 juillet, ces deux structures jumelles métamorphosent les ruelles pierreuses d’Avignon en un véritable labyrinthe théâtral où les milliers d’affiches sont autant d’invitations aux arts vivants.
Pour vous y retrouver au milieu de cette myriade de lieux et d’artistes et vivre Avignon au rythme des cigales comme des performances, Le Monde Campus vous donne ici cinq conseils pour devenir un authentique festivalier :
Festival « in » : ruez-vous sur l’abonnement « 4/40 »
Pour avoir la chance de découvrir la programmation du Festival, l’abonnement « 4/40 » permet aux moins de 26 ans d’obtenir 4 places pour 40 euros. « Il reste des formules 4/40 disponibles à la vente, précise Virginie de Crozé, directrice de la communication du Festival. Même quand le spectacle affiche complet sur Internet, il faut être tenace et tenter sa chance. Nous remettons toujours des places en vente quarante-cinq minutes avant la représentation : au Festival d’Avignon, qui veut rentre ! »
Un des murs du Cloître Saint-Louis où se situe la billetterie principale, permet également aux spectateurs de coller de petits mots pour rechercher ou revendre une place.
Reste à choisir parmi les cinquante et un spectacles dont trente-six créations en danse, théâtre, musique et lectures.
Fabienne Darge, critique de théâtre au Monde, considère Les Damnés, d’après Visconti et interprété par la troupe de la Comédie-Française, comme « un incontournable de ce Festival 2016 ». Ce spectacle d’ouverture du Festival, mis en scène par Ivo van Hove, marque le grand retour de la Comédie-Française dans la Cour d’honneur du Palais des papes, après treize années d’absence.
Au public étudiant, Fabienne Darge recommande également les créations des jeunes metteurs en scène Jean Bellorini et Julien Gosselin, étoiles montantes de la scène française. Bellorini signe avec Karamazov une adaptation du roman éponyme de Dostoïevski, qui sera jouée en plein air dans « un lieu mythique d’Avignon », pour Fabienne Darge : la Carrière de Boulbon. « Il sera également passionnant d’assister aux représentations de 2666, par Julien Gosselin, ajoute Fabienne Darge. C’est l’adaptation d’un grand roman contemporain par un grand metteur en scène, une épopée de douze heures qui devrait laisser un grand souvenir de théâtre. »
Festival d’Avignon, réservation par téléphone + 33 (0) 4-90-14-14-14. billetterie sur place : Cloître Saint-Louis, 20, rue du Portail-Boquier ouvert tous les jours et Boutique du Festival, place de l’Horloge tous les jours à partir du 6 juillet de 10 heures à 19 heures
Festival « off » : explorez le plus grand théâtre du monde à – 30 %
Abondance de biens ne nuit pas, dit l’adage. Mais avec près de 1 416 spectacles dans le « off », le spectateur de bonne volonté peut bien vite se sentir submergé.
Raymond Yana, élu cette année président d’Avignon Festival & Compagnies qui coordonne le « off », recommande de préparer son festival en amont en consultant le programme sur le site Internet du « off » et de se rendre au Village du « off » pour obtenir toutes les informations sur les temps forts du Festival et acheter sa carte « off » (16 euros plein tarif) qui offre une réduction de 30 % sur tous les spectacles répertoriés dans le programme.
Pour faire vos choix, certains théâtres ont développé une forte identité, ce qui peut vous permettre de vous orienter. Ainsi, l’Île Piot est dédiée au cirque, le Théâtre Golovine à la danse, la Maison du théâtre pour enfants au jeune public, le Théâtre de Doms à la création Belge, et le Palace, aux humoristes. « Avec le nombre de spectacles présentés, il y a en pour tous et pour tous les goûts », précise Raymond Yana.
Pour dénicher la perle rare parmi la centaine de créations théâtrales contemporaines ou classiques, vous retrouverez tout au long du mois de juillet les critiques des journalistes du Monde, mais vous pouvez aussi regarder les chroniques critiques et débats de Festi Tv, WebTV du festival présentée par des étudiants ou écouter Radio Campus Avignon.
Et si vous avez été subjugué ou révolté par un spectacle, envoyez votre contribution critique à l’équipe d’ I/O Gazette, quotidien distribué gratuitement dans Avignon.
Mais pour vivre le « off » en véritable festivalier, promenez-vous au gré des affiches, laissez-vous séduire par les parades des comédiens qui distillent des extraits de leurs spectacles en pleine rue et franchissez la porte des théâtres.
Village du « off » : école Thiers – 1, rue des écoles, Avignon Centre
Jonglez entre gratuit et tarifs réduits
Entre le logement, les frais de déplacement et les spectacles, le Festival d’Avignon nécessite un véritable investissement financier. Heureusement il existe des parades pour réduire les coûts. La SNCF propose cette année un nouveau partenariat aux jeunes qui permet d’obtenir des billets de train aux tarifs préférentiels et un abonnement 4/40. Le site Mégabus propose des trajets de nuit à des tarifs défiant toute concurrence. Reste aussi le covoiturage avec des sites comme Blablacar.
Sur place, vous trouverez des auberges de jeunesse – généralement prises d’assaut durant le Festival – et le site Airbnb met en ligne des locations dans et hors les remparts. Pour ceux qui compteraient rester pour une longue durée, le Crous d’Avignon et les résidences étudiantes proposent chaque année des solutions de logement à condition de s’y prendre à l’avance. Enfin, les campings d’Avignon, accessibles à pied depuis le centre, demeurent un très bon choix pour les petits budgets.
Côté spectacles, vous pourrez si vous le voulez ne rien débourser. « Chaque année, certains festivaliers profitent uniquement des événements gratuits, précise Virginie de Crozé de la communication du Festival. Tous les jours à midi, le feuilleton théâtral Le Ciel, la Nuit et la Pierre glorieuse retrace l’histoire d’Avignon de 1947 à 2086. De la même façon, vous pouvez débattre sur des transats en assistant aux Ateliers de la pensée dans les jardins de l’université d’Avignon.
L’université d’Avignon propose également un riche programme de rencontres, de spectacles et de débats en accès libre, tandis que la vie au Village du « Off » sera rythmée par de nombreux événements culturels, politiques et festifs.
Les rues d’Avignon sont en soi un véritable spectacle durant le festival, entre la grande parade du 6 juillet, les différentes fêtes organisées pour le 14 juillet et les parades quotidiennes des compagnies, vous ne risquez pas de vous ennuyer !
Profitez du spectacle de la rue
Le Festival d’Avignon, célébration des arts vivants incontournable dans le paysage français et européen, fait également honneur au sens de la fête des artistes et des artisans du spectacle.
Pour jouer les noctambules, suivez notre programme. A l’heure de l’apéritif, avoir tenté de repérer vos acteurs préférés place de l’Horloge, allez vous attabler place des Corps-Saints et admirez le ciel et les affiches bariolées se déploient au-dessus de vos têtes. Ecoutez vos voisins de table faire la revue des spectacles du jour entre deux tournées et amusez-vous de leurs discussions endiablées.
A la tombée de la nuit, filez voir un spectacle et, en sortant, faites un tour au Village du « off » où des concerts gratuits ont lieu à partir de 22 heures. Puis allez faire un tour au Cubanito, bar latin où les jeunes comédiens se déhanchent sur de la musique cubaine. En cas de fringale nocturne, l’enseigne FoodandMets propose des frites maisons et des burgers jusqu’à 3 heures du matin. Pour les plus vaillants, allez admirer le lever du jour sur le pont d’Avignon depuis les berges du Rhône.
Et si vous faites parti des élus du Festival (ou si vous soudoyez un ami comédien), rendez-vous au Bar du « in » (accessible uniquement sur invitation), installé dans le jardin du Gymnase du lycée Saint-Joseph. Autour d’une ancienne piscine désormais garnie de canapés et de coussins, discutez avec les stars du festival et profitez de la douceur de la nuit avignonnaise.
Excellent Festival d’Avignon à tous !
Olivier Py donne aux jeunes les clefs d’Avignon
« Il n’y a pas une pierre, pas un platane à Avignon qui ne me touche » confie Olivier Py, qui s’apprête à diriger son deuxième Festival d’Avignon « in ». Celui qui a fait son premier Avignon « à l’âge de vingt ans dans le “off” en 1985, dans une troupe rejointe une semaine avant le début du festival » considère le rajeunissement du public du festival comme une de ses priorités. « Avec le projet Avignon Provence Culture Tech nous créons des ponts avec un public plus jeune, grâce à de nouveaux outils numériques à portée de main. L’application “To see or not to see”, permet par exemple de noter les spectacles du “in” comme du “off” ».
A Avignon, Olivier Py recommande tout particulièrement le Cloître des Célestins, « un lieu que j’investis d’une émotion particulière puisque j’y ai joué dans le “in” pour la première fois ». L’église des Célestins attenante accueillera cette année une exposition, des rencontres et des séances de cinéma gratuites.
Le maître d’Avignon donne enfin rendez-vous aux jeunes dans les jardins de l’université d’Avignon pour la fête de fin du Festival, prévue le 23 juillet, avec General Elektriks et Dj Pone.
Agathe Charnet
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 5:27 PM
|
Par Marie-Aude Roux dans Le Monde
Approcher L’Enlèvement au sérail selon Mozart – à savoir une bouffonne turquerie du XVIIe siècle – lui paraissait « cauchemardesque ». Le metteur en scène Wajdi Mouawad a donc effectué un important travail de réécriture du livret de Johann Gottlieb Stephanie. Le nouveau directeur du Théâtre de la Colline, qui réalisait ici sa première mise en scène d’opéra, n’a pas pour autant changé la trame du Singspiel de 1782.
Konstanze et sa suivante anglaise, Blonde, sont prisonnières dans un harem turc, tandis que leurs fiancés, le sieur Belmonte et son serviteur Pedrillo, dûment infiltrés, tentent de les sauver. Tout le monde sera relâché par le pacha magnanime. Mais Wajdi Mouawad en a fait un conte philosophique, renversant présupposés idéologiques et psychologiques, introduisant sous la forme d’une mise en abyme (un récit au style indirect libre, le drame revécu a posteriori) un humanisme militant.
WAJDI MOUAWAD EN A FAIT UN CONTE PHILOSOPHIQUE, RENVERSANT PRÉSUPPOSÉS IDÉOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES
Nous ne sommes plus au palais du pacha Selim, mais dans les salons viennois du père de Belmonte (et, au passage, de Mozart vu par L’Amadeus, de Milos Forman), heureux de fêter le retour des quatre jeunes gens sains et saufs. Mais là où les hommes se vengent d’avoir dû sacrifier à la magnanimité de l’étranger en s’adonnant au jeu de massacre appelé « Tête de Turc », les femmes s’offusquent. Elles ont vécu l’épreuve de la séquestration comme une ouverture au monde, aimé leurs ravisseurs (le pacha pour Konstanze, le gardien du harem, Osmin, pour Blonde), défendu l’émancipation féministe des Noces de Figaro, goûté à l’« échangisme sentimental » de Cosi Fan Tutte. Pas un banal syndrome de Stockholm, donc, mais une véritable découverte de l’autre, profonde, bouleversante, empreinte de tolérance.
Paris-Dakar mozartien
L’air du temps a ramené L’Enlèvement au sérail sur le devant de la scène lyrique. On se souvient du Théâtre de l’Archevêché transformé en base djihadiste par Martin Kusej pour un Mozart au pays de l’Etat islamique, en juillet 2015, au Festival d’Aix-en-Provence. Le metteur en scène libanais a pris le contre-pied, visant les préjugés sur l’islam, la sujétion des femmes, les hiérarchies sociales. Orient ? Occident ? Les voilà confondus. Les Lumières sont partout. L’obscurantisme aussi. A Vienne comme au sérail. Cette bien-pensance en costumes d’époque pourrait sembler un tantinet moraliste, n’étaient une direction d’acteur fouillée et le symbolisme monumental des beaux décors d’Emmanuel Clolus, dont cette énorme sphère minérale, mystérieuse, sorte de planète close qui, pivotant enfin au troisième acte, dévoile enfin ce rêve d’Orient (fantasme de l’homme occidental) : le harem.
La naïveté appliquée du Belmonte de Cyrille Dubois (un timbre citronné), la puissance un peu fruste du Pedrillo de Michael Laurenz ont laissé la part belle à l’Osmin sensible et vaillant de David Steffens. Ses allures de grand prêtre ont donné au Selim sévère de Peter Lohmeyer, une figure plus patriarcale qu’amoureuse. Pas facile de comprendre la faiblesse de Konstanze à son endroit, d’autant que la volcanique Jane Archibald – yeux et vocalises revolver – manque de sensualité. C’est la lumineuse Blonde de Joana Wydorska, voix miniature magnifiquement projetée jusque dans les coloratures (rajoutées), qui tire son épingle de ce jeu plus philosophe que sentimental. Dans la fosse, Stefano Montanari (le Rocky de la baguette) a couru une sorte de Paris-Dakar mozartien mouvementé et un peu éprouvant.
L’Enlèvement au sérail, de Mozart. Avec Jane Archibald, Joanna Wydorska, Cyrille Dubois, Michael Laurenz, David Steffens, Peter Lohmeyer. Wajdi Mouawad (mise en scène), Emmanuel Clolus (décors), Emmanuelle Thomas (costumes), Eric Champoux (lumières). Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, Stefano Montanari (direction). Opéra de Lyon. Jusqu’au 15 juillet. De 14 € à 94 €. opera-lyon.com
Marie-Aude Roux (Lyon, envoyée spéciale)
Journaliste au Monde
Lire l’entretien avec Wajdi Mouawad : « Il faut abandonner l’idée que l’enfer, c’est forcément les autres » http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/article/2016/06/27/wajdi-mouawad-il-faut-abandonner-l-idee-que-l-enfer-c-est-forcement-les-autres_4959108_4497271.html

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 2:20 PM
|
C’est Fabrice Hyber qui signe, et c’est la première fois q’un artiste a cette chance, l’affiche de la quinzième édition de Nuit Blanche 2016. Un cœur dans une nuit, et au cœur de ce cœur, coule la Seine qui ignore la Tour Eiffel.
C’est Jean de Loisy, le directeur du Palais de Tokyo qui est le commissaire de cette quinzième édition qui aura lieu le samedi 1er octobre 2016. Ce parcours qui suivra le fil de la Seine nous racontera une histoire, celle de Poliphie, un héro en quête d’amour et de beauté.
Lors de son conte initiatique il croisera du vivant. Jean de Loisy l’affirme et vient là combler un manque majeur : « Il y aura beaucoup de performances sur l’ensemble du parcours et deux grandes parades ». Du côté du vivant, cela va commencer avant le 1er octobre puisque quelques jours avant Abraham Poincheval qui récemment a passé dix jours dans le corps d’un ours au Musée de la Chasse, va présenter Vigie urbaine, une performance où l’homme habite sur un toit prés de la Gare de Lyon.
L’amour selon Jean de Loisy semble être douloureux et en même temps réjouissant de violence. Il nous confrontera face à une quarantaine d’œuvres dont un tiers sont produites par des artistes étrangers. Toutes viendront dans ce parcours chronologique qui nous emmène du centre de Paris Médiéval au futur du Grand Paris, interroger notre rapport amoureux. Nous pourrons nous soigner à « l’atelier des cœurs brisés » puis tenter de rompre les sorts auprès de magiciens qui tiendront séance au Quai Branly. Et comme les sentiments sont des jeux pour les funambules, Brigitte Polks nous apprendra les règles fragiles de l’équilibre avec ses balancing rocks qu’elle présentait au Palais de Tokyo cette saison.
Le musée du Quai Branly, tout comme Le Châtelet, le Petit Palais, La Monnaie de Paris ou l’ENSBA est un partenaire institutionnel de cette Nuit Blanche dont le budget s’annonce en hausse.
Dès septembre, il faudra savoir garder les yeux ouverts, et se tenir prêt à une rencontre, qui aura volontiers lieu sur les quai de Seine. Bruno Julliard l’affirme : « Les berges de Seine seront fermées après Paris plage ». L’idée polémique est de « rendre » aux parisiens cet espace devenant piéton.
Si la nuit est claire ce samedi 1er octobre 2016, peut être que comme dans le conte attribué à Francesco Colonna, Poliphile retrouvera Polia. Ce conte dont Yannick Haenel écrira une version très particulière.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 6:49 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama :
Tout l’inspire : Shakespeare bien sûr, mais aussi les films de Bergman ou le rock de Bowie. A Avignon, Ivo Van Hove, metteur en scène flamand adapte “Les Damnés” de Visconti, avec les comédiens du Français.
C’est l’événement du festival 2016. Non seulement le retour de la Comédie-Française dans la cour d’honneur du palais des Papes, où on ne l’avait plus vue depuis un Dom Juan de Molière en 1993. Mais la dernière mise en scène du patron du Toneelgroep d’Amsterdam, Ivo Van Hove, dont on avait déjà pu admirer à Avignon les puissantes Tragédies romaines, d’après Shakespeare (2008), ou The Fountainhead, d’après le roman d’Ayn Rand (2014). En scène, l’utilisation d’images vidéo cadrant les acteurs au plus serré faisait merveille. L’artiste aime à resculpter charnellement les textes, à tirer matière scénique de romans ou de films — de Bergman à Cassavetes et aujourd’hui Visconti. C’est sa manière de se lancer des défis, après plus d’une centaine de spectacles depuis près de quarante ans.
Mais sa palette d’intervention, de passions, a toujours été large : d’Arthur Miller (Vu du pont, à l’Odéon en 2015, Grand Prix de la critique 2016) à David Bowie, dont il signa le dernier spectacle à Broadway, Lazarus, fin 2015.
Avec sa dégaine mince et racée à la Cary Grant, son verbe sec, rapide, l’artiste belge de 57 ans, présent à Londres comme à New York, Berlin ou Paris, théâtralise donc cet été le scénario des Damnés, film scandale, film requiem sorti en 1969. C’était une des premières fois qu’on y observait sur grand écran les compromissions de la grande bourgeoisie industrielle allemande avec les nazis ; et la libération de tous les interdits, de toutes les perversions dans un monde en train de basculer vers le mal. Une fascinante danse de mort…
Après tant d’œuvres sur cette tragique période, pourquoi ‘Les Damnés’ ?
Pour moi, Visconti n’a pas fait un film sur le nazisme, mais sur le renversement possible des valeurs dans toute
société. Il montre combien le monde peut devenir barbare au nom de simples intérêts économiques et financiers. Pour obtenir le pouvoir dans l’aciérie familiale, une veuve et mère à la lady Macbeth manipule ici un fils follement désireux de se faire aimer d’elle, mais aux prises avec trop d’instincts pervers… Il se retrouvera sans morale ni identité à la fin de l’histoire. Il n’aura rien appris de l’existence, où, capable de tous les excès, il promène juste sa violence. Tel un djihadiste ? Tel un militant d’extrême droite ? Les Damnés, qui se passe dans les années 1933-1934, est pour moi d’une troublante actualité dans cette Europe où tout pourrait désormais basculer…
Travailler avec la Comédie-Française a-t-il été particulier ?
J’ai été ému de voir les comédiens arriver aux premières répétitions le texte su, concentrés, chaleureux. A la fois sérieux et pleins d’humour, tels Guillaume Gallienne et Denis Podalydès. Bien sûr, j’avais déjà travaillé avec des acteurs français dans Vu du pont, ou avec Juliette Binoche dans Antigone, mais je suis étonné par le sens du collectif de cette troupe. Ils s’entraident, savent s’apporter des commentaires constructifs ; certains viennent même assister à des répétitions où ils ne sont pas programmés… Si diriger des acteurs en français a toujours été un de mes cauchemars récurrents, finalement tout se passe bien. Dans la détente et l’écoute…
“Un de mes pires cauchemars était qu’on exige que je dirige un spectacle en français”
Un cauchemar ? Mais vous parlez parfaitement français…
Oui. Est-il dû aux sempiternels problèmes entre Belges et Flamands ? Jeune, j’allais en vacances avec mes parents sur la Côte d’Azur ; j’ai fait mes études de droit en français. Mais rien n’y a fait. En France, plus qu’ailleurs, on croit aider les étrangers en les corrigeant quand ils parlent. Même les garçons de café n’y résistent pas. Moi, ça m’a toujours bloqué, terrifié. Et un de mes pires cauchemars était effectivement qu’on exige que je dirige un spectacle en français. Même si j’ai fini par accepter le défi et m’exprime un peu mieux…
Comment travaillez-vous ?
Vite. Les répétitions sont rapides — trois semaines — car je prépare énormément en amont. Un an à l’avance. Je relis le texte mille fois, je questionne chaque phrase. Comme je travaille souvent avec de la vidéo, il faut aussi prévoir précisément et à l’avance les places des caméras et des acteurs. Avec Jan Versweyveld, le scénographe et vidéaste de tous mes spectacles, nous avons peu à peu mis en place une manière très personnelle, je crois, de raconter une histoire.
L’omniprésence de la vidéo aujourd’hui au théâtre n’est-elle pas excessive ?
Les Grecs utilisaient les masques comme des porte-voix. Ils permettaient de concentrer et projeter la voix des comédiens pour qu’elle soit audible par des milliers de spectateurs. Aujourd’hui on peut utiliser d’autres moyens techniques pour rapprocher les acteurs du public. La vidéo permet ainsi de mieux les suivre, de surprendre leurs émotions au plus intime. Et elle libère aussi le metteur en scène. Grâce à elle, il peut montrer le « hors champ », ce qui se passe aux abords de la scène. Chez Shakespeare, dans les corridors du pouvoir par exemple, qu’on ne représente guère d’habitude, mais que j’ai pu montrer dans Kings of war (Prix de la critique au titre du meilleur spectacle étranger), grâce à la vidéo. Je ne l’emploie jamais pour la beauté des images mais pour la construction de l’histoire.
Le cinéma vous a-t-il beaucoup influencé ?
Adolescent, j’ai aimé Kubrick, Orange mécanique entre autres. Mais un film a bouleversé ma vie : Le Dernier Tango à Paris, de Bernardo Bertolucci.
Pourquoi ?
A cause de l’amour exclusif de Marlon Brando pour la jeune Maria Schneider. Il ne veut rien savoir d’elle, la retrouve dans un appartement vide. Ils s’aiment passionnément trois jours durant sans que ce soit compréhensible. L’amour d’un couple est toujours incompréhensible pour les autres. Le film m’a fait accepter ça. Mais j’aime beaucoup aussi Cassavetes, Bergman dont j’ai adapté Cris et chuchotements, qui parle de la mort de manière si extrême.
Pourquoi tant d’adaptations de scénarios de films ?
Parce que certains films abordent des thèmes que le théâtre ne traite pas. J’ai monté la trilogie d’Antonioni, aussi, L’Avventura, La Nuit, L’Eclipse. Mais les scénarios étaient faibles et j’ai fait un spectacle trop compliqué techniquement pour les acteurs, trop difficile à maîtriser sur le plateau. Une erreur.
“Shakespeare m’inspire. Dans son théâtre, il y a toujours des énigmes à résoudre pour un metteur en scène”
Vous revenez quand même régulièrement à Shakespeare ?
Il est tellement grand ! Non que ses pièces soient forcément bien construites, mais ce sont des mondes, des paradis perdus, des royaumes de l’imagination, des utopies, des viviers d’idées. Je me suis rendu compte que j’avais besoin d’y revenir tous les trois ans environ. Shakespeare m’inspire. Dans son théâtre, il y a toujours des énigmes à résoudre pour un metteur en scène, des scènes à couper ou à improviser pour en retrouver le sens. Du travail jubilatoire à -affronter. Et quelle liberté ! Shakespeare ne raconte pas -seulement des histoires, mais une vision du pouvoir, de la politique, de l’amour. J’ai mis deux ans à préparer Kings of war, contraction de Henry V, Henry VI et Richard III, que vous avez pu voir à Paris. Déjà Shakespeare y pressent — comme nous devrions le faire aujourd’hui — qu’il faut adapter à la société de son temps les manières de gouverner. Actuellement, par exemple, la tension entre le civil et le religieux est si forte, partout dans le monde, qu’on ne peut pas ne pas en tenir compte. Le théâtre traite de l’irrationnel, du rêve, de l’angoisse, de tout ce qu’on ne veut pas dans sa vie mais qu’on est heureux de pouvoir exorciser grâce au spectacle. Les acteurs sont des exorcistes.
Comment les dirigez-vous ?
J’aime que mes mises en scène soient comme des maisons pour eux, qu’ils s’y sentent bien. Je ne répète en général que quelques heures l’après-midi — le matin je m’occupe de mon théâtre d’Amsterdam, des tournées, des projets à venir. Mais dès la première répétition, tout est prêt dans ma tête. J’ai la vision d’ensemble depuis longtemps. Je sais ce que je veux. Jamais avec moi de première « lecture à la table », où le metteur en scène lit et décortique les répliques avant de les faire répéter. Parler des scènes est trop intellectuel. Dans la vie sait-on pourquoi on agit de telle ou telle façon ? Pourquoi les acteurs le sauraient-ils davantage ? Il faut avant tout incarner les situations, découvrir ensemble la pièce en la jouant. Et selon son ordre même. Chronologiquement. Rien que de très banal, vous voyez… Je n’ai pas de méthode, car chaque acteur est différent. Certains ont besoin de comprendre la psychologie du personnage, d’autres surtout pas. Je ne suis pas un gourou. J’essaie de m’adapter au contraire aux besoins de chacun. Si j’aime provoquer les confrontations en répétitions, j’ai aussi horreur des conflits. J’ai besoin d’harmonie dans le travail.
Avez-vous eu des modèles côté mise en scène ?
Patrice Chéreau. Je ne l’ai pas connu mais j’admirais tout de lui. Le cinéaste, y compris pour ses films moins brillants comme Judith Therpauve, le metteur en scène d’opéras… L’entrée du chœur dans La Maison des morts, de Janácek, reste pour moi un moment fulgurant, comme l’apparition du fantôme du roi sur son cheval dans Hamlet, la cruauté de ce père-roi qui piétine presque Hamlet au sol… La danse avec Pascal Greggory pour Dans la solitude des champs de coton sur la musique de Massive -Attack m’a aussi fait pleurer ; il y avait un lien père-fils si troublant. J’ai appris beaucoup en observant les spectacles de Chéreau, et quelques documentaires sur son travail. D’abord qu’on parle aussi avec son corps. Les hommes sont des animaux, très physiques. Les mots ne sont qu’une des formes de leur langage, parmi tellement d’autres.
J’ai appris ensuite qu’un metteur en scène ne doit jamais tout dire de ce qu’il sait de la pièce à ses acteurs mais attendre que les secrets adviennent dans leur tête. Enfin, Chéreau m’a enseigné à utiliser la musique. Il n’y a jamais de longs silences dans mes spectacles. Depuis que je fais des mises en scène d’opéras — de Berg à Wagner, de Mozart à Janácek —, la musique m’aide à structurer la représentation, à lui donner du rythme, de l’émotion.
N’est-ce pas parfois une facilité ?
Et alors ? On est immédiatement dans l’atmosphère. La musique est généreuse. Ne croyez pas que le silence m’angoisse. Mais s’il y a trop de silence, on ne l’entend plus. J’utilise toutes les musiques, du baroque à David Bowie.
Vous avez justement mis en scène le dernier spectacle de David Bowie, Lazarus, peu avant sa mort…
J’étais son fan absolu depuis le premier concert auquel j’ai assisté. Pour sa musique, d’abord ; pour la liberté d’être qu’il nous a offerte, aussi. Surtout aux homosexuels, dont je suis. Je me souviens qu’il avait embrassé sur la bouche, lors du concert, un de ses musiciens ; j’avais 17 ans, Bowie rendait possible l’amour homosexuel, et beau, et sexy. Ceux qui avaient du mal, encore, à se faire tolérer dans leur sexualité, étaient fascinés, bouleversés. Bowie est devenu une sorte de modèle. J’ai utilisé quantité de ses chansons dans tous mes spectacles. Alors quand le producteur Robert Fox m’a contacté pour Lazarus, j’ai d’abord cru à une blague. J’ai pourtant rencontré David trois semaines après. Il savait tout de moi, et même l’utilisation de ses chansons dans mes spectacles… Il était d’un professionnalisme obsessionnel. Je lui ai demandé d’avoir le droit de tout savoir aussi, sur son album, avant de le mettre en scène. Il a accepté, ce que ses proches m’ont dit très rare ; il m’a expliqué chaque chanson, et les implications personnelles qu’elles avaient. Elles en avaient toutes. Lazarus, c’est lui ; on est dans son cerveau. C’est l’impression même que j’ai voulu donner via un décor d’appartement où les deux fenêtres figuraient ses deux yeux… Mais Bowie est toujours resté très secret : je ne suis jamais allé chez lui. Il me manque. D’autant qu’il ne voulait pas mourir. Il m’avait déjà demandé de réfléchir à un autre spectacle ensemble.
L’homosexualité a-t-elle au départ été quelque chose de difficile à vivre ?
Pour moi, pas du tout. J’ai su dès 11 ans que j’étais homosexuel. Et je vis depuis trente-six ans avec mon scénographe, Jan Versweyveld. Pour mes parents, en revanche, ça a d’abord été un drame. Ils m’ont donné une éducation rigoureuse, qui d’ailleurs m’a beaucoup servi. Mon père était le pharmacien d’une petite ville de deux mille habitants, essentiellement des fermiers et des mineurs venus d’Italie. Pour ces gens-là, mes deux frères et moi, nous étions « les fils du pharmacien », espèce de notable local. Je me sentais exclu, et moi, j’aime l’inclusion, pas l’exclusion. J’ai donc été heureux, après trois semaines de larmes, que mes parents me mettent en internat à 11 ans, au milieu de huit cents garçons. Ils travaillaient beaucoup, nous confiaient à nos grands-pères, qui n’étaient pas riches : pas d’auto, pas de téléphone, peu de chauffage. Je suis content d’avoir vécu ça aussi, avec eux. Mais ça a été une chance de quitter mon village. A l’internat, j’ai tout vécu, la brutalité, la tendresse, les secrets, la mort d’un ami à vélo, le deuil. La peur, aussi, quand un professeur nous a expliqué froidement ce qu’était la bombe atomique. J’avais 12 ans et n’en ai pas dormi pendant trois nuits. Mais ce n’est pas mauvais d’être terrifié pour un jeune garçon. Ça développe l’imaginaire.
“Dans tous mes spectacles on voit qui je suis ; ce sont des autobiographies masquées”
Comment est apparu le théâtre ?
A l’internat ! Le mercredi, on pouvait choisir entre sport et promenade, ou groupe de théâtre. J’ai choisi théâtre. Et j’ai adoré ces atmosphères du mercredi, la chaleur de faire quelque chose ensemble. On était comme un monde dans le monde. Personne ne savait ce qu’on préparait. Et les applaudissements, après ! Je suis vite devenu le leader du groupe. J’avais ça en moi. Mais je n’étais pas encore décidé à en faire mon métier. J’ai commencé le droit à l’université d’Anvers. Quand j’ai réalisé que je finirais dans un bureau tous les jours au même endroit, j’ai compris que je devais faire du théâtre. Sinon je serais malheureux, frustré, violent. J’ai alors monté Agata, de Marguerite Duras, à 23 ans. Une grande comédienne belge est venue me dire « Ivo, le théâtre et toi, c’est un mariage parfait. » Je l’ai accepté. J’ai épousé le théâtre pour le meilleur et pour le pire. C’est ma vie. Il faut trouver dans l’existence quelque chose qui rend heureux. Ce peut être un mari, un ami, une famille, un job. Moi, c’est le théâtre. Le théâtre est mon instrument. Je peux y exprimer tout ce que je pense et sens de la vie, la politique, la société. Dans tous mes spectacles on voit qui je suis ; ce sont des autobiographies masquées.
Vivre avec votre scénographe, Jan Versweyveld, a renforcé les épousailles avec le théâtre ?
On s’est connus à 20 ans. Jan sortait d’une école d’arts plastiques. Nous avons collaboré dès mon premier spectacle. Faire du théâtre ensemble a sauvé notre relation et en même temps c’est de plus en plus difficile. On exige toujours mieux de l’autre. On redoute la routine. Comme dans le sport de haut niveau, on veut aller aux jeux Olympiques, être les meilleurs au monde… Alors on travaille sans arrêt. Longtemps à l’avance, Jan lit, relit énormément les textes, prépare ses images. Dans un documentaire qui m’était consacré, je l’ai entendu dire que l’aspect essentiel de mon travail était ma patience avec les acteurs et ma tendresse pour eux. Notre vie est une conversation ininterrompue sur le théâtre. Nous avons peu de vie en dehors du théâtre.
‘Lazarus’, ‘Les Sorcières de Salem’ à Broadway, l’ouverture d’un congrès sur l’Europe à Amsterdam, le Festival d’Avignon, n’y a-t-il pas risque de devenir un metteur en scène à la mode internationale ?
C’est ma vie, ça me regarde. La saison 2015-2016 m’a permis de vivre dix années en une. J’aime ça. Personne de toute façon ne peut m’acheter ou rien m’imposer : je ne peux faire que ce que je veux faire. Ainsi, quoi qu’on m’ait demandé, je suis venu tardivement à la mise en scène d’opéras : je ne m’estimais pas prêt. Je ne souhaite par pour autant faire les choses lentement, progressivement. Je m’ennuie trop vite. J’ai besoin d’être une minute là, deux minutes là-bas. Je n’aurais jamais pu être acteur
•
1958 : Naissance à Heist-op-den-Berg (Belgique).
2001 : Fondation du Toneelgroep Amsterdam.
2008 : Tragédies romaines, d’après Shakespeare, au Festival d’Avignon.
2014 : The Fountainhead, d’après le roman d’Ayn Rand, au Festival d’Avignon.
2015 : Mise en scène de Lazarus, dernier spectacle de David Bowie.
2016 : Kings of war, d’après Shakespeare.
A voir :
Les Damnés d’après Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli, 6 au 16 juil., 22h, cour d’honneur du palais des Papes, Avignon (84). Tél. : 04 90 14 14 14. Retransmission le 10 juillet à 22h50 sur France 2.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 4:31 PM
|
Par Clarisse Fabre dans Le Monde :
Eloge du ressassement. Cela fait trente ans que Madeleine Louarn arpente les plateaux, avec un groupe de comédiens handicapés mentaux. Peu de gens le savent. Originaire de Bretagne, née à Saint-Renan, en 1957, l’ancienne éducatrice expérimente la pratique théâtrale au sein de deux structures : d’une part, l’atelier Catalyse créé dans les années 1980 (officiellement dénommé « Etablissement et service d’aide par le travail ») où vivent les acteurs qui l’accompagnent depuis plusieurs années, Tristan Cantin, Guillaume Drouadaine, Christelle Podeur, Christian Lizet, Jean-Claude Pouliquen, Sylvain Robic. D’autre part, sa compagnie, fondée en 1994 – le Théâtre de l’Entresort – située « au bout du monde », comme elle dit, soit à Morlaix.
Pour compléter le tableau bretonnant, les deux scènes qui figurent parmi ses plus fidèles soutiens sont Le Quartz, à Brest, et le Théâtre national de Bretagne (TNB), à Rennes. La voici, enfin, pour la première fois de sa carrière, à 58 ans, programmée dans le « in » d’Avignon, avec une pièce intitulée Ludwig, un roi sur la lune, d’après un texte de Frédéric Vossier (Les Solitaires intempestifs, 64 p., 13 €). « Bien sûr, il faut montrer l’émergence artistique. Mais il y a aussi le geste de la maturité, le ressassement. L’atelier Catalyse, avec les comédiens handicapés, c’est toute une vie », dit-elle.
Une folie douce sur scène
On découvre son travail au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, début mai, avec Tohu-Bohu qui revisite des spectacles anciens, d’après Lewis Caroll, Daniil Harms et François-Marie Luzel. Une folie douce sur scène, un théâtre de l’absurde, avec des acteurs qui ont appris un texte mais se retrouvent aussi à improviser. « Le pari, c’est de ne pas cacher le handicap, ni d’en faire quelque chose de larmoyant, de dangereux. Avec les comédiens, je travaille la grammaire théâtrale. Je veux qu’ils se glissent dans la pensée d’un autre. Ce qui me différencie d’un metteur en scène comme Pippo Delbono, qui prend les acteurs handicapés comme ils sont », raconte-t-elle après la représentation. Elle ajoute : « Les acteurs ont leur façon à eux de répondre à ma proposition artistique. Il ne faut pas avoir peur de l’accident. » Eloge du « déraillement », un mot qui lui est cher.
Une amie de longue date vient la saluer : Mathilde Cannat, géophysicienne au CNRS et cofondatrice du collectif La Barbe, créé en 2008, qui a mené des actions spectaculaires pour dénoncer l’absence de femmes à l’affiche des grands théâtres (ou du CAC 40). Tiens tiens, drôle de clin d’œil au sujet qui nous occupe : les femmes… Madeleine Louarn ne s’attarde pas sur sa situation personnelle : « Je suis tellement hors cadre ! Le fait de travailler avec des acteurs handicapés a toujours été plus fort que le fait d’être une femme. »
Mais Madeleine Louarn ne peut échapper au sujet de la parité, en tant que présidente du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) depuis 2013, la plus puissante organisation patronale du spectacle vivant. La patronne du Syndeac dénonce une injustice : « Les hommes ont presque trois fois plus de moyens que les femmes pour leurs créations. Des trentenaires “qui montent” peuvent se retrouver avec un budget de 800 000 euros, quand beaucoup de femmes stagnent à 200 000, 300 000 euros. » Eloge de l’équité.
Dates
1957 Naît à Saint-Renan (Finistère).
1982 Crée l’atelier Catalyse et commence à pratiquer le théâtre avec des personnes handicapées.
1994 Crée le Théâtre de l’Entresort, à Morlaix.
2009 Devient artiste associée au Théâtre de Lorient, jusqu’en 2015.
2013 Est élue présidente du Syndeac, le syndicat du spectacle vivant.
2016 Crée Ludwig, un roi sur la lune, à Avignon.
Ludwig, un roi sur la lune, de Frédéric Vossier, mise en scène de Madeleine Louarn. L’Autre Scène du Grand Avignon (Vedène), du 8 au 13 juillet (relâche le 10), à 15 heures. Durée : 1 h 20.
Clarisse Fabre
Reporter culture et cinéma

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 4:22 PM
|
Publié dans le site Rue du Conservatoire
Pour essayer de mettre fin aux approximations ou à la désinformation...
Vos commentaires
Pour essayer de mettre fin aux approximations ou à la désinformation, voilà ce que je viens de publier sur FB :
Analyse et réponses aux questions
Chers amis, il est difficile de répondre individuellement à toutes les questions sur l’accord concernant les intermittents du spectacle, c’est pourquoi il m’a paru important d’apporter quelques précisions. Beaucoup d’approximations et de désinformations circulent, cela laisse place à beaucoup de rumeurs.
Voilà aujourd’hui 23 juin ce que l’on peut dire :
L’Etat a repris la main sur la convention d’assurance chômage, cela signifie-t-il qu’il la finance ?
NON et heureusement. Le Medef et la CFDT ne se sont pas mis d’accord pour entrer en négociation. En effet l’exigence des syndicats de salariés pour commencer à discuter du régime général était l’augmentation des cotisations sur les CDD. Le MEDEF n’a pas voulu céder sur ce point. Les négociations n’ont donc pas commencé. L’Etat a donc été obligé de substituer sa signature à la leur auquel cas il n’y aurait plus eu de convention après le 1er juillet et les chômeurs n’auraient pas été payés. Un premier décret a donc prorogé la convention telle qu’elle est aujourd’hui sans limite de temps. Un deuxième décret intègre le nouvel accord sur les annexes 8 et 10. Il ne faut donc pas confondre les décrets qui se substituent au processus classique de signatures des syndicats et le financement. Le régime général et toutes ses annexes sont financés par les cotisations des salariés du privé comme avant.
Pour les intermittents, l’état verse 12 millions d’euros dans le fonds de solidarité (créé en 2004) pour financer notamment les nouvelles dispositions sur les congés maternité.
A quelle date le nouvel accord sera-t-il en vigueur ?
A priori le 15 juillet mais c’est encore flou. Les transpositions de règles ont déjà commencé. Cela ne devrait pas dépasser le 1er Août.
Les nouvelles règles sont-elles applicables pour des droits en cours ?
Non. Comme tout accord assurance chômage, les nouvelles règles (notamment de 507h en 12 mois) seront applicables pour tous ceux qui ont une ouverture de droits ou une réouverture de droits après la date d’entrée en vigueur. Concrètement, si l’accord est mis en place le 15 juillet, toute fin de droits après le 15 juillet bénéficiera des nouvelles règles.
L’accord sur les annexes 8 et 10 va-t-il être modifié ou supprimé à la rentrée ?
NON.
L’état souhaite que des négociations puissent avoir lieu à la rentrée mais les syndicats de salariés disent que tant que le MEDEF reste sur ses positions, cela ne sert à rien de revenir autour de la table. Il y a donc peu de chances que des négos soient réouvertes dans un délai si court et les prévisions ne vont pas dans ce sens.
Et si c’était le cas ?
Lorsque cet argument vient de personnes qui luttent pour l’ensemble de l’assurance chômage et pas que pour les annexes 8 et 10, il est pour le moins incompréhensible.
En effet, on sait que l’état souhaite la réouverture des négos pour faire 800 millions d’euros d’économies sur le dos des chômeurs. Par ailleurs on sait que si elles ont lieu à la rentrée 2016, ces négos ne concerneront que le régime général. Si on doit redouter que des négociations reprennent, c’est bien pour les chômeurs du régime général, et pas pour les intermittents. L’accord des intermittents ne pourra pas être remis en cause. Le Medef et la Cfdt ne pourront pas prouver qu’il n’est pas assez économique vu qu’il aura été mis en place 2 mois avant.
L’accord sur les annexes peut-il être modifié ou supprimé dans les années qui viennent ?
BIEN SÛR. Une convention n’est jamais gravée dans le marbre. Elle est valable pour 2 ans maximum et à tout moment les syndicats peuvent la modifier par avenant. Pour rappel les règles des annexes avaient été modifiées en cours de convention le 26 juin 2003 et l’avenant ne concernait que les intermittents. Rien n’est donc gravé dans le marbre, jamais.
Que peut-il se passer ?
Le MEDEF et la CFDT tiennent à leur lettre de cadrage et aux économies impossibles réclamées aux intermittents. Ils jouent aussi la stratégie du financement par l’état et de la caisse autonome. C’est pourquoi la mise en garde que j’avais faite il y a quelques mois sur l’attaque la remise en cause de l’intermittence est toujours d’actualité. Et la mobilisation a été déterminante, les menaces de grèves aussi.
Ainsi dans un premier temps (avant 2 ans), ils pourraient réclamer à l’état les 100 millions d’euros qui leur manquent pour cadrer avec leur exigence de 185 millions d’euros d’économies.
Puis lors de la prochaine convention, ils voudront continuer à appliquer leur feuille de route pour arriver à 400 millions d’euros d’économies en 2020 sur les seuls intermittents.
C’est pourquoi nous savons que ce qui a été acquis est fragile, que c’est une pause avant de nouvelles attaques. Ces attaques auront peut-être lieu dans 1 ou 2 ans.
Que doit-on faire maintenant ?
Les avis sont partagés, nous ne sommes pas tous d’accord.
Voilà le mien, et cela n’engage que moi :
Je comprends parfaitement les arguments de ne pas pouvoir se réjouir d’avoir obtenu quelque chose au milieu de chômeurs toujours aussi mal traités et alors que la loi travail est maintenue. Oui nous avons un traitement à part qui ressemble à un achat de paix sociale.
Pour autant je pense qu’il est très important d’acter cette victoire de la lutte. Nous voulions un retour à un principe mutualiste, redistributif, plus juste pour tous les intermittents de l’emploi. Certes nous n’avons fait qu’une partie du chemin puisque cela ne concerne que les intermittents du spectacle. Mais ce n’est pas rien ! Cela prouve que la lutte paye et cela doit donner espoir pour tous les autres combats.
Nous ne devons pas reproduire l’erreur faite après la victoire au conseil d’état. Cette victoire contre la convention d’assurance chômage a été peu actée, pas fêtée du tout, alors qu’elle était historique. Cette victoire avait été le résultat d’un très long travail (auquel je n’ai pas participé). C’est parce que nous n’avons pas assez revendiqué cette victoire que Myriam El Khomri a pu rédiger l’article 52 de la loi travail dans l’indifférence générale. Cette article 52 rend légal ce que le conseil d’état avait retoqué. Autrement dit l’article 52 de la loi travail annule notre belle victoire au conseil d’état.
Ne recommençons pas cette erreur.
Plus nous défendrons notre accord, plus nous l’acterons, plus il sera difficile de nous le retirer.
Par ailleurs, une occasion unique nous est donnée : faisons enfin une pause sur les annexes 8 et 10 et intéressons-nous au sort de tous les chômeurs. Les intermittents du spectacle doivent sortir du piège corporatiste et se battre pour le droit de tous les chômeurs. Nous savons intimement l’importance de l’assurance chômage dans nos vies, nous sommes les mieux placés pour imaginer une vie sans ce droit fondamental. Ainsi j’espère que tous les mercis que nous recevons seront transformés en actions, en présence devant le Medef quand les copains du régime général sont attaqués …
Il est regrettable de constater que beaucoup d’entre nous ne sont là que lorsque les annexes sont menacées et que leur porte-monnaie est touché. Aucune envie de culpabiliser qui que ce soit, chacun fait comme il peut. Mais nous ne pourrons pas continuer à résister dans notre coin. Et les attaques qui nous attendent nécessiteront une mobilisation forte, massive et déterminée.
Samuel Churin
28 juin : rendez-vous à 14h Place de la Bastille pour manifestater contre la Loi-Travail jusqu'à Place d'Italie.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 3:42 AM
|
Entretien avec Laure Adler sur France-Culture.
Ecouter l'émission (45mn) : http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/11189-22.06.2016-ITEMA_21016164-0.mp3
Il est père d’une petite fille. Que lui suggère cette enfant qui grandit, à lui qui a fait du thème de la mémoire familiale le cœur de son œuvre artistique ? « Ce qui a surgi, je dirais, c’est le regard de mes parents sur moi à l’âge de mon enfant. C’est comme si au fond les choses se déployaient en poupée russe. Plus ma fille se déploie, et plus je me déploie dans le regard de mes parents. »
D’où le thème de la transmission lui vient-il ? « C’est venu pendant l’adolescence, et de ce hiatus qui a surgi lorsque, découvrant la littérature, (…) j’ai commencé à mesurer la schizophrénie qui existait entre le silence brisé grâce à la littérature et le silence opaque de la famille dès que je refermais le livre ».
Né dans une famille qui a fui le Liban, Wajdi Mouawad fut le témoin privilégié de la douleur de l’exil. « Il y avait trop de honte, trop d’humiliations dues aux douleurs, aux souffrances vécues par mes parents et par la génération de mes parents… »
« La question de la transmission a surgi en me disant : lorsque mes petits-enfants arriveront, (…) il sera très important de me souvenir de la puissance de la parole, il faudra trouver le courage pour raconter. Même si c’est humiliant ou honteux, transmettre, ce n’est pas seulement enseigner, ce n’est pas que ça. C’est faire ressentir, bouleverser, enflammer, bruler, illuminer la conscience de l’autre…»
C’est à huit ans que Wajdi Mouawad quitte, en famille, son pays natal. D’abord pour la France, puis pour le Québec. « Dans mon cas, la résilience était beaucoup plus puissante chez moi que chez ma mère ou mon père, je m’adaptais parfaitement aux nouvelles réalités : je découvrais la langue française en France, je découvrais le théâtre au Québec, (…) Je construisais une nouvelle langue poétique qui était la mienne. Tout cela devenait très étranger à mes propres parents. Il y a donc eu une sorte de séparation en plus. (…) C’est comme si je partais en fugue : plus on partait en exil plus moi je partais en fugue. »
Il évoque Georges Brassens et Jacques Brel dont il dit qu’avec Gotlib, ils lui ont appris à parler français ; et également cet auteur qui a libéré son imaginaire littéraire, Franz Kafka :
« Voici que celui qui se pose la question de la langue, Tchèque écrivant en allemand, se demande ce que c’est que d’être juif, celui-là est devenu beaucoup plus proche de moi, que les êtres que je côtoyais tous les jours qui m’étaient devenus tout à coup étrangers. Cette expérience-là de la littérature dans ce qu’elle a d’explosif a scellé quelque chose. Je ne voulais appartenir qu’à ça… »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 3:26 AM
|
Par Mariette Navarro dans son blog : "Petit oiseau de révolution"
En parallèle des Etats singuliers de l'écriture dramatique, qui viennent de s'achever au théâtre de l'Echangeur, la revue Frictions, dirigée par Jean-Pierre Han, a proposé aux sept auteurs réunis dans cette affaire une carte blanche dans son dernier numéro. L'occasion de développer chacun un texte personnel, mais aussi de proposer un texte commun, né de nos discussions sur notre travail, un état des lieux de la place des écrivains de théâtre dans notre milieu professionnel (et non, surprise, ce n'est pas très à la mode d'écrire des textes de nos jours). Des pistes pour une réflexion à poursuivre, à élargir, à partager. Sans aigreur. Pour comprendre. De quoi le règne des images aujourd'hui est-il le nom?
Extraits de ce texte, intitulé Ceux qui vont mourir vous saluent:
" Les metteurs en scène, si frileux pour beaucoup à s'emparer des textes d'aujourd'hui, ne sont-ils pas en réalité les premières victimes d'une censure qui ne dit pas son nom? Ne leur a-t-on pas inculqué qu'ils doivent absolument imposer leur propre lecture, leur propre discours critique, afin de déployer leur style et leur intelligence. Combien de dossiers de présentation sont inutilement truffés de citations savantes pour bien faire comprendre que la lecture du metteur en scène dépasse l'oeuvre elle-même, autrement dit que le texte choisi, brandi, est tout simplement un prétexte. Qui oserait dire qu'il veut tout simplement faire entendre une pièce dans la complexité et la densité de ses strates? Qui oserait dire qu'il fait pleinement confiance au texte?"
(Frictions n°26, p.50)
De manière générale, je t'encourage fortement à te découvrir Frictions si tu ne connais pas encore. C'est une revue très riche, avec toujours de très beaux dossiers photos, et à la fois profondément politique et littéraire (le dernier numéro était consacré à Hélène Bessette, c'est dire...). Moi, c'est toujours une lecture qui me remet en mouvement, me redonne des forces. * Le texte que j'y signe s'appelle Zones à étendre, j'y tricote quelques parallèles entre les Nuits debout et la nécessité de réinventer aussi quelque chose dans nos métiers de théâtre, dans nos écritures. Avec quelques extraits d'un travail en cours. Bonne lecture.
Mariette Navarro
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...