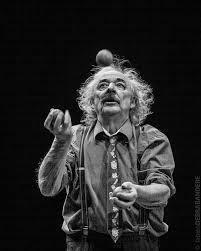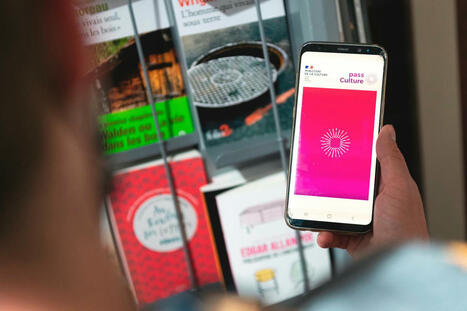Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 5, 3:24 PM
|
Par Grégoire Biseau dans Le Monde le 3 janvier 2025
PORTRAIT
Entourée par la même bande qu’à ses débuts au théâtre, la comédienne de 46 ans enchaîne les rôles au cinéma avec beaucoup de liberté. Aujourd’hui, elle renoue avec ses premières amours en interprétant un seule-en-scène adapté du roman « Jewish Cock », de Katharina Volckmer. Un texte provocateur, drôle et féministe autour d’une femme désireuse de se faire greffer un pénis circoncis. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2025/01/03/de-connasse-a-l-adaptation-de-jewish-cock-le-talent-insolent-de-camille-cottin_6479021_4500055.html
Devant un lourd rideau de velours pourpre tombé du ciel, une silhouette de femme portant des lunettes de soleil et coiffée d’un de ces grands chapeaux de paille glamour tournicote sur elle-même pour s’emmêler dans un drap. Elle est belle et ridicule. Star et cruche. « Est-ce qu’on comprend bien qu’elle est ligotée ?, demande Camille Cottin à son metteur en scène, Jonathan Capdevielle. J’aimerais qu’on voie une image de l’assignation. » Mais après plusieurs minutes de combat avec son drap, l’actrice rend les armes. Le tandem décide qu’il est trop tard pour garder l’idée pour ce soir, mais, promis, on fixera tout cela en vue des représentations aux Bouffes du Nord à Paris, dans trois semaines, à partir du 7 janvier. Ce mercredi 18 décembre, sur la scène du Théâtre d’Arles, Camille Cottin répète le spectacle Le Rendez-Vous, créé en septembre à Aix-en-Provence. Adaptée du roman Jewish Cock, littéralement « bite juive », de la romancière allemande Katharina Volckmer, la pièce est le monologue d’une femme venue chez son gynécologue pour se faire greffer un pénis circoncis. Un texte monstre, farouchement féministe, provocateur et drôle. Une « caresse et une claque », selon les mots de Jonathan Capdevielle, où il est question de la culpabilité allemande liée à la Shoah, de Dieu, de l’amour du théâtre, de la transition de genre et, bien sûr, des hommes. Et plus exactement de leur bite, puisque c’est ainsi que l’autrice nomme leur pénis. Quand elle a lu la première page du roman, il y a presque quatre ans, Camille Cottin s’est arrêtée et s’est demandé à haute voix : « Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? » Elle a posé le livre, comme s’il lui fallait prendre une grande inspiration, avant de poursuivre sa lecture. Lorsqu’elle a sollicité des agents littéraires pour trouver des idées de scénario de film avec de beaux rôles de femme à défendre, c’est le premier texte qui lui a été adressé. L’actrice ne sait pas quoi faire de cette bombe. Elle envoie un exemplaire à sa mère, Edith, grande lectrice, dont elle aime solliciter l’avis, et un autre à son meilleur ami, Benjamin Gauthier, acteur et metteur en scène. Leur retour est enthousiaste. « C’est un texte essentiel », assure ce dernier, qui la pousse immédiatement à l’adapter au théâtre. Un nouveau départ Si Camille Cottin avait bien caressé l’idée de remonter un jour sur des planches, ce n’était certainement pas pour un seule-en-scène. Pour elle, un projet théâtral est d’abord une aventure collective, une affaire de troupe. Et puis qui pourrait mettre en scène cette étrange logorrhée ? Benjamin Gauthier lui suggère le nom de Jonathan Capdevielle, marionnettiste de formation, acteur chez Gisèle Vienne, et grand metteur en scène de l’intime. Leur première rencontre a lieu en 2022 par Zoom, alors qu’elle tourne en Angleterre dans un film de Kenneth Branagh (Mystère à Venise). Malgré la distance, le courant passe immédiatement. Ils décident d’adapter ensemble le livre pour la scène. Et en juin, dans la salle de répétition du théâtre des Bouffes du Nord, Camille Cottin commence à réciter son texte devant un drap miteux en guise de rideau. « J’ai découvert en Jonathan un copain de jeu comme quand j’avais 10 ans et qu’on créait des spectacles avec mes cousins dans le grenier de ma grand-mère », confie-t-elle. « Immédiatement, j’ai vu une petite fille qui se remet à s’amuser avec un jouet qu’elle avait délaissé et qui se reconnecte à son passé avec une immense joie », renchérit Jonathan Capdevielle. Comme s’il y avait dans ce retour sur scène autre chose qu’un simple détour, pour une actrice de cinéma qui tourne trois à quatre films par an depuis dix ans et s’est déjà fait un petit nom à Hollywood. Plus qu’un retour aux sources, une sorte de nouveau départ. Camille Cottin, dont l’image reste toujours autant associée au personnage de Connasse, apparu sur Canal+ en 2013, et à celui d’Andréa Martel de la série à succès Dix pour cent, ressentait le besoin d’ouvrir de nouveaux horizons. Et, finalement, quoi de plus radical quand on est une actrice de 46 ans, d’origine juive par sa mère mais baptisée, que de vouloir un pénis circoncis à la place du vagin, pour prendre son élan ? Une scène de cinéma L’histoire de Camille Cottin commence par une scène de cinéma. A la fin des années 1970, celle qui va devenir sa mère, Edith Yaffi, dîne seule à la brasserie Chartier, rue du Faubourg-Montmartre. Face à elle, un homme, Gilles Cottin, beau comme un dieu, accaparé par la lecture de son journal, ne lui prête aucune attention. Elle tape sur son journal, pour engager la conversation. Interloqué, il lui explique qu’il parcourt les petites annonces, car il cherche des peintres en bâtiment pour l’aider à terminer un chantier. Elle lui répond qu’elle tombe à pic, puisqu’elle connaît très bien trois peintres, qui se feront un plaisir de venir l’aider. Ils s’échangent leurs adresses et se disent à très vite. Il ignore évidemment qu’elle a tout inventé. Et le lendemain, la baratineuse envoie au rendez-vous trois copains déguisés en peintres. L’histoire d’amour sera aussi intense que courte. C’est la rencontre de deux mondes. Lui, artiste, est issu d’une grande famille bourgeoise parisienne, catholique et intellectuelle. Elle, née d’une famille de commerçants pieds-noirs d’Algérie, a été envoyée à Paris à l’âge de 15 ans, car elle faisait le mur pour soutenir la cause indépendantiste du FLN. Insoumise, entreprenant mille choses sans en finir une seule, s’inventant des vies, Edith aime les hommes, les voyages et la liberté. Le couple se sépare, juste à la naissance de Camille, mais reste très lié. Gilles propose à Edith de venir vivre avec leur enfant dans son appartement de la rue du Faubourg-Montmartre, lui occupant une chambre de bonne à l’étage au-dessus. Et quand elle décide, quelques années plus tard, de déménager pour s’installer avec son nouvel amoureux, Gabriel Besson, un analyste financier de 22 ans, de quinze ans plus jeune qu’elle, Gilles demande à les suivre, pour habiter sur le même palier. « Tout cela était très joyeux et finalement assez naturel », se rappelle Camille Cottin. Une demi-sœur, Avril, six ans d’écart avec elle, va naître dans la foulée. Une relation mère-fille compliquée La mutation à Londres de son beau-père, qu’elle appelle très vite « Gab », oblige toute la famille à rejoindre la capitale anglaise, mais cette fois sans Gilles, qui reste à Paris. C’est un changement de vie. L’argent coule à flots, la famille loge dans une maison du quartier chic de Chelsea, Camille fréquente le lycée français, des nounous s’occupent des filles. Ce sont les années d’adolescence, des premières amours, et souvent d’affrontement avec cette mère fantasque et rebelle, mais aussi très stricte avec ses propres enfants. Camille fait le mur. Ce n’est une surprise pour personne : elle est la fille de sa mère, insolente et frondeuse. « A l’époque, ça monte souvent dans les tours », se souvient Avril. Très vite, les deux sœurs improvisent des spectacles dans leur chambre. Camille déguise sa cadette, la dirige, joue avec elle. On chante, on danse, on se travestit. La première montée sur les planches est restée mythique. Dans le cadre de l’association théâtrale créée au lycée français de Londres par sa mère, Camille répète le rôle d’Hélène dans La guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux, celui de Pâris est incarné par un beau gosse de terminale. Mais ce dernier se désiste quelques jours avant la représentation. Et c’est Edith qui le remplace au pied levé, une casquette sur la tête. « L’image de ces deux-là censées s’aimer sur scène alors que leur relation était à l’époque très difficile n’en finit pas de me faire rire », s’amuse Avril Besson. Camille attrape le virus. Après le bac, elle demande à rentrer à Paris pour faire du théâtre. Ses parents ne disent pas non mais lui demandent d’assurer ses arrières : elle s’inscrit en maîtrise d’anglais à la Sorbonne, et en parallèle à l’école d’art dramatique Périmony. Une Kawasaki à la place d’un nouveau nez Elle a 20 ans, la vie devant elle. Un soir, alors qu’elle revient de jouer une pièce devant cinq personnes, elle reçoit un coup de fil de sa mère : son beau-père est mort au travail d’un infarctus, à 38 ans. Une déflagration. Le lendemain, elle remonte pourtant sur scène. « Je me demande encore comment j’ai pu faire ça », se dit-elle. Gabriel était plus qu’un beau-père. Ensemble, ils adoraient les sensations fortes des sports de glisse, le ski, la planche à voile, la plongée, aussi. Elle entame une psychanalyse qu’elle arrêtera vingt ans plus tard. « C’était un moment difficile pour moi, j’étais encore en construction, je ne savais pas très bien ce que j’allais faire de mon existence », se remémore-t-elle. Pendant trois ans, elle gagne sa vie comme professeure d’anglais, puis arrête pour plonger la tête la première dans le théâtre. « Le plateau devient alors un espace sacré et réparateur pour elle », estime sa copine, la comédienne Camille Chamoux. Camille Cottin n’a pas de temps à perdre. Elle roule dans Paris au guidon d’une Kawasaki 650, un modèle qui ressemble aux Triumph anglaises, qu’elle adore. Cette moto vient de loin, de son enfance, quand son père Gilles l’emmenait à la crèche sur sa grosse BMW. Mais surtout d’un pacte scellé peu avant ses 18 ans. Pour son anniversaire, son grand-père paternel lui propose de lui offrir une séance de chirurgie esthétique afin de corriger ce nez… trop droit, trop long, trop grand, qui l’enquiquine depuis l’adolescence. « Et si à la place tu m’offrais une moto ? », lui propose-t-elle. Va pour garder ce nez et acheter une Kawasaki. Toutes les copines de l’époque adorent monter derrière elle et s’accrocher à sa taille. La vie devient tout de suite beaucoup plus excitante. La Kawasaki est volée deux ans plus tard, et remplacée par une Suzuki 250. « L’image de Camille reste très associée à sa moto. Celle d’une jeune femme toute fine, aux longs cheveux blonds, qui dégage une grande force et qui trace son chemin », confie la productrice Shirley Kohn, une de ses grandes amies. Les années cachets minables et débrouille Son chemin, c’est le théâtre. Pendant plus de dix ans, elle s’y adonne totalement. Et se construit une bande d’amis, des acteurs comme elle qui rêvent tous de se faire un nom (Benjamin Gauthier, Zoé Bruneau, Alexandra Chouraqui, Guillaume Mélanie, Cédric Moreau…). Elle joue tout et un peu n’importe quoi, du moment qu’elle joue. Elle est la militante Helen Keller, aveugle, sourde et muette, le chat Béhémot dans Le Maître et Marguerite, de Boulgakov. Elle passe du Cid, de Corneille, à la troupe de Pierre Palmade. Elle écrit une comédie potache avec sa grande copine Alexandra Chouraqui, Le Lifting de Madame Bénichou. Un petit succès. Une partie de la bande de copains y joue en alternance. Chaque été, ils descendent, en transhumance, au festival off d’Avignon (Camille Cottin en compte sept à son actif). Ce sont des années de cachets minables, de débrouille et de bouts de chandelle. « Mais c’était très joyeux », sourit-elle. Elle en profite pour découvrir, dans la cour d’honneur du Palais des papes, le théâtre de l’Allemand Thomas Ostermeier et la trilogie de Wajdi Mouawad (Littoral, Incendies, Forêts). Même si elle rêve de cinéma, elle se rassure en se disant que le théâtre est suffisamment vaste pour y passer une vie entière. A Paris, l’atelier d’artiste que lui a laissé son beau-père devient le QG de la bande. Camille y habite avec son amoureux, Benjamin (dont elle préfère taire le nom pour éviter d’exposer leurs enfants), un architecte, qui deviendra le père de ses enfants, et sa demi-sœur Avril. La bande d’amis décide d’y écrire sa première pièce collective, une comédie, Paris Dallas, pendant qu’Avril les filme lors de leurs séances de travail. Elle en fait son film d’études pour le concours d’entrée de la Fémis. Elle intègre la prestigieuse école de cinéma, mais Paris Dallas est un bide. Depuis presque vingt ans, le groupe est resté intact, il a juste été rebaptisé sur WhatsApp « entourage », après s’être longtemps appelé « la bandoule ». Personne n’en est parti. Très vite, Camille Chamoux a été intégrée. Puis le duo à l’origine de Connasse, Noémie Saglio et Eloïse Lang. Et, plus récemment, Marion Cotillard. Chaque été, ils se donnent rendez-vous dans l’ex-maison varoise du beau-père de Camille Cottin à Cavalaire-sur-Mer, un coin de paradis, pour y passer une quinzaine de jours en juillet. Un rituel devenu immuable. Avril est là bien sûr, mais aussi Edith, et ses beaux-parents. De l’aveu de tous, il n’y a pas vraiment de chef. Juste une fédératrice : Camille Cottin. La première fois qu’on rencontre cette dernière, le lundi 9 décembre, elle est Jeanne. Elle habite un petit pavillon de brique rouge à Cergy-Pontoise. Sa sœur vient de lui déposer ses deux jeunes enfants et de disparaître. Le film, Les enfants vont bien, le troisième de Nathan Ambrosioni, son deuxième avec Camille Cottin (après Toni en famille, en 2023), raconte cette « maternité » forcée par le destin et par cette mère volatilisée. L’équipe entame la dernière semaine de tournage. « L’anti-connasse » Camille Cottin nous accueille comme si elle était la maîtresse de maison. Elle est en chaussons et gros pull en laine. Elle nous fait la bise, presque maternelle. Nous demande si ce n’était pas trop long pour arriver jusqu’à Cergy, nous propose un café. Et nous tutoie au bout de la deuxième phrase. Il n’y a pas vraiment de calcul. Elle est pudique mais frontale, fonceuse mais traqueuse, sans concessions mais soucieuse des autres. « Elle veut tout le temps faire plaisir. Tout le monde compte sur elle. Alors, parfois, elle peut se faire bouffer », sourit Noémie Saglio. Camille Cottin a découvert récemment qu’elle souffrait depuis longtemps d’un trouble de l’attention. « J’ai toujours eu du mal à hiérarchiser les problèmes et les sollicitations. Toutes les préoccupations m’arrivent avec un même niveau d’intensité… », décrit-elle. Intranquille, elle ne sait pas rester en place, sauf sur une scène de théâtre ou un plateau de cinéma. « C’est vraiment l’anti-connasse par excellence. C’en est troublant », renchérit Camille Chamoux. Leur première rencontre a lieu au théâtre Silvia Monfort, à Paris, où Camille Chamoux, 24 ans à l’époque, fait passer un casting pour une pièce qu’elle monte. Elle ne la prend pas. Elles se retrouvent ensemble dans la distribution de la pièce Love and Fish, d’Israel Horovitz, en 2004. Elles deviennent inséparables et décident de former une sorte de couple interchangeable. Même silhouette, même taille, presque même couleur de cheveux. Deux Camille dans un seul corps. Elles s’échangent les plans, les rôles, se remplacent au pied levé…. « Personne ne s’en rendra compte » est leur mantra. Ainsi, quand, en 2013, Camille Chamoux, alors un peu connue, est appelée pour passer un casting pour un programme court de caméra cachée pour la télévision, elle envoie sa copine à sa place. Celle-ci débarque, tout en noir, dans une cave du 11e arrondissement pour passer son audition. On lui demande d’improviser, sur le canapé, une scène dans un taxi. « En cinq minutes, on a tout vu : le taximan, le siège à boules, le petit sapin qui pendouille au rétro central. On était avec elle », raconte Eloïse Lang. Contre toute attente, ces petites pastilles, diffusées pendant « Le Grand Journal » deviennent virales. Camille Cottin devient la Connasse, cette bourgeoise parisienne, sans filtre et sans gêne, qui ne pense qu’à sa gueule et qu’on adore détester. Sa carrière décolle. Deux ans plus tard, en 2015, c’est la grande rencontre avec Andréa Martel, agente d’acteurs de cinéma au sein de la société ASK, dans la série Dix pour cent, créée par Dominique Besnehard et la scénariste Fanny Herrero. Cédric Klapisch, le réalisateur de la première saison, se souvient très bien du jour où il a découvert l’actrice : « Elle dégageait un truc cérébral et organique. Un côté punk et sophistiqué à la fois. » Parmi une trentaine de comédiennes passées à la moulinette, elle fait l’unanimité. Andréa est lesbienne, ambitieuse, menteuse et horriblement attachante. Et par effet de ricochet, Camille Cottin devient un porte-drapeau de la cause queer. La vague #MeToo s’apprête à déferler. La comédienne est prête : elle a déjà lu King Kong Théorie, de Virginie Despentes, et les premiers livres de Mona Chollet. Au sein de la bande, on discute beaucoup de cette révolution qui vient, on s’échange les essais qui font référence, on manifeste, presque toujours ensemble. « On compare nos modèles, hérités de nos mères », décrypte Shirley Kohn, avec qui elle a créé une société, Malmö Productions, qui porte des projets engagés en faveur de la cause féministe. A force de déclarer son admiration pour Mona Chollet dans des interviews, Camille Cottin finit par recevoir un SMS de remerciement de l’essayiste. Les deux femmes décident de déjeuner ensemble. « Elle m’a donné l’impression d’une actrice qui se posait beaucoup de questions sur sa carrière… Sur les choses qu’elle doit accepter ou non dans un milieu du cinéma encore très patriarcal. C’est vraiment une actrice qui fait du bien », se souvient l’autrice de Sorcières (La Découverte, 2018). Le prix de la liberté Shirley et Camille ont un moment réfléchi à adapter Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminine (La Découverte, 2012), dans lequel Mona Chollet dénonce l’influence de l’industrie du luxe sur les représentations féminines. Mais c’était avant que Camille Cottin accepte de tourner une publicité, gentiment grotesque, flanquée de Jean Dujardin et George Clooney, pour vendre des capsules Nespresso. Et qu’elle devienne une égérie de la maison Dior et du joaillier Tiffany. Aujourd’hui, elle incarne un chic, une élégance bourgeoise, qui ravit la presse féminine. Ses copines assurent qu’elle s’achète de la liberté et que c’est très bien comme ça. Mona Chollet a, elle aussi, mis de l’eau dans son vin : « Dans mon livre, j’avais eu la dent dure contre Anna Mouglalis, qui était à l’époque égérie de Chanel. Aujourd’hui je ne veux plus faire porter aux seules actrices la charge de tout ce système. L’industrie du luxe fait partie du jeu si on veut faire carrière dans le cinéma. » Camille Cottin assume : « Oui, je suis dans une forme de contradiction. J’en conviens parfaitement. Mais on peut avoir envie d’être plusieurs femmes, et ça ne m’empêche pas d’entendre et de comprendre la critique féministe de cette objectivation du corps des femmes par les marques de luxe. » La « meilleure actrice de sa génération », selon la metteuse en scène Salomé Lelouch, qui l’a dirigée dans Justice, en 2018, avec Camille Chamoux, a ce truc énervant de certains premiers de la classe qui réussissent aussi à être très populaires ou très forts en sport. Elle est capable de faire entrer des carrés dans des ronds. Elle est une actrice grand public reconnue par le cinéma d’auteur, de gauche et aimée de la presse de droite, fidèle en amitié et épanouie dans sa vie familiale. Parfois, il arrive que ça coince. Au début de l’été, le tournage en Arménie de Sauver les morts, le premier film de fiction de la documentariste Tamara Stepanyan, a été éprouvant. Huit semaines sans rentrer à Paris, même si ses deux enfants (15 et 9 ans) sont venus deux fois lui rendre visite. Elle a manqué la réunion de la bandoule à Cavalaire. « Je ne recommencerai pas », promet-elle. Elle court toujours après ce premier rôle d’un film qui mettrait tout le monde d’accord, le public et la critique, et qui la détache pour de bon de l’image d’Andréa Martel. Un texte qui déconcerte Cette année sortira Rembrandt, le prochain film de Pierre Schoeller, où elle interprète le rôle d’une ingénieure qui travaille dans le nucléaire et qui voit sa vie bouleversée par la découverte de tableaux de Rembrandt. Elle sera de tous les plans. « Comme les actrices américaines, elle a une puissance à l’image très impressionnante », s’enflamme Schoeller, convaincu que Camille Cottin est « la Meryl Streep française, [qu’]elle va magnifiquement vieillir ». En avril, elle tournera dans le prochain Olivier Nakache et Eric Toledano, une comédie située dans les années 1980 qui évoquera leur enfance, où elle formera un couple avec Louis Garrel. Ce jeudi matin 19 décembre à Arles, elle s’est réveillée totalement enrhumée, le nez bouché. Un cauchemar pour une actrice de théâtre qui doit jouer le soir même. Elle a trouvé le public de la veille glacial. Elle a du mal à accepter que ce texte puisse décontenancer, voire provoquer du rejet, tant il résonne intimement, pour elle, et profondément « avec le procès Mazan et cette culture du viol ». Pendant longtemps, le spectacle devait s’appeler Jewish Cock, comme le livre. Mais plusieurs théâtres l’ont alertée que, depuis le massacre du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, tout pourrait être mal interprété. Ce sera donc Le Rendez-Vous, mais pour dissuader la venue d’adolescents qui espéreraient retrouver la Connasse, Camille Cottin l’a fait interdire aux moins de 16 ans. « La production m’a trouvée un peu maximaliste », rigole-t-elle, en commandant un grog. Elle nous demande si on connaît les bienfaits de la rhodiole, car elle croit aux vertus des plantes et des esprits. Elle le tient notamment de sa mère et de ses différents voyages en Afrique et en Inde. Elle aime l’idée du pouvoir de la sorcellerie, puisque les sorcières ont toujours été des femmes libres. Pour convoquer des forces surnaturelles, sa mère a l’habitude d’allumer des bougies. « Elle en a allumé deux pour les copains et une autre pour Avril ; ils attendent tous une réponse importante », précise-t-elle. Camille Cottin ne se rappelle pas à quand remonte sa dernière bougie. Peu importe, les esprits doivent penser qu’elle n’en a plus vraiment besoin. Grégoire Biseau / M le magazine du Monde Crédit photo : OTMAN QRITA POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 5, 2:56 PM
|
Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 5 janvier 2025 LA RELEVE 2025. L'artiste « gender fluid » est aussi virtuose et inspiré dans les rôles de garçon, de filles ou intersexes. Brillant au théâtre comme au cinéma et dans les séries, le compagnon de route du Théâtre 14 va s'attaquer à sa première mise en scène au mois de mai.
A 31 ans, on lui en donne toujours 20. Yuming Hey a l'enthousiasme d'un enfant et mord sa vie de comédien a pleines dents. Né à Marseille, l'artiste qui se revendique « gender fluid » a touché à tout dès la maternelle : flûte traversière, chant, cirque, danse, claquettes, avant d'embrasser le métier d'acteur. Diplômé du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, il s'est initié au théâtre moderne grâce à son compagnonnage avec le metteur en scène Mathieu Touzé, actuel directeur du Théâtre 14 à Paris. Intense et d'une incroyable précision, Yuming Hey est aussi à l'aise sur les planches en mauvais garçon (Un garçon d'Italie), qu'en diva hystérique (Les Bonnes), en enfant sauvage (Jungle Book) ou en personnage intersexe (Herculine Barbin). Ses rôles dans des séries (« Osmosis » et « Emily in Paris » sur Netflix) ont accru le nombre de ses fans. En cette année 2025, l'artiste tout genre s'apprête à franchir une nouvelle étape en mettant en scène au Théâtre 14 Platonov, d'Anton Tchekhov. Une nouvelle corde à son arc-en-ciel. Ce n'est pas qu'un détail : Fan de mode, il adore porter des chaussures signées Christian Louboutin. Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Né à Marseille, l'artiste qui se revendique « gender fluid » a touché à tout dès la maternelle. (Photo : Pauline Roussille)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 5, 10:33 AM
|
Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 3 janvier 2025 Finir en beauté. Pour clore son mandat d’administrateur, Éric Ruf réunit la troupe du Français et fait du “Soulier de satin” de Paul Claudel une fête du théâtre qui célèbre l’art dramatique où l’impossible est à jamais interdit de séjour. Un espace nu pour un temps gigogne. Voici brossé à grands traits Le Soulier de satin de Claudel proposé par Éric Ruf en un adieu majestueux à ses dix années d’administrateur de la Comédie-Française. Avec lui, la troupe s’est enrichie, renouvelée, diversifiée et réunit d’incandescents talents. C’est à l’un des derniers comédiens engagés, Baptiste Chabauty, que revient le rôle de Don Rodrigue, le personnage autofictionnel de Paul Claudel, fringant conquistador à 15 h lorsque démarre le spectacle, vieillard amputé et vendu comme esclave, à 23h30, au terme de la représentation. Aux multiples raisons qui ont motivé le choix d’Éric Ruf de monter cette pièce hors norme, on en retiendra une qui associe la démesure poétique au rappel d’un geste de résistance politique. C’est ici, dans les murs de la Comédie-Française qu’a été créé Le Soulier de satin, mis en scène par Jean-Louis Barrault, en 1943, en pleine Occupation. C’est encore là qu’Antoine Vitez souhaitait la reprendre, lorsqu’il fut nommé administrateur, après l’avoir créé au festival d’Avignon en 1987. Il n’en eut pas le temps. Depuis, seul Olivier Py s’est risqué en 2003 et 2009 à monter la version intégrale de la pièce. Une épopée ambitieuse Les coupes drastiques opérées dans le budget de la culture ne sont pas favorables à ces grandes formes extravagantes qui convient le monde sur un plateau ? “La Comédie-Française traversant des troubles budgétaires, le réflexe serait de diminuer l’ambition artistique, je pense au contraire qu’il faut, dans ces cas, l’agrandir encore”, rétorque Éric Ruf. Or, dans ce cas précis, le fond rejoint la forme. Après avoir déambulé sur l’immense plateau nu de la salle Richelieu, les acteur·ices se faufilant au milieu du public, de l’orchestre, le long d’une passerelle qui enjambe le quatrième mur et multiplie les entrées et sorties des personnages, l’Annoncier que campe avec bonheur Serge Bagdassarian ouvre les festivités : “Il faut que tout ait l’air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l’enthousiasme ! (…) L’ordre est le plaisir de la raison : mais le désordre est le délice de l’imagination.” Nous voici embarqué·es dans l’épopée amoureuse entre Don Rodrigue et Dona Prouhèze (Marina Hands) qui, pour être impossible, n’en consume pas moins leur être pendant trois décennies que Paul Claudel découpe et éparpille en quatre journées au temps des conquistadors. Preuve s’il en est qu’il est plus facile de conquérir les terres que les cœurs et que la violence parvient plus vite à ses fins que l’intégrité d’une âme déchirée entre l’exigence de la foi et l’ouragan de la passion. Le carrefour de tous les théâtres Résumer l’intrigue est non seulement impossible mais vain ; il suffit de savoir que parcourir le monde sur une scène de théâtre en une cavalcade échevelée d’amours contrariées, d’ambitions nobles ou fielleuses, toutes également soumises à l’indomptable course du temps, revient pour Éric Ruf à faire de la Salle Richelieu le carrefour de tous les théâtres : vaudeville, tragédie, farce, comédie, sans oublier le ballet-théâtre cher à Molière à travers la présence des musicien·nes aux côtés de la troupe dans une forme olympique, rien ne manque à la fête. Le Soulier de satin, de Paul Claudel, version scénique, scénographie et mise en scène Eric Ruf. Jusqu’au 13 avril, Salle Richelieu, Comédie-Française.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 4, 1:07 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 17 décembre 2024 Découverte en février 2024 au Théâtre des Quartiers d’Ivry, la version de « Par les villages » du jeune metteur en scène, avait impressionné. Quelques prises de rôles, dont celle de Reda Kateb et celle de Marie-Sohna Condé, quelques légères retouches, une densité plus forte encore, qui ne sacrifie jamais la fluidité du spectacle, tout ici enthousiasme le public.
On comprend que Peter Handke ait été très intéressé par les idées de Sébastien Kheroufi et qu’il ait accepté de travailler avec lui sur ce texte fondateur qu’est Par les villages. Fondateur pour l’auteur, mais aussi pour plusieurs générations de lecteurs, ceux qui ont l’âge d’Handke, comme ceux qui se sont succédé depuis. En France, on a eu le privilège de la traduction de Georges-Arthur Goldschmidt chez Gallimard, et de mises en scène éclairantes, personnelles, telles celles de Claude Régy, et beaucoup plus tard, Stanislas Nordey. C’est un jeune homme de trente-deux ans, qui, aujourd’hui, reprend son travail. Après Ivry, en février dernier, il avait présenté le spectacle au Centre Georges-Pompidou. Quelques mois ont passé. On avait beaucoup apprécié et l’esprit de l’adaptation, et la force de la mise en scène, de la direction du jeu : des amateurs et des professionnels, dans un déploiement beau et puissant (voir ce blog au 4 février 2024). Les spectacles mûrissent. Au Centre Georges-Pompidou, ces jours-ci, on est époustouflé par l’intelligence, l’audace et l’évidence liées, de la représentation. Après Lyes Salem que l’on n’oublie pas, Reda Kateb endosse le manteau sombre, de coupe classique, de l’écrivain revenant dans l’endroit où il a grandi. On ne parle plus de village, on dit « cité ». Et sans doute, parfois, accroche-t-on sur l’idée de l’église, des vallées, de la nature. Mais prenez Nanterre, allez dans la ville première et vous verrez l’église, allez du côté de la Ferme du Bonheur et vous verrez moutons et prés verdoyants, paysages doucement vallonnés. Mais nul besoin de référence. On écoute. Le prix Nobel 2019, a composé, avec Par les villages, une oeuvre magistrale. La traduction est belle et puissante. Les inventions de Sébastien Kheroufi sont magnifiques. Ainsi, d’ouverture en grandiose achèvement, la présence de Casey illumine chacun. Cette artiste, qui du rap au slam, manie la langue avec virtuosité, est auteure, compositrice, interprète à timbre unique, poète. Elle possède une rigueur extraordinaire et laisse passer sa force prophétique, sans excès, sans violence. Avec ce qu’il faut d’énigmatique questionnement. Comme un dieu, comme une déesse d’un monde qu’elle nous révèlerait, un monde archaïque et fertile, comme celui de la Grèce ancienne et de ses figures mythologiques, comme celui de l’Asie ancienne, de l’Arabie. Autre grande figure de femme entrée dans le jeu de Peter Handke et de Sébastien Kheroufi, Marie-Sohna Condé, très grande comédienne qui reprend en alternance le rôle que tenait à la création Gwenaëlle Martin. Quel bonheur d’applaudir l’humanité chaleureuse de cette interprète très précise, très rigoureuse, et bouleversante. Belle voix, belle présence, esprit, humour -il en faut avec Peter Handke- elle bouleverse et arrache des larmes. On n’oublie pas Gwenaëlle Martin, en alternance. On n’oublie pas Anne Alvaro, embarquée depuis le début dans cette aventure. Elle est la vieille femme. Telle qu’en elle-même, avec son timbre rauque et grisant, elle nous parle et parle à l’enfant. Hans, le frère, personnage très important, est toujours porté par Amine Adjina. Remarquable, avec ce qu’il faut de vulnérabilité et de fierté, qui défend haut et clair le village et sa soeur, une certaine vérité du monde face à l’homme en redingote élégante que l’on ne saurait complètement reconnaître. Un très beau personnage, par qui passe la réalité du passé des deux frères et de leur soeur. Magnifiques sont ses paroles. Sophie, c’est toujours la même très aigüe comédienne qui la défend. Vaillante et très nuancée. Hayet Darwich. Reda Kateb, que l’on est très heureux de retrouver au théâtre, impose sa silhouette haute et très fine, son visage de lion royal, sa diction ferme et tendre, au personnage de Gregor, celui qui revient. Mais qui est complètement décalé. Son parcours est très beau, en toute sensibilité et discrétion, comme un comédien parmi les autres. Humble. Ici, il y a aussi le travail des amateurs, belles présences eux aussi et travail fertile sur les voix, la musique, le chant. Il y aurait beaucoup plus à dire. Mais l’essentiel est : courez-y. Les heures passent comme un souffle tant la haute littérature et le grand art du théâtre, cet « élitaire pour tous » qu’appelait Antoine Vitez, sont là, dans un accomplissement prodigieux. Et simple. Accessible. Pour chacun de nous tous, oui. Armelle Héliot Centre Georges-Pompidou, à 20h00 jusqu’à samedi, à 17h00 dimanche 22 janvier, puis du 22 au 26 janvier, au Théâtre des Quartiers d’Ivry. Durée : 3h20, prologue compris, mais sans entracte. Dans le cadre du Festival d’Automne. Sébastien Kheroufi a reçu le prix de la révélation du palmarès du Syndicat de la Critique, 2024, en juin dernier.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 2, 4:46 PM
|
Enquête Libé, par Cassandre Leray - le 2 janvier 2025 Il était son idole. En 2010, Agathe Pujol a 17 ans, elle est en terminale dans un lycée parisien. Un jour de septembre, elle poste une lettre longue de plusieurs pages à l’adresse du comédien Philippe Caubère pour lui témoigner son «admiration». «J’ai lu vos livres, vos conversations, vos interviews, j’ai appris sur le théâtre plus que jamais auparavant», lui confie l’adolescente. Elle rêve d’être actrice, mais connaît très peu ce monde et ses coutumes. Elle demande : «En 1968, vous aviez mon âge, mais aviez-vous mes doutes, mes incertitudes, mes angoisses ?» A sa grande surprise, l’acteur lui répond. Philippe Caubère a alors 60 ans, il a déjà été récompensé de deux Molières, dont celui de la «révélation théâtrale masculine» en 1987. Il est une figure du théâtre du Soleil, mené par Ariane Mnouchkine. Il arpente les scènes françaises pour y interpréter des textes retraçant sa vie. Il propose une rencontre à sa très jeune admiratrice. Avertissement : Cet article relate des violences sexuelles, notamment sur des mineures, et peut choquer. Rendez-vous est pris le 6 octobre 2010. L’adolescente se rend à l’appartement du comédien, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), où il lui parle de son art avant de l’inviter à son spectacle le soir même. Cinq jours plus tard, le 11 octobre, elle retourne chez lui, «rassurée» après leur premier rendez-vous : elle voit en lui un potentiel «mentor» à qui demander conseil. Ce soir-là, après lui avoir «servi des verres de vodka glacée et discuté de théâtre pendant des heures», Caubère «m’embrasse sur son canapé avant de toucher ma poitrine», décrit Agathe Pujol. Quelques jours plus tard, elle le revoit. Il la «pénètre avec ses doigts et [lui] fait un cunnilingus», alors qu’elle est encore mineure : «C’était la première fois que quelqu’un m’embrassait ou me touchait.» S’ensuivent plus de dix ans «d’horreur». Agathe Pujol accuse Philippe Caubère de l’avoir violée et agressée sexuellement de manière répétée entre 2010 et 2022, de ses 17 à ses 29 ans. Mais aussi de l’avoir «fait violer» pendant des années par des hommes recrutés sur des sites de petites annonces. «Libération» a recueilli les témoignages des trois femmes qui ont déposé plainte Quand Agathe Pujol coupe les ponts avec l’acteur en 2022, elle se jure de ne plus jamais parler de tout cela. Mais la police judiciaire de Créteil débarque chez ses parents le 22 juin 2023. Une plainte pour «atteinte sexuelle» sur mineure a été déposée quelques mois plus tôt contre l’artiste par une comédienne, Pauline Darcel, et Agathe pourrait être une témoin clé. Aux enquêteurs, elle retrace douze années «d’emprise» et «l’ascendance» que Caubère avait sur elle, mais aussi sur «d’autres jeunes filles naïves et vulnérables» qui «le voyaient comme un demi-dieu, car il se présentait comme tel». Après plusieurs mois de réflexion, elle dépose plainte en octobre 2023. En février 2024, Philippe Caubère, 74 ans aujourd’hui, a été mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur ainsi qu’agression sexuelle sur une personne majeure, dans le cadre de trois affaires, pour des faits qui se seraient déroulés entre 2010 et 2022. Contacté, le parquet de Créteil précise que l’acteur a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs, interdiction d’entrer en relation avec les victimes et obligation de soins. Libération a recueilli les témoignages des trois femmes qui ont déposé plainte contre l’acteur. Parmi elles, Flora (1), une étudiante de 21 ans qui souhaite rester anonyme. Mais aussi deux comédiennes, qui s’expriment pour la première fois à visage découvert : Agathe Pujol, 31 ans, et Pauline Darcel, 29 ans. Contactées lundi 16 décembre par Libération, les avocates de Philippe Caubère, Me Julia Minkowski et Me Eléonore Heftler-Louiche, ont jugé «inenvisageable» de répondre à nos questions, alors que leur client, présumé innocent, n’a «toujours pas été entendu au fond par le juge d’instruction». Elles précisent toutefois que celui-ci «réfute» avoir «imposé le moindre acte sexuel» à Pauline Darcel, et «qu’il réfute avec autant de force avoir imposé des relations sexuelles à celle qui a été sa compagne pendant dix ans», Agathe Pujol, «par quelque moyen que ce soit». Le scénario de 2010 décrit par Agathe Pujol fait écho à celui de novembre 2011 que dépeint Pauline Darcel. Alors lycéenne en classe de première, celle-ci rencontre l’acteur – dont elle est «fan» – sur le tournage du film l’Harmonie familiale, où elle est figurante. Comme avec Agathe Pujol et Flora, il lui demande de regarder les DVD des pièces et films dans lesquels il joue, et lui offre un exemplaire de son livre Carnets d’un jeune homme, publié en 1999, dans lequel il décrit notamment sa sexualité ou encore le fait qu’il s’est masturbé sur des «photos de victimes nues des camps de concentration», des propos choquants pourtant passés inaperçus à la sortie de l’ouvrage. La première étape de ce que Pauline Darcel nomme la «caubérisation». A la même époque dans un cours de théâtre à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), elle croise la route de Théo Arnulf, un ami d’Agathe Pujol, devenu depuis éclairagiste. Quand Pauline lui raconte qu’elle a décroché un rendez-vous avec Caubère, il s’inquiète : «Agathe m’avait raconté ce qui lui était arrivé, alors j’ai tenté de la dissuader d’y aller», explique-t-il à Libération. Mais Pauline Darcel fait confiance à Caubère. Elle l’a tout de suite vu comme «un père spirituel du théâtre qui [le lui] raconterait et [le lui] expliquerait», écrit-elle dans un SMS du 29 février 2012 envoyé à l’acteur. Entre décembre 2011 et mars 2012, il l’«invite au théâtre et chez lui à deux occasions pour parler de sa carrière, sans que rien ne se passe». Lorsqu’elle le retrouve une nouvelle fois dans son appartement à Saint-Mandé le 1er avril 2012, elle croit là encore à un rendez-vous professionnel. Mais en pleine discussion, il «[l’]embrasse en [lui] saisissant la nuque par surprise», «puis il [l’]emmène dans sa chambre». Elle ne se souvient plus de ce qui s’est passé ensuite, souffrant d’une «amnésie traumatique». Elle a 16 ans, lui 61 ans. «Matzneff dit la vérité» Les récits d’Agathe Pujol et Pauline Darcel se superposent. Pendant plusieurs mois, en 2012, toutes les deux voient régulièrement Philippe Caubère sans jamais se croiser. Parfois, l’une arrive alors que l’autre vient de partir. Il leur réclame «l’épilation du pubis». Un retrait intégral des poils qui provoque à Agathe Pujol des «cystites à répétition», laquelle raconte qu’il finance l’esthéticienne quand elle ne peut pas payer. Il ne supporte pas non plus de porter un préservatif : «Il disait qu’il lui était impossible de “baiser avec un sac-poubelle sur la bite”», rapporte Agathe Pujol. Quand les deux adolescentes refusent qu’il les pénètre avec son pénis, il leur impose d’autres pratiques, rapportent-elles. Comme la fellation, dans une position qu’elles décrivent à l’identique : lui debout face à un miroir, elles à genoux. Elles l’accusent également chacune d’avoir tenté de les pénétrer par surprise. Agathe Pujol raconte qu’il «hurle» que la «frustration est trop grande» et lui «impose des sodomies» en attendant de pouvoir «la déflorer». Pauline Darcel rapporte des reproches sur une relation qui serait «platonique» car elle n’accepte «que» la fellation et la masturbation. Pour l’anniversaire des 17 ans de Pauline Darcel, Caubère prévoit une «surprise» : il la «pénètre avec un godemiché», se souvient-elle. Agathe Pujol raconte qu’il fait de même avec elle quelques semaines plus tard. Cette fois, c’est un cadeau de félicitations : elle a obtenu le baccalauréat. Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici Au-delà des souvenirs, Philippe Caubère laisse derrière lui plusieurs centaines de mails et de SMS que Libération a pu consulter. L’homme était «omniprésent» dans leurs vies. A Agathe Pujol, il écrit «Matzneff [écrivain visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, ndlr] dit la vérité : c’est merveilleux à 15 ans» ou encore : «Je te trouvais trop bonne. Même ta maigreur de déportée me faisait – mentalement – bander.» A Pauline Darcel, il dit aimer «quand tu m’embrasses avec tant de passion et de grâce à la fois, tant de fureur et d’érotisme enfantin». Des viols «organisés plusieurs fois par semaine» A l’été 2012, Pauline Darcel, 17 ans, ne «supporte plus ce que lui impose Philippe Caubère» et cesse de le voir. Elle perd du poids, fait des crises d’angoisse, se brosse les dents jusqu’à faire saigner ses gencives pour «effacer les traces de son sexe dans ma bouche». Son meilleur ami, Morgan Janoir, auteur de théâtre, 29 ans aujourd’hui, a toujours suspecté quelque chose de grave quand elle lui racontait, plus jeune, qu’elle «voyait» le comédien. Six ans plus tard, en 2018, il prévient Pauline Darcel qu’une comédienne, Solveig Halloin, a déposé plainte pour viol contre Caubère. La jeune femme s’effondre, et lui raconte «tout ce qu’elle a vécu». Pauline Darcel repense à Agathe Pujol. Elles ne se sont jamais vues mais Philippe Caubère aime raconter à l’une ce qu’il fait avec l’autre en les nommant, comme il le ferait avec d’autres jeunes femmes, selon les témoignages concordants des deux plaignantes. Il instaure entre elles un «climat de concurrence, notamment sexuel», expose Pauline Darcel. Après avoir déposé plainte le 28 octobre 2022, elle glisse donc le nom d’Agathe aux policiers. Ce que Pauline Darcel ne sait pas, c’est que l’histoire d’Agathe Pujol a duré plus d’une décennie. A ses 18 ans, Philippe Caubère la «viole avec son pénis dans le vagin pour la première fois», retrace Agathe Pujol. Le comédien l’aide ensuite à préparer les concours d’entrée dans les écoles d’art dramatique. Il le lui promet : elle est «vouée à un grand avenir», se rappelle-t-elle. A condition qu’elle soit plus «libérée». L’acteur poste alors «des messages sur les sites de petites annonces Wannonce et Vivastreet avec des photos de moi dénudée», relate-t-elle, pour «l’offrir» à des inconnus. «Elle souhaite que je la présente à un homme bien monté et circoncis (obligatoirement) pour exhib hard et humiliation symbolique, suivie d’une fellation nature, complète ou pas […]», rédige-t-il dans un mail qu’il lui transfère le 30 mai 2011. Seul critère, précise Agathe Pujol : que les «clients», à qui il demandait «une dizaine d’euros», «fassent des fautes d’orthographe». Une manière de s’assurer qu’ils ne sont pas issus du milieu de la culture, et qu’ils n’ont aucune chance de le reconnaître. Parfois, il la «donne à des amis de confiance». Ces «viols» sont «organisés plusieurs fois par semaine» par Caubère entre 2011 et 2018. En guise de décor, son appartement ou celui d’un «client», le bois de Vincennes ou encore sa résidence à La Fare-les-Oliviers, un village provençal. Agathe Pujol estime avoir été «violée par des centaines d’hommes». Souvent, Caubère «regarde et prend des photos». Une fois les hommes partis, «il me violait à son tour. Il avait des problèmes d’impuissance et disait que c’était la seule chose qui le faisait bander». Quand elle angoisse, «il [lui] fait prendre un comprimé d’Urbanyl», un anxiolytique. Des faits qu’elle a confiés à son ami Théo Arnulf dès 2011, ce qu’il confirme à Libération. Le 8 novembre 2011, ce dernier envoie un mail désespéré à Agathe Pujol : «Tu ne vaux pas ça, tu ne vaux pas 300 euros ou 100 millions […] Merde à la soumission, merde à la domination […] Merde à Philippe Caubère !» Philippe Caubère «contrôlait ma carrière, mes relations…» A l’époque, Agathe Pujol veut que tout «s’arrête». Mais, selon son récit, si elle s’oppose à Caubère, leur histoire est vouée à l’échec. Et il le lui a suffisamment dit : elle n’est rien sans lui. Elle vient d’un milieu modeste, n’a pas de contacts dans le théâtre et manque d’argent. L’acteur l’emploie comme assistante de production ou lui fait vendre ses livres, et la présente comme «sa petite amie» à des artistes pour lui trouver des rôles. «Il contrôlait ma carrière, mes relations…» se remémore Agathe Pujol. La «mainmise» de Philippe Caubère sur sa vie est «totale», dit-elle : en juin 2013, elle «tombe accidentellement enceinte de lui» et pense un temps garder l’enfant. «Mais il m’a dit que j’allais ruiner sa vie et m’a incendiée jusqu’à ce que j’avorte.» Dès les premiers mois de leur relation et de plus en plus souvent au fil du temps, Agathe Pujol pense au suicide. Elle perd du poids, jusqu’à ne peser que 46 kilos pour 1,72 mètre. En août 2022, son état de santé provoque un déclic : elle rompt avec Caubère et est hospitalisée en urgence pour «un épuisement dépressif» et des «idées suicidaires», selon le compte rendu médical. Depuis, elle n’a jamais cessé de prendre des antidépresseurs. «Si la police n’était pas venue me chercher, je n’aurais jamais osé parler.» Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici «La défense de Caubère sera de dire que si je suis restée douze ans, j’étais forcément consentante», pressent Agathe Pujol. Un «raccourci» qu’elle déconstruit : «J’étais une gamine quand je l’ai rencontré, je n’avais aucun libre arbitre.» Elle repense à l’adolescente «influençable et paumée» qu’elle était, celle «qui n’avait aucune confiance en elle, pas d’argent et pas de proches sur qui compter». Elle raconte les «maintes fois où [elle] a tenté de s’extirper de lui». Mais «il a fait de moi sa chose. Mes fragilités faisaient de moi la proie parfaite, et il le savait». Philippe Caubère n’a jamais caché ses «conquêtes» à son entourage, selon Agathe Pujol : il l’a présentée aussi bien à ses proches qu’à ses collègues. Tout comme il a convié Pauline Darcel à le rejoindre après ses spectacles. Chacune l’assure : «Tout le monde savait.» Une vision partagée par la troisième plaignante, Flora. En janvier 2024, lorsqu’elle lit dans la presse que Philippe Caubère est visé par une plainte, elle n’est «pas surprise». L’étudiante de 21 ans contacte alors la PJ de Créteil et est entendue le 23 janvier, sans penser entamer une démarche judiciaire. Mais à la suite de son récit, le parquet met en examen le comédien pour «corruption» de mineur – le fait d’imposer à un mineur des propos, des actes ou des images pouvant le pousser à adopter une attitude ou un comportement sexuel dégradant. Une décision qui motive Flora à porter plainte. «Ce qui m’a protégée, c’est d’être devenue une amie de sa fille» Son récit commence en 2017. A 14 ans, Flora contacte Philippe Caubère pour son oral d’histoire de l’art du brevet des collèges. Elle a grandi dans une famille admiratrice du travail de l’acteur et prépare un exposé sur lui. Impensable : «Il me répond et m’invite au restaurant.» Quand il commence à «[l]’appeler “ma chérie” et «[lui] écrire nuit et jour», Flora se croit «chanceuse» : elle parle à «son artiste préféré». Deux ans plus tard, à l’été 2019, Véronique Coquet, l’épouse de Philippe Caubère qu’elle a déjà rencontrée lors de dîners, «m’invite chez eux dans le sud de la France pour un stage de tri des archives» de l’acteur, explique Flora. Qui plante le décor de ce séjour : le soir, elle «retrouve Caubère au bord de la piscine». Ils discutent de longues heures de «sa sexualité, du théâtre ou encore de sa petite amie Agathe». Les deux sont «si proches», se remémore Flora, que la fille de Caubère – 13 ans à leur rencontre – lui avoue des années plus tard avoir cru qu’elle était «la copine» de son père. A la fin des vacances, «il m’a envoyé une photo de son corps nu au bord de la piscine», détaille Flora. Une image que Libération a pu consulter. Elle accuse Caubère d’avoir continué à lui adresser «des messages à caractère sexuel» jusqu’en 2021. «[…] je serais trop fier. D’être accusé de pédophilie par un si beau bébé […]», peut-on lire dans un échange de juillet 2019. «Le simple fait d’être devant une élève d’école, avec son cahier d’écolière si bien tracé, faisait place à une autre sensation […] Tu me plaisais. […] Sauf que tu avais… 15 ans ? C’est ça ? Peut-être même pas ! 14 ?» lui écrit-il dans une lettre pour ses 18 ans, en juillet 2021. Philippe Caubère n’ira jamais plus loin. «Ce qui m’a protégée, c’est d’être devenue une amie de sa fille» lors de cet été dans leur maison, suppose Flora. Contacté par Libération, Philippe Caubère explique, par l’entremise de ses avocates, qu’il «regrette» l’envoi de messages à l’adolescente et «présente ses excuses». «J’ai un gros problème avec la question de l’âge» Selon nos informations, plusieurs personnes de l’entourage de Philippe Caubère ont été entendues par la police judiciaire de Créteil. Auditionnée le 7 février 2024, Véronique Coquet, avec qui l’acteur dit être en mariage libertin depuis 2005, a admis connaître Agathe Pujol. Mais assure avoir découvert son existence et leur liaison seulement quand elle avait 18 ans, sans que les 42 ans qui les séparent ne l’alertent. Auprès de Libération, Véronique Coquet écrit n’avoir «jamais eu connaissance de relations sexuelles de Philippe Caubère avec des mineures». Plusieurs collègues de l’acteur, eux aussi, rapportent avoir connu Agathe Pujol et la nature de leur relation. Pourtant, personne autour du comédien ne semble s’étonner de l’âge des jeunes filles croisées. Entendue par les enquêteurs le 14 février 2023, Ariane Mnouchkine, qui a lancé la carrière de l’acteur au théâtre du Soleil dans les années 70, assure alors que le comédien «n’est pas un prédateur», et qu’il n’a pas, à sa connaissance, «d’attirance» pour les mineures. Contactée par Libé, la metteuse en scène précise avoir découvert les accusations à l’encontre du comédien «dans la presse». «Philippe a quitté le Soleil en 1978, rappelle-t-elle. Nous sommes restés longtemps éloignés, et je n’ai donc pas suivi sa vie privée.» Les conclusions de l’experte décrivent un «désir de toute puissance» Au cours de son expertise psychologique en août 2024, dont Libération a pu prendre connaissance, Philippe Caubère a reconnu les «liaisons et rapports sexuels» avec «deux des plaignantes», sans préciser si elles étaient majeures ou mineures. Il explique qu’il a «eu des petites amies de tous les âges». «J’ai un gros problème avec la question de l’âge qui a été multiplié par le jeu de la vie, je joue l’enfant, l’adolescent et l’adulte», dit-il encore, ajoutant avoir «du mal à différencier sexe, amour et création, en fait, c’est la même pulsion». Les conclusions de l’experte décrivent chez l’acteur un «désir de toute puissance», et un «goût du prestige» vis-à-vis de «sujets jeunes et inexpérimentés, susceptibles d’être placés dans un rapport de séduction et de subordination maître/élève». «Encore et toujours» le «prétexte de l’art», soupire Pauline Darcel. En octobre 2021, elle avait manifesté près du ministère de la Culture, à l’occasion du premier rassemblement du mouvement #MeTooThéâtre. Elle se souvient y avoir aperçu Solveig Halloin, la première femme à avoir accusé publiquement Caubère de viol. «Si sa plainte n’avait pas été classée sans suite» par le parquet de Créteil pour manque d’éléments en 2019, souffle Agathe Pujol, «nous aurions peut-être toutes osé parler plus tôt». (1) Le prénom a été modifié. Cassandre Leray / Libération
Légende photo : Agathe Pujol (31 ans) et Pauline Darcel (29 ans) accusent le comédien Philippe Caubère de plusieurs viols lorsqu'elles étaient mineures. (Cha Gonzalez/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 31, 2024 7:05 PM
|
Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 31 déc. 2024 La danseuse a marqué notamment avec son « Lac des Cygnes » gay et afro-contemporain, devenu une référence en 2010. Elle s’est éteinte, le 29 décembre, à l’âge de 39 ans. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/12/31/dada-masilo-choregraphe-sud-africaine-connue-pour-ses-relectures-engagees-des-monuments-du-repertoire-est-morte_6475615_3382.html
Son allure joyeusement fonceuse et guerrière, sa détermination à fleur de peau attrapaient l’œil où qu’elle soit. Dans la rue comme sur scène, la danseuse et chorégraphe sud-africaine Dada Masilo irradiait d’un charme puissant. Connue dans le monde entier depuis une quinzaine d’années pour ses relectures engagées, entre contemporain et tradition africaine, de monuments du répertoire, l’artiste est morte dimanche 29 décembre, à l’âge de 39 ans. Née en 1985, à Soweto, Dada Masilo a grandi à Johannesbug où elle fonde, dès l’âge de 12 ans, un petit groupe de filles baptisé The Peacemakers. Dans la foulée, elle prend ses premiers cours à la Dance Factory. Huit ans plus tard, elle intègre P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), école dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker, à Bruxelles. Elle y étudie pendant deux ans puis retourne en Afrique du Sud. Coup sur coup, après avoir créé sa compagnie en 2008, elle chorégraphie des pièces qui vont marquer sa trajectoire, adaptations de mythes dont Roméo et Juliette (2008) et Carmen (2009). En 2010, sa version gay et afro-contemporaine, très électrique et rouleuse de hanches, du Lac des cygnes impose son geste engagé : le prince choisit un cygne du même sexe que lui. Cette production, véritable hit dans sa trajectoire, met son nom sur la carte des artistes qui font parler d’eux. Avec toujours en ligne de mire, quel que soit le thème, la volonté de dénoncer les abus en tous genres, de militer contre l’homophobie. Se confronter aux « problèmes de société » Lors d’un entretien pour Le Monde, en 2012, à propos du Lac des cygnes, elle témoignait ainsi : « Evidemment, il y a des danseurs homosexuels, et qu’est-ce que ça peut faire ? J’ai eu envie de montrer cette évidence-là. Qu’est-ce que ça peut faire que Siegfried soit gay ? Est-il moins une personne pour autant ? Les êtres humains sont naturellement chargés sexuellement. De plus, nous vivons dans un monde où le sexe nous est vendu en permanence à la télévision, dans les magazines. Je vis par ailleurs dans un pays où l’homophobie est très présente, et je veux que mon travail se confronte à ces problèmes de société. » Présentée en 2014 au Théâtre du Rond-Point, à Paris, sa Carmen, pour quinze danseurs, ne tourne pas deux fois son cigare dans sa bouche pour faire entendre ce qu’elle désire. Sur la musique de Bizet retravaillée par le Russe Rodion Chtchedrine, Dada Masilo, qui désirait interpréter Carmen après avoir vu la version du chorégraphe suédois Mats Ek lorsqu’elle avait 16 ans, orchestre une invraisemblable fiesta où les cris se transforment en roucoulements tandis que les langues de l’Afrique du Sud, le xhosa, le tswana et le zoulou, se télescopent. A l’affiche du Festival d’Avignon en 2022, elle dansait Le Sacrifice, sous influence du Sacre du printemps, de Stravinsky, avec neuf interprètes, trois musiciens et une chanteuse. Une femme victime y était portée à la fin de la pièce dont l’écriture était inspirée par la danse tswana du Botswana. Parallèlement à ses créations, Dada Masilo a également collaboré avec William Kentridge pour Refuse the Hour, en 2012. Début décembre, elle inaugurait une plaque en forme d’étoile à son nom sur le mur du Théâtre de Soweto. Dada Masilo en quelques dates 1985 Naissance à Soweto (Afrique du Sud) 2008 Fonde sa compagnie à Johannesburg 2009 Création de « Carmen » 2010 Création du « Lac des cygnes » 2022 Présente « Le Sacrifice » au Festival d’Avignon 29 décembre 2024 Mort Rosita Boisseau Légende photo : « Le Lac des cygnes », revu par la chorégraphe Dada Masilo, qu’elle interprète ici, à Londres, en 2014. LEO MASON/POPPERFOTO/CORBIS VIA GETTY IMAGES

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 30, 2024 4:33 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - publié le 30 déc. 2024 Fer de lance et âme du Prato à Lille, ce « Théâtre international de quartier » unique au monde, Gilles Defacque était un clown sans pareil, un poète, un pourfendeur d’idées reçues, un auteur- metteur en scène généreux, un inventeur de tout avec rien et et un formateur infatigable auprès de nombreux artistes en herbe aujourd’hui reconnus. Il le disait, le pressentait déjà, il y a sept ans dans son Journal de création : « On aura pas le temps/ On pourra pas tout faire avant de partir/On aura pas le temps/On aura pas le temps de tout dire/On fera un effort un essai encore encore/ un autre et on aura pas le temps de finir / On sera pris de court bien sûr/ C’est comme pour le grand déménagement/ on frotte on astique on lave on range on/ empile/On cire on met dans des sacs dans des boîtes/ et puis à la fin on met tout dehors/ Et on se dit que ça y est on est prêt à partir/ et en même temps on a l’impression/ qu’on oublie quelques chose – parce qu’on/ oublie toujours quelque chose –/,on cherche on trouve pas on repasse tout/ dans sa tête – et puis on a l’impression/ qu’on a oublié quelqu’un qu’on a oublié/ de dire quelque chose à quelqu’un et cette/ chose-là c’était ce qu’il fallait lui dire c’était/ le plus important – et on voit pas –/ on a oublié – y a la part d’oubli qui s’est/ glissée là subrepticement au détour/ d’une occupation tellement plus importante /sur le coup/ On sera pris de court/ Forcément/ (Comme un raz de marée qui vous enlève/ vous soulève et vous emmène chez les morts.c’est comme les souvenirs on aura pas le/ temps de tous les emmener de les préparer de les bichonner de les ranger)/ (On aura tout juste le temps de ne pas y/ croire de se dire que c’est pas vrai de penser/ que c’est un cauchemar quelque chose/ comme ça – en un instant – un raz de marée/ ;– une tornade / – un coup de foudre – un coup de grisou.). » Au stalag le père de Gilles avait animé une troupe de théâtre amateur, son épouse allait délaisser son guichet à la poste pour gérer le Mignon-Palace un café-restaurant du coin (de proximité comme on dit aujourd’hui) où le gamin Gilles fit ses classes de lutte des classes, apprit ses premiers rudiments de comédie avec les catcheurs réputés et madrés comme L’Ange blanc ou le Bourreau de Béthune. Plus tard, Defacque étudia, eut même comme prof Henri Meschonnic. En mai 68, il n’a pas encore 23 ans, du mordant plein les dents. Ça milite dur. Extrêmement à gauche toute. Et puis, c’est le coup de massue. Un jour, des potes entraînent Gilles dans un lycée de Tourcoing voir un spectacle à sketches sur des textes de Peter Weiss. C’est le déclic. Il rejoint le Prato, une troupe amateure qui joue dans les rues du quartier Wazemmes à Lille. Prato, pourquoi ce nom ? A cause de ces praticables dont use le théâtre ? de la proximité entre Prato et plateau ? Et pourquoi pas un anagramme avorté de patron ? Le patron du Prato c’est bientôt Gilles le bien prénommé. La troupe marche sur deux pieds : clown et burlesque, gag et agit-prop, avec des titres de spectacles comme Silence on détourne ! En 78, Aux armes citoyens ! en 90, Opéra Bouffes circus en 2002, etc. Autour de Gilles Defacque, ils sont aussi nombreux que fidèles comme Alain D’Haeyer pour n’en citer qu’un. Le premier spectacle de clown en 1973 réunissait Jean-Noël Biard, Ronny Coutteure et Gilles Defacque, son titre Tu t’en vas?Non, non j’m’en vais, n‘est pas sans évoquer un autre titre, Si tu me quittes est-ce que je peux venir aussi ? futur spectacle du Ballatum théâtre, compagnie créée à Liévin par Eric Lacascade et Guy Alloucherie. Tous deux formés aux spectacles de rue et d’agit prop anarchistes allaient devenir des enfants du Prato, deux ans durant, avant de fonder leur compagnie. Saison après saison les spectacles bricolés maison se multiplient dont ce bel aboutissement que sera, en 2007, la fresque de Mignon-Palace (138 représentations) avec Jacques Motte et bien d’autres. Le Prato s’intéressera aussi à des textes de grands auteurs dont l’univers ne leur est pas indifférent , Defacque parle à ce sujet « attractions littéraires » dans tous les sens du mot attraction. Ainsi Beckett (Godot, Fin de Partie, Oh les beaux jours avec Danièle Hennebelle) , ainsi Calaferte et d ‘autres encore comme Benjamin Peret ou Bukovski. Ce qui n’empêche pas Defacque d’écrire et de faire le clown, ses deux mamelles. Defacque fait école et il est bientôt appelé à enseigner le clown dan des écoles nationales (cirque ou théâtre). Nombreux sont les gens de cirque (ou pas) qui viendront faire un séjour, souvent très long, au Prato. Citons de très grands clowns comme Catherine Germain (« Gilles est un profond insatisfait, il est sans arrêt en train de se poser lui comme passeur, un voyageur, un intranquille, le clown, c’est un peu ça, c’est un brouillon ») ou Gacon Bonaventure (« Le Prato c’est une famille c’est plus qu’une troupe » ). Dans ce beau livre très illustré nombreux sont les artistes qui disent tout ce qu’ils doivent au Prato, à « Gilles » et à « Pat », à la façon dont ils ont été écoutés, reçus, accompagnés. Citons Camille Decourtye et Blai Mateus (Baro d’evel), Chloé Moglia (« La façon qu’ont Gilles et Patricia d’être là tous les soirs, ce n’est pas juste un lieu qui fonctionne, mais c’est un poème qui respire »), Melissa von Vépy, Yolande Moreau ou Tiphaine Raffier. Cette dernière est élève à l’école du Théâtre du Nord lorsque Gilles Defacque vient diriger les élèves lors d’un stage. Defacque propose à Tiphaine de rejoindre l’équipe de Soirée de gala, autre spectacle marquant du Prato en 2013. « Une grande aventure, dit Tiphaine, la découverte que j’aimais beaucoup travailler avec des circassiens et que j’étais moi-même une artiste burlesque». Il faudrait aussi citer les complicités, avec Jacques Bonnafé, André Minvielle, Bernard Lubat et bien d’autres sans parler des musiciens compagnons du Prato. A La fin du livre, un abécédaire fait l’inventaire de tous ceux et toutes celles qui on partagé un bout de leur histoire avec le Prado. Il énumère également la liste des spectacles (autour de 70) sans compter les multiples solos de clowns, les ateliers-spectacles, les stages, les « performances à géométrie variable » et les « attractions littéraires ». Patricia Kapusta avait rejoint le Prato dès 1991. A lui l’imagination et l’improvisation, à elle la gestion et l’organisation. Ils font la paire. Depuis qu’ils ont passé la main, Patricia retourne parfois au Prato. Gilles ne préfère pas. Il écrit, il a toujours écrit, des « parlures » et autres poésies, des canevas, ses mémoires sous un mode burlesque. Il en a aujourd’hui fini de « jardiner les possibles ». Ses obsèques auront lieu le 6 janvier à 11h, au cimetière de Lille-Est. Une exposition de ses dessins et autres facéties se tiendra au Théâtre du Nord du 17 janvier au 8 février. Un théâtre international de quartier, le Prato, ouvrage collectif sous la direction de Patricia Kapusta, éditions Invenit, 192 p, nombreuses illustrations, 25€.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 20, 2024 5:35 PM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 20 décembre 2024 Le prix du Jury, présidé par Thomas Jolly, est allé à « Sans faire de Bruit » de Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny par la compagnie Nachepa, le prix des lycéens et celui de la SACD mettent à l’honneur « Annette » de Clémentine Colpin par la compagnie Canicule et le prix du public a élu « La trouée » de Cécile Morelle et sa compagnie Le compost.
Impatience, « le festival du théâtre émergent »t existe, lui, depuis longtemps. La preuve, Thomas Joly, le président du Jury cette année, heureux de retrouver le théâtre après ses agapes olympiques, est un ancien lauréat du festival, tout comme un des nombreux membres du jury, Tommy Milliot, aujourd’hui à la tête du CDN de Besançon. Organisé depuis le début par Le Centquatre et Télérama, le festival se grossit chaque année ou presque de nouveaux membres partenaires en France mais aussi en Belgique et en Suisse . Le Jury, de plus en plus pléthorique, change de président chaque année, outre les organisateurs et les lieux partenaires, il compte quelques membres pour ainsi dire de droit telle Nicole Gauthier, sans doute la meilleure connaisseuse du théâtre qui se fait en France ou bien des accros comme Eric Ruf retenu cette année par sa mise en scène fleuve du Soulier de Satin, son dernier spectacle en tant qu’administrateur de la Comédie-Française. Neuf spectacles avaient été sélectionnés sur maquette, vidéos ou de visu. Certains plutôt neufs, d’autres déjà rôdés par des tournées. Le plus souvent des compagnies plus ou moins encore balbutiantes après quelques années de pratique , mais là, stupeur et indignation, on y trouve une compagnie « conventionnée » ayant à son actif cinq spectacles, celui présenté au festival étant coproduit par deux CDN et diverses Scènes nationales et le directeur artistique étant artiste associé à deux CDN. On est loin du « théâtre émergent », ADN du festival Impatience dont les règles mériteraient d’être redéfinies. Fort heureusement le spectacle au demeurant assez confus, de cette compagnie n’a pas été primé. Le prix du jury est donc allé à Sans faire de bruit par la compagnie Nachepa. Tal Reuveny a créé cette compagnie en 2018 (avec Michael Charny), Louve Reiniche-Larroche l’a rejointe en 2021 pour en partager la direction artistique. Toutes les deux sont passées,entre autres, par les cours Florent et l’école Jacques Lecoq. Ensemble, elles signent l’écriture de Sans faire de bruit, Tal Reuveny assure la mise en scène. Il serait faux de dire que Louve Reiniche est « seule en scène » même si son seul son corps y est présent. Dans un décor de salon un peu suranné, elle entre et dispose sur le sol un micro et un magnétophone puis déplace un fauteuil roulant et revient s’asseoir. C’est alors que le spectacle comme vraiment : Assise dans son fauteuil, l’actrice parle. Ce n’est pas sa voix que l’on entend mais celle d’un vieil homme, son grand père. Troublante synchronisation entre les lèvres de l'actrice et la voix du vieil homme. Puis, dans le même dispositif, se succéderont d’autres voix familiales, de différents âges jusqu'à en cerner le nœud : la mère de l’actrice qui, d’un seul coup, se réveille sourde. Alors le spectacle, tout e restant, aussi simple que fort, bascule dans une sorte d’onirisme concret. N’en disons pas plus. Ce spectacle joliment titré Sans faire de bruit va donc en faire du bruit avec ce prix du Jury qui lui garanti une belle tournée. Le spectacle avait déjà été à l’affiche du nouveau théâtre de l'Atalante et au Train bleu lors du dernier festival off d’Avignon. A l a sortie du spectacle, on vous offre un QR code qui vous conduit à un entretien entre le docteur ORL Isabelle Mousnier et celle qu’elle a opérée, Hélène Laroche, la mère de Louve. Le prix du Jury et celui de la SACD sont allés à Annette de la compagnie belge Canicule fondée par Clémentine Colpin, Pauline Desmarets et Olivia Smets. La première signe la mise en scène, les deux autres jouent rejoints par Paul Fury, Alex Landa Aguirreche et, omniprésente, Annette Baussart, qui, à 75 ans, pète le feu. Ça joue, ça danse, ça batifole, ça rajeunit à vue d’œil. C’est joyeux. Annette (Baussart) est comme la meneuse de revue un rien coquine de sa propre vie sous l’œil complice de ses camarades de jeu et de la metteuse en scène Clémentine Colpin. Enfin le prix du public est allé à La trouée, justement sous titré « un road trip rural », écrit, mis en scène et interprété par Cécile Morelle. Un spectacle qui, lui aussi, était au Train bleu lors du dernier festival d’Avignon off et que l’on avait vu et chroniqué (lire ici) l’an dernier lorsqu’il avait été programmé au Phénix de Valenciennes dans le cadre du Cabaret de curiosités. Dates de tournée de Sans faire de bruit: les 7,8,9 fév au Bellovidère, à Beauvoir, le28 fév - Prades-le-Lez, du 6 au 15 mars au Théâtre Paris-Villette, les 3,4 et 5 avril à la La Pop, du 21 avril au 4 mai 2 au festival Komidi à la Réunion, Suite la saison prochaine. Légende photo : Scène de Sans faire de bruit © Fred Mauviel

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2024 2:41 PM
|
Par Joëlle Gayot dans Le Monde - Publié le 18 déc. 2024 Au Lucernaire, à Paris, la pièce inspirée des « Frustrés » et des « Mères » est portée par deux actrices effrontées, Valérie Dashwood et Cécile Garcia-Fogel.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/12/18/poussez-vous-les-mecs-un-spectacle-qui-reprend-la-pertinence-caustique-de-claire-bretecher_6456258_3246.html
Le titre est excluant. Mais pas le spectacle, qui vient glisser, à point nommé, sa pertinence caustique dans une fin d’année théâtrale chiche en propositions. Présenté au Lucernaire, à Paris, Poussez-vous, les mecs ! n’épargne pas plus les hommes que les femmes. A la charge urticante menée contre les adeptes du manspreading (au sens strict et métaphorique du concept qu’on peut traduire par « étalement masculin ») s’ajoute une critique des bourgeoises qui votent à gauche, on se demande pourquoi. Claire Bretécher (1940-2020), autrice de BD, est à l’origine d’une représentation piquante portée par deux actrices effrontées : Valérie Dashwood et Cécile Garcia-Fogel, cette dernière ayant eu la riche idée de prélever (et de mettre en scène) des fragments des Frustrés et des Mères, deux bandes dessinées qui avaient trouvé asile dans les pages du Nouvel Observateur, dans les années 1970-1980. Dans une minuscule salle perchée sous les toits, le décor téléporte le public vers une France post-soixante-huitarde et prémitterrandienne : un canapé en Skaï avec ses coussins rouges luisants, un ballon bleu de cours de pilates, un cadre qui sert de portant de vêtements et de lucarne télévisuelle. Pur plaisir du jeu En une heure déroulée au pas de charge, qui les voit basculer du salon d’un appartement à une manifestation féministe, avant de finir allongées sur une plage de Belle-Ile-en-Mer, les comédiennes conjuguent leurs différences à la manière de Laurel et Hardy. L’une grande, l’autre petite, l’une en chemise, l’autre en polo, l’une déniaisée, l’autre boudeuse, l’une échevelée, l’autre quasi gominée : Valérie Dashwood et Cécile Garcia-Fogel restituent l’esprit incisif de Claire Bretécher avec l’enthousiasme de deux athlètes qui s’échangeraient des balles de tennis pour le pur plaisir du jeu. La dessinatrice épinglait dans ses vignettes les tendances lourdes de ses contemporains. La gauche bobo, les états d’âme féminins sur fond de quotidien opulent, l’obsession sexuelle des hommes pour les nymphettes de moins de 25 ans (si possible cultivées et diplômées), qu’ils appelaient de leurs vœux grâce aux petites annonces, dont le contenu laisse le public incrédule. Autres temps, autres mœurs ? Roland Barthes ne se trompait pas quand il qualifiait Bretécher de « sociologue » de son époque. Comment traduire son dessin, forme et contenu mêlés, sur un plateau de théâtre ? La réponse tient dans la concision et la netteté de la représentation. Pas de mollesse dans le tempo, pas de flou dans les présences. Le coup de crayon était résolu, les gestes et la diction des actrices sont taillés au scalpel. L’intérêt est moins le féminisme ironique de l’autrice que la complicité des deux interprètes. Bel exemple d’une sororité qui est, en soi, la preuve qu’on peut exister sans piétiner sa partenaire. Le manspreading cède la place à une union, dont l’authenticité se vérifie au fil de chansons portées a cappella par Dashwood et Garcia-Fogel. Parmi les mélodies, les paroles de L’Hymne du MLF (« Debout femmes esclaves et brisons nos entraves ») sur l’air du Chant des marais. Rire n’empêche pas de frissonner. Poussez-vous, les mecs !, d’après Les Frustrés et Les Mères, de Claire Bretécher. Mise en scène de Cécile Garcia-Fogel. Avec Cécile Garcia-Fogel et Valérie Dashwood. Le Lucernaire, Paris 6e. Jusqu’au 5 janvier 2025. Joëlle Gayot/ Le Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 17, 2024 5:42 PM
|
Sous le charme de loups, oiseaux et autres cosmonautes, «Libé» livre sa sélection de créations de théâtre ou de cirque conçues pour les enfants et les ados, à voir dans toute la France. Alors qu’on vient d’apprendre que le festival Odyssées du centre dramatique national de Sartrouville (Yvelines), qui depuis vingt-sept ans présentait des spectacles dédiés à la jeunesse, allait définitivement disparaître à cause de coupes budgétaires décidées par le président (LR) du conseil départemental, Pierre Bédier, il est bon de rappeler à quel point la scène consacrée aux enfants et adolescents est riche, inventive, inspirée par l’actualité la plus âpre ou par la rêverie, qu’on se tourne vers le théâtre ou le cirque. Libération a sélectionné 10 spectacles qui se jouent en cette période de fêtes et tournent bien souvent tout au long de l’année. Dans des mises en scènes réalistes, ou pas du tout, hybridées de vidéo ou au contraire totalement artisanales, on fraye avec des cosmonautes perdus dans l’espace, on piste des loups ou on plonge à la rencontre d’enfants migrants à tout jamais restés en Méditerranée. Sous les chapiteaux, on choisit entre la barre russe du luxueux cirque Leroux et la danse gumboot de la compagnie sudafricaine du Zip Zap Circus. Théâtre «Pister les créatures fabuleuses» de Pauline Ringeade Fabuleuses, elles le sont, ces créatures, puisque tout au long du spectacle, elles n’existeront que dans notre imagination. Loups, renards, écrevisses, tous évoqués par la seule comédienne en scène (Eléonore Auzou-Connes ou Blanche Ripoche en alternance), convoqués par ses bruitages – froissement de papiers, crissement des mains sur ce qui pourrait être du sucre glace, mais aussi des enregistrements collectés dans la nature. Tout doucement, la pisteuse nous guide dans la forêt, en montagne. En bonnet et parka, elle mène l’enquête : que faisait ce loup dont on devine les traces près de cette rivière ? Et qui est le nanoulak, cet hybride d’un grizzly et d’une ourse polaire, né de la rencontre des deux espèces provoquées par le réchauffement climatique ? Pauline Ringeade a créé son très poétique paysage sonore après une conférence du philosophe et pisteur de loup Baptiste Morizot. S.F. Dès 7 ans. Au théâtre Silvia-Monfort (75015), jusqu’au 19 décembre, puis en tournée. «Fusées» de Jeanne Candel Quelque chose a dû mal tourner, mais quoi ? Deux cosmonautes sont en roue libre dans la stratosphère : leur contact, tout en bas, sur la Terre, tente de ne pas les alarmer. Non, pour l’instant le retour est impossible. Non, non, on ne sait pas quand on pourra les redescendre. Boris et Kyril s’occupent, se baladent, trouvent de nouveaux coins à étoiles comme on trouve des coins à champignons. Les comédiens jouent l’apesanteur en se déhanchant le cul sur un tabouret comme on le faisait quand on était petits, reliés à leur fusée par des tuyaux d’aspirateur. Ici on bricole la guerre des étoiles, on mime la haute technologie. Fusées de Jeanne Candel est aussi un hommage au théâtre de toute beauté : sur scène, à l’orée de cette histoire de fusée/pétard mouillé, il y a un tout petit théâtre miniature avec cintres et poulies, une boîte noire où quatre comédiens reproduisent le mouvement des astres en pieds nickelés, font naître des tempêtes dans un verre d’eau, et miment les grandes machineries des théâtres du XVIIe siècle, quand les ingénieurs tentaient de reproduire les puissances de la nature qui les dépassaient. Sur la scène infinie de l’espace ou dans le petit cosmos du théâtre, c’est kif-kif : la grande comédie des ambitions humaines. S.F. Dès 6 ans. Du 18 au 21 décembre au Théâtre Garonne à Toulouse (Haute-Garonne), puis en tournée. «Esquif [à fleur d’eau]» d’Anaïs Allais Benbouali Le sujet de cette pièce si forte est un bateau, l’Ocean Viking, le navire ambulance de l’association SOS Méditerranée. Il a sauvé depuis 2016 plus de 40 000 personnes tentant de rallier par la mer les rives européennes. Plus de 25 000 autres sont mortes en risquant le même chemin lors de la dernière décennie, et encore ne parle-t-on que des corps qui ont pu être recensés. Pour aborder cette terrible actualité sans désespérer ni tétaniser les enfants à qui elle la raconte, Anaïs Allais Benbouali opte pour le conte. C’est d’abord Orphéon qui nous parle, et la Mer qui a recueilli en son sein toutes ses vies d’enfants. «Etre enfant, c’est quand on a tout compris, mais qu’on ne le sait pas.» C’est pourquoi Esquif évoque sans fausse pudeur ceux qui sont morts et demandent une chose aux petits spectateurs : continuer de faire vivre leurs prénoms. Hawa, Adama, Yara, Sarah, Yasmine, Nahal, Célestin, Ibrahim… S.F. Dès 8 ans. Jusqu’au 22 décembre au théâtre national de la Colline (75020), puis en tournée. «Le Petit Chaperon rouge» du collectif Das Plateau Créé dans le in d’Avignon 2022, le Petit Chaperon rouge version Das Plateau poursuit sa route à travers bois bien sûr, mais pas que, le spectacle étant même annoncé au printemps prochain à l’Alliance française de New York. Revendiquée «puissante, positive et féministe», la relecture de l’illustrissime conte «plus subversif qu’on ne le pense avec son droit au mystère, au plaisir à la liberté et la peur» joue ici la carte de l’immersion, avec ses deux comédiens entraînant le public dans un assemblage savant de projections d’images, de miroirs et de silhouettes étranges propices aux interprétations les plus réalistes comme les plus fantasmagoriques, sur fond de trombone, orgue et harpe. Plus de deux cents ans après une première publication du récit des frères Grimm, la transposition théâtrale du collectif parisien semble aussi en voie de devenir un classique, à l’instar des Pommerat stimulant pareillement l’imaginaire enfantin. G.R. Dès 5 ans. En tournée à partir du 24 janvier (Cusset, Saint-Quentin, Créteil…) «Je suis trop vert» de David Lescot Sur le plateau tout noir, un gros bloc de bois clair, et c’est tout. Autant dire que pour attirer le jeune chaland, David Lescot ne donne pas dans la surenchère. Mais très vite, s’élèvent du module bavardages, rires, le bruit tout entier et bien vivant d’une classe de collège. Parmi elle, le protagoniste de cette histoire commencée il y a quelques années avec J’ai trop peur et J’ai trop d’amis. La 6e D a de la chance : elle devrait partir en classe verte. Il va falloir s’adapter à ce nouveau lieu plein de bêtes, d’odeurs et aussi de labeur : la campagne. C’est peu dire qu’il est difficile d’écrire pour le jeune public. David Lescot trouve un ton juste, en parvenant à situer le point de vue de son héros, au niveau très juste d’une compréhension encore enfantine du monde, lacunaire donc, angoissée parfois, mais jamais simple. La pédagogie n’est pas son affaire et il aborde la question écologique sans l’asséner, comme une matière scénique avant tout. L.C. Dès 8 ans. Au théâtre Nouvelle Génération – centre dramatique national de Lyon (Rhône) jusqu’au 18 décembre, puis au Théâtre de l’Olivier à Istres (Bouches-du-Rhône) du 13 au 15 janvier, avant une tournée. «Oiseau» d’Anna Nozière Un spectacle jeunesse qui parle de la mort, des morts et de la manière dont la plupart d’entre nous les ignorent. Mustapha, dont le père vient de mourir, rencontre Pamela, elle aussi marquée par le deuil (celui de Calamar, son chien) et la «petite Françou» qui connaît des êtres qui peuvent emmener les vivants «de l’autre côté». C’est le début d’une grande confrérie à l’école – «Si tu aimes tes morts, viens avec nous.» Les enfants se mettent à organiser une fête dans le cimetière et partent, la nuit, depuis leur lit, retrouver leurs défunts. Sous le regard sévère et interdit de la directrice, pour qui la mort n’est tout de même pas un jeu d’enfants. Anna Nozière joue de tous les codes du théâtre et de la vidéo, notamment, qui fait surgir de belles images d’enfants au cœur du spectacle. S.F. Dès 9 ans. A la scène Transversales de Verdun (Meuse) du 23 au 25 janvier, au CDN Le Quai d’Angers (Maine-et-Loire) le 30 janvier, et en tournée. Cirque «Strano» de Trottola Apologiste d’un cirque «à l’ancienne» jamais avare pour autant en surprises, Trottola jouit d’une estime aussi durable que justifiée auprès de ses pairs, comme du public qui continue d’affluer. Il faut dire qu’avec seulement cinq spectacles en un quart de siècle, la compagnie centrée sur Bonaventure Gacon – gaillard hirsute à la voix de stentor – et Titoune Krall – poids plume qui, la cinquantaine entamée, continue de voltiger dans les airs – sait se faire désirer. «On a envie que ce soit simple, évident, exigeant, retors, que ça surprenne, que ça grince […], que ça touche, que ça inquiète, que ça raconte», professe le tandem (ici soutenu par un circassien et un organiste) qui, de fait, honore son cahier des charges à l’heure de Strano, le cru 2024. Une pièce qui, mêlant clowns, acrobates et trapézistes, compte son lot de prouesses artisanales, à l’exemple du magnifique final construit autour d’une grande échelle posée sur un axe rotatif dont le mouvement circulaire corrobore la grâce burlesque de l’escouade en équilibre. G.R. Dès 8 ans. Au CentQuatre (75019) jusqu’au 22 décembre, puis en tournée (Lorient, Quimper, Châlons-en-Champagne, Lille…) «Machine de cirque» de la compagnie éponyme La compagnie Machine de cirque porte bien son nom qui, en dix ans d’activité, est devenue une référence internationale, à l’exemple d’une première pièce, validée par «plus de 1 000 représentations devant plus de 460 000 spectateurs», qui poursuit son exploitation à Paris. Une carte de visite en somme qui présente la particularité d’être exclusivement masculine avec six interprètes, cinq acrobates et un musicien omniprésent, colportant une bonne humeur assez résolument québécoise. Malgré quelques baisses de régime (cf une séquence «humoristique» longuette et sans intérêt avec une personne du public), Machine de cirque – qui est donc aussi le titre du spectacle – finit par emporter l’adhésion, grâce aux envolées sur la planche coréenne qui fait toujours son effet. A signaler également l’originalité d’un numéro vraiment cocasse celui-là, lorsque les garçons, à poil, doivent «jongler» avec une petite serviette de bain pour tenter de préserver leur intimité. G.R. Dès 8 ans, A la Scala (75010) jusqu’au 5 janvier. «Moya» de Zip Zap Circus Chômage très élevé, insécurité endémique, économie au bord du gouffre… Plus de trente ans après l’abolition de l’apartheid, l’Afrique du Sud reste un pays fragile. C’est aussi le plus inégalitaire au monde, avec 90 % des richesses détenues par 1 % de la population et les trois quarts des personnes noires qui demeurent sous le seuil de pauvreté. Ce préambule est modérément festif, on en convient, pour situer la vocation non seulement artistique, bien sûr, mais aussi sociale, de Zip Zap Circus (formation gratuite, appui financier de fondations, d’entreprises…). La compagnie née au Cap en 1992 actionne un «levier d’épanouissement et d’émancipation» pour dix jeunes interprètes – dont certains passés par le spectacle Rhapsodie, du Cirque Phénix, en 2022 – qui, aux agrès rituels (sangles aériennes, roue Cyr, trapèze…) associent des éléments chorégraphiques (de la danse gumboot comprise) et musicaux d’inspiration locale. L’ensemble composant un show à la fois enjoué, imaginatif et fédérateur. G.R. Dès 5 ans. A l’espace chapiteaux du parc de la Villette (75019) jusqu’au 29 décembre. «Entre chiens et louves» du Cirque Le Roux Il faut casser sa tirelire (entre 50 et 75 euros) pour voir la troisième création du Cirque Le Roux, à nouveau nuitamment implantée – après un premier séjour, fin 2023 – en plein cœur du Bon Marché, temple bourgeois de la consommation à Paris. Après deux spectacles plus (The Elephant in the Room) ou moins (la Nuit du cerf) réussis, le troisième, Entre chiens et louves, persiste à exploiter une trame théâtrale fondée sur trois époques (1870, 1960, 2022) si confuse et vaine, il faut bien l’avouer, qu’on ne capte absolument rien. Côté numéros en revanche, l’affaire prend une tout autre tournure, qui, sur fond de Beethoven ou Schubert, confirme le niveau des huit interprètes excellant dans les portés acrobatiques. Un florilège qui réserve quelques surprises, telle cette contorsionniste escaladant la grande paroi verticale en fond de scène, d’où sortent les mains et les pieds de partenaires sur lesquels elle prend appui. Ou l’usage pas si fréquent de la barre russe, grosse poutre flexible soutenue par deux porteurs, depuis laquelle une voltigeuse s’élève dans les airs. G.R. Dès 8 ans. Au Bon Marché Rive Gauche, (75007) jusqu’au 31 décembre. Légende photo : «Fusées» déploie sur scène un tout petit théâtre miniature avec cintres et poulies. (Jean-Louis Fernandez)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 17, 2024 5:30 AM
|
Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - publié le 17 déc. 2024
Le dispositif destiné aux jeunes de 18 ans coûte très cher et ne répond pas aux objectifs fixés de démocratisation des pratiques culturelles, estime un rapport publié mardi 17 décembre. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/12/17/la-cour-des-comptes-dresse-un-bilan-tres-severe-du-pass-culture_6453158_3246.html
Tout, ou presque, semble à revoir dans le dispositif du Pass culture. Un rapport, publié mardi 17 décembre par la Cour des comptes, dresse un « premier bilan » pour le moins sévère des effets de cette application géolocalisée. Depuis 2021, elle permet à tous les jeunes de 18 ans de bénéficier d’un crédit de 300 euros pour accéder à des activités ou à des biens culturels de leur choix et même, apprend-on, à des escape games… Qu’il s’agisse de son coût, de son fonctionnement ou de sa portée, pas grand-chose ne va depuis le lancement de cette nouvelle politique culturelle voulue par Emmanuel Macron, dit en substance la Cour. Selon elle, le passe ne répond pas aux objectifs fixés de démocratisation et de diversification des pratiques culturelles, dispose de crédits budgétaires « non maîtrisés » et doit revoir son modèle de gouvernance pour devenir un opérateur de l’Etat. Avec un budget annuel de 244 millions en 2024, la SAS Pass culture (société par actions simplifiées d’intérêt général) occupe désormais « la deuxième place parmi les structures financées par le ministère de la culture après la Bibliothèque nationale de France », note la Cour. A lire son « enquête », centrée sur la part individuelle du passe, il paraît clair que, si une réforme en profondeur n’est pas engagée, c’est l’existence même du dispositif qui pourrait être remise en cause dans un contexte de finances publiques fortement dégradées. « Tout statu quo concernant le Pass culture apparaît comme non tenable », prévient la Cour des comptes. Passage en revue des constats dressés par cette juridiction et de ses recommandations. Un impact « limité » Ce que soulignait l’inspection générale des affaires culturelles, en juillet, est confirmé par la Cour des comptes. Si, globalement, 84 % des jeunes âgés de 18 ans ont activé leur passe, ce chiffre tombe à 68 % parmi ceux issus des classes populaires. « La capacité d’un dispositif, avant tout financier, à aider les publics les plus éloignés de la culture à surmonter les inégalités préexistantes est à relativiser. Le principal impact du Pass culture se traduit plutôt par une intensification des pratiques culturelles déjà bien établies, ce qui contribue à confirmer le risque d’effet d’aubaine de son utilisation par des jeunes disposant déjà, notamment par leur environnement familial, d’un capital culturel plus élevé », constate la Cour. Le profil type du jeune n’ayant pas recours au passe est un homme, ayant arrêté ses études ou issu de classe populaire. Quant à la diversification des pratiques, elle n’est pas au rendez-vous. Consommant en moyenne 257 euros sur l’enveloppe qui leur est allouée, les bénéficiaires du passe l’utilisent majoritairement pour les livres (67 % des réservations en volume et 46 % en montant). Ainsi, parmi les quelque 36 000 offreurs culturels, le premier, du point de vue du montant, est la Fnac, avec un chiffre d’affaires cumulé de 105 millions d’euros grâce au Pass culture. Quant aux mangas – dont le passe fit exploser les ventes lors de son lancement –, ils ne représentent désormais que 20 % des montants consommés pour les livres (contre 40 % fin 2021). Suivent le cinéma (17 % des réservations en volume et 21 % en montant) et la musique (8,6 % des réservations en volume et 23 % en montant). Alors que le spectacle vivant représente moins de 1 % des réservations, la Cour des comptes constate le faible nombre de places proposées par les principaux établissements nationaux de ce secteur (914 à l’Opéra de Paris, 279 au Théâtre national de Strasbourg, 124 à l’Opéra-Comique en 2023, par exemple). « Si le ministère a demandé, en mai, d’augmenter l’inscription d’offres des théâtres nationaux sur le Pass culture, il leur est en même temps réclamé d’accroître leurs ressources propres. Un équilibre entre ces deux exigences est à trouver », relève la Cour. De plus, « l’absence de billetterie centralisée dans ce secteur ajoute une difficulté supplémentaire ». Faute de médiation, « le Pass est, à ce jour, avant tout un outil d’amplification des pratiques culturelles les plus populaires » et « peine à se distinguer d’un chèque culture », constate-t-elle. En moyenne depuis 2021, 88,6 % des réservations s’effectuent à partir du moteur de recherche, ce qui signifie que les jeunes savent déjà ce qu’ils cherchent. Seules 6,3 % des réservations sont effectuées grâce à la consultation de la page d’accueil, espace dans lequel se concentre la capacité de médiation du dispositif. « Le Pass culture s’apparente davantage à un simple portail de réservation plutôt qu’à un véritable espace de découverte. » Quant aux quelque 283 offres « spéciales ou exclusives » établies avec quelques partenaires culturels pour favoriser la médiation – et pour lesquelles les équipes du passe multiplient les communiqués de presse –, elles ne touchent qu’un nombre très limité d’utilisateurs : 4 560 jeunes en 2023. Un coût « non maîtrisé » La Cour constate que le coût de la part individuelle du Pass culture est « systématiquement supérieur aux dotations initiales ». Ainsi, l’enveloppe prévue dans les lois de finances initiales n’est jamais respectée : 209 millions d’euros budgétés en 2023 pour 240 millions exécutés ; 210 millions budgétés en 2024 pour 244 millions exécutés. « Des arbitrages doivent être pris pour mettre un terme à la croissance non maîtrisée des crédits budgétaires du Pass culture », recommande la Cour qui cite trois pistes d’économies : la réduction du montant du crédit alloué aux jeunes âgés de 18 ans ; la mise sous condition de ressources (une mesure évoquée en octobre par la ministre de la culture Rachida Dati) ; le ciblage des bénéficiaires selon des critères sociaux (boursiers) ou territoriaux (quartiers de la politique de la ville, milieu rural). « Un recalibrage du dispositif est non seulement possible mais souhaitable eu égard aux résultats contrastés de cette politique », insiste la juridiction. L’enquête menée par la Cour des comptes a aussi permis de lever un lièvre. Ainsi, elle a découvert que 16 millions ont été « indûment dépensés » pour financer des activités d’escape games « alors qu’elles n’auraient jamais dû être considérées comme pouvant entrer dans le périmètre des offres éligibles sur l’application ». Depuis cette découverte, le ministère de la culture a demandé le déréférencement de 500 offreurs. Un fonctionnement « à réformer » « La gouvernance du Pass culture est à revoir en profondeur », considère la Cour. Financée à plus de 90 % sur des fonds publics et dotée d’un effectif de 176 équivalents temps plein, la SAS Pass culture doit être « transformée en opérateur de l’Etat dès 2025 », demande-t-elle, afin, notamment, « qu’un plafond d’emplois lui soit appliqué et qu’un contrôle plus étroit du ministère comme du Parlement puisse être réalisé ». Bref, il faut en finir avec, pourrait-on dire, l’« open bar ». « La pleine réappropriation du Pass culture par le ministère permettrait, au minimum, de résoudre la mise à disposition inachevée des données de la société Pass culture au ministère et la bonne articulation entre les équipes territoriales du Pass culture et celles déployées au sein des directions régionales des affaires culturelles », expliquent sans détour les magistrats. Sandrine Blanchard / LE MONDE Légende photo : Les bénéficiaires du Pass culture l’utilisent majoritairement pour les livres (67 % des réservations en volume et 46 % en montant). Ici, dans une librairie à Aurillac, en juillet 2021. JÉRÉMIE FULLERINGER/PHOTOPQR/LA MONTAGNE/ MAXPPP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 15, 2024 2:11 PM
|
Par Christophe Bourdoiseau, correspondant à Berlin pour Libération - 16 déc. 2024 La ville-région s’apprête à voter, jeudi 19 décembre, des économies de 130 millions d’euros dans la culture. Des coupes sans précédent depuis la réunification allemande. Sous le choc, les artistes indépendants pensent à l’exode et une manifestation a eu lieu ce dimanche. «C’est la merde, la merde, la merde…» répète en cadence une voix amplifiée sur «l’île aux Musées», dans le cœur historique de Berlin, pour protester contre les économies de 3 milliards d’euros, dont 130 millions pour la culture. Les concernés sont venus manifester, ce dimanche 15 décembre, leur opposition à ces coupes budgétaires historiques qui risquent de ruiner la réputation de la capitale : sa vie culturelle. Tout le monde y passe, des petits cinémas aux grandes institutions. Les grands orchestres comme la philharmonie ou le Konzerthaus, mais aussi les grands théâtres, devront se serrer la ceinture en 2025, comme le Berliner Ensemble (1,75 million de moins), le Deutsches Theater (3 millions), la Volksbühne (2 millions) ou encore le Maxim-Gorki (1 million). Les établissements privés sont aussi concernés, comme la compagnie de danse de Sasha Waltz, qui va perdre 200 000 euros, ou le music-hall Friedrichstadt-Palast, une attraction touristique, qui devra renoncer à 1,6 million. Le plan prévoit la suppression de plusieurs centaines d’ateliers subventionnés. «La fuite des artistes risquent de s’accélérer avec des loyers qui deviennent impayables», constate Sylvie Boisseau, artiste vidéaste française établie à Berlin. Frank, membre d’un chœur indépendant, y voit aussi une tentative de la part du maire conservateur, Kai Wegner, de réduire l’influence de la gauche dans la culture. «On constate un glissement vers l’extrême droite dans toute l’Europe, chez nous aussi, avec des attaques contre les milieux socioculturels», constate-t-il. «Les conservateurs veulent-ils détruire, comme en Italie, la cohésion sociale du pays ?» s’interroge Iris Laufenberg, directrice du Deutsches Theater. Kai Wegner a provoqué un tollé en prétendant que les pauvres finançaient à Berlin la culture pour les plus riches. «Faut-il qu’une vendeuse du supermarché, qui va probablement rarement au Staatsoper [le plus prestigieux des opéras de Berlin], subventionne des tarifs aussi bas avec ses impôts ?» a-t-il déclaré. Le maire ne comprend pas pourquoi Berlin propose encore des billets à moins de 50 euros (plein tarif). «Pour qu’une vendeuse aille à l’opéra», répond Sabine Kroner, une des représentantes de la scène indépendante. «Pauvres mais sexy» Kai Wegner préfère défendre la voiture plutôt que la culture avec le maintien des prix bas des parcmètres ou le prolongement de l’autoroute urbaine A100, la plus chère d’Allemagne (1,8 milliard d’euros), qui doit raser le dernier quartier alternatif de la capitale avec des dizaines de clubs techno et d’institutions indépendantes. «Leur vision de l’avenir, c’est plus de police et moins de culture», déplore Annemie Vanackere, directrice du Hebbel-Theater. La culture, c’est pourtant l’étendard de la ville. «A part la culture, Berlin n’a rien à offrir !» commente un manifestant. Trois quarts des touristes (dont plus de la moitié sont des Allemands) déclarent visiter la capitale pour ses spectacles et ses musées. «Berlin est une ville attractive grâce à sa culture. Nous avons proclamé fièrement que nous étions pauvres mais sexy [slogan de l’ancien maire Wowereit dans les années 2000]. Mais Berlin ne sera bientôt plus sexy, estime Marcel Weber, le président de l’association des clubs de nuit à Berlin (Clubcommission). On a programmé la disparition de la scène indépendante.» Christophe Bourdoiseau / Libération Légende photo : Manifestation à Berlin, ce dimanche. (Fabian Sommer/Picture alliance. DPA)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 14, 2024 4:47 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 11 déc. 2024 A travers « On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie », l’ acteur et auteur Éric Feldman raconte, non sans humour, son trauma, ses névroses, lui dont la famille proche échappa miraculeusement aux camps de la mort. On en sort secoué. Et d’abord de rire.
Feldman est assis lorsque les spectateurs prennent place dans la petite salle Roland Topor du Théâtre du Rond Point. Le spectacle a été créé au Théâtre National de Strasbourg et il est arrivé à Paris rôdé, affiné. Le fauteuil en bois où l’acteur-auteur a pris place n’est pas accompagné d’un divan de psy auquel le patient allongé va raconter sa vie. Feldman, qui ne voit plus de psy depuis trois ans, brouille les pistes : l’analysé parle assis de ses névroses devant le divan du public venu nombreux. Le titre du spectacle, On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie », mi blagueur, mi terrifiant, sera dit à l’oreille d’un péquin dans un jardin public. Le mot Shoah, lui, restera au fond de la gorge, cependant la saga familiale des Feldman, socle du spectacle, en déploiera bien des aspects traumatiques. Parents, oncles et tantes proches ont miraculeusement échappé aux rafles, aux camps et aux fours crématoires contrairement à des millions de Juifs. Ce qui , par ricochets, amène Feldman à bien prononcer le mot Auschwitz, un mot si mal prononcé par beaucoup de français s’amuse t-il. Jouxtant le fauteuil, un petite table avec quelques livres et des carnets où puiser quelques citations dont l’une de l-écrivain Isaac Bashevis Singer mais comment dit-on ce « Singer » -là? Pas comme la machine à coudre ni comme le verbe singer. Tout le fil du propos va se nouer autour d’une anecdote ; après avoir fait l’amour avec une femme Eric Feldman n’a qu’un mot sur les lèvres : Hitler. Ce qui le laisse peut-être songeur mais surtout explorateur de son identité. Ce nom et tout ce qu’il recouvre va implicitement faire la paire avec un autre nom, omniprésent par ricochets, celui de Freud. Entre ces deux pôles, quelques dérives autour de son chat Milosh ou, inattendue et surprenante, l’histoire des origines du Club méditerranée via le récit de l’un de ses oncles. On passe allègrement de la famille d’Hitler à celle de Feldman et d’Éric à Sigmund C’est plein de méandres comme il se doit dès lors que l’on dissèque à vue une névrose ont le théâtre, cet ouvrier émérite, dessine le profil et les contours, disons la mimesis d’une pseudo thérapie volontiers burlesque. Bref, c’est d’autant que drôle que le trauma est là, sous-jacent avec ses séquelles toujours à l’affût. Comme dans un cabinet de psy, les associations libres fusent et le public en prend note ; il sourit et ça et là, rit. Feldman a l’art de parler légèrement de choses qui pèsent lourdement sur son identité et celle des siens. Résumant en une formule l’art et la manière constituant le spectacle On ne jouait pas à la pétanque dans le ghetto de Varsovie, Olivier Veillon -qui en signe la mise en scène- parle de « stand up assis ». C'est joliment dit mais un peu réducteur. Veillon dirige parfaitement l’acteur qui était remarquable et fut remarqué dans le spectacle Ça ira, Fin de Louis dont l’auteur et metteur en scène, Joël Pommerat, est qualifié dans le générique du spectacle de « soutien amical à la dramaturgie et à la mise en scène ». Créé au TNS, le spectacle est à l’affiche du Théâtre du Rond-Point, du mar au sam 20h, sam 19h, dim 16h., jusqu’au 22 déc. Puis le 31 janv au Théâtre des Bains douches au Havre et le 4 fév au théâtre de Troyes.
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 5, 3:06 PM
|
Par Anne Diatkine dans Libération - 5 janvier 2025 Réunis au théâtre parisien des Bouffes du Nord pour «le Rendez-vous», leur adaptation du sulfureux roman de Katharina Volckmer «The Jewish Cock», les deux artistes explorent hardiment les thèmes de l’héritage, de l’identité et du poids de l’histoire. Une scénographie qui palpite, un ample tissu violet plissé qui emballe entièrement la scène. Et une jambe bien vivante qui surgit de cet antre organique, isolée du reste du corps. Elle remue, se replie, bat. Cette voix, cette jambe dissociée de tout, puis ce corps en entier, juvénile, vêtu de rouge, en short et bombers, mais oui, c’est bien Camille Cottin, actrice populaire s’il en est, plus rare au théâtre, et qui tout en tournant assidûment au cinéma jusqu’aux Etats-Unis, revient sur les planches avec une autrice et un metteur en scène qu’elle a choisis, à savoir l’autrice allemande Katharina Volckmer et l’artiste metteur en scène archi repéré et plutôt pointu Jonathan Capdevielle. Dans son premier roman, The Jewish Cock, écrit directement en anglais, et dont le titre est resté en VO comme pour masquer sa crudité ou son scandale, Katharina Volckmer, née en 1987, restitue la voix d’une femme d’à peu près son âge, lors d’une consultation avec un médecin qui ne l’interrompt quasiment jamais, qui ne l’écoute peut-être pas, et à qui elle demande de lui greffer une «jewish cock». Peu à peu, ce flux de paroles qui semble passer du «cock» à l’âne et être axé sur un changement de sexe interroge l’histoire de l’Allemagne et le poids du nazisme sur celles et ceux qui sont aujourd’hui les petits enfants du IIIe Reich. La culpabilité se dilue-t-elle avec les générations ? Suffit-il de passer dans un autre corps, dans une autre langue pour pouvoir regarder avec une distance nouvelle les responsabilités de tout un peuple vis-à-vis de la Shoah ? Dans quelle mesure peut-on s’affranchir d’un passé qu’on n’a pas vécu mais qui fait partie de soi ? Qu’est-ce qui a présidé au choix de The Jewish Cock de Katharina Volckmer ? Camille Cottin : Je cherchais un roman à adapter au cinéma, de préférence avant même qu’il ne soit traduit en français. J’ai fait appel à une agence qui met en relation des maisons d’édition et des boîtes de production en vue d’une adaptation. Et le premier roman qu’on m’a proposé était The Jewish Cock de Katharina Volckmer. Je l’ai adoré. On m’en a proposé d’autres, mais je revenais toujours au texte de Katharina Volckmer, qui a pourtant une forme évidemment théâtrale peu transposable au cinéma. Le texte est si fort qu’il aurait été possible de se poser avec juste un micro et de l’asséner, façon stand up. Mais avant même de savoir à quel metteur en scène m’adresser, j’étais certaine de vouloir que ça engage mon corps, qu’il y ait une scénographie. J’avoue, je ne connaissais pas le travail de Jonathan Capdevielle. Je suis allée voir [les pièces] Rémi, Saga, et j’ai été happée par cet onirisme punk, ce jeu avec le fantastique et le sombre, la question des héritages, mais aussi son humour. Comment l’approcher ? C’était devenu une obsession. Je me disais : si Jonathan ne veut pas en être, j’abandonnerai le projet. Jonathan Capdevielle : Camille et moi étions dans deux endroits différents. Artistiquement, géographiquement, et évidemment, en termes de notoriété ! J’étais au Mexique quand j’ai reçu ce coup de fil : «Camille Cottin, vous connaissez ? Elle a pensé à vous pour mettre en scène un texte de Katharina Volckmer.» J’ai lu le récit dans la foulée. Et à travers les thèmes de l’identité et des héritages qui traversent le livre, un lien se faisait. C’est la première fois que je travaillais avec une comédienne que je ne connaissais pas, qui plus est une «star». C.C. : C’est la première fois que j’initie un projet. Même au cinéma, je ne l’ai jamais fait. Pas encore… J.C. : On a très vite décidé qu’on allait adapter ensemble le roman. On s’est autorisés à remanier un peu la traduction, à parfois modifier l’ordre de certains paragraphes. C.C. : On partage le même totem. Ça aurait été complètement différent si on avait fait appel à un adaptateur. C’était important qu’il s’agisse d’un texte féministe ? C.C. : Evidemment. Les premières représentations ont eu lieu à Aix-en-Provence [de la fin septembre à début octobre, ndlr], en plein procès Pelicot [au tribunal judiciaire d’Avignon, portant sur les viols infligés à Gisèle Pelicot par Dominique Pelicot et 50 coaccusés, tous condamnés et dont dix-sept ont fait appel], et le texte résonnait puissamment. Notamment, tout le passage sur le «vagin qui sera toujours un objet de baise». Ou encore sur les deux manières de s’asseoir selon qu’on est un homme ou une femme. On peut dire que c’est cru et dur. Mais Katharina Volckmer n’est jamais dans la posture. Ce dont elle parle nous traverse encore. Le texte évoque également les résonnances souterraines de la Shoah sur sa génération. C.C. : Ce que Katharina Volckmer hurle en tant qu’Allemande née en 1987, c’est : «Pardon ! On est donc censés se construire après Auschwitz ? Vous pensez vraiment que trois générations plus tard, on peut accepter d’en être issu ? Regardez donc tout ce qu’on fait pour être pardonné, mais qui n’efface ni ne pardonne.» Ce poids est l’un des axes auquel on tenait beaucoup, Jonathan et moi. La narratrice paye ce pénis avec une somme provenant de son arrière-grand-père, chef de gare de la dernière station avant Auschwitz. Camille, quel élan a suscité votre retour au théâtre ? C.C. : Je rêvais de partage avec les spectateurs. Au cinéma, il y a un délai très long entre le tournage et la diffusion. J’avais la nostalgie de ce moment collectif de la scène, ici et maintenant, jamais identique à la veille ni au lendemain. Cette énergie-là, cet échange, me manquait. Au cinéma, le corps est morcelé. On joue avec un geste de la main, une expression saisie en gros plan. Sur un tournage, je continue d’apprendre à comment procéder pour que ma pensée soit toujours en mouvement tandis que tous les muscles du visage sont détendus. On obéit à des marques. C’est très bien, j’adore cet exercice, mais je voulais revivre une expérience où on joue avec son corps entier. Au théâtre, je suis heureuse d’avoir un corps en liberté, même quand les mouvements sont hyperprécis, en particulier dans ce spectacle, où je dois dissocier les gestes des mots que je prononce. Mais j’en suis maître… Du désir à la réalité : sauter le pas a été facile ? C.C. : Non ! En particulier en raison de la disponibilité extrême qu’exige la scène. Au cinéma, on peut demander de décaler des dates ou des scènes. Au théâtre, une fois que la décision est prise, on doit jouer, l’engagement est irréversible. Ça demande d’être au clair avec son désir que le projet existe. Autre obstacle : je n’avais jamais été seule sur un plateau. Du coup, j’ai quand même essayé de faire demi-tour une ou deux fois. Ça n’a jamais duré longtemps, il y a toujours eu quelqu’un pour me rattraper. J.C. : Le mariage est d’autant plus risqué qu’on réserve des théâtres sur une note d’intention quand rien n’existe encore, qu’on n’a pas commencé à répéter. L’engagement a lieu avant d’avoir une idée précise de la forme du spectacle… On se projette. Ce saut en partie dans l’inconnu est évidemment moins impérieux lorsqu’il s’agit d’une forme de théâtre plus formatée, qui reproduit des modèles existants. Sauf exception, ce sont d’ailleurs plutôt les scènes privées qui font appel à des têtes d’affiche. Jonathan, quand vous disiez que vous n’étiez au même endroit, Camille et vous, vous pensiez à quoi ? J.C. : Bien qu’elle ait débuté au théâtre, Camille fait partie de la famille du cinéma et cette famille va jusqu’à Ridley Scott ! Moi, j’évolue dans un théâtre minoritaire, de recherche et subventionné, fortement mis en mal par les coupes budgétaires. Et qui n’existe que grâce à une politique culturelle forte que les élus sont censés et doivent soutenir. Notre alliance rend plus poreuse la frontière de moins en moins étanche entre le public et le privé. A la fois par son financement mais aussi parce qu’on tourne dans le réseau des scènes subventionnées mais aussi privées. Si bien qu’on va rencontrer des publics qui sans doute n’auraient jamais eu l’idée d’aller voir mon travail. A quoi pense-t-on sur scène ? C.C. : Uniquement à ce que je suis en train de faire ! Un seul en scène, c’est un ring. Tu n’as pas l’espace pour être parano, pour penser au spectateur qui tousse ou regarde son portable, car tu es tellement en charge… Pourtant je suis sensible à l’énergie que me renvoie la salle. Tout en sachant que je ne peux pas trop m’y fier non plus. D’un soir à l’autre, les spectateurs ne rient pas au même endroit. Jonathan est en régie où il fait la voix du médecin en direct. On peut imaginer que ce médecin est aussi celui qui manipule le rideau, gonfle les tissus, le rend organique… On n’a pas le sentiment que vous êtes vraiment seule. C.C. : Effectivement, j’ai l’impression de respirer avec le décor. Je ne m’y attendais pas, mais mon corps devient ma marionnette. Il est mon partenaire. Pourtant, j’ai déjà incarné sur scènes des rôles exigeants physiquement. Quand je faisais, il y a quinze ans, Helen Keller dans Miracle à Alabama [de William Gibson, mis en scène par Bénédicte Budan, ndlr], j’étais sourde, muette, aveugle, c’était gratiné. Mais là, je travaille avec mon corps en dissociation. Je parle et j’agis en séparant les deux. «J’ai toujours su que j’étais un chat qui aboie», dit l’héroïne. Vous aussi ? C.C. : Etre un chat qui miaule, c’est obéir à une norme. Etre un chat qui aboie, c’est refuser de correspondre aux attentes ou avoir l’impression de ne pas être à sa place quand on y est. Je ne sais pas si j’en suis un, mais j’aime bien sortir du cadre. Mais Katharina va plus loin. Selon elle dans nos sociétés normées «aucun chat qui aboie n’a jamais conquis le ciel». J.C. : Je comprends l’affirmation de Katharina sur le travestissement, que j’ai exploré très jeune. Encore aujourd’hui, il n’est pas évident de faire partie de «ces chats qui aboient». Enfant, avant la puberté, on m’a piqué aux hormones parce que je ressemblais trop à une fille. Dans les années 80, il arrivait que des médecins généralistes décrètent : «Tels caractères secondaires pas suffisamment affirmés, piquouse ! Voix trop aiguë, pas suffisamment de poils : on booste le corps.» Et à côté de cela, qu’est-ce que ça crée ? Un dérèglement hormonal. Mon corps était un feu d’artifice, je ne comprenais rien. C’est comme si on te forçait d’un coup à devenir quelqu’un d’autre. Aujourd’hui, est-ce qu’on contraindrait ainsi le corps d’un enfant ? Je ne le pense pas. Selon vous, dans la pièce, la transition de la narratrice a-t-elle déjà eu lieu ou est-elle en cours ? J.C. : Cette question m’a taraudée jusqu’à ce qu’il m’apparaisse certain qu’il s’agit d’un examen et que la chirurgie se fera après. Il est clair qu’aujourd’hui on ne peut pas représenter des personnages trans sans se poser la question de qui les incarne et des enjeux de cette incarnation. Vous avez commencé à imaginer ce spectacle il y a quatre ans, quand l’Europe n’était pas en guerre, avant l’élection de Trump. Le monde a énormément changé… C.C. : L’année dernière, il y a eu un temps où j’ai eu peur effectivement de ne pas réussir à porter le projet, de ne plus parvenir à avancer. L’actualité était paralysante. Me frappe aujourd’hui à l’inverse la dimension terriblement contemporaine qu’il prend. Rien n’est obsolète dans le texte de Katharina, tout fait écho. Ses derniers mots: «Quittons cet endroit avant qu’il ne soit envahi par les clowns. Tenons nous la main, soyons des guerriers» Le Rendez-vous, adaptation de Jewish Cock de Katharina Volckmer par Camille Cottin et Jonathan Capdevielle, mis en scène par Jonathan Capdevielle, aux Bouffes du Nord (75 010) du 7 au 25 janvier. Propos recueillis par Anne Diatkine / Libération Légende photo : Camille Cottin et Jonathan Capdevielle au théâtre des Bouffes du Nord à Paris, le 3 janvier 2025 (Christophe Maout/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 5, 2:50 PM
|
Critique de Chantal Boiron pour le site de Ubu - scènes d'Europe le 4 janvier 2025 Le Soulier de satin : sous le signe de la joie PAR CHANTAL BOIRON Pour sa dernière création en tant qu’administrateur de la Comédie-Française, Éric Ruf (qui quittera ses fonctions fin juillet 2025) met en scène Le Soulier de satin de Paul Claudel. Quatre-vingt ans après sa création dans la Maison de Molière par Jean-Louis Barrault en 1943, sous l’occupation allemande, c’est faire acte de transmission. Une volonté de transmission que l’on peut également retrouver dans le choix de la distribution puisque Marina Hands est Doña Prouhèze, le personnage qui était interprété par sa mère Ludmilla Mickael dans la mise en scène d’Antoine Vitez au Festival d’Avignon et au Théâtre national de Chaillot en. 1987. Didier Sandre, que l’on retrouve ici dans le rôle de Don Pelage jouait alors Don Rodrigue. C’est Baptiste Chabauty qui reprend le flambeau. Ainsi y a-t-il une transmission entre deux générations d’acteurs à l’intérieur même de la troupe. Ce spectacle est d’ailleurs un magnifique hommage d’Éric Ruf à la troupe de la Comédie-Française parmi laquelle il aura passé tant d’années. Et, il fallait ces interprètes-là (plusieurs d’entre eux jouent plusieurs personnages) pour nous faire entendre la puissance poétique de la langue de Claudel, pour porter sur scène durant huit heures trente cette œuvre épique et mystérieuse, monumentale et complexe qui, par l’incroyable liberté dont fait preuve l’écrivain, reste encore aujourd’hui une énigme dans le paysage théâtral. Après Jean-Louis Barrault et Antoine Vitez, c’était une gageure qu’Éric Ruf relève avec brio. L’amour qui unit Don Rodrigue, jeune conquistador épris de gloire, et Doña Prouhèze, épouse du vieux Don Pélage, ne pourra pas s’accomplir ici-bas car tous deux sont déchirés entre le désir qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et leur exigence d’absolu, entre leur sensualité et l’appel impérieux d’une transcendance spirituelle. Rodrigue et Prouhèze sont condamnés à la séparation. Cet amour fou, cet amour total est comme une quête chimérique qui les entraîne à travers l’univers, dans des aventures aussi prodigieuses que mystiques. Éric Ruf, qui signe également la version scénique et la scénographie, place Le Soulier de satin sous le signe de « la joie », mot qui revient fréquemment sous la plume de Claudel : « Ah ! c’était le même saisissement au cœur une seconde, la même joie immense et folle » dit Rodrigue à propos de Prouhèze. « Saisissement », « joie » : on n’est pas très loin des mots de Pascal : « Certitude, joie ». Pour Rodrigue, Prouhèze est « l’étoile » qui le guide. Et ni l’absence, ni l’éloignement ne pourront éteindre cette joie : « Moi, moi, Rodrigue, je suis ta joie. Moi, moi, moi, Rodrigue, je suis ta joie ! » lui dira Prouhèze lors de leur dernière rencontre. Quand on pénètre salle Richelieu, les comédiens sont déjà là, ils ont investi le théâtre. Certains sont sur scène, bavardant, s’affairant, chantonnant avec gaieté, dans une bonne humeur générale. À cour, un petit orchestre joue en live avec Vincent Delerme au piano, accompagné d’Aurélia Bonaque Ferrat, de Merel Junge et d’Ingrid Schoenlaub (violon, trompette, violoncelle). D’autres acteurs se promènent dans les couloirs où ils accueillent les spectateurs. D’autres encore viennent les saluer en empruntant un podium qui traverse la salle comme une sorte de chemin exigu, de passage qui conduirait du plateau jusqu’au public… Podium n’est pas tout à fait le mot adéquat. Par son étroitesse, ce serait plutôt une poutre d’équilibre pour des acrobates ou des gymnastes bien entraînés ! Il faudra toute l’agilité de nos comédiens pour s’y déplacer et y jouer sans embûche, malgré les costumes somptueux de Christian Lacroix. On entend des cris de mouette. Au fond du plateau, des cordages qui pourraient être les drisses, les écoutes d’un immense voilier. Le parallèle entre un bateau et la scène s’impose naturellement à notre imaginaire : la mer étant omniprésente dans la pièce de Claudel. Rodrigue court les mers du monde, allant des rivages de l’Espagne à ceux de l’Afrique, des Indes occidentales jusqu’aux Baléares, en passant par le Japon etc. Quand le spectacle commence, la troupe, rassemblée sur le plateau forme un chœur devant lequel l’Annoncier (Serge Bagdassarian) prononce les mots d’ouverture : Le Soulier de satin ou le pire n’est pas toujours sûr. À partir de cet instant, nous serons emportés sur ce navire théâtral pour une longue traversée romanesque, métaphysique et poétique. Attaché au grand mât, au milieu de la mer déchaînée, le Père jésuite (Alain Lenglet), frère de Rodrigue, dit de lui comme pour nous signaler d’où vient le problème : « son affaire à ce qu’il imagine n’étant pas d’attendre, mais de conquérir et de posséder ». Dans la scénographie d’Éric Ruf, on ne quitte jamais le théâtre et ses conventions. On utilise les éclairages (superbes), on joue avec la transparence d’une toile de fond qui devient comme un miroir sans teint etc. Il y a aussi une foule de symboles auxquels il faut prêter attention. Par exemple, sur un pan de la robe de Prouhèze, on devine les traits de la Vierge Marie à qui justement elle donnera son soulier de satin rouge. Cela permet d’aller vite. Et il faut aller vite, très vite car la pièce de Claudel est une succession ininterrompue d’aventures, chaque scène nous entraînant d’un pays à l’autre, d’une ville à l’autre : la Catalogne, l’Afrique du nord, l’Amérique, Prague, Naples… Le minimalisme n’empêche pas la force des images. On a parfois l’impression de regarder un tableau de grand maître. Le plateau vide devient alors comme la toile blanche du peintre : par exemple, durant la Première journée, la scène dans l’auberge avec les paysans armés de fusils et de fourches, prêts à attaquer Don Balthazar (Laurent Stocker). Ou encore, la table surabondante, couverte de fruits et de coquillages, de jambons et de carafes de vin où le même Balthazar s’apprête à souper. Lors de la Quatrième journée, on assistera même à une bataille navale musicale entre l’Armada et la flotte anglaise. On pourrait multiplier les exemples. Nous le disions, les comédiens français sont formidables. Comme toujours. Marina Hands incarne une Prouhèze flamboyante, joyeuse et passionnée dans la première partie. Tragique et déterminée, à la fin. Elle n’hésite pas à ramper sur l’étroite poutre, à grimper, à s’accrocher à une échelle pour tenter de rejoindre Rodrigue alors que son Ange gardien (Sefa Yeboah) veille et l’empêche. Il y aura plus tard une autre scène magnifique avec l’Ange gardien, puis la scène très forte où elle dit sa vérité à Camille (Christophe Montenez) : « Non, je ne renoncerai pas à Rodrigue ». Retenons encore son ultime et bouleversante rencontre avec Rodrigue, à bord de sa caravelle, au large de Mogador : « Je vous donne tout » lui dit-elle. En effet, avant de repartir, elle lui confie Marie des Sept-Épées (Suliane Brahim), la fille qu’elle a eue de Camille mais « qui ne ressemble qu’à Rodrigue ». Quant à Baptiste Chabauty, il nous fait d’abord vivre intensément, et dans la joie lui aussi, dans une forme d’optimisme, les aventures du jeune Rodrigue, un conquérant sûr de lui. Plus tard, il nous fera vivre de façon très juste, très émouvante, sa métamorphose, son vieillissement et les changements qui s’opèrent en lui. Quand Rodrigue revient enfin en Espagne, il n’est plus le jeune et glorieux conquistador qui remportait toutes les batailles. Il a perdu une jambe en combattant les Japonais. Il a perdu ses richesses et sa caravelle. C’est un misérable qui vit sur un rafiot et qui, pour gagner quelques sous, peint des images pieuses. Il y a des icônes accrochées partout autour de lui. On y retrouve celle de la Vierge avec le petit soulier de satin rouge de Doña Prouhèze. Désormais, ses ambitions sont ailleurs : « Je suis venu pour élargir la terre » dira-t-il à Doña Sept-Épées. Citons Didier Sandre, acteur claudélien par excellence qui, après avoir joué Rodrigue il y a près de quarante ans, reprend le rôle de Don Pélage qu’interprétait autrefois Antoine Vitez… Laurent Stocker que l’on voit camper dans la Première journée un Balthazar généreux et drôle, aux allures de Falstaff, puis d’autres personnages comme l’Archéologue… Danièle Lebrun qui interprète, tour à tour, le Chancelier, Doña Honororia, le Chambellan et la Religieuse. Ou encore, Suliane Brahim dans le rôle de Doña Sept-Épées, aussi libre, aussi passionnée que sa mère, Doña Prouhèze, en révolte contre Rodrigue qui refuse d’aller avec elle combattre la barbarie en Afrique : « Ce n’est pas la peine d’avoir un père s’il n’est pas comme nous » lui lance-t-elle avant de s’en aller. Il y a encore la très belle scène avec la Bouchère (Coraly Zahonero) … Lorsque la pièce de Claudel s’achève, Rodrigue a tout perdu. À lui, dont « l’affaire (était) de conquérir et de posséder », il ne reste rien. C’est un proscrit et un SDF, dépouillé de tout. Sans doute, fallait-il en passer par là pour qu’il trouve sa vérité. Prouhèze est toujours son étoile éternelle. Et, en le rachetant avec un chaudron en fer et quelques hardes, la sœur Glaneuse l’a sauvé d’une mort programmée. Claudel nous l’avait bien dit : « Le pire n’est pas toujours sûr ». Alors que Rodrigue s’éloigne avec la vieille religieuse, on entend le coup de canon qui annonce que Doña Sept-Épées est arrivée sur le bateau de Jean d’Autriche, qu’elle est sauvée elle aussi : la fille de Prouhèze, « l’enfant de la Douleur, » a rejoint le fils de Dona Musique, « l’enfant de la Joie ». Cette fois, la joie a définitivement gagné. Au moment des saluts, la troupe entonne un dernier chant. Il n’est pas si facile de mettre un point final après une telle aventure théâtrale. Quant à nous, spectateur, au sortir de cette magnifique traversée claudélienne, de cette incroyable expérience que nous venons de vivre, nous éprouvons ce même sentiment de joie. Le Soulier de satin de Paul Claudel, mise en scène d’Éric Ruf, à la Comédie-Française, salle Richelieu, du 21 décembre 2024 au 13 avril 2025, avec un horaire exceptionnel : 15h – 23h30 Chantal Boiron / UBU - Apite Légende photo : © Jean-Louis Fernandez – Laurent Stocker et la troupe de la Comédie-Française dans Le Soulier de satin de Paul Claudel mise en scène d’Éric Ruf, salle Richelieu

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 4, 3:38 PM
|
Par Baudouin Eschapasse dans Le Point - 4 janvier 2025 Le comédien, également psychologue spécialiste de l’autisme et écrivain, est décédé le vendredi 3 janvier 2025 à l’âge de 74 ans. Retour sur un parcours hors norme.
Les clowns meurent aussi ! Buffo, personnage burlesque créé par Howard Buten, est décédé, avec son auteur, le 3 janvier 2025. Résumer en quelques lignes la vie de ce comédien, par ailleurs romancier et psychologue clinicien spécialiste de l'autisme, n'est pas chose aisée, car le personnage aimait s'entourer de mystère. Né le 28 juillet 1950 à Detroit aux États-Unis, son parcours reste plein de zones d'ombre... Fils aîné d'un avocat, Ben Butensky (qui avait raccourci son nom par souci de simplicité, mais aussi pour se distinguer de son frère, membre d'un gang de malfaiteurs), élevé par une danseuse de claquettes, Dorothy Fleisher, il disait avoir très tôt voulu travailler dans un cirque. Mais pas forcément comme clown… « J'ai toujours détesté les "Augustes" », expliquait-il. La faute probablement à Ricky, un tramp clown [un clown clochard, NDLR] vu à la télévision pendant son enfance. « Ce vagabond aux lèvres blanches, au visage fardé et aux vêtements de guenille me faisait plus peur que rire », confiait Howard Buten. Inspiration Doué pour le chant et doté d'un petit talent de ventriloque, le jeune Howard s'inscrit, en 1968, à l'université du Michigan, aux cours de chinois avec le projet de sillonner l'Asie. Pour voyager, il ne voit alors que deux moyens de transport possibles. Soit le cargo, soit le cirque. À vingt ans, au terme de deux années d'études poussives du mandarin, il tente de s'engager dans la marine marchande. En vain. Faute de devenir marin, il sera donc circassien. Il s'inscrit au début des années 70 en Floride dans la prestigieuse école du cirque Barnum & Bailey. Une institution prestigieuse fondée par les Ringling Brothers et qui a inspiré à Cecil B. De Mille son long-métrage Sous le plus grand chapiteau du monde (The Greatest Show on Earth) en 1952, avec Charlton Heston et James Stewart. Howard s'y forme à la pantomime et à la jonglerie auprès de Lou Jacobs (1903-1992). C'est cet artiste qui lui fait prendre conscience de la richesse de l'art clownesque. « Lou m'a tout appris : l'histoire de ce genre qui naît en Italie au XVIIIe siècle avec le comique italo-britannique Joey Grimaldi. Mais aussi le rôle fondamental car thérapeutique du rire », évoquait Howard Buten. Premiers pas Par la magie du masque grotesque du pitre, ses grimaces et ses chutes, le jeune homme réalise qu'il lui est possible de raconter des histoires susceptibles de toucher un public international, sans pour autant avoir à apprendre une langue étrangère. Doté d'une grande faculté d'improvisation et d'un certain don pour la musique (il joue du violon), le jeune apprenti clown ne tarde pas à se faire recruter par le Clyde Beatty Cole Brothers Circus et à partir en tournée. Son premier sketch est cependant un cuisant échec. « Le clown que j'incarnais (et qui n'avait pas encore de nom) entrait en piste muni d'un panier contenant trois œufs surdimensionnés. J'entreprenais de jongler avec. En vain, évidemment. Je finissais mon tour en faisant jaillir de mon baluchon un poulet que je jetais en l'air. Mais personne ne riait », se rappelait-il, avec cet air affligé inimitable. Modèle Le même numéro lui avait valu d'être recalé à l'examen de sortie de l'école, alors dirigée par Irving Feld. Cet échec provoquera chez lui son premier épisode dépressif. Il y en aura beaucoup d'autres. Une rencontre va néanmoins le sortir de l'ornière. En 1970, il fait la connaissance, en Californie, du clown Otto Griebling. C'est lui qui l'aidera à trouver son style. Rendu muet par un cancer du larynx, Otto a en effet développé des numéros sans paroles et sans artifices dont le comique réside dans l'extraordinaire économie de moyens qu'il met en œuvre face à un public par ailleurs médusé par les tours de force des acrobates, contorsionnistes et autres dompteurs du reste de la troupe. « Le truc d'Otto était de rester immobile de longues minutes au bord des gradins, de chercher des yeux un spectateur, de le fixer longuement jusqu'à ce qu'un malaise s'installe puis de sembler chercher son nom dans une liste et de le cocher ; avant de passer au suivant », disait Howard Buten. C'est sur son modèle qu'il crée le personnage de Rumples (un mot que l'on pourrait traduire par « chiffonné »). Et c'est avec ce clown qu'il intègre, en 1972, le cirque Bartok, où il partage la roulotte d'un ancien champion olympique de gymnastique polonais devenu alcoolique. Révélation Howard Buten va passer deux saisons au sein de ce cirque. Il y effectue, chaque soir, un périlleux numéro avec un dresseur d'ours puis développe une série de sketchs en groupe. Les clowns américains intervenant en bande là où les Européens sont plutôt adeptes de duos, généralement composés d'un Auguste et d'un Pierrot – un pitre et un clown triste. Mais les explosions de pétard, les tartes à la crème et autres plats de spaghettis qu'ils s'envoient au visage finissent par le lasser. En 1973, il découvre le personnage de Grock, inventé par le Suisse Adrien Wettach : un personnage comique qui ne donne pas la réplique à un clown blanc, mais à un musicien. C'est une révélation. Quelques mois plus tard, Buffo naît. Le nom, pioché dans le dictionnaire italien, renvoie au « bouffon » médiéval, mais aussi à l'opéra-bouffe… Naissance de Buffo Buffo ? C'est un gringalet, incapable de prononcer autre chose qu'un long « hein ? » traînant (ce qui lui donne l'air d'un abruti) ; un homme-enfant incapable d'exprimer ses sentiments (ce qui le rend irascible) ; un individu perpétuellement éberlué par ce qu'il voit du monde (et dont l'apparente inadaptation à son environnement crée, en définitive, une inépuisable poésie). La seule manière de communiquer de Buffo est, de fait, le recours à la musique. Avec ce personnage, Howard Buten peut enfin exprimer ce qui lui tient à cœur : raconter, de manière cryptée, l'histoire de son grand-père paternel, Joseph Butensky, né vers 1880 dans un shtetl de Lituanie et débarqué à Ellis Island sans parler un mot d'anglais, à la veille de la Première Guerre mondiale. Cet aïeul, devenu chiffonnier, occupe une place centrale dans la vie et l'imaginaire de Howard, qui quitte la troupe du Super Circus Bartok pour intégrer celle d'un music-hall de Mount Clemens, dans la banlieue de Detroit, avec ce personnage de Buffo. La voix de la musique Howard Buten se produira d'abord avec la chanteuse Milly Whiteside, puis avec un pianiste, avant de continuer l'aventure en solo, recourant désormais tantôt à une trompette, tantôt à un violon (en réalité, plusieurs, de tailles différentes). « J'envisageais le personnage comme une sorte de Simplet, le nain de Blanche-Neige, fasciné par ce qu'il voyait dans la salle. Un truc que j'avais emprunté à Liza Minelli qui, lorsqu'elle chantait, se mettait à fixer un point au loin, par-delà le public. Si vous apparaissez sur scène et que vous semblez cloué sur place par une apparition lointaine, le public vous prête tout à coup une attention soutenue », résumait-il. Après avoir transporté son personnage des comedy clubs de Californie à ceux de New York et effectué plusieurs tours du monde (Buffo est très populaire au Japon), Howard Buten retournera sur les bancs de l'université pour suivre un cursus de psychologie. « C'est ma rencontre avec un enfant autiste, Adam Shelton, qui m'a poussé à le faire, en m'incitant à chercher les moyens de comprendre les esprits humains qui ne fonctionnent pas comme les autres », explique alors le clown, qui créera, en 1996, un centre d'accueil pour enfants frappés par ce syndrome. Vies parallèles Devenu psychologue clinicien, Howard Buten se tourne, dans le même temps, vers l'écriture. En 1981, il publie Quand j'avais 5 ans je m'ai tué. L'ouvrage, passé inaperçu aux États-Unis, est traduit en français par Jean-Pierre Carasso. C'est un succès tel que le comédien s'installe à Paris. Suivront quatre autres livres, dont Le Cœur sous un rouleau compresseur, Monsieur Butterfly et Quand est-ce qu'on arrive ? Des récits où le rire côtoie l'effroi. Comme dans Histoire de Rofo le clown : une histoire où un pitre de cirque tue son meilleur ami avant de sombrer dans une profonde dépression. Malgré ces succès éditoriaux, Howard Buten ne tournera pourtant jamais le dos au personnage de Buffo, dont il endossera régulièrement le costume. Notamment dans un spectacle avec la violoncelliste et musicothérapeute Claire Oppert, qui tournera plusieurs années et sera récompensé en 1998 par un Molière au titre du meilleur one man show. Au début des années 2000, le « saltimbanque » – comme il aimait à se définir – s'était progressivement retiré de la scène. Vivant loin de Paris, dans une maison isolée en Bretagne, en compagnie de la veuve de Jean-Pierre Carasso, Howard Buten avait fini par ressembler au clown Buffo : mutique, contemplant le monde d'un air effaré depuis son fauteuil, comme coupé du monde… ================================================ L'hommage de Libération Disparition Howard Buten, alias le clown Buffo, est mort LIBERATION et AFP publié le 05/01/2025 L’un des clowns les plus célèbres de France et des Etats-Unis, qui était par ailleurs psychologues, est décédé vendredi 3 janvier à Plomodiern, dans le Finistère. Il était connu, entre autres, pour son livre «Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué» et pour ses recherches sur l’autisme. Le clown Buffo ne fera plus rire. Howard Buten, connu pour son personnage «Buffo» et auteur d’une dizaine de livres dont Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué, est mort vendredi 3 janvier à l’âge de 74 ans, a-t-on appris samedi auprès de sa compagne et traductrice, confirmant une information du Point. Né à Détroit aux Etats-Unis en 1950, l’artiste américain, qui était atteint de la maladie d’Alzheimer, s’est éteint «paisiblement dans son sommeil» à Plomodiern (Finistère), où il résidait, a déclaré à l’AFP Jacqueline Huet, qui traduisit certains de ses livres. Avec son visage blanc, son nez rouge, ses mitaines et ses longues chaussures noires, le clown Buffo était reconnaissable entre mille. Sous ce déguisement, Howard Buten provoquait toujours le même attendrissement et les rires du public, par des sketches muets, des petits tours de danse, des gestes maladroits et des mimiques ahuries. C’est dans son pays que ce personnage lunaire, qui était aussi danseur, chanteur et musicien, s’était façonné, au cours d’un numéro de music-hall qui s’allongea au fil du temps. Dans les années 1970, il totalisait déjà un millier de représentations. Buffo avait avec lui ses instruments de musique (violon, piano, trompette), son poulet plastique vindicatif, ses ustensiles ménagers récalcitrants. Il fut même un temps ventriloque. Docteur en psychologie Issu d’une famille lituanienne qui avait émigré aux Etats-Unis, Buten s’était installé en France en 1981 à la sortie de son premier livre, Burt. Traduit et publié en français sous le titre Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué, qui fut un best-seller. L’artiste est bien plus que cela : il devient en 1986 docteur en psychologie clinique et se consacre aux enfants autistes à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dans le Centre Adam Shelton qu’il crée en 1996. Parmi ses autres livres, certains abordent aussi ce sujet, comme Il y a quelqu’un là-dedans : les autismes ou Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes. Son dernier livre, Buffo, paru en 2005, est autobiographique. En 1998, il obtint un Molière du meilleur one man show pour un spectacle avec la violoncelliste Claire Oppert. Il avait été fait chevalier des Arts et des Lettres en 1991. «Un hommage lui sera rendu plus tard à Paris», a annoncé sa compagne à l’AFP.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 3, 12:29 PM
|
Editorial d'Alexandra Schwartzbrod dans Libération - 3 jan. 2025 Les faits abjects dont le comédien est accusé par deux femmes dans «Libération» font tristement écho aux affaires Depardieu et PPDA, tant dans le mode opératoire que dans l’emprise que ces hommes auraient exercée sur les plaignantes. La lecture des témoignages d’Agathe Pujol et de Pauline Darcel, qui accusent Philippe Caubère de violences sexuelles et d’emprise, est doublement édifiante. Elle est édifiante parce que les faits qu’ils dénoncent sont intolérables et abjects. Elle est édifiante parce qu’on y retrouve le même mode opératoire que dans certaines grandes affaires ayant défrayé la chronique ces dernières années, celles concernant Gérard Depardieu ou Patrick Poivre d’Arvor, deux hommes de la même génération. Là encore, le scénario semble être le même : un personnage puissant dans son milieu, adulé par des femmes très jeunes, profite de son aura pour attirer dans sa toile des personnes vulnérables, soit en raison de leur jeune âge, soit en raison de leur solitude, soit en raison de leur classe sociale. Ces violences dénoncées découlent d’un narcissisme et d’un égotisme fous mais aussi d’une grande lâcheté, car quoi de plus facile que de profiter de mineures ou de femmes jeunes et sans défense qui comprennent trop tard ce qui est en train de leur arriver. Formé à l’école du théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine, fondé peu après 1968 dans un esprit communautaire, Philippe Caubère a été la figure de proue d’un certain théâtre hérité de ces années-là, à la parole décomplexée, au jeu virtuose et exaltant voire exalté. Il fait partie de cette génération post-1968 pour laquelle tout semblait permis, y compris les pires interdits, ce qu’il revendiquait dans des «seul en scène» très autobiographiques qui faisaient chaque fois salle comble. Mais ça, c’était avant #MeToo, qui a soudain ouvert les yeux de la société sur les nombreux abus dont les femmes étaient victimes dans tous les milieux, et d’abord dans celui de la culture. Philippe Caubère a d’ailleurs été un de ceux qui ont très vite dénoncé les «dérives» de ce mouvement né des violences exercées sur les femmes par le producteur américain Harvey Weinstein. Comme quoi, on peut être talentueux mais se comporter en parfait salaud et ne rien comprendre aux évolutions du monde. Alexandra Schwartzbrod / Libération Lien vers tous les articles de la Revue de presse théâtre liés au thème "#MeToo Théâtre / Cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 2, 4:33 PM
|
Par Cassandre Leray dans Libération - 2 janvier 2025 Condamnée pour diffamation contre l’acteur, qui conteste les nouvelles accusations de viols qui le visent aujourd’hui, la comédienne se dit «scandalisée et meurtrie» par le traitement de l’affaire par la presse et la justice, au début du mouvement #MeToo. Elle parlait pour «protéger toutes les autres femmes et filles». Le 13 mars 2018, la comédienne Solveig Halloin dépose plainte contre l’acteur Philippe Caubère. Elle l’accuse de l’avoir violée huit ans plus tôt, en mars 2010, à Béziers (Hérault), alors qu’elle avait 35 ans. Un mois plus tard, le 18 avril 2018, elle s’exprime pour la première fois dans la presse, dans une vidéo publiée par le Huffington Post. Philippe Caubère, lui, reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la plaignante, mais dément tout viol. Un an après l’explosion du mouvement #MeToo, Solveig Halloin est alors l’une des rares femmes en France à prendre la parole à visage découvert. Onze mois plus tard, le 17 février 2019, le parquet de Créteil classe l’affaire sans suite. Solveig Halloin raconte aujourd’hui à Libération son travail de dramaturge «qui s’est achevé», mais aussi «la paupérisation et la dépression qui en ont découlé». «La persécution a continué», relate-t-elle : en 2018, elle est poursuivie en diffamation par Philippe Caubère. Sur ses réseaux sociaux, en avril de la même année, la plaignante avait mis en cause le comédien. «Faire bouger les institutions pétries de culture du viol» Se disant «incapable» de croiser Philippe Caubère «après les tortures qu’il [lui] a fait vivre», il lui est «impossible» de se rendre à l’audience où elle est poursuivie pour diffamation, le 18 juin 2021. Trois mois plus tard, elle est condamnée à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à l’artiste, ainsi que 2 000 euros pour ses frais de justice. Elle ne fera pas appel, ni de sa condamnation ni du classement sans suite de sa plainte, «scandalisée, meurtrie, revictimisée par les violences policières, judiciaires et médiatiques. La triple peine est un cauchemar», dénonce Solveig Halloin, aujourd’hui âgée de 49 ans. Pendant des années, elle est accusée d’avoir «instrumentalisé» la cause #MeToo, des mots de Philippe Caubère et son ancienne avocate Me Marie Dosé. A l’époque, l’acteur est soutenu par de nombreux médias, qui le dépeignent en victime des «dérives» du mouvement féministe. Dans la presse, la publication du témoignage de Solveig Halloin est ainsi désignée comme un «dérapage médiatique» aux lourdes «conséquences» pour Caubère. Au cours d’une interview, un journaliste lui demande même : «Avez-vous le sentiment d’être une victime de la vague #MeToo ?» Tandis que dans un autre article, la crédibilité de la comédienne est questionnée : «Force est de reconnaître que trois ans après le dépôt de la plainte […] aucune autre victime ne s’est jamais fait connaître.» Sur les réseaux sociaux, les mots sont violents : elle y est aussi bien traitée de «folle» que de «menteuse». En juin dernier, la comédienne dénonçait dans une enquête de Mediapart le «fiasco judiciaire et médiatique» qui a suivi sa plainte. A Libération, Solveig Halloin l’affirme : «Une femme qui parle en sauve mille, mille femmes qui parlent sauvent toutes les femmes, c’est comme cela que l’on fait bouger les institutions pétries de culture du viol.» Margot accuse Philippe Caubère de l’avoir violée en avril 2006 Dès la publication de son témoignage, Solveig Halloin reçoit des messages de femmes «qui [lui] racontent les violences perverses commises par Caubère», retrace la dramaturge, dont elle donne les noms à la police. Dans cette liste, une apprentie comédienne, Pauline Darcel, alors âgée de 23 ans. Le 23 novembre 2018, celle-ci reçoit un appel surprise de la police judiciaire de Créteil à propos de Caubère. Selon le procès-verbal de l’entretien, consulté par Libération, Pauline Darcel décrit une fellation au cours de laquelle Philippe Caubère «fait preuve de brutalité» alors qu’elle n’avait que 16 ans. Sur le papier, l’agent indique pourtant qu’elle n’a subi «aucune violence sexuelle», bien que Caubère, écrit-il, ait su «profiter de sa jeunesse et de son état de vulnérabilité». En raccrochant, Pauline Darcel pense que ce qui lui est arrivé «n’est pas pénalement répréhensible». Et abandonne l’idée d’entamer toute démarche judiciaire. «L’agent qui m’a appelée me répétait que ce que j’avais vécu n’était pas grave, que ce n’était pas vraiment du viol», souligne-t-elle. Il lui faudra «des années» pour redonner sa confiance à la justice, jusqu’à sa plainte en octobre 2022, suite à laquelle Philippe Caubère a été mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineure en février 2024. Quand Margot (1) est à son tour contactée par la police après avoir écrit à Solveig Halloin, elle reste «tétanisée». Elle ne répondra jamais au mail des enquêteurs. «Je ne me sentais pas prête à plonger tête baissée dans une procédure judiciaire. Encore moins avec l’emballement médiatique que cette affaire générait», confie-t-elle. Elle accuse pourtant Philippe Caubère de l’avoir violée en avril 2006, quand elle avait 20 ans. Selon son récit, le comédien l’invite chez lui, à Saint-Mandé (Val-de-Marne) après l’avoir rencontrée à la fin de l’un de ses spectacles. «Un soir, il me met la pression pour qu’on ait une relation sexuelle», relate-t-elle. Elle raconte qu’après son refus, il lui «demande une fellation à la place». De nouveau, elle dit non. «Il me répond que si j’hésite, notre relation ne vaut rien», rapporte Margot. Quelques minutes après, décrit-elle, «il m’attrape, me jette sur son lit et me pénètre brutalement. J’ai juste regardé le plafond en espérant que tout s’arrête». Questionné à ce sujet par Libération, Philippe Caubère explique, par l’entremise de ses avocates Me Julia Minkowski et Me Eléonore Heftler-Louiche, qu’il n’a «pas connaissance» de telles accusations. Soutien à Sofiane Bennacer et Gérard Depardieu Six ans plus tard, Margot, 38 ans aujourd’hui, ne souhaite toujours pas porter plainte. Témoigner dans la presse lui est déjà difficile : «La façon dont la plainte de Solveig Halloin a été médiatisée, puis sa condamnation en diffamation, en dit long sur la manière dont on recevait les témoignages des victimes à l’époque», soupire-t-elle. Un mot en particulier lui reste en tête : dans plusieurs médias, elle lit que l’acteur est «blanchi» après le classement sans suite de la plainte de Solveig Halloin. Pourtant, une telle décision met simplement un terme aux investigations en raison d’un manque d’éléments probants. Elle ne dit pas autre chose. Une situation fréquente dans ces dossiers, pour lesquels il est difficile de rassembler des preuves : selon une étude de l’Institut des politiques publiques parue en avril, 94 % des affaires de viols sont classées sans suite. 24 nov. 2022 édition abonnés Philippe Caubère n’a jamais caché ses positions vis-à-vis du mouvement MeToo. En janvier 2023, il faisait partie des signataires d’une tribune dans le Point en soutien à l’acteur Sofiane Bennacer, mis en examen pour viols sur plusieurs femmes, dont les témoignages ont été révélés par Libération. En décembre 2023, il signait cette fois dans le Figaro une tribune de soutien à l’acteur Gérard Depardieu, mis en examen pour viols et appelé à comparaître en mars 2025 pour «agressions sexuelles» contre deux femmes. Chaque fois, les textes dénoncent une «présomption de culpabilité» qui serait infligée aux hommes mis en cause. Philippe Caubère s’estime lui-même touché. En 2018, il racontait à Libération «tomber des nues» devant le témoignage de Solveig Halloin. Six ans plus tard, trois autres femmes ont déposé plainte contre lui. (1) Le prénom a été modifié. Légende photo : La comédienne Solveig Halloin à Toulouse, le 19 novembre 2024. (Cha Gonzalez/Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 30, 2024 5:17 PM
|
Par Marie-José Sirach dans L'Humanité - 30 déc. 2024 Clown, poète, musicien, fondateur du Prato – le plus petit théâtre international de quartier à Lille–, Gilles Defacque a tiré sa révérence. Tristesse. Jusqu’au bout, il se sera bagarré contre la maladie. Faut dire que c’était un sacré bagarreur, contre la bêtise et la crasse du monde, contre la grisaille et l’hypocrisie du système. Gilles Defacque mettait du soleil dans nos vies. Nez rouge, en chemise et bretelles, là où il débarquait, ça tourneboulait sec. Les punchlines, il en avait plein sa besace, à croire qu’il avait un jardin secret où les cultiver. Mais il était bien plus que ça : c’était un immense poète, un fantaisiste hors pair, un saltimbanque de la trempe des plus grands. Né en 1945 à Friville-Escarbotin, ça s’invente pas, en Picardie, il a pris la Libération au pied de la lettre. C’est dans une salle de bal-catch-cinéma que tenaient ses parents qu’il grandit. Toujours aux premières loges, il observait les danseurs tournoyer, les matchs de catch, pourtant interdit aux minots, se faufilant entre les fauteuils pour se faire une cinématographie désordonnée et populaire. Lorsque le jeune Picard migre à Lille, il débarque à Wazemmes. Le coup de foudre est immédiat et réciproque : il devient un Ch’ti avec l’accent. Le Prato comme écrin Dans la mouvance post-68, il fonde avec une bande de copains le Prato, qui devient l’épicentre d’aventures théâtrales épiques, clownesques et fantaisistes. Beaucoup d’acteurs, de clowns, de musiciens y feront leurs premiers pas. Defacque avait le souci de la formation et de la transmission, alors le Prato ouvrait grand ses portes à celles et ceux qui voulaient se lancer dans l’aventure. Guy Alloucherie et Éric Lacascade, Jean-Michel Soloch et Chantal Lamarre, Howard Buten, Jacques Bonnaffé, Yolande Moreau, Jean Boissery, Tiphaine Raffier, David Bobée ; mais aussi toute une génération de clowns et clownes, Baro d’evel, le cirque Trottola ; des musiciens, William Schotte, Nono, André Minvielle, Bernard Lubat ou la compagnie du Tire-laine, tous sont passés par le Prato, qui est consacré lieu de création, une fabrique de théâtre populaire, un cirque de tous les possibles, avec son festival Au rayon burlesque ou ses bals du dimanche (gratuits). Gilles Defacque était un clown jusqu’au bout de son nez rouge. Ses écrits, poético-burlesques, ne manquaient ni de piment, ni de sel. La Rentrée littéraire de Gilles Defacque (la Contre Allée, 2014) est un florilège de saillies mordantes et de contrepèteries improbables où Defacque, dans la peau d’un critique littéraire qui aurait « regardé (trop) la télé ou qui aurait dormi (au choix) », invente une liste des 700 livres, rentrée littéraire oblige, avec une règle du jeu : un titre, un résumé et une petite appréciation si possible ou un nom d’éditeur. Cela donne des brèves de conteur, à déguster entre deux fricadelles-frites et une gorgée de bière… Cet été encore, alors qu’il était affaibli par la maladie, Gilles était venu à Uzeste, sur un coup de tête. Il a improvisé, s’autoproclamant maître de cérémonie du concert de la Cie des fifres de Sylvain Roux. Autant dire qu’il leur a cloué le bec, aux fifres ! C’est Patricia Kapusta, sa compagne et complice de cette aventure artistique singulière, qui a annoncé sa mort. De très nombreux artistes ont fait part de leur tristesse et émotion. « Lille et le monde de la poésie perdent un grand artiste », a écrit Martine Aubry, maire de Lille, sur les réseaux sociaux. « Il était plus qu’un artiste. Il a été de tous les combats pour défendre la condition humaine et les conquêtes sociales du XXe siècle. Nous avons partagé tant de ces luttes », a pour sa part déclaré Fabien Roussel, secrétaire national du PCF. Marie-José Sirach / L’Humanité Légende photo : ©Gilles Defacque est mort à l'âge de 79 ans. © PHOTOPQR/VOIX DU NORD/Max ROSEREAU

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 28, 2024 4:07 PM
|
Par Armelle Héliot dans son blog - 20 décembre 2024 Seul en scène, le comédien innerve le texte de l’écrivain et metteur en scène, d’une force sans brutalité qui apporte de la lumière aux mots de « Kolizion ». On les connaît tous les deux. Le porteur de la parole, Radouan Leflahi, présence forte, charme puissant. Mais l’interprète est ennemi de toute démonstration. On l’a toujours connu dans la sobriété, même dans la joie éclatante d’incarner le Dom Juan de Molière, sous la direction de David Bobée, par exemple. Il avait déjà beaucoup travaillé avec celui qui est aujourd’hui au Théâtre national de Lille. Il a tourné pour le cinéma, pour des séries. On le reverra beaucoup dans les années qui viennent. L’écrivain et metteur en scène, Nasser Djemaï, est une personnalité forte du paysage théâtral et l’on n’oublie pas ses pièces qui puisent, dans l’Histoire, des situations dramatiques fertiles. On n’oublie pas le comédien d’Une étoile pour Noël , il y a près de vingt ans. Puis toutes ces pièces qui disent ses origines, qui disent l’enracinement en France, dans la langue française. Hommes et femmes y sont présents avec sensibilité et profondeur. Invisibles, magnifique mise en lumière du sort de Chibanis d’après des paroles recueillies, tout comme Vertiges, Héritiers, Les Gardiennes, nous ont tous frappés par leurs constructions, leurs styles. Et par les personnes que l’on voyait vivre devant nous. Kolizion est un texte difficile. Il va et vient, faux récit de formation, fausse fable, faux conte. Difficile de savoir ce qui est puisé dans le vif de la vie de l’écrivain, difficile de savoir lorsque l’on est dans le rêve, sinon le délire d’un homme qui semble prétendre nous livrer la vérité de son destin. Un personnage combattant. On le suit. Sur un plateau un peu encombré, car le comédien va d’un espace à l’autre, selon les épisodes de sa vie, Radouan Leflahi offre sa présence magnétique, ses dons oratoires (voix harmonieuse, très bien placée, son énergie sans brutalité), son charme, sa beauté nocturne, au personnage. Mais on lui demande un peu trop. Une heure quarante. Des glissements, des ruptures. Le texte est difficile et mériterait sans doute d’être un peu resserré. Après les représentations de la Manufacture des Œillets, Théâtre des Quartiers d’Ivry, que dirige brillamment Nasser Djemaï, on imagine sans peine que la représentation va être resserrée. Certains épisodes éclaircis, certains passages rendus plus simples. On compte profondément sur ces théâtres de langue française, ces artistes français, issus d’horizons parfois lointains, et qui sont la sève de la littérature et de l’interprétation, en France, aujourd’hui. C’est ici, au Théâtre des Quartiers d’Ivry, qu’a été créé Par les villages, qui électrise la grande salle du Centre Georges-Pompidou, avant de retrouver le lieu de sa naissance, fin janvier –voir juste avant, dans ce blog. Armelle Héliot Théâtre des Quartiers d’Ivry, centre dramatique national du Val-de-Marne. Jusqu’au 20 décembre. Tél : 01 43 90 11 11. Puis en tournée MC2 Grenoble du 4 au 7 février, Les Passerelles de Pontault-Combault le 7 mars,, etc. La tournée se poursuit jusqu’en avril. Avec le Théâtre Joliette du 20 au 22 mars, la Scène de Bayssan, du 25 au 30 mars. A Sartrouville, centre dramatique des Yvelines le 3 et 4 avril, le Théâtre de Nîmes du 9 au 11 avril. Le texte est publié par Actes Sud-Papiers (13€) et en version numérique, 9,99€.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2024 2:59 PM
|
TRIBUNE – Historique. Pour la première fois, toutes les associations labellisées du spectacle vivant et les festivals signent une tribune dénonçant les coupes franches opérées partout dans la culture, qui menacent jusqu’à l’existence même des artistes. Publié le 18 décembre 2024 à 17h00 « Notre pays traverse aujourd’hui une crise politique et budgétaire sans précédent. Pour y faire face, les pouvoirs publics – État et collectivités territoriales – se sont engagés dans une politique de réduction des dépenses publiques qui touche aujourd’hui violemment le secteur des arts et de la culture. Nous, réseaux de structures œuvrant pour des missions de service public et d’intérêt général, ne prétendons pas que le secteur de la culture doive échapper à l’effort collectif. Mais nous voulons rappeler ici que la contribution décisive du secteur culturel à la dynamique sociale et économique de notre pays n’est plus à démontrer. Les artistes, les compagnies, les ensembles, les opéras, les orchestres, les théâtres, les salles de spectacles et de concerts, les cirques, les festivals…, sont aujourd’hui des éléments essentiels de la vitalité des territoires. Le réseau dense d’établissements et d’initiatives culturelles, patiemment bâti au fil de décennies de politiques publiques en faveur des arts et de la culture, constitue aujourd’hui une dimension fondamentale de notre histoire et de notre identité. Le laisser se déconstruire et dépérir au nom d’économies de court terme risque d’hypothéquer gravement notre avenir commun. Le spectacle vivant public n’est pas réservé à l’entre-soi confortable d’une élite cultivée. Bien au contraire, tout l’effort des politiques publiques dont nous sommes les actrices et les acteurs consiste précisément à élargir toujours davantage l’accès de nos concitoyennes et concitoyens à la culture, que ce soit en proposant des tarifs qui n’excluent aucune catégorie de public, ou en rapprochant l’offre culturelle de celles et ceux qui, pour des raisons sociales ou géographiques, s’en trouvent éloignés. Le travail patient et rigoureux que nous accomplissons sur les territoires où nous agissons, dans les salles ou dans l’espace public, a toujours pour but de partager le plus largement possible aussi bien les innovations de la création contemporaine que le patrimoine musical, théâtral, littéraire, chorégraphique, circassien…, de notre pays. Le maintien résolu d’une culture vivante relève d’une véritable écologie de l’esprit, indispensable à l’invention de futurs désirables. Dans le cadre de nos missions de service public, nous participons à l’émancipation des citoyennes et des citoyens et au maintien de la cohésion sociale des territoires. Dans une époque marquée comme la nôtre par des défis inouïs, il s’agit là d’un véritable investissement d’avenir, sur lequel il est particulièrement périlleux de vouloir économiser. C’est pourquoi il nous semble essentiel, en raison même de la crise que traverse actuellement notre pays, que soit préservé l’écosystème précieux de la culture vivante. Son histoire, sa richesse, sa diversité, son engagement résolu et citoyen, constituent des repères et des facteurs de stabilité, alors même que nous sommes entrés dans des temps particulièrement troublés. Les coupes franches envisagées par certaines collectivités territoriales, ajoutées aux 200 millions d’économies imposées par l’État au secteur de la création en 2024, et alors même que les plus grandes incertitudes pèsent sur le budget 2025, viennent aujourd’hui gravement affaiblir un secteur déjà très éprouvé par les crises successives de ces dernières années. La fragilisation du principe de cofinancement des collectivités territoriales et de l’État remet en cause la cohérence des politiques publiques pour la culture, jusqu’alors définies par une ambition commune artistique, culturelle et sociale. Nous nous alarmons de constater qu’en de nombreux endroits le remède sera à terme bien pire que le mal qu’il prétend traiter. Pour la première fois depuis plusieurs décennies est menacée la capacité même de nos organisations, qu’elles soient en charge de la création ou de la diffusion, à soutenir tout projet artistique et culturel dans les domaines de la danse, du théâtre, de la musique instrumentale et lyrique, des musiques actuelles, du cirque, de la marionnette et des arts de la rue. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, c’est donc la capacité à réaliser nos missions de service public qui est fondamentalement remise en question. Les conséquences des premières annonces ne se sont pas fait attendre : c’est l’existence même des artistes et des équipes artistiques qui est en jeu, autant qu’une part importante du dynamisme économique des territoires. » Signataires
ACCN – Association des centres chorégraphiques nationaux
A-CDCN – Association des centres de développement chorégraphique nationaux
ACDN – Association des centres dramatiques nationaux
A-Cnarep – Association des centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public
aCNCM – Association des centres nationaux de création musicale
AFO – Association française des orchestres
ASN – Association des scènes nationales
Fedelima – Fédération des lieux de musiques actuelles
France Festivals
Latitude Marionnette – Association des centres nationaux de la marionnette
ROF – Réunion des Opéras de France
Territoires de cirque Dans un discours resté célèbre, prononcé le 11 novembre 1848 devant la représentation nationale, Victor Hugo mettait déjà en garde contre la tentation de faire des économies sur les arts et les lettres :
« Personne plus que moi, messieurs, n’est pénétré de la nécessité, de l’urgente nécessité d’alléger le budget ; seulement, à mon avis, le remède à l’embarras de nos finances n’est pas dans quelques économies chétives et contestables. Les réductions proposées sur le budget spécial des sciences, des lettres et des arts sont mauvaises doublement : elles sont insignifiantes au point de vue financier, et nuisibles à tous les autres points de vue. Que penseriez-vous, messieurs, d’un particulier qui aurait 1.500 fr. de revenus, qui consacrerait tous les ans à sa culture intellectuelle par les sciences, les lettres et les arts, une somme bien modeste, 5 francs, et qui, dans un jour de réforme, voudrait économiser sur son intelligence 6 sous ? Voilà, messieurs, la mesure exacte de l’économie proposée. Eh bien, ce que vous ne conseilleriez pas à un particulier, au dernier des habitants d’un pays civilisé, peut-on le conseiller à la France ? »

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 18, 2024 10:59 AM
|
Reportage de Molière Adely, correspondant de Libération à Port-au-Prince, le 18 déc. 2024 En dépit des crises sécuritaire et humanitaire qui touchent le pays, les organisateurs d’activités culturelles ne veulent pas baisser les bras. C’est le cas de ceux des deux grands festivals de théâtre : «Quatre Chemins» et «En Lisant», qui se déroule du 9 au 19 décembre. Il est 13 h 50 dans la cour de l’Institut français en Haïti vendredi 13 décembre. L’escalier pour se rendre à sa salle de spectacle est bondé. Tous font la queue pour assister à la 9e édition du festival de théâtre En Lisant, qui se déroule à Port-au-Prince jusqu’au 19 décembre. «Je suis contente qu’il y ait eu une salle pleine de gens», dit à l’issue de la représentation la comédienne française Sylvie Laurent-Pourcel, invitée du festival, qui est en Haïti depuis septembre pour préparer le spectacle avec des artistes haïtiens. Organisé autour du thème «Et si c’était la fin», celui-ci se déroule dans un contexte difficile. Le pays fait face à une crise multidimensionnelle. La violence des gangs a fait plus de 700 000 déplacés internes selon l’Organisation internationale pour les migrations. Récemment, près de 200 personnes ont été massacrées à Cité Soleil, une commune tout près de la capitale, sous l’instruction d’un chef de gang. Face à toutes ces exactions, les artistes haïtiens veulent faire entendre leurs voix. «On a choisi ce thème parce qu’on veut passer en revue tout ce qui se passe dans le monde, explique Eliezer Guérismé, directeur artistique du festival. Il y a des crises partout. Il y a la guerre en Europe et en Asie, des massacres en Haïti. On a choisi cette thématique pour dire stop.» «On ne fait pas ça juste pour distraire, mais pour questionner» Malgré cela, les acteurs culturels n’entendent pas baisser les bras. Ils veulent redonner espoir aux gens et libérer la parole à travers leurs événements. «On doit continuer à faire du théâtre en Haïti dans ce contexte, parce qu’on ne fait pas ça juste pour distraire, mais pour questionner, affirme le metteur en scène, qui considère le théâtre comme un outil de combat. C’est pour cela que le staff du festival a sélectionné plusieurs textes d’auteurs qui font des problèmes du monde la toile de fond de leurs œuvres, parmi lesquels on peut citer “Juste la fin du monde” de Jean-Luc Lagarce et “Ça ne passe pas” de Claudine Galea.» Plusieurs artistes étrangers, un auteur français et d’autres artistes venant de la Martinique, de Belgique et de la Guadeloupe, dont la comédienne Anyès Noël, devraient rejoindre Sylvie Laurent-Pourcel pour le festival. Mais tout a changé le 11 novembre, lorsque la Federal Aviation Administration (FAA), régulatrice de l’aviation civile américaine, a interdit le survol d’Haïti après que des avions ont été touchés par balle. «On est obligé de faire certaines activités sur Internet pour leur permettre de participer, confie Eliezer. Philippe Violanti devait venir pour assister à la mise en scène de sa pièce de théâtre, mais il n’a pas pu.» L’auteur a animé son intervention en ligne le 12 décembre, autour du thème «Et si c’était la fin des guerres : que penserait le théâtre». «C’est un engagement qu’on prend» Sylvie Laurent-Pourcel, quant à elle, est une habituée du pays. Sa première visite en Haïti remonte à 2004 lorsqu’elle était venue pour adopter sa fille. Depuis, elle y fait des va-et-vient pour faire du théâtre ou des spectacles de marionnettes en collaboration avec des professionnels locaux. Elle n’était pas revenue en Haïti depuis 2020, mais elle a tenu à revenir en septembre malgré la grave crise sécuritaire. «Je n’ai pas peur. On m’a placée dans un lieu très calme. Je ne prends pas de risque non plus. Je sors quand il le faut. Donc, j’ai fait très peu de déplacements», rassure la marionnettiste. La comédienne devait retourner en France le 23 décembre mais la FAA a prolongé sa restriction sur la capitale haïtienne jusqu’en mars. Sylvie Laurent-Pourcel confie qu’elle n’a pas l’intention de changer son itinéraire pour pouvoir regagner son pays. Entre-temps, elle continue à travailler sur des projets artistiques. «J’ai la chance de travailler au lycée français. On m’a confié des stages de construction de marionnettes, de théâtre et d’éveil musical avec les enfants», informe-t-elle avec enthousiasme. Pendant son séjour, elle a déjà joué à deux reprises un spectacle pour les élèves du Lycée Alexandre-Dumas. La Française aime partager ses connaissances avec les autres, notamment les jeunes. Elle ne rate aucune occasion de le faire. Tout comme Eliezer Guérismé, elle plaide pour la pérennisation des activités culturelles en Haïti. «C’est un engagement qu’on prend. Parce que si ce festival n’existe pas, si le festival Quatre Chemins n’existe pas, il n’y aura plus rien au niveau de la culture pour les jeunes», a-t-elle conclu. Molière Adely / Libération Légende photo : De gauche à droite, Sylvie Laurent-Pourcel, Joseph Derilon Fils Derilus, Edouard Baptiste et Jenny Cadet, sur scène à l’Institut français en Haïti le 13 décembre 2024. (Louis Guerinault )

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 17, 2024 6:42 AM
|
par Ève Beauvallet dans Libération, publié le 16 déc. 2024 A rebours des annonces fracassantes de Christelle Morançais, qui doit faire voter jeudi 19 décembre son budget 2025, des élus régionaux lancent un chantier de réflexion sur le financement du secteur et le nécessaire renouvellement des politiques culturelles. Y aura-t-il un effet Christelle Morançais ? En annonçant avec décontraction des coupes inédites dans son budget culture 2025 (entre autres), la présidente (Horizons) de la région Pays-de-la-Loire a-t-elle ouvert la voie à d’autres collectivités, pressées de sabrer également les budgets mais aussi la légitimité d’un service public de la culture ? En attendant le 19 décembre, jour du vote à Nantes qui confirmera ou non la baisse de 100 millions d’euros (l’Etat n’en demandait que 40 %) annoncée le mois dernier, les regards convergent vers les autres régions et le secteur retient son souffle. Un soulagement s’est fait entendre le 12 décembre côté Bretagne. Par communiqué, le président, Loïg Chesnais-Girard (ex PS), envoyait une fléchette dans le mollet de Christelle Morançais, informant que, «à rebours des décisions prises par d’autres collectivités», le vote du budget 2025 confortait les crédits accordés à la culture, aux langues et aux sports. Avant d’ajouter, vibrant, épée en main, que «ces trois domaines essentiels pour notre qualité de vie et la cohésion sociale de nos territoires sont l’âme de la Bretagne». Seconde fléchette. Selon nos informations, seules les régions Bretagne et Bourgogne-Franche-Comté seraient en mesure de sanctuariser les crédits culture. Les autres anticipent toutes des baisses. Même si certains votes seront différés, comme l’espère le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), principal représentant des employeurs de la filière, qui appelait le 12 décembre au report de toute décision de coupes budgétaires motivées par un projet de loi de finances devenu caduc après la censure du gouvernement. «Sans nier la gravité des enjeux budgétaires […], tout plan d’économies nécessite au préalable de prendre le temps d’une réflexion responsable, afin que ces économies ne conduisent pas à l’effondrement de tout un secteur d’activité.» Les collectivités, premières financeuses de la culture Qu’ils soient finalement contraints ou non de revoir à la baisse leurs ambitions, plusieurs élus régionaux de tous bords n’entendent pas, en tout cas, porter l’infâme chapeau de fossoyeur des arts. Fin novembre, à la suite des prises de paroles populistes de Christelle Morançais, quatorze vice-présidents de région en charge de la culture s’exprimaient collectivement dans une tribune inédite lancée par Catherine Morin-Desailly, sénatrice centriste de Seine-Maritime, présidente déléguée de la commission culture de Régions de France. Parmi les signataires, l’ancienne directrice des Trans Musicales de Rennes Béatrice Macé, aujourd’hui en charge du portefeuille à la région Bretagne, mais aussi nombre de délégués culture du centre et de droite, comme Sophie Rotkopf (LR), vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui compte désormais dans son bilan les coupes massives dans les budgets culture ordonnées par Laurent Wauquiez en 2023. Ensemble, ces élus régionaux refont d’abord de la pédagogie : les collectivités sont aujourd’hui les premières financeuses de la culture. Seulement, l’Etat ayant réduit leur dotation et engagé maintes réformes, leurs caisses sont vides. Dès lors, «sans marges de manœuvre, dans l’obligation de voter des budgets à l’équilibre, les collectivités se retrouvent dans l’impossibilité d’aider la grande majorité des acteurs culturels». Tout ce qui a été tissé en termes de service public de la culture, s’alarment-ils, risque donc de «se désintégrer massivement». Partant de là, on se pend ? Pas tout à fait. Dirigeant leur regard vers les Pays-de-la-Loire, ces élus régionaux déplorent le «renoncement» et le «fatalisme» et assurent ne vouloir ni baisser le niveau d’ambition en matière culturelle, ni renoncer «au rôle éminent joué par l’artiste au cœur de la société». Ce désaveu discret des discours de Christelle Morançais a-t-il de quoi embarrasser Edouard Philippe, qui ne cache plus ses ambitions pour la présidentielle ? Rires jaunes dans l’assemblée : le 9 décembre, Christelle Morançais était, bien au contraire, nommée vice-présidente du parti Horizons, comme s’en scandalisent aujourd’hui plusieurs syndicats dans Libération. Aussi, c’est finalement moins aux discours populistes de la présidente des Pays-de-la-Loire que les élus régionaux s’en prennent qu’à la politique gouvernementale, elle qui tarderait tant à poser les «vraies» questions. Sauvegarder notre «exception culturelle» Extrait : «L’Etat a fait preuve de son incapacité, voir sa réticence, à encourager une réelle décentralisation.» Pourquoi de simples mesurettes ou autres «plans» quand tous les indicateurs montrent depuis des années l’impasse qui se profile ? Pourquoi autant de budget pour inciter les jeunes à découvrir des œuvres alors que celles-ci n’auront bientôt plus les moyens d’être produites (le Pass Culture) ? Pourquoi un tel manque de continuité dans l’action du ministère (aucun ministre n’est resté en poste plus de dix-sept mois ces dix dernières années) ? Pourquoi les lieux culturels labellisés par l’Etat ont-ils toujours le même cahier des charges qu’il y a trente ans alors que les pratiques, les coûts, les besoins et la société ont changé ? La surproduction d’œuvres, sitôt créées, sitôt balayées, est programmée dans tous les cahiers des charges. Par exemple, la subvention que perçoit un artiste est chaque année conditionnée à la production d’une nouvelle création. Les structures culturelles, de leur côté, sont toujours évaluées sur leur capacité à présenter tant de spectacles par saison, au lieu de l’être, par exemple, sur un axe de développement et de présence artistique auprès des habitants. A contrario d’un Etat jugé attentiste, ces vice-présidents de région annoncent donc se saisir publiquement et nationalement du sujet, dans une tentative de sauvegarder ce qu’il reste de notre «exception culturelle». Bonne nouvelle ? Le Syndeac participe en tout cas depuis quinze jours à ces réflexions en lien avec Régions de France, et se félicite de voir des élus lancer le débat. Un bémol néanmoins : la question centrale de la «décentralisation culturelle» appellera «de toute évidence de notre part à une très grande réserve», de façon à se prémunir d’un clientélisme politique déjà observé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Des auditions seront ainsi menées, avec restitution au prochain Congrès des régions à l’automne 2025, auprès de divers acteurs culturels. Si, d’ici là, il en reste quelques-uns. Eve Beauvallet / Libération Légende photo : Mobilisation devant l'hôtel de région des Pays-de-la-Loire, à Nantes, pour protester contre les coupes budgétaires dans le secteur culturel, le 25 novembre. (Estelle Ruiz /Hans Lucas. AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 15, 2024 3:06 PM
|
Par Sandrine Blanchard et Rosita Boisseau dans Le Monde, publié le 16 déc. 2024 Cette forme théâtrale menée par des conférenciers-comédiens-vulgarisateurs, qui abordent les sujets les plus variés sur un mode ludique ou poétique, connaissent un succès grandissant. https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/12/15/les-conferences-spectacles-ou-l-art-de-se-cultiver-en-s-amusant_6450242_3246.html
« Je suis un chercheur en science de la représentation et vous êtes mon échantillon », annonce Jérôme Rouger à l’attention du public. Sur la scène du Théâtre de Belleville, à Paris, fiches Bristol en main et paperboard installé à ses côtés, le comédien délivre, en ce mois de décembre, ses Conseils aux spectateurs, titre de sa nouvelle et facétieuse conférence-spectacle. Ce n’est pas la première fois que cet auteur s’empare de ce genre théâtral en plein essor, qui requiert une bonne maîtrise de l’art de l’éloquence. Dans Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie – autre « conférence spectaculaire » qu’il reprend dans la même salle –, Jérôme Rouger se mue en « directeur de l’Ecole d’agriculture ambulante » pour s’interroger, entre données véridiques et humour délicieusement absurde, sur les droits de la poule et les conditions de vie de l’œuf. La démarche « à la fois scientifique et poétique » de cet acteur poitevin rejoint celle de nombreux artistes qui, depuis cinq ans, cartonnent sur le front de ce format scénique particulier nommé conférence-spectacle théâtrale, dansée ou performative. Entre références documentées et illustrations scéniques, ces performances au ton mi-docte, mi-piquant donnent des informations toujours bonnes à prendre sur un ton ludique, faisant passer crème un contenu parfois complexe. De l’histoire du graff au féminin ou de la vie de la marmotte, de l’océan et son réchauffement climatique au fil de fer barbelé, ou encore à la boule de cristal, les sujets les plus variés et insolites sont à l’affiche. Aux manettes de ces moments didactiques, pédagogiques et spectaculaires dont on ne sort jamais idiot, le chorégraphe Jérôme Bel, le metteur en scène François Gremaud, l’historienne de l’art et comédienne Hortense Belhôte, l’agrégé de géographie formé en climatologie Frédéric Ferrer, l’auteur David Wahl, l’acrobate Matthieu Gary ou encore les ex-enseignants Arnaud Hoedt et Jérôme Piron dispensent un savoir bien digéré, le rendant accessible en nous enchantant. « Populariser des concepts pointus » « Mon premier métier, c’est prof, mon premier plaisir, c’est de parler à un auditoire. Se retrouver à réfléchir avec le public, c’est merveilleux », confirme Clément Viktorovitch. Ce docteur en science politique, auteur et chroniqueur, fait depuis quelques mois l’expérience des planches avec un succès non démenti, pour un seul-en-scène en forme de conférence, qui reprend son sujet de prédilection : la rhétorique et l’analyse du discours politique. « La scène est une incartade passionnante, le spectacle est joyeux, mais tendu vers un propos qui ne l’est pas », assure-t-il. Cette conférence politique où il se met dans la peau d’un conseiller présidentiel représente, à ses yeux, une « forme artistique plus riche que les contenus didactiques ou académiques, car elle permet non seulement de faire comprendre, mais aussi, grâce au ressenti, de faire prendre conscience ». Les profils éclectiques de ces nouveaux conférenciers, leurs thématiques diverses, ont des enjeux communs. L’intrépide Hortense Belhôte, qui fit sa première intervention intitulée L’Université du bazar, en 2010, pour un festival étudiant au Théâtre du Rond-Point, à Paris, le résume ainsi : « L’objectif est de populariser des concepts pointus, souvent pensés par des universitaires ou des minorités, de manière ludique et documentée, en bousculant les hiérarchies culturelles. La conférence spectaculaire joue sur le plaisir de piéger notre propre culture dans une perspective, en ce qui me concerne, volontiers féministe, queer et libertaire. » Même ton engagé chez le metteur en scène, acteur et dramaturge suisse François Gremaud, dont la trilogie conférencielle composée des solos Phèdre ! (2017), Giselle… (2021) et Carmen (2023) tourne non-stop : « Il y a, chez moi, une volonté de mettre en partage des informations en tentant de démocratiser et dédramatiser aussi l’accès aux cultures savantes. » Pour susciter l’écoute et sensibiliser à des thèmes qui peuvent apparaître délicats, les ingrédients sont multiples. Si les références et les connaissances, dûment vérifiées, cimentent les propos des unes et des autres, chacun impose ensuite son style plus ou moins performatif et débridé. Pour Hortense Belhôte, qui signe une nouvelle conférence, 1664, entrelaçant la saga du ballet classique et l’addiction, entre autres, à la bière 1664, il s’agit de conjuguer « un peu d’histoire, des éléments autobiographiques, de la pop culture, avec une dramaturgie de l’effeuillage, car tout passe par [son] corps ». Selon David Wahl, toujours en tournée avec, notamment, La Visite curieuse et secrète, autour des fonds marins, le mélange est celui de « l’enquête subjective avec de l’humour et de l’émerveillement, dans une langue singulière ». Humour indispensable Evidemment, l’humour est indispensable. A condition qu’il soit subtilement dosé afin, comme le résume Jérôme Rouger, « qu’il n’écrase pas le fond ». Pour Conseils aux spectateurs, il s’appuie sur sa propre expérience pour livrer une sorte d’étude sur le public – son rôle, ses attitudes, ses rituels, sa sociologie, ses réactions –, à la fois désopilante et parfaitement observée. « Qu’il soit poétique ou absurde, l’humour est essentiel. Sur les questions climatiques et écologiques, le plus gros danger est d’avoir un discours moralisateur », constate Frédéric Ferrer. Il se souviendra longtemps de cette réflexion d’un spectateur, à l’issue d’une représentation : « Il m’a dit : “Vous devriez faire du théâtre.” J’ai adoré ! » Les enjeux de ces conférences sont variés. Si certains, comme Hortense Belhôte ou David Wahl, répondent souvent à des commandes, d’autres se projettent sur des sujets qui leur sont chers. Lorsque Matthieu Gary, de la compagnie de cirque La Volte, imagine la conférence Faire un tour sur soi-même, en 2022, il a d’abord envie de « faire entendre un corps d’acrobate qui pense ». « Les arts de la piste sont malheureusement très peu documentés, et rares sont les acrobates qui prennent la parole pour évoquer leur technique et leur travail très introspectif, dit-il. Entre la pratique et l’expérience du mouvement, je voulais amener une réflexion sur ce que je fais. » Tenir les rênes d’un texte en conférencier-acteur n’est pas une mince affaire. Cela exige d’endosser différents rôles, dont celui de chercheur et d’écrivain. Pour élaborer Faire un tour sur soi-même, Matthieu Gary a passé un an à la table à retracer son parcours, son enfance, ses choix. Il se nourrit d’analyses de philosophes, s’immerge dans des manuscrits du XVIe siècle pour évoquer la représentation du corps, pour finir avec un texte d’une centaine de pages, réduit à 30, avec la complicité de l’autrice Alice Zeniter. Tout le travail de Frédéric Ferrer repose sur une recherche documentaire et des rencontres avec des spécialistes à partir desquelles il approfondit une question et partage ses réflexions. Ses « conférences décalées » sont à la fois érudites et drolatiques. Que ce soit sur le changement climatique (A la recherche des canards perdus, en 2011) ou sur les épreuves mythiques des Jeux olympiques (Olympicorama, en 2024), il navigue sur scène entre son pupitre, son grand écran et manie avec talent ce qu’il nomme la « dramaturgie du PowerPoint ». « Ce n’est pas un cours, mais une lecture étonnante, un chemin de traverse qui fait regarder un sujet autrement, dans le but d’aiguiser la curiosité », souligne-t-il. Simplicité du dispositif La conférence-spectacle pour apprendre et susciter ou éclairer le débat différemment, c’est aussi le credo d’Arnaud Hoedt et de Jérôme Piron. Ils se régalent d’entendre des spectateurs leur glisser, à la sortie de leur spectacle : « Je n’avais jamais pensé à ça. » Leurs deux créations, La Convivialité ou la faute de l’orthographe, consacrée aux pièges de la langue française, ou Kevin, qui explore les inégalités du système éducatif, font gamberger, de manière divertissante, sur des sujets qui parlent à tout le monde. Pour le duo, qui a quitté l’enseignement depuis quatre ans, ces spectacles sont aussi une autre manière de transmettre. Si certains assument tranquillement le terme et la fonction de conférencier, revue et pas mal corrigée, d’autres les questionnent. Lorsque Jérôme Bel, dès 2004, évoque le ballet classique dans le solo Véronique Doisneau, à l’Opéra de Paris, la danse royale thaïe avec Pichet Klunchun and Myself (2005) ou les Danses non humaines (2023), au Louvre, avec Estelle Zhong Mengual en conférencière, il met en scène des formats conférenciels mais n’utilise jamais le mot. « J’ai toujours présenté ces œuvres comme des spectacles à part entière, insiste-t-il. La conférence est, pour beaucoup, rebutante. Mais, paradoxalement, les pièces utilisant ce format ont été des succès publics, car les gens adorent apprendre et comprendre. » François Gremaud préfère, lui, se définir comme un « conteur qui partage son étonnement sur les choses ». « Le mot “conférence” me fait peur par son côté rébarbatif, mais je reconnais que je dois beaucoup à cette figure du conférencier, précise-t-il. Si j’évite le PowerPoint, j’emprunte beaucoup à sa posture mâtinée de distance brechtienne. » Quant à David Wahl, il a opté pour la « causerie ». Quelle que soit l’étiquette qu’on lui appose, « ce genre théâtral permet d’attirer un public plus large », affirme Frédéric Ferrer. Grâce à la simplicité du dispositif, ces conférenciers-comédiens-vulgarisateurs peuvent jouer dans de multiples lieux, « de la salle des fêtes au Centre Pompidou », indique-t-il. Arnaud Hoedt et Jérôme Piron sont régulièrement demandés dans des centres de formation de professeurs, dans des écoles ou des facultés. Hortense Belhôte collabore avec différentes universités « qui, elles aussi, ont développé des modes de vulgarisation ». Le « je » du jeu conférenciel entraîne l’effondrement du quatrième mur et un autre rapport au public. « Je m’intéresse de plus en plus à la relation de domination entre le sachant et l’apprenant, mais aussi à la manière d’impliquer les spectateurs différemment », explique Jérôme Rouger. Dans Conseils aux spectateurs, le public devient le sujet même de la réflexion, et le processus fonctionne. Dans Kevin, les deux professeurs belges invitent à répondre à des questions pour enrichir leur propos. « Par rapport au monde théâtral, ces conférences particulières apportent une forme de fraîcheur qui sort de l’entre-soi pour s’adresser à tous », note Arnaud Hoedt. Conseils aux spectateurs et Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie, écriture, jeu et mise en scène de Jérôme Rouger. Théâtre de Belleville, Paris 11e, jusqu’au 28 et 30 décembre. L’Art de ne pas dire, de Ferdinand Barbet et Clément Viktorovitch, avec Clément Viktorovitch. Théâtre Saint-Georges, Paris 9e, jusqu’au 20 décembre ; Le 13e Art, Paris 13e, du 13 janvier 2025 au 28 avril. Toutes les dates sur Clemovitch.com Atlas de l’anthropocène, Wow, cartographie 5, de et avec Frédéric Ferrer. Centre Pompidou, Paris 4e, le lundi 16 décembre, à 19 heures. A la recherche des canards perdus, de et avec Frédéric Ferrer. Service culturel de Maisons-Laffitte (Yvelines), le vendredi 10 janvier 2025, à 20 h 30. Olympicorama, épreuve 15. Le breaking et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur d’autres choses, de et avec Frédéric Ferrer. Maison de l’université, Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), le mardi 21 janvier 2025. Toutes les dates sur Verticaldetour.fr Kevin, conception, jeu et écriture d’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Théâtre de l’Ancre, Charleroi (Belgique), du 21 au 25 janvier 2025 ; La Rose des vents, Villeneuve-d’Ascq (Nord), les 4 et 5 mars ; Festival « off » d’Avignon, en juillet. Et la marmotte ?, d’Hortense Belhôte. L’Etincelle, Rouen, le 17 décembre. Portraits de famille, d’Hortense Belhôte. Musée des beaux-arts, Tours, les 15 et 16 janvier 2025 ; TU, Nantes, les 10 et 11 mars. Toutes les dates sur Hortensebelhote.com 1664, d’Hortense Belhôte. Université Sorbonne Nouvelle-Paris-III (Festival d’automne), Paris 12e, le 29 janvier 2025 ; université Paris Cité (Festival d’automne), Paris 6e, le 30 janvier. Festival-automne.com Histoire spirituelle de la danse, de David Wahl. Château de Villers-Cotterêts (Aisne), le 18 janvier 2025 ; Théâtre de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), les 28 et 29 janvier. La Visite curieuse et secrète, de David Wahl. L’Avant-scène, Cognac (Charente), le 21 mars 2025. Toutes les dates sur Davidwahl.fr Faire un tour sur soi-même, de et avec Matthieu Gary. Au Plus Petit Cirque du Monde, Bagneux (Hauts-de-Seine), du 1er au 4 avril 2025. Toutes les dates sur Lavolte-cirque.fr Allegretto, de et avec François Gremaud. Théâtre de la Cité, Toulouse, jusqu’au 20 décembre. Giselle…, de François Gremaud. Scènes Vosges, Epinal, le 14 janvier 2025 ; Salle Europe, Colmar, le 16 janvier. Carmen, de François Gremaud. Le Phénix, Valenciennes (Nord), les 21 et 22 janvier 2025. Toutes les dates sur 2bcompany.ch Conférence sur rien, de Jérôme Bel. Conservatoire de Rennes, le 25 janvier 2025. Recommencer ce monde (les créatures fabuleuses), de Jérôme Bel. Bonlieu scène nationale, Annecy, du 29 au 31 janvier 2025. Sandrine Blanchard et Rosita Boisseau / Le Monde Légende photo : Jérôme Rouger, dans « Conseils aux spectateurs », à La Coursive de La Rochelle, le 3 septembre 2024. ZEF

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 15, 2024 1:55 PM
|
Tribune de Philippe Torreton publiée dans Le Monde - 15 déc. 2024 Le comédien réagit, dans une tribune au « Monde », à l’annonce faite par la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morançais, de sa volonté d’économiser 82 millions d’euros dans le budget 2025 de la région, et 100 millions à l’horizon 2028, en amputant notamment le financement de la culture. Lire l'article sur le site du Monde : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/12/15/philippe-torreton-je-ne-savais-pas-qu-un-tel-mepris-envers-le-monde-culturel-et-associatif-pouvait-s-assumer-avec-cet-aplomb_6449908_3232.html
C’est sans fin. Il faut encore et encore répéter à des élus régionaux et nationaux l’importance et la nécessité de notre tissu culturel et associatif, les emplois qu’il crée, l’activité économique qu’il génère. Justifier, se justifier, nous justifier… Raconter encore et encore notre histoire commune, et je dirais même l’histoire de l’humanité, car, depuis l’aube humaine, nous avons toujours eu à cœur de protéger les artistes afin qu’ils nous peignent, écrivent, chantent, dansent, jouent et rejouent le monde tel qu’il est, tel qu’il pourrait être ou encore tel qu’il a été. Ce que les Néandertaliens et leurs cousins avaient compris, Christelle Morançais, la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, membre du parti Horizons d’Edouard Philippe, ne le comprend visiblement pas ou, pire, feint de ne pas le comprendre. Cette personne insinue en un élan populiste que ne bouderait pas Donald Trump que le monde de la culture ne serait qu’une niche de gens gâtés qu’il serait grand temps de confronter au réel, afin, dixit, qu’ils se réinventent. Alors que le précédent gouvernement lui a suggéré une économie de 40 millions d’euros et, le doigt sur la couture du pantalon, elle répond qu’elle poussera jusqu’à 82 millions dès 2025 et 100 à l’horizon 2028. Oui, 100 millions d’euros ! C’est-à-dire une amputation à vif de 73 % du budget de la région consacré à la culture, de 75 % de celui réservé au sport et de 90 % de celui à l’égalité femmes-hommes. Pour le bien commun Chère Madame, la culture est un secteur économiquement porteur pour un territoire, mais, et je reconnais que cela est compliqué pour vous, l’écosystème culturel n’affiche pas ses résultats et ses perspectives économiques, tout cela est imbriqué et dilué dans l’activité du pays et, pour s’en rendre compte, il faut, il est vrai, travailler un minimum le sujet. Nous n’avons pas de CAC 40, ni de grands patrons proches du pouvoir, pas de sommets internationaux sécurisés, pas de jets privés, ni de chaîne de télévision aux ordres… Mais je peux vous assurer pourtant que ça travaille, et ça travaille dur pour le bien commun. Et si l’on doit parler de « réinvention », c’est plutôt à vous et à vos amis politiques qu’il reviendrait de faire cet effort et ce de toute urgence. Le monde s’écroule par pans entiers et rien de sérieux ne sort de vos programmes et de vos réunions, votre système de pensée semble être figé dans l’ambre jaune d’un capitalisme préhistorique. Je ne savais pas qu’en 2024 une telle opinion, un tel mépris envers le monde culturel et associatif pouvait, non seulement se concevoir, mais également s’assumer avec cet aplomb que doit certainement autoriser l’ignorance débridée. Nous connaissons maintenant le projet culturel du candidat à l’élection présidentielle Edouard Philippe, son silence est éloquent et vaut approbation. Philippe Torreton (Comédien)
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...