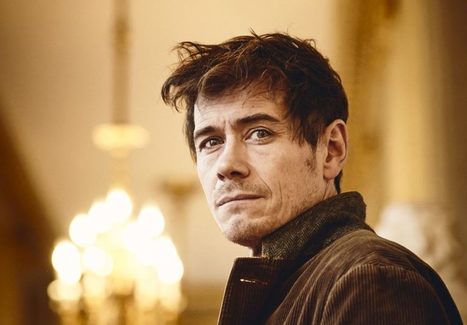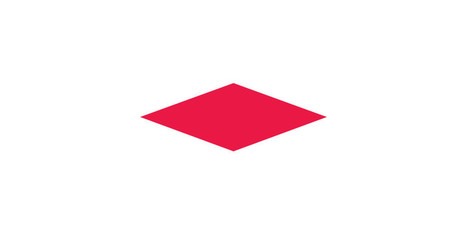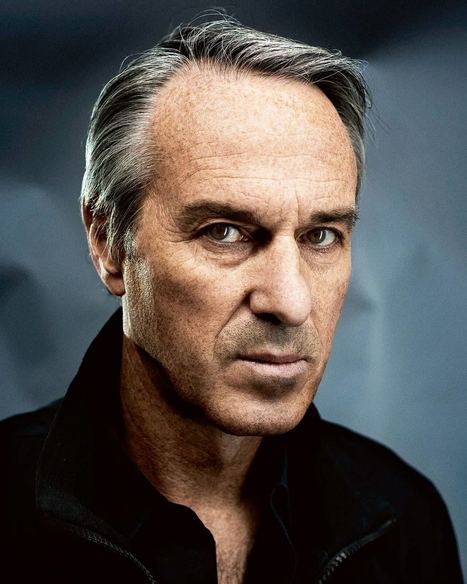Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 25, 2024 12:43 PM
|
Par Laurent Goumarre dans Libération - 25 mars 2024 Adaptée d’un roman de Marieke Lucas Rijneveld, la pièce du metteur en scène belge décortique une mécanique pédocriminelle à la Villette à Paris. Elle a 14 ans, Kurt en a 49. Elle n’a pas de prénom, désignée dans la distribution comme «la fille». Décidément, quelque chose ne va pas. Son père est fermier, il se tait depuis la mort du petit frère. Elle se rêve rock star comme Kurt Cobain, fascinée par le «club des 27» ; mourir jeune et reconnue, elle a encore le temps, alors elle se rappelle la lettre d’adieu du chanteur avant son suicide, quelque chose comme : «Il y a du bien en nous tous, et je pense que j’aime trop les gens tellement que ça me rend triste.» Heureusement, il y a Kurt, le vétérinaire, marié, un enfant, qui fait de la mob sur le plateau, emmène La Fille danser, c’est de leur âge. Kurt comme Cobain, c’est un signe. Un type sympa avec qui partager ses rêves, chanter un Total Eclipse of the Heart de circonstance en se marrant, se coucher dans la paille pour regarder ensemble le ciel, les nuages, les merveilleux nuages qui passent sur l’immense écran panoramique au-dessus de la scène. Le père, lui, écoute Vivaldi, il n’a encore rien compris. Et puis un jour, on annonce «le petit taureau est mort» à cette Agnès de la campagne. L’orage éclate sur la vidéo, sur scène, on a changé de disque, c’est I Will Always Love You qu’ils gueulent tous les deux, «We both know I’m not what you, you need», – «nous savons tous les deux, que je ne suis pas celui /celle qu’il te faut». Elle 14 ans, Kurt 49, sous la pluie qui inonde le plateau. C’est un jeu pour La Fille qui mime la star sous les éclairs comme dans un clip avec son pote le véto. Ça ne l’est plus du tout pour Kurt, avec passage à l’acte : le baiser. Forcément, puisqu’ils se comprennent, qu’ils sont complices, le baiser c’est ce qu’on fait quand on «always love you». Point de vue Mais ça, c’est le discours de Kurt, qu’il s’est construit depuis des années à visiter le père de La Fille pour soigner ses vaches. C’est son point de vue pédophile, qui s’exerce dans le roman, best-seller controversé en 2021, de Marieke Lucas Rijneveld – 23 ans, écrivain·e non-binaire, premier·ère romancier·ère néerlandais·e à remporter le Booker International Prize – de la même manière qu’Humbert Humbert était le narrateur du Lolita de Nabokov. Cette histoire d’amour, c’est ce qu’il se raconte, Kurt, 49 ans quand même, avec un passé qu’on découvre traumatique dans des scènes de violence sexuelle sous la domination d’une mère incestueuse. Le roman était la confession écrite en prison de Kurt. Encore une parole de prédateur, s’était-on offensé à sa sortie. Dans un entretien, Marieke Lucas Rijneveld expliquait ce choix : «Ce roman est en partie basé sur mon vécu. J’ai connu une situation plus ou moins similaire, mais je ne pensais pas écrire sur le sujet. J’ai choisi le vétérinaire comme narrateur, car il aurait été trop difficile pour moi, trop proche, de devenir la narratrice, d’expliquer que la jeune fille a laissé les choses se passer…» En adaptant le texte sur scène, Ivo Van Hove déplie magnifiquement la parole de La Fille et fait entendre ce que Rijneveld ne pouvait alors écrire : son théâtre a guéri le roman. Responsable La force de la mise en scène est de juxtaposer sur le plateau à découvert, sans changement de décor, ni de comédiens, l’enfance violée de Kurt et celle de La Fille. Ça n’excuse pas le baiser, ni le reste, ça montre qu’il y a deux enfants sur le plateau, mais avec des années de différence, et ça, ça fait interprétation. D’ailleurs voilà Freud qui débarque en personne dans la ferme. Y a du boulot au vu de ce qui se dit : «Il y a en moi un petit garçon démuni qui aimerait tant jouer avec toi… Tu me fais sentir jeune et je suis sûr que tout ça est arrivé à cause de ma mère… Elle m’a laissé une blessure durable que j’essaie de guérir grâce à toi…» La Fille, puisqu’il est admis qu’elle n’a pas de nom – comment en aurait-elle un quand elle n’est qu’instrument de réparation ? Donnons au moins celui de la jeune comédienne, excellente : Eefje Paddenburg – va devoir alors prendre tout sur elle. Quatorze ans et responsable de tout : de Kurt et de sa mère aux jambes écartées, mais aussi de la mort violente de son petit frère, du silence du père qui regarde passer les Saisons chez Vivaldi, des vaches malades qu’on va devoir abattre, du «petit taureau [qui] est mort», et puis le 11 Septembre, c’est elle, elle le sait ; la mort de Jésus, toujours elle. Qu’en dit le Freud qui s’avance pour la deuxième fois sur le plateau ? On a noté dans le noir de la salle, pour ne rien perdre, quelque chose comme : «Il faut aimer quelqu’un pour ne pas tomber malade. Au bout du compte, ça se résume à ça : les gens tombent malades quand ils ne peuvent pas aimer.» Mon Bel Animal, d’après le roman de Marieke Lucas Rijneveld, mise en scène d’Ivo van Hove, du 28 au 30 avril, Grande Halle de la Villette, Paris Légende photo : Katelijne Damen, Hans Kesting et Eefje Paddenburg dans «Mon Bel Animal». (Jan Versweyveld)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 28, 2021 3:46 PM
|
Par Brigitte Salino dans Le Monde - 27 nov. 2021 Dans « Age of Rage », présenté à La Villette à Paris, le metteur en scène flamand réunit dans un spectacle haletant des tragédies d’Euripide et de Sophocle. Et voilà que revient l’éternelle question de la vengeance, sous le regard des dieux. Elle éclate dans Age of Rage, à voir à la Grande Halle de La Villette à Paris, jusqu’au 2 décembre. Cette nouvelle création d’Ivo van Hove arrive d’Amsterdam, où le metteur en scène a dirigé la fameuse troupe de l’Internationaal Theater. A sa manière, elle poursuit le chemin d’Electre/Oreste, qu’Ivo van Hove a mis en scène à la Comédie-Française, en 2019. Les deux pièces d’Euripide étaient présentées dans la même soirée et dans la foulée, comme si elles n’en faisaient qu’une. On les retrouve dans Age of Rage, où elles sont jouées avec Iphigénie, Les Troyennes, Hécube et Agamemnon, toujours dans la même soirée, mais en néerlandais (surtitré) cette fois. Ainsi se rejoignent Euripide et Eschyle, ou, pour être plus juste, Euripide, Eschyle et Ivo van Hove. Car, dans cet Age of Rage, les tragédies antiques sont un socle sur lequel s’appuie le metteur en scène. L’adaptation qu’il cosigne avec Koen Tachelet est une pièce en soi : en 3 h 45, elle épouse le récit brut de la violence qui s’abat sur les Atrides, après que deux frères, Atrée et Thyeste, se sont déchirés pour le pouvoir. Une violence sans nom, sinon celui de malédiction, qui se nourrit de la vengeance, entraîne la guerre de Troie et déploie un effroyable cortège de parents sacrifiant leurs enfants ou les mangeant, de mères qui donnent naissance à leurs assassins, de frères et sœurs déchiquetés par la haine ou la folie. Sans répit Ivo van Hove se montre sans pitié. Il condense les tragédies d’Euripide et d’Eschyle en une tragédie, celle des mécanismes de la violence, qu’il exacerbe jusqu’à la transe. Des musiciens et un chœur de danseurs, dirigés par Wim Vandekeybus, rythment la représentation d’une manière frénétique. Des résumés et des généalogies sont écrits sur le mur du fond, le texte est direct, les images sont simples : Ivo van Hove guide les spectateurs pour mieux les entraîner dans un courant vertigineux. Age of Rage ne laisse aucun répit. On entend Iphigénie dire à son père : « Ne me tue pas, la lumière est si douce », comme si la supplique venait d’un autre monde. On n’est pas surpris de lire, devant Mycènes : « Qui dévaste les tombeaux et les temples tombera à son tour », comme si aujourd’hui rejoignait hier. On est happé par l’engagement et le talent des comédiens, Hans Kesting (Agamemnon) et Chris Nietvelt (Clytemnestre) en premier. Tout contribue ainsi à faire d’Age of Rage un spectacle haletant, mais qui pourtant laisse sur sa faim. Il lui manque une respiration qui permette de souffler entre les assauts de la violence : on subit la tragédie sans pouvoir la sublimer. Age of Rage, d’après Euripide et Eschyle. Adaptation de Koen Tachelet et Ivo van Hove. Mise en scène Ivo van Hove. Avec la troupe de l’Internationaal Theater Amsterdam. Grande Halle de La Villette, 211, avenue Jean-Jaurés, Paris 19e. Tél. : 01-40-03-75-75. Mardi, mercredi, jeudi et samedi, à 19 heures ; dimanche à 15 heures. De 12 € à 35 €. Durée : 3 h 45. En néerlandais surtitré. Jusqu’au 2 décembre. Brigitte Salino Légende photo : « Age of Rage » d’après Euripide et Eschyle, adaptation de Koen Tachelet et Ivo van Hove. JAN VERSWEYVELD

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 10, 2019 4:03 PM
|
Entretien avec Loïc Corbery, dans le feu de l’action
Propos recueillis par Laetitia Heurteau 9 Mai 2019
Ce temps qui passe aussi vite, cela fait froid dans le dos. Ma première interview avec Loïc Corbery date déjà de quinze ans. A l’époque, il n’était pas encore entré à la Comédie-Française où il est à présent sociétaire. Cette année, on a déjà pu le voir à plusieurs reprises sur scène : dans l’intimité du Studio Théâtre pour son Hamlet à part, sur la scène de l’Odéon pour Le Pays Lointain de Jean-Luc Lagarce, sans oublier les bonnes vieilles planches de la salle Richelieu pour la reprise des Damnés et la création d’Electre / Oreste par le même Ivo Van Hove. Retrouvailles au café Nemours, au lendemain du tragique incendie de Notre-Dame.
Tu as repris Les Damnés tout récemment, salle Richelieu, comment as-tu vécu cette incroyable aventure ?
Hier soir quand Eric Génovèse entre en scène en disant « Le Reichstag est en flammes », et que Notre-Dame est entrain de brûler à quelques kilomètres de la Comédie Française, ça n’est pas anodin.
Mais avec Les Damnés, il y a toujours un écho surprenant avec l’actualité du monde : que cela soit au moment de sa création au Festival d’Avignon, lors de la deuxième représentation, le soir de l’attentat de Nice, où le Président Hollande a quitté précipitamment la salle à 21h50. On ne savait pas trop ce qui se passait. On l’a appris pendant le spectacle. Et en sortant, c’était assez assourdissant !
On l’a repris l’année d’après, salle Richelieu pendant la présidentielle avec la montée du Front national. Et après on est allé le jouer l’été dernier à New York, dans l’Amérique de Trump.
« Le Reichstag est en flammes ! ». Ce spectacle a un tel écho… Et il est nécessaire pour ça !
C‘était comment de le jouer à New York ?
New York n’est pas l’Amérique. New York, c’est New York. C’est un bout d’Europe aux États-Unis. L’impact de ce spectacle sur le public a été très fort parce que l’histoire de l’Amérique aujourd’hui a des relents nauséabonds. Mais nous-mêmes, on réentendait ce qu’on racontait. On retrouvait le sens de ce qu’on disait. Il y avait un tel vertige à dire, notamment ce que disait mon personnage…
Il est justement très singulier ton personnage dans l’intrigue…
C’est le témoin et c’est celui qui parle directement aux gens pour leur dire : on n’est pas en train de vous raconter une histoire. On est en train de vous raconter notre histoire, ce qui se passe de nouveau aujourd’hui. On vous parle de l’Allemagne de 1933 mais aussi de la France, des États-Unis, du monde.
En ce moment, tu es dans une période incroyablement prolifique où tu joues dans plusieurs projets à la fois…
En fait, ça reste rationnel parce que toutes ces belles choses s’enchaînent, elles ne se mélangent pas trop, donc ça va : entre Hamlet à part, Le Pays lointain, la reprise des Damnés et là Electre/ Oreste.
Si on peut revenir sur Hamlet à part, que tu as monté et joué sur la scène du Studio Théâtre en février dernier. J’ai été frappée quand tu disais que c’était vraiment le rôle que tu voulais jouer mais que tu sentais que tu n’allais pas forcément un jour le jouer. Tu t’étais ainsi emparé de l’idée du comédien qui se prépare au rôle. Mais c’est un rôle que tu pourrais tout à fait jouer, en fait ?
C’est un rôle que je pourrais tout à fait jouer et que je vais peut-être jouer mais en revanche, c’est un rôle que je n’avais jamais rêvé de jouer. Jamais. Autant la pièce Hamlet me passionnait, autant le rôle lui-même, moins. Alors que Perdican ou Alceste étaient des rôles que je rêvais d’interpréter. Mais je t’avoue qu’après avoir bossé beaucoup dessus et l’avoir traversé un peu dans ce spectacle, là j’aurais très envie à présent de le jouer !… (Rires)
Ce Hamlet à part te raconte aussi de manière presque intime…
Tout à fait, en prenant en charge Hamlet et tout ce qui pour moi faisait écho à Hamlet, dans le théâtre et dans la littérature ; en en faisant un montage (et c’est une écriture, le montage !) ; de tout ça, je ne faisais que me raconter, moi, et me raconter très intimement. Dans mes racines de théâtre, intimes, d’homme…
Avignon est très présent dans le spectacle comme Avignon est très présent dans mon enfance. J’ai en effet puisé beaucoup dans mon enfance. Et je ne m’en suis rendu compte qu’après, par exemple, en utilisant le vinyle et les cassettes comme accessoires, comme partenaires. En fait, j’avais reconstitué le salon de mes parents quand j’étais petit…
Je t’ai imaginé tout seul lors des répétitions… Ce n’est pas un peu flippant la solitude dans la création ?
C’est assez excitant aussi. En fait, ce qui était vertigineux, c’était le soir de la première : être seul en coulisse, prendre en charge pour la première fois un moment de théâtre avec les gens, dans une relation immédiate et directe avec eux. C’était un vrai vertige, qui m’a pris tous les soirs aux tripes avant de jouer. Et en même temps l’écho, la récompense, le retour en est d’autant plus beau pendant et après le spectacle…
Peux-tu nous parler des répétitions du spectacle Oreste/Electre auquel tu te prépares avec la troupe en ce moment ?
C’est déjà un grand bonheur que de retrouver Ivo Van Hove, et que ce très grand metteur en scène souhaite retravailler avec moi. Dans Les Damnés, je suis un peu à côté du chaos. Je suis un peu le contrepoint de cette folie familiale; autant là, j’accompagne et même, je provoque le désastre.
C’est intense comme toujours avec Ivo : on a un temps de répétitions qui est ramassé, d’une intensité folle, tous ensemble réunis, acteurs, techniciens, musiciens et en effet le rythme de travail est rude. Je ne vais pas trop dévoiler mais je joue Pylade, l’ami fidèle qui accompagne Oreste dans son errance, dans ses tourments…
Dans ton emploi du temps, les répétitions se passent tous les après-midis ?
Oui, tous les après-midi de 13h à 17h. Et comme il y aura aussi beaucoup de musique de chorégraphie, on a aussi des séances de travail sur le corps et sur le chant.
Comme tous les spectacles d’Ivo, c’est un spectacle viscéral, qui pour atteindre le sens, passe par tous les sens. Tout le corps du spectateur est sollicité.
Tu peux proposer des choses ou c’est vraiment Ivo qui te guide ? Tu peux avoir un vrai échange avec lui ?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, Ivo a profondément besoin des acteurs. C’est un théâtre extrêmement construit en amont, extrêmement structuré scénographiquement, musicalement, dans l’adaptation. Les images sont préconçues mais il sait qu’au cœur de son dispositif, il y a l’acteur et sa personnalité, le filtre de l’acteur, de son humanité…
Ivo a besoin des acteurs, donc il est à l’affût de leurs propositions. C’est un vrai échange.
La récente rencontre avec Ivo Van Hove dans la coupole de la Comédie-Française m’a permis d’avoir une relecture passionnante de son travail et aussi de découvrir une personnalité plus humaine et accessible que son image d’homme du nord, un peu austère, véhiculée par les médias…
On le voit très bien dans ce genre de moment-là avec Ivo. C’est-à-dire qu’on lui prête une austérité assez impressionnante… Une espèce d’ascèse du théâtre… Et il est comme ça mais pas uniquement. De cette pudeur, de cette timidité, il sait aussi être chaleureux, humain, drôle et simple, dans son rapport aux choses et à l’autre.
Si on revient au récent téléfilm Un homme parfait diffusé sur France 2, ou si on repense aussi au film Pas son genre, on a l’impression qu’à l’image tu explores quelque chose de beaucoup plus sombre qu’au théâtre…
Au théâtre aussi ! Mais c’est vrai que ce n’est pas rien de devoir interpréter un monstre, d’autant plus à l’image ! (le personnage interprété par Loïc est un père incestueux, ndlr).
Au théâtre, la convention fait qu’on accepte plus facilement de jouer et de voir des monstres. A l’image, c’est un peu différent. La distance est plus difficile à prendre. J’ai reçu le script mais je ne l’aurai pas accepté avec n’importe qui, ni n’importe comment. Je connaissais bien le réalisateur et ce qu’il avait fait auparavant.
Le scénario était merveilleusement écrit, donc j’y suis allé. Je n’ai pas vu le film et je n’ai pas envie encore de le voir mais je suis ravi de savoir que le film est à la hauteur du sujet et qu’il a rencontré son public, qui plus est.
Après, tu sais, je réponds aux projections des metteurs en scène de théâtre ou de cinéma mais c’est sûr qu’avec mon nez en trompette et ma tête de jeune premier encore à 40 ans, je suis ravi quand on m’envoie des choses plus sombres, des personnages plus troubles.
Tu as joué récemment dans Le pays lointain mise en scène par Clément Hervieu-Léger au Théâtre de l’Odéon. Tu es toi-même un fidèle de cette Compagnie des Petits-Champs co-fondée par Clément Hervieu-Léger et Daniel San Pedro…
La famille de la Compagnie des Petits-Champs se crée et s’agrandit au fur et à mesure des spectacles mais il se trouve qu’avec la relation de complicité, de compagnonnage que j’ai avec Clément à la Comédie-Française ; avec l’amitié qui nous lie, il est venu m’embarquer très vite et notamment dans le premier spectacle de la compagnie, L’épreuve. C’était une occasion pour Clément, comme pour moi de pouvoir retravailler avec tous les gens avec qui on ne peut pas travailler parce qu’on est au Français : Daniel San Pedro, Audrey Bonnet, Stanley Weber, Nada Strancar…
Cette famille de la Compagnie des Petits-Champs s’est créée de spectacle en spectacle. Et l’aventure du Pays lointain a été magnifique ! Pouvoir s’organiser avec Éric Ruf et qu’il nous laisse Clément et moi partir l’année dernière quelques temps pour créer le spectacle à Strasbourg et en tournée ; puis qu’il nous laisse à nouveau l’opportunité de le jouer cette année à l’Odéon, c’était inespéré.
Il y a une chose que j’ai notée dans l’entretien que nous avions fait ensemble en 2004…
Oh la, la, ça ne nous rajeunit pas, Laetitia ! Mais on est toujours là, c’est chouette ! (Rires)
… C’est que tu aimes mettre de l’énergie sur le plateau. Tu disais « J’aime sauter sur les tables » et c’est ce que l’on peut constater encore une fois dans Le pays lointain… C’est quelque chose qui se fait chez toi de manière inconsciente ?
Il y a cette légende qui raconte que les acteurs français sont très cérébraux, à la différence des acteurs allemands ou anglais, qui sont très physiques. Pour moi, le rapport au corps ne m’a jamais posé de problème. J’ai toujours construit avec mon corps autant qu’avec ma pensée. Mon corps a toujours été mon principal moyen d’expression sur un plateau de théâtre.
Après le temps passant, les rôles changeant aussi, il y a quelque chose qui se centre peut-être un peu plus mais de toute façon, j’aime bien être un peu décentré.
Je sais que quand j’étais tout jeune acteur à l’école, j’étais un peu le chien fou de la classe mais c’est vrai : il y avait une table, je sautais dessus. C’est devenu une blague à mon propos. Mais pour moi, ça n’est pas anodin, sur un plateau de théâtre, un accessoire, un meuble… Là avec Ivo, de la boue… Pour moi, ça provoque quelque chose !
Ivo n’a pas besoin de me dire d’utiliser la boue. Je rentre sur le plateau, je me dis qu’il y a de la boue et qu’il faut que j’en fasse quelque chose. Cela ne servira à rien qu’elle soit là si je ne peux vivre avec, travailler avec.
Est-ce que tu es toujours d’accord avec ce que tu disais en 2004 à savoir en tant qu’acteur sur le plateau et malgré ce que tu as tout préparé, tu dois être toujours dans l’instant et dans l’instinct ?
Ça n’est pas « malgré » mais « grâce à » la préparation, grâce au travail, grâce à la maîtrise de toutes les contraintes du travail (le texte, la scéno, les indications du metteur en scène, de ses partenaires), que tu trouves l’abandon, la libération du moment présent. C’est comme ça que j’aime l’écriture théâtrale, quand toutes les partitions physiques, vocales, sensibles sont superposées les unes avec les autres et tellement imprégnées, que justement on puisse s’abandonner à l’instant présent avec ses partenaires et avec le spectateur.
Et là maintenant, tu ne te verrais pas quitter le Français ? Tu y as acquis un vrai espace de liberté ?
Toutes les libertés, non. Je fais beaucoup de sacrifices aussi à côté : je dis non aussi à beaucoup de choses à l’image comme au théâtre. Cela me prend beaucoup de temps dans ma vie personnelle et ce n’est pas forcément simple parce que cette maison est quand même chronophage.
En tout cas aujourd’hui, j’y suis bien. Mais Dieu merci, il y a beaucoup d’autres endroits où l’on peut faire du théâtre de manière magnifique.
On fait quand même un drôle de pari dans cette maison : de jouer trois, quatre spectacle en même temps, en en répétant d’autres, de passer comme ça d’un spectacle à un autre…
C’est le seul endroit au monde où il y a cette gymnastique-là et pour l’acteur et pour le spectateur.
Pour le moment, j’y suis bien. J’y ai toujours été bien. C’est un théâtre que j’ai vraiment rencontré, qui correspond vraiment à ce dont je pouvais rêver quand j’étais jeune acteur, dans ce qu’il me demande, dans ce qu’il m’offre.
Et la rencontre avec la troupe est une rencontre amoureuse et dont les liens ne font que de se renforcer, d’année en année, de spectacle en spectacle.
Je vais jouer Les Damnés à Londres en juin et Oreste / Électre au Théâtre d’Épidaure, en Grèce, en juillet donc tout va bien !… (Rires)
Portrait de Loïc Corbery et Photo de Hamlet à part, crédits photo
de Christophe Raynaud de Lage - Crédits photo Electre / Oreste
de Jan Versweyveld, coll. Comédie-Française.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 30, 2019 5:51 AM
|
Par Stéphane Capron dans Scenweb le 30 avril 2019
Deuxième mise en scène d’Ivo van Hove à la Comédie-Française, après l’adaptation des Damnés de Visconti en 2016, il compile Electre et Oreste, deux pièces d’Euripide, dont il place l’action dans un champ de boue.
En février 2015, Ivo van Hove avait mis en scène Juliette Binoche dans Antigone de Sophocle, dans une scénographie épurée et très classieuse de Jan Versweyveld. Il revient à la tragédie grecque à travers Euripide en compilant Electre et Oreste dans un spectacle ramassé de deux heures d’une grande limpidité, qui demande aux comédiens de la troupe de la Comédie-Française une extrême agilité. Ils doivent se déplacer (en chaussure à crampons) sur un sol boueux et glissant. Chaque personnage descendant d’une passerelle et tombant les deux pieds dans le piège d’une terre inhospitalière.
Les comédiens de la Comédie-Française sont désormais rompus à toutes les expériences. Ils n’ont plus peur de rien. Suliane Brahim et Christophe Montenez, les deux héros de ces tragédies se jettent à corps perdu dans ce magma. Sœur et frère, ils se retrouvent après leur exil et vengent le meurtre de leur père Agamemnon orchestré par leur mère. Ils commettent le meurtre le plus horrible: le matricide. Christophe Montenez est totalement habité par son rôle, tout comme Loïc Corbery qui incarne son fidèle compagnon Pylade. Les deux comédiens, très souvent maculés de sang, électrisent le plateau. Suliane Brahine, cheveux courts, incarne une Electre rebelle, “l’inverse d’une princesse” dit-elle.
La pièce est rythmée par un quatuor de percussions. La musique d’Eric Sleichim fait plonger la tragédie dans des formes rituelles, orchestrées par des chorégraphies de Wim Vandekeybus qui s’est joint à l’équipe artistique. Les comédiens entrent alors en transe dans une procession qui donne à cette tragédie antique une force tellurique d’une grande intensité. Comme dans Les Damnés, Ivo van Hove met en scène la violence. Chez Visconti, elle était froide, ici elle est plus démonstrative. Le sang des meurtres éclaboussent les corps. Electre et Oreste, enfants rejetés par le pouvoir utilisent les mêmes armes pour parvenir à leur fin. La violence légitime-t-elle la violence ? C’est la question posée par Ivo van Hove. Il s’est appuyé avec son dramaturge Bart Van den Eynde sur les travaux de spécialistes de la radicalisation (Mohammed Hafez et Creighton Mullins) qui estiment que “la marginalisation économique et l’aliénation culturelle” provoquent “un sentiment aigu de victimisation“. Electre et Oreste, atteints de folie se réfugient dans la violence pour sortir de l’enferment idéologique.
Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr
Électre / Oreste
de Euripide
Mise en scène Ivo van Hove avec
Claude Mathieu,
Cécile Brune,
Sylvia Bergé,
Éric Genovese,
Bruno Raffaëlli,
Denis Podalydès,
Elsa Lepoivre,
Loïc Corbery,
Suliane Brahim,
Benjamin Lavernhe,
Didier Sandre,
Christophe Montenez,
Rebecca Marder,
Julie Sicard
Gaël Kamilindi
Durée: 2h
Comédie-Française
Salle Richelieu
En alternance
Du 27 avr 2019
au 03 juil 2019
photo Jan Verweyveld

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 11, 2019 5:23 PM
|
Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 10 avril 2019
The Hidden Force, de Louis Couperus, mise en scène de Ivo Van Hove
Au cours des dernières saisons, la troupe d’Ivo Van Hove – Internationaal Theater Amsterdam – a présenté trois pièces qui rendent hommage à l’un des plus grands auteurs néerlandais, Louis Couperus. Ainsi, The Hidden Force, Les Choses qui passent et Petites Âmes ont été adaptées à la scène.
Louis Couperus (1863-1923) est pour le metteur en scène néerlandais, Ivo Van Hove, un contemporain dont le talent consiste à traduire l’angoisse existentielle.
The Hidden Force est écrit après que l’auteur soit allé dans les Indes orientales néerlandaises (Indonésie) en1899, au faîte de la domination coloniale des Pays-Bas.
Le roman est visionnaire, prophétisant la disparition prochaine de la colonie, l’effondrement d’une vision du monde européenne et univoque, à partir du portrait du personnage principal, un gouverneur dévoué et compétent, pense-t-il lui-même.
Or, c’était sans compter, ni d’un côté, avec la population autochtone, leurs croyances – culture et religion -, leur statut de dominé et de servilité obligée, ni de l’autre, avec ses proches mêmes– ses propres enfants, son épouse, ses amis- dont il ignore tout.
Ignorance des communautés qui ne se croisent ni ne se rencontrent mais cohabitent.
L’égoïste se pense unique et authentique, à l’intérieur d’un même foyer, tel le gouverneur colonial, père de deux enfants, qui s’est remarié, et dont la fille est amoureuse d’un métis, un gendre de « sang-mêlé » que le père ne saurait accepter.
De son côté, le fils apprend que son père a aussi un fils non reconnu, dont la mère indonésienne a été répudiée, ce qui provoque la haine filiale entretenue à distance,
Par ailleurs, la seconde épouse du gouverneur va d’une aventure amoureuse à l’autre, entretenant des relations sexuelles extra-conjugales, consenties et décomplexées, tant avec l’amant de sa belle-fille qu’avec le propre fils de son époux.
Voilà pour les affaires privées et familiales du gouverneur prétendument respectable. Pour ce qui est des affaires publiques, tout tourne mal pour le responsable du district, quand un nouveau régent est nommé, moins obéissant que le précédent.
La régence est dévolue aux grandes familles autochtones de la région, qui ont leurs propres traditions – civilisation ancienne, sens de la famille et de la communauté, mysticisme et rituels à connotation magique -, que l’on se doit de respecter.
Le gouverneur n’est pas apte à l’ouverture ni à la compréhension de l’Autre. Le régent a offert une vasque de fruits à son épouse qu’il aurait dû à son tour redonner.
Des manifestations étranges – forces des ténèbres en rappel conradien, ou forces cachées, The Hidden Force– ne cessent d’advenir dans la maison du gouverneur, mettant à mal et sa fille et sa femme car lui reste sourd aux convictions orientales.
Croyances, superstitions et magie, les événements surgis déconcertent et inquiètent.
De même, la nature et ses forces immenses n’en finissent pas d’écraser l’homme – des pluies torrentielles et des raz de marée de ces lointaines contrées orientales.
La scénographie de Jan Versweylveld est somptueuse au sens strict du terme. Un sol immense de maison coloniale couvre le plateau de ses lattes de bois – l’espace scénique dans lequel les situations seront installées – avec à cour, des tables basses autour desquelles s’agitent des serviteurs et servants de rituels locaux.
A jardin, un piano à queue et des instruments orientaux de percussions, qui délivrent leurs musiques classiques, leurs gongs significatifs, tandis que la bande sonore déplie ses bruissements d’oiseaux et ses cris d’effroi d’animaux nocturnes inconnus.
Chorégraphie et danse contemporaine, les corps s’exhibent et s’épanouissent, au rythme alangui d’une ambiance indo-néerlandaise, saturée de sensualité.
Les acteurs vêtus avec chic sont tous pieds nus, qu’ils soient dominants ou dominés.
Les pluies continues de la mousson tombent généreusement sur le plateau trempé d’eau, mouillant à l’excès les interprètes – vêtements, corps –, tous les accessoires.
Décidément, la nature domine le monde, non jugulée, non domestiquée, écrasant d’autant l’homme « moderne » qui pensait être le maître des progrès et de la planète.
Un spectacle magnifique et envoûtant sur la déception des pouvoirs illusoires.
Véronique Hotte
Théâtre de la Ville – Hors les murs/ La Villette Théâtre, 211 av. Jean Jaurès 75019- Paris, du 4 au 11 avril à 20h. Tél : 01 42 74 22 77/01 40 03 75 75
Crédit photo : Jan Versweyveld

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 3, 2016 6:34 PM
|
Par Judith Sibony pour son blog "Coup de théâtre"
Voilà un film qui s’est magnifiquement laissé métamorphoser en spectacle vivant, et voilà un spectacle qui a superbement voyagé de la cour d’honneur du Palais des Papes à la salle Richelieu de la Comédie Française.
Sorti en 1969, Les Damnés de Visconti raconte l’Allemagne de 1933 en croisant la grande et la petite histoire : triomphe du nazisme d’un côté, décadence d’une riche famille d’industriels de l’autre. Entre ce pays où « aujourd’hui tout peut arriver », et le clan Essenbeck dont le chef usurpateur apprend bien vite à « tuer ceux qui (le) gênent », le parallèle est à la fois évident et stimulant, comme le sont toutes les mises en abîme qui réfléchissent, au sens propre, une réalité complexe. Dans son adaptation théâtrale, le metteur en scène Ivo van Hove s’empare de ce jeu de miroir déjà très analytique pour le décomposer encore. Bien plus que du simple théâtre agrémenté de jeux sonores et projections sur écran, son travail est un savant dialogue entre spectacle vivant et images animées ; un travail où le regard du spectateur se trouve en permanence mis à l’épreuve. Etre témoin des choses, est-ce en être complice ? Regarder sans rien dire, comme le font certains personnages de la pièce, est-ce participer à l’horreur ? Quand on est spectateur, est-ce qu’on laisse le monde qui tourne mal nous bercer insensiblement ?
Ici la caméra, les micros et l’écran ne servent ni à fasciner le public ni à faciliter la tâche des acteurs, ils sont là pour faire sentir qu’il y a autre chose à voir. Sur le devant de la scène, les crimes s’enchaînent, jamais vraiment commentés, toujours escamotés, mais sur le bord du plateau, soudain relayés par l’écran géant, il y a les visages des victimes, et leurs regards horrifiés jusqu’au fond du tombeau. Officiellement, le Baron Konstantin von Essenbeck (Denis Podalydès) se vante de son appartenance virile aux forces SA, mais dans l’ombre (et ici en gros plan), on découvre ses frasques arrosées de bière qui finissent en bain de sang, ambivalente célébration de la guerre et vaine tentative d’oublier l’impuissance. Sous les feux de la rampe, on a presque envie d’admirer Sophie von Essenbeck (Elsa Lepoivre), femme fatale et terrifiante dont la soif de pouvoir ressemble à celle de Lady Macbeth ; mais dans les coulisses et jusque dans la rue, un chef opérateur met à jour sa fragilité et sa détresse dès lors que ceux qu’elle manipule commencent à résister.
A travers cette cohabitation féconde entre projection d’images et jeu d’acteurs prodigieux (il faudrait citer aussi Eric Génovèse, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Guillaume Gallienne, Didier Sandre, l’époustouflant Christophe Montenez…), cette adaptation des Damnés décompose ce qu’est une représentation, et cela suffit à conférer au spectacle une vraie force éthique et esthétique.
Quitte à le faire de façon appuyée, ce théâtre se réclame d’ailleurs des Lumières, comme en témoigne notamment l’usage du plein feu à chaque fois que quelqu’un se fait assassiner au fil de l’intrigue. Dès qu’un personnage est envoyé au tombeau, le public se retrouve, littéralement et radicalement, éclairé. Ce serait bien, en effet, si l’opinion pouvait sortir grandie, éclairée, illuminée, lorsqu’elle assiste à des meurtres et autres actes de terreur. En attendant, Ivo van Hove invente ici un théâtre de la vigilance, et c’est une riche et belle expérience.
Les Damnés, d’après Visconti, à la Comédie Française (salle Richelieu) jusqu’au 13 janvier 2017.
Photo : Denis Podalydes et Sébastien Baulain dans « Les Damnés » mis en scène par Ivo van Hove © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2016 4:09 PM
|
Par René Solis pour Delibere.fr
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
Dans le scénario des Damnés de Visconti (La caduta degli dei – La chute des dieux – en italien), tous les ingrédients d’une bonne série sont là : nid de vipères familial (avec sa brochette de lâches, de salopards, de monstres, plus nombreux et plus intéressants que les innocents sacrifiés), intrigue policière (meurtres, suicides, fausses accusations) enchâssée dans la grande Histoire (les débuts du pouvoir nazi, de l’incendie du Reichstag à la Nuit des longs couteaux). Le tout sur fond de bûcher infernal (les aciéries von Essembeck et leurs hauts fourneaux, objets de toutes les convoitises). Du film de Visconti, sorti en 1969, reste d’abord la puissance des flammes saturant l’écran de lueurs orangées et l’implacable cruauté du portrait d’une aristocratie moribonde, avec sa foule de domestiques traquant les grains de poussière et les faux plis dans les nappes alors que les maîtres s’entretuent. Plus daté : un certain baroque nazi (travestis, lèvres peintes en noir, bas résilles, Lily Marlene, orgie homo SS – ou plutôt SA), malgré la performance d’Helmut Berger en dernier rejeton dégénéré.
Du film de Visconti, le metteur en scène Ivo Van Hove, n’ignore rien et on n’est pas obligé de le croire quand il prétend ne pas l’avoir revu depuis longtemps. Mais il dit vrai quand il affirme être parti, pour son adaptation théâtrale, du scénario et pas du film. Le directeur artistique du Toneelgroep d’Amsterdam a l’habitude. Il a notamment puisé chez Bergman (Cris et chuchotements, Après la répétition, Persona…),, mais aussi Cassavetes ou Pasolini. Et c’est la troisième fois qu’il s’inspire de Visconti (après Rocco et ses frères et Ludwig). Tous réalisateurs clairement proches du théâtre. À chaque fois, ce ne sont pas les images du film que Van Hove cherche à transposer, mais l’histoire et sa structure. Le théâtre lui permet de jouer de la profondeur, de montrer le hors-champ, les coulisses. Et les images diffusées sur écran n’ont pas pour vocation d’illustrer. Filmées en direct, elles sont un outil cinématographique -gros plans sur un visage ou une main- au service du théâtre; elles peuvent aussi avoir une valeur informative, quand sont projetés des documents d’époque, avec en surtitre des rappels d’événements historiques. Du cinéma, Van Hove fait moins un support qu’un interlocuteur, voire un contradicteur : l’écran saturé d’informations s’oppose au vide du plateau, comme si le cœur de l’action ne pouvait être qu’un no man’s land, un désert imaginaire.
À tous les spectateurs de théâtre qui ont pu se lasser ces dernières années d’un recours immodéré à la vidéo, le spectacle d’Ivo van Hove vient rappeler ce que peut être une utilisation intelligente des images. Dans Les Damnés, elles ont aussi une valeur radiographique, souvent surexposées, parfois en noir et blanc, elles donnent aux personnages une dimension fantomatique, quand les corps de chair et d’os sur scène ont, eux, des allures de pantins.
Cauchemar ou bal des spectres, au delà des personnages du film de Visconti, ce sont bien des figures théâtrales qui revivent et meurent sur le plateau de la cour d’honneur. Van Hove, qui a monté Shakespeare, sait bien que la généalogie de la famille von Essenbeck puise de ce côté là. Il y a du Lear chez le vieux baron Joachim, du Lady Macbeth chez la baronne Sophie – et du Macbeth chez son amant Friedrich Bruckmann, du Hamlet chez les deux héritiers Günther et Martin (qui bascule à la fin du côté de Richard III). La liste des références possibles est sans fin, elle mène aussi aux origines de la tragédie familiale, chez les Atrides, Agamemnon, Iphigénie, Clytemnestre, Égisthe, Oreste, Électre, etc. Et se prolonge chez Racine, il y a du Néron chez Martin et de l’Agrippine chez Sophie… Tous personnages que les acteurs de la Comédie-Française connaissent bien. Et c’est peut-être bien à eux qu’ils pensent, tandis qu’ils se préparent pour le dîner d’anniversaire du vieux baron Joachim (Didier Sandre, toujours impeccable), exactement comme s’ils étaient dans leur loge avant d’entrer en scène. Entre eux et le metteur en scène un courant a dû passer. Ivo van Hove n’est pas seulement doué pour les images et la dramaturgie, il sait aussi diriger les acteurs, les pousser à “l’exploration de zones psychologiques complexes et d’émotions raffinées”, ainsi qu’il le dit dans un entretien publié dans le programme et réalisé par Laurent Muhleisen, conseiller littéraire de la Comédie-Française.
© Christophe Raynaud De Lage / Festival d’Avignon
Pour son retour en Avignon, près de vingt-cinq ans après sa dernière venue, la troupe a délégué plusieurs de ses acteurs vedettes et ils brillent, d’Éric Genovese en officier aristo SS à Elsa Lepoivre en baronne perverse, en passant par Sylvia Bergé, Denis Podalydès, Alexandre Pavloff, Guillaume Gallienne, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Clément Hervieu-Léger, Jennifer Decker, Christophe Montenez… Tous acteurs et victimes de ce que le metteur en scène qualifie de “rituel de mort”.
Un rituel où le public est convié. Côté cour, six cercueils ouverts attendent leurs pensionnaires. À chaque mise à mort, les projecteurs éclairent les gradins plein feu tandis que la victime va se coucher dans la boîte capitonnée. Pour la plupart, la mort n’est pas un apaisement. Une caméra placée à l’intérieur filme en gros plan les visages de ceux pour qui l’enfer éternel commence. Un enfer dont les spectateurs auraient tort de se sentir à l’abri.
Ivo Van Hove ose, en guise de fin, l’image de Martin, le dernier survivant des von Essenbeck, en uniforme noir SS, arrosant la salle de rafales de kalachnikov. Une scène qui, moins d’un an après le Bataclan, sera peut-être encore plus éprouvante lors de la reprise du spectacle à la Comédie-Française. Le Mal aujourd’hui, c’est aussi le sujet de 2666, l’adaptation par Julien Gosselin du roman de Roberto Bolaño et de ¿ Qué haré yo con esta espada ?, la nouvelle création d’Angélica Liddell, à l’affiche tous deux du festival ces prochains jours. Ivo van Hove, qui a tiré le premier, place la barre haut.
René Solis
Les Damnés, d’après Visconti, mise en scène de Ivo Van Hove, Cour d’honneur du palais des Papes, jusqu’au 16 juillet.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2016 8:24 AM
|
Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan
Après plus de vingt ans d’absence, la Comédie-Française fait son retour au festival d’Avignon avec l’un des très grands metteurs en scène européens, Ivo van Hove. Qui réinvestit et adapte le scénario de Visconti pour son film « Les damnés ». Spectacle costaud. Retour gagnant.
Lire sur le site d'origine : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/070716/avignon-les-damnes-vous-saluent-bien
Devant le mur de la Cour d’honneur du Palais des papes que le metteur en scène Ivo van Hove considère comme un simple mur, mais fait de vieilles pierres qui en savent long sur l’orgueil et la soif de pouvoir des hommes, est déployé un écran de cinéma .
Le royaume de la sidérurgie
Des images d’archives nous y rafraichissent brièvement la mémoire : prise de pouvoir d’Hitler par les urnes, incendie du Reichstag, montée en puissance militaire l’Allemagne hors des normes dictées par le traité de Versailles, camp de concentration de Dachau….
Et pourtant, d’un bout à l’autre de ces « Damnés », spectacle inspiré non par le film de Visconti mais à partir de son scénario (écrit par Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli) on ne verra aucune croix gammée. Aucun signe ostensible du nazi, aucun décorum habituel. Pas même le bras tendu, bien peu présent dans le spectacle, alors que l’on en voit des milliers actuellement dans les grands stades de foot, pour d’autres raisons, ce qui n’empêche pas un certain effroi.
Ce n’est pas « la montée du nazisme » qui est au premier plan dans ces « Damnés », c’est la lutte pour le pouvoir au sein , d’une grande famille dont le royaume est la sidérurgie allemande , industrie cruciale en temps de guerre, et la manipulation, la collusion de cette famille par le pouvoir en place, par les luttes au sein même de ce pouvoir (par exemple entre les SA kakis et les noirs SS) où la vieille famille bourgeoise a également ses représentants. Un parti pris affirmé, justifié et implacablement tenu.
Un redoutable commando
Tous les spectacles d’Ivo van Hove partent d’une, deux, trois idées-intuitions fortes dont la traduction est à la fois dramaturgique et scénique. C’est le fruit commun d’un commando redoutable d’efficacité qui accompagne Ivo van Hove dans ses créations : Jan Versweyveld (scénographie et lumière), Tal Yanden (vidéo), Eric Steichim (musique et concept sonore). La force visuelle, les grandes options rythmiques du spectacle, c’est à ce travail d’équipe qu’on le doit.
Tandis que le côté gauche est réservé aux chambres à coucher (où l’on s’habille pour les soirées, où l’on séduit, etc.), sur le côté droit du plateau sont alignés des cercueils vides. Ils attendent un à un les membres de la famille qui va être broyée, à commencer par le patriarche , le baron Joachim Von Essenbeck (Didier Sandre, martial et mélancolique, ses yeux clairs et vitreux savent qu’ils appartiennent au passé ) assassiné (balle dans la tête) par l’un des hauts placés de ses aciéries, l’ambitieux Friedrich Bruckmann (Guillaume Gallienne, impressionnant, avec une barbichette de traitre empruntée à Iago) finissant dans le dernier des cercueils avec son amante, la non moins ambitieuse baronne Sophie Von Essenbeck (Elsa Lepoivre, phénoménale de beauté, de force, d’impudeur et de séduction).
Entre temps auront pris place dans les autres boites, Konstantin Von Essenbeck qui n’a pas compris le sens de l’histoire dans et hors l’entreprise familiale (Denis Podalydès, très à l’aise en buveur de bière nu) et le plus lucide mais aussi le plus désespérée de tous, Herbert Thallman (Loïc Corbery, sobrement bouleversant) dont la femme Elisabeth(Adeline d’Hermy, très juste jusque dans ses larmes) , la « petite juive », a été envoyé à Dachau et qui se livre à la Gestapo pour sauver ses enfants.
Le rituel de la mise en bière
Ces mises en bière sont l’objet d’un rituel qui se reproduit autant de fois. Tout le monde se met en place face au public (c’est aussi ainsi que le spectacle commence et qu’il se finira), chaque mort va vers son cercueil suivi de six hommes en noir, il s’y allonge, le couvercle est fermé. Tandis qu’il proteste par-delà la mort, le spectacle continue. Tout cela est accompagné d’un rituel de filmage vidéo et d’une partition sonore. Tout avance de front. Ce n’est pas sans rappeler l’un des magnifiques spectacles d’Ivo van Hove que l’on a pu voir il n’y a pas longtemps « Kings of war » (lire ici). Cette fois, ce ne sont pas les rois qui se succèdent mais une famille et ses alliés qui se (et qu’on) rétrécit. Comme on le constate à chaque retour du rituel au personnel de plus en en plus clairsemé.
Qui sont ceux qui restent ? Ceux qui ne voulaient pas le pouvoir, qui n’avaient pas d’ambition politique mais qui finiront dans les bras exacerbés de fierté nationaliste, consentants, influencés. Ainsi Martin Von Essenbeck qui bien que possédant 51% de l’entreprise de son grand père s’en désintéressera longtemps, se laissera manipuler jusqu’à, in fine, exercer son pouvoir par haine de sa mère. Il s’offre aux nazis et leur offre ses usines (Christophe Montenez, seule figure viscontienne, coachée par Pasolini). Il en ira de même son cousin Günther Von Essenbeck, lui par vengeance (Clément Hervieu-Léger, parfait dans le mystère que l’évolution de son personnage suscite). Reste au-dessus, le grand manipulateur, l’homme de l‘ombre, le discret tireur de ficelles au service du régime, Von Aschenbach, le cousin de la baronne Sophie (Eric Génovèse, au léger sourire assassin, au calme diabolique).
"La noirceur de l'âme humaine"
On aurait pu craindre que l’usage de la vidéo fasse trop penser au film de Visconti (même si on ne l’a plus revu depuis longtemps), il n’en est rien. Cependant cet usage s’avère parfois excessif et inutile, il ne fait pas assez confiance à la force des acteurs de la Comédie Française laquelle, de Vassiliev à Ivo van Hove, se grandit avec les plus grands. En revanche, cet usage apparait on ne peut plus pertinent et inventif pour des scènes de groupe (type bacchanale des SA suivie de leur massacre par les SS) où le cinéma laisse habituellement le théâtre paralysé dans les starting blocks.
Ainsi le rituel avignonnais du « grand spectacle d’ouverture dans la Cour d’honneur » aura-t-il été accompli par un spectacle bien balancé, rythmé de rituels, une machine qui tourne sans à-coups et sans faiblesse. On aurait aimé un spectacle au sujet plus incisif, moins patrimoine, moins rouleau compresseur si je puis dire. Il faudra revoir ce riche spectacle à la Comédie-Française, où les dimensions de la salle Richelieu, vont conduite à réinventer la scénographie du spectacle, la bande à Ivo van Hove, sait faire. Et, dans la salle parisienne,on aura le plaisir de voir les acteurs de plus près, et espérons-le, dépourvus de ces micros HF qui leur balafrent le visage quand ils sont filmés en gros plan.
Dans un texte qui ouvre un ouvrage universitaire qui vient de lui être consacré, Ivo van Hove écrit : « Au musée, au théâtre, au cinéma, j’aime être plongé dans le chaos. Je veux ressentir du désarroi, avoir peur, trouver de l’espoir. L’art peut surprendre, il est dangereux à condition de constituer une zone de liberté. L’artiste doit nous transporter et nous choquer en nous donnant à voir la noirceur de l’âme humaine ». Mission accomplie
Festival d’Avignon, Cour d’honneur du Palais des papes, jusqu’au 16 juillet à 22h, sf le 14 à 23H, relâche le 10. Puis à la Comédie Française, salle Richelieu, du 24 sept au 13 janvier 2017
« Ivo van Hove, la fureur de créer » ouvrage collectif sous la direction de Frédéric Maurin, éditions les Solitaires intempestifs, 204 p 17€
Image : scène de "Les damnés" © Christophe Renaud de Lage

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 29, 2016 9:30 AM
|
Par Sophie Jouve pour Culturebox.fr
Après 23 ans d'absence, la Comédie-Française ouvre ce 70e Festival d'Avignon avec "Les Damnés", inspiré du film de Visconti. Le maître d'œuvre est un des grands du théâtre européen, le Belge Ivo van Hove. Nous avons retrouvé la troupe en répétition au 104, dans le 19e arrondissement, loin des ors du Palais Royal. Une troupe enthousiaste et galvanisée par le travail déjà réalisé.
Dans l'espace de répétition tout est en place : un grand écran vidéo occupe le fond de la scène. De part et d'autre d'un vaste espace de jeu, des canapé-lits, des tables de maquillages éclairées, un gong. Changement de décors, habillage, tout se passe à vue.
Le metteur en scène, Ivo van Hove ne dispose que d’un mois de travail à Paris et de 10 jours à Avignon : "Le moment crucial dans mon rapport aux acteurs, celui où tout se joue est celui des répétitions", affirme-t-il.
Ce jour là on commence l'acte II : images de propagandes et musique Métal sont interrompues par l’entrée d’un groupe de SS, en uniforme et coupes de champagne à la main.
Ils trinquent à un prototype de mitrailleuse, en compagnie de l’ambitieux Friedrich Bruckmann incarné par Guillaume Gallienne, homme de confiance de la riche famille d’industriels allemands, von Essenbeck, mais prêt en même temps à retourner sa veste.
"Il faut que tu montres le fusil, comme... (il cherche le mot)… comme un trophée qui va changer le monde", indique Van Hove à l’ouvrier qui porte l’arme. "Il faut être plus conscient de l’importance de ce moment, il faut être plus agile ça se dit comme ça ? plus tonique. Oui c’est ça."
"Lorsque tu brandis le fusil tu fais peur, alors du coup tout le monde lève son verre. Je veux essayer ça." "Au prototype, avec l’espoir d’entendre bientôt sa musique", reprend l’un des comédiens-officier.
Ivo van Hove insiste sur le rythme, prête une attention toute particulière à la position des corps
Se dessinent en quelques secondes les rapports de forces. Ceux qui prêtent allégeance aux nazis tel Eric Génovèse (Wolf von Aschenbach), manipulateur, ambigu et menaçant, ceux qui hésitent encore et ceux dont l’avenir est déjà menacé. C’est le cas de Denis Podalydès (Konstantin von Essenbeck), fils de la grande maison et membre des SA dont le sort est déjà scellé. Lorsque qu'il entre, l’assemblée se fige, l’ignore, se détourne.
"On ne comprends pas tout de suite pourquoi on ignore Konstantin von Essenbeck", constate Podalydès. "Il découvre qu’il y a une conspiration contre lui, c’est un bloc contre lui", dit van Hove.
La scène est rejouée 7 fois. Ivo van Hove distille ses conseils à la fin de chaque scène, sobre, concret, insistant sur le rythme, prêtant une attention toute particulière à la position des corps.
"C'est quelqu'un de très pudique, qui ne dirige pas énormément, et qui est très clair quand il demande quelque chose. Il cible, il n'y a pas de gras. Il travaille très rapidement, il va à l'essentiel, très vite. C'est très agréable", sourit Elsa Lepoivre (Baronne Sophie von Essenbeck).
"Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais"
La scène suivante voit Eric Génovèse faire pression sur Galllienne pour obtenir des subsides conséquents de la famille Eisenbeck : "Nous devons gagner les élections pour qu’ils n’y en aient plus jamais", argumente-t-il, glaçant.
"La pression sur lui doit être extrême, indique van Hove à Génovèse. Bruckmann (Gallienne) pensait être entouré d’amis, il n’a plus que des ennemis. C’est ça qui le pousse à bout, à la colère. Donc tu avances vers lui."
"Il y a zéro psychologie chez van Hove, analyse Gallienne. Il est très conscient, très ouvert par rapport au temps du spectacle, qui ne nous appartient pas et en même temps on peut prendre des temps qu'on ne soupçonne pas. 'Prends plus de temps là', dit-il en imitant de manière irresistible l'accent flamand du metteur en scène. Et en même temps, il a une telle énergie, ça avance tellement vite." Et pour détendre l'atmosphère Gallienne prend van Hove par le cou en riant : "Il déteste ça, il n'est pas du tout tactile !"
"On donne corps à cette violence.
Et pourtant justement,"Le corps dans les spectacles d'Ivo que j'ai pu voir à une place centrale, constate Loic Corbery (Herbert Thallman). La violence est très sourde dans le scénario, mais avec Ivo on donne corps à cette violence sur le plateau."
"Il est fascinant, il peut dire juste trois ou quatre mots, donner une description physique, dire : "Voilà il saute sur la table". Juste en disant ça, il sait où ça va mener l'acteur et il ne l'embète pas plus. C'est ça qui est chouette, c'est efficace, tu comprends très vite et du coup ton corps sait ce qu'il doit faire", confie admiratif Christophe Montenez. Le jeune sociétaire embauché pour Tartuffe n’en revient pas d’avoir décroché le rôle de Martin, central selon van Hove : "Un caméléon capable de s’adapter à toutes les situations, même les plus oppressantes, un nihiliste sans ambitions qui ne pense qu’à sa survie". Ce rôle là avait été confié par Visconti à Helmut Berger qui était aussi jeune et sans grande expérience, comme Montenez aujourd'hui.
Dans la scène suivante, très sensuelle, on découvre Martin avec son amie puis violant une petite fille. C'est en tout cas ce que l'on comprend, car van Hove a un sens imparable de la suggestion et aussi une autre qualité : faire démarrer chaque scène à son point culminant, à son maximum d'intensité. Pas de préambule, on est tout de suite au cœur des choses.
"Dur mais jouissif à jouer"
"Il est complètement fêlé ce jeune homme, reprend Montenez, mais c'est à cause de ce que sa mère a fait de lui, du système… On se reconnait un peu tous dans ce désir d'amour inassouvi. C'est dur mais c'est jouissif à jouer".
Face à la scène tout le bataillon de la production : le dramaturge (Bart Van den Eynde), le scénographe lumière (Jan Versweyveld), le responsable vidéo (Tal Yarden), le compositeur (Eric Sleichim)… Tous extrêmement concentrés, susurant en anglais, allemand ou flamand.
"Le spectacle va être violent. Il y a le relais de la vidéo qui est intéressant et qui crée une distance. Même sur les scènes assez dures d'incestes… Mais ce qu'on vit sur le plateau nous secoue nous-même. Mais quand on parle de ça (le nazisme), on ne peut pas le faire avec du coton", remarque Elsa Lepoivre.
"Faire ce spectacle en 2016, avec la mémoire des 70 années passées, c'est tellement théâtral et concret qu'on sent que ça peut finalement se reproduire demain, conclut Gallienne. Il y a des phrases très marquantes, il y en a une que j'adore dire : Et ceux qui cherchent refuge dans la neutralité seront les perdants de la partie".
Avignon du 6 au 16 juillet
Comédie-Française, salle Richelieu du 24 septembre au 13 janvier 2017
Infos pratiques
"Les Damnés" d'après Luchino Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove
Cour d'honneur du Palais des Papes
6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 juillet à 22H/ 14 juillet à 23H
Voir l'article sur son site d'origine : http://culturebox.francetvinfo.fr/avignon/les-damnes-de-visconti-dans-les-coulisses-des-repetitions-avant-avignon-242113

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 20, 2016 7:01 PM
|
Par Philippe CHEVILLEY dans Les Echos
Avec « Vu du pont » et « Kings of war », le metteur en scène belge est doublement récompensé par l’association professionnelle de la critique. Tiago Rodrigues, Alain Françon, Christophe Rauck, Dominique Valadié, Charles Berling et Maëlle Poésy figurent également au palmarès 2016.
Le grand gagnant des Molières 2016 fut Joël Pommerat, distingué quatre fois pour son spectacle « révolutionnaire » « Ça ira. Fin de Louis (1) ». Le vainqueur du prix de la critique décerné lundi 20 juin au Tarmac à Paris, est Ivo Van Hove. Le metteur en scène belge a reçu non seulement le Grand prix pour sa lecture épurée de « Vu du pont » d’Arthur Miller , présentée en début de saison au théâtre de l’Odéon (avec une troupe française), et le prix du meilleur spectacle étranger pour « Kings of War », fulgurante compilation des pièces « royales » de Shakespeare (« Henri V », « Henri VI » et « Richard III ») à Chaillot.
Un succès mérité pour le directeur du Toneelgroep d’Amsterdam, passé maître dans l’art de bousculer les classiques (« L’Avare » de Molière en mode trader), mais aussi d’adapter des romans fleuves (« Fountainhead », d’Ayn Rand) ou des films (sa mise en scène des « Damnés » de Visconti dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec la troupe de la Comédie-Française sera un des événements du prochain Festival d’Avignon). « Vu du pont » a autant séduit la France que l’Amérique, puisque la reprise de la pièce en anglais a reçu il y a une semaine un Tony Awards à New-York.
Oublier Elizabeth Taylor…
Autre metteur en scène étranger récompensé – pour la meilleure création d’une pièce en langue française – le Portugais Tiago Rodrigues, auteur d’une version fine de « Bovary » , tirée à la fois du roman de Flaubert et du procès de l’écrivain, mixant la littérature d’hier et les mots d’aujourd’hui en un maelström d’émotions. Le prix Georges-Lherminier du meilleur spectacle de théâtre créé en province est décerné à Christophe Rauck pour sa relecture originale, cinématographique et opératique, de « Figaro Divorce », d’Odön Von Horvath, à Lille au Théâtre du Nord. Quant au prix Laurent Terzieff du meilleur spectacle présenté dans un théâtre privé, il revient au déjà distingué par un Molière « Qui a peur de Virginia Woolf », d’Edward Albee , monté avec justesse et mordant par Alain Françon au Théâtre de l’Œuvre. Sa principale interprète, Dominique Valadié – géniale furie faisant presque oublier Elizabeth Taylor dans le film de Mike Nichols – se voit décerner le prix de la meilleure comédienne. Le prix du meilleur comédien revient sans surprise à Charles Berling pour sa prestation pudique et tragique de père amoureux dans « Vu du pont » (qui lui a valu également un Molière). La révélation de l’année n’est pas un(e) comédien(ne), mais une metteure en scène : la jeune Maëlle Poésy, 32 ans, qui a su si joliment coudre deux petits Tchekhov ( « Le Chant du Cygne/L’Ours » ) au Studio-Théâtre de la Comédie-Française. Un autre spectacle du Français, « 20.000 lieues sous les mers » , est distingué pour la meilleure scénographie – l’univers sous-marin enchanteur conçu par Eric Ruf, Valérie Lesort et Carole Allemand dans le cadre de scène restreint du Vieux-Colombier. « Orfeo » et Joëlle Bouvier Côté musique, le Grand prix de la critique a été attribué à « Orfeo », de Luigi Rossi , dirigé par Raphaël Pichon à la tête de l’Ensemble Pygmalion et mis en scène par Jetske Mijnssen à l’Opéra de Nancy/Lorraine. Le prix Claude Rostand du meilleur spectacle lyrique créé en province revient à « Lady Macbeth de Mzensk », de Chostakovitch (Kazuchi Ono/Dimitri Tcherniakov) à l’affiche de l’Opéra de Lyon. La meilleure création musicale est l’opéra de François Paris, « Maria Republica » (Angers/Nantes). Et la personnalité musicale de l’année est Paavo Järvi, directeur musical de l’Orchestre de Paris de 2010 à 2016. Côté danse enfin, le Grand prix est décerné à « Tristan et Isolde : Salue pour moi le monde », chorégraphie de Joëlle Bouvier présentée à Chaillot. Les meilleurs interprètes sont, ex-aequo, le Ballet de Monte-Carlo et Rainer Behr (pour son interprétation du répertoire du Wüppertal Tanztheater) et la personnalité de l’année est Didier Deschamps « pour son engagement et son action en faveur de la danse ».

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 16, 2015 7:23 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde : C’est à une véritable résurrection que l’on assiste à Paris aux Ateliers Berthier, la deuxième salle de l’Odéon-Théâtre de l’Europe : celle du grand Arthur Miller, que l’on redécouvre avec un œil neuf, dans cette remarquable mise en scène de Vu du pont que signe le Belge Ivo van Hove – lequel est décidément devenu, avec Thomas Ostermeier, l’un des tout premiers maîtres du théâtre européen.
Cela fait bien bien longtemps que l’on n’avait pas vu ici une mise en scène digne de ce nom d’une des pièces de Miller. La célébrité du dramaturge américain, disparu en 2005, est paradoxale, et à plusieurs tiroirs. Pour beaucoup, Miller, sans doute, n’est plus que l’homme qui a été le mari de Marilyn Monroe. Pour d’autres, il est une figure du théâtre politique des années 1950-1960, à la fois admirée pour sa droiture et sa noblesse, et considérée comme datée, inscrite dans son époque, celle du maccarthysme sur le plan politique et d’un certain naturalisme psychologique sur le plan artistique.
Mais ce qui est beau, avec le théâtre, c’est qu’il est par excellence l’art où les cartes peuvent toujours être rebattues : un art d’essence talmudique où l’interprétation du texte – un texte ne « parle » jamais tout seul, contrairement à un cliché qui fait encore florès – peut toujours faire renaître un auteur, pour peu que celui-ci en soit vraiment un. Et donc revoilà Arthur Miller, comme on ne l’avait jamais vu, débarrassé de sa gangue Actors Studio, des oripeaux du théâtre de dénonciation, pour retrouver ce qui fait l’os de son œuvre : le rapport à la tragédie, et le rôle que ce rapport à la tragédie joue dans l’histoire américaine.
Mise en scène au cordeau
Ivo van Hove a choisi Vu du pont, entre autres textes célèbres du dramaturge. Le Flamand a déjà mis en scène la pièce en anglais, à Londres, où le spectacle a joué à guichets fermés pendant deux ans, et il va la recréer à Broadway, à l’occasion du centenaire de la naissance, en 1917, de Miller. Il en propose ici une version française tout aussi percutante. C’est un choix on ne peut plus pertinent que cette pièce écrite par Miller en 1955, qui, en France, a été créée par Peter Brook – eh oui – en 1958, avec Raf Vallone, et que le film d’Elia Kazan Sur les quais a rendue mythique.
Mais pour la redécouvrir, cette pièce, il fallait d’abord la retraduire, et c’est la première réussite de ce spectacle que d’offrir une version française à la fois contemporaine et serrant au plus près le texte de Miller. La seule traduction qui existait jusqu’alors était celle de Marcel Aymé, qui, pour avoir eu son importance à l’époque, est aujourd’hui datée, et prend des libertés d’écrivain avec le texte d’Arthur Miller. Daniel Loayza, qui est à la fois traducteur et conseiller dramaturgique au Théâtre de l’Odéon, signe un texte français d’une précision, d’une acuité et d’une netteté propres à déployer la mise en scène d’Ivo van Hove, telle qu’elle a été conçue : au cordeau.
Il n’y a en effet pas une once de gras, d’anecdote ou de lourdeur psychologique dans ce spectacle où le metteur en scène et son équipe tiennent de bout en bout le fil de la pureté tragique. La première surprise vient, pour le spectateur, de la scénographie, d’une intelligence et d’une beauté magistrales, conçue par Jan Versweyveld. Quand vous entrez dans la salle, vous vous retrouvez assis sur l’un des trois gradins qui entourent un mystérieux cube noir. Vu du pont commence quand ce cube s’ouvre, comme un rideau se lève, sur une scène en avancée au milieu des spectateurs, qui évoque bien sûr le proscenium de la tragédie antique.
Nul besoin de décor pour évoquer l’histoire d’Eddie Carbone, cet homme dont « les yeux sont comme des tunnels ». Eddie est docker, sur le port de Red Hook, à l’ombre du pont de Brooklyn. Toute sa vie, il a travaillé comme un bœuf, notamment pour offrir une vie meilleure que la sienne à sa nièce, Catherine, qu’il élève avec sa femme, depuis la mort de la mère de la jeune fille.
C’est une histoire d’immigrants, de gens modestes pris dans les rets du destin, une histoire du rêve américain, comme toutes celles de Miller qui, à travers une plongée dans le milieu italo-américain, y raconte sa propre destinée de fils d’un tailleur juif d’origine polonaise, quasiment analphabète. Mais c’est avant tout une histoire – pas une thèse. Eddie n’a pas voulu voir que Catherine avait grandi, qu’elle était devenue une femme. Quand elle tombe amoureuse d’un de ses lointains cousins, tout juste arrivé d’Italie comme immigré clandestin, il sombre, cet homme ordinaire et droit. L’histoire d’amour et de désir incestueux finira mal, très mal.
Des révélations
Le théâtre de Miller apparaît pour ce qu’il est fondamentalement : un théâtre remarquablement écrit, reposant sur des figures humaines d’une force et d’une complexité peu communes. Il évoque cette remarque de Bernard-Marie Koltès : « Je n’écris pas avec des idées, j’écris avec des personnages. » Et ces personnages existent ici avec une crédibilité rarement atteinte au théâtre, parce qu’ils sont interprétés par des acteurs choisis et dirigés avec une science confondante.
Plusieurs d’entre eux sont de ces comédiens français que parfois le grand public ne connaît pas, qui ne travaillent pas forcément beaucoup, et qui n’en sont pas moins des artistes de grand talent. A l’image de Caroline Proust. Dans le rôle de Béatrice, la femme d’Eddie, qui découvre l’ampleur de la passion de son mari pour sa nièce et l’impossibilité d’enrayer la catastrophe, elle est fabuleuse. Ou d’Alain Fromager (l’avocat Alfieri), témoin impuissant de toute cette histoire, et qui fait aussi fonction de chœur antique.
D’autres sont des révélations, comme la jeune Pauline Cheviller, d’une intensité et d’une grâce bouleversantes dans le rôle de Catherine, ou Nicolas Avinée, dans celui de Rodolpho, l’amoureux qui va mettre le feu aux poudres. Enfin, il y a Charles Berling, que l’on n’avait pas vu aussi bien depuis longtemps : un bloc granitique d’humanité douloureuse et blessée, opaque à lui-même. Avec eux se noue cette tragédie d’hommes et de femmes ordinaires, qui se referme sur eux comme un piège, à l’image de la boîte noire du décor.
Vu du pont, d’Arthur Miller (traduit en français par Daniel Loayza). Mise en scène : Ivo van Hove. Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, 1, rue André-Suarès, Paris 17e. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 15 heures, De 8 € à 36 €. Durée : 1 h 55. Tél. : 01-44-85-40-40. Jusqu’au 21 novembre.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 2015 2:19 PM
|
Ouverture du festival Exit par un grandiose Marie Stuart, de Schiller, mis en scène d’Ivo van Hove avec le Toneelgroep Amsterdam. Qu’importe l’époque exacte de la condamnation de Marie Stuart – appartient-elle au siècle d’Elisabeth 1e, à celui de Schiller, ou au nôtre ?–, qu’importe l’époque des histoires romaines révisées par Shakespeare ou celle des scènes conjugales revisitées par Bergman, Ivo van Hove les reverse au même présent. Il fait théâtre du présent en faisant présent du théâtre (1). Il est une fois. L’histoire se constitue à vue et à vie (live), sous nos yeux, nos oreilles, et quoiqu’elle soit connue de tous et parce qu’elle est connue de tous, comme dans la Grèce athénienne, elle demeure tapie dans les circonvolutions du jeu. Chaque instant est un défi à sa destination. Le metteur en scène retarde sans cesse la fin en activant à toute allure les moyens, propres à l’invention de l’acteur, à la densité d’exécution, aux lumières et aux sons. Sur la route familière qui conduit à la décapitation de Marie Stuart, il nous précède en nous déroutant. Oui, nous sommes bien là où nous pensons être, tout en étant ailleurs. Et c’est cet ailleurs qui marque très exactement l’acte théâtral, et nous le rend indispensable. Certes, Marie Stuart, de Schiller (1800), n’est pas la pièce la mieux connue du répertoire allemand. Ce n’est pas un hasard si elle n’a été créée qu’un siècle et demi plus tard en France (2). Cet épisode fondateur de l’histoire anglaise vue d’Allemagne, via la révolution française, a suscité peu de vocations de metteurs en scène. Ivo van Hove a taillé largement dans le corps, jetant au cachot les comparses et négociant avec l’histoire au plus juste pour qu’elle apporte son témoignage sans excès de zèle, afin de resituer les deux prétendantes au trône d’Angleterre, Marie la papiste (Halina Reijn) et Elisabeth l’anglicane (Chris Nietvelt). Ce qui l’intéresse, c’est la mécanique de destruction et d’autodestruction mise en branle. Les rapports de force entre les deux femmes. Leur manière de soumettre les hommes et de les enrôler dans leur guerre. Le déferlement de passion qu’elles vivent et suscitent. Un pas de deux entre désir et pouvoir, sanctionné par une mort-spectacle, vers laquelle Marie s’avance royalement. Ivo van Hove pratique l’épure. Le passage d’une unique enveloppe de mains en mains vaut pour toutes les missives. Répété, le geste est chaque fois neuf. Les personnages sont dégagés d’un fond qui risquerait de les étouffer sous la profusion des signes, comme dans les peintures de Djamel Tatah. Les costumes sombres laissent aux visages le soin de capter les lumières, ouvrant chaque expression au dialogue avec une certaine idée de majesté, dans ce qui oppose et différencie, de bon plaisir et de calcul, de tremblement et d’assurance, de jouissance et de loi, les deux prétendantes au trône unique. Quant aux seigneurs de compagnie, ce sont boys aux corps souples, prompts à servir leurs reines au mieux de leurs propres intérêts, en un ballet – poursuivi jusque dans l’immobilité –, passé par les revues de Broadway. Et lorsque qu’une reine passe robe, c’est à des peintures dûment répertoriées qu’elle le doit. Si pas un pli, pas une agrafe, pas un rubis, pas une ombre du maquillage ne fait défaut, ce n’est pas pour tenter de rejoindre l’histoire réelle, mais l’histoire déjà représentée, celle des manuels et des musées. Lire l'article entier ----> http://www.mouvement.net/critiques/critiques/reine-vs-reine-a-creteil Marie Stuart de Ivo van Hove, du 26 au 28 mars à la MAC Créteil, dans le cadre du festival Exit.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 1, 2012 4:29 AM
|
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 3, 2023 6:49 PM
|
Par Joëlle Gayot (Montpellier, envoyée spéciale) dans Le Monde, le 3 juin 2023
Avec « Après la répétition/Persona » et « Extinction », les deux metteurs en scène mettent à vif les nerfs des spectateurs, secoués par des débordements physiques et émotionnels.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/06/03/au-printemps-des-comediens-a-montpellier-ivo-van-hove-et-julien-gosselin-font-du-theatre-a-cor-et-a-cri_6176040_3246.html
Le théâtre est hors de lui et il le fait savoir. Au Printemps des comédiens, deux artistes expédient leurs spectacles aux confins du raisonnable. Le premier, Julien Gosselin, en forçant les limites de ce que peut, veut et va endurer le public. Le second, Ivo van Hove, en imposant une scène où les sanglots et les cris sont les carburants d’un jeu épidermique. Avec sa mise en scène d’Extinction, d’après Thomas Bernhard (1931-1989), Julien Gosselin livre une épopée furieuse de plus de cinq heures en terre d’écriture autrichienne. Elle est portée par une équipe exceptionnelle d’acteurs français et allemands (ces derniers viennent de la Volksbühne à Berlin). Cette traversée fracassante démarre par un concert techno avec danse collective autour des DJ. Elle se poursuit par une immersion dans les nasses psychologiques d’Arthur Schnitzler (1862-1931) dont trois textes sont tricotés entre eux (La Nouvelle rêvée, La Comédie des séductions, Mademoiselle Else). Elle s’aventure dans Lettre de Lord Chandos, de Hugo von Hoffmannsthal (1874-1929) avant de s’achever par les mots de Bernhard. Alors seulement, la tempête s’apaise, abandonnant les décibels sonores, les volutes de cigarettes, le brouhaha des corps, les vociférations des acteurs, les vidéos noir et blanc tournées en live par des cameramen voltigeurs. Seule sur une estrade, l’actrice Rosa Lembeck dit calmement le début d’Extinction, la mort des parents et du frère, le retour du narrateur vers le château familial où se tapit le nazisme persistant d’une Autriche qu’il exècre. Derrière la culture, le pire de l’humain On reçoit ce récit les nerfs à vif, fourbu par le chaos qui l’a précédé. Certains ont déserté la salle. Ceux qui ont résisté reconsidèrent ce qu’ils viennent de vivre. Eclairés par la rhétorique lucide de Bernhard, ils se repassent le spectacle depuis sa mise en bouche (le concert immersif) jusqu’au plat de résistance : les deux heures trente en compagnie des protagonistes schnitzleriens, une communauté d’hommes et de femmes dont l’élégance accouchera du pire de l’humain. Filmés par un groupe de caméras, les comédiens évoluent derrière un décor de façade juxtaposant une chambre à coucher, un vestibule, un salon et une salle de bains. Chandeliers, verres à pied, cigares, piano et dîner chaleureux : les Autrichiens du début du XXe siècle sont des épicuriens lettrés. Ils parlent de musique, de littérature, de peinture. Ils sont beaux, spirituels. Rien ne permet de soupçonner ce qu’ils vont devenir. Sauf les femmes sur lesquelles s’attardent les objectifs et qui, leurs regards fixés vers un horizon invisible, semblent deviner qu’une tragédie se profile. Albertine, Aurélie et Else vont défaire méthodiquement ce qui fait couple, famille, société, morale. La première en avouant à son mari ses pulsions sexuelles (La Nouvelle rêvée, de Schnitzler, a inspiré à Stanley Kubrick son film Eye Wide Shut). La seconde en couchant avec son frère. La troisième en sacrifiant sa pudeur pour sauver son père de la faillite. Toutes trois manient le masochisme et le sadisme avec un égal talent, tandis que le vernis civilisé des hommes se craquelle insidieusement. C’est donc chez ces êtres propres sur eux que mature une perversité appelée à se muer en monstruosité, chez ces phraseurs qui citent Mondrian et Schönberg que s’épanouit le nazisme. Fascisme rampant Julien Gosselin prend plus de deux heures avant de mettre les points sur les i du fascisme rampant, non sans avoir opéré un détour par Hoffmannsthal dont la poésie est impuissante à stopper le cauchemar : les masques tombent lors d’une scène apocalyptique convoquant un cinéma d’angoisse (des Oiseaux d’Hitchcock à Melancholia de Lars von Trier). Rendus à leur sauvagerie, les Autrichiens enfilent des costumes bavarois et s’adonnent à un jeu de massacre. Sans tronçonneuse mais à coups de hache sanglante. L’ambiance à couper au couteau précipite le public entre exaspération, fascination, épuisement et sidération. La confusion du spectateur n’est pas anecdotique. Elle signifie que Gosselin a su agir sur lui avec un aplomb diabolique en le piégeant dans les filets serrés de l’intellect et du sensible. Ecrivant Extinction, Thomas Bernhard visait sa propre désintégration. A son corps défendant, le public subit une même expérience. Si beaucoup peut être reproché au metteur en scène (ses outrances, sa noirceur ou son usage immodéré du cinéma), une chose est sûre : il croit tellement au théâtre, à son pouvoir de contamination et à sa mission émancipatrice, qu’il prend en son nom des risques inconsidérés. Ça passe ou ça casse. Mais le fait est : la scène est ici le lieu d’un enjeu artistique et politique qui place chacun à hauteur d’homme et de citoyen. Personnages au bout du rouleau Avec Ivo van Hove, metteur en scène belge, le théâtre se fait plus intime mais tout aussi urticant : personne n’aime voir un homme, une femme ou un couple se donner en spectacle. Or nous sommes au spectacle de gens qui se donnent en spectacle, et plutôt deux fois qu’une, puisque le metteur en scène belge propose (douze ans après l’avoir créé avec des acteurs hollandais) un diptyque associant Après la répétition et Persona. Rapatriés du grand écran aux planches de bois, ces drames du suédois Ingmar Bergman dissèquent, à grand renfort de débordements physiques et émotionnels, les subjectivités d’artistes au bout du rouleau. Présentés dans l’ordre inverse de leur création – Après la répétition date de 1984 et Persona de 1966 –, les scénarios se donnent la réplique. L’un convoque un metteur en scène qui ne veut pas quitter le théâtre, le second une actrice qui l’a fui en se réfugiant dans le silence. Dans les deux cas, l’art est incapable de réparer les dégâts causés par la vie (et vice versa). En proie à des tortures mentales et sentimentales abyssales, les héros traversent l’enfer sur terre. Après la Répétition surexpose les affres de Vogler, metteur en scène vieillissant (Charles Berling) aux prises amoureuses et professionnelles avec une jeune actrice. Elle le trouble d’autant plus qu’elle est la fille d’une comédienne dont il fut l’amant et qui revient hanter sa mémoire. Portrait dévastateur d’un homme cramponné à ses fantasmes d’un art qui ne l’affecterait pas : « Je ne participe pas au drame, je fais en sorte qu’il existe », assène le personnage. Sauf que la plainte de Rachel, son ex-maîtresse morte de n’avoir plus été désirée parce que trop délabrée, le rappelle à sa réalité. Lui aussi a le corps mou et se dirige vers la fin de son rôle. Il peut bien vivre nuit et jour dans une salle de répétition, rien n’empêchera la vérité d’en franchir le seuil. « La paix, l’ordre et la courtoisie » C’est par une étroite porte que Rachel, venue réclamer justice, entre sur scène. Un froid rectangle gris avec canapé, chaises, table, caméra sur trépied, toile blanche (le cinéma est cité avec parcimonie). Reclus entre ses murs, Charles Berling porte sur ses épaules le poids des désillusions. Il incarne avec abnégation l’impuissance d’un homme castré par le couperet de l’âge et le tranchant de la culpabilité. Lui qui voulait « la paix, l’ordre et la courtoisie » en prend pour son grade. L’irruption d’Emmanuelle Bercot en Rachel est synonyme de crises de nerfs répétées. Une façon de jouer l’exacerbation qu’Ivo Van Hove remet au goût du jour, sans craindre la surenchère de pathos. La seconde partie du diptyque, Persona, amplifie le naufrage de ces artistes en perdition. Après un entracte, les lumières se lèvent sur une table de fer où Emmanuelle Bercot – dont il faut souligner le don sans réserve qu’elle fait d’elle-même à cette représentation – s’allonge nue. Focus, cette fois, sur une héroïne qui a choisi le mutisme après avoir joué Electre. Sous la houlette de sa supérieure (Elizabeth Mazev), une jeune infirmière (Justine Bachelet) tente de briser l’enfermement de la malade en monologuant à marche forcée sur tout et sur rien. Ses mots opèrent une trouée dans le silence. Ce qui se traduit par une explosion du cadre scénique. Les murs s’effondrent, le plateau est un radeau précaire qui flotte sur un lac étale. Des ventilateurs latéraux vrombissent, arrosant les interprètes d’une pluie torrentielle. Elles sont trempées, nettoyées, purifiées. Si l’image est splendide, la métaphore est plus qu’insistante. Mais nous sommes au spectacle de héros qui se donnent en spectacle et ce, jusqu’à extinction totale des lumières. Ivo Van Hove fait en sorte qu’on ne l’oublie pas. Son parti pris est agaçant mais d’une cohérence sans faille. Extinction, d’après Thomas Bernhard, Arthur Schnitzler et Hugo von Hofmannsthal. Mise en scène de Julien Gosselin. Les 3 et 4 juin au Printemps des comédiens (Montpellier), les 12 et 13 juin au Wiener Festwochen (Vienne), du 7 au 12 juillet au Festival d’Avignon, puis tournée jusqu’en mars 2024. Après la répétition/Persona. Ingmar Bergman. Mise en scène d’Ivo van Hove. Les 3 et 4 juin au Printemps des comédiens (Montpellier), du 28 septembre au 1er octobre à Châteauvallon-Liberté (Toulon) et du 6 au 24 novembre au Théâtre de la Ville (Paris), puis en tournée jusqu’en mai 2024. Joëlle Gayot(Montpellier, envoyée spéciale) Légende photo : Charles Berling et Justine Bachelet dans « Après la répétition/Persona », d’Ivo van Hove, en mai 2023. MARIE CLAUZADE

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 21, 2019 6:50 PM
|
Par Guillaume Tion dans Libération — 21 juin 2019
Présent à Aix avec «Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny», de Kurt Weill et Bertolt Brecht, le metteur en scène néerlandais dépeint sa façon de travailler.
Ivo Van Hove court la France ce trimestre : Electre / Oreste à la Comédie-Française, Don Giovanni à l’Opéra de Paris et aujourd’hui Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny au Festival d’Aix.
Trois productions quasi simultanément, n’est-ce pas trop ? «Je ne pense pas, beaucoup d’éléments sont décidés et travaillés en amont à l’opéra, la préparation s’est déroulée il y a presque un an», nous répond-il au téléphone. Voilà donc ce qui permet son ubiquité. «Pour Mahagonny, je voulais aussi travailler avec Esa-Pekka Salonen, chef d’un niveau international, et j’ai appris que lui-même désirait collaborer avec moi. Je vois ça comme un défi.» D’autant que cette production, notamment coproduite par le Met de New York, fait office d’offre artistique qu’on ne peut pas refuser. En attendant de reprendre sa répétition du brûlot de Kurt Weill et Bertolt Brecht, le Néerlandais a accepté de se prêter au jeu du questionnaire sur le travail du metteur en scène.
Quel déclic vous fait accepter de mettre en scène une œuvre ?
D’abord la musique. Quand je n’aime pas la musique d’un opéra, il est difficile de le mettre en scène. Il faut l’aimer profondément. Mais aussi l’urgence du contenu, urgence personnelle ou en rapport avec des événements qui se déroulent dans la société aujourd’hui. Comme pour Don Giovanni, un opéra sur l’abus de pouvoir, un thème important à notre époque en France et ailleurs. Mahagonny, c’est l’histoire d’hommes et de femmes qui ne se sont pas entendus et qui désirent la même chose que les riches. Ils veulent une société où on peut jouir. Quand j’étais à Paris, j’entendais ce slogan : Vivre oui, survivre non. C’est de ça que parle Mahagonny. Mais il y a des voies différentes, des personnages évoluent, les avis changent. C’est un monde complexe, qui évoque notre société mais aussi ses classes marginales : criminels, prostitués, ouvriers, des gens qui n’ont pas d’argent et trouvent cela injuste.
Comment abordez-vous le travail ?
Je suis entouré d’une dramaturge qui lit la musique. Je peux aussi la lire, j’ai travaillé sur plus d’une quinzaine d’opéras, je vois maintenant dans une partition ce qui est important pour un metteur en scène, mais il me faut de l’aide. Ensuite, on s’interroge. Que veut-on dire avec chaque scène et chaque personnage, comment tout cela s’exprime déjà dans la musique. Car il y a une histoire dans la musique. Je ne travaille jamais uniquement sur le livret. Dès le début, j’achète la partition, j’écoute, je ne dissocie pas les deux éléments : à l’opéra, théâtre et musique racontent une histoire ensemble, pas séparément. C’est le défi. Parallèlement, je développe une dramaturgie visuelle avec mon équipe. On connaît les opéras qui sont très visuels. Par exemple la fin de Don Giovanni passe en deux secondes du réalisme à la métaphysique. On en discute forcément.
La vidéo, c’est une révolution ?
C’est une technique, un instrument pour raconter quelque chose qu’on ne pourrait pas raconter sans. Parfois, au théâtre, on utilise des microphones, c’est utile comme le masque de la tragédie grecque. Le masque servait aussi pour projeter le son, comme une trompette. Mais il permettait aussi un gros plan car il montrait durant deux heures une expression fixe. La vidéo et l’amplification sont des instruments à utiliser si nécessaire. Mais au fond, c’est aussi un choix instinctif de ma part. Pour Don Giovanni, j’ai tout de suite écarté la vidéo, sauf pour la mort du personnage, durant une minute et demie. Pour Mahagonny, j’ai au contraire voulu de la vidéo, indispensable pour créer l’illusion de cette ville, presque un mirage.
Un chanteur est-il aussi un acteur ?
Quand on n’est pas intéressé par le texte et la musique, ce n’est pas la peine de mettre en scène un opéra. Pareil pour les chanteurs : s’ils se préoccupent seulement de la production des sons et ne veulent pas réfléchir au personnage et établir un caractère dans toutes ses nuances… ça ne vaut pas la peine qu’ils fassent de l’opéra. Mais la situation a énormément changé. Par exemple, les chanteurs de Don Giovanni étaient très impliqués.
A l’opéra, qui dirige ? Le metteur en scène ou le chef d’orchestre ?
Ce doit être un équilibre. Avec Jordan et Jurowski, ça fonctionnait comme ça, on était vraiment ensemble, du premier au dernier jour. Le problème survient quand le chef d’orchestre débarque et n’a rien vu des premières répétitions. La situation peut alors se compliquer et mener à une petite guerre. Mais ça ne vaut pas la peine d’en arriver là. Il faut un respect mutuel, sans condition.
Remarquez-vous qu’il y a plus de femmes metteures en scène ?
Oui, il y a de plus en plus de femmes, mais surtout chez les cheffes d’orchestre. Le mouvement est lancé, on ne peut pas l’arrêter et c’est très bien ainsi. Il faut de la diversité.
Avez-vous déjà eu des problèmes avec les maisons d’opéra ?
Non. Jamais de censure. Il y a toujours des conseils, mais je ne fais jamais de compromis. Parfois, pendant le processus créatif, on s’interroge sur la nécessité de tel ou tel élément. Partout dans le monde il y a des restrictions budgétaires, mais il faut toujours travailler collectivement pour trouver les solutions qui permettent d’obtenir le meilleur résultat artistique. C’est pourquoi j’aime être entouré des mêmes personnes : Jan Versweyveld (scénographie et lumière), An d’Huys (costumes), Tal Yarden (vidéo). Ce n’est pas qu’Ivo Van Hove, c’est toute une équipe.
L’avis du public change-t-il quelque chose ?
Quand je sens qu’un élément n’est pas assez précis, que le public ne répond pas, je le retravaille, mais je ne modifie pas la mise en scène en fonction du goût du public. Comme pour une peinture : on ne va pas la changer, elle est là. Parfois on a du succès, parfois on n’en a pas avec des mises en scène qu’on aime beaucoup. L’opéra, comme le théâtre, est un art vivant, voilà sa beauté ! Cela respire sur le plateau, c’est réel. Et ce sera aussi son importance : notre siècle est celui des réalités virtuelles, je suis sûr que partout dans le monde les gens voudront davantage de spectacle vivant car il devient rare.
Guillaume Tion
Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny µ de Kurt Weill et Bertolt Brecht m.s. Ivo Van Hove, dir.mus. Esa-Pekka Salonen. Au Grand Théâtre de Provence, les 6, 9, 11 et 15 juillet à 20 heures.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 7, 2019 8:51 AM
|
Publié sur la page de RFI Écouter l'émission en ligne Electre et Oreste sont écartés du royaume par leur mère Clytemnestre après qu'elle ait assassiné leur père Agamemnon et épousé son amant Egysthe. Les deux enfants déchus se vengeront et tueront leur mère et son époux. Un matricide dont les poètes antiques se sont accaparé,Sophocle et Eschyle . Mais c'est la version d'Euripide, la plus brutale, qu'adapte Ivo Van Hove pour sa deuxième mise en scène à la Comédie-Française après « Les Damnés » de Visconti. Il réunit sur scène les deux pièces « Électre et Oreste ». Le metteur en scène flamand nous en parle.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 27, 2019 8:09 AM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde le 26.04.2019 A l’affiche de trois pièces à la Comédie-Française ce printemps, la comédienne puise au plus profond d’elle-même les émotions de ses personnages.
Sourire radieux, classe naturelle, yeux bleus où passent des tristesses cachées, qui ne seront surtout pas affichées, délayées, livrées en pâture. Une forme de modestie foncière, à rebours de l’esprit actuel, qui consiste à se vendre en permanence.
Et pourtant, elle est en ce moment la prima donna de la troupe de la Comédie-Française, l’actrice dont tout le monde – les amateurs, les spécialistes, ses camarades de la troupe, Denis Podalydès en tête – dit : elle peut tout jouer. Une prima donna en jean et en pull, qui, dans la vie, cultive le naturel, la fraîcheur et la simplicité.
C’est Elsa Lepoivre, 46 ans, dans tout l’épanouissement d’un talent tranquillement mûri par l’amour profond du théâtre comme artisanat et comme art. Cette saison, à la Comédie-Française, elle aura simplement été à l’affiche de quatre productions : Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, où elle a repris le rôle-titre initialement tenu par Guillaume Gallienne ; Fanny et Alexandre, d’après Ingmar Bergman, mis en scène par Julie Deliquet ; Les Damnés, le spectacle créé par Ivo van Hove à partir du scénario du film de Luchino Visconti. Ivo van Hove qu’elle retrouve en cette fin de saison avec une nouvelle création, Electre/Oreste, à partir de deux pièces d’Euripide, où elle joue le double rôle de Clytemnestre et d’Hélène.
« Quand on sent véritablement le retour d’émotion, la catharsis que l’on provoque, c’est d’une force inouïe »
« J’ai voulu faire du théâtre, eh bien j’en fais ! », s’amuse cette grande gigue blonde, abonnée depuis quelques années aux rôles tragiques, mais qui n’aime rien tant que faire le clown en coulisses. Etre à l’affiche de quatre productions, cela signifie, dans le système de l’alternance propre à la Comédie-Française, jouer tous les soirs, et assurer jusqu’à quatre représentations le week-end.
Lire la critique : « Fanny et Alexandre » par la grande porte
Une passionnante mosaïque de la condition féminine
La définition de l’acteur comme « athlète affectif », selon Antonin Artaud, semble avoir été inventée pour elle : il ne s’agit pas seulement de se livrer à une performance, mais de réactiver à chaque représentation les émotions et les énergies propres à chacun des personnages, à la manière dont on le regarde, l’interprète.
En même temps, les rôles qu’endosse Elsa Lepoivre cette saison, à la suite de tous ceux qu’elle a joués ces dernières années, composent une passionnante mosaïque de la condition féminine, ce qui n’est pas tout à fait un hasard chez cette petite-fille d’institutrice féministe. De Lucrèce Borgia à Clytemnestre, à la fois monstres et victimes, de Sophie von Essenbeck dans Les Damnés (rôle pour lequel elle a obtenu le Molière de la meilleure actrice en 2016), manipulatrice machiavélienne, à Emilie Ekdhal, femme solaire prise au piège d’un mari pervers dans Fanny et Alexandre.
Pour des rôles pareils, il faut à chaque fois aller puiser en soi, au plus profond de douleurs, de pulsions et d’émotions intimes. « C’est tout sauf anodin, et cela ne laisse pas indemne, constate Elsa Lepoivre. Mais quel bonheur d’avoir cet exutoire… De pouvoir se servir de ses émotions pour les transformer et les offrir en partage. Je note que toutes les partitions que je joue cette saison sont des partitions de mères. Et cela me trouble, parce que c’est une chose que j’aurais aimé vivre, mais qui n’a pas été possible pour moi. C’est assez bouleversant, de me dire que grâce au théâtre je peux aller farfouiller là-dedans, et donner quelque chose de cela, le temps d’un spectacle. Quand on sent véritablement le retour d’émotion, la catharsis que l’on provoque – c’est flagrant avec Lucrèce, notamment –, c’est d’une force inouïe. C’est pour livrer quelque chose d’aussi intime que je fais ce métier. Mais je ne me noie pas dedans : après la représentation, je vais boire un coup pour me remettre de mes émotions. »
Une humanité inouïe
Les vengeresses, les « monstresses », les diaboliques, les maléfiques, les pures victimes, les femmes qu’on oublie dans un coin, comme Catherine dans Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce, qu’elle a interprétée sous la direction de Michel Raskine en 2008 : à toutes, elle donne une humanité inouïe, dans l’intelligence profonde du parcours de ces femmes, de ce qui les a menées là, à la violence, à la défaite ou aux seconds rôles de la vie.
Lire le portrait dans « M » : Elsa Lepoivre, le théâtre dans la peau
Et c’est bien ainsi qu’elle aborde Clytemnestre, qu’elle retrouve après l’avoir jouée, dans la version de Sénèque, sous la direction de Denis Marleau, en 2011, et qu’elle répète, avec ses camarades (une distribution éblouissante : Suliane Brahim, Christophe Montenez, Denis Podalydès, Loïc Corbery…), sur un plateau que le metteur en scène flamand a voulu envahi par la boue.
« Ivo van Hove, qui, lui, part d’Euripide, ne voit pas Clytemnestre avec les yeux de la haine que lui portent ses enfants Electre et Oreste. Au contraire, il la voit comme une figure maternelle assez douce qui arrive chargée de son propre drame – avoir tué son mari Agamemnon parce qu’il avait sacrifié sa première fille, Iphigénie. Le spectacle raconte vraiment cet éternel drame des places occupées par chacun dans une famille, dans une fratrie, et ce qu’elles suscitent. »
Le tragique lui « colle à la peau »
Comme tout(e) grand(e) comédien(ne), Elsa Lepoivre est bien une vivante bibliothèque des émotions humaines, qu’elle cultive et exorcise à travers le théâtre. Et elle aime les rôles de pure composition à la folie. Rien n’a pu lui faire plus plaisir que lorsque des spectateurs fidèles lui ont avoué ne pas l’avoir reconnue dans La Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, où elle jouait la Poncia, une vieille servante de 70 ans, ou dans Les Ondes magnétiques, de David Lescot, où elle était irrésistible en animatrice de radio libre.
« J’adore ça, disparaître complètement dans les rôles. Je crois que j’aime l’autre – l’autre dans les autres, et l’autre en moi. Et j’aime la comédie, aussi, que j’ai beaucoup jouée à mes débuts avec Pierre Debauche. J’en plaisante régulièrement avec Eric Ruf, en lui demandant quand il compte me mettre dans un petit Feydeau… Mais voilà, depuis quelques années, le tragique me colle à la peau ». Sans doute parce qu’elle est capable de toute la démesure requise, en l’assortissant de multiples nuances.
Elle est actrice jusqu’au bout des ongles – des ongles qui, ce jour-là, sont vernis en orange, pour être assortis à la couleur du décor des Damnés, qu’elle jouera le soir. Le lendemain, elle enlèvera cette laque sophistiquée pour entrer dans la peau d’Emilie Ekdhal ou de Clytemnestre.
Elle ne s’interdit rien, y compris les rêves de jouer aussi des rôles d’hommes – après tout, le très conservateur tournant des XIXe et XXe siècles a bien vu Sarah Bernhardt interpréter Hamlet ou Lorenzaccio, et Maria Casarès le roi Lear, dans la pièce mise en scène par Bernard Sobel. Ni l’envie de jouer un jour le rôle de Gena Rowlands, une de ses idoles, dans Opening Night, de John Cassavetes. Une actrice qui joue une actrice, jouée par une actrice qui, dans la vie, n’a pas besoin de (sur)jouer l’actrice, tant elle l’est, profondément, avec autant de rigueur que de passion.
Elsa Lepoivre en dates
1972
Naissance à Caen
1995
Admission au Conservatoire national supérieur d’art dramatique
2003
Entrée dans la troupe de la Comédie-Française
2016
Molière de la comédienne pour Les Damnés, mis en scène par Ivo van Hove
2018-2019
Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, mis en scène par Denis Podalydès ; Fanny et Alexandre, d’après Ingmar Bergman, par Julie Deliquet ; Les Damnés, d’après Visconti, et Electre/Oreste, d’Euripide, par Ivo van Hove.
« Electre/Oreste », d’Euripide. Mise en scène : Ivo van Hove. Comédie-Française, Salle Richelieu, 1, place Colette, Paris 1er. Tél. : 01-44-58-15-15. A 20 h 30 ou 14 heures, en alternance, jusqu’au 3 juillet. De 5 € à 42 €.
Elsa Lepoivre est également à l’affiche des « Damnés » d’après Luchino Visconti, jusqu’au 2 juin, et de « Fanny et Alexandre », d’Ingmar Bergman, jusqu’au 16 juin, à la Comédie-Française.
Fabienne Darge
Légende photo : Elsa Lepoivre à la Comédie-Française à Paris, le 19 avril. CLAUDE GASSIAN POUR "LE MONDE"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
April 7, 2019 6:03 AM
|
Par Amélie Blaustein Niddam dans Toutelaculture.com - 05.04.2019
Dans le cadre du Festival 100% qui se tient à la Villette jusqu’au 6 avril, Ivo van Hove et l’Internationaal Theater Amsterdam présentent The Hidden Force, également en partenariat avec le Théâtre de la Ville hors les murs. Jusqu’au 11 avril 2019 dans la Grande Halle.
Le grand orfèvre des mises en scène offre une nouvelle fois un écrin somptueux à un texte de Louis Couperus . Après le noir De Dingen Die Voorgijgann présenté au dernier Festival d’Avignon, c’est pour The hidden force, roman écrit en 1900 et très connu aux Pays Bas (une série télévisée en a été tirée en 1974) que le directeur de l’Internationaal Theater Amsterdam pose un acte apocalyptique.
Le décor de Jan Versweyveld mêle l’eau à torrent à un sol carré tout en bois. Les scénographies d’Ivo Van Hove sont reconnaissables à la première seconde. Il réussit toujours à provoquer un choc sans en faire des tonnes, tout en en faisant des tonnes. La machinerie est sans doute énorme ici mais elle reste discrète et c’est l’ambiance qui nous enveloppe.
Pour nous raconter cette histoire qui se passe à Java au XIXe siècle sous colonie néerlandaise, il nous installe dans le très chic cadre du pouvoir, chez le résident (Gijs Scholten van Aschat) et sa nouvelle femme (Halina Reijn). Rien ne semble tranquille, jamais. L’impossible se passe, les tromperies intimes croisent les incompréhensions entre l’occupant et l’occupé.
Comme dans Les Damnés, la vidéo est utilisée comme un acteur à part entière. Mais ici elle ne ne sert pas à décupler les personnages en entrant en eux. En interview, Ivo Van Hove nous a précisé : « Je l’utilise comme des peintures de guerre et comme références aux images historiques. Ce n’est pas vraiment comme j’ai l’habitude de faire. » La vidéo occupe les trois murs et vient avec la musique live (piano européen et percussions orientales) de Harry De Wit nous embarquer sur le plateau presque vide dans une tension ascendante vers l’inextricable.
C’est le début de la fin d’un monde qui s’expose pendant cette mousson interminable qui rend folle l’assistante du résident, Eva (Maria Kraakman) et où les occupants et les occupés doivent trouver des terrains d’entente. Les néerlandais devront composer avec le régent (Barry Emond) et sa puissante et hiératique mère (Chris Nietvelt)
La politique, les passions et la magie sont les yeux au cœur du cyclone. Le tsunami qui s’abat sur la ville symbolise le choc des mondes. Van Hove convoque les dieux et les auteurs antiques en faisant entendre des répliques aux accents grecs : « Et tu lui as donné ta propre fille en victime expiatoire ». L’issue ne peut être qu’un anéantissement Les comédiens de la troupe sont à leur image , toujours éblouissants, dans un jeu naturaliste que seul Ivo Van Hove et ses héritiers maîtrisent. Les artistes doivent faire face à la tempête qui s’empare de la scène et cela permet au théâtre d’exploser. On entend : « l’art est un emplâtre » dans cette tragédie parfaite qui rappelle plus d’un siècle après son écriture l’impossible compréhension de l’autre.
Visuels: @Jan Versweyveld
Avec Bart Bijnens (Si-Oudijck), Mingus Dagelet (Addy de Luce), Jip van Den Dool (Théo van Oudijck), Barry Emond (Soenario, Régent van Ngadjiwa), Eva Heijnen (Doddy van Oudijck),Halina Reijn (Léonie van Oudijck), Maria Kraakman (Eva Eldersma), Chris Nietvelt (De Raden-Ajou Pangeran), Massimo Pesik (serviteur), Dewi Reijs (Oerip), Michael Schnörr (serviteur), Gijs Scholten van Aschat (Otto van Oudijck), Leon Voorberg (Frans van Helderen)
Jusqu’au 11 avril à la Grande Halle

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
September 18, 2016 11:32 AM
|
Par Corinne Denailles dans Webthéâtre
Ivo van Hove est sans conteste un des grands talents actuels de la scène internationale. Avec le même art, il sait être fidèle au texte qu’il met en scène (Vu du pont d’Arthur Miller, 2016, Prix de la critique) et construire un monde, tisser un récit de mots et d’images à partir d’un matériau qu’il creuse et nourrit, qu’il réinvente totalement. Pour la Cour d’honneur d’Avignon il s’est emparé des Damnés (La caduta degli dei, littéralement La chute des dieux) de Visconti (1969) avec une maîtrise et une force de frappe incomparable, recomposant les éléments du film pour parler d’aujourd’hui, du risque de résurgence de nationalisme et des effets économiques et politiques délétères associés. Et le parallèle est loin d’être vain. L’histoire sulfureuse de la manipulation d’une famille de grands industriels, les Von Essenbeck (en réalité les aciéries Krupp) qui croiront pouvoir profiter de la situation économique et politique et se feront engloutir par le régime nazi suinte la corruption, la trahisons, toutes les violences y compris sexuelles, et révèle un monde en folie qui a perdu toute humanité.
Tout commence avec l’assassinat du baron Joachim (Didier Sandre, aristocrate et digne) qui ne voulait consentir à fabriquer des armes pour le régime nazi. On accuse Herbert (Loïc Corbery excellent, figure d’intégrité dans cet enfer), hostile à Hitler et qui doit fuir. Aschenbach (Eric Genovèse), ange noir du pouvoir, va manipuler tout le monde avec la complicité de Bruckmann (incroyable et méconnaissable Guillaume Gallienne) et de Konstantin von Essenbeck (Denis Podalydes, surprenant dans ce rôle de brute répugnante). La baronne Sophie Essenbeck, autoritaire, glaçante et cynique, finira dans son cercueil dans un sinistre costume de noces aux côtés de son amant Konstantin. Elle est la mère de Martin qu’elle manipule, jeune homme inverti, pervers, pédophile, rebelle qui se retrouve à la tête des aciéries et consentira à toutes les trahisons, symbole absolu du Mal, magnifiquement interprété par Christophe Montenez. Chez Visconti, Helmut Berger apparaissait travesti en Marlène Dietrich. C’est un vrai bonheur de voir la troupe de la Comédie-Française dans la Cour d’honneur après plus de vingt ans d’absence et d’admirer la cohésion et le talent de comédiens tous très doués, libres de tout académisme et capable de dépasser les frontières de leur art.
La scénographie du spectacle utilise toute l’ouverture immense du plateau : à jardin des loges d’artistes, au centre un grand espace de jeu orange, évocation du métal en fusion des aciéries, à cour, des cercueils alignés qui recevront successivement les corps dans un rituel répétitif. La musique (enregistrée ou joue en direct par des musiciens qui accompagnent les acteurs) emprunte à la musique classique ou au rock métal allemand. La vidéo occupe une place prépondérante, parfois un peu envahissante, voire intrusive, même si elle est toujours pertinente. Sur un écran géant, des gros plans scrute les personnages et montre des images d’archives, plus précisément quatre événements symboliques : l’incendie du Reichstag, le camp de concentration de Dachau, un autodafé au cours duquel sont égrenés des noms d’écrivains concernés, la nuit des longs couteaux, orgie sanglante. Quand l’écran ne renvoie pas l’image du public muet, complice malgré lui de tant d’horreurs. Un travail tout le temps inventif et jamais redondant, ajoutant du sens au sens, associé à un travail sur le son exceptionnel (au début du spectacle les gradins vibrent de grondements puissants évoquant le bruit des machines. Le chant nazi chanté par un chœur de SA sur l’écran enveloppe le public créant une sensation vraiment dérangeante).
La mise en scène de Ivo Van Hove s’éloigne de tout réalisme en n’utilisant que les codes du nazisme reconnaissables, elle joue conjointement de la stylisation et d’images chocs et réussit à faire en sorte que l’histoire d’hier parle d’aujourd’hui, concluant par une scène finale redoutable de violence et d’efficacité.
Les Damnés, d’après Luchino Visconti, mise en scène Ivo van Hove. Scénographie et lumière Jan Versweyseld. Costumes An d’Huys. Vidéo Tal Yarden. Musique et concept sonore Eric Sleichim . Dramaturgie Bart van den Eynde. Avec la Troupe de la Comédie-Française : Sylvia Bergé, Éric Génovèse, Denis Podalydès, Alexandre Pavloff, Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre, Loïc Corbery, Adeline d’Hermy, Clément Hervieu-Léger, Jennifer Decker, Didier Sandre, Christophe Montenez
Et Basile Alaïmalaïs, Sébastien Baulain, Thomas Gendronneau, Ghislain Grellier, Oscar Lesage, Stephen Tordo, Tom Wozniczka.
A la comédie-Française à 20h30, dimanche à 14h.
Avec Bl !ndman [Sax] : Koen Maas, Roeland Vanhoorne, Piet Rebel, Raf Minten
© Christophe Raynaud de Lage
Le scénario Les Damnés est paru dans le n°634 de la revue L’Avant-Scène Cinéma.
Les Damnés fait l’objet d’une Pièce (dé)montée, dossier pédagogique réalisé par Canopé.
Le spectacle sera diffusé sur Culturebox pendant 6 mois.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 7, 2016 3:06 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde
C’est un triomphe étrange qui a accueilli, mercredi 6 juillet au soir, la première représentation des Damnés dans la Cour d’honneur du Palais des papes, en ouverture de la 70e édition du Festival d’Avignon. Un triomphe grave, presque solennel, à la hauteur du sujet, et du spectacle grandiose et glaçant – mais pas glacé – signé par le metteur en scène flamand Ivo van Hove, et joué par la troupe de la Comédie-Française.
Le public est resté tétanisé quelques secondes, avant de se lever par vagues qui ont fini par gagner le carré VIP au centre des gradins, au cœur duquel se trouvait la ministre de la culture, Audrey Azoulay, entourée par Olivier Py, le directeur du Festival d’Avignon, et par Eric Ruf, l’administrateur général de la Comédie-Française, venu assister au retour de la troupe, après vingt-trois ans d’absence dans le Vaucluse.
On ne sait ce qui frappe en premier lieu dans cette réinterprétation magistrale de l’histoire inventée en 1969 par Luchino Visconti : la pertinence de la remettre sur le devant de la scène aujourd’hui, dans une Europe à nouveau gagnée par les nationalismes et les tentations autoritaires ; l’audace formelle du metteur en scène, qui invente ici une des fusions les plus poussées entre cinéma et théâtre qu’il ait été donné de voir ; ou le jeu brillantissime et intense offert par les comédiens-français.
CES NOCES SONT L’OCCASION POUR LE METTEUR EN SCÈNE D’UN MARIAGE INÉDIT ENTRE THÉÂTRE ÉPIQUE ET THÉÂTRE DRAMATIQUE, ET ENTRE THÉÂTRE ET CINÉMA
Comme dans le film, l’histoire commence le 27 février 1933. A Berlin, le Reichstag est en flammes. Dans la famille von Essenbeck, qui a fait fortune dans l’industrie sidérurgique, on célèbre l’anniversaire du patriarche, Joachim. Le bonheur familial en trompe-l’œil sera de courte durée. Les rivalités familiales, dignes de la tragédie grecque, et la soif de pouvoir, aussi dévorante que chez Shakespeare, ne vont pas tarder à se déchaîner, attisées par un deus ex machina appartenant aux cercles hitlériens, le Hauptsturmführer von Aschenbach.
En adaptant Les Damnés, Ivo van Hove rompt totalement avec l’esthétique profuse et historique du film. Il est en revanche profondément fidèle à la ligne de fond qui le sous-tend, ce regard viscontien sur les noces de sang du capitalisme et du nazisme. Le cinéaste italien disait d’ailleurs que ses Essenbeck, aussi déments, aussi déshumanisés fussent-ils, étaient encore bien en dessous de la réalité incarnée par la famille Krupp…
Et ces noces sont l’occasion pour le metteur en scène d’un mariage inédit entre théâtre épique et théâtre dramatique, et entre théâtre et cinéma. Dans la Cour d’honneur du Palais des papes, il n’y a pas vraiment de décor, pas de reconstitution d’une grande demeure bourgeoise. Le mur de la cour, cette « pierre glorieuse » célébrée par Jean Vilar, est à nu. Comme l’avait fait Patrice Chéreau, dont Ivo van Hove est un grand admirateur, avec son Hamlet, le metteur en scène a fait le choix de l’horizontalité de la cour, et pas de sa verticalité. Au centre du plateau, un grand rectangle orange, aire de jeu, creuset en fusion de toutes les folies familiales et politiques.
Rituel de mort
Ivo van Hove la met en scène, cette histoire, comme un rituel de mort, qui voit les protagonistes, l’un après l’autre, passer de jardin à cour, des loges de théâtre où ils se préparent et s’habillent à vue aux cercueils qui scellent leurs destinées. Le metteur en scène, avec son scénographe habituel, Jan Versweyveld, a conçu cet « espace vide » pour mieux développer le dialogue qu’il instaure entre cinéma et théâtre : un dialogue qui, à part chez Frank Castorf, n’avait jamais été aussi loin.
Le travail réalisé avec le vidéaste américain Tal Yarden est stupéfiant à divers titres, qui semble jouer sur toutes les gammes à disposition. Images filmées en direct, qui jamais ne viennent doubler l’action sur le plateau, mais l’approfondissent dans un rapport intime. Images enregistrées et projetées parallèlement à l’action, qui permettent de donner toute leur force aux scènes les plus difficiles, comme celle de la Nuit des longs couteaux, en suggérant plus qu’en montrant directement. Images démultipliées, floutées, grainées, warholiennes, jeu entre la couleur et le noir et blanc, dans le passage de la vie à la mort…
Et c’est ainsi qu’Ivo van Hove retrouve une dimension opératique, mythique et épique, tout en faisant jouer le drame à ses comédiens de la manière la plus organique et la plus humaine possible. Et ils jouent le jeu, ces comédiens-français que l’on dit souvent, par pur cliché, prisonniers d’un certain académisme, de manière éblouissante.
Emotion
La place manque pour décrire le travail de chacun. Ce que fait ici Denis Podalydès est particulièrement saisissant, dans le rôle sans doute le plus ingrat, le plus abject de la pièce, celui du SA (Section d’assaut) Konstantin von Essenbeck. Guillaume Gallienne, dans celui de Friedrich Bruckmann, Macbeth au petit pied, fait montre d’une sobriété et d’une intériorité inédites et magnifiques.
Tous apportent une couleur singulière, une force, une émotion. Mais ici, on se souviendra particulièrement de Christophe Montenez. Avec lui, Martin, le pivot de l’histoire, garde tout son mystère : un abîme noir de ressentiment, de haine et de perversion que le jeune comédien exprime avec une douceur vénéneuse et morbide. Et l’on se souviendra longtemps d’Elsa Lepoivre, en Sophie von Essenbeck-Lady Macbeth, hantant de sa folie les souterrains du Palais des papes. La grande blonde est bien la reine des Damnés.
Les Damnés,d’après le film de Luchino Visconti. Mise en scène : Ivo van Hove. Cour d’honneur du Palais des papes, à 22 heures, jusqu’au 16 juillet. Durée : 2 h 20. Tél. : 04-90-14-14-14.
Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale)
Journaliste au Monde

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 30, 2016 3:17 AM
|
Par Marie-Pierre Ferey pour AFP TV5Monde :
C'est un maître du théâtre et un fan absolu de cinéma. Ivo van Hove va piloter le grand retour de la Comédie-Française après 23 ans d'absence au Festival d'Avignon, avec l'adaptation du scénario des "Damnés" de Visconti.
"Pour un metteur en scène, la Cour d'honneur est un grand défi. Ne pas s'y confronter, ce serait un peu comme refuser de monter Shakespeare, autant changer de métier!" lance-t-il.
Ivo van Hove fait partie de la poignée de metteurs en scène d'envergure mondiale que les grandes scènes s'arrachent. Ses pièces sont parfois données en plusieurs langues, comme "Vu du pont", donnée en Français au théâtre de l'Odéon et en anglais à Londres puis New York. Il est aussi un des derniers à avoir travaillé avec David Bowie, sur la mise en scène de la pièce musicale "Lazarus", peu avant sa mort.
Lorsque Eric Ruf, le patron de la Comédie-Française, l'a sollicité pour la Cour d'honneur il n'a pas hésité une seconde. "On ne savait pas quelle serait la pièce, mais j'ai dit oui immédiatement. On a beaucoup discuté, de textes classiques ou modernes du XXe siècle, et j'ai demandé à Eric Ruf si on pouvait faire quelque chose qui ne se fait pas tellement à la Comédie-Française par exemple une adaptation d'un film, et là c'est lui qui a dit oui immédiatement."
Eric Ruf cherchait depuis des mois un maître du théâtre pour frotter la troupe à d'autres esthétiques, d'autres méthodes, la "bousculer".
Il ne pouvait mieux trouver: Ivo van Hove a mis au point une esthétique unique, qui mélange subtilement le théâtre et le cinéma. Il aime s'emparer de films pour les adapter au plateau. Certaines scènes sont filmées "live" en coulisses, offrant un contrechamp au jeu des acteurs. "Les Damnés" sont son troisième emprunt à Visconti, après "Rocco et ses frères" et "Ludwig".
"J'ai vu beaucoup de films, je suis un film freak", avoue-t-il. "A 57 ans, j'ai fait beaucoup de théâtre et pour un metteur en scène c'est un défi d'inventer un monde théâtral à partir d'une matière qui n'avait pas été pensée pour ça, Visconti n'a jamais eu l'intention de faire une pièce de théâtre des Damnés".
- Montée des populismes en Europe -
Le spectacle s'ouvre sur des images d'archives de l'incendie du Reichstag. Les flammes en noir et blanc dévorent l'écran tandis que les comédiens prennent position sur scène. On est dans la maison familiale des Essenbeck, une dynastie allemande à la tête d'aciéries vitales pour le Reich. La pièce raconte le basculement de la famille dans la barbarie nazie et dans la haine.
Pour Ivo van Hove, "il y a beaucoup de raisons sur le plan politique de faire ce spectacle aujourd'hui. On voit partout en Europe mais aussi dans le monde, en Amérique, une montée des populismes et de l'extrême droite - et je ne vais pas comparer ces partis avec le nazisme - mais il y a quelque chose qui donne à réfléchir: quand un chef d'Etat, un politicien nous dit de suivre nos sentiments profonds, nos pulsions, c'est dangereux".
"Un autre thème très important dans ce spectacle est la liaison dangereuse entre le monde économique et le monde politique, pour des raisons purement opportunistes, là il s'agit de sidérurgie mais aujourd'hui on pourrait penser au pétrole ou au commerce des armes".
"Le troisième thème important pour moi, c'est le basculement des valeurs, en un temps très court. Le jeune Martin (l'héritier des aciéries) finit par devenir nazi, non pas par idéologie, mais parce qu'il est utilisé par les vrais idéologues. Martin est frustré parce qu'il ne reçoit pas l'amour de sa mère qu'il désire tellement, et il devient un fasciste pour se venger d'elle".
Pour Ivo van Hove, "on peut comparer cela au jihadisme: ce sont toujours des jeunes hommes qui sont frustrés dans la société, qui n'ont pas de boulot, ce n'est jamais pour des raisons idéologiques, ce sont les religieux radicaux qui utilisent ces jeunes gens, qui ont rarement plus de 30 ans".

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
June 28, 2016 6:49 PM
|
Par Fabienne Pascaud dans Télérama :
Tout l’inspire : Shakespeare bien sûr, mais aussi les films de Bergman ou le rock de Bowie. A Avignon, Ivo Van Hove, metteur en scène flamand adapte “Les Damnés” de Visconti, avec les comédiens du Français.
C’est l’événement du festival 2016. Non seulement le retour de la Comédie-Française dans la cour d’honneur du palais des Papes, où on ne l’avait plus vue depuis un Dom Juan de Molière en 1993. Mais la dernière mise en scène du patron du Toneelgroep d’Amsterdam, Ivo Van Hove, dont on avait déjà pu admirer à Avignon les puissantes Tragédies romaines, d’après Shakespeare (2008), ou The Fountainhead, d’après le roman d’Ayn Rand (2014). En scène, l’utilisation d’images vidéo cadrant les acteurs au plus serré faisait merveille. L’artiste aime à resculpter charnellement les textes, à tirer matière scénique de romans ou de films — de Bergman à Cassavetes et aujourd’hui Visconti. C’est sa manière de se lancer des défis, après plus d’une centaine de spectacles depuis près de quarante ans.
Mais sa palette d’intervention, de passions, a toujours été large : d’Arthur Miller (Vu du pont, à l’Odéon en 2015, Grand Prix de la critique 2016) à David Bowie, dont il signa le dernier spectacle à Broadway, Lazarus, fin 2015.
Avec sa dégaine mince et racée à la Cary Grant, son verbe sec, rapide, l’artiste belge de 57 ans, présent à Londres comme à New York, Berlin ou Paris, théâtralise donc cet été le scénario des Damnés, film scandale, film requiem sorti en 1969. C’était une des premières fois qu’on y observait sur grand écran les compromissions de la grande bourgeoisie industrielle allemande avec les nazis ; et la libération de tous les interdits, de toutes les perversions dans un monde en train de basculer vers le mal. Une fascinante danse de mort…
Après tant d’œuvres sur cette tragique période, pourquoi ‘Les Damnés’ ?
Pour moi, Visconti n’a pas fait un film sur le nazisme, mais sur le renversement possible des valeurs dans toute
société. Il montre combien le monde peut devenir barbare au nom de simples intérêts économiques et financiers. Pour obtenir le pouvoir dans l’aciérie familiale, une veuve et mère à la lady Macbeth manipule ici un fils follement désireux de se faire aimer d’elle, mais aux prises avec trop d’instincts pervers… Il se retrouvera sans morale ni identité à la fin de l’histoire. Il n’aura rien appris de l’existence, où, capable de tous les excès, il promène juste sa violence. Tel un djihadiste ? Tel un militant d’extrême droite ? Les Damnés, qui se passe dans les années 1933-1934, est pour moi d’une troublante actualité dans cette Europe où tout pourrait désormais basculer…
Travailler avec la Comédie-Française a-t-il été particulier ?
J’ai été ému de voir les comédiens arriver aux premières répétitions le texte su, concentrés, chaleureux. A la fois sérieux et pleins d’humour, tels Guillaume Gallienne et Denis Podalydès. Bien sûr, j’avais déjà travaillé avec des acteurs français dans Vu du pont, ou avec Juliette Binoche dans Antigone, mais je suis étonné par le sens du collectif de cette troupe. Ils s’entraident, savent s’apporter des commentaires constructifs ; certains viennent même assister à des répétitions où ils ne sont pas programmés… Si diriger des acteurs en français a toujours été un de mes cauchemars récurrents, finalement tout se passe bien. Dans la détente et l’écoute…
“Un de mes pires cauchemars était qu’on exige que je dirige un spectacle en français”
Un cauchemar ? Mais vous parlez parfaitement français…
Oui. Est-il dû aux sempiternels problèmes entre Belges et Flamands ? Jeune, j’allais en vacances avec mes parents sur la Côte d’Azur ; j’ai fait mes études de droit en français. Mais rien n’y a fait. En France, plus qu’ailleurs, on croit aider les étrangers en les corrigeant quand ils parlent. Même les garçons de café n’y résistent pas. Moi, ça m’a toujours bloqué, terrifié. Et un de mes pires cauchemars était effectivement qu’on exige que je dirige un spectacle en français. Même si j’ai fini par accepter le défi et m’exprime un peu mieux…
Comment travaillez-vous ?
Vite. Les répétitions sont rapides — trois semaines — car je prépare énormément en amont. Un an à l’avance. Je relis le texte mille fois, je questionne chaque phrase. Comme je travaille souvent avec de la vidéo, il faut aussi prévoir précisément et à l’avance les places des caméras et des acteurs. Avec Jan Versweyveld, le scénographe et vidéaste de tous mes spectacles, nous avons peu à peu mis en place une manière très personnelle, je crois, de raconter une histoire.
L’omniprésence de la vidéo aujourd’hui au théâtre n’est-elle pas excessive ?
Les Grecs utilisaient les masques comme des porte-voix. Ils permettaient de concentrer et projeter la voix des comédiens pour qu’elle soit audible par des milliers de spectateurs. Aujourd’hui on peut utiliser d’autres moyens techniques pour rapprocher les acteurs du public. La vidéo permet ainsi de mieux les suivre, de surprendre leurs émotions au plus intime. Et elle libère aussi le metteur en scène. Grâce à elle, il peut montrer le « hors champ », ce qui se passe aux abords de la scène. Chez Shakespeare, dans les corridors du pouvoir par exemple, qu’on ne représente guère d’habitude, mais que j’ai pu montrer dans Kings of war (Prix de la critique au titre du meilleur spectacle étranger), grâce à la vidéo. Je ne l’emploie jamais pour la beauté des images mais pour la construction de l’histoire.
Le cinéma vous a-t-il beaucoup influencé ?
Adolescent, j’ai aimé Kubrick, Orange mécanique entre autres. Mais un film a bouleversé ma vie : Le Dernier Tango à Paris, de Bernardo Bertolucci.
Pourquoi ?
A cause de l’amour exclusif de Marlon Brando pour la jeune Maria Schneider. Il ne veut rien savoir d’elle, la retrouve dans un appartement vide. Ils s’aiment passionnément trois jours durant sans que ce soit compréhensible. L’amour d’un couple est toujours incompréhensible pour les autres. Le film m’a fait accepter ça. Mais j’aime beaucoup aussi Cassavetes, Bergman dont j’ai adapté Cris et chuchotements, qui parle de la mort de manière si extrême.
Pourquoi tant d’adaptations de scénarios de films ?
Parce que certains films abordent des thèmes que le théâtre ne traite pas. J’ai monté la trilogie d’Antonioni, aussi, L’Avventura, La Nuit, L’Eclipse. Mais les scénarios étaient faibles et j’ai fait un spectacle trop compliqué techniquement pour les acteurs, trop difficile à maîtriser sur le plateau. Une erreur.
“Shakespeare m’inspire. Dans son théâtre, il y a toujours des énigmes à résoudre pour un metteur en scène”
Vous revenez quand même régulièrement à Shakespeare ?
Il est tellement grand ! Non que ses pièces soient forcément bien construites, mais ce sont des mondes, des paradis perdus, des royaumes de l’imagination, des utopies, des viviers d’idées. Je me suis rendu compte que j’avais besoin d’y revenir tous les trois ans environ. Shakespeare m’inspire. Dans son théâtre, il y a toujours des énigmes à résoudre pour un metteur en scène, des scènes à couper ou à improviser pour en retrouver le sens. Du travail jubilatoire à -affronter. Et quelle liberté ! Shakespeare ne raconte pas -seulement des histoires, mais une vision du pouvoir, de la politique, de l’amour. J’ai mis deux ans à préparer Kings of war, contraction de Henry V, Henry VI et Richard III, que vous avez pu voir à Paris. Déjà Shakespeare y pressent — comme nous devrions le faire aujourd’hui — qu’il faut adapter à la société de son temps les manières de gouverner. Actuellement, par exemple, la tension entre le civil et le religieux est si forte, partout dans le monde, qu’on ne peut pas ne pas en tenir compte. Le théâtre traite de l’irrationnel, du rêve, de l’angoisse, de tout ce qu’on ne veut pas dans sa vie mais qu’on est heureux de pouvoir exorciser grâce au spectacle. Les acteurs sont des exorcistes.
Comment les dirigez-vous ?
J’aime que mes mises en scène soient comme des maisons pour eux, qu’ils s’y sentent bien. Je ne répète en général que quelques heures l’après-midi — le matin je m’occupe de mon théâtre d’Amsterdam, des tournées, des projets à venir. Mais dès la première répétition, tout est prêt dans ma tête. J’ai la vision d’ensemble depuis longtemps. Je sais ce que je veux. Jamais avec moi de première « lecture à la table », où le metteur en scène lit et décortique les répliques avant de les faire répéter. Parler des scènes est trop intellectuel. Dans la vie sait-on pourquoi on agit de telle ou telle façon ? Pourquoi les acteurs le sauraient-ils davantage ? Il faut avant tout incarner les situations, découvrir ensemble la pièce en la jouant. Et selon son ordre même. Chronologiquement. Rien que de très banal, vous voyez… Je n’ai pas de méthode, car chaque acteur est différent. Certains ont besoin de comprendre la psychologie du personnage, d’autres surtout pas. Je ne suis pas un gourou. J’essaie de m’adapter au contraire aux besoins de chacun. Si j’aime provoquer les confrontations en répétitions, j’ai aussi horreur des conflits. J’ai besoin d’harmonie dans le travail.
Avez-vous eu des modèles côté mise en scène ?
Patrice Chéreau. Je ne l’ai pas connu mais j’admirais tout de lui. Le cinéaste, y compris pour ses films moins brillants comme Judith Therpauve, le metteur en scène d’opéras… L’entrée du chœur dans La Maison des morts, de Janácek, reste pour moi un moment fulgurant, comme l’apparition du fantôme du roi sur son cheval dans Hamlet, la cruauté de ce père-roi qui piétine presque Hamlet au sol… La danse avec Pascal Greggory pour Dans la solitude des champs de coton sur la musique de Massive -Attack m’a aussi fait pleurer ; il y avait un lien père-fils si troublant. J’ai appris beaucoup en observant les spectacles de Chéreau, et quelques documentaires sur son travail. D’abord qu’on parle aussi avec son corps. Les hommes sont des animaux, très physiques. Les mots ne sont qu’une des formes de leur langage, parmi tellement d’autres.
J’ai appris ensuite qu’un metteur en scène ne doit jamais tout dire de ce qu’il sait de la pièce à ses acteurs mais attendre que les secrets adviennent dans leur tête. Enfin, Chéreau m’a enseigné à utiliser la musique. Il n’y a jamais de longs silences dans mes spectacles. Depuis que je fais des mises en scène d’opéras — de Berg à Wagner, de Mozart à Janácek —, la musique m’aide à structurer la représentation, à lui donner du rythme, de l’émotion.
N’est-ce pas parfois une facilité ?
Et alors ? On est immédiatement dans l’atmosphère. La musique est généreuse. Ne croyez pas que le silence m’angoisse. Mais s’il y a trop de silence, on ne l’entend plus. J’utilise toutes les musiques, du baroque à David Bowie.
Vous avez justement mis en scène le dernier spectacle de David Bowie, Lazarus, peu avant sa mort…
J’étais son fan absolu depuis le premier concert auquel j’ai assisté. Pour sa musique, d’abord ; pour la liberté d’être qu’il nous a offerte, aussi. Surtout aux homosexuels, dont je suis. Je me souviens qu’il avait embrassé sur la bouche, lors du concert, un de ses musiciens ; j’avais 17 ans, Bowie rendait possible l’amour homosexuel, et beau, et sexy. Ceux qui avaient du mal, encore, à se faire tolérer dans leur sexualité, étaient fascinés, bouleversés. Bowie est devenu une sorte de modèle. J’ai utilisé quantité de ses chansons dans tous mes spectacles. Alors quand le producteur Robert Fox m’a contacté pour Lazarus, j’ai d’abord cru à une blague. J’ai pourtant rencontré David trois semaines après. Il savait tout de moi, et même l’utilisation de ses chansons dans mes spectacles… Il était d’un professionnalisme obsessionnel. Je lui ai demandé d’avoir le droit de tout savoir aussi, sur son album, avant de le mettre en scène. Il a accepté, ce que ses proches m’ont dit très rare ; il m’a expliqué chaque chanson, et les implications personnelles qu’elles avaient. Elles en avaient toutes. Lazarus, c’est lui ; on est dans son cerveau. C’est l’impression même que j’ai voulu donner via un décor d’appartement où les deux fenêtres figuraient ses deux yeux… Mais Bowie est toujours resté très secret : je ne suis jamais allé chez lui. Il me manque. D’autant qu’il ne voulait pas mourir. Il m’avait déjà demandé de réfléchir à un autre spectacle ensemble.
L’homosexualité a-t-elle au départ été quelque chose de difficile à vivre ?
Pour moi, pas du tout. J’ai su dès 11 ans que j’étais homosexuel. Et je vis depuis trente-six ans avec mon scénographe, Jan Versweyveld. Pour mes parents, en revanche, ça a d’abord été un drame. Ils m’ont donné une éducation rigoureuse, qui d’ailleurs m’a beaucoup servi. Mon père était le pharmacien d’une petite ville de deux mille habitants, essentiellement des fermiers et des mineurs venus d’Italie. Pour ces gens-là, mes deux frères et moi, nous étions « les fils du pharmacien », espèce de notable local. Je me sentais exclu, et moi, j’aime l’inclusion, pas l’exclusion. J’ai donc été heureux, après trois semaines de larmes, que mes parents me mettent en internat à 11 ans, au milieu de huit cents garçons. Ils travaillaient beaucoup, nous confiaient à nos grands-pères, qui n’étaient pas riches : pas d’auto, pas de téléphone, peu de chauffage. Je suis content d’avoir vécu ça aussi, avec eux. Mais ça a été une chance de quitter mon village. A l’internat, j’ai tout vécu, la brutalité, la tendresse, les secrets, la mort d’un ami à vélo, le deuil. La peur, aussi, quand un professeur nous a expliqué froidement ce qu’était la bombe atomique. J’avais 12 ans et n’en ai pas dormi pendant trois nuits. Mais ce n’est pas mauvais d’être terrifié pour un jeune garçon. Ça développe l’imaginaire.
“Dans tous mes spectacles on voit qui je suis ; ce sont des autobiographies masquées”
Comment est apparu le théâtre ?
A l’internat ! Le mercredi, on pouvait choisir entre sport et promenade, ou groupe de théâtre. J’ai choisi théâtre. Et j’ai adoré ces atmosphères du mercredi, la chaleur de faire quelque chose ensemble. On était comme un monde dans le monde. Personne ne savait ce qu’on préparait. Et les applaudissements, après ! Je suis vite devenu le leader du groupe. J’avais ça en moi. Mais je n’étais pas encore décidé à en faire mon métier. J’ai commencé le droit à l’université d’Anvers. Quand j’ai réalisé que je finirais dans un bureau tous les jours au même endroit, j’ai compris que je devais faire du théâtre. Sinon je serais malheureux, frustré, violent. J’ai alors monté Agata, de Marguerite Duras, à 23 ans. Une grande comédienne belge est venue me dire « Ivo, le théâtre et toi, c’est un mariage parfait. » Je l’ai accepté. J’ai épousé le théâtre pour le meilleur et pour le pire. C’est ma vie. Il faut trouver dans l’existence quelque chose qui rend heureux. Ce peut être un mari, un ami, une famille, un job. Moi, c’est le théâtre. Le théâtre est mon instrument. Je peux y exprimer tout ce que je pense et sens de la vie, la politique, la société. Dans tous mes spectacles on voit qui je suis ; ce sont des autobiographies masquées.
Vivre avec votre scénographe, Jan Versweyveld, a renforcé les épousailles avec le théâtre ?
On s’est connus à 20 ans. Jan sortait d’une école d’arts plastiques. Nous avons collaboré dès mon premier spectacle. Faire du théâtre ensemble a sauvé notre relation et en même temps c’est de plus en plus difficile. On exige toujours mieux de l’autre. On redoute la routine. Comme dans le sport de haut niveau, on veut aller aux jeux Olympiques, être les meilleurs au monde… Alors on travaille sans arrêt. Longtemps à l’avance, Jan lit, relit énormément les textes, prépare ses images. Dans un documentaire qui m’était consacré, je l’ai entendu dire que l’aspect essentiel de mon travail était ma patience avec les acteurs et ma tendresse pour eux. Notre vie est une conversation ininterrompue sur le théâtre. Nous avons peu de vie en dehors du théâtre.
‘Lazarus’, ‘Les Sorcières de Salem’ à Broadway, l’ouverture d’un congrès sur l’Europe à Amsterdam, le Festival d’Avignon, n’y a-t-il pas risque de devenir un metteur en scène à la mode internationale ?
C’est ma vie, ça me regarde. La saison 2015-2016 m’a permis de vivre dix années en une. J’aime ça. Personne de toute façon ne peut m’acheter ou rien m’imposer : je ne peux faire que ce que je veux faire. Ainsi, quoi qu’on m’ait demandé, je suis venu tardivement à la mise en scène d’opéras : je ne m’estimais pas prêt. Je ne souhaite par pour autant faire les choses lentement, progressivement. Je m’ennuie trop vite. J’ai besoin d’être une minute là, deux minutes là-bas. Je n’aurais jamais pu être acteur
•
1958 : Naissance à Heist-op-den-Berg (Belgique).
2001 : Fondation du Toneelgroep Amsterdam.
2008 : Tragédies romaines, d’après Shakespeare, au Festival d’Avignon.
2014 : The Fountainhead, d’après le roman d’Ayn Rand, au Festival d’Avignon.
2015 : Mise en scène de Lazarus, dernier spectacle de David Bowie.
2016 : Kings of war, d’après Shakespeare.
A voir :
Les Damnés d’après Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico Medioli, 6 au 16 juil., 22h, cour d’honneur du palais des Papes, Avignon (84). Tél. : 04 90 14 14 14. Retransmission le 10 juillet à 22h50 sur France 2.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 30, 2015 6:55 PM
|
Par Catherine Robert pour La Terrasse :
Ivo van Hove crée la version française de sa mise en scène de Vu du pont. Entre colère et érotisme, défit et dépit, les passions s’exacerbent jusqu’à un point d’incandescence éblouissant. La scénographie de Jan Versweyveld installe le public dans la situation que suggère le titre de la pièce d’Arthur Miller : la scène est comme vue du pont, celui de Brooklyn, qui permet de plonger sur le quartier de Red Hook et d’observer la vie de ceux qui vivent dans les bas-fonds de New York. L’installation trifrontale des gradins en surplomb, et la boîte qui s’ouvre et se ferme sur les immigrés italiens qui gagnent le pain du rêve américain en trimant sur les docks, sont saisissantes. On observe la tragédie, qui paraît d’autant plus inéluctable que ses protagonistes sont enfermés dans la cage de leurs affects. Entre Eddie et les siens, se tient l’avocat Alfieri (Alain Fromager, remarquable de justesse et d’empathie), qui sert lui aussi de pont entre le pays dont il a choisi de servir la loi et ses compatriotes immigrés qui se débattent entre rêve d’ascension sociale et réalité sordide, loi des hommes et loi du sang. Mais aucun pont ne résiste lorsque gronde le torrent des égarements : Eddie a quitté son lit pour le laisser aux cousins italiens, et comme une rivière tumultueuse, ses affects débordent sur les rives jusqu’alors paisibles du cours de son existence.
Un drame à hauteur de tragédie
Charles Berling est Eddie : un bloc tout en fêlures. Remarquablement dirigé par Ivo van Hove, le comédien interprète la victoire de la folie sur la bonté avec une précision et une intelligence psychologique confondantes de vérité. Le corps maladroit sous la caresse et brutal dans les coups, Berling offre une élégance bougonne au colosse aux pieds d’argile que renverse le trop-plein d’amour qu’il a pour Catherine, l’enfant qu’il ne supporte pas de découvrir femme pour un autre. Caroline Proust (Béatrice) et Pauline Cheviller (Catherine), la sage et la folle, la mère et la fille, l’oblative et la conquérante, magnifient la polarisation des affects qui fait osciller et affole Eddie, qui ne sait plus à quel sein se vouer. Nicolas Avinée, Pierre Berriau, Frédéric Borie, Laurent Papot offrent à la bande qui entoure le drame d’Eddie une authenticité hors afféteries folkloriques (les costumes et le jeu évitent la reconstitution caricaturale) et hausse les protagonistes de cette course à la mort au rang de héros tragiques. Ivo van Hove (dont la science de la mise en scène irradie dans chaque geste et chaque adresse, jusqu’au génie dans les derniers mouvements) offre un très grand moment de théâtre avec cette pièce. Il en universalise le propos, dont la portée politique est d’autant plus aiguisée : ce qu’elle ausculte des difficultés à immigrer et à accueillir l’autre en sa famille, en son pays et en son cœur sonne aujourd’hui comme une vibrante alerte.
Catherine Robert

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 27, 2015 2:21 PM
|
Publié par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Une fois encore Ivo van Hove, le grand maître de la formidable troupe du Toneelhroep d’Amsterdam revient au festival Exit à la Maison des arts de Créteil. Une fois encore il nous éblouit et nous étonne avec sa mise en scène de « Mary Stuart » une adaptation de la pièce de Schiller. Une leçon de théâtre à travers une méditation sur la lutte pour le pouvoir, son exercice pour les vainqueur (et ce qui va avec : responsabilité, légitimité, solitude), la haine et la peur de nuisance des vaincus et les affres de ces derniers.
Le président Hollande qui ne va jamais au théâtre devrait inviter la chancelière Merkel à ce spectacle d’une grande pièce allemande dite en néerlandais et présentée avec des sous-titres français. Ils auraient beaucoup de choses à se dire et à méditer à la sortie après avoir salué la troupe du Toneelgroep renforcée par des acteurs du Toneelhuis d’Anvers, une distribution parfaite emmenée par les deux actrices, compagnes de route du metteur en scène, Chris Nietvelt (Elizabeth Ier) et Halina Reijn (Mary Stuart).lls pourraient féliciter, chaleureusement comme il se doit, Ivo Van Hove, un grand monsieur. Lire l'article entier ---> http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-thibaudat/270315/marie-stuart-dapres-schiller-par-ivo-van-hove-une-lecon-de-theatre

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
March 26, 2015 12:06 PM
|
Publié par Fabienne Darge dans Le Monde Londres, Bruxelles
Pendant quelques jours, on suit Ivo van Hove. Il est à Londres, à Bruxelles, repart à Amsterdam, où il dirige le Toneelgroep, le théâtre le plus en vue aux Pays-Bas. Encore a-t-on de la chance : il aurait pu être à New York. Ivo van Hove est très demandé. L’homme semble être aussi mobile que le lui permet sa silhouette d’une minceur extrême, le pas rapide, tout entier tendu vers le travail. En France, on le connaît mal, malgré ses escales régulières à la Maison des arts (MAC) de Créteil, et une étape avignonnaise très remarquée, en 2008, avec ses Tragédies romaines inspirées de Shakespeare.
Aujourd’hui, on dirait que son heure est venue. Son spectacle The Fountainhead, superbe réflexion sur la création et la singularité de l’artiste, a emballé le dernier Festival d’Avignon (Le Monde du 14 juillet 2014). Le voilà de nouveau à Créteil, où il ouvre le festival Exit avec une mise en scène puissante, au cordeau, de Mary Stuart, le drame de Schiller. Du 22 avril au 14 mai, il sera au Théâtre de la Ville, à Paris, avec son Antigone déjà passée par Luxembourg et Londres, jouée (en anglais) par Juliette Binoche.
Plusieurs autres de ses spectacles sont à l’affiche à travers l’Europe. Mais pourquoi la reconnaissance arrive-t-elle si tard, pour un artiste né dans un petit village du Limbourg en 1958, et qui fait partie intégrante de cette fracassante génération flamande qui a révolutionné les arts de la scène, au tournant des années 1980 ?
Secrets de la vie
Petit rembobinage arrière. Ivo van Hove, fils de pharmacien, quitte à 11 ans son village pour partir dans un pensionnat de garçons catholique du nord de la Belgique. Là, il a « tout vécu : la douleur, l’angoisse, la cruauté, la sexualité, mais aussi, magnifiquement, la découverte du théâtre, dans le groupe amateur qui était un monde à l’intérieur du monde de la pension, laquelle était elle-même un univers clos dans le vaste monde ». Dans ce pensionnat qui aurait pu être « dans un film de Michael Haneke », Ivo van Hove a été heureux. Grâce au théâtre, qu’il n’a plus quitté, malgré la tentative de ses parents pour lui faire étudier le droit. Il s’est donc retrouvé à Anvers à la fin des années 1970 : creuset où tout s’est inventé, où les Jan Fabre, Jan Lauwers, Anne Teresa De Keersmaeker, Guy Cassiers, Alain Platel, etc., ont fourbi leurs armes pour réinventer complètement la scène.
Ivo van Hove est dans le mouvement. Le théâtre belge lui apparaît « affreusement conservateur, d’une médiocrité inimaginable », et il va chercher les secrets de la vie et de l’intensité dans le rock et dans la performance. Avec trois icônes majeures : David Bowie, Joseph Beuys et Marina Abramovic. « Dans la performance, ce qu’on voit est vrai. Quand Marina Abramovic s’assied en face de toi sur une chaise, c’est vraiment elle, et elle te regarde vraiment [il s’agit de l’œuvre The Artist Is Present, de la performeuse serbe]. »
Ivo van Hove noue surtout un dialogue direct avec Joseph Beuys, qu’il va voir dans sa maison de Kleve, en Allemagne. « Il a eu une importance énorme pour moi, dans le choix des matériaux bruts et organiques, dans sa performance [I Like America and America Likes Me] au cours de laquelle il s’enferme pendant des heures avec un coyote… Ramener dans l’espace de l’art un élément sauvage, un élément de réalité pure, c’est ce que j’essaie de faire encore maintenant. »
Comme pour tous ses camarades, la performance sera la matrice à partir de laquelle revivifier le théâtre, au-delà des différences et des rivalités – « avec Jan Fabre, on s’est longtemps détestés, avec Guy Cassiers, on a toujours été proches », s’amuse Ivo van Hove. Pas de coyote, mais un tigre (en cage) dans le premier spectacle qu’il signe en 1981, Geruchten (« Rumeurs »).
Comment expliquer, alors, qu’Ivo van Hove soit longtemps resté dans l’ombre ? Tout simplement parce que le metteur en scène est revenu rapidement à une forme de théâtre plus classique, quand ses camarades faisaient péter la scène et affirmaient leur statut d’auteurs. Mais comme son confrère allemand Thomas Ostermeier, dont il est proche, Ivo van Hove a redonné un sacré coup de jeune et de modernité au « vieux » théâtre. S’il est revenu aux textes canoniques, c’est parce qu’il a découvert « qu’ils [lui] permettaient de dire des choses plus personnelles qu’avec [ses] propres textes ».
Contemporains ou classiques
A partir de là, il a patiemment construit une œuvre passionnante, avec des lignes de force très nettes, situant son travail à la croisée des interrogations intimes et existentielles et des questions politiques. Ivo van Hove travaille sur tous les matériaux possibles. Textes contemporains (il aime Duras) ou classiques (Shakespeare first). Il a été un des premiers à réhabiliter ces auteurs américains que la modernité théâtrale avait condamnés comme trop réalistes et trop psychologisants – Eugene O’Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Lillian Hellman… Et à signer autant de spectacles (marquants) inspirés par des scénarios de grands cinéastes, Ingmar Bergman et John Cassavetes en tête.
Mary Stuart est emblématique de ce que peut offrir Ivo van Hove aujourd’hui, c’est-à-dire redonner à un drame assez classique et rhétorique une urgence, une intensité, dans le bel espace sobre conçu par son scénographe de toujours, Jan Versweyveld, qui est aussi son compagnon. L’histoire du combat entre la reine d’Ecosse et Elisabeth Ire y prend la férocité, chargée d’amour et d’énergie sexuelle, d’un combat de fauves, aux résonances politiques troublantes. Et ce, notamment, grâce aux merveilleux (ses) comédien (ne) s réunis par Ivo van Hove au Toneelgroep d’Amsterdam, qu’il sait diriger en maître : Chris Nietvelt (Elisabeth), fine et émouvante, Hans Kesting (Leicester), un des comédiens les plus puissants d’aujourd’hui, et Halina Reijn (Mary Stuart), une reine de la scène, sensuelle et libre.
On n’en dira malheureusement pas autant de Juliette Binoche, dont l’Antigone manque de force tragique, malgré l’humanité cherchée par l’actrice. C’est d’autant plus dommage que le travail effectué sur la complexité politique de la pièce est remarquable. Mais l’ensemble demeure un peu lisse, comme peut rester lisse le visage d’Ivo van Hove quand on discute avec lui. Sûr qu’il y a une bête sauvage tapie au cœur de cet homme-là, mais il ne la lâche que dans la cage du théâtre.
Fabienne Darge Mary Stuart, de Friedrich von Schiller. Mise en scène d’Ivo van Hove. A 20 heures, du 26 au 28 mars. De 12 à 24 €. En néerlandais surtitré. Dans le cadre du festival Exit : spectacles, performances, exposition « Home Cinéma ». Du 26 mars au 5 avril. Maison des arts, 1, place Salvador-Allende, Créteil. Tél. : 01-45-13-19-19. .maccreteil.com. Exposition : 3 €, spectacles de 8 à 20 €, soirées spéciales.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/03/26/ivo-van-hove-le-theatre-comme-un-combat-de-fauves_4601749_1654999.html#UUDwLSVjDp9lipVP.99
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...