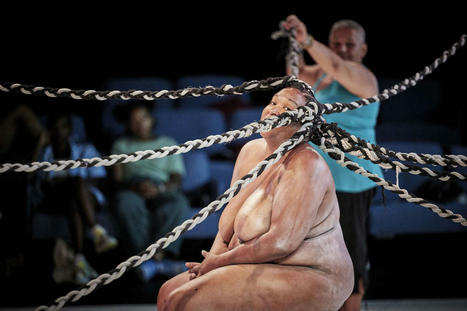Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 9, 6:54 PM
|
Article de Romain Boulho, pour Libération - 7 fév. 2025 Quatorze jeunes habitants seront sur la scène des Amandiers, à Nanterre, les samedi 8 et dimanche 9 février, pour jouer «Nemetodorum», une pièce qui raconte l’attachement à leur ville, encore traumatisée par le drame et les émeutes de l’été 2023. Un témoignage intime et politique. Il dit «j’y étais», sans détour ni prétention, comme un secret qu’il partagerait avec beaucoup de monde. Il parle des émeutes. Aussi : «Nahel était mon ami.» Est-il possible de transcrire la «haine» qui l’a saisi cet été-là sur une scène de théâtre, de ne pas la pervertir en simple «colère» ? Aymen s’interroge. Il tente de jouer avec «de l’émotion» mais il ne veut pas qu’on confonde tout. Il se réprime. «De base», le théâtre, il est loin de ça. Aymen, la majorité franchie de peu, est un technicien fibre optique pour un opérateur télécoms. Quelques mois après l’été 2023, un «grand du quartier» organise un concours d’éloquence. Il hésite, s’inscrit, gagne, poursuit jusqu’à faire dorénavant partie d’une asso locale. Il discourt en général sur «les injustices policières et le train de vie d’un banlieusard qui n’est pas un bandit ou une personne mal intentionnée». Il rit parce que ça lui semble incohérent. Avec sa dégaine, survêt gris, chaussé de Nike Requin, le cheveu lustré de gel, son crâne liseré d’un trait de rasoir. Mais, surtout, avec ce qu’il se figurait jadis de lui-même. Il dit que, aussi surprenant qu’un crachin une journée azur, le théâtre lui est «tombé dessus». Aymen est l’un des quatorze comédiens sur la scène des Amandiers pour deux représentations de Nemetodorum, ces 8 et 9 février. Des jeunes amateurs de la ville, dans un théâtre de la ville, avec des spectateurs de la ville (les deux dates sont complètes), sur le trauma de la ville, la mort d’un jeune de 17 ans abattu par le tir à bout portant d’un policier, et ses répercussions. Depuis l’espace jeunesse du quartier du Parc, planté tout près des tours Nuages, qui se confondent dans la vapeur glacée du soir avec celles de La Défense, Nicolas Sene se place en retrait des comédiens qui répètent. «Les habitants restaient silencieux, et moi, je voulais trouver une forme pour parler des événements qu’on a vécus, donner la parole aux jeunes avec quelque chose d’artistique», retrace celui qui est à l’origine du projet. Vidéaste en plus d’être coordinateur jeunesse du quartier, il se rapproche des Amandiers, prospecte, allume la mèche chez certains jeunes, mène des auditions. «Une trentaine sont venus. Ils me racontaient leur vie, leurs passions, leur rapport à Nanterre. Je les ai emmenés sur les derniers événements qui les ont marqués. Bien sûr, ils ont très vite évoqué la mort de Nahel.» Une pièce «poétique et intime» La pièce commence par quelque chose d’impossible à dire. Deux mots, «d’abord, rien», c’est-à-dire l’émotion de Noah sur ce qui a déclenché l’embrasement des quartiers partout en France. Le «rien» de Noah et la «haine» d’Aymen. Certaines formules du texte heurtent en douceur. Sur l’éclat de la révolte : «Depuis ma fenêtre, au-dessus de l’avenue Pablo-Picasso, je reçois en continu cette onde sonore, qui me traverse.» Ses dégâts : «Ce soir, la ville s’automutile.» Ces phrases sont l’œuvre de tous, converties en répliques par Noham Selcer après plusieurs séances d’écriture collective, avec à la mise en scène Jade Herbulot et Julie Bertin, du Birgit Ensemble. Noham Selcer n’y voit pas une pièce «uniquement politique mais aussi poétique et intime. Elle fait voir qui sont ces jeunes-là, quels sont les lieux qu’ils arpentent et qu’ils aiment». Elle vit sur les histoires des comédiens qui la composent, autant que leurs rejets et leurs rêves – de Pascal Praud au Dakota, le grec du coin où «c’est pas l’Amérique mais c’est encore plus». Marija, 21 ans, travaille à l’hôpital Foch, à Suresnes, elle y est agent d’administration. Elle suit des cours au conservatoire de Nanterre depuis trois ans. Longue robe de laine cordelée à la taille, haute posture. A la simplicité d’une brève discussion, elle préfère vider en un éclair : «Toute ma vie j’ai été effacée. Je passe inaperçue. Je ne parle pas. Là, je voulais montrer de quoi je suis capable. Qui je suis, pour pas qu’on m’oublie. Je n’ai ni rêve ni mission ni but, comme je dis dans un monologue. Je l’ai écrit comme ça, d’un trait, pendant une soirée, et ce monologue représente toute ma vie. Je veux juste le livrer.» Marija raconte tout autant l’insouciance, ce qui la rattache à Nanterre, sa chambre de jeune fille ou cette colline de la ville par exemple, une colline de rien, sans même de nom, juste un endroit où, enfant, les jours de neige, elle dégringolait enfouie dans un sac-poubelle, «trop pauvre» pour acheter une luge. Pour Simon, c’est le parc des Anciennes Mairies, un lieu qu’il fréquente depuis môme, où il se pose pour écrire parce que ça l’apaise. Il dit qu’il se sent connecté à l’endroit, qu’il y a accumulé des souvenirs qui affleurent au seuil de sa mémoire en images, «spectacle de trapèze, concert de rap, ex quittée, combat SDF contre crackhead». Le titre, Nemetodorum, c’est lui. «Je suis passionné par l’histoire de Nanterre. C’est le nom de la ville, donné par les Celtes : le bourg sacré.» Le jeune homme, école, collège, lycée, même prépa à Nanterre, poursuit avec des noms venus des temps anciens, qui s’achèvent en -um. Lui est «ému». Parce qu’il est ouvreur aux Amandiers d’habitude, qu’il va fouler cette fois la scène, qu’il écrivait voilà un an des textes, seul dans sa chambre, dont des pans sont utilisés dans la pièce, gribouillis dans la section «notes» de son téléphone. Qu’il voit tout cela comme une sorte de revanche. «Je me souviens d’un des premiers trucs que Nicolas Sene m’a dit : “Cette pièce, c’est comment retrouver l’espoir après, appelons un chat un chat, le meurtre de Nahel”. Je la vois presque, pas comme un hommage, mais une façon de faire honneur, à Nahel et à la ville.» Puis, voix claire et fierté rentrée : «Ça m’émeut. Ce sont nos textes, notre parole, sur un endroit qui est le nôtre.» «Se réunir autour d’une émotion commune» «C’était délicat, donc je crois qu’on l’a été aussi, reconstitue François Lecours, responsable des actions culturelles des Amandiers. Parce qu’il s’agit de la mort de quelqu’un de proche, parfois d’intime. L’événement reste présent dans l’esprit de tout le monde et je crois que ça va être quelque chose pour la ville, une façon de se retrouver, de se réunir autour d’une émotion commune.» Nicolas Sene voudrait l’y voir sur la grande scène du théâtre, à la fin de la rénovation en cours. Déjà, Aymen, lui, dit qu’il est «content à mort». Dans la pièce, le garçon parle du PSG et du Collectif ultra Paris, qui constitue une partie de son identité. Et phosphore sur les émeutes. Là, posé sur une chaise haute tandis que les répétitions se poursuivent, yeux et barbelette noirs, il se retourne sur la fin du mois de juin 2023, songe à cette révolte «à notre façon». «On a peut-être dégradé mais c’était nécessaire. On est dans une société qui marche comme ça, par la violence. Regarde les gilets jaunes, comment ont-ils obtenu gain de cause ? On nous apprend ça, à réagir comme ça. Notre seul moyen de s’exprimer, ce sont les révoltes. On ne porte pas plainte, puisque les policiers ne sont jamais inquiétés. On n’a pas les médias avec nous. On va peut-être casser notre quartier mais on va montrer ce qui est toléré par le gouvernement et même une partie de la France. Sans les émeutes, Nahel est un parmi tant d’autres. On n’a que ça. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autre ?» Désormais, et aussi insensé que ça puisse lui sembler, Aymen a le théâtre. Romain Boulho / Libération Légende photo : Lors des répétitions de «Nemetodorum» à Nanterre, le 1er février 2025. Simon, avec les lunettes, a trouvé le titre : «C’est le nom de la ville, donné par les Celtes : le bourg sacré.» (Cyril Zannettacci/Vu pour Libération)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 22, 2023 5:57 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 22 juillet 2023 La metteuse en scène de 37 ans travaille le rapport aux corps, aux identités et aux questions décoloniales à travers la performance.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/22/rebecca-chaillon-figure-d-un-renouveau-theatral-queer-et-afrofeministe_6183015_3246.html
Il n’est pas rare que Rébecca Chaillon apparaisse avec les lèvres peintes en bleu cobalt, ou les paupières en rose fuchsia. En ce Festival d’Avignon qui s’achemine vers sa fin, son nom est sur toutes les lèvres. Carte noire nommée désir, sa dernière création en date, avait déjà tourné de-ci de-là, suscitant un bouche-à-oreille on ne peut plus flatteur. Mais la présentation à Avignon a considérablement accéléré le mouvement, et installé la metteuse en scène comme une figure majeure d’un renouveau théâtral qui passe par la performance et les approches intersectionnelles actuelles, en mêlant l’afroféminisme et les questions queer et décoloniales. L’impétrante est née en 1985 à Montreuil (Seine-Saint-Denis). D’origine martiniquaise, fille d’un technicien de la SNCF et d’une conseillère à la Sécurité sociale, elle a découvert le théâtre en Picardie, où elle a grandi. Puis elle a suivi des études en arts du spectacle à Paris, où elle est notamment passée par le conservatoire du 20e arrondissement. Très vite, elle a fait son chemin dans le théâtre-forum, avec la compagnie Entrées de jeu animée par Bernard Grosjean, et les milieux de l’éducation populaire incarnés par les centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, tout en créant sa propre compagnie, qu’elle a nommée Dans le ventre, en 2006. Il lui faudra un peu de temps, et la rencontre avec l’univers de l’auteur-metteur en scène punk hispano-argentin Rodrigo Garcia, pour la confirmer dans ce qu’elle veut vraiment faire : un théâtre de performance, où le corps serait en jeu, de même que la pratique de l’automaquillage artistique, sur laquelle elle s’est également formée. Un théâtre où s’exprimerait, aussi, sa fascination pour la nourriture, qui traverse tout son travail. Nudité politique En 2012, elle signe un premier seule-en-scène, L’Estomac dans la peau, et d’autres créations de format court, qu’elle écrit et performe. Sa création suivante, Monstres d’amour (Je vais te donner une bonne raison de crier), en duo avec Elisa Monteil, tourne autour du cannibalisme amoureux. En 2016, elle participe à My Body My Rules, un documentaire expérimental d’Emilie Jouvet qui s’intéresse aux corps libres et sauvages et à la nudité politique. Ainsi qu’à Ouvrir la voix, d’Amandine Gay, qui donne la parole aux femmes afrodescendantes et à leur vécu. Cette expérience comptera pour beaucoup dans la création de Carte noire nommée désir. En 2018, elle crée Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, pièce sur le football féminin et les discriminations subies par les joueuses face à leurs homologues masculins. En 2020, elle commence la création en plusieurs étapes de Carte noire nommée désir, qui va muter et grandir jusqu’à aboutir à la version présentée à Avignon. Dans une époque où il est mal vu pour les femmes d’afficher leur gourmandise, et où l’injonction à la minceur pèse autant, sinon plus, dans des milieux intellectuels et artistiques supposément plus audacieux que le reste de la société, Rébecca Chaillon assume ses courbes plantureuses avec un aplomb tranquille. Elle en fait même un formidable accélérateur de particules. Le corps des femmes est au cœur de la révolution sociétale et artistique en cours, et elle le sait. S’inscrivant dans la grande tradition de la performance au féminin, glissant même au passage dans son spectacle, ni vu ni connu, le nom de Marina Abramovic, la papesse du genre, la Chaillon est dans son être même un des épicentres de cette révolution. Fabienne Darge Légende photo : Rébecca Chaillon, dans « Carte noire nommée désir », le 19 juillet, au Festival d’Avignon. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 19, 2023 3:58 AM
|
Par Sandrine Blanchard(Avignon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 19 juillet 2023 Dans le « off », la pièce de la jeune compagnie Quai n° 7 résonne avec la déprogrammation de la nouvelle création de Krystian Lupa, dans le « in », pour cause de conflit avec l’équipe technique pendant les répétitions.
Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/19/a-avignon-services-ou-la-revanche-des-techniciennes-de-theatre_6182572_3246.html Par le truchement d’une jeune compagnie de théâtre, l’affaire Krystian Lupa résonne dans le « off » d’Avignon. Pour sa première aventure dans ce vaste marché du spectacle vivant, la compagnie strasbourgeoise Quai n° 7 n’aurait jamais pu imaginer que Services – « relecture irrévérencieuse » des Bonnes, de Genet, qui nous plonge dans les coulisses d’une troupe théâtrale – se télescope avec le coup de tonnerre survenu quelques semaines avant l’ouverture du festival « in ». Petit retour en arrière : metteur en scène polonais réputé, âgé de 79 ans, Krystian Lupa devait être l’un des invités phares du rendez-vous théâtral avignonnais. Mais sa nouvelle création, Les Emigrants, a été déprogrammée. L’équipe technique de la Comédie de Genève, où se déroulaient les répétitions, a jeté l’éponge à la suite, écrit-elle, d’une « ambiance de travail écrasante où les propos abusifs et humiliants empêchaient de produire [leur] travail ». Les techniciens suisses auraient pu dire, comme le fait l’un des personnages de Services : « Sans nous, votre spectacle n’existe tout simplement pas. » Sur scène, les filles de Quai n° 7 sont cinq à incarner des techniciennes chargées de la lumière, du son, du plateau et de la régie d’une adaptation des Bonnes. Alors qu’elles remisent le décor et nettoient tout pour préparer la représentation du soir, ces femmes de l’ombre vont révéler, à travers une mise en abyme de la pièce culte de Genet, les abus de pouvoir et autres mécanismes de domination qui se jouent au sein de l’équipe. « Requestionner la notion de troupe » Empruntant les accessoires et costumes du spectacle, elles vont tour à tour imiter la metteuse en scène, leur « Madame » (la figure d’autorité, comme dans Les Bonnes), et jouer ses subalternes. Les techniciennes sont celles qui font au service de celle qui parle. En rangeant différemment cet espace et en s’emparant de tous ces objets qu’elles connaissent par cœur, elles évoquent leur quotidien professionnel et se mettent à l’imaginer autrement, à réinventer ce que pourrait être le spectacle si elles osaient parler à leur tour. Toutes profitent de ce moment d’intimité et de liberté que constitue la remise en place d’un plateau pour se confier, se révolter et s’émanciper, sans pour autant cacher leurs ambiguïtés. « Quand Madame a le dos tourné, on fait les malignes, mais quand elle s’en prend à l’une d’entre nous, les autres se la ferment », lance la régisseuse. Car elles ne sont pas non plus sans reproche, ces techniciennes prêtes « à obéir au doigt et à l’œil à tous les ordres, même les plus débiles ». Soit par réflexe, par mauvaise habitude, soit aussi parfois par peur de perdre leur travail. « Services, c’est un peu notre spectacle manifeste pour requestionner la notion de troupe », explique la metteuse en scène Juliette Steiner. Ce spectacle reflète en creux les interrogations de la jeune génération du théâtre, qui refuse que la création repose sur une part de souffrance. « La force de la création peut être aussi dans l’écoute, le respect des compétences de chacun, et dans la confiance vis-à-vis de l’intelligence collective entre équipe technique et artistique », résume, hors scène, Camille Falbriard, l’une des singulières comédiennes de la pièce. « Effectivement, notre création se retrouve en résonance avec l’affaire Krystian Lupa, mais elle cache aussi la question plus large de la souffrance au travail. Le monde culturel est confronté aux mêmes problématiques que d’autres secteurs professionnels », estime Juliette Steiner. Avec Services, la compagnie avait à cœur d’interroger « comment on fait politiquement du théâtre, comment on travaille ensemble ». Camille Falbriard insiste : « Ce n’est pas un plaidoyer pour l’équipe technique, mais un questionnement sur les rapports de pouvoir et de domination qu’un système permet ou pas. » L’écriture s’est faite au plateau, avec tous les membres de la troupe, techniciennes et comédiennes, et avec l’auteur québécois Olivier Sylvestre pour la mise en texte. Toutes ont partagé leur savoir-faire. Les premières ont appris aux secondes à manipuler le son et la lumière, et les secondes ont transmis aux premières les principes de jeu. Bouche-à-oreille Tout a débuté en improvisation, « chacune racontant une situation humiliante vue ou vécue et aussi [les] petites lâchetés qui consistent à ne rien dire de ce que l’on ressent », raconte Ondine Trager, conceptrice lumière. Le résultat est à la hauteur de la fougue de leur jeunesse, à la fois désordonné, stylisé et truffé d’idées. A la sortie du spectacle, certains jeunes travaillant dans le milieu théâtral leur disent : « Votre spectacle donne de l’espoir, on peut travailler ensemble. » Son premier « off » d’Avignon, la compagnie le vit comme « quelque chose d’à la fois vertigineux et joyeux ». Et surtout comme un « passage obligé » pour sortir professionnellement de leur région. Services a été joué dix-huit fois sur des scènes subventionnées du Grand-Est avant d’arriver dans la cité des Papes. « On avait un bon écho lors de la création. Les professionnels qu’on contactait nous disaient : “Prévenez-nous quand vous jouerez à Avignon ou à Paris.” » Alors la troupe est venue à Avignon, en particulier grâce à l’aide financière du conseil régional du Grand-Est. « On est logées correctement, on est payées et on dispose de bonnes conditions techniques », reconnaît Juliette Steiner. Comédiennes et techniciennes paradent dans les rues avignonnaises avec le masque de « Madame », remettent « une couche d’affiches » et communiquent sur leurs réseaux sociaux. « C’est très exigeant, le “off”, on sent les enjeux », témoigne Camille Falbriard. Et les corps doivent s’habituer à la chaleur. Pour l’heure, à mi-parcours du Festival, la fréquentation de leur spectacle est en hausse grâce au bouche-à-oreille, et plus d’une dizaine de professionnels sont déjà venus les voir. Chaque jour, comme toutes les compagnies à Avignon, elles distribuent des tracts dans la ville. Leur pitch est rodé : « Venez assister à un avant-spectacle, cinq techniciennes remisent Les Bonnes, de Genet, et en profitent pour raconter leur histoire. » « Services », jusqu’au 25 juillet à la Caserne des pompiers, à Avignon. Sandrine Blanchard(Avignon, envoyée spéciale du Monde) Légende photo : « Services » par la compagnie Quai n°7, à la Comédie de Colmar, en novembre 2021. MICHEL GRASSO

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 9, 2023 6:46 AM
|
par Marlène Thomas dans Libération publié le 9 mai 2023 Dans une lettre à «Télérama», l’ancienne comédienne connue pour ses engagements féministes, sociaux, antiracistes et écolos assume et donne du sens à sa rupture avec le 7e art. Adèle Haenel se lève et se casse du cinéma français. Dans une lettre à Télérama, l’ancienne comédienne explique l’arrêt de sa carrière d’actrice : «J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est.» Depuis son départ fracassant des César en 2020 en réaction au sacre de Roman Polanski - visé par plusieurs accusations de viols, sa mue devenait de plus en plus visible. Militante active du Réseau pour la grève générale, présence sur des piquets de grève comme celui de la raffinerie de Gonfreville-l’Orcher en Normandie, soutien aux meetings d’étudiantes, alliée du Comité Adama, immanquable des mobilisations féministes et queers… l’ancienne comédienne de 34 ans est devenue l’un des visages de la lutte intersectionnelle. Un virage amorcé dès novembre 2019 lorsqu’elle a accusé dans une enquête de Mediapart et dans une émission ayant fait date, le réalisateur Christophe Ruggia de l’avoir agressé sexuellement et harcelé sexuellement de ses 12 à ses 15 ans. Adèle Haenel avait choisi sciemment la voie médiatique plutôt que judiciaire. «La justice nous ignore, on ignore la justice», assénait-elle. «Je vous annule de mon monde» Le courrier de l’actrice de Portrait de la jeune fille en feu ou 120 battements par minute à Télérama n’est pas spontané. Il s’agit d’une réponse à une enquête que l’hebdomadaire publie aussi ce lundi. Celle-ci retrace «l’itinéraire d’une artiste en lutte», de cette femme issue d’une famille de classe moyenne politisée ne pouvant plus se contenter d’engagements symboliques, d’un soutien parallèle comme d’autres actrices politisées telles que Delphine Seyrig (connue pour sa lutte pour le droit à l’avortement au sein du MLAC) ou Simone Signoret avaient pu le faire avant elle. Elle veut agir, en être pleinement, se retrouver surtout en accord avec elle-même et avec son cheminement intellectuel engagé depuis plusieurs années. «Face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie, je n’ai pas d’autres armes que mon corps et mon intégrité. De la cancel culture au sens premier : vous avez l’argent, la force et toute la gloire, vous vous en gargarisez, mais vous ne m’aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon monde», écrit-elle dans sa lettre. Son ancienne agente Elizabeth Simpson déplore auprès de Télérama qu’après son témoignage à Mediapart «on ne lui a plus proposé que des rôles de femmes abusées, des histoires d’inceste ou des films où elle servait de caution». Adèle Haenel a aussi lâché l’un des derniers rôles qu’elle avait accepté pour L’Empire de Bruno Dumont parce qu’elle jugeait son contenu «sexiste et raciste», souligne l’hebdomadaire. Cette rupture avec le cinéma ne l’éloigne pas totalement des pratiques artistiques, puisque Adèle Haenel explore désormais les champs chorégraphique et théâtral, indique l’hebdo. A l’heure où les enquêtes se multiplient dans les médias pour dénoncer les violences sexuelles et l’omerta du milieu du cinéma (Sofiane Bennacer, Gérard Depardieu…), cette prise de position puissante fera, sans nul doute, une nouvelle fois du bruit. Légende photo : Adèle Haenel, en mai 2022. (Anna Margueritat/Hans Lucas. AFP)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
January 16, 2022 5:51 PM
|
Par Annabelle Martella dans Libération 16 janvier 2022 Légende photo : Rébecca Chaillon à Dijon, en décembre. (Romy Alizée/Libération) Le nouveau spectacle de la performeuse, «Carte noire nommée désir», joyeux chaos à la frontière du fantastique, développe une réflexion profonde sur la représentation des femmes noires. Les pièces qui pilonnent l’imaginaire colonial, on en voit (et heureusement) un joli paquet aujourd’hui. Il y en a surtout, des pédagos, des didactiques, des qui nous disent quoi penser, de façon très docte, avec beaucoup de gravité. Parfois, il y en a qui sortent du lot. Carte noire nommée désir, nouveau spectacle de la jeune metteuse en scène Rébecca Chaillon sur la représentation des femmes noires bouleverse nos repères sur le sujet parce qu’elle joue à fond la carte du baroque, de la potacherie, du détournement carnavalesque, du rire gras qui tâche, de la scatophilie. Sur le plateau chaotique s’enchaînent les numéros sans discontinuer, passant d’une choré sur du Aya Nakamura à une acrobatie aérienne ou à une session de chant lyrique. Ça twerke jusqu’à l’épuisement et ça lit avec malice les petites annonces récoltées dans Amina, «le magazine de la femme africaine et antillaise» : «Douce perle africaine voudrait nouveau départ pour une relation sérieuse pouvant aboutir au mariage, svp uniquement homme européen et sérieux. Les autres abstenez-vous.» Ici, les huit performeuses noires ne s’attardent pas sur les fondements socio-historiques du racisme mais subvertissent avec inventivité et un humour féroce les stéréotypes auxquels elles sont encore trop souvent reléguées : la femme de ménage, la nounou, la danseuse ultra-sexualisée… Le discours sur leur beauté exotique passe à la moulinette de la parodie. Clin d’œil de calendrier : on pense évidemment avec elles au visage grimaçant de Joséphine Baker, s’extirpant, à la faveur de ses mimiques, des tableaux primitivistes dans lesquels on voulait l’enfermer. «Culpabilité ?» C’est un spectacle qui vogue sur les rives du surréalisme et d’un fantastique «queer». Les performeuses exagèrent leurs caractéristiques physiques pour apparaître en créatures étranges et c’est une «négritude» nouvelle qu’elles revendiquent. Ici : les tresses bicolores de Rébecca Chaillon s’étendent sur des kilomètres, créant un feuillage au-dessus de son tronc nu. Pendue au plafond, une circassienne évolue dans un écosystème digne des Métamorphoses d’Ovide. Là : un couple de femmes rondes et nues s’enlace sur du zouk joué à la harpe. Plus loin : une cantatrice étouffe sa camarade, jugée trop foncée, avec la crème lactée d’un café. La metteuse en scène joue sur la diversité des morphologies avec des figures qui, comme dans Alice au pays des merveilles, n’ont jamais la bonne taille ni la couleur adéquate. Et dans ce labyrinthe de visions psychédéliques, le noir et blanc se répondent dans un grand jeu symbolique. «Je me pose beaucoup de questions sur le public qui apprécie la pièce. L’aime-t-il uniquement par culpabilité ?» s’interroge Rébecca Chaillon, que Libé a rencontrée via Zoom, accompagnée de sa joyeuse bande de performeuses. L’artiste de 36 ans, également maquilleuse professionnelle, est une habituée des tenues flashy, lèvres peinturlurées de bleu turquoise et lentilles de contact bariolées. En repos pendant quelques jours dans les Pyrénées, on la retrouve toute en sobriété, habillée d’un pull zébré, clin d’œil non dissimulé aux métaphores colorées de la pièce. Adepte des métamorphoses, elle décline sur scène un nombre infini de looks et d’identités. Femme de ménage zombie dans Carte noire nommée désir, «crachoir public» en tenue de championne de natation pour «exorciser» la colère des militants lors de festivals féministes ou encore «Ariette la grosse sirène», mix entre l’héroïne de Disney version «grosse… et noire» et la déesse aquatique Mami Wata, honorée dans le culte vaudou. Fille d’un technicien de la SNCF et d’une conseillère de la Sécu, Rébecca Chaillon a découvert le théâtre en Picardie, région où elle a grandi, avant de partir faire des études d’arts du spectacle à Paris. Mais c’est bien plus tard et après un bout de carrière dans le théâtre-forum et l’éducation populaire que son chemin croise celui de Rodrigo García et de la performance. Parcours militant L’idée du spectacle part d’une «blague», nous raconte-t-elle, autour du fameux slogan publicitaire qui lie couleur noire et désir pour devenir un conte politique autour des «peaux café». Il prend évidemment ses racines dans son parcours militant, notamment depuis sa participation au documentaire Ouvrir la voix d’Amandine Gay. En 2017, la même année que la sortie du film, Rébecca Chaillon décide de transformer la carte blanche que lui propose le théâtre de la Loge en «carte noire», mettant en place un dispositif bi-frontal où les femmes noires font face au reste du public. Y résonne déjà son texte, inspiré du Cahier d’un retour au pays natal de Césaire et du concept de «biomythographie» développée par la poétesse américaine Audre Lorde, fusion de mythes afro-futuristes, épisodes historiques et paroles intimes. Dans les interstices de ce récit poétique habité par la végétation de la Martinique, son île d’origine, Rébecca Chaillon imagine ensuite des protocoles d’improvisation dans lesquels les autres performeuses pourraient évoquer leur parcours. La metteuse en scène, dont la compagnie ne s’appelle pas «Dans le ventre» pour rien, raffole de récits anecdotiques et de comparaisons entre nourritures et faits politiques : «C’est intéressant d’observer que les produits issus de l’exploitation coloniale, le sucre, le cacao, le café, étaient des produits bruts qu’on voulait sans cesse raffiner, blanchir, rendre moins amer», nous fait-elle remarquer. Pour mieux connaître son équipe, elle demande à chacune de se présenter à partir de leurs plats préférés. «Sur scène, je nomme par exemple le saka-saka [plat à base de feuilles de manioc pilées], explique Olivia Mabounga, une des comédiennes, tout juste sortie de l’école. C’est vrai que les plats congolais me tiennent à cœur et parlent de mon intimité.» Agées de 25 à 40 ans, ces performeuses viennent de France, de Suisse, de Belgique, connaissent Rébecca Chaillon depuis des années ou l’ont rencontrée lors du grand casting qu’elle a organisé. Une cinquantaine de filles s’y étaient présentées. «On voit souvent les mêmes actrices noires sur les plateaux français. J’avais envie d’un grand renouvellement et de ne pas travailler uniquement avec des comédiennes. J’aurai rêvé m’entourer d’artistes du Brésil, du Burkina Faso, mais l’économie du spectacle ne le permettait pas», explique celle qui a constitué une véritable communauté autour de son projet. Discours engagé et taquineries fusent dans une ambiance de franche camaraderie, lorsqu’on les rencontre. Parmi ces artistes, il y a Estelle Borel, circassienne aux cheveux rouges, perdue «dans les Alpes profondes» et qu’on confond systématiquement, nous dit-elle, aux deux autres femmes noires suisses qui officient dans sa discipline «alors qu’on ne se ressemble pas du tout». Voici également Bebe Melkor-Kadior, fakir, cracheuse de feu et travailleuse du sexe, passionnée par les rituels d’épuisement et autrice du manifeste Balance ton corps dans lequel elle développe le concept de «salope heureuse». Mais aussi Fatou Siby, poétesse avec qui Rébecca Chaillon a animé des colos dans un centre social ou encore Ophélie Mac, céramiste performeuse vivant à Bruxelles, «lesbienne d’origine martiniquaise». Pétries de pop culture, certaines égrènent leurs références communes : le magazine Fan 2, MTV, Beyoncé, etc., qui se mélangent, sans distinction, à leurs aspirations esthétiques et aux théories militantes qu’elles lisent. Toutes très engagées, elles ne servent pas pour autant un spectacle sur la révolte clés en main. Et c’est seulement guidé par leur désir insatiable de liberté que l’on traverse les zones troubles de l’hilarité. C’est que Rébecca Chaillon, «esprit bordélique» comme elle se qualifie elle-même, voulait sortir du documentaire, histoire que ces thèmes politiques se transforment sur scène en un chambardement d’images zébrées. Carte noire nommée désir de Rébecca Chaillon, le 16 janvier à Villeneuve-d’Ascq, du 2 au 4 février à Saint-Etienne, les 21 et 22 février à Paris, et en tournée.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 9, 2021 4:58 PM
|
Par Mathilde Blottière dans Télérama 8/12/21 Face aux violences sexistes et sexuelles, comment réagit-on au Conservatoire national supérieur d’art dramatique ? Chacun, dans l’école, a son idée sur la façon de se battre. Quant à sa directrice, Claire Lasne Darcueil, elle n’a pas attendu le séisme #MeToo pour faire évoluer l’établissement. Il fut, il y a quelques décennies encore, une institution patriarcale, blanche et bourgeoise. Les élèves les plus jolies y jouaient les jeunes premières, les autres se partageaient le peu de rôles qui restaient. Cet automne, alors que #MeTooThéâtre fait trembler les planches, le Conservatoire national supérieur d’art dramatique a clairement choisi son camp. Le changement contre le conservatisme. Sur ses murs, on peut lire : « Quel gâchis que tu sois lesbienne », « T’as de l’ambition pour une femme », « C’est trop cucul, c’est féminin »… Des « mots de trop » rassemblés par des étudiantes en écoles d’art. Plus loin, une affiche invite victimes et témoins de violences sexuelles à contacter le numéro vert du ministère de la Culture. Claire Lasne Darcueil, première femme à diriger le Conservatoire depuis sa création, en 1784, n’a pas attendu #MeTooThéâtre pour révolutionner l’école (aujourd’hui CNSAD-PSL, pour Conservatoire national supérieur d’art dramatique - Paris Sciences et Lettres). Dès sa nomination, fin 2013, cet « animal militant » a diversifié les promotions. En termes de couleurs de peau, de classes sociales, de physiques. « À mon arrivée, le Conservatoire n’avait pas de costume féminin au-dessus de la taille 36-38… » En 2018, une charte « égalité femmes-hommes » est rédigée sur la base d’une étude menée au sein de l’école par une ancienne élève, autrice d’une pièce sur les violences faites aux femmes. Le texte acte l’abolition des « emplois », qui indexaient la distribution des rôles au physique des interprètes. « L’autre avancée de cette charte, que tout le monde doit signer, est de permettre aux candidats au concours de s’inscrire en tant que femme, homme, ou non binaire pour ceux qui ne se sentent ni homme, ni femme. » Dès les premiers temps, Claire Lasne Darcueil est frappée par le nombre de comédiennes qui se présentent devant le jury dans la peau de personnages victimes et souffrants. « Je n’en pouvais plus de ce mythe qui veut qu’une bonne actrice soit comme Romy Schneider dans L’important c’est d’aimer : belle, nue et en pleurs. » Surtout, la directrice est d’emblée aux prises avec le fléau des violences et l’omerta qui l’accompagne. D’anciennes élèves lui racontent ce qu’un enseignant leur a fait subir. « Elles voulaient s’assurer que leur agresseur ne remettrait plus les pieds à l’école, tout en me suppliant de ne pas révéler son nom. Elles n’étaient et ne sont toujours pas prêtes à porter plainte ; il faut savoir respecter ce temps des victimes. » Afin de prévenir d’autres agressions, des cellules d’écoute sont mises en place. Des étudiants deviennent « référents égalité et discrimination ». Le personnel et les apprentis comédiens sont formés à reconnaître les situations d’emprise et à mettre des mots sur les délits et crimes sexuels. « Nous voulions créer un endroit bienveillant où la parole circule librement et soit entendue », explique Elliot Marès, responsable des ressources humaines. Imaginer le Conservatoire en sanctuaire serait pourtant une erreur. C’est un lieu en effervescence, un vrai bain à remous, que tous ne considèrent pas comme une « zone sécurisée ». Certains étudiants sont d’autant plus vigilants qu’ils ont parfois subi des violences dans des cours ou des écoles de théâtre privés. Comme Joanna qui, en tant qu’actrice noire, a été victime de racisme. « Dans l’école où j’étais avant, nous étions deux Noires sur cent vingt, mais on arrivait tout de même à nous confondre… » Élève trans non binaire, Olek ne supporte plus qu’on nie son identité, surtout dans un environnement aussi progressiste que le « Cons » : « Tous les jours, des gens m’assignent un genre qui n’est pas le mien et se justifient en disant ne rien comprendre à la transidentité ! Je suis ici pour étudier, pas pour les éduquer ! » Pour ces jeunes gens de première année, très politisés, la lutte est globale. Intersectionnelle. « Toutes les questions de minorité sont hyper importantes pour nous », confirme Walid. Isoler la cause féministe d’autres combats, contre le racisme, pour les droits des trans et des handicapés, n’a aucun sens à leurs yeux. « Ils ont occupé le Théâtre de la Colline en mars pour dénoncer la précarité des intermittents. Ça les a chauffés à blanc. Ils sont très unis et en contact permanent avec les élèves d’autres écoles de théâtre», indique Claire Lasne Darcueil. Unanimement révoltés par les faits dénoncés par #MeTooThéâtre, les étudiants sont plus partagés sur les moyens de lutter contre. Si la question du « consentement au plateau » fait consensus – tous s’accordent à dire qu’il suffirait que les metteurs en scène demandent clairement l’autorisation avant de toucher une partie du corps d’un comédien –, la façon d’assainir la relation entre les profs et les apprentis divise. Le collectif #MeTooThéâtre préconise une charte déontologique pour éviter, notamment, de « banaliser les relations intimes et sexuelles entre enseignants et élèves ». Sylvain, en troisième année, est pour : « Si ça peut rappeler aux profs qu’il n’y aura plus d’impunité, tant mieux ! » Lorsqu’il était au cours Florent, il avait dû prendre ses distances avec un intervenant un peu trop intrusif… Lola, sa camarade de promo, est plus nuancée : « Le théâtre fonctionne par réseaux : certains de mes profs sont devenus des amis et m’ont aidée à m’orienter dans ce métier. » Elle s’inquiète également de voir le répertoire abordé « à travers le seul prisme des préoccupations de [sa] génération. Je suis une enfant de mon époque, elles m’accompagnent tous les jours mais je veux aussi pouvoir pratiquer mon art sans y mettre systématiquement un message politique ». Pour Walid, Olek et Joanna (ce dernier prénom a été changé), réinterroger les classiques est incontournable. Le premier se souvient de tensions autour d’une scène d’Oncle Vania, de Tchekhov. « Astrov embrasse Elena qui lui a pourtant dit non plusieurs fois. Les profs nous dirigeaient comme s’il s’agissait d’une scène romantique alors qu’il aurait fallu représenter la violence d’Astrov ! » Un peu effrayés par la virulence de leurs camarades, des élèves plus réservés et non militants redoutent que positions de principe et convictions politiques ne brident l’imagination artistique, faite de tâtonnements et de ratages. « J’ai joué dans un spectacle qui traite de l’inceste, raconte Sylvain. Avant de trouver comment le représenter, on est passés par des phases où la discussion nous a permis d’avancer. Sans cela, on reste dans le noir. » Et de pointer l’incapacité de certains à tolérer la contradiction. « On marche souvent sur des œufs, confirme Lola. La colère, je la ressens moi aussi. Mais elle ne peut pas être le seul moteur pour faire avancer nos causes. » Claire Lasne Darcueil le sait bien. « En tant qu’actrice de 55 ans, bonne pour la benne donc, j’épouse le jusqu’au-boutisme de certains mais mon rôle de directrice est de veiller à ne pas faire de l’école une chapelle où tout le monde penserait pareil. On doit pouvoir travailler ensemble avec nos désaccords. » Pour apaiser les situations inflammables — une formulation « problématique » lâchée par un enseignant, par exemple —, la directrice joue les médiatrices. Récemment, une promotion a informé la directrice de son refus de travailler avec un intervenant. En cause ? Sa réputation de dragueur. « Comme j’aime énormément cet artiste, j’ai très mal vécu la situation, incitant les élèves à la nuance en leur demandant de hiérarchiser leurs colères. Puis j’ai fini par comprendre, et par décider que le changement passerait par la radicalité. » Une pédagogie vers plus de souplesse Du côté des pédagogues, #MeTooThéâtre est perçu comme une suite logique du #MeToo de 2017. « Je vois la colère de mes élèves à l’aune de ce que j’ai supporté plus jeune, ressent Sandy Ouvrier, professeure d’interprétation. Ça a tendance à me galvaniser. » Comme elle, d’autres enseignants ont fait évoluer leur pédagogie vers plus de souplesse. « Je n’ai pas envie d’imposer des rôles aux élèves, je préfère qu’ils les choisissent », témoigne Xavier Gallais, un autre professeur d’interprétation. Alors qu’il suggérait de travailler sur Macbeth ou Richard III, l’acteur s’est incliné de bonne grâce devant… Mary Stuart. « Filles et garçons s’étaient mis d’accord pour une pièce avec un personnage principal féminin. » L’an dernier, pour la première fois, Sandy Ouvrier a souhaité aborder autrement l’œuvre de Molière : « Non comme un vivier de rôles de femmes et d’hommes mais comme un territoire où chacun, chacune, pouvait s’emparer de tous les personnages. Des filles ont joué Harpagon, un garçon a joué Angélique. Cela a permis un travail passionnant sur les textes ! » Pour Xavier Gallais et Sandy Ouvrier, il ne s’agit plus d’enseigner comment « obéir au désir du metteur en scène ». Mais d’inventer un nouveau statut de l’acteur qui, d’instrument-objet, deviendrait partie prenante de la mise en scène, sujet créateur. Restent des questions : comment aider les élèves à trouver leur personnalité artistique sans faire intrusion dans leur intimité, désarçonner leurs certitudes sans saper leur confiance en eux ? « Toute la difficulté de notre rôle de pédagogue est d’être guide sans s’imposer en maître », résume Xavier Gallais. Un défi que Sandy Ouvrier relève sans crainte. « Il y aura peut-être des moments où je serai moins instinctive, plus attentive aux mots employés. Et alors ? Ça vaut le coup ! Si l’on cherche le bien-être de chaque jeune artiste, l’effet sera bénéfique. En coulisses et sur scène. » Légende photo : Lola, Olek, Sylvain et Walid. “Toutes les questions de minorité sont hyper importantes pour nous », affirme ce dernier. © Jérôme Bonnet pour Télérama Mathilde Blottière / Télérama Dans le même numéro de Télérama : #MeTooThéâtre, la fin de l'omerta Enquête d'Emmanuelle Bouchez Après #MeTooThéâtre, les femmes ont encore du pain sur les planches Enquête de Sophie Rahal

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 25, 2021 5:04 PM
|
Par Cassandre Leray dans Libération le 25 nov. 2021 La ministre de la Culture a annoncé ce jeudi un ensemble de nouvelles mesures visant ce fléau. Anne Monfort, élue au Syndicat des entreprises artistiques et culturelles, souligne auprès de «Libération» l’importance symbolique de cette action gouvernementale mais en pointe aussi les limites. Objectif : taper au portefeuille. Un peu plus d’un mois après le lancement du mouvement #MeTooThéâtre dans la foulée de l’enquête de Libération sur le metteur en scène Michel Didym, Roselyne Bachelot a présenté ce jeudi son plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant. A partir de janvier 2022, le ministère de la Culture conditionnera le versement de ses 272 millions d’euros de subventions à des engagements pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Qu’il s’agisse de structures de théâtre, de musique ou de danse, les mesures à respecter seront les mêmes : se conformer aux obligations du code du travail, créer un dispositif interne de signalements, former les équipes à ces questions et engager une évaluation annuelle des actions. Des annonces positives sur le papier, selon le Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), mais qui restent encore insuffisantes. Anne Monfort, élue en charge de l’égalité femmes-hommes et de la diversité de cet organisme, regrette en particulier auprès de Libération l’auto-évaluation attendue des établissements. La syndicaliste appelle également à un travail plus profond sur la parité dans le secteur. Que retenez-vous du plan annoncé par la ministre de la Culture ? D’un point de vue symbolique, ces annonces sont très positives. C’est fort de s’attaquer aux conditions de versement des subventions. Mais pour que cela fonctionne, il faut que ces mesures soient suivies d’effets et que les contraintes soient fortes. Le point le plus important est que la formation sur les violences sexistes et sexuelles soit rendue obligatoire. Au niveau du Syndeac, on a déjà lancé des formations similaires cet été, mais on n’a évidemment pas la force de frappe de la contrainte. C’est important car il y a encore énormément de points juridiques que les directions ne connaissent pas. Par exemple, beaucoup pensent que si une plainte est déposée, il n’est pas possible de mener une enquête interne. Ce qui n’est pas le cas. Il ne faut pas confondre droit du travail et droit pénal. De nombreuses victimes estiment aussi que le dépôt de plainte au commissariat est la seule solution, alors que saisir son employeur est une autre voie possible quand les faits ont lieu dans le cadre du travail. Les structures évalueront elles-mêmes leur respect de ces mesures. Un point qui inquiète le Syndeac… L’auto-évaluation nous alerte. Tous les ans, les structures devront tirer un bilan et mesurer elles-mêmes si elles ont respecté ou non les mesures annoncées. Cela ne nous semble pas être efficace. Pour donner un exemple, la feuille de route ministérielle pour l’égalité adoptée en 2018 prévoit des objectifs de progression chiffrés sur la programmation des femmes artistes. Mais cette mesure n’a pas été mise en œuvre, faute de remontée faites par les structures, car c’est aussi une auto-évaluation. Il faut que cette évaluation annuelle soit objectivée. Bien qu’il existe des structures vertueuses, il y a aussi des personnes en position de pouvoir qui pourraient avoir intérêt à ne pas faire remonter ces données. Le Syndeac a lancé sa propre campagne de comptage et on constate qu’il y a encore du travail. La question de la parité n’est pas abordée dans ce plan. Il s’agit d’un des fers de lance du Syndeac. Qu’en pensez-vous ? La question de l’écosystème sexiste et de la parité n’est pas prise en compte alors que pour moi, c’est lié. On ne peut pas lutter contre les violences sexuelles sans remettre en question un système dans lequel les postes de pouvoir sont majoritairement aux mains d’hommes cisgenres blancs. Il faut aussi mener un travail sur la parité. Les violences sexistes et sexuelles interviennent d’autant plus simplement qu’on est dans un secteur qui ne représente pas la société dans son ensemble. Certes, les femmes dirigent 46 % des centres dramatiques nationaux, mais plutôt ceux qui ont le plus petit budget. On sait aussi que les compagnies dirigées par des femmes disposent seulement de 18 % de l’argent attribué aux compagnies conventionnées, ou que plus on monte dans les instances de reconnaissance, plus les femmes sont absentes… Ce qu’on demande, c’est la parité dans les programmations et dans les moyens de production. Que faire pour renforcer encore la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le spectacle vivant ? C’est à la justice de mieux fonctionner. Il y a toujours 76 % de plaintes classées sans suite, et seules 13 % des personnes qui se disent victimes de viol portent plainte. De nombreuses femmes ne portent pas plainte car elles n’ont pas confiance, la majorité des plaintes étant classées sans suite. C’est une question d’omerta, de culture du viol. Par ailleurs, on entend encore trop souvent la parole des victimes être mise en doute. Il faut aussi que notre profession prenne en charge ces affaires et agisse, se moralise. On dit aux victimes de parler alors qu’elles ont la crainte d’être grillées professionnellement, mais on perpétue l’omerta en laissant ces mêmes hommes qu’elles accusent à des postes de pouvoir.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 11, 2021 9:35 AM
|
Par Laurie Moniez dans Le Monde - 11 nov. 2021 Dans une petite salle oppressante, les visages en noir et blanc de centaines de femmes, victimes de violences masculines, recouvrent les murs et plongent le public dans un profond malaise. Les sourires de ces femmes se sont éteints sous les coups des hommes. En France, en 2020, 102 personnes de sexe féminin ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-compagnon. « Toutes ces femmes victimes de violences, ce sont des faits divers que l’on voit régulièrement aux informations mais, finalement, après, on tourne la page ». Ce constat a conduit Àlex Rigola, metteur en scène barcelonais et directeur de la compagnie Heartbreak Hotel, à décider de créer un « choc suffisamment fort pour garder tout cela en tête et aider les gens à changer les choses ». Créée en 2018, son installation immersive de théâtre documentaire construit autour des violences machistes est tristement universelle. Présenté pour la première fois en France, à Lille, depuis le 8 novembre, Macho Man s’étale sur onze espaces dans lesquels des groupes de six spectateurs déambulent. Casque sur les oreilles, ils sont guidés par la voix d’une femme ayant subi des violences du fait de son genre. Dans l’une des salles, les témoignages successifs permettent d’entendre et comprendre le schéma de l’emprise. « On est comme un puzzle qu’on a mis en pièces », confie cette victime. Restitution d’interrogatoire La reconstitution d’un parloir contraint les visiteurs à se dévoiler face aux violences machistes présentes dans les cercles conjugaux ou familiaux. Les sphères judiciaire et policière ne sont pas épargnées, notamment à travers la restitution de l’interrogatoire de la jeune femme victime d’un viol lors des fêtes populaires de la San Fermin, en 2016. Dans un premier procès, la qualification de « viol » n’avait pas été retenue contre les cinq hommes qui se surnommaient eux-mêmes « la meute ». L’affaire avait ému l’Espagne et provoqué une grève générale féministe sans précédent. « Macho Man est un miroir qui permet d’aborder le sujet des féminicides encore tellement tabou, estime Maria-Carmela Mini, la directrice artistique de Latitudes Contemporaines, bureau de production de la scène contemporaine internationale à l’origine de la programmation de Macho Man dans les Hauts-de-France. Quand je l’ai découvert à Valence, c’était pour moi la première fois que je voyais un spectacle qui traitait ce sujet de société de manière aussi impactant, sans être dans le jugement ou le dogmatisme ». A travers ce voyage expérimental à la croisée des arts de la scène, des arts plastiques, de la psychologie et de la documentation, Àlex Rigola a voulu sensibiliser à un sujet qui touche une femme sur trois. Et donc des millions de familles. Dans le coin d’un jardin reconstitué, une petite cabane en bois plonge les spectateurs dans une ambiance plus intime encore. C’est là qu’ils sont invités à se saisir de carnets de dessins d’enfants traduisant l’horreur des violences faites au sein des familles. « On joue avec le curseur des émotions pour que les gens puissent se demander « qu’est-ce que je peux faire pour changer la situation ? » », insiste Àlex Rigola. Lire aussi Féminicides : en 2020, près d’une victime sur cinq avait porté plainte A la fin de la déambulation, un espace ressources a été aménagé pour permettre de discuter avec des professionnels, psychologues ou associations. Et digérer la dernière et onzième installation qui diffuse un extrait du jeu vidéo GTA V (Grand Theft Auto) dans lequel les joueurs sont invités, après un acte sexuel avec une prostituée, à la tuer en la frappant à mort afin qu’ils puissent récupérer leur argent. Glaçant. Macho Man, jusqu’au 13 novembre au Grand Sud à Lille. Puis à Arras du 17 au 22 novembre. Laurie Moniez(Lille, correspondante)
|

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 27, 2023 1:07 PM
|
par Ève Beauvallet dans Libération, le 27 juillet 2023 Ironisant sur les stéréotypes racistes accolés aux femmes noires dans la société contemporaine, accueilli en triomphe dans le festival in, le spectacle «Carte noire nommée désir» a suscité les réactions agressives, verbales et physiques, de certains spectateurs. Pendant ce temps, la fachosphère fustige une oeuvre qu’elle n’a pas vue. Ces derniers jours, au Festival in d’Avignon, des spectateurs ont crié leur mécontentement pendant une pièce accueillie comme un chef-d’œuvre par une partie de la presse et du public. L’un d’eux a même frappé une comédienne sur la main. Une routine déplorable mais une routine, penserait-on a priori, celle du monde tumultueux du spectacle vivant qui en a vu bien d’autres en matière d’«interaction» violente et anti-démocratique entre scène et salle : un homme montant sur le plateau pour tordre le doigt de la chorégraphe Maguy Marin, un autre criant «Mange ton caca !» au metteur en scène Johan Simons… Sauf que la pièce en question, ici, s’intitule Carte noire nommée désir, qu’elle est interprétée par huit artistes afro-descendantes devant un public majoritairement blanc, et qu’elle revisite pendant 2h40 les clichés les plus lourds liés aux représentations de la femme noire dans la société française contemporaine, notamment son hypersexualisation. Dès lors, plus de «routine» du spectacle vivant derrière ces violences mais plutôt une routine sociétale, celle des «agressions racistes», ont déduit plusieurs spectateurs, manifestant depuis leur émotion sur les réseaux sociaux. L’équipe du Festival d’Avignon caractérisait de la même façon les événements lundi, par communiqué : «Les interprètes font face lors des représentations mais aussi dans les rues à des agressions verbales et physiques à caractère raciste.» Le directeur de l’événement Tiago Rodrigues a fermement condamné ces comportements en conférence de presse : «Au Festival d’Avignon, nous ne trouvons pas seulement cela inacceptable mais nous combattons [ces comportements].» Ni l’équipe du festival ni l’équipe artistique de la pièce n’ont souhaité décrire et commenter les faits auprès de Libération. Contre-offensive en salle Les tensions ont commencé dès la première représentation à Avignon, jeudi 20 juillet. Lorsque les spectateurs de Carte noire nommée désir entrent en salle, ils découvrent un gradin pour les blancs, un gradin pour les noires. A nous, une hôtesse d’accueil indique le gradin habituel, à ces afro-descendantes et métisses visibles elle indique à voix basse qu’elles peuvent, si elles le souhaitent, s’installer sur ces banquettes en fond de scène, face aux autres spectateurs, devenant ainsi le décor vivant d’un spectacle qui ambitionne justement de parler de «ça» : la ségrégation quotidienne plus ou moins larvée dans une société qui croit en être totalement débarrassée. Certaines spectatrices noires jouent le jeu, d’autres le refusent. On en verra une quitter la salle au milieu de la pièce. Faut-il vraiment le préciser ? Le geste relève évidemment, à l’image de l’ensemble du spectacle, de la mise en scène purement sarcastique. Libre à chacun de la trouver plus ou moins corrosive ou plus ou moins inspirée, mais quiconque aurait un problème idéologique majeur avec cet «humour noir» et le discours qu’il sert ici est invité, via une annonce diffusée pendant la durée de l’installation du public, à en discuter paisiblement avec l’équipe autour d’un verre à l’issue de la représentation. Un homme criera pourtant au «déni de démocratie» pendant la représentation du 21 juillet, rapporte le site Sceneweb. Le 20, date où nous étions, et alors que Rebecca Chaillon frotte interminablement le plateau pour le rendre plus blanc que blanc, un autre spectateur s’écrie : «Il y a une éthique au théâtre ! A Avignon, on dit ce qu’on pense !» La contre-offensive, massive, fuse immédiatement en salle, en chœur : «Ta gueule.» Stéréotype de la «nounou noire» Plus tard, les interprètes parodient un jeu télévisé participatif type Questions pour un champion avec ici l’équipe «ménage», là l’équipe «cantine». Soudain, une interprète s’élance dans les gradins pour dérober les sacs et objets des «blancs», évidemment sans leur consentement, puisqu’il s’agit d’un grand jeu de colonisation inversée, a-t-elle expliqué, les «pillés» en verront bientôt les bénéfices ! Un homme rechigne à laisser ses lunettes. «Il y a de la résistance, je vois !» crie-t-elle au public, toujours dans son personnage. La même comédienne recevra le lendemain une claque sur la main après qu’un spectateur, «âgé d’une soixantaine d’années», a refusé à plusieurs reprises de laisser son sac, rapporte encore le site Sceneweb : «L’une des comédiennes s’exclame alors : «Voilà on peut frapper une actrice pendant un spectacle et partir tranquillement, c’est ce qu’on appelle le privilège blanc».» L’équipe artistique a finalement choisi de couper cette scène interactive pour la remplacer par la lecture d’un texte. Les dates restantes ont été encadrées par un vigile. Toutes sont accueillies par une standing ovation d’une majeure partie du public. Un attaché de presse présent dans la salle lors de cette frappe s’est désolé sur son compte Facebook de n’être pas intervenu pour empêcher le mauvais joueur de quitter la salle et s’en est excusé auprès de la compagnie. Une artiste belge lui répond qu’ « à Bruxelles, ce spectateur se serait fait pisser dans la bouche. » Un autre témoin des faits déplore «la réaction très agressive (de ce) spectateur, agacé par la séquence de simulation de sac volé ou par trop de vérités ?. Réaction venue signifier exactement ce qui était démontré sur scène !» Quoi donc? Un racisme flagrant? Sur Sceneweb, un commentateur peine à comprendre le lien logique: « N’est ce pas un spectateur simplement agacé que l’on s’empare de son sac et qui a réagi un peu trop fermement ? Quel rapport avec la » race » ( sic)? » Pour l’heure, Rébecca Chaillon a préféré parler, sur sa page Facebook, de «violentes réactions», manifestant aussi son émotion d’avoir découvert une grande pancarte de soutien devant le théâtre : «Tous les messages, partages sur les réseaux sociaux, le bouche à oreille, les débats menés avec l’entourage, les groupes, le soutien du festival… Comment dire ? Ça fout la chiale de sentir que certain·e·s sont là, nous entendent, nous accompagnent. Merci !» Les marques de solidarité du milieu culturel pleuvent depuis, notamment de la part de l’équipe du théâtre de l’Odéon à Paris qui doit accueillir la pièce à l’automne. Mais pendant ce temps, un autre public aux valeurs bien plus lisibles que celui d’Avignon s’est réveillé : la fachosphère bien sûr, qui n’a pas cru bon d’assister à ce spectacle «wokiste» et «financé par nos impôts» pour interpréter, avec une littéralité confondante, les images et extraits qui circulent sur le Web. Eric Zemmour s’est évidemment fendu d’un tweet, jeudi 27 juillet, pour se scandaliser de ce «racisme anti-blanc y compris au sein du public qu’on sépare entre femmes noires d’un côté mises en majesté, et le reste du public, blanc, auquel on fait vivre un petit apartheid». Comme si cette scène en forme de pied-de-nez relevait d’un rêve de société. Pire, l’homme politique y tient la preuve que les afro-descendants veulent «génocider les blancs, à commencer par les bébés». La preuve ? La photo du spectacle sur laquelle une comédienne noire embroche des bébés en plastique blanc. Dans Carte noire nommée désir, une comédienne incarne, le temps d’un tableau, le stéréotype de la «nounou noire» employée par les riches blancs et embroche des poupons en plastique (des blancs et des noirs). Faut-il encore le préciser ? Rien n’indique que cette scène relève d’un projet de société. C’est une mise en scène bouffonne, évidemment, des cauchemars racistes de certains blancs, qu’on pensait dater d’il y a cent ans. Tout cela, Eric Zemmour le sait bien. Mais dans la guerre culturelle d’aujourd’hui, tout est affaire de récupération. Eve Beauvallet / Libération Mis à jour le 27 juillet 2023 à 18h56 après le tweet d’Eric Zemmour Légende photo : Dans une scène bouffonne, une comédienne incarne le stéréotype de la «nounou noire» et embroche des poupons blancs en plastique. (Christophe Raynaud de Lage/Christophe Raynaud de Lage)

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
July 21, 2023 4:41 PM
|
Par Fabienne Darge dans Le Monde - 21 juillet 2023 La metteuse en scène et performeuse déconstruit la représentation de la femme noire dans un spectacle performatif et magistral. Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/07/21/au-festival-d-avignon-rebecca-chaillon-penetre-l-inconscient-colonial_6182956_3246.html
Nouveau triomphe à Avignon : après Bintou Dembélé et Milo Rau, c’est la metteuse en scène et performeuse Rébecca Chaillon qui a mis toute la salle debout, jeudi 20 juillet au soir. Le public a semblé ne plus jamais vouloir s’arrêter d’applaudir, à l’issue de la première avignonnaise de Carte noire nommée désir. Cet accueil est venu saluer un spectacle impressionnant, et qui fera date, dans sa manière d’inscrire la pensée décoloniale dans une histoire du théâtre et de la performance, avec une intelligence magistrale, un humour dévastateur et un engagement du corps phénoménal. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que Rébecca Chaillon jette son corps dans la bataille, de même que celui de ses performeuses, dans ce spectacle qui déconstruit, au fil de quelque trois heures, les représentations de la femme noire, et ce qu’elles révèlent de l’inconscient colonial français. Un spectacle qui commence avant de commencer, par l’annonce faite par des haut-parleurs : les femmes noires assistant à la représentation sont invitées à se regrouper dans un autre espace que celui du reste du public. Elles seront une vingtaine, installées sur des canapés de l’autre côté du plateau, et nous faisant face. En séparant ainsi les spectateurs en fonction de leur couleur de peau et de leur genre, en assignant à sa place le public « blanc », bien obligé de constater sa troublante homogénéité, en inversant les termes de la discrimination, Rébecca Chaillon n’en est qu’à son premier coup d’éclat, dans ce spectacle qui va en aligner bien d’autres. Tresse politique Et c’est elle que l’on découvre d’abord, en train d’astiquer le sol blanc de son plateau, encore et encore, dans une première performance stupéfiante, qui la voit mener cette tâche comme si sa vie en dépendait, enlever ton tee-shirt, son pantalon puis sa culotte pour frotter et frotter encore, et finir par dédier tout son corps ample, superbe et noir à la mission de rendre toujours plus pure cette surface déjà immaculée. Avant qu’une de ses compagnes, enfin, ne l’arrête, au bout de longues minutes où s’éprouvent en direct la dépense et le combat. S’ouvre alors une autre scène, magnifique, où ce corps malmené, instrumentalisé, va être réparé et bichonné. Les longs cheveux de Rébecca Chaillon, cachés sous la charlotte, sont libérés et dépliés, mèches noires et blondes mélangées. Ils vont être nattés avec des cordes elles-mêmes noires et blondes, pour finir par former une énorme tresse, si lourde à porter qu’elle devra être posée sur un portant métallique. Les cheveux des femmes, et singulièrement des femmes noires, sont un sujet éminemment politique, et cette tresse est le motif central de Carte noire nommée désir. Elle finira par être reliée à de nombreuses autres qui formeront un nid, mais qui, selon l’éclairage, peuvent aussi prendre l’apparence de chaînes. La scène se passe dans un salon de coiffure où, comme il se doit, on lit des magazines féminins : en l’occurrence Amina, dédié aux femmes antillaises et africaines, avec ses petites annonces sentimentales. Un vrai régal pour Rébecca Chaillon et ses partenaires, qui s’en donnent à cœur joie avec ces textes qui alignent comme à la parade tous les clichés qui collent à la peau de la femme noire. Cette chasse à la « perle noire », ces fantasmes de tigresses ou de gazelles, mais aussi les demandes des femmes, en recherche d’un homme blanc âgé et protecteur, feraient sourire, s’ils ne recouvraient la réalité affligeante d’un racisme qui s’infiltre au cœur le plus intime de l’amour et du désir. Ainsi va ce spectacle, qui subvertit tous les stéréotypes attachés à la femme noire – outre la femme de ménage, la nounou, la danseuse animalisée et sexualisée, la chanteuse, la racaille de banlieue… – et déploie les scènes les plus insensées, à l’image de ce banquet scatologique en forme de rituel défoulatoire et libératoire. Les huit femmes s’y livrent à un dynamitage en règle de toutes les représentations associant le noir et le marron aux excréments ou plus exactement – le mot est important – au caca. Avec une furie lacanienne et explosive, elles font éclater l’absurdité de ces associations, de ces inconscients structurés comme un langage où du caca on glisse au café et au cacao, qui ont été des matières premières au cœur de l’exploitation coloniale, mais sont aussi des mots employés pour définir des couleurs de peau. La chanson Couleur café, de Gainsbourg, en prend pour son grade au passage. Puissance créatrice inépuisable Une autre des scènes cultes de ce Carte noire est une parodie du jeu télévisé « Questions pour un champion », où il va s’agir, à partir de quelques mots, d’identifier un certain nombre de situations ou de personnages encapsulés dans cette construction du Noir. Rébecca Chaillon fait monter la folie théâtrale jusqu’à une forme de chaos (très maîtrisé) où certains spectateurs – dont nous fûmes – se voient dépouiller de leur sac à main (restitués à la fin de la représentation), alors que les participants au jeu sont en train de deviner le mot colonisation. Encore n’est-ce là qu’une partie des mille et une actions, images, idées, idées-images, que Rébecca Chaillon sort de son chapeau avec une puissance créatrice qui semble inépuisable. Il y a un côté Alice au pays des merveilles grotesque, queer et surréaliste dans cette Carte noire qui adresse un vrai bras d’honneur à ce monde où les femmes n’ont jamais la couleur, le poids ou la taille imposés par le modèle dominant – un monde qui a érigé ses fantasmes de blancheur, de pureté et de légèreté comme un absolu permettant d’asservir une bonne partie de l’humanité. En tissant cette dialectique du noir et du blanc de toutes les manières possibles, Rébecca Chaillon renvoie un miroir aussi drôle qu’impitoyable à ce monde-là, tel qu’il s’est construit sur cette binarité. Performeuse exceptionnelle, qui semble capable de tout oser, elle ne mange pourtant pas toute la lumière. Elle est accompagnée par sept artistes à la présence éclatante, qui toutes sont des personnalités fortes, aux parcours de vie peu ordinaires : Estelle Borel, Aurore Déon, Maëva Husband, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Davide-Christelle Sanvee et Fatou Siby. Le plus beau est sans doute la manière dont, après cette traversée ravageuse, elle ramène de la beauté, de la douceur et une sororité qui forme l’étoffe même du spectacle. Alors que se tisse le fameux nid protecteur, l’action, la provocation et la performance laissent la place au texte, sorte de long poème-essai qui s’inscrit dans la filiation d’Aimé Césaire et de la poétesse américaine Audre Lorde, et où la Chaillon revendique sa « pensée blanche et noire, tressée ». Elle apparaît alors, irradiant de force tranquille sous son énorme tresse dressée comme un tronc d’arbre vers le ciel, nue toujours – elle n’a pas cessé de l’être, ou presque, tout au long du spectacle. Souveraine comme une idole. Carte noire nommée désir, de et par Rébecca Chaillon. Gymnase du lycée Aubanel, à Avignon, jusqu’au 25 juillet (complet). Puis à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, du 28 novembre au 17 décembre, au Havre et à Malakoff. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) / Le Monde « Carte noire nommée désir », de Rébecca Chaillon, au Festival d’Avignon en juillet 2023. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FESTIVAL D’AVIGNON

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
May 16, 2023 10:55 AM
|
Tribune publiée dans Libération le 16 mai 2023 En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival démontre que les violences dans les milieux de création peuvent s’exercer en toute impunité. Plus d’une centaine d’actrices et acteurs saluent la décision d’Adèle Haenel d’arrêter le cinéma et ne veulent plus se taire. L'actrice Adèle Haenel lors d'une action dénonçant le sexisme dans le monde du théâtre, lors de la Nuit des molières, le 30 mai 2022, à Paris. (Karim Daher/Hans Lucas) par Un collectif d'actrices et d'acteurs publié aujourd'hui à 13h15 Le cinéma français a intégré un système dysfonctionnel qui broie et anéantit. Nous le savons depuis longtemps, nous en sommes les victimes et les témoins quotidiens. C’est parce que nous aimons passionnément notre métier que nous prenons la parole aujourd’hui. Nous subissons bien trop souvent des agressions sexuelles, du harcèlement moral et du racisme au sein même de nos lieux de travail. Lorsque nous avons le courage de parler ou demander de l’aide nous nous entendons trop souvent dire : «Tais-toi s’il te plaît, pour la vie du film.» Il arrive même que des producteur·ices soient prêt·es à acheter notre silence. Ces formes de violences font partie de notre quotidien, on a même tenté de nous faire croire que cela faisait partie du métier. Il est temps que cela change, et cela ne peut se faire que si nous sommes entendues aux plus hautes places du pouvoir du cinéma français. Nous ne pouvons pas dire que ce soit le cas pour l’instant. La peur comme verrou Nous sommes profondément indigné·es et refusons de garder le silence face aux positionnements politiques affichés par le Festival de Cannes. Nous refusons d’être associées aux décisions prises ces dernières semaines. En déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent, le festival envoie le message que dans notre pays nous pouvons continuer d’exercer des violences en toute impunité, que la violence est acceptable dans les lieux de création. Il est temps que le cinéma français cesse d’apporter son soutien aux personnes qui abusent de leurs positions de pouvoir. Evidemment, la place que l’on offre aux personnes qui abusent, harcèlent, violentent, sur le tapis rouge de ce festival ne vient pas de nulle part. C’est symptomatique d’un système global mis en place depuis des générations. C’est un système basé sur les principes de domination et de silenciation. La silenciation de toutes celles et ceux qui travaillent dans le milieu du cinéma et qui n’osent prendre la parole par peur des impacts sur leur carrière, leurs productions, leurs postes. Cette peur est un verrou puissant. Faire entendre une autre voix Nous voulons faire entendre une autre voix, celles de femmes et d’hommes qui soutiennent les techniciens et techniciennes, les acteurs et les actrices qui dénoncent les violences, les journalistes qui publient ces enquêtes. Nous connaissons le milieu du cinéma, nous vous croyons, nous ne voulons plus nous taire, nous vous soutenons. Adèle Haenel a récemment rappelé qu’elle a «décidé de politiser son arrêt du cinéma». C’est une décision que nous comprenons et soutenons. Nous ne pouvons que déplorer le fait que ce milieu soit toxique au point de vouloir le quitter totalement. Nous profitons de cette tribune pour dire avec elle : «la HONTE». Nous savons qu’une autre façon de fonctionner est possible, que les avancées qu’apportent un mouvement comme celui de #MeToo offrent la perspective d’un monde dans lequel nous pourrons enfin tous et toutes travailler sans peur et offrir des films qui porteront l’enthousiasme d’une génération qui refuse les rapports de domination. Notre voix ne fait que naître. Les 123 signataires : Ariane Labed, Clotilde Hesme, Louise Chevillotte, Daphné Patakia, Megan Northam, Mara Taquin, Luna Ribeiro, Luana Duchemin, Maud Wyler, Alma Jodorowsky, Noée Abita, Ji-Min Park, Louise Orry Diquero, Julia Faure, Marie Denarnaud, Felix Maritaud, Solène Rigot, Bastien Bouillon, Anthony Bajon, Florence Loiret Caille, Maximilien Seweryn, Liv Henneguier, Estelle Meyer, Olivia Ross, Jérémie Renier, Caroline Ducey, Valerie Crouzet, Judith Davis, Alice Issaz, Muriel Combeau, Guslagie Malanda, Valentine Cadic, Bérénice Coudy, Christine Citti, Corentin Fila, Nejma Ben Armor, Emmanuel Noblet, Nahuel Perez Biscayart, Alice de Lencquesaing, Camille Chamoux, Lola Bessis, Agathe Bonitzer, Clément Métayer, Timothée Robart, Swann Arlaud, Anna Mouglalis, Marie Papillon, Pauline Etienne, Julie Gayet, Romane Bohringer, Jonathan Couzinié, Camille Claris, Eurydice El-Etr, Manda Touré, Stanley Weber, Galatéa Bellugi, Alba Gaïa Bellugi, Vahina Giocante, Clara Ponsot, Sabrina Seyvecou, Louise Coldefy, Lina El Arabi, Constance Rousseau, Adeline Moreau, Caroline Proust, Marianne Denicourt, Assa Sylla, Victor Bonnel, Leo Chalié, Finnegan Oldfield, Arnaud Valois, Géraldine Nakache, Laika Blanc Francard, Dimitri Doré, Sigrid Bouaziz, Bérangère Mc Neese, Arthur Choisnet, Eliam Mohammad, Matthieu Rano, Marie Colomb, Tobias Nuytten, Matthieu Lucci, Melvin Boomer, Tracy Gotoas, Anne Benoit, Laura Sepul, Karina Testa, Félix Kyssyl, Manuel Severi, Fantine Harduin, Zita Hanrot, Lilith Grasmug, Axel Auriant, Léna Garrel, Makita Samba, Grace Seri, Sophie Cattani, Naidra Ayadi, Stéphanie Cléau, Zinedine Soualem, Jonas Bachan, Victoire Du Bois, Jenna Thiam, Massimo Riggi, Gerard Watkins, Ophélie Bau, Naëlle Dariya, Melissa Guers, Anne Azoulay, Laure Calamy, Clémentine Poidatz, Ornella Fleury, Adama Diop, Annabelle Lengronne, Laurence Cordier, Claire Dumas, Sophie Duez, Delia Espinat Dief, Giorgia Sinicorni, Lola Naymark, Agathe Drone, Lena Paugam, Ava Baya. Pour signer la pétition c’est ici Vous souhaitez publier une tribune dans Libération ? Pour connaître nos conseils et la marche à suivre, ainsi que l’adresse à laquelle nous envoyer vos propositions, rendez-vous dans la section «Proposer une tribune» en bas de cette page.

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
February 26, 2023 4:47 AM
|
Par Laurent Carpentier et Aureliano Tonet dans Le Monde - 26/02/23
Accusées de sexisme ou de postcolonialisme, dans les écoles d’art, de cinéma et de théâtre, les icônes d’hier sont aujourd’hui « déconstruites » et la parole des enseignants est remise en question.
Lire l'article sur le site du "Monde" :
https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/02/26/quand-les-etudiants-deboulonnent-godard-koltes-ou-tchekhov_6163345_3246.html
Lundi 5 décembre 2022, à la Fémis, la grande école parisienne de cinéma, Nicole Brenez tient un cours sur l’art et la manière de conclure un film. La directrice du département Analyse et culture cinématographique projette la fin de Sombre (1998), de Philippe Grandrieux : un féminicide, analyse-t-elle, après avoir averti que l’extrait contenait des images violentes. Tollé des étudiants qui quittent la salle. « Le viol n’est pas un motif narratif, il n’est pas un pivot dramaturgique, il n’est pas une pulsion de mort qui existe en chaque être humain », écrivent, deux jours plus tard, les élèves de première année, dans un long mail interpellant l’ensemble de la Fémis. « Le viol est une construction sociale largement acceptée, normalisée, esthétisée et érotisée. Il est temps d’en parler comme tel. » Signé : « Les femmes de la promotion Kelly Reichardt… » Anecdotique ? Pas vraiment. L’événement raconte un mouvement que l’on retrouve dans la plupart des lieux où s’enseigne la culture. A la Fémis, dans l’urgence, la direction organise un débat, vendredi 9 décembre 2022. « Trois heures de dialogue de sourds, entre deux générations irréconciliables », juge une étudiante. « Un échange fructueux, assure, au contraire, Nathalie Coste-Cerdan, la directrice générale, pour qui tout est rentré dans l’ordre. Un groupe de réflexion, dont font partie certaines étudiantes de la pétition, s’est réuni plusieurs fois : comment mieux encadrer et contextualiser les représentations violentes, sans les interdire ? » Fin janvier, au bar Le 61, un café parisien près du canal de La Villette, Nicole Brenez dédicace le livre qu’elle vient d’écrire, Jean-Luc Godard (De L’incidence éditeur, 336 pages, 9 euros). La petite salle grouille de cinéphiles venus l’écouter. Emue, elle parle mezza voce, tout son corps semble s’excuser d’être là, un tout petit peu dans la lumière : « Dans ma génération, on s’intéressait plus aux œuvres qu’aux gens. Je suis une formaliste, j’ai été éduquée comme ça. Alors que je suis une groupie de Godard, je n’avais pas lu une biographie et n’avais jamais imaginé le rencontrer », raconte la critique devenue une proche du réalisateur. On cherche à lui parler. On évoque la Fémis. Sa voix se tarit, submergée de tristesse. Tout juste balbutie-t-elle : « Tout mon principe de base existentiel, structurant, idéologique, m’empêche de me battre contre mes élèves. J’ai toujours été pour la liberté de la parole, la remise en question, je suis là pour les aider. On est dans une absurdité totale… » Lire aussi Article réservé à nos abonnés Un vent de diversité souffle sur les écoles de cinéma Aux Beaux-Arts de Marseille, c’est Le Mépris (1963), de ce même Godard, qui a mis sur la sellette Didier Morin, professeur de cinéma et de lettres pendant un quart de siècle. « Depuis quelque temps, pendant les projections, j’entendais un brouhaha dans le fond de la salle, je croyais que c’était de l’inattention, mais, ce jour-là, j’ai compris… » Ce jour-là, « elles » se sont levées et ont débranché le projecteur. C’était en 2019. Exit Brigitte Bardot dans le plus simple appareil roucoulant « Tu les aimes mes fesses ? Et mes seins ? ». Spécialiste de Pier Paolo Pasolini et de Jean Genet, Didier Morin pousse un soupir sans fin : « Et encore, je n’ai jamais montré Une sale histoire (1977), de Jean Eustache, où Michael Lonsdale raconte comment il est devenu voyeur grâce à un trou percé dans les toilettes des femmes… Je me serais fait incendier. » « Une génération hypersensible » Partout, des profs sur le gril. En février 2020, à Paris-VIII, une historienne travaillant sur les représentations de l’affaire Dreyfus met le film de Roman Polanski à son programme. La séance est interrompue. Un an plus tôt à la Sorbonne, Les Suppliantes, d’Eschyle, sont bloquées parce que le metteur en scène, Philippe Brunet, spécialiste de la Grèce antique dont il dit suivre la tradition, a maquillé une Danaïde couleur cuivre : délit de « blackface ». Ici, c’est un linguiste tenant une conférence anti-écriture inclusive qui est arrosé d’urine ; là, une professeure qui écrit « chère madame » à ses élèves se retrouve attaquée parce que le « chère » est jugé familier. « C’est une génération hypersensible », se désole un professeur confronté à une étudiante horrifiée par la photo de Richard Avedon, Dovima with Elephants (1955), qui heurte ses convictions animalistes. Combat de nègre et de chiens (1979), la pièce de Bernard-Marie Koltès, reste elle en travers de la gorge d’élèves de Paris-III. La liste est sans fin. L « Juste de la hargne contre notre autorité de la part de quelques harpies débiles », s’emporte un professeur d’histoire de l’art. Attaqué pour ses manières d’un autre âge – du genre à dire à une étudiante qu’elle est « jolie comme une sculpture de porcelaine » –, il a fini, poussé par son administration, par partir à la retraite bien avant ses 64 ans. Au commissariat de police où il avait été convoqué, l’inspectrice lui avait signalé : « Vous montrez des nus dans vos cours ! » Il en rigole encore. « Je travaillais sur l’arte povera et l’art brut, je n’ai jamais montré de nus, mais je lui ai conseillé d’aller faire un tour au Louvre. » Convoqué au commissariat, Didier Morin l’a été lui aussi. L’homme qui, aux Beaux-Arts de Marseille, faisait étudier Le Mépris aurait, à la cantine, touché avec son plateau-repas les fesses d’une élève. Non-lieu judiciaire, opprobre public. Il a quitté l’enseignement. Ce que, dans leur texte, les « femmes de la promotion Kelly Reichardt » de la Fémis reprochent à leur professeur, au-delà d’avoir montré quelque chose qu’elles considèrent comme du « male gaze » (le regard masculin érotisant le corps des femmes), c’est de ne pas les avoir mieux averties du contexte, de n’avoir pas actionné de « trigger warning » (« avertissement en amont »)… Né sur les campus américains, le lexique « woke » (le « réveil » des consciences) a gagné l’université française. « Cancel culture » (dénonciation publique et annulation d’événements comme méthode de lutte), « safe place » (lieu où l’on ne tolère pas les comportements stigmatisants), « blackface » (grimage du visage en noir)… Lire aussi Article réservé à nos abonnés Le péril largement exagéré d’une jeunesse « woke » en rupture « On sait bien ce que produit le “trigger warning” aux Etats-Unis : de l’injustice, de la censure, s’inquiète un professeur de Paris-III qui a longtemps travaillé outre-Atlantique. Là-bas, les élèves sont des clients. Ils paient et il faut les satisfaire. Chez nous, c’est moins le cas. » A voir. Là où l’école publique, laïque et obligatoire avait sanctifié la parole du maître, l’autonomie grandissante des établissements du supérieur et l’optimisation financière qui va avec sont en train de changer la donne. L’élève, qu’il paie chèrement ses études ou qu’il soit boursier, devient une variable économique, un consommateur à satisfaire. Le professeur, autrefois systématiquement soutenu par l’institution, est remis en question. Ajoutez la caisse de résonance des réseaux sociaux : désormais, la voix des élèves n’est pas seulement écoutée, elle est entendue. Comme le raconte Emma, en cinquième année d’un cursus de médiation culturelle à Bordeaux : « A nous, on a appris qu’on avait le droit de parler et que notre parole avait un sens. » En 2022, un de leurs professeurs tenait des propos « sexistes et racistes ». Les élèves sont allés voir la direction. Il a disparu des effectifs. Enseignement en jeu Un changement de paradigme salutaire pour les jeunes générations. Qui laisse, de l’autre côté, les enseignants parfois bien seuls face à la vague. Spécialiste de l’essai documentaire et du montage cinématographique, Bertrand Bacqué, 58 ans, est professeur associé à la Haute Ecole d’art et de design (HEAD) de Genève (Suisse). En avril, il travaille avec ses élèves sur un texte de Johan van der Keuken datant de 1967, « La vérité 24 fois par seconde » – référence à une formule de Godard, une fois de plus. Comme il le fait depuis dix ans, Bertrand Bacqué diffuse un extrait d’un film de l’auteur, Lucebert, temps et adieux (1994). « C’est un montage très serré, des travailleurs sous le soleil, un dictateur grimaçant, une chèvre qu’on égorge, et puis une fête en Espagne avec les Rois mages, dont Balthazar, le visage peint, raconte un élève. Une étudiante noire a jugé que c’était négrophobe, elle s’est couchée sur sa table. Le prof a essayé de lui expliquer que van der Keuken était de son côté. Rien n’y a fait. » L’élève ne vient plus aux cours, le professeur ne valide pas son semestre. Le voilà bientôt convoqué par l’administration pour diffusion d’images racistes. C’est que la HEAD est à la pointe de la lutte contre les discriminations. Il y a quatre ans, son président a nommé un « déléguex » à l’inclusivité – le « x » désigne le non-genré. Transgenre, Nayansaku Mufwankolo est en effet, tel que l’explique sa bio sur le site de l’université, « unx poetx et chercheurx en art contemporain diploméx d’un master de l’université de Lausanne en anglais avec spécialisation en new american studies et en histoire de l’art ». A Bertrand Bacqué, on demande de suivre une formation sur ces questions. « Ça a l’air futile, raconté comme ça, mais si l’écriture inclusive fait autant peur, c’est qu’elle questionne le pouvoir », réagit Iris Brey, 37 ans. Avec son essai Le Regard féminin. Une révolution à l’écran (Ed. de L’Olivier, 2020), cette critique de cinéma est devenue un modèle pour les élèves qui se clament « déconstruit.e.s ». « On est à un endroit de fracture et de scission. C’est un moment d’inconfort, qui peut créer des situations ubuesques, mais je pense que ça va déboucher sur une vision fructueuse du cinéma. A l’image de ce qu’a fait le mouvement structuraliste dans les années 1960, réfléchir aujourd’hui à travers une grille féministe ne peut que générer de la pensée. Godard ne disparaîtra pas, mais il rencontrerait moins de résistance si, à côté de ses films, on étudiait un peu plus ceux de Chantal Akerman. » Helléniste, venue au cinéma par la littérature et le mythe de Médée, longtemps enseignante à la New York University, Iris Brey se veut conciliatrice : « Nicole Brenez est, pour moi, une des plus grandes critiques qui existent, qui a beaucoup apporté à la compréhension d’un cinéma queer. Mais, à la Fémis comme ailleurs, c’est moins la question du “trigger warning” que celle de l’enseignement qui est en jeu. Dans les listes de films recommandés par le corps professoral, je vois une absence criante de réalisatrices ou de cinéastes issus de minorités. » Nathalie Coste-Cerdan insiste, elle, sur la marche vers davantage de parité et de pluralité qu’a entreprise son établissement : « Ce socle, coconstruit avec les étudiants, ne s’érige pas en un jour. » Iris Brey en convient : revoir sa façon d’enseigner exige du temps. « Quand j’ai commencé à donner des cours, ayant programmé A bout de souffle, j’ai vu des étudiantes me montrer des choses – le regard sur la femme enceinte, la façon dont le corps est cadré, le mépris qui en ressort –, que je n’avais pas perçues alors que je me pensais plutôt déconstruite et féministe. La nouvelle génération a un prisme qui est beaucoup plus vif sur les questions de sexisme. » Risque de l’autocensure Lisa Quiesse, 19 ans, et Enora Giboire, 21 ans, sont en deuxième année de licence de cinéma à La Sorbonne - Saint-Charles. « On est en colère depuis le début de l’année », dit l’une. « Ça fait plaisir de voir que c’est en train d’éclore un peu partout », confirme l’autre. « Par exemple, ce matin, en cours de postproduction, un élève a présenté un film sur une femme trans. Et le prof ne savait pas comment en parler. Il ? Elle ? Il parlait de transsexualité au lieu de transidentité, s’étonne Lisa. Les profs auraient besoin d’une mise à niveau. » La première vient de Caen, l’autre de Rennes. Elles sont toutes deux cisgenres et « elles » (dans le monde « déconstruit », on annonce son pronom pour mieux inclure les personnes trans et non binaires). Parents brodeuse, sculpteur, architecte… ouverts à la discussion. Elles aussi. Révoltées certes (« Entre les déconstruits et les autres élèves, il y a une rupture »), capables de tenir la dragée haute aux mandarins ou de passer à l’action (laquelle, elles ne le savent pas encore), mais aussi promptes à s’émerveiller qu’on les écoute. « On a compris que ça n’allait pas, grimace Enora, quand une prof, à qui on suggérait qu’il y avait un peu plus de réalisatrices importantes que les trois qu’elle citait, nous a répondu : “Ça fait trente ans que je fais le même cours, je ne vais pas le refaire.” » Et Lisa d’embrayer : « On a un doctorant, on dirait qu’il n’aime qu’un seul film : La Vie d’Adèle ! Quand on fait remarquer que Kechiche pose un regard masculin, que D. W. Griffith a aidé le Ku Klux Klan, que Polanski a été accusé de viol, on nous renvoie toujours au contexte. Il a bon dos, le contexte. Eux, ils ne se remettent pas dans le contexte ! » Un vent de panique passe sur l’université. A Toulouse, un colloque est organisé en mars 2022 sur « Les Nouvelles Censures ». Simple journée d’études réservée aux doctorants ? Quand nous avons voulu en savoir plus, les organisatrices ont pris peur : « Il ne faut pas en parler. D’ailleurs ce n’est pas ouvert au public », ont-elles botté en touche. « Le vrai risque derrière tout ça, c’est l’autocensure, relève une professeur de philosophie qui préférera, tout compte fait, rester anonyme. Tzvetan Todorov racontait comment, avant la chute du rideau de fer, les intellectuels bulgares s’étaient rués sur le structuralisme. Parce que c’était un sujet neutre. On parlait de forme, ça évitait les ennuis… C’est compréhensible de ne pas vouloir aller en cours la peur au ventre. » « Des pyramides de pouvoir » C’est ainsi que les rebelles d’hier, dans leur refus de tout diktat, se retrouvent en première ligne : « Quand le wokisme est arrivé, j’étais plein d’espoir, cela allait apporter de l’air frais, témoigne le plasticien Jean-Luc Verna, qui enseigne le dessin aux Beaux-Arts de Cergy (Val-d’Oise). Puis c’est devenu une idéologie, et enfin du marketing. Cela donne des groupes fermés, beaucoup d’entre-soi, les queers avec les queers, les racisés avec les racisés. Ces gens non binaires ont une vision très binaire. Quid du droit au flou ? Je n’en peux plus des “alphabet people” [référence à l’acronyme LGBTQIA+ : lesbiennes, gay, bisexuels, transexuels, queer, intersexe, asexuel]. C’est le monde d’Internet, des catégories, qui crée de la souffrance pour ceux qui n’entrent pas dans le cadre… Tout ça, ce sont des élèves qui érigent des pyramides de pouvoir. Plus ils réclament de l’horizontalité, plus ils recréent de la verticalité. » Enorme chaîne noire sur sa combinaison noire, couvert de tatouages qui ruissellent depuis le sommet du crâne qu’il a rond et lisse, un sourire brillant de dents métalliques, Jean-Luc Verna n’est pas du genre à se cacher derrière son petit doigt : « Entre profs, on ne parle plus que de ça. Il y a quelque temps, on a reçu une circulaire. Règle 1 : pas d’interaction physique. Donc si quelqu’un pleure, on ne peut pas lui toucher le bras ?, commente-t-il. J’ai rassuré les étudiants : je n’aime pas les corps de jeunes. » Il prend une pose pour minauder : « J’ai 57 ans, mais j’en parais 37 », avant de reprendre : « Règle numéro 2 : des interactions “mates”. Pas d’humour, quoi. C’est dommage parce que, pour moi, c’est le lubrifiant pédagogique numéro 1. » Il en rit, mais ces « ligues de vertu » le mettent en colère. « A Cergy, mes collègues blancs, hétéros, de plus de 50 ans, rasent les murs. Ils sont considérés comme des agresseurs potentiels, suppôts du patriarcat. Le fait que je sois solidaire et que je le dise en public, ça ne passe pas. » En octobre 2022, il était invité à donner une conférence devant trois cents personnes à la Villa Arson, à Nice, où il a passé vingt-cinq ans. « Moi qui suis une vieille pédale maquillée, qui leur ai pavé le chemin, j’ai senti du flottement quand j’ai dit qu’avant d’être homosexuel, j’étais un homme, et avant d’être un homme, un artiste. Que je n’étais pas fier d’être homosexuel : je ne l’ai pas choisi, comme je n’ai pas choisi d’être blanc. Et que j’accepterai de porter le drapeau arc-en-ciel lorsqu’il comprendra une couleur pour les hétérosexuels… » Le Niçois s’est pris une bronca. « Une voie à suivre » Un mois après, une autre ancienne de l’école, l’artiste égyptienne réputée féministe Ghada Amer se voit, elle aussi, reproché de n’être « pas assez ». « C’est beaucoup plus agressif qu’aux Etats-Unis », raconte celle qui vit et travaille désormais à New York. De passage en France cet hiver, elle donne quelques conférences dans les écoles d’art. A Marseille, la voilà prise à partie. « Je suis inclusive, pas exclusive, #metoo est devenu ça. » Elle rit mais son rire sonne tristement. « Ils dogmatisent une pensée qui est importante pour moi, sur laquelle, pendant trente ans, j’étais seule à me battre. » Jointe au téléphone, elle évoque ce professeur qui, lorsqu’elle étudiait à la Villa Arson, à la fin des années 1980, refusait aux femmes l’accès à son cours de peinture. « C’est lui qui m’a réveillée. J’ai été à la bibliothèque et vu le peu de place fait aux femmes dans les arts plastiques… En Egypte, j’avais dû me battre pour le corps, en France, pour la tête. C’était angoissant, mais j’en ai fait une arme. » Lorsqu’elle revient à la Villa Arson, en décembre 2022, l’amphithéâtre est plein. De nouveau, on l’interpelle : « Quel est votre rapport au postcolonialisme ? » Elle répond qu’elle fait de l’art… « C’est comme si j’avais dit “Dieu n’existe pas” à des religieux. » La salle insiste : « Que pensez-vous du racisme systémique de la Villa Arson ? » Elle ne comprend pas. « Le directeur était là, il aurait dû réagir… », s’étonne-t-elle. Les élèves ont quitté le lieu. « Qu’une génération nouvelle s’affirme en rupture, c’est un mécanisme assez classique, considère Sylvain Lizon, le directeur de l’école. En France, il y a une histoire particulière des relations entre le pouvoir, les artistes et les œuvres que cette génération bat en brèche, revendiquant ses propres repères. On vit un moment particulier et passionnant qui invite toute la communauté à se déplacer. Après, c’est vrai que ça nous demande d’être agiles. » De l’agilité, Claire Lasne Darcueil en a : « Le tout, c’est de ne pas monter dans les tours, si vous voulez que l’autre n’y aille pas non plus », dit en souriant la directrice du Conservatoire national supérieur d’art dramatique qui quitte son poste fin juin. « On assiste à la remise en cause d’un héritage par des gens qui n’en sont pas très contents. Si on est honnête, est-ce que l’on peut l’être de ce que nous leur laissons ? On a bouffé des fraises en hiver et on a vécu une liberté de création qui repose sur des injustices fondamentales… Je ne comprends pas les gens qui utilisent le mot de “censure” n’importe comment. Quand je passe dans la classe internationale, en écoutant les Afghanes, je pèse ce que c’est vraiment. » Lire l’enquête : Article réservé à nos abonnés Dans les écoles de théâtre, les pédagogies brutales ont toujours cours La photo des élèves du Conservatoire, témoigne-t-elle, a changé en dix ans. « On est passé de 15 % de boursiers à quelque chose comme 60 % aujourd’hui. Nous enseignons à des personnes qui ont lutté pour être là. Et qui doutent que le monde du théâtre et du cinéma les attende à bras ouverts… » Claire Lasne Darcueil est de celles et ceux qui prennent ce mouvement « comme une chance, une voie à suivre ». « Dès que des gens protestent fort, on dit qu’ils protestent trop fort, et mal, qu’ils sont dangereux. Alors que j’ai en face de moi des gens qui me font découvrir des choses. Même sur Tchekhov, mon auteur, mon chéri… » Et de citer l’acte III d’Oncle Vania, lorsque Astrov arrache un baiser à Elena Andréevna : « C’est le classique “Tu me dis non, mais tu veux dire oui.” Il y a encore trois ans, ça ne me faisait rien. Aujourd’hui, ça me saute aux yeux. Du coup, on l’a travaillé. Quinze versions différentes, quinze interprétations, c’était très riche. La question, c’est d’interroger le répertoire, pas de le mettre à la poubelle. » « Un désir de justice » Latiniste et helléniste, Pierre Vesperini, 45 ans, replace ces soubresauts dans le temps long. « A la fac, quand j’enseignais le viol de Lucrèce, l’événement fondateur de la République romaine, j’avais à l’esprit qu’il était tout à fait possible qu’une ou plusieurs de mes étudiantes aient subi un viol. Je faisais attention à la façon dont j’en parlais. C’était il y a vingt ans, bien avant #metoo. Mais il suffisait d’avoir un minimum de décence et de respect pour y penser. » L’historien ne nie pas un fossé entre des professeurs « engourdis » et des étudiants « démunis », les premiers prisonniers d’un « savoir sacralisé et sclérosé », les seconds manquant de recul, faute d’avoir reçu « un enseignement suffisamment riche pour les initier à la complexité de l’histoire de la culture européenne ». « La génération de 68 voulait en finir avec le puritanisme, au nom de l’autonomie du règne esthétique. Il fallait choquer le bourgeois, en brandissant Sade, Bataille… La nouvelle génération ramène de la morale, un désir de justice qu’il faut écouter. » Lui qui, dans Que faire du passé ? Réflexions sur la cancel culture (Fayard, 2022), rappelle que les Romains érigeaient des statues à leurs ennemis, d’Hannibal à Cléopâtre, en est persuadé : « L’esthétique doit pouvoir dialoguer avec l’éthique. » Sur quel art, quel cinéma, quel théâtre, tout cela ouvre-t-il ? Telle est la question qui travaille ces enseignants mis au défi de leur propre déconstruction. Aux Beaux-Arts de Paris, où il enseigne, le cinéaste et plasticien Clément Cogitore n’est pas inquiet, bien au contraire : « De tout ça, on me parle beaucoup, de ces échanges violents. Moi, je n’y suis pas confronté. Mes étudiants pensent la complexité, et cela me donne une grande foi en l’avenir. Parce que, entre un paternalisme qui regarde le monde d’un point de vue dominant et des slogans qui simplifient, le vrai sujet est là : celui de la complexité, souligne l’artiste de 39 ans. Tout mouvement important crée sa radicalité ; il n’en reste pas moins important. » Laurent Carpentier et Aureliano Tonet / Le Monde Illustration : SÉVERIN MILLET Voir tous les articles de la Revue de presse théâtre associés au mot-clé "#MeToo Théâtre et cinéma"

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 9, 2021 5:05 PM
|
Par Sophie Rahal dans Télérama 8/12/21 Elles ne réalisent qu’un tiers des mises en scène. Leurs spectacles sont joués moins longtemps que ceux des hommes. Malgré d’encourageants progrès, une réelle volonté politique se fait attendre pour donner aux femmes toute leur place. Lorsqu’un directeur de centre dramatique national (CDN) lui a récemment confié qu’il ne connaissait pas assez de créatrices pour bâtir une programmation paritaire, Claire (le prénom a été modifié) a manqué s’étouffer. « On en était encore là, à considérer que les femmes talentueuses manquent à l’appel ? » se souvient la jeune metteuse en scène, dont deux spectacles sont présentés cet automne. Et pourtant, sur beaucoup d’affiches, les femmes manquent encore. Après avoir détaillé les programmations de trois cent six de ses adhérents (scènes nationales, CDN, festivals), le Syndeac, principal syndicat d’employeurs du spectacle vivant subventionné, relève qu’elles réalisent à peine 35 % des mises en scène. Fait inédit, le comptage évalue aussi le potentiel de spectateurs perdus. Car les spectacles qu’elles signent sont non seulement joués moins longtemps, mais dans de plus petites salles. Résultat : « Les créatrices ne s’adressent qu’à 31 % du public potentiel, deux fois et demie moins que les hommes », note le syndicat, dont le président Nicolas Dubourg dénonce un « schéma systémique et péniblement caricatural ». Rien n’aurait donc changé depuis 2006 ? Cette année-là, Reine Prat, alors inspectrice au ministère de la Culture, publiait un rapport sur les inégalités entre femmes et hommes dans le subventionné, qui sert toujours de repère. « Pour la première fois, on accédait à des statistiques sexuées issues du ministère, dont les résultats dépassaient ce qu’on imaginait », se souvient-elle. Aucune femme à la tête des cinq théâtres nationaux (Comédie-Française, Théâtre national de Strasbourg, théâtres de la Colline, de l’Odéon et de Chaillot) et trois directrices sur trente-huit CDN. La chercheuse pointait des projets mieux financés lorsqu’ils sont portés par des hommes. Des jurys ou conseils d’administration inégalitaires. Une habitude masculine de l’entre-soi à l’origine d’un système global d’empêchement et d’interdictions. Pas moins macho ni misogyne, le monde du théâtre apparaissait soumis aux mêmes fractures et inégalités que le reste de la société. Le Festival d’Avignon, jamais dirigé par une femme seule Quinze ans plus tard, un bout de chemin a indéniablement été parcouru. Associations et collectifs se sont formés pour lutter contre toute forme de discrimination. Les plateaux se sont féminisés, et les rôles de femmes, dans le théâtre contemporain, ont bougé. Du côté des directions, l’avancée est contrastée. Le casting est toujours 100 % masculin dans les théâtres nationaux, alors qu’entre 2010 et 2014, Muriel Mayette et Julie Brochen avaient dirigé, respectivement, la Comédie-Française et le Théâtre national de Strasbourg. Quant au Festival d’Avignon, il n’a toujours pas été dirigé par une femme seule… Les directions des scènes nationales, subventionnées aussi par les collectivités et dont les postes sont en CDI, restent masculines : 67 % d’hommes, contre 33 % de femmes, selon l’Observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes (ministère de la Culture, mars 2021). Mais dans les CDN, la parité est presque atteinte après les nominations de Maëlle Poésy à Dijon et de Pauline Bayle à Montreuil : on recense seize directrices à la tête des CDN, pour dix-neuf directeurs et trois binômes. Des metteuses en scène émergentes n’hésitent plus, aujourd’hui, à postuler à leur direction, ce qui n’était pas le cas il y a dix ans. « Notre génération sait maintenant épauler les femmes artistes dans leur développement afin qu’elles puissent elles-mêmes devenir responsables de centres dramatiques, après y avoir été artistes associées », estime la metteuse en scène Chloé Dabert, la quarantaine, directrice de la Comédie de Reims. Les listes finales de candidats tentent le plus souvent de refléter la parité femmes-hommes. Roselyne Bachelot vient de présenter un plan Depuis bientôt dix ans, les pouvoirs publics ont pris la mesure de ces enjeux. « Le ministère s’est doté d’un Observatoire de l’égalité femmes-hommes, il réalise une veille statistique et produit chaque année depuis 2013 des analyses fines et plus qualitatives, souligne Reine Prat. L’égalité entre femmes et hommes est passée de “priorité nationale” sous François Hollande à “grande cause nationale” pendant le quinquennat d’Emmanuel Macron. On s’approche lentement de la parité dans les jurys ou comités. Malheureusement, cela relève encore de l’affichage : il manque une vraie volonté politique de changer les choses. » Ce que réfute la ministre Roselyne Bachelot qui, à l’occasion de la présentation récente d’un plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel dans le spectacle vivant, a indiqué que les futurs subsides versés aux équipes artistiques tiendront compte de la parité. « Je prépare une politique volontariste pour début 2022 », a-t-elle annoncé. D’autant que le constat de l’Observatoire est sans appel : le théâtre fait encore tristement exception à plusieurs égards, à commencer par la question de l’accès aux moyens de production. Les femmes ne représentent que 40 % des récipiendaires de subventions, et seulement 28 % des montants alloués. Elles ne réalisent que « 38 % des représentations programmées, qu’elles interviennent en termes d’écriture, d’adaptation, de scénographie, de mise en scène, de chorégraphie ou de traduction ». Et dans les théâtres nationaux, la part des autrices a progressé mais reste faible : 26 % en 2018-2019, contre 5 % dix ans plus tôt. Le Syndeac vise une “parité exemplaire” Le Syndeac promet de renouveler chaque année son comptage national jusqu’à atteindre une « parité exemplaire », et enjoint ses adhérents à faire progresser les chiffres deux fois plus vite que les objectifs fixés par le ministère. « Il y a encore quelques années, j’estimais que l’art devait échapper aux quotas, mais les choses n’avançant pas naturellement, autant en passer ponctuellement par une injonction au changement », admet le metteur en scène Joris Mathieu, directeur du Théâtre Nouvelle Génération, à Lyon, et membre de l’Association des CDN. L’idée, controversée, défendue notamment par le Mouvement H/F (Hommes-Femmes) de conditionner l’attribution de subventions au respect de la parité dans les programmations, les postes à responsabilité ou les instances de décisions, a aussi fait du chemin. Tout le monde s’accorde au moins sur un point : rien ne fonctionnera sans un rééquilibrage des moyens de production permettant aux créatrices de s’épanouir sur scène dans les mêmes conditions que leurs pairs masculins. Afin qu’elles puissent réellement inventer de nouveaux textes, et de nouvelles manières de penser le monde. Sophie Rahal / Télérama Dans le même numéro de Télérama : #MeTooThéâtre, la fin de l'omerta Enquête d'Emmanuelle Bouchez

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
December 9, 2021 4:51 PM
|
Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama - 9/12/21 Le lancement du collectif #MeToo au théâtre, cet automne, a fait l’effet d’une bombe. Comédiennes, autrices ou metteuses en scène victimes d’agressions sexuelles parlent enfin, le gouvernement lance un plan de lutte. Mais la radicalité du mouvement divise…
L’article paru dans Libération le 1er octobre dernier, révélant qu’une enquête préliminaire était ouverte pour agression sexuelle contre le metteur en scène Michel Didym, les a fait monter au créneau. « Quand on a lu que “tout le monde savait” sans rien dénoncer, on a réagi contre cette omerta » : comédiennes, autrices ou metteuses en scène, cinq femmes, toutes également victimes de violences sexistes et sexuelles, ont d’abord partagé la même indignation. Une fois leur collectif #MeTooThéâtre organisé, elles ont, le 7 octobre, lancé le hashtag assorti en publiant leurs propres témoignages. Marie Coquille-Chambel, youtubeuse du spectacle vivant qui sait manier les codes de la viralité numérique, a posté les deux premiers tweets. Dans le premier, elle appelle les personnes harcelées à témoigner. Et évoque dans le second le viol qu’elle aurait subi lors du premier confinement, perpétré par un acteur de la Comédie-Française dont elle ne donnait pas le nom, avec lequel elle entretenait une relation. En juin 2021, Nâzim Boudjenah a été condamné à six mois de prison avec sursis sans inscription au casier judiciaire pour menaces de mort et relaxé pour les violences aggravées. La plainte pour viol, elle, est toujours en cours d’instruction. Surgi brutalement sur la scène culturelle française cet automne, soit quatre ans après celui du cinéma, le mouvement #MeTooThéâtre a fait l’effet d’une bombe. Les premiers témoignages visant la Comédie-Française ont immédiatement entraîné cinq mille commentaires. La parole des femmes s’est libérée. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière le rideau ? Le théâtre – où il faut être « désiré » pour être distribué, mais où l’on est censé œuvrer à l’émancipation des citoyens – n’est-il qu’un terrain de chasse pour prédateurs sexuels. « Il faut apporter de la nuance à cette lutte, sinon elle brisera la confiance entre les hommes et les femmes.» Valérie Dréville, comédienne Les plus jeunes générations, au fait des nouvelles luttes féministes centrées sur les violences sexistes, parlent de « culture du viol », quand d’autres, portées par le mouvement de libération sexuelle des années 1960-1970, sont plus mesurées. Jusqu’ici, à la Comédie-Française, où s’applique d’abord le droit du travail, aucune sanction disciplinaire ne peut être prise contre un pensionnaire avant l’aboutissement judiciaire. Dans une maison où se côtoient presque quatre générations, le débat est vif, semble-t-il, autour de cette révolution qui veut que « la peur change de camp ». Comme dans tout le milieu théâtral. Judith Henry, 53 ans, raconte pourtant avoir trouvé refuge au théâtre à la fin des années 1990, en ralentissant des tournages de cinéma, commencés très jeune, où elle s’était sentie « comme une proie ». Alors qu’elle n’a rien dit au moment de #MeTooCinéma, la comédienne a choisi de parler aujourd’hui pour soutenir les lanceuses d’alerte du théâtre. Car il n’est pas si simple, selon elle, de témoigner sur de tels sujets. Comme du chantage sexuel, par exemple, imposé par certains hommes aux manettes : des « si tu couches pas, t’as rien », lancés par un metteur en scène à une interprète ou par un directeur de théâtre à une metteuse en scène en quête de financement. Les témoins sont unanimes : « En parler provoque la honte et expose, parfois, à des représailles durables. » Souvent rouée de vrais coups Autrice-metteuse en scène dont les premiers spectacles évoquaient, dès 2011, la cause des femmes, Pauline Bureau, 41 ans, sait pourquoi elle n’est plus comédienne. Peu avant de passer à l’écriture, elle avait joué le rôle d’une jeune fille piégée par deux proxénètes. Les seins souvent à l’air, seule face à une équipe entièrement masculine et à un metteur en scène bien plus âgé, elle se retrouvait souvent rouée de vrais coups. « Je me suis battue sur l’échancrure de la culotte, ai refusé dans une scène de la retirer, signalé à l’acteur qu’il m’avait plusieurs fois démis l’épaule. Celui-ci en était désolé, mais ça recommençait : la violence n’était pas cadrée. Quand on est jeune, on ne sait rien. J’ai appelé, en larmes, une actrice expérimentée. Sur ses conseils, j’ai alerté l’équipe, personne ne m’a entendue. » La violence faite aux femmes dans le milieu théâtral est-elle à ce point « systémique » ? « Oui ! Sur fond de patriarcat, le milieu était aveugle. » La metteuse en scène Pauline Bayle, 35 ans, qui prendra en janvier la direction du centre dramatique national de Montreuil, pense de son côté que le changement est déjà à l’œuvre « car le système pyramidal qui affirmait la domination du metteur en scène s’est affaibli grâce à l’arrivée des collectifs et des femmes », mais il se fera en profondeur « lorsque la justice elle-même sera réformée, et mettra fin au cycle de violences sexuelles et sexistes au sein de la société ». La pression (y compris homosexuelle) peut venir, d’ailleurs, de tous sur les plateaux : acteurs, techniciens, producteurs… Toujours les mêmes affaires En attendant, la discussion tourne toujours autour des mêmes affaires : Guillaume Dujardin, metteur en scène et ancien professeur à l’université de Franche-Comté, condamné en appel pour harcèlement, agression et chantage sexuels à quatre ans de prison, dont deux ferme ; Michel Didym, ex-directeur du centre dramatique national de Nancy soupçonné de viol, objet d’une enquête diligentée par le procureur ; entaché par une accusation de viol classée sans suite, le metteur en scène Jean-Pierre Baro, qui a démissionné, en décembre 2019, de la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry sous la pression des activistes. On ne connaît pas avec précision l’ampleur des agressions. Depuis juillet 2020, le ministère de la Culture a tout de même fait quatre signalements à la justice dans le secteur public (concernant Michel Didym, notamment)… Dans le théâtre privé, rien n’est encore sorti. À la cellule d’écoute psychologique et juridique ouverte en juin 2020 par la Fesac (Fédération des employeurs du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma), soutenue par l’État et opérée par la mutuelle Audiens, on reste prudent. En quinze mois, une centaine d’appels ont été reçus, concernant cinéma et théâtre à égalité, pour des faits anciens ou récents, qualifiables ou pas. Pas négligeable, selon la cellule, si l’on compare avec d’autres secteurs. Néanmoins, #MeTooThéâtre n’a pas provoqué de vague : « Les plaignantes réfléchissent longuement avant d’appeler. On en verra les effets avec le temps.» Le plan de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels lancé par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, en novembre, les confortera sans doute : référent et formation obligatoire dans toutes les structures subventionnées, théâtres ou compagnies. En 2022, le respect d’un tel dispositif sera la condition d’accès aux subventions publiques, comme c’est le cas désormais dans le cinéma. Pour les scènes de nudité ou à caractère sexuel, une médiation sera nécessaire dès le début des projets. La violence envers les femmes est-elle systémique ? « Oui ! Sur fond de patriarcat, le milieu était aveugle.» Pauline Bureau, autrice, metteuse en scène Y a-t-il un risque artistique à encadrer ainsi la création ? Les trentenaires répondent qu’il n’y a « aucun danger à se sentir en sécurité pour créer ! ». Pourtant, beaucoup d’artistes s’affolent en off des « oukazes moralistes » postés sur Instagram. Coraly Zahonero, sociétaire de la Comédie-Française, vingt-sept ans de maison, assume son désarroi. Si elle admire ces éclaireuses « qui, enfin, inversent le focus et parlent du consentement des femmes et non plus du désir des hommes », elle se méfie aussi « de la face obscure du mouvement ». Il faut prendre garde, selon elle, à ce que la parole des femmes ne se transforme « en censure ». Quand la première de Mère, de Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre national de la Colline, est menacée parce qu’il invite Bertrand Cantat (condamné pour les coups mortels portés à sa compagne Marie Trintignant) à créer la bande-son de son nouveau spectacle, elle désapprouve : « Quelles que soient nos opinions personnelles, la justice est passée. Le choix de Mouawad est cohérent avec son œuvre et celui-ci doit être respecté. » Ce jour-là, la Colline a évité de peu le blocage par une vingtaine d’activistes traitant le public de « complice » et réclamant le retrait du spectacle de son directeur comme de celui de Jean-Pierre Baro, programmé dans la saison. « Depuis le début, on ne voulait pas se faire “rattraper” par l’affaire Cantat de peur que cet autre sujet n’éclipse tout le reste, se désole l’autrice-metteuse en scène Julie Ménard, 37 ans, cofondatrice de #MeTooThéâtre. Nous n’avons pas appelé au boycott et nous n’y étions pas ce soir-là, mais un hashtag appartient à tout le monde. C’est incontrôlable : s’y exprime qui veut. On aurait peut-être dû choisir un autre nom… Car nous voulons à tout prix faire avancer la cause. » Sauf que, le matin même, sur Twitter, Marie Coquille-Chambel avait d’avance fustigé les journalistes susceptibles de couvrir la première. Le soir même, elle était devant le théâtre. En son nom propre ? Vers une scission dans le milieu ? Fondatrice de collectif théâtral devenue directrice du TGP de Saint-Denis, Julie Deliquet, 41 ans, craint avec tristesse une scission dans le milieu : « La division se dessine à propos du “moment d’après”, quand la justice ne peut pas passer, faute d’éléments suffisants, et que la rumeur continue en sous-main. Que fait-on alors ? De mon point de vue, il ne faut pas laisser retomber la pression, alors s’il ne s’agit pas d’interdire, les inquiétudes doivent pouvoir s’exprimer. » « On est sur un bateau qui tangue », confie à son tour la comédienne Valérie Dréville, 59 ans, qui a travaillé avec les plus grands du théâtre français. Elle ne voudrait pas que la colère exacerbée s’installe : « Apporter de la nuance à cette lutte est nécessaire, sinon elle brisera la confiance entre les hommes et les femmes. Ce serait grave, surtout pour les jeunes, et d’autant plus paradoxal que le théâtre est, par définition, l’endroit où l’on dépasse les questions de genre. C’est sur scène que je me sens le moins « femme » tel que la société le définit. Car j’y convoque à la fois ma féminité, ma masculinité et mon « neutre »… pour approcher de ma simple humanité. » Cellule d’écoute psychologique et juridique : 01 87 20 30 90.
violences-sexuelles-culture@audiens.org Emmanuelle Bouchez / Télérama Dans le même numéro de Télérama : Après #MeTooThéâtre, les femmes ont encore du pain sur les planches Enquête de Sophie Rahal

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
November 18, 2021 11:45 AM
|
Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks 17/11/2021 L’autrice, performeuse et metteuse en scène signe un spectacle ébouriffant pour déconstruire le regard porté sur les femmes noires en France. Drôle, énervée et intelligente, son écriture théâtrale est aussi singulière que jubilatoire. Dans des cas comme ceux-ci, il est inutile d’y aller par quatre chemins : l’émotion s’impose avant toute tentative d’analyse. Carte Noire nommée désir de Rébecca Chaillon est l’une des pièces les plus puissantes, les plus inventives et les plus brillantes qu’il nous ait été donné de voir depuis… On ne sait plus très bien combien de temps d’ailleurs… Impossible de ne pas sortir de là sonné par ces moments de théâtre lumineux, réjouit par l’humour punk et bravache de ses huit interprètes et, on l’espère aussi, un peu mieux armé pour réfléchir à la condition des femmes noires en France et essayer de déconstruire notre regard porté sur celles-ci. Avant même de rentrer dans la salle, Rébecca Chaillon et les siennes déstabilisent. Dans le hall du théâtre, un message est adressé aux spectateur·ices. La scène, nous explique-t-on, est construite selon un dispositif dit “bi-frontal”. De part et d’autre du plateau, deux gradins se font face. À droite, les fauteuils sont exclusivement réservés aux femmes noires, métisses et afrodescendantes ; le reste du public est invité à prendre place à gauche. Jamais nous n’avions vu une telle séparation selon des critères de couleurs de peau, et, en toute franchise, il nous aura fallu une bonne demi-heure pour comprendre la pertinence de ce dispositif. Mais ici, cette non-mixité permet d’appréhender la réaction au même spectacle de “l’autre” public dans les gradins sur la question du racisme, entre autres. Et la rencontre a bien lieu. Scène mémorable La scène d’ouverture est à la fois effroyable et sublime. Une femme noire nettoie le sol avec une éponge ; triste spectacle d’un corps martyrisé. Elle est en culotte, à quatre pattes, sa forte taille rend son travail d’autant plus pénible et humiliant. On peut même sentir l’odeur âcre d’eau de Javel dans le public. Et rapidement, ses mouvements vont se détraquer. Elle se met à passer l’éponge sur sa peau, frénétiquement. Jusqu’à l’intervention d’une deuxième comédienne qui la prend dans ses bras, l’assoit sur un tabouret et se met à natter ses cheveux, lentement, patiemment, avec des cordelettes accrochées sur une structure en haut du plateau. S’en suit une dizaine de scènes survoltées où les effets et les émotions se bousculent. On hurle de rire devant le détournement de la publicité pour Carte noire où l’érotisation grotesque des corps de femmes noires est poussée à l’extrême. On est gênés de se retrouver dans les portraits d’employeurs bobo, plus ou moins “cool”, quand ils s’adressent à Fatou, l’assistante maternelle surmenée. On est sidérés à la lecture des petites annonces véridiques d’hommes de plus de soixante ans qui tentent de faire venir chez eux des “Africaines” pour qu’elles se partagent entre l’amour et le ménage. On participe, avec le reste du public, au jeu de mimes visant à deviner des personnalités de femmes noires connues. On s’amuse devant les chorégraphies des neuf comédiennes qui commencent avec des twerks hyper sexuels et se déglinguent comme les mouvements d’un automate abîmé. Et petit à petit, on assiste à ces corps se débattant face aux injonctions contradictoires et aux stéréotypes qui les assignent ; femmes inquiétantes mais désirables, femmes sauvages mais dominées, femmes respectables mais infantilisées… Et de bout en bout, le dosage entre le rire, l’effroi, la colère et la connivence provoqués est toujours juste. À la fin du spectacle, au fil d’une scène mémorable que nous ne dévoilerons pas, le corps de Rébecca Chaillon réapparaît, en écho avec la scène d’ouverture, mais cette fois magnifiquement libéré. Chapeau. Carte noire nommée désir, de Rébecca Chaillon, avec BeBe., Estelle Borel, Rébecca Chaillon, Aurore Déon, Maëva Husband en alternance avec Olivia Mabounga, Ophélie Mac, Makeda Monnet, Fatou Siby. Du 18 au 20 novembre 2021, à L’Aire Libre, dans le cadre du festival TNB, à Rennes. Du 1er au 4 décembre 2021, au Théâtre Dijon Bourgogne, à Dijon. Du 9 au 11 décembre 2021, au Maillon, au Théâtre de Strasbourg, à Strasbourg. Le 16 janvier 2022, à La Maison Folie Wazemmes, dans le cadre du festival DIRE, à Villeneuve-d’Ascq. Du 2 au 4 février 2022, à la Comédie de Saint-Etienne, à Saint-Etienne. Les 21 et 22 février 2022, au Carreau du Temple, à Paris. Le 25 février, au Phénix, Scène Nationale de Valenciennes. Le 1er mars 2022, à la Scène nationale d’Orléans, à Orléans. Du 9 au 11 mars 2022, aux Subs, à Lyon. Le 24 mars 2022, à La Maison de la Culture d’Amiens, à Amiens. Le 22 et 23 avril 2022, à Fort-de-France, au Tropique Atrium, en Martinique. Igor Hansen Love / Les Inrocks Légende photo : “Carte Noire Nommée Désir“ de Rébecca Chaillon @ Vincent Zobler

|
Scooped by
Le spectateur de Belleville
October 31, 2021 6:23 PM
|
Par Cassandre Leray dans Libération le 29 octobre 2021 Depuis juin 2020, le groupe Audiens accompagne les victimes de violences sexistes et sexuelles dans la culture, soit bien avant l’émergence de #MeTooThéâtre. Des militantes dénoncent le manque de communication et d’implication du ministère. Des années ont beau s’être écoulées depuis l’explosion du mouvement #MeToo, la même question se pose après chaque scandale : que faire une fois la parole libérée ? Les militantes du collectif #MeTooThéâtre, qui a vu le jour le 7 octobre, le martèlent : elles ne veulent pas s’arrêter au recueil de témoignages. Le constat a déjà trop été fait, et ce dans chaque branche de la culture. Elles attendent des actions concrètes, à commencer par une véritable prise en compte de la parole des victimes. «Il faut que l’on sache vers qui se tourner quand on subit des violences», insiste Marie Coquille-Chambel, membre du collectif. Depuis un peu plus d’un an, Audiens, le groupe de protection sociale du monde de la culture, de la communication et des médias, tente justement de répondre à cette attente. Créée en juin 2020, une cellule dédiée aux professionnels du spectacle vivant et enregistré, mais aussi du jeu vidéo, vise à recueillir les témoignages des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le secteur (1). «Notre rôle, c’est d’accueillir la parole des victimes et de les aider à déposer plainte si elles le souhaitent», explique Carla Ballivian, pilote de la cellule. «Le secteur n’accepte plus l’impunité» Concrètement, les personnes qui appellent sont orientées soit vers un accompagnement psychologique, soit vers une assistance juridique – ou les deux – en fonction de leurs souhaits. Mise en place à l’initiative des partenaires sociaux du monde de la culture, la cellule s’adresse aussi bien aux intermittents qu’aux salariés en poste fixe, et la confidentialité est garantie. Pour Carla Ballivian, ce travail a avant tout pour but d’envoyer un message clair : «Le secteur n’accepte plus l’impunité.» A l’autre bout du fil, les professionnels à l’écoute disposent quant à eux d’une «connaissance solide du secteur de la culture» absolument indispensable, selon la pilote de la cellule. Car le monde culturel, de par sa structure, enferme bien souvent les victimes dans le silence. Entre «l’importance du réseau» pour trouver du boulot et la notoriété dont jouissent certaines personnes mises en cause, difficile, voire impossible de témoigner : «C’est un milieu dans lequel tout se sait, alors les victimes ont peur d’être stigmatisées et de ne plus pouvoir travailler si elles parlent», relève Carla Ballivian. Pas de communication du ministère Depuis son lancement, la cellule a reçu environ 115 appels, dont 53 % pour dénoncer «des actes ou des agressions physiques», précise Carla Ballivian. Des chiffres loin de coller à l’ampleur des violences dans le secteur culturel, que ce soit dans le cinéma, la musique ou le théâtre. Il faut dire que le ministère, qui finance pourtant le dispositif à hauteur de 250 000 euros, ne «communique absolument pas à ce sujet. Il y a encore énormément de personnes qui ne savent même pas que ce numéro existe malgré son importance», regrette Marie Coquille-Chambel. D’ailleurs, «le ministère n’a pas fait de communiqué de presse» au lancement de la cellule, abonde Carla Ballivian. Et «pas un seul non plus depuis le #MeTooThéâtre, alors que c’était l’occasion de rappeler l’existence de cet outil», reprend la membre du collectif. Aline César, copilote du groupe «Egalité Diversité» du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) : «[La cellule] permet de sortir les victimes de l’isolement, de la culpabilité, et de qualifier les faits. Mais ce n’est pas suffisant», affirme-t-elle, pointant le manque d’implication du ministère. En effet, les informations recueillies par la cellule ne sont pas transmises au cabinet de Roselyne Bachelot. Si pour Carla Ballivian, «les victimes pourraient avoir peur de parler si le nom de la personne qu’elles accusent était remonté au ministère», selon Aline Cesar, c’est justement là que ça coince. Puisque le ministère n’a pas connaissance des informations recueillies, «il leur est impossible de se saisir de ces affaires et de lancer des enquêtes internes ou des signalements», regrette-t-elle. Résultat : «Les mis en cause restent à des postes haut placés, et il ne se passe rien.» Selon la syndicaliste, une remontée et un recoupement devraient être systématiques afin d’éviter que le poids de la procédure pèse uniquement sur les épaules des victimes. Même discours du côté du collectif #MeTooThéâtre, qui soutient qu’il faut aller plus loin encore. «Il faut que des signalements soient faits, que le ministère communique sur cette cellule et renforce ses liens avec elle… énumère Marie Coquille-Chambel. Tout simplement qu’il y ait un positionnement fort du ministère de la Culture.» Aussi bien concernant les violences dans le théâtre que dans l’ensemble du secteur culturel, reprend la critique et militante : «Il est temps que la sphère politique s’empare de ces questions.» Malgré nos sollicitations, le ministère de la Culture n’a pour l’instant pas répondu à nos questions envoyées le… 12 septembre. (1) Stop violences sexistes et sexuelles : 01 87 20 30 90.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...