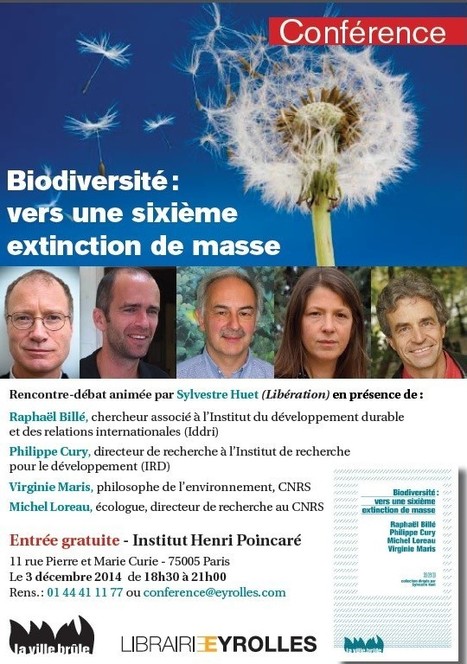Les aires protégées ne doivent pas faire oublier le rôle des 70 % restants de la surface terrestre dans la protection de la biodiversité.
Stéphanie Carrière, 01.02.2022
Directrice de recherche en écologie et ethnoécologie, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Paysages « bioculturels » et biodiversité
Dans la zone intertropicale, on observe notamment des « melting-pots » de biodiversité, des paysages agrosylvopastoraux façonnés par les agricultures familiales, tels que les agroforêts indonésiennes ou africaines, ou encore les paysages en terrasse rizicoles à Madagascar, qui aident les populations à vivre, à gagner un revenu et à entretenir une cohésion sociale grâce aux éléments ancestraux, culturellement importants qui sont maintenus dans les paysages.
Une immense majorité de ces paysages bioculturels issus des agricultures familiales facilitent en outre le maintien d’une grande diversité d’habitats écologiques et d’espèces fonctionnellement importantes – oiseaux et mammifères disperseurs de graines, insectes et chauves-souris pollinisateurs.
Cette biodiversité dite ordinaire n’en est pas moins fonctionnelle qu’une biodiversité emblématique comme celle que l’on peut retrouver dans une AP. De nombreuses études montrent que la biodiversité peut être remarquablement élevée dans ces paysages dès lors que les agriculteurs s’en sont fait les alliés pour produire leur alimentation et pour en tirer régulièrement des services (c’est le cas du système de culture-jachère).
Les paysages hétérogènes qui sont constitués d’une grande diversité de modes d’occupation du sol à petite échelle (prairies, forêts, mares, ruisseaux, rochers éboulis…), où la présence d’arbres est importante (haies, vergers, arbres isolés, bosquets, ripisylves), comptent une large variété d’habitats écologiques et donc de possibilité de vie et de reproduction pour la biodiversité.
Une reconnaissance mais peu de moyens
Or ces espaces non protégés, majoritaires sur la planète, sont aujourd’hui beaucoup moins bien dotés d’un point de vue des actions, des moyens humains et financiers pour conserver la biodiversité alors qu’ils incarnent nos espaces de production et de vie futurs.
Ils sont aussi porteurs de valeurs diverses (historiques, esthétiques, culturelles, patrimoniales) et c’est bien grâce aux pratiques humaines combinées aux processus écologiques qu’une partie de ces agricultures familiales, contribuent à la durabilité sociale, écologique et économique des paysages.
La reconnaissance de ces paysages bioculturels existe à travers la catégorie V et VI de l’Union internationale pour la conservation de la nature pour les AP mais elle reste très largement minoritaires dans la zone intertropicale.
______________________________
Aires protégées classées par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) :
- Catégorie UICN : Ia (Réserve naturelle intégrale)
- Catégorie UICN : Ib (Zone de nature sauvage)
- Catégorie UICN : II (Parc national)
- Catégorie UICN : III (Monument naturel)
- Catégorie UICN : IV (Aire de gestion des habitats/espèces)
- Catégorie UICN : V (Paysage terrestre/marin protégé)
- Catégorie UICN : VI (Zone de gestion de ressources protégées)
Aires protégées par catégorie UICN — Wikipédia



 Your new post is loading...
Your new post is loading...