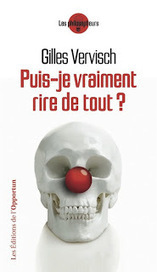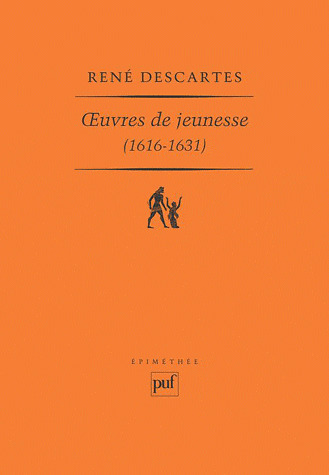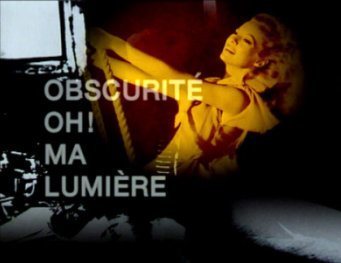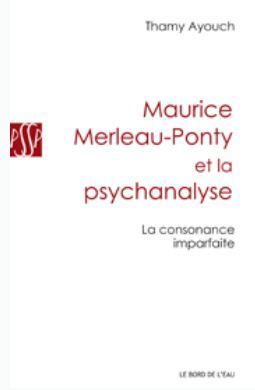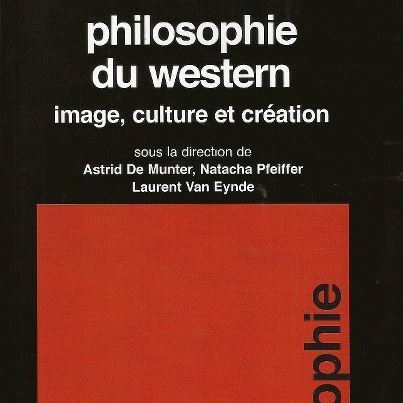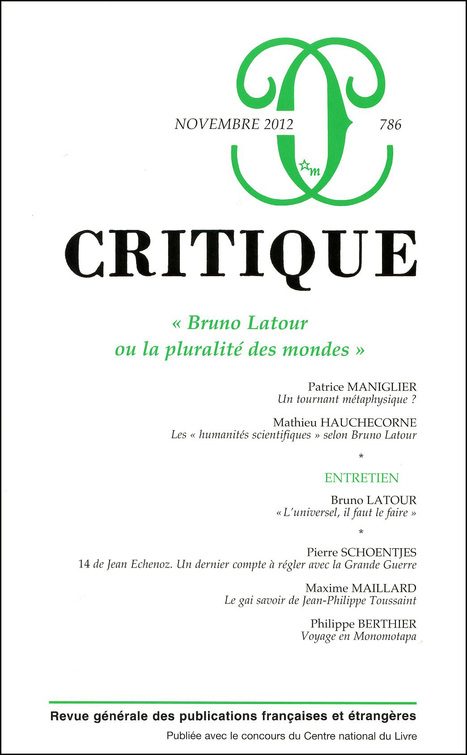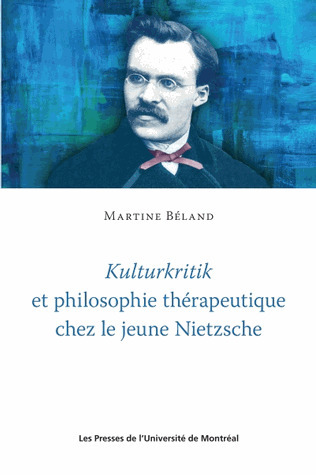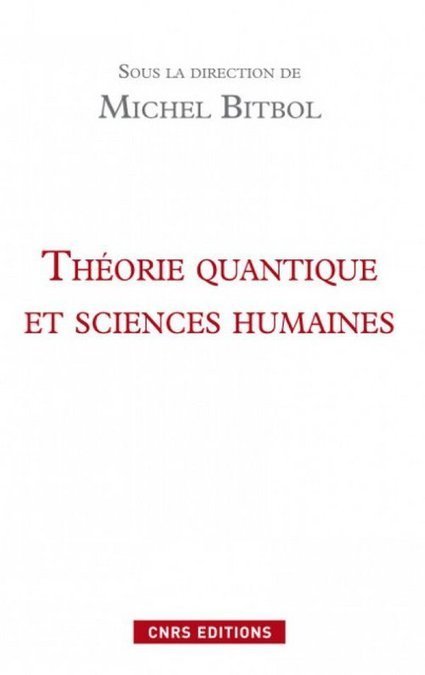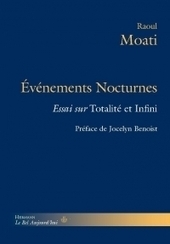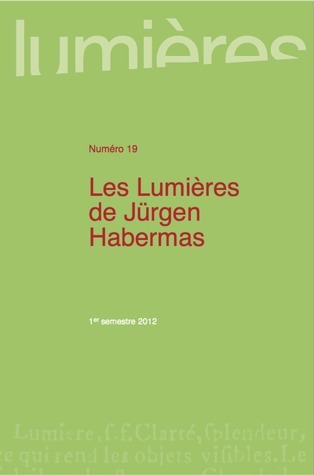Your new post is loading...
 Your new post is loading...

|
Scooped by
dm
January 13, 2013 10:53 AM
|
« Peut-on rire de tout ? La question revient souvent dès que les humoristes ou caricaturistes s’attaquent à des sujets dits “sensibles”, comme la religion, la maladie, etc. Les uns considèrent qu’il faudrait imposer des limites à l’humour au nom de la morale et même, au nom de la loi. Les autres mettent en avant la sacro-sainte liberté d’expression. Et pour trancher, on a l’habitude de citer Desproges : “On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde.” C’est sans doute qu’on considère toujours que le rire consiste à se moquer. Mais ne rit-on que des choses ridicules ? Le rire n’est-il pas sérieux ? Au fond, quels sentiments s’expriment dans le rire ? Pour savoir si on peut rire de tout, il faudrait donc commencer par se demander : qu’est-ce que le rire ? »

|
Scooped by
dm
January 6, 2013 6:12 PM
|
Anne Creissels et Giovanna Zapperi (dir.), Subjectivités, Pouvoir, Image. L’histoire de l’art travaillée par les rapports coloniaux et les différences sexuelles, Editions EuroPhilosophie 2012, ChampsArts&contreChamps - Ce livre rassemble des contributions issues du séminaire de recherche Acegami (Analyse culturelle et études de genre : art, mythes, images) du Centre d’Histoire et Théorie des Arts de l’EHESS. Les contributions proposent une approche critique de la production de sens et d’idéologie inhérente au champ artistique et envisagent l’histoire de l’art comme un domaine traversé par des rapports de force mais aussi par des subjectivités multiples.

|
Scooped by
dm
December 30, 2012 4:28 PM
|
René DESCARTES : Etude du bon sens - La recherche de la vérité et autres récits de jeunesse (1616-1631)
Il s’agit d’une édition de fragments (titres et extraits de traités entrepris ou simplement projetés) et de commencements d’œuvres de Descartes qui nous sont parvenus par des sources variées mais parfaitement fiables, et dont Descartes lui-même a fait mention à un moment ou à un autre dans sa Correspondance ou dans le Discours de la méthode, mais qui n’ont jamais été pris en considération pour eux-mêmes.
Nous avons réuni ces textes, nous les avons traduits quand ils étaient en latin ou en néerlandais – tout en plaçant les originaux en regard –, présentés, datés et annotés historiquement et philosophiquement. Nous insistons sur la Licence en droit (placard découvert en 1987), l’Étude du bon sens, dont nous restituons l’objet et l’ensemble des fragments non identifiés jusqu’ici, et La recherche de la vérité, pour la première fois traduite en français à partir de sa version néerlandaise et datée de façon sûre.
Ces textes ainsi réunis et datés présentent pour la première fois un Descartes inédit, travaillant en philosophe, et non seulement en savant, dans les deux décennies qui précèdent le Discours de la méthode. - PUF - Janvier 2012

|
Scooped by
dm
December 27, 2012 2:01 AM
|
Heidegger et les finisseurs - Raouf Sedghi
Les bruits de l'être (Heidegger, Derrida, Severino)
Alfonso Berardinelli
Derrida : l'arbitraire de la déconstruction - Roberto Giacomelli
Seul un dieu peut-il encore nous sauver ?
Javier Rodriguez Hidalgo
Un si petit monde : Heidegger et le milieu philosophico-littéraire français - Séverine Denieul

|
Scooped by
dm
December 24, 2012 2:00 AM
|
On connaît la problématique du cercle herméneutique : le tout n’est compréhensible qu’à partir du détail qui n’est compréhensible qu’à partir du tout. André Stanguennec cherche à tenir les deux exigences sans céder en rien sur la rigueur du détail ni sur le mouvement dialectique de la totalisation, à partir du sujet de l’action. Son oeuvre vise à se comprendre et à comprendre notre époque à travers ses totalisations éthiques, juridiques, politiques, esthétiques, scientifiques – et bien évidemment philosophiques. Or l’activité critique possède l’ambition de comprendre le discours tout d’abord aussi bien, puis mieux que son auteur. Ce livre cherche donc à présenter cette philosophie herméneutique et dialectique qui se veut totalement compréhensive ; et à la comprendre avec et contre son auteur. Il provient d’une journée d’étude, organisée en 2010 par J-M. Lardic et P. Billouet à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, sous la présidence de Bernard Bourgeois, Professeur émérite, (Paris I), Membre de l’Institut (Académie des sciences morales et politiques), en hommage à A. Stanguennec, Professeur émérite à l’Université de Nantes.

|
Scooped by
dm
December 10, 2012 5:44 PM
|
Ce livre développe, à partir de Merleau-Ponty, Henry et Sartre, une phénoménologie décrivant la vie perceptive du point de vue du désir d'éprouver qui s'y déploie. L'auteur interroge, selon différents chemins tout à la fois opposés et noués les uns aux autres, le rapport de la vie perceptive à l'imaginaire et à la théâtralité originaire du corps. Il montre comment chaque expérience perceptive est la mise en jeu d'un désir de vivre, comment elle est susceptible d'accroître ou d'affaiblir la capacité des individus à se laisser affecter en profondeur par leur situation, à l'endurer, à y ouvrir du possible. Ed. Peter Lang. Collection: Anthropologie et philosophie sociale - volume 5 - 2012

|
Scooped by
dm
December 9, 2012 6:16 PM
|
A prpos de : La question vidéo : entre cinéma et art contemporain
Auteur : Philippe Dubois Composé de quinze textes écrits entre 1981 et 2007, La question vidéo constitue une réflexion théorique d’ampleur, en mouvement, et quasiment "en direct", sur un des phénomènes d’images les plus marquants de notre époque : la vidéo. L’auteur le précise d’emblée : s’il existe une question vidéo, ce n’est pas au sens de la quête d’une impossible spécificité ontologique du médium ou de la nature de ses images. C’est, bien plutôt, parce que la vidéo constitue elle-même un processus de questionnement sur les images – sur toutes les images, quelles qu’elles soient.

|
Scooped by
dm
December 6, 2012 11:35 PM
|
Un étude visant à reconstituer le projet philosophique du jeune Nietzsche entre 1869 et 1876, qui nous donne l'occasion de relire des textes qui n'ont rien perdu de leur actualité. Auteur : Martine Béland
Éditeur : Les Presses de l'Université de Montréal
Date de publication : 04/12/12

|
Scooped by
dm
November 30, 2012 1:41 AM
|
Novembre 2012 - Stock - 20 € - Cet ouvrage analyse la dimension thérapeutique qui sous-tend l'ensemble de la Correspondance entre Descartes et la princesse Elisabeth, fille aînée du roi déchu Frédéric V de Bohême. Sur fond d'exil aux Pays-Bas, l'un pour se libérer de tout carcan social, l'autre à cause de la guerre de Trente Ans, Descartes et Elisabeth cherchent ensemble quelles réactions avoir face aux événements traumatiques de l'existence et comment se les approprier en tant que sujets. Descartes met en pratique sa théorie du «contentement», et dévoile à la princesse les secrets de son équilibre physique et psychique. Quant à Elisabeth, c'est une femme d'un grand courage. Sa sensibilité la pousse à une exigence intellectuelle accrue ; la princesse philosophe rencontre Descartes et lui demande de l'aider à guérir. Descartes lui permet de davantage accéder à elle-même, explicitant dans ses lettres non plus la notion de dualisme mais celle d'union de l'âme avec le corps.
Par leur honnêteté intellectuelle et le lien transférentiel qui s'établit, ils nous donnent accès à certains mécanismes des passions et abordent la complexité des liens intersubjectifs.
Elisabeth va conduire Descartes à élaborer sa théorie des passions en prenant appui sur le vécu, montrant dans quel registre penser le «vrai homme»; leur union épistolaire donnera naissance au traité des Passions de l'âme.

|
Scooped by
dm
November 25, 2012 5:24 PM
|
Sommaire du dernier numéro | APPEP

|
Scooped by
dm
November 18, 2012 5:06 PM
|
Aux mois d'avril et de mai 1981, Michel Foucault prononce un cours qu'il intitule Mal faire, dire vrai. Fonction de l'aveu en justice. Il y poursuit l'élaboration de la notion de gouvernement par la vérité, introduite en janvier 1979 dans La naissance de la biopolitique puis reprise en janvier 1980 dans Le gouvernement des vivants pour donner un contenu positif et différencié à la notion de savoir-pouvoir et opérer par rapport à celle d'idéologie dominante un second déplacement. Le cours est la trace d'un engagement militant : le fruit de l'alliance nouée avec des juristes radicaux, sous l'égide de l'École de criminologie de l'Université catholique de Louvain, à l'occasion d’un projet de révision du code pénal en vigueur en Belgique. Adressé à un public de juristes et de criminologues, il replace l’analyse du développement de l’aveu pénal dans l’histoire plus générale des technologies du sujet et examine diverses techniques par lesquelles l’individu est amené, soit par lui-même, soit avec l’aide ou sous la direction d’un autre, à se transformer et à modifier son rapport à soi. D’entrée de jeu, Michel Foucault annonce que le problème qui l’occupe a deux aspects. Politique : « savoir comment l’individu se trouve lié, et accepte de se lier au pouvoir qui s’exerce sur lui ». Philosophique : « savoir comment les sujets sont effectivement liés dans et par les formes de véridiction où ils s’engagent ».
Ainsi conçues, les leçons peuvent se lire comme une suite donnée à Surveiller et punir ou comme une première esquisse de l’analyse de la parrêsia et des formes alêthurgiques développée dans Le courage de la vérité. Avec le sujet avouant, ce n’est pas seulement le thème du dire vrai qui est introduit. Parce que les formes de véridiction ont partie liée avec l’assujettissement et la déprise de soi, c’est aussi la question de ce qui s’en déduit pour la philosophie critique – qu’en l’occurrence, Michel Foucault met en œuvre, à la croisée de l’activité pratique et de l’activité théorique, de la politique et de l’éthique. « On parle souvent de la récente domination de la science ou de l’uniformisation technique du monde moderne. Disons que c’est là la question du "positivisme", au sens comtien du terme, et peut-être vaudrait-il mieux associer à ce thème le nom de Saint-Simon. Je voudrais évoquer, pour y loger les analyses que je vous propose, un contre-positivisme qui n’est pas le contraire du positivisme, plutôt son contrepoint. Il se caractériserait par l’ étonnement devant la très ancienne multiplication et prolifération du dire vrai, la dispersion des régimes de véridiction dans des sociétés comme les nôtres." Cet ouvrage, coédité par les Presses universitaires de Louvain et University of Chicago Press, est le fruit d’une collaboration entre l’École de criminologie de l’Université catholique de Louvain et University of Chicago.

|
Scooped by
dm
November 11, 2012 1:01 AM
|
Thamy Ayouch, Maurice Merleau-Ponty et la psychanalyse. La consonance imparfaite
- C'est « par ce qu’elle sous-entend ou dévoile à sa limite – par son contenu latent ou in- conscient – que la phénoménologie est en consonance avec la psychanalyse », écrit Maurice Merleau-Ponty en 1960. Singulière euphonie entre deux disciplines habituellement opposées dans leurs définitions: l’une ne centre-t-elle pas ses recherches sur la conscience, et l’autre sur l’inconscient? Quelle serait donc cette harmonie entre phénoménologie et psychanalyse? Dans quel système tonal se définit-elle et quelles modulations connaît l’intervalle mélodique entre les deux? Philosophie de la forme, existentialisme, phénoménologie de la perception, de l’inapparent, puis philosophie de la chair, le parcours de Merleau-Ponty semble poser, de manière à chaque fois plus fine, la question d’une paradoxale phénoménologie de l’inconscient, aux doubles confins de la phénoménologie et de la psychanalyse. Pour autant, si la relecture merleau-pontyenne de la phénoménologie s’accompagne d’une lecture inédite de la psychanalyse, ce double remaniement ne manque pas de faire surgir bien des questions. L’examen, auquel invite cet ouvrage, des positions originales de Merleau-Ponty permet de mesurer l’incontestable rapprochement esquissé avec l’oeuvre de Freud. Toutefois, les réponses que J. B Pontalis, A. Green, J. lacan et C. Castoriadis font à cet appel pointent les limites d’une lecture résolument philosophique de la psychanalyse, qui ne semble instaurer, entre les deux, qu’une cadence évitée. À l’issue de ce dialogue, nulle impression de repos, et la phrase musicale est relancée sur d’autres lignes harmoniques. Le Bord de l'Eau, coll. "Psychanalyse, Sciences Sociales et Politiques", 2012.

|
Scooped by
dm
November 8, 2012 4:59 PM
|
J.L.Déotte : Walter Benjamin et la forme plastique
Novembre 2012 / L'harmattan - W. Benjamin est un penseur essentiel de la technique comme déploiement de la nature, c’est la raison pour laquelle il abordera la photographie, la radio, et le cinéma sans complexes. Mais on doit distinguer chez lui deux époques de la technique et de la transmission, suivant le critère de l’événementialité : soit les choses n’ont lieu qu’une fois, c’est l’époque du don, de l’artisanat et des narrations. Ce qui arrive a de l’aura. Soit tout est reproductible, on peut toujours tout recommencer, c’est l’époque de l’industrie, de la masse et du jeu cinématographique, seules les traces comptent. Or, c’est grâce à la lecture de l’historien de l’architecture S. Giedion, en 1929, qu’il va découvrir l’architecture industrielle du XIXème siècle et ses prolongements modernes. Cette architecture apporte des solutions techniques nouvelles à des problèmes classiques parce qu’elle inaugure un autre mode de la forme. Jusqu’ici la forme avait été pensée sous la dépendance de ce qui la nomme, le modèle était théologique. Dorénavant, la forme technique (la forme plastique) résout une difficulté architectonique, mais en plus s’impose au monde de l’art et de la littérature. En effet, la forme plastique érige en principe le montage par éléments constructifs. Les éléments d’un hall d’exposition ou d’un pont métallique sont immédiatement saisissables, exposables. Transférer au monde du texte, cela implique qu’il n’y a pas à rechercher une vérité cachée. Il faut prendre les choses au pied de la lettre. Il en va de même pour la traduction. W.Benjamin a ainsi jeté les bases d’une esthétique topologique.
|

|
Scooped by
dm
January 9, 2013 12:07 PM
|
Philosophie du western. Image, culture et création
Le cinéma naît alors que l’épopée de l’Ouest touche à sa fin. En 1895, on déclare la fin de la Frontière et le cinéma prend la relève du mouvement de conquête. Les fondateurs de Hollywood ne manqueront pas de faire eux-mêmes le parallèle. Dès qu’il y eut cinéma aux États-Unis, il y eut western… Ce rapport de proximité entre l’époque et l’invention d’un nouveau mode de création nourrit une intimité sur laquelle fait fond le western classique américain. Au fil des contributions ici rassemblées, les angles d’approches se multiplient : esthétique, anthropologie philosophique, philosophie sociale et politique, philosophie de l’histoire, histoire de l’art et études cinématographiques. En mobilisant essentiellement des compétences et des références philosophiques, mais aussi les vertus de l’interdisciplinarité, ce collectif se propose de poser les jalons d’une étude approfondie de l’image westernienne en traitant les enjeux des limites et frontières, de la justice sans cesse réinterrogée, de l’étranger, du lointain, du vivre ensemble, de la persécution, de l’imaginaire culturel et social et de l’invention historique... Sous la direction de : Astrid De munter, Natacha Pfeiffer et Laurent Van Eynde, avec la collaboration de : Daniel Agacinski, Augustin Dumont, Franck Kausch, Florence Gravas, Laurent Jullier, Jean-Marc Leveratto, Philippe Sabot, Jean-Jacques Melloul et William Bourton
Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, Belgique

|
Scooped by
dm
December 30, 2012 4:42 PM
|
Critique n° 786 : Bruno Latour ou la pluralité des mondes
Bruno Latour est infatigable. De la fabrique des faits scientifiques ou des objets techniques à l'ethnopsychiatrie, en passant par la religion, le droit, la politique ou les récentes controverses sur le changement climatique, aucun domaine du savoir et des pratiques ne lui est étranger. Depuis plus d"un quart de siècle, son ambitieux programme d’une anthropologie des « Modernes » lui fait parcourir dans toute son extension le « plurivers » où l’humanité invente son destin - monde bigarré, plein de hiatus, de malentendus et de controverses. En « diplomate » attentif à la pluralité réelle des intérêts, des valeurs, mais aussi des modes d’existence, il ne se contente pas de décrire les points de tension ; il entend les traiter en convoquant à la table des négociations le savant et le schizophrène, l’économiste et le militant écologiste, et pourquoi pas les non-humains avec les humains. C’est du moins ce qu’annonce sa vaste Enquête sur les modes d’existence, tout récemment parue. Le dossier que nous lui consacrons en cerne les enjeux aux confins de l’anthropologie et de la métaphysique, avec des articles de Mathieu Hauchecorne et de Patrice Maniglier, complétés par un entretien inédit avec Bruno Latour.

|
Scooped by
dm
December 30, 2012 4:15 PM
|
Kulturkritik et philosophie thérapeutique chez le jeune Nietzsche, par Martine BÉLAN
Dans la Grèce ancienne, on considérait la philosophie comme un remède aux maux de l'âme, comme une thérapeutique permettant à l'individu d'atteindre l'indépendance et la tranquillité d'esprit par la connaissance de soi. Il n'est pas étonnant de retrouver des échos de cette pensée sous la plume du jeune philologue Friedrich Nietzsche. Dans ses premiers écrits, Nietzsche, alors professeur à l'Université de Bâle, donne à cette préoccupation thérapeutique la forme de la Kulturkritik : le philosophe est un médecin qui lutte contre la maladie de la civilisation, en s'en prenant à la fois aux causes et aux manifestations du mal. Cette entreprise l'amène à critiquer les postures caractéristiques du moderne : l'optimisme théorique, l'esprit scientifique, le relativisme historique, l'esthétique de l'imitation, la dignité accordée au travail. /// Les presses de l'université de Montréal - octobre 2012

|
Scooped by
dm
December 24, 2012 2:06 AM
|
Pour Orwell, « le concept de vérité objective est celui de quelque chose qui existe en dehors de nous, quelque chose qui est à découvrir et non qu’on peut fabriquer selon les besoins du moment ». Le plus effrayant dans le totalitarisme n’est pas qu’il commette des « atrocités » mais qu’il s’attaque à ce concept. Pourtant, cette perspective d’un monde d’où l’idée de vérité objective aurait disparu n’effraie guère la plupart des intellectuels de gauche. Qu’ils se réclament de Rorty le « libéral » ou de Foucault le « subversif », ils y travaillent activement en proclamant que ces idées sont dépassées, dogmatiques et finalement réactionnaires.
Cet essai montre que « préservation de la liberté et préservation de la vérité représentent une seule et indivisible tâche, commune à la littérature et à la politique ». Celle-ci ne présuppose aucun postulat métaphysique mais seulement la reconnaissance du rôle fondamental que joue dans nos vies le concept commun et ordinaire de « vérité ».
De tels débats ne sont pas « purement philosophiques ». O’Brien, le dirigeant politique qui torture méthodiquement le héros de 1984, n’est pas un colonel parachutiste mais un philosophe cultivé, ironiste et courtois, professant qu’il n’y a pas de réalité objective et que « tout est construit ».Click here to edit the title
Théorie quantique et sciences humaines est un recueil de huit articles réalisé sous la direction de Michel Bitbol. D’emblée, signalons qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage traitant des conséquences philosophiques de certains résultats de la physique quantique comme par exemple les extrapolations d’ordre psychologique de Wigner à propos de la réduction du paquet d’ondes [1], mais l’intention de ce livre est plutôt de suggérer une identité de méthode entre la mécanique quantique et les sciences humaines et plus particulièrement les théories de la décision.
Via Plasticities Sciences Arts

|
Scooped by
dm
December 10, 2012 5:30 PM
|
Préface de Jocelyn Benoist - Ed. Hermann - 2012 PRÉSENTATION :
L’Idée de l’Infini a été découverte par Descartes dans les Méditations métaphysiques. Il restait après Descartes à élucider la signification de cette Idée éminente par la concrétisation de son contenu. L’expérience vécue qui articule concrètement le développement de l’Idée de l’Infini est la socialité. En elle, la présence de l’être transcende l’horizon limitatif de la découverte intellective - de la compréhension ou constitution de l’être à partir de sa mise en lumière.
L’Idée de l’Infini révèle ainsi une dimension irréductible de l’être, proprement nocturne, échappant à l’ontologie qui gouverne la philosophie occidentale. Le débordement de l’être sur l’ontologie coïncide sans reste avec l’éthique. Il annonce la venue dans l’être de la paix messianique par-delà l’ontologie de la guerre et les illusions de la morale.
Nous interrogeons dans le présent essai en suivant Levinas en son chef-d’œuvre de 1961, Totalité et Infini, le sens de cette présence éminente de l’être en ses événements ultimes - essentiellement nocturnes.
La sensibilité, la socialité, l’éros et la fécondité sont autant d’événements paroxystiques de l’être dont la production échappe à la lumière de l’ontologie. C’est à l’élucidation de cette dimension essentiellement clandestine de l’être qu’est consacré, dans la continuité de Levinas, le présent essai.

|
Scooped by
dm
December 9, 2012 6:07 PM
|
Maître Eckhart n’est resté connu d’un grand nombre de lecteurs qu’à travers ses Sermons allemands. Aujourd’hui, Jean Devriendt, théologien, latiniste et philosophe nous montre que l’apport de L’Œuvre latine est considérable à la compréhension de sa pensée [1]. Car si l’on en reste aux pièces allemandes, on risque de « verser dans le contresens ou la caricature ». (p. 17). On comprend alors toute l’importance du travail de Jean Devriendt : sa traduction représente un apport considérable pour la recherche.

|
Scooped by
dm
December 1, 2012 5:56 PM
|
Novembre 2012 - l'Harmattan - Au travers de parcours à la fois méthodologiques et historiques, cet ouvrage cherche à témoigner du destin de la pensée hégélienne en France, de la fin du XIXe siècle jusqu'à l'après-guerre. Ce livre tente de former une « phénoménologie de la réception » en décrivant l'itinéraire d'une oeuvre, le parcours d'une pensée, les modes de circulations des idées hégéliennes et de leur perception, souvent contradictoires.

|
Scooped by
dm
November 26, 2012 5:17 PM
|
Edmund Husserl (1859-1938) a fondé une discipline nouvelle, la phénoménologie, où il développe une analyse descriptive des actes de la conscience intentionnelle (perception, imagination, souvenir, conscience d' autrui, etc.).
Avec le premier livre des Idées directrices pour une phénoménologie pure et une philosophie phénoménologique (1913), Husserl définit la phénoménologie transcendantale comme « science des phénomènes ». Il expose la méthodologie de la pratique phénoménologique et conçoit un ambitieux programme de recherche : la description des actes de conscience doit permettre de révéler les structures essentielles de la subjectivité transcendantale. Ce faisant, Husserl ne crée pas seulement une nouvelle discipline philosophique. Il ouvre aussi la voie à une ambitieuse « refondation » des sciences empiriques et réaffirme la nécessité d 'un certain rationalisme, tout à la fois théorique et éthique. Cet ouvrage explicite et interroge ce projet d 'une « science des phénomènes », en examinant un à un chacun des paragraphes des Idées directrices. Commentaire de cette oeuvre majeure, il constitue aussi une introduction à l 'oeuvre d' Edmund Husserl et à la phénoménologie elle-même.

|
Scooped by
dm
November 19, 2012 6:09 AM
|
(Galilée - 2012 --
Le présent volume édite la première des deux années du séminaire que Jacques Derrida consacra au sujet de la peine de mort (en 1999-2000 et 2000-2001). Présenté intégralement dans le cadre du programme « Philosophie et épistémologie » à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris, ce séminaire a aussi fait l’objet d’un enseignement aux États-Unis. Il précède immédiatement celui consacré à « La bête et le souverain » (2001-2003), déjà publié. Il relève de l’ensemble commencé en 1997-1998 sous le titre « Le parjure et le pardon », qui appartient lui-même à un ensemble plus long, « Questions de responsabilité », initié en 1989 et finalisé en 2003 avec la dernière année d’enseignement de Jacques Derrida.Voici le résumé qu’en donnait Jacques Derrida dans l’Annuaire de l’ehess 1999-2000 : "La problématique engagée sous ce titre < « Le parjure et le pardon » > au cours des deux années passées nous a conduits à privilégier cette fois la grande question de la peine de mort. C’était nécessaire au moins dans la mesure où la peine dite capitale met en jeu, dans l’imminence d’une sanction irréversible, avec ce qui paraît tenu pour l’impardonnable, les concepts de souveraineté (de l’État ou du chef d’État – droit de vie et de mort sur le citoyen – ), de droit de grâce, etc. Nous avons étudié la peine de mort, de façon au moins préliminaire, aussi bien à partir de grands exemples paradigmatiques (Socrate, Jésus, Hallâj, Jeanne d’Arc) que de textes canoniques, de la Bible à Camus ou à Badinter, en passant par Beccaria, Locke, Kant, Hugo – à qui nous avons consacré de nombreuses séances –, Genet, etc., et surtout de textes juridiques d’après la Seconde Guerre mondiale. Un grand nombre de conventions internationales recommandent en effet la fin des châtiments cruels et des tortures, dont la peine de mort, sans jamais en faire obligation aux États dont la souveraineté devait être respectée. Nous nous sommes intéressés aux mouvements abolitionnistes, à leur logique et à leur rhétorique, et surtout aux Etats-Unis dont l’histoire récente, voire très actuelle, a requis de nombreuses analyses – notamment depuis la décision de la Cour suprême qui, en 1972, jugea inconstitutionnelle l’application de la peine de mort (« cruel and unusual punishment »), jusqu’à la reprise amplifiée et spectaculaire des exécutions depuis 1977, etc. Nous avons accordé beaucoup d’attention à l’exception des États-Unis. Trois concepts problématiques ont dominé notre questionnement à travers les textes et les exemples étudiés : la souveraineté, l’exception et la cruauté. Autre question conductrice : pourquoi l’abolitionnisme ou la condamnation de la peine de mort, dans son principe même, n’ont-ils (presque) jamais, à ce jour, trouvé une place proprement philosophique dans l’architectonique d’un grand discours philosophique en tant que tel ? Comment interpréter ce fait hautement signifiant ?"

|
Scooped by
dm
November 16, 2012 12:51 PM
|
La perspective adoptée par Incidence à la suite des travaux de l’égyptologue allemand Jan Assmann consiste à aborder Moïse non pas comme une figure de l’histoire, mais comme une figure de la mémoire. Moïse y est le nom d’un complexe de souvenirs, déformés dans les textes, refoulés dans les marges de la culture, mais qui reviennent hanter la mémoire de l’Occident et qui parcourent toute l’histoire de sa philosophie politique. Si l’on accepte cette hypothèse, il devient possible d’affronter l’énigme de l’institution d’un peuple, étranger au monde, sans terre et sans chef, soumis à d’antiques persécutions, qui a su pourtant se maintenir dans l’histoire par la seule force de ses lois. S’intéresser aux figures de Moïse, c’est donc, par un travail singulier de lecture, se rendre attentifs à la dimension inconsciente de notre tradition théologico-politique.

|
Scooped by
dm
November 8, 2012 5:51 PM
|
Le dialogue avec les Lumières est un fil conducteur dans l'ensemble de la philosophie de Jürgen Habermas et représente selon lui un outil opératoire pour s'opposer aux « nouvelles mythologies » et à une « société anonyme sans sujet ». Si l’on reconnaît encore aujourd’hui que Habermas est resté fidèle au projet d’émancipation des Lumières, historiens comme philosophes ont tendance à mettre l’accent sur les déficits historiographiques de sa lecture des Lumières et sur les incohérences de la théorie institutionnelle qu’il en tire. Il est par conséquent opportun de dresser un bilan de la manière dont Habermas conçoit cette entreprise intellectuelle et dont il s’inscrit dans le sillage de cette démarche pour la poursuivre voire la renouveler.
Le retour sur les Lumières de Jürgen Habermas que les contributions rassemblées dans ce numéro de Lumières proposent comprend deux volets complémentaires : un examen critique de la lecture qu’il fait de certains auteurs essentiels des Lumières et une mise en perspective de la philosophie politique de Habermas sous l’angle des rapports de continuité et de rupture qu’elle entretient avec le projet d’émancipation du XVIIIe siècle. Cela constitue à la fois une réflexion sur le devenir des Lumières, sur leur impact dans la société contemporaine, et un éclairage inédit en France sur les enjeux actuels de la pensée philosophique allemande.
|



 Your new post is loading...
Your new post is loading...